«Il famoso detto: “l’economia è il nostro destino” è il triste segno di un’epoca, purtroppo, non ancora interamente tramontata. Palese falsità in ogni periodo di storia e di civiltà normale, questo principio è divenuto vero dopo che l’uomo ha distrutto l’uno dopo l’altro tutti i valori tradizionali e tutti i punti superiori di riferimento, che prima presiedevano alle sue decisioni e alle sue azioni»
(J. Evola, Saggi di dottrina politica)
All’indomani dell’attentato alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo di Parigi, nel gennaio dello scorso anno, tra le vittime mi colpì la presenza di un nome che già mi era familiare da molti anni: quello di Bernard Maris.
Bernard, già consigliere della Banca di Francia, docente universitario a Parigi, giornalista ed economista, fu molto critico con gli economisti e l’economia moderna. Non certo l’unico ad esserlo, ma la sua modalità fu piuttosto efficace ed incisiva.
«Si ha voglia di capire. Perché questa scienza economica – partita da tanto in alto, dalla filosofia e dalla logica, da Ricardo, da Marshall, nell’epoca in cui questi ne facevano pazientemente una scienza autonoma a Cambridge con il sostegno del logico Sidgwick, e supplicava Keynes, di cui presagiva la genialità, di fare una tesi in economia e non in matematica (e Keynes le fece entrambe) – è decaduta a cagnara di refettorio, con qualche sorvegliante che urla più forte, come se la fisica dei Foucault si fosse abbassata al rango delle ciance delle astrologhe che predicono il futuro con un pendolino» (1).
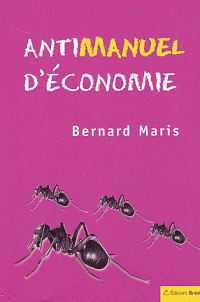 Bernard non le mandava di certo a dire: «E voi, gente dei numeri…Agitatori di nacchere statistiche, che maneggiate somme sbalorditive, che fate giochi di destrezza con i tassi, illusionisti dei miliardi di dollari e della disoccupazione ridefinita venticinque volte in vent’anni come in Inghilterra (ha finito col diminuire), che fate previsioni cercando il futuro con un ago nel buio e una candela nel pagliaio» (2). E ancora: «Voi, i «ricercatori» delle organizzazioni al soldo dei potenti, mai stanchi di leccar piedi, che risalite senza posa le rupe dei loro errori, poveri Sisifo dell’equazione…Voi consiglieri del Principe, chief economists, […] Sicari del rapporto raffazzonato ma che uccide […] interpreti dei pastrocchi econometrici e delle curve di numeri usciti direttamente dalla pancia dei computer […] Sacerdoti di una religione senza fede e senza legge se non quella della giungla» (3).
Bernard non le mandava di certo a dire: «E voi, gente dei numeri…Agitatori di nacchere statistiche, che maneggiate somme sbalorditive, che fate giochi di destrezza con i tassi, illusionisti dei miliardi di dollari e della disoccupazione ridefinita venticinque volte in vent’anni come in Inghilterra (ha finito col diminuire), che fate previsioni cercando il futuro con un ago nel buio e una candela nel pagliaio» (2). E ancora: «Voi, i «ricercatori» delle organizzazioni al soldo dei potenti, mai stanchi di leccar piedi, che risalite senza posa le rupe dei loro errori, poveri Sisifo dell’equazione…Voi consiglieri del Principe, chief economists, […] Sicari del rapporto raffazzonato ma che uccide […] interpreti dei pastrocchi econometrici e delle curve di numeri usciti direttamente dalla pancia dei computer […] Sacerdoti di una religione senza fede e senza legge se non quella della giungla» (3).
Tutto ciò, Bernard lo scriveva nel 1999, ben prima della crisi del 2007-2008 che ha reso palese, per chi ancora non l’avesse già chiaro, la totale incapacità della teoria economica moderna di affrontare i problemi reali, dell’economia reale. Una “scienza” che «ripete da centocinquant’anni, ad nauseam, la legge della domanda e dell’offerta, e quell’«astuzia della ragione» – direbbe Hegel – secondo cui dai vizi privati nascerebbe un bene sociale. Siate egoisti e la società andrà bene. Come principio esplicativo è semplice quanto la lotta di classe. A partire da lì, si può ricamarci su. All’infinito» (4).
Ma altre grandi menti, prima di lui, già avevano denudato il Re-economista. Da Ezra Pound, a John Kenneth Galbraith, a Giacinto Auriti. Anche Evola ci ammoniva sull’epoca moderna del materialismo e dell’economicismo, caratterizzata dalla «subordinazione dell’idea all’interesse» (5). Perché è proprio questo il punto: il venir meno della radice ideale dei concetti, che tradizionalmente ancora collegavano il mondo reale con la teoria, con le idee appunto. Venendo meno le idee, e la razionalità che le esprime, viene meno la capacità di spiegazione del mondo reale, e si cade nell’ideologia del puro interesse egoistico e strumentale.
Nell’ordine tradizionale, le classi della società sono puramente meritocratiche secondo le reali capacità degli individui e ne rappresentano anche l’effettiva realizzazione, in senso metafisico. È una società, quella tradizionale, «che non conosce e nemmeno ammette classi semplicemente economiche, che non sa né di “proletari” né di “capitalisti”» (6). Distinzione, quella tra capitalisti e proletari, della teoria economica ottocentesca, che definì in tal modo il terzo ed il quarto stato, in quanto soggetti economici.
Qui non si tratta di demonizzare il progresso tecnico e tecnologico, che è palesemente un vantaggio per tutti, ma di ripristinarne la giusta collocazione, organica all’ordine sociale nel suo complesso. «Prima dell’avvento in Europa di quella che nei manuali viene chiamata significativamente l’”economia mercantile” (significativamente, perché ciò esprime che il tono all’intera economia fu dato esclusivamente dal tipo di mercante e del prestatore di danaro), dalla quale doveva svilupparsi rapidamente il capitalismo moderno, era criterio fondamentale dell’economia che i beni esteriori dovessero essere soggetti ad una certa misura, che il lavoro e la ricerca del profitto fossero solo giustificabili per assicurarsi una sussistenza corrispondente al proprio stato. Tale fu la concezione tomistica e, più tardi, quella luterana. Non era diversa, anche, in genere, l’antica etica corporativa, ove avevano risalto i valori della personalità e della qualità e ove, in ogni caso, la quantità di lavoro era sempre in funzione di un livello determinato di bisogni naturali e di una specifica vocazione. L’idea fondamentale era che il lavoro non dovesse servire per legare, ma per disimpegnare l’uomo» (7) affinché avesse più tempo per degni interessi.
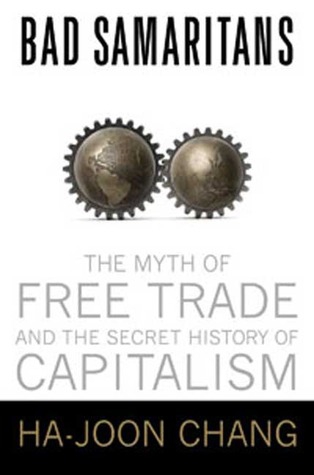 L’economista moderno neoclassico è nudo perché la teoria che pretende “scientifica” e “razionale” (8) è in realtà uno studio di fenomeni, quali i comportamenti umani, che, di per loro, sono per lo più irrazionali. Come afferma con grande onestà intellettuale Ha-Joon Chang, uno dei più rinomati economisti odierni a livello internazionale, già consulente per numerosi organismi internazionali e docente a Cambridge, «il 95 per cento della scienza economica è semplice buonsenso reso complicato da espressioni tecniche e formule matematiche» (9).
L’economista moderno neoclassico è nudo perché la teoria che pretende “scientifica” e “razionale” (8) è in realtà uno studio di fenomeni, quali i comportamenti umani, che, di per loro, sono per lo più irrazionali. Come afferma con grande onestà intellettuale Ha-Joon Chang, uno dei più rinomati economisti odierni a livello internazionale, già consulente per numerosi organismi internazionali e docente a Cambridge, «il 95 per cento della scienza economica è semplice buonsenso reso complicato da espressioni tecniche e formule matematiche» (9).
Chang è uno degli studiosi, tra i più recenti di una lunga serie, che con onestà intellettuale hanno ammesso i forti limiti di tante teorie e modelli, astratti dal fenomenico, che vengono sovente studiati e presi come riferimento nelle scienze sociali. Maurice Allais, già premio Nobel per l’economia nel 1988, ammetteva candidamente, l’anno seguente, che «gli ultimi quarantacinque anni sono stati dominati da una bella serie di teorie dogmatiche, sempre sostenute con la stessa sicumera, ma in piena contraddizione l’una con l’altra, l’una più irreale dell’altra, e tutte abbandonate l’una dopo l’altra sotto la spinta dei fatti» (10).
Allo studio della Storia, all’analisi approfondita di quanto avvenuto in passato, per trarne beneficio per il presente e per il futuro, ossia al tradizionale e reale apprendimento ex post, «non si è fatto altro che sostituire semplici affermazioni, troppo spesso basate su puri sofismi, su modelli matematici non realistici e su analisi superficiali delle circostanze» (11). Con un uso spregiudicato della statistica che «all’incrocio dell’autorità statale con l’autorità scientifica (il calcolo delle probabilità e l’econometria) è nata per servire il Principe […] La statistica eufemizza il discorso politico. La «neutralità» del numero rimanda all’autorità scientifica, al discorso «autorizzato». Il discorso autorevole non è fatto per essere capito, ma per essere riconosciuto. Per far paura. […] La paura è l’inizio della fiducia nei capi» (12).
La lista di convertiti o onesti intellettuali, sulla stessa scia, è lunga: da Keynes che già nel 1937 parlava delle «forze oscure dell’incertezza e dell’ignoranza che operano sui mercati», a Hicks, altro premio Nobel, che dopo aver ridotto la Teoria generale di Keynes ad un diagramma, il famoso IS-LM, ammise «che la sola economia possibile era la Storia. Che la nozione di legge economica non aveva senso», a Pareto che, dopo aver osannato Walras e la sua teoria astratta, riconobbe che «l’economia era soltanto un vano tentativo di parlare di psicologia», e similmente di economia come psicologia parlarono Marshall e Allais. Per finire con Myrdal, premio Nobel del 1974, che «si è sgolato a ragliare contro gli economisti e sghignazza degli econometristi» e con Solow, Nobel nel 1987, che «dopo anni di casistica matematica, riconosceva che, decisamente, in «scienza» economica, sono importanti l’istituzione, la Storia, la politica. Mai l’equilibrio, la razionalità, la concorrenza, l’efficienza e altre scempiaggini» (13).
La teoria economica moderna, neoclassica, si basa sulla teoria dell’equilibrio generale di Walras. Una teoria, ahinoi, i cui assiomi irreali la rendono un vero e proprio castello in aria. E dopo esser stata sbugiardata in modo netto dalla realtà, lo fu anche in ambito teorico dall’equilibrio di Nash, il quale dimostrò che il mercato, in un universo strategico, è la soluzione peggiore.
«Scommetto che la quasi totalità degli economisti sanno di essere soltanto dei logici, e si accontentano di produrre nel loro cantuccio i loro teoremini; che, simili ai microbi degli scienziati pazzi, non fanno male a nessuno finché non escono dalle provette», affermava lacònico Maris. «Poco importa sapere se i postulati sono veri (d’altronde non lo sono), o se le conclusioni sono vere (d’altronde nemmeno queste lo sono). Importa soltanto affermare che le conclusioni sono le conseguenze logiche necessarie di quei postulati» (14).
Molti economisti, consapevoli delle enormi falle delle teorie economiche neoclassiche à la Walras, hanno scelto di concentrarsi sulla teoria dei giochi che, per dirla con Maris «è una vasta impresa logico-ludica […] Anche i nomi dei giochi sono divertenti: il dilemma del prigioniero, la guerra dei sessi, la colomba e lo sparviero, il teorema del folclore…Con la teoria dei giochi giunse l’epoca della burla da osteria, della goliardata portata ai vertici del pensiero […] Certo, esteriormente si esibirà l’espressione austera di chi fa cose complessissime che sarebbe oltremodo maleducato da parte del pubblico cercare di capire!». Difatti, tali economisti «hanno il privilegio unico di poter concionare sulla vita degli uomini in società, di consigliarli, di guidarli, di sottoporli a paternali, di affamarli, all’occorrenza, senza mai dover render conto. Per giunta, le loro chiacchiere sono così complicate che nessuno ci capisce niente; vorrei anche vedere che qualcuno pretendesse di capire! Osiamo dirlo: la teoria dei giochi, l’economia postwalrassiana è una possibilità storica per i dotti, quelli veri: possono finalmente spassarsela in santa pace» (15).
La teoria economica classica, centrata sulla produzione (16), nacque come “teoria d’appoggio” della nascente rivoluzione industriale borghese. Con la modernità più recente, e l’avvento della società consumistica, la focalizzazione della teoria economica passa dall’offerta (produzione) alla domanda (consumo), nella dominante teoria neoclassica. Ma si rimane sempre sull’idea del mercato come perno centrale dell’economia, e la distribuzione come ambito marginale. Il contrario di quanto accadeva nell’economia tradizionale: il sovrano era interessato alla distribuzione, che tutti avessero il necessario, lasciando gli aspetti più pratici produttivi al terzo stato, al tempo per lo più artigiani, limitandosi a regolarne, entro certi limiti, i fattori di produzione.
Nella visione tradizionale, cioè, l’ambito economico è in subordine a quello politico, il quale regola produzione, distribuzione e consumo in base ai bisogni della comunità. Nella modernità, accade invece l’inverso: è il mercato liberista che determina le possibilità di scelta dell’ambito politico, attraverso la manipolazione dei tassi d’interesse. E, ancor più importante, attraverso la discrezionale emissione di moneta da parte del sistema bancario (17).
L’economia dei politici «è soltanto retorica destinata a tranquillizzare e a dare fiducia». «Tutte le teodicee politiche si sono giovate del fatto che le capacità generative della lingua possono valicare i limiti dell’intuizione o della verifica empirica per produrre discorsi formalmente corretti ma semanticamente vuoti» (18).
Termini quali equilibrio, concorrenza, efficienza, trasparenza, razionalità del mercato e soprattutto la connessa e fondante “legge della domanda e dell’offerta” del modello walrasiano, hanno invaso oramai tutti gli altri ambiti sociali. Termini pseudoiniziatici, tentativi più o meno consapevoli di mascherare, con un’aura di verginità, la brutale realtà del mondo economico capitalista che si regge, al contrario, sull’opacità, sull’asimmetria informativa, sul disordine e sull’emotività umana.
L’ideologia neoclassica di un’economia “pura”, libera dal politico ed eticamente “neutra”, deve far posto, o meglio tornare a far posto, ad un’economia politica, sottoposta, secondo buon senso razionale, alla regolamentazione dell’ambito politico. Tanto quanto la politica deve tornare ad essere meta-politica, ossia non eticamente “neutra” ma ben radicata nella radice superiore delle Idee.
Quello dell’economia è solo il riflesso di un problema di più ampia portata. Forse invertire la rotta dell’estrema specializzazione del sapere, oggi dominante, potrebbe essere un primo passo. Ortega y Gasset, quasi novant’anni fa, affermava che lo specialista del mondo odierno «non è un saggio, perché ignora formalmente quanto non entra nella sua specializzazione; però neppure è un ignorante, perché è un ‘uomo di scienza’ e conosce benissimo la sua particella di Universo. Dovremo concludere che è un saggio-ignorante» (19).
L’universitas studiorum medievale, oltre a mirare ad una formazione la più vasta e completa possibile, universale appunto, l’opposto dell’ ”università” moderna, aveva come scopo la comprensione della ratio insita nel Creato, ricordando che tali universitates erano sostanzialmente promosse dal clero cattolico, e che la somma materia di studio era la teologia. Non si fantasticava su modelli matematici e teorie astruse, con assiomi spesso irrazionali, ma piuttosto si ragionava sul Reale, nel suo complesso, cercando di comprenderlo, e facendo leva sulla Storia secondo una visione monistica della realtà. L’insegnamento includeva le disputationes, ossia una sorta di dialogo platonico, tra maestri ed allievi, per comprendere assieme il mondo.









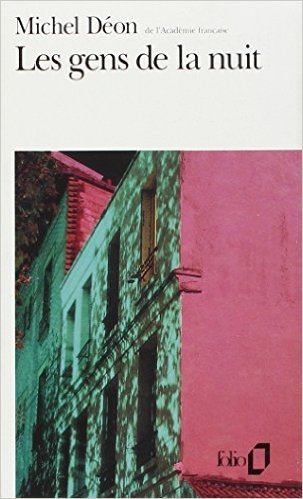 « Le difficile est de faire le gris » estimait Aragon à propos du travail du romancier : ne pas grossir les traits mais ramener les individus à des proportions qui sont celles de la vie du lecteur. Il semble bien que Michel Déon fasse sien dans Les gens de la nuit l’art poétique de l’auteur des Beaux quartiers, tant son narrateur, fantôme perdu dans les brumes mélancoliques du Paris de l’après-guerre, tient du personnage d’Aurelien, cet ancien combattant de la guerre de 14 écrasé par le « nouveau mal du siècle » que diagnostiqua Antoine Blondin dans son article « Cent ans de Mal du Siècle ».
« Le difficile est de faire le gris » estimait Aragon à propos du travail du romancier : ne pas grossir les traits mais ramener les individus à des proportions qui sont celles de la vie du lecteur. Il semble bien que Michel Déon fasse sien dans Les gens de la nuit l’art poétique de l’auteur des Beaux quartiers, tant son narrateur, fantôme perdu dans les brumes mélancoliques du Paris de l’après-guerre, tient du personnage d’Aurelien, cet ancien combattant de la guerre de 14 écrasé par le « nouveau mal du siècle » que diagnostiqua Antoine Blondin dans son article « Cent ans de Mal du Siècle ».


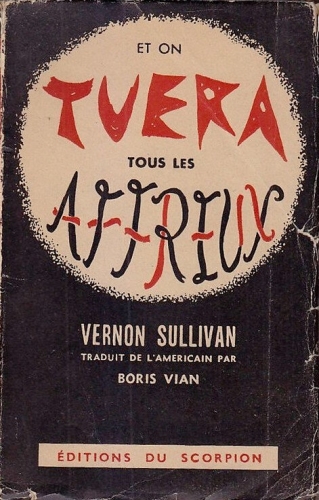

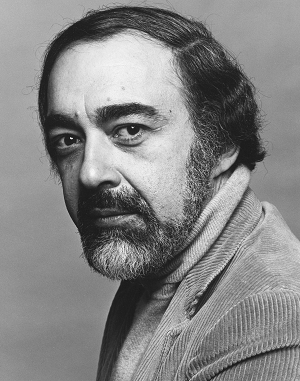
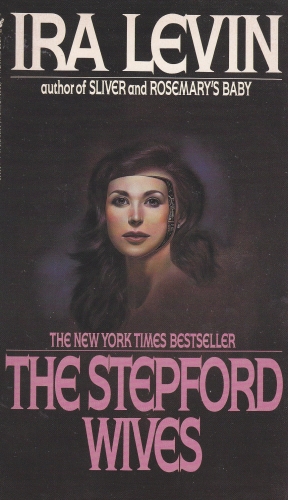
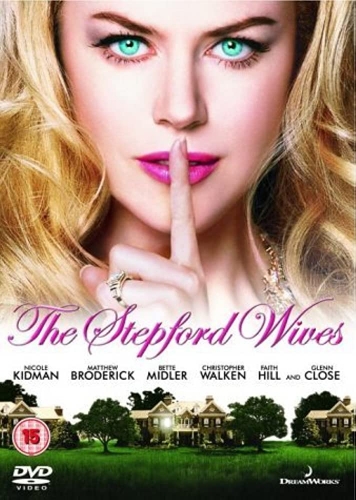
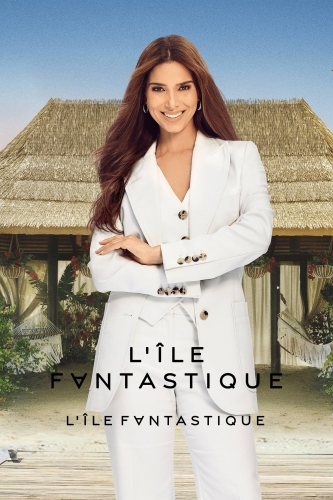



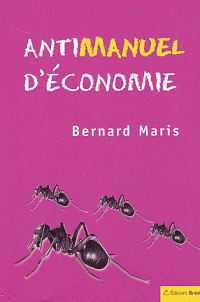 Bernard non le mandava di certo a dire: «E voi, gente dei numeri…Agitatori di nacchere statistiche, che maneggiate somme sbalorditive, che fate giochi di destrezza con i tassi, illusionisti dei miliardi di dollari e della disoccupazione ridefinita venticinque volte in vent’anni come in Inghilterra (ha finito col diminuire), che fate previsioni cercando il futuro con un ago nel buio e una candela nel pagliaio» (2). E ancora: «Voi, i «ricercatori» delle organizzazioni al soldo dei potenti, mai stanchi di leccar piedi, che risalite senza posa le rupe dei loro errori, poveri Sisifo dell’equazione…Voi consiglieri del Principe, chief economists, […] Sicari del rapporto raffazzonato ma che uccide […] interpreti dei pastrocchi econometrici e delle curve di numeri usciti direttamente dalla pancia dei computer […] Sacerdoti di una religione senza fede e senza legge se non quella della giungla» (3).
Bernard non le mandava di certo a dire: «E voi, gente dei numeri…Agitatori di nacchere statistiche, che maneggiate somme sbalorditive, che fate giochi di destrezza con i tassi, illusionisti dei miliardi di dollari e della disoccupazione ridefinita venticinque volte in vent’anni come in Inghilterra (ha finito col diminuire), che fate previsioni cercando il futuro con un ago nel buio e una candela nel pagliaio» (2). E ancora: «Voi, i «ricercatori» delle organizzazioni al soldo dei potenti, mai stanchi di leccar piedi, che risalite senza posa le rupe dei loro errori, poveri Sisifo dell’equazione…Voi consiglieri del Principe, chief economists, […] Sicari del rapporto raffazzonato ma che uccide […] interpreti dei pastrocchi econometrici e delle curve di numeri usciti direttamente dalla pancia dei computer […] Sacerdoti di una religione senza fede e senza legge se non quella della giungla» (3).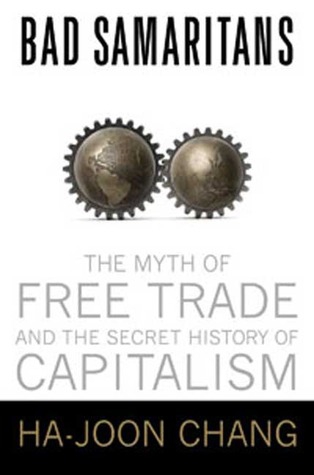 L’economista moderno neoclassico è nudo perché la teoria che pretende “scientifica” e “razionale” (8) è in realtà uno studio di fenomeni, quali i comportamenti umani, che, di per loro, sono per lo più irrazionali. Come afferma con grande onestà intellettuale Ha-Joon Chang, uno dei più rinomati economisti odierni a livello internazionale, già consulente per numerosi organismi internazionali e docente a Cambridge, «il 95 per cento della scienza economica è semplice buonsenso reso complicato da espressioni tecniche e formule matematiche» (9).
L’economista moderno neoclassico è nudo perché la teoria che pretende “scientifica” e “razionale” (8) è in realtà uno studio di fenomeni, quali i comportamenti umani, che, di per loro, sono per lo più irrazionali. Come afferma con grande onestà intellettuale Ha-Joon Chang, uno dei più rinomati economisti odierni a livello internazionale, già consulente per numerosi organismi internazionali e docente a Cambridge, «il 95 per cento della scienza economica è semplice buonsenso reso complicato da espressioni tecniche e formule matematiche» (9).