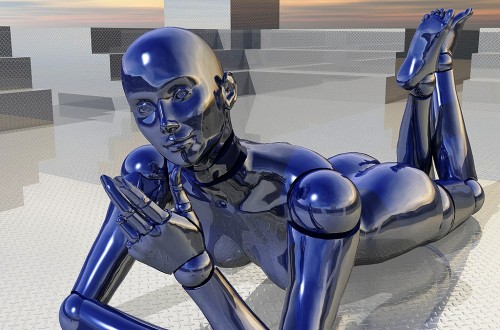Ex: http://fortune.fdesouche.com/

Note au lecteur : la bonne compréhension de ce texte suppose la lecture des articles du 28/01/2010 (L’euro : implosion ou sursaut ?) et du 16/02/2010 (Pour mieux comprendre la crise : déchiffrer l’essence de l’Etat).
La crise grecque et ses prolongements confirment que ce prêt à porter qu’est la monnaie unique est porteur de méfiance chez les passagers clandestins du bateau euro.
Tous veulent conserver les avantages qu’ils se sont progressivement créés dans le bateau : faibles taux d’intérêt, « monnaie de réserve à l’américaine », terrain de jeu plus vaste au profit des entrepreneurs politiques pour certains, exportations « à la chinoise » pour d’autres.
Aucun ne voulant en payer le prix, c’est-à-dire le coût de l’entretien du bateau pour le maintenir à flots : création d’une zone monétaire optimale par vaste édification d’un Etat européen à l’instar de l’Etat fédéral américain, politique de change, contrôle de la banque centrale, etc.
La grande crise des années 2010 devant inéluctablement connaître des développements monétaires, il était logique qu’elle développe d’abord une métastase dans le bateau le plus sensible : l’euro zone.
La solution toute temporaire à la crise grecque et à ses prolongements immédiats, confirme le refus de payer le prix d’une bonne maintenance du bateau.
Avec le temps, il se confirmera que les entrepreneurs politiques français ont préféré une nouvelle fuite en avant, plutôt que d’affronter leurs collègues allemands et d’exiger des solutions plus radicales : quel entrepreneur politique français au pouvoir pourrait aujourd’hui, sans risque, oser vendre sur le marché des idées, outre le « quantitative easing » semble-t-il acquis de haute lutte, la fin de l’indépendance de la BCE, ou la fin de la libre circulation des capitaux ?
De telles propositions développeraient – encore aujourd’hui – un double risque électoral et financier, double risque fonctionnant en boucle. Produits politiques trop innovants aujourd’hui, il faudra pourtant bien les mettre en place pour éviter un demain encore plus ruineux.
Une caisse à outils pour deux crises
Il y a pourtant un progrès significatif entre la solution imaginée pour la Grèce et la solution acquise dans la nuit du 9 au 10 mai.
Dans le premier cas, le dispositif est intergouvernemental et surtout à un coup. C’est dire qu’il faut revoir toute la procédure en cas de besoins nouveaux.
Dans le second, il est possible de passer à la mitrailleuse : constitué essentiellement d’un « Special Purpose Vehicle » de droit privé luxembourgeois, il vient en appui dans un nombre de cas non défini a priori. Il s’agira toujours de prêts conditionnels, à partir d’une matière première qui ne sera plus de la dette des autres Etats prêteurs. Simplement, ces derniers garantissent l’activité du SPV. Si les modalités de fonctionnement ne sont pas encore connues, il faut néanmoins noter que le nouveau dispositif n’est pas encore celui d’une mutualisation de la dette, qui ferait disparaître les dettes souveraines et donc les spreads.
Mais surtout, un progrès sensible figure sous la forme d’une intervention beaucoup plus active de la BCE sur le marché secondaire de la dette, ce que Jean Quatremer appelle une « nuit du 4 août » .
Le nouveau dispositif n’est pas une simple arme de dissuasion : il devra servir sur les futurs champs de bataille annoncés, dès que les taux sur dettes nationales deviendront supérieurs au taux proposé par le SPV. Les besoins futurs pour les PIGS étant très importants, on peut penser que le taux de financement du SPV sera très vite celui qui sera payé par ces derniers.
En théorie, chaque fois qu’une agence nationale de la dette viendra buter sur un taux supérieur à celui qui approvisionne le SPV, l’Etat correspondant changera de fournisseur de liquidités, les classiques Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) se retournant vers le SPV.
Sauf à considérer que ce dernier fonctionne avec une marge bénéficiaire (comme c’est le cas dans le dispositif grec), il deviendrait très vite un acteur essentiel, avec une spéculation qui pourrait rapidement se déplacer sur lui. Avec le risque de passer de la fragilité en détail à la fragilité en gros… C’est la raison pour laquelle de nombreux freins seront sans doute envisagés, pour éviter un usage trop aisé du dispositif.
Mais le nouveau dispositif ne règle en rien la maintenance du bateau, les trous confectionnés par les passagers clandestins (déficits budgétaires) étant rebouchés avec la matière dégagée par de nouveaux trous.
La fuite en avant continue par conséquent, fuite concernant désormais, dans un même mouvement, le sauvetage des Etats et celui du système financier, beaucoup plus lourdement chargé en dettes publiques qu’en 2008. Le naufrage de l’un, signifiant désormais le naufrage de l’autre.
Le dispositif SPV est toutefois lui-même complété par l’intervention de la BCE sur les marchés secondaires des dettes souveraines, ce que certains commentateurs appellent l’arme nucléaire.
Cette nouvelle fuite en avant a été politiquement préférée à une sortie de la zone de ceux des passagers clandestins les plus touchés par la spéculation. Il est vrai qu’un raisonnement fort simple nous permet de comprendre qu’un passager clandestin quelconque, par exemple la Grèce, ne peut quitter le navire sans faire chavirer l’ensemble.
Un passager clandestin prisonnier
Une sortie précautionneuse de la Zone voudrait que dans une nuit de week-end, un décret annonce le retour de la Drachme, en stipulant que toutes les créances libellées en euros sont converties en Drachmes sur la base d’un taux de 1/1. Cela concernerait tous les éléments de la masse monétaire et le taux de conversion choisi permettrait de ne pas altérer l’expression monétaire des prix internes, tout au moins dans le très court terme.
Par contre, dans le cadre des opérations avec l’étranger, il y a une dévaluation à prévoir, par exemple de moitié. Les titulaires étrangers de dette grecque, comme les nationaux, sont à échéance remboursés en Drachmes. Les bilans privés locaux ne connaissent guère de changement, sauf quand ils sont l’image d’activités faisant intervenir des actifs et passifs en devises étrangères. Selon les cas, actif ou passif, il y a réévaluation ou dévaluation, et donc modification de la structure des patrimoines. La partie de la masse monétaire figurant sous la forme fiduciaire ne constitue qu’un problème fort marginal, et on comprend fort bien que les agents ne se rendront pas à la banque pour convertir leurs derniers euros et chercheront à bénéficier du nouveau taux de change.
La dévaluation, dans un pays très largement déficitaire, constitue une forte baisse du pouvoir d’achat sur les marchandises importées. En retour, la Grèce devient théoriquement plus compétitive sur ses activités traditionnelles. Les mouvements de capitaux sont en théorie favorables, la fuite étant pénalisante et les rapatriements avantageux. Le mouvement des taux est, lui, soumis à probable et significative évolution inverse.
On peut débattre à l’infini de la solution retenue sur le paiement de la dette détenue par des étrangers (80% de la dette grecque est aujourd’hui détenue par des non résidents). Le remboursement en Drachmes ne correspondant pas à une répudiation, si le nouveau taux de change est adopté. Il s’agirait d’ailleurs d’une solution optimale puisque, formellement, il n’y aurait pas, d’une part, restructuration et renégociation de la dette et, d’autre part, maintien insupportable de son poids grâce à sa monétisation. On peut en effet penser que la sortie de la zone est assortie d’une renationalisation de la Banque centrale, laquelle monétise en fonction de critères politiquement déterminés.
Et le critère numéro 1 est évidemment de sortir de l’étau monétaire, donc l’abandon de la rente financière sur la dette. On peut même penser que, dans un souci de respect des contrats et engagements, tout serait entrepris pour amortir le choc de la sortie, sur la dette dont la maturité n’est pas immédiate. Certes, une pression inflationniste s’enclenche en liaison avec une baisse des cours de la dette souveraine, mais il n’est pas interdit de penser que le Trésor rachète lui-même, progressivement, les titres en voie de dépréciation.
A terme, la dette publique, et la rente correspondante, disparaît et peut ne pas se reconstituer, comme le révèle l’expérience de la France d’avant la loi du 3 janvier 1973, laquelle viendra interdire à son Etat tout accès aux crédits de la banque centrale… d’où l’émergence de la problématique de la dette.
Ainsi brièvement exposé, on peut penser que, bien menée, une sortie de la zone, d’un pays étranglé par la dette publique, est économiquement et politiquement jouable. Et si, d’aventure, la compétition entre acheteurs de voix, sur les marchés politiques locaux, devait déboucher sur un retour des déficits, l’inflation et la dépréciation externe viendraient bloquer tout retour de la rente. Au-delà de la redistribution imposée par les entreprises gagnantes sur le marché politique, chacun est davantage rétribué en fonction de sa productivité, et moins en fonction de son positionnement dans l’accès à une rente en voie de disparition.
Le raisonnement ci-dessus exposé, est pourtant très probablement erroné, en raison des risques de contagion qui, dans un premier temps, ferait chuter l’euro, puis affaisserait les cours des dettes souveraines de fragilité comparable, puis mettrait en péril la solvabilité des banques, et par contagion au marché interbancaire mondial, développerait une nouvelle crise systémique… Cette fois, sans le secours d’Etats en défauts.
Il est d’ailleurs probable que la sortie de la zone se produirait en utilisant un taux de change, non plus par rapport à l’euro duquel le divorce est envisagé, mais par rapport au dollar. Ce qui assurerait la rapide disparition de l’euro lui-même. Une sortie individuelle n’est donc guère envisageable.
Dans ce bateau des passagers clandestins, si la solidarité est inexistante, il faut néanmoins tout entreprendre pour éviter la ruine collective. Et donc, la voie de la sortie n’est pas celle qui sera retenue sur les marchés politiques, qui se doivent de découvrir un très complexe compromis assurant la reconduction au pouvoir du plus grand nombre.
C’est dire que les passagers clandestins sont tenus de rester dans un bateau qui, prenant l’eau, continueront dans un mouvement ascendant, à boucher des trous en en créant de nouveaux toujours plus vastes. Besogne d’autant plus épuisante qu’il faut d’un même geste maintenir à flot le bateau voisin : celui du système financier dont le destin est a priori indissolublement lié à celui des Etats.
Des marchés politiques en quête d’innovations de produits
Il est évidemment difficile de décrire les prochaines étapes de la fuite en avant, et comme le dirait Hegel : « nul ne peut sauter par-dessus son temps ».
Pour autant, l’une d’entre elles vient immédiatement à l’esprit : il s’agit de la mutualisation de la dette. Le dispositif construit dans la nuit du 10 mai en constitue les prémisses, puisqu’il n’est pas intergouvernemental et se trouve issu de la commission. Il n’est toutefois pas organe de mutualisation faisant disparaitre la notion même de dette souveraine.
L’étape suivante sera donc la création d’un outil de la dette pour l’ensemble de la zone. Sera ainsi créée une « Agence Zone Euro », sur le modèle de l’Agence France Trésor, laquelle sera chargée de la vente de dette pour l’ensemble de la zone. Si le spread disparait, on peut aussi penser que les taux qui s’y fixeront pour les différentes maturités seront dans un premier temps plus accessibles aux Etats les plus fragiles.
Le problème restera toutefois celui de la clé de répartition et des droits de tirage des divers Etats. Nombreux sont les « think tanks » (Montaigne ; Bruegel ; etc.) qui, d’ores et déjà, proposent aux entrepreneurs politiques de miraculeuses solutions. Avec néanmoins de gros débats sur les marchés politiques, moins entre entreprises politiques de chaque Etat, qu’au niveau international.
Solution d’étape, qui ne résout en aucune façon la crise générale de la dette et laisse entier le heurt de plus en plus frontal entre une rente croissante et des Etats providence qui constituent – pour partie et pour partie seulement – la rente des plus humbles et des accidentés de la crise.
Le périmètre des PIB étant devenu inélastique, la rente qui se goinfre de la dette devra rogner les avantages sociaux obtenus sur les marchés politiques. Et cette inélasticité est a priori davantage le danger des « petits un peu ronds » de la zone. C’est que la rigueur des plans d’ajustement, dans un contexte de crise mondiale, ne laissera que fort peu de chance à une augmentation de la demande globale, comme ce fut le cas dans les années 90 pour des pays comme le Canada ou la Suède.
Ainsi la Grèce qui, au nom de l’ajustement, pour ne prendre qu’un exemple, connaissant une hausse des prix interne impulsée par une hausse de TVA (4 points), verra – en raison de l’élasticité/revenu et prix de la demande – une diminution de la consommation globale. Et diminution aggravée par une élasticité croisée, non négligeable, de la demande souterraine… Ce qui signifiera, dans quelques mois, une aggravation de sa situation. Donc, une augmentation de la part de la rente dans le revenu global. Comme quoi, les entrepreneurs politiques restent dans la fuite en avant.
La solution de la mutualisation de la dette nous fait donc passer de la fragilité en détails, à la fragilité en gros. Avec, toutefois, cette formidable soupape de sécurité qu’est l’évolution du comportement de la BCE, laquelle aura pour effet, en cas de réussite, de maintenir la zone, tout en contenant sans doute partiellement les effets destructeurs de la rente. De quoi prolonger la fuite en avant…
Réussite effectivement temporaire car, le remboursement de la dette étant devenu largement impossible, le bilan de la BCE deviendra très lourd, d’où de nouvelles inquiétudes sur les marchés.
Mais surtout, puisque la lutte contre l’inflation est abandonnée au profit de l’achat massif de titres publics, d’abord nationaux puis ensuite européens – des « Eurobonds » – le différentiel d’inflation ne pourra qu’augmenter et élargir le fossé entre pays de la zone.
Et possiblement une entreprise politique française gagnante…
A terme, des entrepreneurs politiques innovants devront prendre le risque de propositions radicales et reconnaître l’impossibilité, au moins temporaire, de poursuivre une aventure si mal engagée. La cartellisation sur l’euro des entreprises politiques, jusqu’ici constatée tant au niveau national qu’au niveau de la zone, devra inéluctablement disparaître.
Les entreprises politiques françaises se sont historiquement cartellisées les premières pour faire naître l’euro et en tirer beaucoup d’avantages en termes d’offre pléthorique de produits politiques : l’euro minimisait le coût du déficit qui, lui-même, pouvait multiplier les produits contre des voix, à effet de se maintenir au pouvoir ou de conquérir le pouvoir.
L’euro n’étant plus capable de minimiser le coût de la dette, le gonflement de la rente vient vider les rayons de la boutique de l’Etat providence… et donc, ruiner la machine à capter des voix. Le prix à payer est lourd : en termes de fréquentation des marchés politiques (taux d’abstention) et en termes de parts de marché (pollution des petits partis).
Les vrais bénéficiaires de la dette ne sont plus des titulaires d’avantages sociaux à crédit, mais des rentiers majoritairement non résidents. Le nombre des bénéficiaires de l’Etat providence étant plus important, le pacte sur l’euro, devenu intenable, sera rompu, et l’entreprise politique française qui aura le courage d’offrir ce nouveau produit aura beaucoup de chances d’emporter la mise.
Et effectivement, en raison d’une histoire de l’euro qui est spécifiquement française, la probabilité de voir ce produit offert par une entreprise française est grande. Ce qui ne veut pas dire qu’il est une promenade de santé, puisqu’il passe par un conflit avec la quasi-totalité des entreprises politiques allemandes (démocratie chrétienne, sociale démocratie, verts, libéraux démocrates) et qu’il suppose de grandes capacités de communication vis-à-vis des marché. Mais, en cas de réussite, cette entreprise s’inscrira dans l’Histoire.
La suite du scénario est plus simple et se trouve déjà dans les pistes de réflexion de nombreux think tanks, universités, voire ministères… Il s’agit généralement de séparer les « grands minces » des « petits un peu ronds » et de retrouver une certaine homogénéité monétaire.
Concrètement, on trouverait un euromark avec l’Allemagne, la Hollande et l’Autriche, et un eurofranc avec la France et nombre de pays de l’Europe du sud. Un taux de change revisitable permettrait à chacun des deux groupes de forger une politique économique adaptée, avec, en particulier, la disparition relative d’une rente devenue, en raison du mode de fonctionnement des marchés politiques, économiquement et socialement intolérable.
Un tel scénario signifierait de grands bouleversements dans les méthodes de construction ou reconstruction de la maison Europe, dans un contexte qui restera celui de la grande crise des années 2010, mais dont la gestion pourra s’inspirer d’une innovation de produit politique majeure.




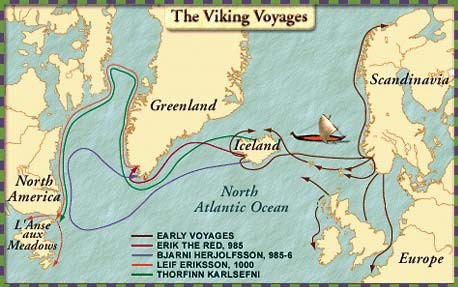

 Proudhon, qui, en 1863 déjà, proclamait la nécessité « du principe fédératif », mettait ses disciples en garde contre cette déformation et cet abus. De cet ouvrage fameux, il est de bon ton de répéter une phrase : « Le vingtième siècle ouvrira l’ère des fédérations, ou l’humanité recommencera un purgatoire de mille ans » et d’en citer … implicitement une autre, en négligeant d’en Indiquer la source : « L’Europe serait encore trop grande pour une confédération unique : elle ne pourrait former qu’une confédération de confédérations ». Il semble que ce soit là tout ce qu’on ait retenu de ce traité fondamental. N’oublie-t-on pas un peu trop facilement avec quelle force il s’est lui-même déclaré « républicain, mais irréductiblement hostile au républicanisme tel que l’ont défiguré les jacobins » ? N’oublie-t-on pas qu’aucune insistance ne lui paraissait indiscrète quand il s’agissait de répéter à ses correspondants : « Méfiez-vous des jacobins qui sont les vrais ennemis de toutes les libertés, des unitaristes, des nationalistes, etc … »
Proudhon, qui, en 1863 déjà, proclamait la nécessité « du principe fédératif », mettait ses disciples en garde contre cette déformation et cet abus. De cet ouvrage fameux, il est de bon ton de répéter une phrase : « Le vingtième siècle ouvrira l’ère des fédérations, ou l’humanité recommencera un purgatoire de mille ans » et d’en citer … implicitement une autre, en négligeant d’en Indiquer la source : « L’Europe serait encore trop grande pour une confédération unique : elle ne pourrait former qu’une confédération de confédérations ». Il semble que ce soit là tout ce qu’on ait retenu de ce traité fondamental. N’oublie-t-on pas un peu trop facilement avec quelle force il s’est lui-même déclaré « républicain, mais irréductiblement hostile au républicanisme tel que l’ont défiguré les jacobins » ? N’oublie-t-on pas qu’aucune insistance ne lui paraissait indiscrète quand il s’agissait de répéter à ses correspondants : « Méfiez-vous des jacobins qui sont les vrais ennemis de toutes les libertés, des unitaristes, des nationalistes, etc … »