samedi, 24 janvier 2026
La scission interne et irréversible au sein de l’Occident - Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale
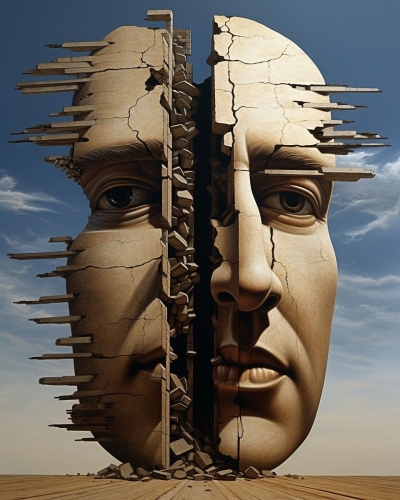
La scission interne et irréversible au sein de l’Occident
Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale
Alexandre Douguine
Alexandre Douguine sur la fracture irréversible de l’Occident, les gambades impériales de Trump, et l’émergence de cinq pôles occidentaux concurrents.
Entretien avec Alexander Dugin pour l’émission « Escalation » de Sputnik TV.
Animateur: Les fêtes de début 2026 ont apporté une nouvelle qui évoque inévitablement les grands bouleversements du passé. La presse discute activement de l’initiative de Donald Trump concernant le Groenland, en la comparant à l’achat de l’Alaska. On dit que si Trump parvient à acquérir l’île, son nom sera associé à celui des plus grands présidents américains. Selon vous, l’acquisition du Groenland est-elle l’un des principaux objectifs de Trump pour les États-Unis, une manière pour lui d’entrer dans l’histoire ?
Alexandre Douguine: Je pense que Trump a certainement un tel objectif, mais ce n’est pas le principal. Devant nos yeux se déroule une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale. Dans l’histoire des États-Unis, aux côtés de l’achat de l’Alaska, il y a également l’achat de la Louisiane, qui appartenait à un régime totalement différent, ainsi que la guerre avec le Mexique, après laquelle les États-Unis ont annexé deux tiers de son territoire. L’expansion d’une sphère d’influence est une constante de la politique américaine.
Aujourd’hui, Trump a proclamé une «Doctrine Monroe» avec son propre «corollaire», c’est-à-dire l’affirmation des États-Unis comme le seul hégémon de l’Hémisphère occidental. Nous l’avons vu dans le cas du Venezuela: l’enlèvement de Maduro et la mise du pays à genoux, pratiquement sans un seul coup de feu. Désormais, les politiciens américains gouvernent là-bas comme si c’était leur propre arrière-pays, et Trump n’écrit pas par hasard sur les réseaux sociaux qu’il est le «président par intérim de l’Argentine». Dans cette logique, le Groenland est une extension géographique naturelle du continent nord-américain.
Cependant, Trump ne s’arrêtera pas là. Le Premier ministre actuel du Canada se prépare déjà, en fait, à une guerre contre les États-Unis — le Canada doit se préparer comme s'il allait être le toute prochaine cible. Je pense que Trump obtiendra gain de cause tant pour le Groenland que pour le Canada. Bien que des problèmes puissent encore apparaître avec l’Amérique du Sud, l’absorption du Canada sera simplement «avalée» par tout le monde. Certains diront que nous avons été malchanceux d’avoir eu un tel président; d’autres diront qu’il a vraiment rendu l’Amérique grande à nouveau.

La situation autour du Groenland révèle un fait crucial: il y a désormais une scission complète au sein de l’Occident. L’Occident uni n’existe plus. Il peut nous combattre, combattre l’Iran ou le Venezuela, mais il est désormais prêt à se livrer des combats aussi à l'intérieur de son propre camp. Nous avons vu les tentatives pitoyables de l’Union européenne d’envoyer quelques troupes au Groenland pour «le protéger» d’une menace fictive de la Russie et de la Chine. Mais dès que Trump a lancé un ultimatum sur les tarifs douaniers, Friedrich Merz a immédiatement retiré son petits groupe de soldats.
Trump dit ouvertement aux Européens: «Vous êtes mes vassaux, faites ce que je vous ordonne». Lorsqu’il leur dit de faire la paix avec les Russes — ils doivent faire la paix. Lorsqu’il leur dit de céder le Groenland — ils doivent le céder. Lorsqu’il leur dit de soutenir Netanyahu — ils doivent le soutenir. Pendant des décennies, la direction mondialiste des États-Unis a créé l’illusion que l’Europe était un partenaire avec une voix au chapitre. Maintenant, ces illusions se sont brisées. Trump leur dit sans détours: «Vous n’êtes personne, juste des bras armés, des livreurs de pizzas ou des travailleurs migrants. Si je prends le Groenland, vous devez répondre: ‘Oh, cher Papa Trump, prends-le vite, sauve-nous des méchants Russes et Chinois avec leurs sous-marins». Voilà le monde dans lequel nous vivons: Trump frappe du poing sur la table, et l’Europe — ayant brièvement tenté de prétendre qu’elle défendrait le Groenland contre l’Amérique — capitule rapidement.

Trump est prêt à démanteler l’OTAN, puisque l’alliance se compose déjà de 95% de ressources américaines. Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas seulement une humiliation colossale pour l’Europe (les émotions passeront), c’est la fin de l’ancien Occident collectif. L’épisode du Groenland est devenu un test de référence, révélant une image unique: un monolithe autrefois uni, avec lequel nous nous battions encore il y a un an, s’est brisé en cinq pôles différents.
Le premier Occident, c’est Trump lui-même. Il déclare: «Je suis l’Occident, et tous les autres ne sont que des décors». Il se comporte comme un cow-boy prêt à «bombarder» tout le monde — ennemis et alliés — sans reconnaître personne comme un sujet souverain. Pour lui, seul le président américain existe; tous les autres ne sont personne.
Le second Occident, c’est l’Union européenne. Elle a soudain découvert qu’elle n’est même plus un «partenaire mineur». L’UE a été dépouillée de toute subjectivité solide, politiquement, elle est effectivement castrée. Pour les élites européennes habituées à une admission formelle dans le «club des hommes», cela a été un choc absolu. On leur a dit franchement: votre opinion sur l’Ukraine ou le Groenland n’intéresse personne.
Le troisième, c’est l’Angleterre. Elle se trouve dans une position étrange: apparemment proche des États-Unis, mais frappée par les tarifs de Trump à cause de ses critiques sur l’accord du Groenland. La Grande-Bretagne n’est plus le chef d’orchestre de l’UE (forcément, après le Brexit), mais ce n’est pas non plus une marionnette américaine. C’est un acteur autonome, à part entière.
Le quatrième groupe rassemble les restes du mondialisme. Il s’agit du «deep state» aux États-Unis, des démocrates, qui regardent Trump avec horreur, réalisant qu’ils sont les prochains sur la liste pour une purge. Leurs représentants restent puissants dans les structures européennes et britanniques, et ils continuent de parler de domination mondiale, même si le sol se dérobe sous leurs pieds. Même Macron parle déjà de quitter l’OTAN, et Merz envisage un rapprochement avec la Russie, ayant saisi l’ampleur des pertes.

Enfin, le cinquième Occident, c’est Israël: un petit pays qui se comporte comme s’il était le centre du monde. Avec une frénésie toute messianique, Netanyahu construit un «Grand Israël», utilisant des méthodes extrêmement brutales et forçant tout le monde à l’aider. Il s’avère qu’Israël n’est pas une avant-garde occidentale, mais une force qui, à bien des égards, contrôle l’Amérique elle-même à travers des réseaux pro-israéliens.
Au final, au lieu d’un seul ennemi, nous faisons face à cinq pôles occidentaux différents. Nos regards se tournent dans tous les sens: avec qui devrions-nous conclure des accords? Qui ici est réellement souverain, et qui ne fait que faire semblant? La stratification de l’Occident en ces cinq parties est la principale conséquence de la crise actuelle.
Animateur : Une question d’un auditeur : « Alexandre Geliévitch [Douguine], quelle est la raison pour laquelle Trump a si violemment changé de tactique après le Nouvel An? Venezuela, Groenland, saisies de pétroliers — pourquoi voyons-nous une telle accélération des actions du président américain ? »
Alexandre Douguine: Tout d’abord, je pense que Trump a rencontré une opposition intérieure extrêmement puissante aux États-Unis même, et il a besoin de consolider sa position par des succès sur la scène internationale. Il a été élu pour restaurer l’ordre chez lui, mais cela s’est avéré extraordinairement difficile. Il s’est avéré que pratiquement tout le système judiciaire américain est sous le contrôle de Soros: les soi-disant «juges militants», qui, au lieu d'être guidés par le sens de la loi et de la justice, le sont par une idéologie libérale et prononcent toujours des verdicts contre Trump.
Cette "justice" a commencé par bloquer tous les processus internes. Des protestations contre les agences fédérales chargées de faire respecter la frontière ont éclaté, aboutissant à des affrontements avec des victimes. De nombreux gouverneurs sabotent effectivement ses directives. Trump commence à s’enliser à l’intérieur du pays: la liste Epstein n’a toujours pas été publiée, et de nombreux griefs légitimes s’accumulent contre lui. Il a compris qu’il pourrait passer trois ans à lutter contre ces libéraux corrompus sans rien obtenir, alors que les élections de mi-mandat de 2026 approchent — élections qu’il a toutes les chances de perdre.
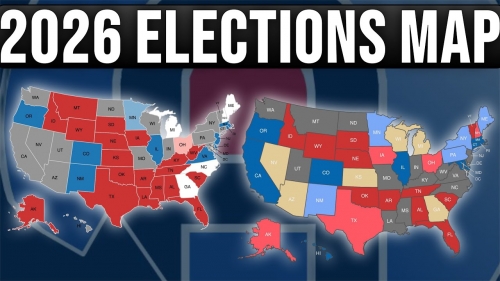
Je pense que les sondages et les conseillers en communication lui ont clairement dit: les ressources internes sont épuisées, il faut un nouvel argument. Il faut annexer quelque chose, kidnapper quelqu’un, le vaincre, l’effrayer ou l’humilier. Ensuite, il pourra obtenir un levier pour la politique intérieure. Trump comprend que le temps s’écoule rapidement — à la fois le temps biologique et le temps de sa présidence. Il a décidé que 2026 est la limite au-delà de laquelle le retard n’est plus possible.
L’annexion du Groenland, le début effectif d’une guerre avec le Canada, la dissolution de l’OTAN, et le démantèlement de l’ONU — tout cela fait partie d’un agenda de redéfinition mondiale. Sur ce fond, les ennemis intérieurs de Trump s’effacent: il est beaucoup plus difficile de démettre un président qui a acquis d’immenses territoires pour les États-Unis et qui a restauré leur statut de puissance redoutable. Après Biden, l’Amérique a commencé à être moquée par tous, mais Trump a rappelé au monde qu’il est un «despote enragé», capable de frapper n’importe où à tout moment.
L’humanité a frissonné. Nous, bien sûr, ne sommes pas des sots non plus et sommes prêts à relever des défis, mais il est important de comprendre: ce n’est plus, face à nous, Russes, l’ancien système mondialiste moribond; c’est autre chose. Trump utilise tous les moyens: des moyens totalement immoraux et illégaux. Il déclare ouvertement que le droit international n’existe plus, et qu’il décidera lui-même de ce qui est moral ou non.
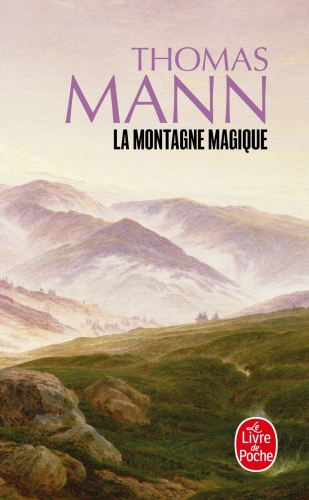 Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.
Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.
Animateur: Des prévisions importantes sont déjà évoquées officiellement. Le représentant spécial du président, Kirill Dmitriev, a souligné qu’au vu des actions plus dures de Trump, l’Europe pourrait commencer à pivoter vers un dialogue avec la Russie. Dans quelle mesure un tel scénario est-il réaliste sous les gouvernements actuels de cette «cinquième partie de l’Occident» dont vous parliez? Après tout, pour des raisons géopolitiques et géographiques, il est objectivement plus avantageux pour l’Europe d’entamer un tel tournant aujourd’hui.
Alexandre Douguine: Vous savez, il y a un an, un an et demi — voire quelques mois —, si nous avions commencé à parler sérieusement de la question que les États-Unis soulevaient au sujet de l’annexion du Groenland, cela aurait semblé si irréaliste que même les penseurs géopolitiques les plus avant-gardistes auraient qualifié cela d’impossible.
Imaginer que l’Europe se prépare d’abord à se battre contre l’Amérique pour le Groenland, puis que cette détermination ne durerait pas plus d’une semaine, se soldant par un recul — cela aurait été inconcevable l’automne dernier. Nous rêvions encore que l’Europe disposait d’au moins une certaine souveraineté.
Aujourd’hui, les Européens se trouvent dans des conditions totalement nouvelles, qui, à bien des égards, sont choquantes. Avant, ils pouvaient se disputer avec Trump sur des détails, comme l’ampleur du soutien à Kiev. Pour Trump lui-même, ce n’est pas particulièrement important: son image de «pacificateur» n’était qu’un écran de fumée, un brouillard. Il n’est pas un hasard s’il a effectivement rétabli le statut du Pentagone en tant que «ministère de la Guerre» — cela en dit long. Il ne se soucie pas d'une vraie paix, ni d’un cessez-le-feu en Ukraine. Il résout ses propres tâches, lesquelles sont purement américaines.
Trump leur a dit franchement: «Concluez rapidement un cessez-le-feu avec les Russes selon les termes que j’ai moi-même acceptés à Anchorage». L’Europe a d’abord répondu avec arrogance: «Nous sommes une coalition des volontaires, nous soutiendrons l’Ukraine et nous nous débrouillerons sans vous». Trump a répliqué: «Alors, gérez, mettez le Groenland sur la table et survivez comme vous pouvez». L’Europe s’est retrouvée dans cette situation soudainement, sans préparation. La panique y règne désormais.
Le fait que Macron ait commencé, dans la chaleur du moment, à parler de quitter l’OTAN, et que Friedrich Merz oscille entre la reconnaissance de l’effondrement de l’économie allemande dû à la rupture avec la Russie et des tentatives de se rapprocher de Washington — c’est de l'hystérie classique. L’Union européenne est en panique. Les dirigeants européens actuels sont des reliques de l’ancien système: des gens à Soros, au Forum de Davos, des adeptes du modèle de Fukuyama, qui a finalement sombré.
Dans cette agonie, ils peuvent proposer n’importe quel scénario, même les plus fantastiques. Y compris: «Pourquoi ne pas s’appuyer sur la Russie? Pourquoi ne pas reconsidérer les relations avec Poutine?». La gravité de ce qu’ils proposent reste une grande question. Pour l’instant, un tel tournant semble improbable, mais dans le contexte de la redéfinition mondiale que Trump a mise en marche, rien n’est à exclure.
Animateur: Restons au sujet que constitue Donald Trump. Cette fois, parlons de son initiative de créer un Conseil de la Paix pour gouverner la Bande de Gaza. Une nouvelle vient de tomber: le porte-parole du président russe a confirmé que Donald Trump aurait invité Vladimir Poutine à rejoindre ce conseil. Que va faire exactement cet organisme, et quelle en sera l’efficacité dans le contexte actuel?
Alexandre Douguine: Je pense que Trump, après s’être retroussé les manches, s’est lancé dans une refonte radicale de la carte politique mondiale. Le droit international, incarné par l’ONU, reflétait un équilibre des puissances vieux de près d’un siècle — un monde bipolaire dans lequel deux superpuissances dialoguaient, tandis que tous les autres pays ne servaient que de figurants. Lorsque l'URSS a commis un suicide géopolitique, ce système a effectivement dépassé sa date de validité. Les Américains ont à plusieurs reprises évoqué la dissolution de l’ONU et son remplacement par une sorte de «Ligue des démocraties», où au lieu du dialogue, il y aurait un monologue américain accompagné du silence approbateur de l’audience.
Aujourd’hui, l’Occident collectif s’est divisé en ces cinq blocs que nous venons d'évoquer. Chacun a son propre programme, mais le tandem Trump–Netanyahu se démarque en particulier. Ce dernier proclame de plus en plus ouvertement être le «roi des Juifs», mettant en œuvre le projet messianique d’un «Grand Israël». Les idées d’exterminer les Palestiniens et d’étendre les frontières d’une mer à l’autre, exposées dans des textes radicaux comme La Torah du roi, ne sont plus de simples théories du complot — elles se reflètent dans le symbolisme même de l’IDF.
Trump, en tant que chrétien sioniste particulier, est encombré par de vieilles institutions. Il a besoin de quelque chose de nouveau, et il commence à façonner des structures alternatives — comme le «Conseil de la paix» — autour de la région centrale de sa géopolitique eschatologique. Cette région, c’est Israël et Gaza. Trump veut créer une institution sans activistes mondialistes comme Greta Thunberg et ses flotilles, composée uniquement de ceux qui ne contrediront pas son ami Netanyahu. C’est aussi un modèle unipolaire, mais dans une nouvelle configuration « mystique ».

Quant à l’invitation à Vladimir Poutine pour rejoindre ce conseil : l’information doit encore être vérifiée. Si Trump a réellement fait un tel geste, alors il suppose à tort que notre position sur Israël est plus douce que celle des mondialistes occidentaux. En réalité, nous condamnons catégoriquement le génocide à Gaza et considérons les méthodes de Netanyahu comme absolument inacceptables. Trump espère s’entourer de ceux en qui il a confiance, mais sur la tragédie palestinienne, nos vues ne coïncident probablement pas avec sa vision d’un «nouvel ordre».
Animateur : Cela vient d’être confirmé par Dmitri Peskov, le secrétaire de presse du président. C’est une information officielle, confirmée par le Kremlin: l’invitation à Vladimir Poutine a bien été faite.
Alexandre Douguine: Alors, il est évident que Trump a confiance en nous, et qu’il pense que nous soutiendrons son initiative. Il est également convaincu que ceux qu’il n’a pas invités délibérément à ce «Conseil de la paix» s’y opposeront. Cet événement — l’invitation à Vladimir Poutine — s’inscrit dans la même veine que l’affaire du Groenland. Nous ne sommes pas ravis par le traité d’achat de l’île, mais, en fin de compte, le Groenland nous préoccupe bien moins que le Venezuela, l’Iran, et surtout l’Ukraine. Les Européens eux-mêmes comprennent parfaitement: si Trump absorbe le Groenland, l’Ukraine sera instantanément oubliée — il n’y aura tout simplement plus de temps pour elle.
L’image de Trump comme opposant aux interventions s’est révélée n’être qu’un brouillard politique. Il a promis d’être un «président de la paix», mais en pratique, il intervient calmement où il veut, menace tout le monde de guerre, et transforme efficacement le département de la Défense en un «ministère de l’Offense» ou un ministère de la Guerre. La paix pour lui n’est qu’une façade. Il n’y croit pas vraiment. Son vrai but est de renforcer l’hégémonie américaine aux dépens de tous — de nous, de la Chine, et, comme on le voit, de l’Europe.
Trump considère l’Europe comme un malentendu agaçant, comme une branche rebelle de sa propre chaîne de distribution qui décide de pousser ses propres marchandises dans sa boutique. Leur désobéissance l’irrite bien plus que notre position calme, souveraine et distanciée. Nous ne provoquons pas; nous agissons avec cohérence: tout ce que nous déclarons, nous le mettons en œuvre, et tout ce que nous faisons, nous l'articulons dans un langage qu’il comprend. Cela ne fait pas de Trump notre ami — il est un ami uniquement pour lui-même. Je ne suis même pas sûr qu’il soit un ami du peuple américain, puisque sa politique pourrait finir en catastrophe. Il risque tout, comme un hussard qui a hypothéqué ses domaines, sa famille, et son avenir en jouant aux cartes. Certains joueurs ont parfois de la chance, mais le plus souvent, ils perdent tout d’un seul coup.

Trump est une brute audacieuse qui a tout misé. Les enjeux dans ce Grand Jeu sont portés à leur paroxysme. Ses mouvements sont imprévisibles: l’invitation de la Russie au Conseil de la paix pour Gaza a probablement été faite pour narguer l’Union européenne, pour leur dire: «Regardez ce que je peux faire». Pour les mondialistes qui, lors du premier mandat de Trump, l’ont qualifié d’«agent du Kremlin», cette invitation ressemble à un cauchemar devenu réalité. L'«ami de Poutine» a invité son « ami » — pour eux, c’est la fin du monde connu.
Cependant, il est difficile d’attendre une paix véritable en Palestine: le destin du peuple longuement souffrant repose entre les mains de ceux qu’on peut appeler des bourreaux et des maniaques. La Russie n’a actuellement pas la capacité d’imposer ses conditions dans cette région sans risquer de provoquer la colère de Trump comme il a énervé l’Europe. Cette invitation est une offre que notre président examinera avec la plus grande responsabilité. Nous n’avons pas besoin de dons. Nous verrons si la Chine et d’autres pays des BRICS rejoignent ce conseil — c’est précisément notre conception multipolaire de l’ordre: une alternative, ni basée sur l’ONU, ni mondialiste.
Le monde d’aujourd’hui n’est pas une image en noir et blanc, mais une «philosophie de la complexité» dont le président a parlé lors du sommet de Valdai. Nous sommes dans une situation de mécanique quantique en politique internationale. La mécanique classique, avec son inertie et ses trajectoires calculables de têtes nucléaires en chute, appartient au passé. Ce sont désormais les lois des ondes qui s’appliquent. Des processus extrêmement complexes de superposition sont en cours, qui «s’effondrent» soudainement dans un État-nation particulier: pendant un instant, le premier ministre parle au nom du pays, l’instant d’après, tout redevient un réseau d’ondes où il est difficile de distinguer le début et la fin.
J’étudie quotidiennement les briefings des principaux centres analytiques mondiaux, et j’ai l’impression que personne n’a une compréhension claire de ce qui se passe. Chacun décrit son propre univers avec ses constantes gravitationnelles. Nous avons besoin d’une pensée totalement nouvelle en politique internationale.
Une invitation à un «Conseil de la paix» d’un pays avec lequel nous sommes effectivement en guerre en Ukraine, tout en condamnant l’agression de son allié, Israël, est un paradoxe qu’il faut replacer dans le contexte approprié.
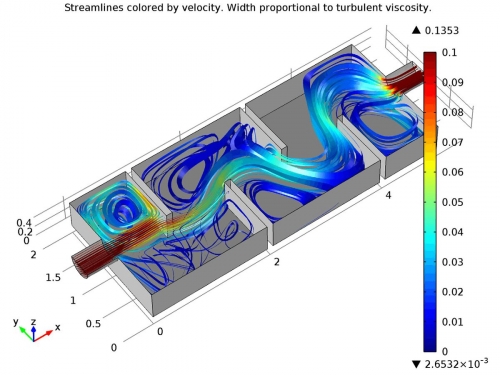
Les anciennes cartes avec des lignes rouges ne fonctionnent plus. Comme le note Sergueï Karaganov, même les armes nucléaires cessent d’être dissuasives dans le sens habituel — la question de leur utilisation directe se pose désormais. Nous sommes dans un état de transition vers une phase nouvelle: l’eau dans la casserole a déjà bouilli ou est sur le point de bouillir. Cette transition stochastique, décrite par les équations de Navier–Stokes et la théorie fractale, se transfère désormais pleinement dans la politique mondiale. Nos analystes doivent abandonner les anciens modèles humanitaires et se tourner vers la nouvelle physique et la théorie des superstructures.
Animateur : Vous avez évoqué la thématique ukrainienne, et sa place dans le contexte actuel est extrêmement intrigante. Selon les publications occidentales, les politiciens européens réécrivent littéralement leurs plans pour l’Ukraine en temps réel: les thèses qu’ils comptaient porter au forum de Davos sont jetées à la poubelle, et toute l’attention se porte désormais sur le Groenland. Pensez-vous qu’il est possible que, désormais, non seulement les États-Unis, mais aussi l’Europe, commencent à s’éloigner progressivement des événements en Ukraine, nous permettant en quelque sorte de mettre fin à ce conflit en tête-à-tête avec Kiev?
Alexandre Douguine: Ce serait l’option optimale, mais je crains que personne ne nous accordera un tel luxe. Bien que je sois convaincu que les jours de Zelensky sont comptés. Il sera certainement «annulé». Il n’est pas certain que Zaloujny le remplacera — quelqu’un d’autre pourrait être installé à sa place. Cependant, nous ne devons pas nous faire d’illusions: Trump lui-même n’est pas prêt à remettre l’Ukraine entre nos mains. De plus, l’existence d’un tel point chaud, terriblement conflictuel, sur notre propre territoire lui profite: c’est un levier classique, un outil pour nous gérer.
Trump ne cédera pas volontairement l’Ukraine. Le plan qu’il propose, prétendument selon nos termes, n’est qu’une tentative de geler le conflit. Ils comptent se regrouper et créer un centre de dissuasion contre nous «au cas où». Je ne pense pas que Trump considère que nous sommes des ennemis existentiels, mais il ne veut certainement pas notre renforcement. Il comprend que la Russie ne peut pas être vaincue, mais aider notre croissance ne fait pas partie de ses plans. Au contraire, son objectif est de nous affaiblir. Par conséquent, nous ne devons pas compter sur sa bonté.
Au contraire, Trump continuera à exercer une pression par des sanctions, et cela pourrait même conduire à des provocations militaires. Trump n’est pas notre ami. Et même si ses opposants le surnomment «ami de Poutine», en réalité, ce n’est pas le cas. Il agit seul, pour ses propres intérêts. Dans sa stratégie — même dans ses versions les plus audacieuses — il n’y a pas l’idée de transférer l’Ukraine à la Russie. Une victoire russe décisive ne fait pas partie de ses plans, ce qui signifie qu’il s’opposera à nous.
Malheureusement, nous devons compter uniquement sur nos propres forces. Nous devons utiliser tout moment favorable: les fluctuations accompagnant un changement de président aux États-Unis, les désaccords en Europe, les scandales de corruption secouant l’Ukraine, et le recentrage de l’Occident sur le Groenland. Tous ces facteurs doivent être pris en compte. Nous n’avons d’autre choix que d’agir en souverains, dans notre propre intérêt et selon notre propre stratégie.
Nous avons besoin d’une stratégie beaucoup plus audacieuse que celle que nous avons actuellement: souveraine, active, rapide et efficace. Si vous voulez, une stratégie à la russe «folle», car en ce moment, nous sommes trop rationnels et trop gentils.
19:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : alexandre douguine, donald trump, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 janvier 2026
Protéger l’Ukraine pour protéger le Groenland? Sur la logique du document de la DGAP allemande sur la «Doctrine Donroe»

Protéger l’Ukraine pour protéger le Groenland?
Sur la logique du document de la DGAP allemande sur la «Doctrine Donroe»
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
La Société allemande pour la politique étrangère (DGAP) a publié début 2026 un mémo (https://dgap.org/en/research/publications/donroe-doctrine-requires-firm-calm-response-europe), qui, sous le mot-clé de «Doctrine Donroe», étudie la politique extérieure de la deuxième présidence de Donald Trump.
Ce document mérite l’attention – non pas parce qu’il convainc nécessairement, mais parce qu’il montre de manière exemplaire comment la politique étrangère allemande est actuellement pensée, encadrée et priorisée.
Tout d’abord, voyons l'argumentation du mémo.
L’autrice décrit la politique extérieure de Trump comme une rechute dans une pensée typique du 19ème siècle: nationaliste, imprégnée de christianisme, ouvertement orientée vers la puissance. Le terme «Doctrine Donroe» doit illustrer que Trump réinterprète la doctrine classique de Monroe – qui consiste à protéger l’hémisphère occidental – de façon renouvelée, plus débridée et plus explicite que les gouvernements américains précédents. Trois éléments la caractérisent: d’abord, un mépris ostentatoire pour les normes internationales; ensuite, un «mercantilisme musclé», où les gains économiques sont garantis et sécurisés par la puissance militaire; et enfin, une approche politique reposant expressément sur le court terme, qui relègue la stabilité, les alliances et les effets secondaires au second plan.

De cette analyse découle une mise en garde sur le plan de la sécurité pour l’Europe – notamment en ce qui concerne le Groenland. Même si une annexion est considérée comme peu probable, la région est interprétée comme un cas-test de la projection de puissance américaine. L’Europe doit donc agir de manière unie, souligner son autonomie et tenter de « faire comprendre » ses intérêts en matière de sécurité aux Américains.
Jusqu’ici, le document reste dans le cadre d’une analyse classique des risques. L'étape décisive intervient cependant ensuite – et c’est précisément là que commence le problème.
En effet, la DGAP conclut que l’Europe – et implicitement l’Allemagne – doit poursuivre résolument et approfondir son soutien à l’Ukraine pour contrer d’éventuelles ambitions expansionnistes américaines. La politique envers l’Ukraine devient ainsi une clé stratégique: preuve de la capacité d’action européenne, signal de fermeté face à Washington, et expression d’un réel sujet politique.
Ce lien stratégique constitue le point névralgique du mémo.
Car c’est ici que différents espaces conflictuels, intérêts et logiques de pouvoir sont connectés de manière fonctionnelle, sans qu’une causalité sécuritaire solide soit établie. Pourquoi des livraisons d’armes et un soutien financier durable à Kiev doivent-ils, en particulier, permettre d’atténuer les ambitions américaines dans l’Atlantique Nord, reste inexpliqué. L'Ukraine n’est pas traitée comme un problème de sécurité autonome, mais comme un instrument symbolique universel de la puissance européenne.
Cela nous amène à la question des intérêts.
Contrairement à certaines critiques, le mémo de la DGAP définit clairement les intérêts européens – et donc aussi les intérêts allemands. Selon lui, ils résident dans le maintien de l’ordre basé sur des règles, dans la cohésion européenne et dans une continuité politique crédible, incarnée principalement par la politique envers l’Ukraine. C’est cohérent – mais extrêmement réducteur.
Car les intérêts allemands ne sont pas formulés comme le résultat d’une priorisation ouverte, mais comme une déduction d’un postulat d’ordre. Divers champs politiques – Arctique, Europe de l’Est, relations transatlantiques – ne sont pas évalués séparément, mais regroupés normativement. Les coûts, risques et alternatives pour l’Allemagne elle-même restent peu analysés : c'est-à-dire les coûts politiques, énergétiques, économiques, fiscaux, sécuritaires.
La politique extérieure apparaît ainsi moins comme un instrument de défense des intérêts de l’État que comme une épreuve de fidélité à l’ordre. Toute déviation ne met pas en danger une position concrète mais toute la crédibilité européenne.
C’est précisément là que réside le danger de telles logiques issues de think tanks. Elles remplacent l’évaluation stratégique par des chaînes d’arguments moralement connotés. Elles relient les conflits, plutôt que de les désolidariser. Et elles définissent la capacité d’agir politique non pas par la réalisation d’objectifs, mais par la continuité d'une attitude.
Conclusion :
Le document de la DGAP est moins une analyse de la politique extérieure américaine qu’un miroir de l’auto-affirmation européenne. Il montre comment les intérêts allemands sont actuellement pensés: fortement liés à l’ordre en place, faiblement priorisés, très symboliques. Mais si l’on veut réellement orienter la politique extérieure allemande selon des intérêts nationaux, il faut précisément commencer ici – et reposer la question à laquelle le mémo répond trop vite :
Qu’est-ce qui sert concrètement l’Allemagne – et qu’est-ce qui sert surtout une certaine vision du monde en matière de politique extérieure ?
19:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, ukraine, groenland, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 19 janvier 2026
Toutes les manœuvres sont possibles en attendant les «midterm elections»

Toutes les manœuvres sont possibles en attendant les «midterm elections»
Nos politiciens et opinion-makers ont vécu une semaine mouvementée. Des rumeurs selon lesquelles le Groenland serait annexé à tout moment par les troupes américaines font haleter de nombreux analystes politiques.
Joachim Van Wing
Source: https://joachimvanwing.substack.com/p/alle-registers-open...
Pas seulement mouvementée, la semaine qui vient de s'écouler... Elle a aussi été éprouvante. «Après le Venezuela, voilà encore ça?!». Nos politiciens européens semblent encore ne pas avoir compris comment le président Trump négocie. La méthode Trump est pourtant très simple:
Le président Trump appelle ses partenaires à la table de négociation. Lorsqu’ils sont tous réunis, il se dirige vers la porte, jette une grenade dans la salle juste avant de la claquer derrière lui. Après le bruit, il revient dans la salle de réunion, ouvre une fenêtre et dit :
«Nous devons parler» (Pippa Malgren, 7 janvier 2026).
Une légère panique règne sur le continent européen. Et cela est d’autant plus surprenant compte tenu des traités et accords limpides conclus au cours des dernières décennies entre le Danemark et les États-Unis. D’où viennent alors toute cette hystérie, cette agitation et cette indignation? Peut-être que nos politiciens et journalistes ne sont guère conscients des traités internationaux qui définissent si précisément le statut du Groenland?
Oui, les troupes américaines sont présentes sur le Groenland. Et ce depuis 1951, lorsque la Guerre froide créait encore un état de bipolarité paralysante. Car, même à cette époque, le Danemark n’était pas une puissance maritime mondiale équipée de sous-marins, de cuirassés et de porte-avions pour fermer les mers du monde, ni de sous-marins soviétiques bloquant l’accès du passage GIUK (Greenland-Iceland-United Kingdom). Seul Washington pouvait assumer ce rôle.
« L’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume du Danemark, en vertu de la Charte de l’Atlantique Nord, concernant la défense du Groenland. »
— Copenhague, 27 avril 1951, Bibliothèque des traités de l’ONU
Après la dislocation de l’Union soviétique, il a fallu attendre jusqu’en 2007 pour que le Groenland ressurgisse de manière significative dans l’agenda géopolitique. À cette époque, le président Poutine expliquait au monde, lors du sommet de Munich, comment la Russie allait progressivement étendre sa présence dans l’Arctique.

Depuis 1951, des troupes américaines patrouillent le Groenland depuis une base aérienne à Thulé, surveillant la façade arctique de l’Atlantique Nord. En 2020, la base aérienne de Thulé a été officiellement transférée à la United States Space Force, et le 6 avril 2023, la base de Thulé a été rebaptisée: elle s'appelle désormais Pituffik. La base abrite une détection avancée de missiles pour le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).
Washington a tenté à plusieurs reprises d’incorporer le Groenland par achat, échange ou annexion militaire.
1867-1868 : l’achat de l’Alaska
Après l’achat de l’Alaska à la Russie en 1867, le gouvernement américain montrait déjà de l’intérêt pour une expansion vers le nord. Le Groenland (ainsi que l’Islande) était considéré comme un territoire potentiellement annexable en raison de sa position stratégique. Les ressources groenlandaises ont été cartographiées, mais aucune offre officielle n’a été faite au Danemark.
1910 : proposition d’échange territorial
Au lieu d’un achat direct, des diplomates américains ont voulu organiser un échange complexe. En échange du Groenland, le Danemark aurait acquis le Schleswig allemand. L’Allemagne aurait été indemnisée par de nouveaux territoires aux Philippines. Ce deal n’a pas abouti.
1946 : offre formelle pendant la Guerre froide
Lorsque la Seconde Guerre mondiale s’est progressivement transformée en Guerre froide, l’administration Truman a proposé au Danemark 100 millions de dollars en lingots d’or pour acheter le Groenland. Le Danemark a refusé de vendre. Les États-Unis ont cependant conservé un droit d’usage militaire pour un ensemble de bases militaires.

1958 : tensions accrues
1958 fut une année particulièrement importante. Le Spoutnik a été lancé. Le Pentagone a rapidement installé le BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System) au Groenland, en Alaska et en Écosse. Alarmé par les avancées technologiques démontrées par l’URSS, le Pentagone a élaboré des scénarios concrets où il invoquait le «droit d’urgence de l’OTAN» et où le Groenland aurait été annexé de façon permanente et immédiate. Mais ce scénario a également disparu dans les plis de l’histoire.
2026 : toutes les manœuvres sont possibles avant les «midterm elections»
L’intérêt accru et soudain des États-Unis pour le Groenland peut s’expliquer par quatre bonnes raisons :
- Les ressources: pour ceux qui en doutaient encore… une course mondiale a été lancée pour acquérir tous les minerais, roches et ressources qu'offre notre croûte terrestre. Le Groenland possède un potentiel formidable pour l’extraction d’argent, de cuivre, d'or, de zinc, de plomb, de nickel, de niobium, de tantale et d'uranium. Au cours des 25 dernières années, la Chine a quasiment pris le contrôle mondial de l’extraction minière, du raffinage, de la transformation et de la commercialisation des minerais, métaux et minerais. Washington prend conscience de cette vulnérabilité et des dangers qu’elle comporte. L’administration Trump intervient en fin de course en mobilisant tous les moyens possibles.

- Les routes maritimes arctiques: les brise-glaces nucléaires sud-coréens, chinois et russes maintiennent la route de l’Arctique libre de glace en permanence, évitant ainsi aux navires militaires et commerciaux de parcourir des milliers de miles en contournant le canal de Suez ou le cap. Avec des bases aériennes et navales en Norvège, en Finlande — et oui, aussi au Groenland —, Washington peut couper les lignes d’approvisionnement chinoises et russes vers l’Europe et l’Atlantique. Sans un point d’appui au Groenland, il ne peut imposer d’embargos ni de blocus.
- La course spatiale: le «space race» est notre première vraie «guerre spatiale». Sans les satellites de communication d’Elon Musk, les forces ukrainiennes devraient arrêter immédiatement leur combat. Starlink est l’unique infrastructure restante permettant aux forces ukrainiennes de communiquer entre elles et de cibler les objectifs russes. La valeur stratégique et opérationnelle de Starlink dans ce conflit ne peut être sous-estimée. Par conséquent, Pékin va très bientôt lancer sa propre alternative à «Starlink» qui aura la même capacité civile et militaire. Les bases de lancement dans la région polaire seront donc essentielles.
- Les midterm elections: le président Trump sait parfaitement ce qui l’attend si lui et les républicains perdent les élections de novembre 2026. Alors, tout son programme législatif sera bloqué, et Donald Trump n’obtiendra rien de validé. Pire encore, comme il le dit lui-même :
« Si nous ne gagnons pas les midterms, parce que si nous ne gagnons pas… ils trouveront une raison de m’infliger un Impeach. Je serai mis en accusation. »
— président Donald Trump, retraite du House GOP, 6 janvier 2026
Cette fois, Trump ne fait pas d’excès. Lui et son cabinet ont en un an éliminé tant de barrières, contourné tant de règles, violé tant de lois, qu’ils n’auront probablement jamais connu le repos. Si l’administration Trump perd sa majorité en novembre, elle sera la cible d’un combat judiciaire sans pitié, qui l’empêchera de fonctionner normalement. Si Trump remporte les midterms, cette chasse sera reportée après la fin de son mandat. Mais une chose est sûre: Trump continuera à être poursuivi sans relâche pour le reste de ses jours.
En conclusion
Il est tout à fait probable que cette administration utilise tous les moyens pour augmenter sa «cote de popularité». Mais les signaux sont sombres. Son intervention unilatérale au Venezuela semble n’avoir pas modifié l’opinion publique. La saisie de navires sous pavillon russe en eaux internationales n’est pas sans danger, et constitue une nouvelle violation. Pour les électeurs réclamant une politique migratoire beaucoup plus stricte, exécuter une jeune femme blanche a été considéré comme "un pont trop loin".
Et tout comme aujourd’hui en Iran, la classe moyenne américaine s’épuise quand les produits de base deviennent inabordables. La dévaluation incessante de la monnaie entraîne une érosion inévitable du pouvoir d’achat et frappe durement les ménages moyens. Beaucoup d’entre eux avaient imaginé cette seconde année de mandat très différemment, et se préparent à ce que les 10 prochains mois leur réservent.
Et pendant ce temps…
Alors que nous, Européens, regardons anxieusement vers le Venezuela, l’Iran ou le Groenland, la Commission européenne continue en toute discrétion à rédiger des textes pour un orwellien «Chat Control » et à signer sans entraves les accords du Mercosur avec l’Amérique du Sud.
13:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, groenland, europe, affaires européennes, donald trump, midterm elections 2026, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 janvier 2026
Et après le Venezuela?

Et après le Venezuela?
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/dopo-il-venezuela/
Ce qui s’est passé au Venezuela, ce qui s’est réellement passé – au-delà de tout le bavardage qu’on nous sert – reste encore enveloppé dans un épais brouillard.
Maduro est entre les mains des Américains. Et il sera jugé aux États-Unis pour trafic de drogue. Une accusation risible, étant donné que le Venezuela est absolument marginal dans la production de cocaïne. Et il faut tenir compte du fait que Trump a récemment gracié et libéré Noriega. Un homme formidable, qui avait transformé le Nicaragua en un centre de production et de distribution de cocaïne. En résumé, un État producteur et exportateur de drogue à l’échelle industrielle.
En outre, Trump n’a pas du tout eu honte de dire clairement que l’opération Maduro, son arrestation et sa déportation, avaient un seul objectif fondamental: le contrôle du pétrole, dont le Venezuela est probablement le plus grand producteur potentiel au monde.
La question de la drogue n’est qu’un prétexte dont le président américain n’a nul besoin. Le Venezuela fait partie de ce « jardin privé », cette arrière-cour, que Washington refuse d’abandonner.
L’opération, selon Trump, s’est déroulée essentiellement sans douleur. Parce que l’armée vénézuélienne a laissé faire, se retirant complètement du terrain et se bornant à regarder.
Sans douleur, au sens où cela ne s’est pas traduit par des pertes humaines, bien qu’au moins quatre-vingts Venezueliens aient été tués. Tous dans l'entourage de Maduro.
Il reste cependant de nombreux aspects obscurs, difficiles à déchiffrer.
Probablement, Trump envisage une transition avec une junte militaire, subordonnée à l’autorité américaine. Ce qui expliquerait la neutralité des militaires et leur attente pendant l’intervention américaine et la capture de Maduro.
Ce dernier ne vient pas des rangs de l’armée comme Chavez, mais des syndicats. Et il a toujours eu des relations difficiles avec les forces armées et leurs dirigeants.
En réalité, ce que s’est passé au Venezuela peut être considéré comme le baromètre d’une scène, et d’un scénario, bien plus vaste.
Et, par ailleurs, comme la seule nouveauté véritable dans un contexte international que l’on peut qualifier de stagnation.
Trump a marqué le territoire, semant inquiétude, voire terreur, dans toute l’Amérique latine.
Lula, le président brésilien, a condamné l’action américaine avec des mots très durs, en invoquant les droits et les conventions internationales. La Colombie et l’Équateur tremblent, se sentant sur la liste des prochaines cibles.
Washington n’est pas disposé à dévier de sa ligne en Amérique latine. Même le Mexique, pour l’instant silencieux, semble très préoccupé.
L’Argentine et le Chili se réjouissent, parfaitement alignés sur le Grand Frère américain.
La Russie a réagi de manière très, peut-être trop, mesurée, laissant entendre que Poutine compte exploiter un accord avec Trump pour prendre le contrôle de vastes zones de l’Ukraine, et annexer le Donbass et Odessa.
La Chine paraît extrêmement irritée. Le Venezuela de Maduro représentait un grand fournisseur potentiel de pétrole, dont l’économie chinoise a un besoin urgent.
Les déclarations de Pékin ont été très dures. Mais ce ne sont que des déclarations. Il faudra attendre pour voir quels accords commerciaux Trump pourra établir avec Pékin, accords sur lesquels il travaille probablement déjà.
Le Venezuela reste, en tout cas, la première véritable nouveauté dans un paysage, qui est, comme je viens de le dire, stagnant.
Un signal que quelque chose bouge au niveau des équilibres internationaux.
Nous en verrons probablement les développements dans les prochains mois.
18:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique internationale, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 05 janvier 2026
Indignation sélective: tempête pour un refus de visa, silence gêné face à l’usage de la force

Indignation sélective: tempête pour un refus de visa, silence gêné face à l’usage de la force
Gastel Etzwane
Source: https://www.facebook.com/Son.Altesse.Emmanuel
Il arrive que la hiérarchie des réactions politiques dise plus que les discours eux-mêmes. À observer les prises de position françaises récentes, une constante apparaît : l’indignation ne semble pas proportionnelle à la gravité des faits, mais à la nature des intérêts touchés.
D’un côté, un responsable européen se voit refuser l’entrée sur le territoire des États-Unis.
De l’autre, ces mêmes États-Unis conduisent une intervention militaire unilatérale au Venezuela, impliquant l’usage de la force armée sur le territoire d’un État souverain.
Dans le premier cas, la réaction française est immédiate, ferme, indignée. Dans le second, elle est étonnamment mesurée, voire accommodante.

Fin décembre 2025, Washington décide d’imposer des restrictions de visa à Thierry Breton (photo), ancien commissaire européen, en lien avec son action en faveur de la régulation des grandes plateformes numériques.
L’affaire est traitée comme un affront politique majeur.
Le président Emmanuel Macron dénonce une mesure relevant de « l’intimidation et de la coercition » à l’encontre de la souveraineté européenne. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, condamne « avec la plus grande fermeté » une décision jugée inacceptable entre alliés. À droite comme à gauche, les qualificatifs pleuvent: «scandale», «atteinte au droit», «geste inamical».
Le vocabulaire est fort, l’émotion assumée, la mobilisation quasi unanime. Le symbole est jugé grave, presque existentiel.
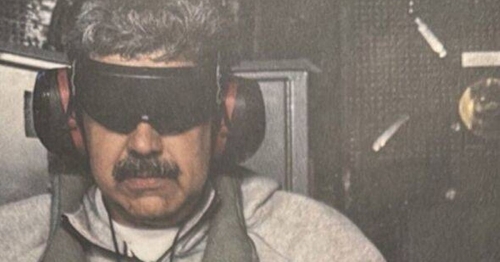
Quelques jours plus tard, début janvier 2026, les États-Unis mènent une opération militaire au Venezuela, sans mandat multilatéral, visant le régime de Nicolás Maduro.
Plusieurs États, hors du bloc occidental, dénoncent une violation du principe de non-recours à la force et de la souveraineté d’un État, fondements pourtant proclamés du droit international contemporain.
La réaction française tranche nettement avec l’épisode précédent. Emmanuel Macron déclare alors:
«Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir»,
appelant à une « transition démocratique ».
La phrase est lourde de sens.
Elle valide le résultat politique, sans jamais interroger la méthode. Aucun mot sur la légalité de l’intervention, aucune référence explicite au droit international, aucune mise en garde sur le précédent qu’un tel usage unilatéral de la force peut créer. La fin justifie les moyens, pourvu que la fin soit jugée conforme aux attentes politiques occidentales.
Le contraste est difficilement contestable.
Un refus de visa, acte administratif sans conséquence humaine directe, provoque une tempête politique et morale.
Une intervention armée, aux effets potentiellement durables et déstabilisateurs, est accueillie par une forme d’approbation implicite, ou à tout le moins par un silence soigneusement calibré.
Ce décalage n’est pas anecdotique.
Vu de l’extérieur, il confirme un reproche ancien et désormais largement partagé: le droit international est invoqué avec emphase lorsqu’il protège les intérêts occidentaux, mais relativisé dès qu’il devient contraignant pour leurs alliés les plus puissants.
Le problème n’est pas l’existence des principes, mais leur application à géométrie variable.
À force de s’enflammer pour l’accessoire et de se montrer conciliant sur l’essentiel, les responsables occidentaux affaiblissent leur propre discours.
Dans un monde multipolaire, cette incohérence n’est plus seulement perçue: elle est analysée, comparée, et de moins en moins acceptée.
Et c’est peut-être là le paradoxe ultime: ce ne sont pas les adversaires de l’ordre international qui le fragilisent le plus, mais ceux qui prétendent en être les gardiens, tout en en modulant l’usage selon les circonstances.
20:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, thierry breton, venezuela, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud, caraïbes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 janvier 2026
Les Américains regrettent d’avoir attaqué la Russie. Les Européens, non. Pourquoi?

Les Américains regrettent d’avoir attaqué la Russie. Les Européens, non. Pourquoi?
Cristi Pantelimon
Source: https://www.estica.ro/article/americanii-regreta-atacarea...
J’ai lu un long article bien informé de Jeffrey Sachs (lien ci-dessous) sur les erreurs stratégiques de l’Occident vis-à-vis de la Russie, depuis la période après les guerres napoléoniennes jusqu’aux accords de Minsk en 2015. Deux siècles durant lesquels l’Occident, selon le professeur américain, a ignoré les demandes fondamentales de sécurité de la Russie, s’est mêlé des affaires russes (notamment entre 1917 et 1920), a pratiqué la double norme (voir le mémorandum de l’historien Pogodin adressé au tsar Nicolas Ier en 1853), a préféré flirter avec Hitler plutôt que d’écouter la volonté de Litvinov d’isoler l'Allemagne nazie, n’a pas tenu ses promesses, ni écrites (Potsdam), ni non écrites (Malte), etc., etc. Tout cela a culminé avec l’idée d’étendre l’OTAN jusqu’à Kiev, ce qui a conduit à la situation que nous avons aujourd’hui.

Je m’attendais à ce que Jeffrey Sachs soit subjectif et « oublie » que les États-Unis sont au moins aussi responsables de l’Ukraine d’aujourd’hui que les Européens l’étaient au 19èmee siècle (on peut aussi mieux comprendre le panslavisme comme une réaction à l’européanisme anti-russe, mais c’est un autre sujet) ; le professeur américain ne fait pas cette omission. Il affirme ouvertement qu’après la Seconde Guerre mondiale, la vision impérialiste américaine a conduit à ignorer la Russie; la note de 1952 de Staline, qui souhaitait une Allemagne réunifiée mais neutre, a été rejetée par Adenauer, homme politique « occidental », et représentant d’une élite qui préférait la tutelle américaine à une russification de l’Europe, c’est-à-dire une entente à long terme avec la Russie. La vision de Brzezinski n’a fait que renforcer cette image de l’impérialisme américain visant à soumettre l’Eurasie par la soumission de la Russie, ce qui impliquait nécessairement la rupture entre l’Ukraine et Moscou, etc.
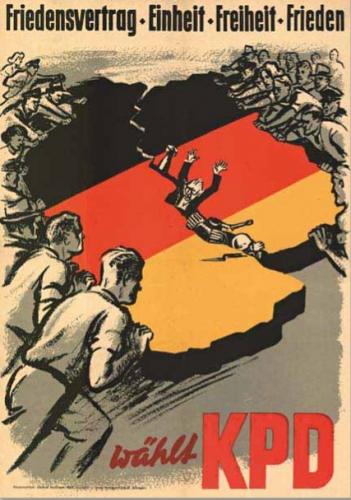
Toute la construction intellectuelle de Sachs voit la Russie comme une victime de l’Occident des deux derniers siècles (il convient de noter que J. Sachs s’appuie sur une bibliographie historiographique occidentale substantielle, qui mériterait d’être étudiée plus attentivement pour comprendre si elle est en accord avec la vision actuelle de Sachs ou non. Personnellement, je pense que ce n’est pas tout à fait le cas, mais je ne veux pas insister).
En résumé, aujourd'hui, ce sont les Américains qui « déposent les armes », ou du moins c’est ce qui semble. Ils sont prêts à réécrire l’histoire des deux derniers siècles pour affirmer la primauté morale de la Russie par rapport à l’Occident. Ce changement est d’une importance epochale.
En Europe, ce processus n’est pas visible. Du moins, pas au niveau de l’élite dirigeante. Il y a suffisamment d’historiens, de théoriciens sociaux (philosophes, sociologues) ou de géopoliticiens qui pensent comme J. Sachs en Europe, mais le message n’a pas encore passé du domaine des professionnels de la pensée à la sphère politique. Les masses sont divisées, mais ce ne sont pas elles qui font l’histoire.
Nous devons nous demander, à la lumière de cette grande reconsidération historique (un véritable révisionnisme historique – voilà à quel point il est important de pouvoir débattre sans entraves du passé, précisément pour nous libérer vraiment de ses erreurs et être plus libres à l’avenir…), pourquoi n’avons-nous pas les mêmes échos en Europe ?
Politiquement, l’Europe reste suspecte de garder le silence en ce moment. À l’exception de la position vague d’E. Macron, l’Europe occidentale semble ignorer le présent et, surtout, ce changement fondamental de vision stratégique qui se passe aux États-Unis.
Il y a deux explications possibles :
- L’Europe se tait parce qu’au moins au cours du dernier siècle, elle a été obligée de faire de la politique américaine en habits européens (de Wilson à Trump…). Aujourd’hui, elle ne sait pas si Trump ira jusqu’au bout ou sera « renversé » par un nouveau Brzezinski, qui attaquera… la Chine aussi via l’Ukraine ! Mais est-ce totalement exclu? Zelenski sanctionne déjà des entreprises chinoises en Ukraine ou menace de le faire. La question est: qui sanctionne en réalité, de sa propre main?
- L’Europe se tait parce qu’elle a elle-même été complice ces dernières décennies de l’expansion de l’OTAN et, surtout après 1989, a voulu compromettre l’OTAN et les États-Unis en adoptant de manière mimétique l’idée d’une expansion illimitée de l’OTAN (au passage, la Russie a tenté deux fois d’entrer dans l’OTAN, en 1954 et en 2000, lors des moments clés de ses relations avec l’Occident – toutes deux ont échoué).
Mais cette complicité de l’Europe pourrait très bien signifier, en pesant le pour et le contre de ce qui s’est passé hier et aujourd’hui, que les Européens ont utilisé les États-Unis pour attaquer la Russie, afin de compromettre les États-Unis et de les affaiblir à l’échelle mondiale.
Les Européens savaient que la Russie réagirait, et leur riposte entraînerait la désintégration de facto de l’OTAN. Et, en effet, les Américains veulent maintenant la paix et souhaitent que l’Europe prenne en charge sa propre sécurité. Les Européens ont obtenu ce qu’ils voulaient: affaiblir les États-Unis en Europe en provoquant la guerre entre l’OTAN (les États-Unis) et la Russie en Ukraine.
Pourquoi prennent-ils autant de temps, les Européens ? Justement pour que ce processus soit finalisé. Plus les Américains restent longtemps dans le conflit en Ukraine, plus ils seront faibles sur tous les autres fronts, du Venezuela au Moyen-Orient en passant par Taïwan. Sans parler de la guerre économique, où la Chine avance en fanfare, ni de l’occasion de se réarmer/ré-industrialiser dans le domaine de la défense sur la base de la menace russe ; une menace qui pourrait être reconfigurée en menace américaine (voir les accents anti-européens aux États-Unis et anti-américains en Europe, qui flirtent avec la diplomatie…).
En résumé, la politique européenne vise à éliminer les États-Unis du continent avec l’aide de la Russie, non directement, mais symboliquement et par épuisement stratégique. Peut-être que, quelque part, en coulisses, la Chine soutient cette entreprise, et que la Russie n’est pas trop triste. Après tout, tout le monde sait que ce qui s’est passé au cours du dernier siècle porte la marque stratégique américaine, peu importe la « tenue » que les acteurs ont portée.
Le silence de l’Europe est suspect.
Après la grande réorientation stratégique américaine, une surprise pourrait suivre : une nouvelle orientation de l’Europe, qui semble pour l’instant être une puissance désemparée ou dont la boussole est restée bloquée… ?
Nous verrons.
Lien:
https://scheerpost.com/2025/12/23/european-russophobia-an...
19:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 décembre 2025
Les 90 milliards qui n’existent pas – le financement de l’Ukraine par l’Europe comme placebo politique

Les 90 milliards qui n’existent pas – le financement de l’Ukraine par l’Europe comme placebo politique
Elena Fritz
Bron: https://pi-news.net/2025/12/90-milliarden-die-es-nicht-gi...
"Merci, cher Friedrich !": L’Ukraine, le pays le plus corrompu du monde, reçoit de l’UE un prêt sans intérêt de 90 milliards d’euros.
Les décisions nocturnes du Conseil européen nous laissent surtout une impression: celle d’un théâtre politique destiné à donner une illusion d’action, là où il ne reste pratiquement plus d’espace de manœuvre. Beaucoup de problèmes semblent résolus, beaucoup de déclarations paraissent grandes – mais en y regardant de plus près, il reste étonnamment peu de substance.
Commençons par le supposé rassurant: les avoirs d’État russes gelés en Europe restent intacts. Malgré des mois de débats, de charges morales et de menaces politiques, Bruxelles n’a finalement pas osé franchir cette ligne juridique. Cela n’est pas tant l'expression de principes propres à l’État de droit, mais plutôt la reconnaissance que la confiscation formelle d’actifs étrangers serait un précédent dangereux – pour le marché financier européen, la confiance des investisseurs internationaux et la crédibilité fragile des garanties de propriété occidentales.
Au lieu de cela, on a présenté un chiffre qui capte mieux l’attention dans les médias: 90 milliards d’euros pour 2026 et 2027, "provenant du budget de l’UE". C’est là que commence le problème.
Car ce budget de l’UE existe déjà – et il est largement planifié. Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 comprend au total 1074 milliards d’euros, soit environ 153 milliards par an. Pour l’Ukraine, aucune ligne budgétaire spécifique n’est prévue. Si l’on mobilisait effectivement 90 milliards d’euros en deux ans, cela représenterait jusqu’à 30% du budget annuel – une ampleur qui bouleverserait fondamentalement la structure financière actuelle de l’UE.
Le budget de l’UE n’est pas un simple coffre-fort, mais le résultat de compromis politiques. Il est principalement alimenté par les contributions de quelques payeurs nets – notamment l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne – et finance des politiques classiques de l’UE: subventions agricoles, projets de transport et d’infrastructure, développement régional. De grands bénéficiaires comme la Pologne en profitent tout particulièrement en chiffres absolus, tandis que des pays comme l’Estonie en profitent en proportion de leur PIB.
Un déplacement massif en faveur de l’Ukraine entraînerait donc inévitablement des perdants au sein de l’UE. Ce que ce vote nocturne ne dit pas. Reste à voir si les programmes existants seront coupés, si de nouvelles dettes seront contractées ou si les règles du budget seront simplement assouplies. Jusqu’à présent, le budget de l’UE est officiellement en équilibre; un déficit structurel serait politiquement délicat et, du moins juridiquement, nécessiterait des explications.

Il n’est donc pas exclu qu’un troisième scénario se dessine: que la référence au "budget de l’UE" soit avant tout rhétorique – un signal politique sans financement assuré. Un simple marqueur pour gagner du temps.
Dans ce contexte, le mécanisme de remboursement choisi est particulièrement révélateur. L’Ukraine remboursera les fonds lorsque la Russie versera des réparations. Cela semble juridiquement net, politiquement élégant – mais c'est économiquement une fiction. En réalité, il s’agit de subventions assorties d’une promesse morale de remboursement. Personne à Bruxelles ne compte sérieusement sur un tel paiement.
Il ne reste donc du grand vote qu’une seule chose: un report. La question fondamentale – qui doit financer à long terme le budget de l’État ukrainien et ses besoins militaires – n’a pas reçu de réponse, mais à été reportée à l’avenir. Chaque euro devra être négocié durement, avec une opposition intérieure croissante dans les États payeurs nets.
L’UE voulait montrer sa détermination, mais a plutôt révélé son épuisement financier. Le problème central n’est pas le manque d’argent, mais le manque de sincérité quant aux limites du possible.
16:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 décembre 2025
Retour aux idées du mouvement MAGA, contre l’UE - La nouvelle « stratégie nationale » de la Révolution conservatrice américaine

Retour aux idées du mouvement MAGA, contre l’UE
La nouvelle « stratégie nationale » de la Révolution conservatrice américaine
Alexandre Douguine
Dans l’émission Escalation de Radio Sputnik, Alexandre Douguine accueille la nouvelle Stratégie de Sécurité Nationale des États-Unis comme un retour à MAGA et à un « ordre des grandes puissances », promettant un retrait de l’interventionnisme mondialiste et déclenchant un tsunami destiné à faire s’effondrer la dernière tentative de croisade libérale de l’UE.
Animateur de Radio Sputnik, Escalation: Commençons par le document qui fait actuellement l’objet d’un débat enflammé en Russie, en Europe, et même en Chine. Je parle de la nouvelle Stratégie de Sécurité Nationale des États-Unis. En particulier, les médias suisses déclarent carrément que ce texte fait en grande partie écho au discours de Munich de notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Alexandre Gelyevitch, selon vous, est-ce vraiment le cas ?
Alexandre Douguine: Vous savez, avec la publication de cette Stratégie de Sécurité Nationale américaine, nous assistons une fois de plus à l’oscillation emblématique de Trump entre le camp MAGA et les néoconservateurs — oscillation dont nous parlons constamment dans nos programmes et que nous suivons de près. Et on peut dire sans détour : la doctrine actuelle a été rédigée spécifiquement au nom de MAGA. C’est la véritable doctrine « Make America Great Again », la voix des opposants résolus au mondialisme et des critiques sévères des thèses néoconservatrices, le noyau même qui a permis à Trump de remporter l’élection.
En substance, cette stratégie est très proche de ce que j’appelais dans mon livre l’«ordre des grandes puissances».
De nos jours, ce terme se fait de plus en plus entendre dans l’espace public — l'«ordre des grandes puissances». Cela signifie que l’Occident ne se considère plus comme le garant de la démocratie, ne s’engage pas dans la diffusion des valeurs libérales, ne se sent pas responsable de toute l’humanité, et ne se voit pas comme faisant partie d’un espace unique avec l’Europe. L’Amérique est désormais seule. Elle aspire toujours à la grandeur, au développement et à la domination, mais elle définit clairement le territoire de cette domination — principalement l’hémisphère occidental, les deux Amériques. C’est de là que vient l’expression «corollaire à la doctrine Monroe». Un corollaire est une addition, un développement d’un certain projet géopolitique, et ce corollaire de Trump est, en essence, l’ordre des grandes puissances.
Que disent Trump et ses soutiens dans ce document ? L’Amérique se préoccupe principalement de deux continents: l’Amérique du Nord (y compris, si vous voulez, le Groenland comme une extension naturelle de l’Alaska) et toute l’Amérique du Sud. C’est leur zone, et ils se la réservent sans condition. Quant au reste du monde, la principale thèse mondialiste selon laquelle la Russie et la Chine sont les principaux adversaires stratégiques a disparu. De telles formulations n’existent plus. La Russie est évoquée de manière plutôt neutre, voire amicale — comme un partenaire potentiel. La Chine est considérée comme une concurrente économique sérieuse et une menace relative, mais plus comme un ennemi au sens traditionnel. L’intervention dans les affaires du Moyen-Orient et dans d’autres zones eurasiennes sera quasiment nulle. L’Afrique a été déclarée zone indifférente, et l’Inde n’est pas du tout mentionnée — c’est-à-dire qu’elle n’est plus considérée comme un partenaire stratégique.
Le résultat est un monde véritablement multipolaire. Trump déclare ouvertement: oui, nous restons la plus grande puissance, nous maintiendrons et affirmerons notre hégémonie, mais nous allons la réduire considérablement. Le rejet de l’agenda mondialiste ouvre objectivement la voie à d’autres pôles — la Russie, la Chine, l’Inde — pour s’affirmer pleinement. Quant au reste, Trump dit simplement : je m’en fiche, créez vos propres pôles ou pas, comme vous le souhaitez. Bien sûr, l’hégémonie américaine reste extrêmement méfiante envers les BRICS et envers toute consolidation d’autres civilisations. Ce corollaire de la doctrine Monroe constitue un défi direct à toute l’Amérique latine, qui sera contrainte de chercher une stratégie commune pour éviter la domination totale des Etats-Unis sur son continent. La même logique s’applique à l’Afrique.
En réalité, il s’agit d’une stratégie profondément anti-européenne. La solidarité atlantique n’est évoquée qu’avec sarcasme et mépris. Elle propose de «partager le fardeau» des dépenses militaires de l’OTAN: l’Amérique renonce à sa responsabilité première en Europe, en laissant seulement quelques positions clés. C’est, en essence, la fin de l’atlantisme en tant que tel. L’Europe doit désormais penser par elle-même et créer son propre pôle civilisateur.
Cette doctrine reflète l’approche même du mouvement MAGA grâce à laquelle Trump est arrivé au pouvoir. Ensuite, il s’en est très fort éloigné: il ne s’est pas vraiment impliqué dans le conflit ukrainien, l’a couvert d’un faux-fuyant plutôt que de proposer une solution réelle, a bombardé l’Iran, a soutenu de façon radicale Netanyahu — il s’est considérablement éloigné de son programme initial. Et dans cette stratégie nouvelle, il revient à ses racines : un retour aux principes du mouvement MAGA.
Il n’est pas surprenant que le document ait provoqué une véritable panique chez les mondialistes — aussi bien en Europe qu’aux États-Unis eux-mêmes. Ils hurlent sur un ton hystérique: qui a écrit ça ? Si la première doctrine de Trump a été rédigée par des néoconservateurs et des mondialistes — Pompeo, Bolton, Pence — maintenant, elle est en train d’être écrite par de véritables supporters de MAGA: Hicks, Vance, Miller. Le paradigme a complètement changé. C’est un réalisme émergent — agressif, hégémonique, mais néanmoins réaliste. L’idée de promouvoir les valeurs libérales a été rejetée une fois pour toutes.
L’Amérique devient une puissance militaire et politique concrète, clairement délimitée, avec des intérêts évidents qu’elle défendra bec et ongles dans son hémisphère. Quiconque se retrouve à mettre des bâtons dans les roues aura des ennuis. Mais il n’est plus question de libéralisme, de démocratie ou de droits de l’homme. America First — point final. Objectivement, le monde multipolaire dont notre président parlait dans son discours de Munich, rejetant les prétentions occidentales à l’universalité et au mondialisme, est désormais en grande partie déclaré par Trump lui-même. Reste à savoir si le successeur de Trump, par exemple Vance, pourra maintenir cette ligne après Trump qui aura alors plus de 80 ans. Ou si, après tout, les néoconservateurs reviendront à l'avant-poste. Pour l’instant, c’est une déclaration de guerre — pas contre nous, mais contre l’élite libérale-globale mondiale.
Animateur: En parlant de l’Ukraine, on entend actuellement dire que Trump n’est pas content du fait que Zelensky ne semble pas accepter son plan de paix. Le fils de Trump suggère même qu’au milieu de toutes ces histoires de corruption, l’Amérique pourrait cesser complètement son implication dans le conflit ukrainien dans les mois à venir. Quelle est la crédibilité de cette hypothèse?
Alexandre Douguine : Le plan que Trump promeut actuellement est précisément celui qui nous convient. Nous lui avons expliqué très clairement: ce qui est acceptable pour nous et avec quoi nous ne pouvons en aucun cas avoir de rapport. Cependant, ce que nous lui avons expliqué et qu’il a apparemment accepté ne sera pas une victoire totale pour nous. Malheureusement, c’est encore un compromis. Ce n’est pas une défaite — en aucun cas — mais ce n’est pas non plus une victoire dans le sens profond du terme. On peut l’appeler une certaine réussite, on peut l’appeler une humiliation de l’Occident idéologique, et c’est indubitablement une défaite personnelle et finale pour Zelensky — mais ce n’est en aucun cas la fin de l’Ukraine en tant que projet, ni la fin de l’Occident en tant que force civilisatrice.
Trump a parfaitement compris cela. Il a compris l’essentiel: s’il veut vraiment sauver l’Ukraine — c’est-à-dire sauver la tête-de-pont de l’anti-Russie, la tête-de-pont russophobe qui s’est construite contre nous depuis tant d’années — il doit immédiatement accepter nos propositions. Pour les mondialistes, pour les Européens, et bien sûr pour Zelensky lui-même, cela représentera une défaite sérieuse et douloureuse. Mais pour l’Ukraine elle-même, cela ne sera pas le cas. L’Ukraine sera sauvée. Et elle sera sauvée dans la but même pour lequel elle a été créée: en tant qu’anti-Russie. Et c’est Trump qui la sauve, en sacrifiant Zelensky et toute une cohorte d’idiots européens qui ne peuvent toujours pas croire à ce qui se passe.
Si Trump, ayant fait tout ce qui était en son pouvoir, se retire simplement du conflit et le laisse à l’Europe et à l’Ukraine — ce qu’il a d’ailleurs laissé entendre à plusieurs reprises, voire dit très ouvertement — ce serait la véritable option idéale pour nous. Oui, nous devrions encore lutter — peut-être longtemps et avec beaucoup de difficulté — mais alors, nous aurions la vraie perspective d’une victoire authentique, complète et irréversible. Toute trêve que nous pourrions conclure maintenant n’est qu’un répit provisoire, et très court. Ni l’Ukraine, ni l’Union européenne, ni même les États-Unis ne continueront à respecter cette trêve une fois qu’ils sentiront qu’ils ont même la moindre possibilité de la violer à nouveau.

Animateur: Si Trump décide de s’attaquer au Venezuela, et que nous développons une alliance avec le Venezuela, comment la Russie doit-elle réagir?
Alexandre Douguine: C’est une question difficile. D’un côté, nous avons une alliance avec le Venezuela, et si nous étions plus forts, nous devrions nous engager pleinement dans ce conflit du côté de Maduro contre l’agression américaine. Mais, malheureusement, nous ne sommes pas dans cette position : toutes nos forces sont complètement mobilisées dans la guerre en Ukraine — comme en Syrie et en Iran. Après la victoire, nous nous engagerons sûrement. Mais pour l’instant, hélas, nous sommes entravés.
Animateur: Commençons cette partie du programme par une déclaration du représentant spécial du président russe, Kirill Dmitriev. Il a dit que les meilleurs diplomates de l’Union européenne sont maintenant en panique. C’était son commentaire sur un rapport de la Pologne selon lequel Dmitriev lui-même et l’homme d’affaires américain Elon Musk auraient décidé de diviser l’Europe. Quelle est la raison de ce genre de discussions sur la division de l’Europe ? Pourquoi Musk est-il redevenu plus actif ? Il a pratiquement disparu de la scène publique pendant un certain temps, et maintenant il a repris sa polémique avec l’Union européenne au sujet de la liberté d’expression et des lois européennes. À quoi cela mène-t-il?
Alexandre Douguine : En réalité, ici, comme dans l’adoption de la nouvelle doctrine de sécurité nationale et dans les négociations sur l’Ukraine, nous voyons la même tendance générale — un puissant mouvement vers un retour au projet original du mouvement MAGA. Parce que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a essentiellement proclamé une refonte complète de toute l’architecture mondiale, et les projets MAGA ont effectivement été lancés. Puis il s’en est éloigné de façon sérieuse et significative. Pendant presque un an — huit, neuf mois — il s’est consacré à des choses complètement différentes: dissimuler les listes d’Epstein, se dérober à la pression énorme exercée par le lobby israélien sur la politique américaine, trahir ses fidèles camarades. En un sens, il a cessé d’être MAGA. Il s’est éloigné de MAGA, à une distance critique. Mais tout cela a commencé exactement comme cela commence maintenant. Et maintenant, il revient — Trump revient, et, par conséquent, Musk revient aussi.

Parce que Musk a clairement reçu le feu vert pour commencer à démanteler l’Union européenne. Les « meilleurs diplomates » dont nous parlons, qui détiennent le pouvoir dans l’Union, sont des ultra-globalistes, des ennemis absolus et irréconciliables de Trump, les adversaires les plus acharnés de sa ligne, de ses idées, de sa vision du monde et de la société. L’hiver dernier, en janvier de l’année dernière, il y a presque un an, Musk a lancé ces campagnes contre Starmer, en soutien à l’AfD, contre Macron. Et en réalité, Twitter — son réseau, interdit en Fédération de Russie — est devenu une plateforme qui a consolidé l’opposition populiste dans chaque pays européen, la portant de la même manière que Soros a jadis soutenu les mondialistes, mais en miroir, dans la direction opposée. Maintenant, Musk a simplement repris les mêmes tactiques, mais à l’envers. Et il a commencé à faire cela il y a un an: en soutenant l’AfD, en soutenant les opposants à Starmer en Grande-Bretagne, Marine Le Pen, Meloni — tous ceux qui s’opposent à l’Union européenne, à l’establishment européen, et soutiennent le populisme européen, si vous voulez.
Et puis, Musk lui-même a été écarté de son poste chez DOGE, l’agence pour l’efficacité gouvernementale. En résumé, il a rompu avec Trump, et en même temps, Trump lui-même s’est lancé dans des stratégies complètement différentes, que Musk a seulement critiquées. Mais Musk s’est retenu. D’abord, il a commencé à critiquer Trump, puis il a fait une pause. Et il a attendu que les fluctuations du trumpisme entrent à nouveau dans la phase MAGA. C’est-à-dire qu’on revient à MAGA. Nous avons commencé cette émission avec cela: en Amérique, on voit que Trump revient à son plan initial, au Plan A, au plan MAGA. Et, bien sûr, Musk s’est immédiatement impliqué activement dans ce processus et continue de s’attaquer à l’Union européenne.
Cette fois, c’est beaucoup plus sérieux. Je pense que la deuxième tentative de MAGA pour démanteler l’Union européenne sera bien plus décisive et cohérente. Cela est confirmé par la nouvelle stratégie de sécurité nationale et par le comportement de l’Union dans la crise ukrainienne, qui contrecarrent constamment les plans de Trump pour sauver l’Ukraine. En ce moment, toutes les conditions sont réunies pour simplement détruire l’Union européenne. Plus personne ne cache rien. Musk dit ouvertement: plus d’UE, détruisons l’Union européenne. Il a toutes les raisons de le faire: il soutient un projet conservateur-populiste high-tech, que les libéraux au pouvoir veulent empêcher simplement de vivre et de respirer.
Je pense que l’Amérique elle-même, Trump, et son équipe de trumpistes, où MAGA commence à sortir de son coma et à jouer un rôle de plus en plus important, ont effectivement commencé à démanteler l’Union européenne. Il ne faut que l’applaudir et, si possible, pousser ce qui tombe déjà. Si nous avions le pouvoir et l’influence pour agir sur l’Union européenne, je suis sûr que nous pourrions envoyer ces «meilleurs diplomates européens» dans l’oubli, des deux côtés. Parce qu’il est impossible d’imaginer quelque chose de plus répugnant, détestable, agressif, cynique, trompeur, toxique, pourri de l’intérieur et répandant cette pourriture au reste de l’humanité, que l’actuelle Union européenne.
Animateur: Et cette amende que la société X a reçue en vertu de la nouvelle législation européenne n’était qu’un prétexte pour Musk pour relancer sa campagne contre l’Europe. Tout cela s’est en réalité produit à la demande de Trump, puisque cela coïncidait avec la publication de la nouvelle stratégie.
Alexandre Douguine : C’est juste un prétexte, mais cela s’inscrit parfaitement dans la fluctuation générale du cap de navigation choisi par l'actuel pouvoir américain — du MAGA aux néoconservateurs et retour au MAGA. Il y a un an, lorsque notre programme Escalation s’est fixé pour objectif de suivre de près ces fluctuations de la politique américaine, nous avons décrit avec précision la logique de formation du nouveau régime trumpiste, comme il s’avère maintenant: il oscillera constamment entre MAGA, en s'approchant du projet MAGA — c'est-à-dire en préconisant l’ordre des grandes puissances — et en s’en éloignant. Évidemment, je ne m’attendais pas à ce qu’il aille si loin, si honteusement et si longtemps, en repoussant tous ses soutiens les plus proches. Mais Trump est une personnalité vraiment imprévisible. Avec la même facilité qu’il les a repoussés, il les a rassemblés à nouveau. Tout comme il a naguère chassé tout le monde, maintenant il a autorisé tout le monde à revenir. L’amplitude de ces fluctuations s’est révélée complètement différente de ce que nous avions prévu lorsque nous avons formulé nos hypothèses, mais l’essence du processus est exactement celle-ci.

Et maintenant, je suis convaincu que Musk a simplement utilisé cette amende comme excuse pour se remettre au travail. Trump lui a donné sa bénédiction silencieuse, et leur relation est progressivement en train de se rétablir. Il a été condamné à plus d’une centaine de millions de dollars, mais dans les premières heures qui ont suivi, X — son réseau, interdit en Fédération de Russie — est devenu la plateforme la plus téléchargée dans tous les pays de l’Union européenne. En d’autres termes, il a déjà gagné. Il a réussi à mettre en exergue la véritable attitude des braves Européens envers leurs détestables gouvernements — c’est, en fait, un vote tacite pour ou contre l’Union européenne. Personne ne défend l’Union européenne aujourd’hui sauf les Eurocrates eux-mêmes, sauf cette clique euro-bruxelloise — un ramassis international de maniaques mondialistes et Starmer, qui les a rejoints, qui est également un maniaque absolu. Ces maniaques tentent maintenant fébrilement de supprimer toute dissidence en Europe. Il circule en ce moment un meme : une photo de Starmer avec la légende « Nous avons une liberté d’expression totale. Quiconque remet cela en question sera immédiatement arrêté». C’est à peu près l’état général des Européens aujourd’hui. Et puisque X n’est pas censuré par lui-même, ils essaient de supprimer ce domaine de liberté. Mais derrière Musk et son réseau se trouve le pouvoir des États-Unis d’Amérique, et Trump a maintenant ouvertement soutenu Musk. Hicks l’a soutenu, Vance aussi. Ils ont dit que censurer la liberté d’expression est sans précédent. En fait, c’est un casus belli, une raison de guerre, un conflit diplomatique et politique direct entre les États-Unis et l’Union européenne. Je pense que cette fois, c’est vraiment très sérieux. Bien sûr, on ne peut pas exclure que Trump se retire encore une fois de sa stratégie MAGA.
 Pourtant, pour l’instant du moins, nous assistons à une nouvelle et puissante vague de retour à MAGA. Tout se déroule strictement selon le plan. L’Union européenne et les États-Unis — en particulier les États-Unis dans leur ensemble — avancent dans cette direction. Bien sûr, les démocrates, les libéraux et les mondialistes ont un point de vue totalement différent. Ils sont en état de panique, ressentent une véritable terreur. J’ai lu les commentaires de McFaul (photo), l’un des mondialistes et architectes de la politique sur la Russie et l’Ukraine: ce sont simplement des appels terroristes, extrémistes, pour renverser le gouvernement en Russie, pour un changement de régime, etc. Il est un ancien ambassadeur, démocrate, mondialiste — et il est tout simplement devenu hystérique: «ce qui se passe, au lieu de combattre la Russie et la Chine, nous sommes en guerre contre nos principaux alliés en Europe!». Il y a une panique totale — en Europe et chez les mondialistes américains.
Pourtant, pour l’instant du moins, nous assistons à une nouvelle et puissante vague de retour à MAGA. Tout se déroule strictement selon le plan. L’Union européenne et les États-Unis — en particulier les États-Unis dans leur ensemble — avancent dans cette direction. Bien sûr, les démocrates, les libéraux et les mondialistes ont un point de vue totalement différent. Ils sont en état de panique, ressentent une véritable terreur. J’ai lu les commentaires de McFaul (photo), l’un des mondialistes et architectes de la politique sur la Russie et l’Ukraine: ce sont simplement des appels terroristes, extrémistes, pour renverser le gouvernement en Russie, pour un changement de régime, etc. Il est un ancien ambassadeur, démocrate, mondialiste — et il est tout simplement devenu hystérique: «ce qui se passe, au lieu de combattre la Russie et la Chine, nous sommes en guerre contre nos principaux alliés en Europe!». Il y a une panique totale — en Europe et chez les mondialistes américains.
C’est sur cette vague que nous surfons actuellement. Et nous pourrions nous réjouir de tout ce qui se passe, sans regard en arrière, s'il n'y avait pas un moment extrêmement problématique pour nous — le plan de paix pour l’Ukraine que Trump promeut. Il ne le fait pas par malveillance; il a simplement son propre agenda, sa propre vision du monde. Il a effectivement exclu la Russie de la liste des principaux ennemis et cibles des campagnes de haine. Nous ne sommes pas fondamentalement importants pour lui; il a d’autres priorités. Et c’est là une différence fondamentale avec l’Union européenne, qui, au contraire, se prépare ouvertement à la guerre contre nous. Il y a eu une vraie scission dans le camp de nos adversaires — et, disons, chez nos ennemis. Si nous avions les outils et la force suffisants pour participer activement à ce processus, je suis convaincu que l’effondrement de l’Union européenne, et la contribution à celui-ci, devraient devenir notre principale tâche étrangère en Europe. Parce que l’humiliation que nous avons subie de la part de l’Union européenne — pas du peuple européen, mais de cette construction euro-bruxelloise — est impossible à pardonner. Ils sont en guerre contre nous; ils financent, arment, soutiennent moralement et politiquement nos ennemis. Ils sont tout simplement l’ennemi. Nous devons appeler un chat un chat: l’Union européenne est un ennemi. A ce titre, elle doit être détruite.

Et nous voyons que les États-Unis aujourd’hui — en particulier la mouvance MAGA de Trump — ont effectivement commencé à la démanteler. Tout le monde s’est aussitôt écrié: regardez, ils sont avec Poutine ! Je pense qu’ils ont une meilleure opinion de nous que ce que nous sommes réellement. Si nous avions de telles opportunités — des représentants officieux dans toutes les capitales européennes, distribuant des biscuits, soutenant tous ceux qui sont prêts à détruire cette structure — nous pourrions établir d’excellentes relations avec une nouvelle Europe : une Europe des nations, une Europe des traditions, une véritable démocratie européenne, avec sa culture et ses intérêts. Il n’est pas certain qu’elle devienne immédiatement notre alliée automatique — j’en doute beaucoup — mais il faut détruire la pathologie que véhicule l’actuelle Union européenne. L’Union européenne, dans son état actuel, doit être détruite.
17:43 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, entretien, actualité, politique internationale, europe, russie, affaires européennes, mouvement maga, maga, états-unis, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 décembre 2025
États-Unis, Russie et Chine redessinent leurs zones d’influence. L’Europe est ignorée

États-Unis, Russie et Chine redessinent leurs zones d’influence. L’Europe est ignorée
Enrico Toselli
Source: https://electomagazine.it/usa-russia-e-cina-ridisegnano-l...
L’Europe, à juste titre, s’est préoccupée des pages consacrées au Vieux Continent dans le nouveau document de sécurité américain. Leur sécurité, non la nôtre. Et le mépris envers la classe dirigeante européenne y est apparu évident. Mais les obtus du Bruxelles des eurocrates et les laquais des différents gouvernements étaient trop occupés à se contempler le nombril, tout en pleurnichant, pour se rendre compte que le document de Trump traite aussi d’autres choses.
Ce qui devrait intéresser l’Italie, si elle avait encore une réelle politique étrangère.
Car, en fait, Trump a annoncé qu’il renonçait à un rôle stratégique en Afrique où, de toute façon, les États-Unis resteront pour garantir des affaires pour les entreprises américaines. Question d’argent, mais sans déclencher des guerres.
En même temps, de Moscou, arrivaient des signaux d’abandon du Moyen-Orient. Un choix obligé pour l'essentiel. Trop de chaos y règne, trop de protagonistes sont en lice, trop de favoritisme en faveur d’Israël. Qu’Erdogan se débrouille, qu’il gère la situation. Et avec lui, il y aura aussi des Chinois, des Indiens, des Saoudiens, des Émiratis.
Il vaut mieux s’occuper de l’Afrique, toujours en collaboration ou en concurrence avec les Chinois, les Turcs, les Indiens, les Saoudiens, les Émiratis. Sans Israël, il est même possible de conclure un accord.
Et qui manque? L’Europe, bien sûr. Parce que seuls les proches de notre Giorgia (Meloni) nationale croient encore à la mascarade du plan Mattei. Certes, les Africains prennent de l’argent qui, pour les contribuables italiens, représente beaucoup, mais par rapport aux investissements chinois et indiens, c’est une misère, et ils concèdent quelques affaires économiques. Mais la non pertinence des Européens est totale.
La non pertinence de l’Europe, la non pertinence de l’Italie. Tant dans les pays d’Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord.
Non pertinents d’un point de vue économique, ce qui est compréhensible. Non pertinents aussi d’un point de vue culturel et, pour l’Italie, c’est encore plus grave.
11:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, états-unis, russie, chine, afrique, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 décembre 2025
Un détritus du passé: la vieillerie OTAN

Un détritus du passé: la vieillerie OTAN
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/detriti-del-passato-la-vecchia-...
Notre monde, celui de la politique internationale, est envahi de débris. Des restes du passé, laissés sur la plage après un naufrage.
Et ces débris, de vieilles babioles désormais inutiles, encombrent le rivage. Rendant, en substance, difficile la compréhension de la réalité.
L'OTAN, c’est un tel déchet. Ce qui reste d’un naufrage. Et pourtant, très peu semblent en prendre conscience. Au moins ici, dans “l’Occident”. Dans cette Europe encore prisonnière des représentations du passé.
Trump, et plus généralement les Américains, ont été extrêmement clairs. L'OTAN, telle qu’elle est, est un vieux bidule. Et, à certains égards, une simple charge inutile que l'on paie encore. En fait, elle est nuisible.
Il ne faut pas croire que cette position provienne uniquement du magnat Trump et de son entourage. Qui, en tout cas, représentent en ce moment le ventre profond de l’Amérique. La majorité avec laquelle il faut compter, malgré la bonne volonté de nos savants de pacotille.
En réalité, cette insatisfaction américaine remonte à longtemps. Et concerne des personnages qui n’ont rien à voir avec Trump et son univers.
Je me souviens que déjà Dick Cheney, l’ombre omniprésente qui se profilait derrière Bush Jr., parlait avec mépris de la “vieille OTAN”. Vieille et inutile, voire un fardeau pour Washington.
Et la guerre en Irak a été menée par une “coalition de volontaires”. Une “coalition de volontaires” qui, selon l’intention de l’administration Bush, devait prendre la place de la vieille OTAN désormais obsolète.
Remplacée par un nouveau système d’alliances “variables”. Plus dynamique, et mieux adapté à la réalité des choses.
En fait, l’Alliance atlantique est un vieil instrument, devenu inutile avec le temps et l’évolution des scénarios internationaux. Un reliquat de la longue période que fut jadis la Guerre froide.
En substance, un vieux jouet à laisser dans le grenier, dans le meilleur des cas.
Et le comportement de Washington devrait nous en faire prendre conscience clairement.
Les accès de psychose fébrile des représentants de l'OTAN, comme cette incroyable caricature de secrétaire général qu'est Mark Rutte, sont à peine tolérés par la Maison Blanche. Qui, désormais, dialogue directement avec les puissances réelles. Moscou, Pékin. Des adversaires, certes, mais avec qui il faut traiter, et, en gros, partager le monde. Chercher de nouveaux équilibres.
Dans ce monde, beaucoup plus compliqué que celui de la Guerre froide, l'OTAN n’a plus aucune raison d’être. Et ce n’est qu’un encombrant et inutile carrosse maintenu en vie par ceux qui en tirent des avantages personnels. Rôle à jouer et argent à palper, pour être clair.
Un résidu d’une guerre (froide) désormais lointaine.
Un déchet inutile de l’histoire.
21:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, otan, atlantisme, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 décembre 2025
Le C5, modèle MAGA de la multipolarité - Une alternative à la domination mondiale de l’ordre unipolaire

Le C5, modèle MAGA de la multipolarité
Une alternative à la domination mondiale de l’ordre unipolaire
Alexandre Douguine
Alexandre Douguine commente la tentative de l’Amérique de construire un ordre multipolaire de grandes puissances en marge du G7 et du mondialisme.
L’idée du C5, ou « Core Five » (le Noyau des 5), en tant qu’alternative au G7, est un projet qui découle directement de l’approche politique et géopolitique du mouvement MAGA dans la politique mondiale. C’est du réalisme politique; c’est un rejet de la mondialisation; c’est la construction d’une nouvelle architecture internationale basée sur les véritables centres de souveraineté dans le monde contemporain.
 Lorsque, il y a un peu moins d’un an, j’ai publié mon livre La Révolution Trump (qui a déjà été traduit dans de nombreuses langues), je lui ai donné le sous-titre suivant: «Un nouvel ordre de grandes puissances». Mais qu’est-ce que «l’Ordre des Grandes Puissances»? C’est précisément la construction d’un système international dans lequel la souveraineté authentique n’appartiendra qu’aux civilisations-États qui possèdent leur propre idéologie, leur propre économie et leur propre géopolitique—des entités véritablement souveraines qui ont déjà prouvé leur viabilité.
Lorsque, il y a un peu moins d’un an, j’ai publié mon livre La Révolution Trump (qui a déjà été traduit dans de nombreuses langues), je lui ai donné le sous-titre suivant: «Un nouvel ordre de grandes puissances». Mais qu’est-ce que «l’Ordre des Grandes Puissances»? C’est précisément la construction d’un système international dans lequel la souveraineté authentique n’appartiendra qu’aux civilisations-États qui possèdent leur propre idéologie, leur propre économie et leur propre géopolitique—des entités véritablement souveraines qui ont déjà prouvé leur viabilité.
C’est, si vous voulez, la version MAGA d’un monde multipolaire. C’est exactement ce dont parlait autrefois le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Cela faisait partie des plans énoncés par plusieurs idéologues du mouvement MAGA comme, par exemple, Steve Bannon. C’était soutenu et étayé—de façon assez critique à l’égard de Trump lui-même—par John Mearsheimer, un excellent représentant du réalisme politique américain. Il s’agit d’une approche froide et dure du concept de souveraineté. La souveraineté ne devrait appartenir qu’aux grandes puissances: «Un nouvel ordre des grandes puissances». En d’autres termes, c’est la version américaine, trumpiste, d’un monde multipolaire, qui diffère assez nettement du modèle BRICS.
Première différence: le groupe BRICS n’inclut pas les États-Unis ni l’Occident; il est construit comme une alternative à eux. Cela est tout à fait logique, car jusqu’à Trump, l’Amérique fonctionnait comme le bastion de l’ordre mondialiste unipolaire. J’ai déjà dit qu’une place pour l’Amérique au sein de BRICS reste ouverte—en fait, en quelque sorte réservée—mais seulement pour une Amérique qui rompe avec la mondialisation.
Deuxième différence: Le groupe BRICS accepte des civilisations qui ne sont pas encore complètement formées. Le monde islamique, qui n’a pas encore atteint l’unité dans le développement d’une stratégie civilisationnelle commune; l’Amérique latine, qui stagne également sur le chemin de l’intégration; et le continent africain. Toutes ces civilisations sont représentées dans le groupe BRICS. En d’autres termes, le groupe BRICS est une multipolarité bienveillante « avec de la place pour croître ». Il inclut à la fois des civilisations-États déjà formées et celles qui doivent encore s’unir. C’est, pour ainsi dire, un «projet d’avenir».
Par conséquent, la différence entre «l’Ordre des Grandes Puissances» et le projet BRICS est que seules les civilisations-États existantes sont reconnues comme souveraines: les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde. Le Japon y est aussi inclus—je pense que c'est pour équilibrer l'ensemble face à la Chine. Le Japon est en effet un pays puissant. S’il pouvait obtenir son indépendance vis-à-vis de l’Amérique, il pourrait très bien devenir un pôle souverain à part entière. Le C5 représente la version américaine de la multipolarité. Dans la dernière version publiée de la Stratégie de sécurité nationale des États-Unis, cette idée est clairement et directement exposée.
L’idée de créer le C5, le « Core Five » (le Noyau des 5), selon la vision des stratèges américains du mouvement MAGA (je souligne: il ne s'agit pas des néoconservateurs, pas des globalistes), signifie donner à cet «Ordre des Grandes Puissances» une sorte de statut de club. Pas encore les bases du droit international, mais un club—cette fois construit de manière totalement différente du G7, qui était rempli de divers nains occidentaux qui ne représentaient rien, comme le Canada.
Tant le G7 que le G20 étaient des clubs mondialistes dominés par l’agenda mondialiste. C’est pourquoi ils sont aujourd’hui complètement insignifiants. Et c’est précisément pour cela que la création d’un club multipolaire véritablement pertinent—le C5—est désormais à l’étude.
Mais comment la stratégie du mouvement MAGA l’envisage-t-elle? Très probablement, les États-Unis voient la création du C5 comme une alternative au groupe BRICS. Cependant, cela peut également être considéré comme un complément au groupe BRICS. Car qu’est-ce qui est fondamentalement important ici? L’absence de l’Europe, de la Grande-Bretagne, du Canada et de l’Australie.
C’est-à-dire l’absence de ces régimes qui, dans leurs derniers spasmes, s’attachent désespérément au projet mondialiste. C’est une géopolitique MAGA authentique, qui—à sa manière—reconnaît la multipolarité.
C’est pourquoi le C5 est une proposition très sérieuse. Bien sûr, elle peut être critiquée; on peut dire que le projet BRICS est meilleur. C’est ce que je pense aussi: le projet BRICS est meilleur à tous égards, sauf un: les États-Unis n’y sont pas. Et tant que les États-Unis et l’Occident n’y seront pas, personne à l’intérieur du groupe BRICS n’ose vraiment défier l'hégémonie mondiale de front. Mais ici, Trump et le mouvement MAGA font un pas en avant qui est intéressant: «Au lieu de se consolider contre nous, rejoignez-nous pour construire ensemble la multipolarité». C’est une question de grande importance et qui exige la plus haute attention. Voyons ce qui peut en sortir.
Nous vivons maintenant à un moment où Trump commence à revenir à sa stratégie MAGA d’origine, dont il s’était éloigné ces derniers mois, à une distance sidérale. Mais le moment du retour est venu. Il n’est pas fortuit qu’à ce moment précis, une proposition ait émergé pour envisager la création du club C5 (Core Five)—un développement extrêmement important, révélateur et extraordinairement intéressant.
L’essentiel est que cette proposition n'englobe pas l’Union européenne, les globalistes, ces Messieurs Soros et Schwab, le forum de Davos, l'inénarrable Macron… Ils sont tous jetés à la poubelle, avec Zelensky et le nazisme ukrainien. C’est vraiment un moment fascinant, où l’Amérique est contrainte de reconnaître la multipolarité, même si elle propose sa propre version de celle-ci.
20:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, c5, core five, multipolarité, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 décembre 2025
Russie et Inde: partenariat stratégique malgré la pression de l’Occident
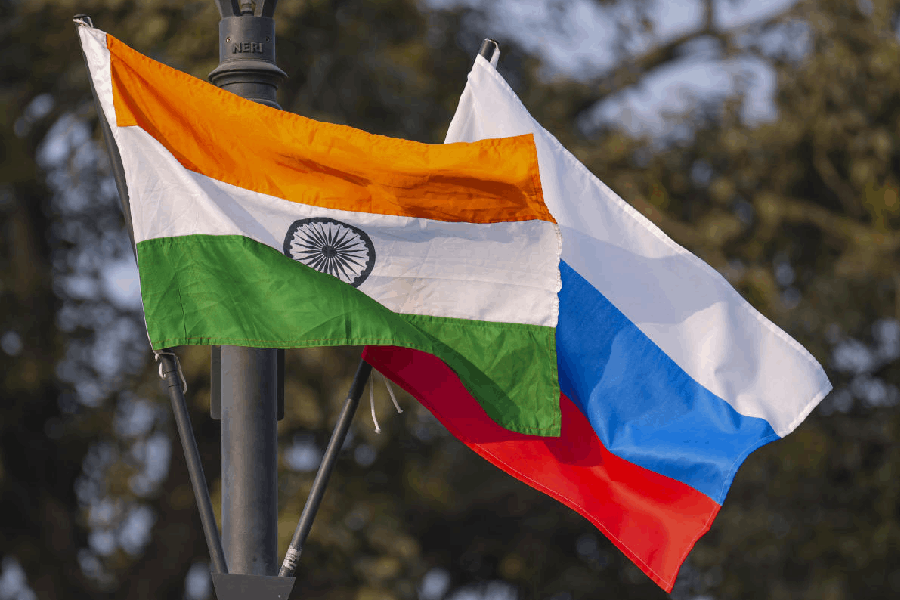
Russie et Inde: partenariat stratégique malgré la pression de l’Occident
Milana Gumba
Du 4 au 5 décembre, le président russe Vladimir Poutine s’est rendu en Inde pour une visite officielle. La dernière visite d’un chef d’État en Inde remonte à une période précédant le début de l’opération spéciale, ce qui donne à cette visite actuelle une dimension historique. Des diplomates des pays de l’OTAN ont accusé la Russie de violation du droit international et ont formulé de nombreuses critiques à l’encontre du Kremlin. La visite du président russe Vladimir Poutine en Inde a secoué certains pays occidentaux — cela leur a envoyé un signal sur la fin de l’ère du monde unipolaire. L’éminent homme politique indien Ram Madhav a, quant à lui, décrit Vladimir Poutine par la phrase suivante: «on peut l’aimer ou le détester, mais on ne peut l’ignorer». Il l’a également qualifié de «chef d’État inébranlable».
Les relations russo-indiennes sont traditionnellement caractérisées comme un partenariat stratégique privilégié, et les visites de haut niveau, notamment celle du président russe en Inde, revêtent toujours une grande importance pour les deux pays.

Aperçu des axes de coopération et des projets prospectifs:
Coopération militaire:
L’Inde demeure le plus grand acheteur d’armements et de matériel militaire russes. La coopération inclut la livraison, la production conjointe (par exemple, les missiles Brahmos - photo), le transfert de technologies, ainsi que la formation des militaires indiens. De nouveaux contrats pour la fourniture et la production sous licence sont en discussion.
L’approfondissement de la localisation de la production en Inde dans le cadre du programme « Made in India », le développement de nouveaux systèmes d’armement, et l’expansion de la coopération militaro-technique dans la maintenance et la modernisation du matériel existant.

Énergie :
La Russie est l’un des plus importants fournisseurs de pétrole et de produits pétroliers pour l’Inde. Le secteur nucléaire connaît un développement actif — la technologie russe et la participation à la construction de la centrale de Kudankulam (photo) en sont un exemple marquant.
Perspectives : augmentation des volumes d’exportation de pétrole et de gaz, développement de la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire civile (construction de nouvelles unités), développement de projets dans les énergies renouvelables, ainsi qu’un approfondissement de la collaboration dans l’exploration d’hydrocarbures.

Commerce et économie :
Le volume des échanges bilatéraux ne cesse de croître, bien qu’un déséquilibre persiste. On travaille activement à la transition vers des monnaies nationales (roupie et rouble) dans les règlements pour réduire la dépendance au dollar.
Diversification de la gamme des produits, augmentation des investissements mutuels, création d’entreprises communes dans des secteurs clés, développement du commerce électronique, simplification des procédures douanières.
Transport et logistique :
Promotion active du corridor de transport international « Nord-Sud » (ICT Nord-Sud), qui réduira considérablement le temps et le coût de livraison des marchandises entre la Russie, l’Inde, l’Iran et d’autres pays de la région.
Achèvement et modernisation des infrastructures du corridor, développement de lignes maritimes directes, optimisation des chaînes logistiques.
Coopération dans les formats multilatéraux :
La Russie et l’Inde collaborent activement dans des organisations telles que BRICS, SCO, G20, ce qui favorise la coordination de leurs positions sur les questions internationales actuelles.
Perspectives : renforcer le rôle de ces organisations, coopérer pour façonner un ordre mondial multipolaire, collaborer sur la sécurité et la stabilité régionales.
Comme l’a conclu Madhav, le voyage de Poutine à New Delhi restera dans les mémoires comme un message puissant au monde sur la fin de l’ère mono-hégémonique. Une telle démarche du président russe montre que l’ère de la multipolarité authentique commence. De plus, cette visite en Inde a été un signe de l’intolérance de Poutine et de la Russie envers les doubles standards dans les relations internationales.
Les visites du leader russe en Inde visent toujours à renforcer davantage le partenariat stratégique, à diversifier la coopération et à parvenir à des accords concrets. Malgré les défis mondiaux, les deux pays montrent leur engagement à approfondir leurs liens, ce qui se traduit par une stabilité dans les contacts au plus haut niveau et par le développement dynamique de projets dans de nombreux secteurs clés. Les perspectives de coopération restent vastes, et ses résultats contribuent au développement des économies des deux pays ainsi qu’au renforcement de leur position sur la scène internationale.
Contexte général de la critique occidentale:
La coopération russo-indienne se déroule dans un contexte de critique accrue de la part des pays occidentaux, en particulier les États-Unis et l’UE, surtout depuis le début du conflit en Ukraine.
Position de l’Occident:
Accusations de soutien à la Russie: les pays occidentaux considèrent la poursuite de la coopération économique et militaro-technique de l’Inde avec la Russie comme un soutien indirect à l’économie russe, et par conséquent à ses actions militaires.
Régime de sanctions: on invite l’Inde à rejoindre les sanctions occidentales contre la Russie et à réduire ses échanges commerciaux, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la défense. On mentionne le risque de «sanctions secondaires» pour les entreprises travaillant avec des structures russes sous sanctions.
Arguments éthiques et de valeurs: l’Occident fait aussi appel aux «valeurs démocratiques» et au droit international, en exhortant l’Inde à adopter une position plus ferme envers la Russie.

Position de l’Inde:
L’Inde maintient une politique de non-alignement et d’autonomie stratégique. Sa politique étrangère repose sur la défense des intérêts nationaux.
Pour l’Inde, en tant que grande économie en développement, assurer la sécurité énergétique est une priorité. Le pétrole russe est proposé à des prix compétitifs, ce qui est crucial pour les consommateurs et l’industrie indiens.
L’Inde a d’importants besoins en défense, notamment face à la tension avec le Pakistan et la Chine. La Russie est un fournisseur éprouvé et fiable d’armements, ainsi qu’un partenaire dans le développement de nouveaux systèmes, ce qui est essentiel pour la sécurité indienne. Passer à de nouveaux fournisseurs serait extrêmement difficile, coûteux et long.
L’Inde partage avec la Russie la vision d’un ordre mondial multipolaire, sans domination d’une ou plusieurs puissances.
L’Inde cherche à maintenir le dialogue avec toutes les parties, y compris l’Occident. Elle participe à des initiatives occidentales telles que le Quad (dialogue quadripartite sur la sécurité), tout en approfondissant ses liens avec la Russie.
Position de la Russie:
«Le pivot vers l’Est»: dans un contexte de sanctions occidentales et de confrontation, la Russie réoriente activement sa politique extérieure et ses relations économiques vers les pays asiatiques, en premier lieu la Chine et l’Inde.
L’Inde est considérée comme un partenaire clé dans la construction d’un nouvel ordre mondial plus multipolaire, moins soumis à la dictature de l’Occident.
En somme, malgré la pression occidentale, la Russie et l’Inde continuent de renforcer leurs liens, en se fondant sur leurs intérêts stratégiques mutuels et la perspective à long terme de la création d’un nouvel ordre mondial. L’Inde jongle habilement entre ses liens traditionnels avec la Russie et ses relations en développement avec l’Occident.
20:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, inde, actualité, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une “Nouvelle” Doctrine de Sécurité Nationale des États-Unis

Une “Nouvelle” Doctrine de Sécurité Nationale des États-Unis
Raphael Machado
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069794930562
Début décembre 2025, la Maison Blanche a publié une nouvelle « Stratégie de Sécurité Nationale », un document dans lequel le gouvernement américain présente ses orientations concernant la sécurité nationale. Dans d’autres contextes, nous avons déjà souligné que la conception américaine de la « sécurité nationale » est unique au monde, étant la seule à englober des événements et des situations qui se déroulent à des milliers de kilomètres de distance.
En général, les conceptions de la sécurité nationale concernent essentiellement les potentiels internes et les risques représentés par l’environnement de chaque pays, incluant au maximum l’accès aux ressources importées considérées comme vitales pour l’économie et la défense.
Traditionnellement, ce n’est pas ainsi que la « sécurité nationale » des États-Unis se définit. Celle-ci est vue comme ayant une portée planétaire, de sorte que des événements dans les recoins de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est ou de l’Asie centrale ont toujours pu être réinterprétés comme affectant la « sécurité nationale » des États-Unis – du moins depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à récemment.
Cette nouvelle doctrine de sécurité nationale apporte une différence significative: l’ampleur de la sécurité nationale des États-Unis est «réduite» à l'«hémisphère occidental», en particulier aux Amériques — même si certains intérêts sont maintenus dans des régions du monde où il y a des ressources stratégiques.
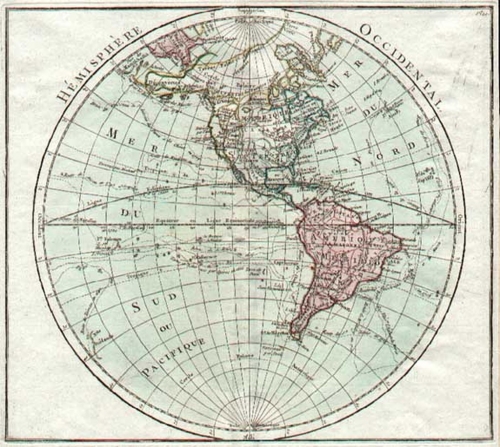
Bonne nouvelle pour la majorité du reste du monde, mauvaise nouvelle pour les pays ibéro-américains.
Ici, on pourrait dire que le document fait une allusion indirecte ou métaphorique à la Doctrine Monroe. Non. Le document a la vertu d’annoncer honnêtement et ouvertement la reprise de la Doctrine Monroe, avec l’ajout d’un corollaire de Trump. Si la version originale de la Doctrine Monroe était principalement dirigée contre la présence espagnole dans les Amériques, et dans une moindre mesure contre la présence d’autres pays européens, sa mise à jour est clairement orientée contre les alliances et investissements russo-chinois dans la région.
Le document admet l’impossibilité de forcer la rupture de toutes ces connexions, en particulier dans le cas de pays qui ont déjà établi des relations profondes et sont hostiles aux États-Unis, mais Washington pense qu’il est possible de convaincre tous les autres pays des Amériques que les accords avec ces partenaires, même s’ils sont moins coûteux, impliqueraient des «coûts cachés» tels que l’espionnage, la dette, etc.
Le problème avec ce genre de narration est que beaucoup de pays de la région sont conscients que les «coûts cachés», lors de relations avec les États-Unis, sont, au mieux, les mêmes. Les scandales d’«écoutes» dirigées contre des cabinets présidentiels ibéro-américains restent encore frais dans la mémoire régionale, tout comme l’historique d’endettement des pays de la région avec le FMI, majoritairement dominé et influencé par les États-Unis.
Il est maintenant clair que les États-Unis utiliseront un ensemble de narrations à la légitimité douteuse pour faire pression en faveur d’une «contribution» à la «lutte contre le narcoterrorisme», par exemple, mais leur véritable objectif sera de garantir l’alignement géopolitique et la reconnaissance de l’hégémonie hémisphérique des États-Unis.
Tout cela n’est pas une nouveauté, puisque dans de nombreux autres articles précédents, j’ai déjà abordé ce sujet.
Dans un article de novembre 2024, où je commente l’initiative Belt & Road en Amérique du Sud, je notais ce qui suit:
« La Doctrine Monroe, qui a fêté ses 200 ans en 2023, était cette directive idéologique qui poussait les États-Unis à éloigner l’Europe de l’Amérique ibérique, afin d’être la seule grande puissance à monopoliser et exercer une influence sur la région. Mais aujourd’hui, la “menace” ressentie par Washington ne provient pas forcément de Paris, Berlin ou Madrid, ou même de Londres, mais de Moscou et Pékin.
C’est autant en raison du renforcement des relations russo-chinoises sur le continent qu’en raison de l’affaiblissement de l’hégémonie unipolaire des États-Unis — plus ressentie en Eurasie, au Moyen-Orient et en Afrique — que les États-Unis entendent se déployer dans une nouvelle impulsion à la Monroe en Amérique centrale et du Sud. Il s’agit d’essayer d’expulser l’«influence» russo-chinoise tout en s’assurant que la seule puissance américaine sera les États-Unis eux-mêmes — pas de puissances extraterritoriales, ni l’ascension d’un quelconque pays américain en tant que puissance. »
En réalité, cela était déjà évident avant le début du nouveau mandat de Donald Trump. Celui-ci, notamment à travers ce document de la Stratégie de Sécurité Nationale, se contente d’expliciter ce qui était implicite depuis 10 ans, puisque depuis le mandat de Barack Obama, on peut identifier une reprise d’un intérêt plus attentif de Washington à l’égard de l’Amérique ibérique. C’est à partir du gouvernement Obama que se multiplient rapidement les cas d’ingérence des États-Unis dans la région (alors que, en contrepartie, le gouvernement Bush se caractérisait par sa focalisation sur le Moyen-Orient et l’expansion rapide de l’OTAN).

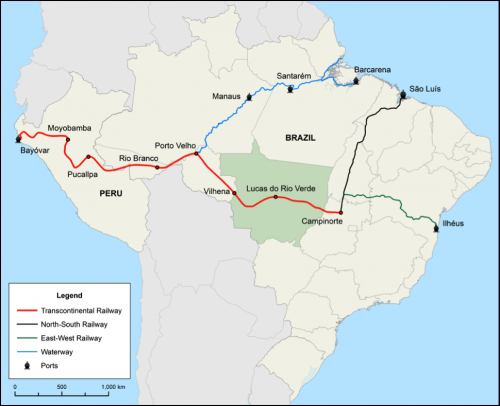

Maintenant, j’ai mentionné plus tôt dans ce texte que tout cela était une «bonne nouvelle pour le reste du monde», même si ce ne l’était pas pour les pays ibéro-américains. «Bonne nouvelle», car le texte de la Maison Blanche indique une reconnaissance de l’inévitabilité de la multipolarité. La nouvelle doctrine américaine critique le caractère géographiquement illimité et indéterminé des intérêts extérieurs dits «stratégiques» des États-Unis. Elle met en évidence un gaspillage de ressources et un manque de concentration, qui ne feraient que nuire à l’atteinte d’objectifs réalistes pour Washington.
En ce sens, implicitement, même si les États-Unis insistent sur une prétention à «aider l’Europe», à «garantir l’accès au pétrole au Moyen-Orient» et à stabiliser la «question taïwanaise», ils reconnaissent, au moins de façon liminaire, l’existence de « zones d’influence » d’autres puissances — mais pas dans les Amériques.
Une répartition du monde selon des lignes multipolaires — un nouveau Yalta — dirigée par les États-Unis ne représenterait qu’une multipolarité incomplète — plus une «tripolarité» sino-russe-américaine qu’autre chose. Le texte est explicite en situant les Amériques dans leur globalité comme subordonnées aux États-Unis, l’Europe comme un «partenaire junior» de fiabilité douteuse, le Moyen-Orient décentralisé au maximum pour le bénéfice d’Israël, et l’Afrique subsaharienne comme un espace de compétition pour les investissements.
Il ne s’agit pas seulement de la Chine et de la Russie en Amérique ibérique, mais aussi d’une interdiction de l’émergence d’une puissance rivale des États-Unis «au sud du Río Grande». D’où aussi l’insistance à garantir l’alignement du Brésil, principal candidat ibéro-américain à devenir un pôle géopolitique autonome.
19:41 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, états-unis, doctrine de monroe, hémisphère occidental |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 décembre 2025
Macron, le Don Quichotte du commerce mondial
Macron, le Don Quichotte du commerce mondial
Par @BPartisans
Emmanuel Macron repart en croisade. Après avoir sauvé — selon lui — l’Europe, l’Ukraine, le climat, la démocratie, la culture, la planète, les dauphins et la dignité humaine, voilà qu’il prétend désormais sauver… le commerce mondial. Comment ? En menaçant la Chine de droits de douane « dans les tout prochains mois ». Une réplique miniature des sanctions américaines, mais servie avec le panache fané de la diplomatie macronienne.
La mise en scène est parfaite : visage grave, ton solennel, posture de chef d’État debout contre les éléments. Mais derrière, c’est le vide. Un vide qu’il faut combler par des annonces tonitruantes. Macron parle non pour agir, mais pour exister. Encore. Toujours.
Le président jure qu’il veut « corriger les déséquilibres massifs » du commerce mondial. Pourtant, il y a quelques mois encore, il qualifiait les droits de douane imposés par les États-Unis de « méthode de chantage des plus forts » qui détruit le libre-échange. (Déclaration officielle, juin 2025.) On appréciera la cohérence : hier, c’était du chantage ; aujourd’hui, c’est du courage.
Même refrain lorsqu’il implore Pékin de « rééquilibrer les échanges et investir durablement » — formulation reprise par plusieurs sources diplomatiques — comme si le simple fait d’appuyer sur la table pouvait redessiner l’économie chinoise. La Chine, rappelons-le, détient plus de 55 % du déficit commercial français hors énergie. Depuis dix ans, la France ne cesse d’importer, tandis que son industrie se délite. Les menaces douanières ressemblent donc moins à une stratégie qu’à une incantation.
Le Financial Times, dans une analyse récente, souligne qu’aucune des démarches européennes n’a fait fléchir Pékin sur sa politique industrielle, massive et assumée. Autrement dit: l’Europe parle, la Chine produit. L’Europe se plaint, la Chine exporte. L’Europe promet des taxes, la Chine hausse un sourcil — et continue.
Mais Macron, lui, a besoin d’exister dans ce théâtre géopolitique où tout le monde l’a dépassé. Washington se concentre sur l’Asie, Londres joue les équilibristes, Berlin tente de sauver son économie… et Paris, faute de leviers réels, menace de sanctions qu’elle n’a même pas les moyens d’appliquer sans se tirer une balle dans le pied industriel.
Car c’est là que sonne le glas : la France dépend massivement des importations chinoises, notamment dans l’électronique, l’automobile électrique, les composants industriels. Chaque droit de douane se traduirait par une hausse des prix, une perte de compétitivité et un coup de massue pour les consommateurs. Derrière la posture martiale, ce sont les entreprises françaises qui paieraient l’addition.
Mais Macron ne calcule plus vraiment : il performe. Tout est devenu spectacle. Diplomatie Twitter, économie PowerPoint, souveraineté TikTok. Il brandit la menace comme un rideau de fumée, espérant masquer le fait que la France n’a plus les moyens de son ambition, ni économique, ni industrielle, ni diplomatique.
Et à force de vouloir exister par l’éclat, Macron pourrait bien provoquer l’inverse : rendre la France inaudible, isolée, et surtout… économiquement vulnérable. Le pire paradoxe d’un président qui confond toujours la scène internationale avec un plateau de théâtre.
Source : https://www.bfmtv.com/economie/international/prenant-l-ex...
@BPARTISANS
16:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, france, emmanuel macron, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 décembre 2025
La communauté de valeurs occidentale se désintègre – l'Europe perd son ancrage stratégique

La communauté de valeurs occidentale se désintègre – l'Europe perd son ancrage stratégique
par Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
La décision du Département d'État américain de ne plus accorder l'accès aux États-Unis aux personnes impliquées dans des activités telles que la vérification des faits ou la modération algorithmique de contenus peut, à première vue, sembler un détail de politique intérieure. En réalité, elle signale une rupture structurelle au sein de cet ordre que l'on qualifiait depuis des décennies de «communauté occidentale des valeurs».
Une communauté de valeurs qui n'en est plus une
Depuis la présidence de Trump, les États-Unis se sont nettement éloignés de la ligne de l'UE sur les questions normatives clés. Aujourd'hui, deux modèles politiques coexistent au sein de cette même communauté de valeurs:
- Le modèle européen, marqué par la régulation, les structures supranationales et une conception normative de la politique visant à organiser la communication sociétale de manière de plus en plus administrative.
- Le modèle américain, qui – du moins sous la direction républicaine – cherche un retour radical à la souveraineté nationale, à la liberté d'expression et à la déréglementation.
La nouvelle directive sur les visas est un symptôme de cette divergence. Elle montre que Washington évalue de manière critique les instruments soutenus par l'État et la société civile en Europe – et n'est plus disposé à les accepter comme expressions de « valeurs occidentales » communes.
Un Occident élargi en distance
Les États de la zone de sécurité indo-pacifique, traditionnellement considérés comme faisant partie de l'alliance occidentale – le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande – s'éloignent également de la logique européenne. Ils s'orientent désormais principalement vers la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine, évitant délibérément de se laisser entraîner dans les conflits européens sur la liberté d'expression, la régulation numérique ou l'identité normative. Ainsi, pour la première fois depuis la fin de la Guerre froide, un Occident pluraliste apparaît, dont la cohésion n'est plus évidente.
L'Europe entre les axes – sans centre de pouvoir propre
Le constat géopolitique plus profond est le suivant:
L'Europe perd son orientation car elle n'est plus un centre stratégique de pouvoir.
- Les États-Unis redéfinissent leurs priorités, devenant plus nationaux et moins multilatéraux.
- L'UE tente de stabiliser son identité politique à travers des projets de régulation et des concepts de sécurité.
- Les partenaires indo-pacifiques privilégient la sécurité régionale plutôt que les normes transatlantiques.
L'Europe, entre ces axes, n'y est pas en tant que créateur, mais en tant qu'espace traversé par des intérêts divergents.

Le point crucial
Ce qu'on appelle la communauté de valeurs occidentale ne fonctionne plus comme un projet stratégique homogène.
Elle est devenue un champ complexe où se juxtaposent différentes visions d'ordre – des visions économiques, politiques et normatives.
Cela a des conséquences:
- Sur le rôle de l'Europe dans la politique mondiale.
- Sur la capacité de l'UE à définir ses intérêts de manière indépendante.
- Et sur chaque débat concernant la souveraineté, la sécurité et la légitimité démocratique.
#géopolitique@global_affairs_byelena
12:18 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, communauté occidentale des valeurs |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 décembre 2025
Trump veut-il vraiment en finir avec la guerre en Ukraine?

Trump veut-il vraiment en finir avec la guerre en Ukraine?
Pierre-Emile Blairon
« Ils ne parlent de « paix » que parce que les lignes ukrainiennes s'effondrent et qu'ils ont besoin de temps et d'espace pour réajuster leur quête de suprématie mondiale, qui dure depuis des décennies, et plus particulièrement leur encerclement et leur endiguement de la Russie et de la Chine. »
Brian Berletic
Psychologie de Trump : un esprit « mercuriel » influencé par le « biblisme »
Il s'agit avant tout de comprendre la psychologie de l’homme occidental contemporain, perturbé, décadent, inconstant et inconsistant, dont Donald Trump constitue un bel échantillon.
Trump, derrière ses emportements souvent agressifs à l’encontre de la planète entière, ses moqueries, ses pirouettes grotesques et ses lourdes blagues est mu par un unique but, il a sa « ligne bleue des Vosges » (on a la ligne qu’on peut, d’autres chefs d’Etat, notamment européens, préfèrent les lignes de coke), son obsession: c’est la suprématie du dollar, qui est pour lui beaucoup plus qu'un simple bout de papier avec lequel "on peut faire des affaires"! C'est, pour le locataire de la Maison blanche, même plus qu'un symbole: c’est sa raison de vivre.

C’est aussi l’horizon et le destin de la plupart des Américains depuis leur rupture avec l'Europe lorsque, le 21 décembre 1620, débarquent du Mayflower, à Cap Cod, 102 colons biblistes, tout imprégnés de l'histoire fantasmée d'Israël, qu’ils assimilent à leur seconde patrie, si ce n’est la première, puisque la première n’existe plus.
Ces Puritains fanatiques fondent la colonie de Plymouth, première ville du Massachusetts; rejetés par leur pays d’origine, l’Angleterre; ils vont prendre leur revanche sur l’Europe tout entière en fondant «le Nouveau Monde», qui est leur «Terre promise», calquée sur celle des Juifs (1). Ils vont donc se donner une philosophie issue de cette croyance et créer un «American Way of Life » qui va se résumer dans une formule en trois mots: Bible and Business.
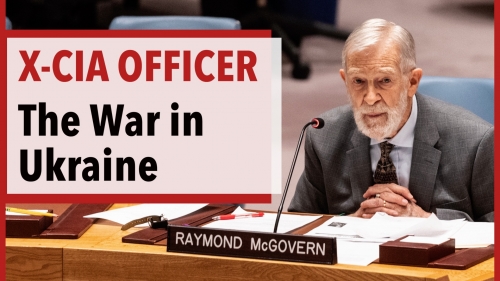
Un éminent conseiller de la présidence américaine, qui a présenté quotidiennement les rapports de la CIA pendant 27 ans aux différents présidents des Etats-Unis alors en exercice, Ray Mac Govern, reçu dans son émission par le professeur Glenn Diesen (2), définit le caractère de Trump comme de type «mercuriel», «c’est le mot qui décrit Trump», dit-il, «Mercure était le patron des escrocs, des voleurs, des tricheurs (3). […] Trump a un tempérament changeant, délirant, narcissique.»
En clair, Trump présente, comme presque tous les dirigeants occidentaux, des troubles du comportement dont la gravité reste à déterminer, si tant est qu’un président des Etats-Unis soit soumis régulièrement, ou plutôt, règlementairement, à un contrôle médical et à la rédaction d’un bulletin de santé. Et encore faut-il que ce contrôle soit effectué dans des conditions qui ne permettent pas de tricher. Cette remarque est valable pour tous les présidents occidentaux en exercice.
L’agression des Etats-Unis et des otano-ukrainiens n’a toujours visé qu’à affaiblir la Russie, et la Chine par ricochet
Depuis l’offensive des Otano-ukrainiens en 2014 contre les populations russophones du Donbass (15.000 morts dont plus de la moitié étaient des civils), les «Européens» n’ont de cesse de falsifier l’histoire.
Luc Ferry, ministre de l’Education nationale de 2002 à 2004, interrogé sur LCI par une «journaliste» agressive et de mauvaise foi, a rétabli magistralement en quelques minutes les vérités concernant l’Ukraine; l’intervention de Luc Ferry nous permet de résumer la situation et les véritables sources du conflit (4).

Brian Berletic (photo) est un ancien Marine américain, auteur, expert en relations internationales et animateur de The New Atlas; selon cet analyste, il apparaît évident que l’Occident (les Américains, la CIA, l'Otan, et leurs satellites: l'Union européenne, l'Israël sioniste, le Mossad), ne veut pas la paix en Ukraine, il cherche juste à faire durer cette guerre le plus longtemps possible afin d’affaiblir par attrition, par usure, les forces russes comme ce fut le cas avec les accords de Minsk sabotés par Boris Johnson, par Hollande, par Merkel.
Le but final de l’Occident est de créer des conflits sur l’ensemble de la planète afin de conserver le leadership économique mondial ainsi que la prédominance du dollar. La Russie et la Chine sont les principaux ennemis de l’Occident global, suivis par les Etats réunis au sein des BRICS.
Les exemples où les Etats-Unis ont agressé des nations souveraines en invoquant des motifs qui relèvent du mensonge d’Etat sont nombreux: Irak, Syrie, Libye, Serbie… Plus récemment l’Iran (5).
Trump n’a fait, sur ce point, que suivre la doctrine américaine mise en place depuis des décennies, qui consiste à entretenir partout et tout le temps des conflits afin, d’une part, de faire travailler le complexe militaro-industriel, d’autre part de contrôler en permanence, et de punir éventuellement, les Etats qui tenteraient d’échapper à l’hégémonie américaine.

Il suffit par exemple, d’évoquer ce qui s'est passé avec le prétendu "cessez-le-feu" de Gaza qui n'a pas été respecté plus de 24 heures par les sionistes; Trump a même osé féliciter Netoyonthou, pardon, Netanyahou d’avoir fait du bon boulot (6) en rasant Gaza et en massacrant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers (nous le découvrirons plus tard) d'enfants, de femmes, de vieillards en toute impunité… et ça continue.
Trump ne changera pas, il a dans son ADN la poursuite du rêve d'hégémonie américaine sur la planète et n'acceptera jamais de voir les Etats-Unis d’Amérique relégués derrière les BRICS.
Trump suit exactement son modèle biblique: c’est le rêve sioniste (7) étendu à l’échelle de la planète: finalement, le « peuple élu », ce n’est pas l’Israël sioniste, ce sont les Américains du «Nouveau Monde»!
L’article que Brian Berletic a publié en fin de semaine dernière, le 21 ou 22 novembre 2025, est riche en informations; en voici un extrait: «L'objectif premier de Washington est en fin de compte de contenir la Chine, ce qui nécessite de coopter ou d'affaiblir la Russie pour avoir une chance d'y parvenir - c'est pourquoi il n'acceptera jamais une paix et une stabilité réelles pour la Russie - il se contentera d'offrir l'illusion de la paix pour obtenir un cessez-le-feu, gagner le temps nécessaire pour sauver et réinitialiser ses mandataires ukrainiens, et continuer comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé (voir : Minsk 1 & Minsk 2 pour plus d'informations).
Les jeux dans lesquels les États-Unis et leurs mandataires totalement sous leur coupe, y compris l'Ukraine et l'Union européenne, font semblant d'être en désaccord sur l'accord, ou même le faux théâtre gauche/droite qui se joue au sein de la politique américaine, offrent simplement aux États-Unis de multiples options pour se sortir de tout accord que la Russie serait assez stupide pour accepter».
Que pensent les Ukrainiens de la proposition de plan de paix établi par l’administration Trump ?
C’est le président de la Verkhovna Rada (le parlement unicaméral d’Ukraine), Rouslan Stefanchuk, probablement «influencé» par Zelensky et les chefs d’Etat européens, qui a été chargé d'annoncer les « lignes rouges » ukrainiennes à ne pas franchir dans les négociations basées sur le plan Trump et ses 28 propositions:
- Aucune reconnaissance juridique de «l'occupation russe» des territoires ukrainiens.
- Aucune restriction sur les forces de défense ukrainiennes.
- Aucun veto sur le droit de l'Ukraine à choisir ses futures alliances.
- Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, rien sur l'Europe sans l'Europe.
- L'Ukraine n'abandonnera jamais sa langue, sa foi et son identité nationale.
Il est bien évident que la Russie n’acceptera jamais de travailler sur ces revendications, dont certaines sont carrément loufoques, et les autres de purs slogans n’ayant aucun lien avec la réalité ni même avec l’histoire du pays.

La députée ukrainienne Julia Mendel (photo), également journaliste et actrice, ancienne attachée de presse de Zelensky, a répondu, le 22 novembre 2025, à Stefanchuk et à ce qui apparaît comme un refus préalable de toute négociation; l’intervention de Julia Mendel démolit la propagande frénétique de nos médias conformistes qui prétendent que la Russie «est à bout de souffle», car elle révèle la réalité brute, c’est-à-dire l’ampleur du désastre auquel se trouve confrontée l’Ukraine, mais aussi tous les gouvernements, essentiellement européens, qui ont soutenu l’agression otano-kiévienne contre les populations de Donbass (15.000 morts):
«En quoi cela diffère-t-il de l'ordre donné par l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson ?
«Nous ne signerons rien avec eux, nous continuons simplement à nous battre»? Cela n'est pas clair?
Chaque accord ultérieur avec l’Ukraine ne fera qu’empirer les choses car nous sommes en train de perdre, nous perdons des hommes, du territoire, et notre économie.
L’U.E. qui, soit dit en passant, a versé à la Russie plus de 311 milliards d’euros d’énergie et de biens depuis février 2022, n’a pas de véritable stratégie, aucun moyen de cesser d’alimenter le budget russe ou de soutenir suffisamment l’Ukraine pour qu’elle gagne, aucun dialogue direct avec Moscou et aucun levier significatif sur le Kremlin ou Washington.
L’argument selon lequel la Russie a «gagné si peu de territoire» paraît presque puéril au regard du coût humain. Nous avons perdu plus d’êtres humains en trois ans que certaines nations européennes n’en ont perdu au total. Mon pays est en train de se vider de son sang.
Nombreux sont ceux qui s’opposent systématiquement à toute proposition de paix, persuadés de défendre l’Ukraine en toute honnêteté. C’est la preuve la plus flagrante qu’ils ignorent tout de la situation réelle sur le terrain et à l'intérieur du pays. La guerre n’est pas un film hollywoodien !
Je n’abandonnerai jamais les valeurs que Dieu et la démocratie placent au fondement même de l’existence humaine; la vie humaine est le bien suprême et ce sont les êtres humains - des êtres vivants- qu’il faut sauver».
N’a-t-on jamais vu, dans l’histoire de la guerre, un pays vainqueur sommé d’accepter les conditions du vaincu ?
Je suis bien obligé de répondre à cette question que je me suis moi-même posée (que les mânes de Clausewitz et Sun-Tzu me pardonnent !): oui. Et par deux fois.
- Oui, parce que c’est exactement ce qui s’est passé avec les troupes françaises qui avaient eu raison de la subversion islamiste en Algérie et qui ont été contraintes de capituler.
Je l’affirme et j’ai la légitimité de l’affirmer parce que j’en ai été témoin et victime: les soldats français qui avaient battu le FLN (les rebelles islamistes) à plate couture en Algérie ont été dépossédés de leur victoire par le général De Gaulle, par leur propre gouvernement, les Français étant obligés de signer les infamants «accords d’Evian» qui, bien sûr, n’ont jamais été respectés par «l’Algérie» dans les rares articles du traité où cette dernière pouvait y voir des effets contraignants.
- Oui, une deuxième fois, et nous revenons à notre époque précisément, car c’est l’Europe d’après-guerre, celle qui est censée avoir gagné la deuxième guerre mondiale qui se retrouve actuellement dirigée par des psychopathes, ce qu’on appelle «l’Europe de Bruxelles», psychopathes qui sont les héritiers d’anciens dignitaires nationaux-socialistes qui, financés par de grandes entreprises américaines lors de la prise du pouvoir d’Hitler, ont été mis en place à la tête des nouvelles structures européennes par les Américains à la fin de la guerre, lors de la création de l’Otan et du Conseil de l’Europe en 1949, de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier en 1951, des Traités de Rome en 1957 (Communauté économique européenne), du Parlement européen en 1958 (8)… Les Ukrainiens qui ont tué de 14.000 à 15.000 habitants du Donbass en 2014 parce qu’ils étaient russophones (ce qui a déclenché l’intervention russe afin d’arrêter le massacre), sont les héritiers du mouvement banderiste, la Légion ukrainienne, fondée par Stepan Bandera qui collaborait avec l’Allemagne nationale-socialiste, les banderistes actuels combattants dans l’armée ukrainienne contre la Russie, l’Ukraine actuelle étant dirigée… par un juif, Volodymyr Zelensky.
Dans cette configuration peu banale, c’est la Russie qui a gagné la guerre contre les Otano-Ukrainiens et c’est l’Occident qui l’a perdue, l’Occident global tel que je l’ai défini plus haut, constitué de plusieurs entités.
Le chef de file occidental étant l’Amérique du Nord, il est bien évident que les Etats-Unis d’Amérique ne reconnaîtront jamais leur défaite (comme dans toutes les guerres qu’ils ont systématiquement perdues), le scénario le plus probable étant que l’administration Trump se défausse sur l’un ou plusieurs de ses satellites ou alliés.

Emmanuel Leroy l’écrit justement: «Il ne s’agissait pas d’une guerre entre l’Ukraine et la Russie, mais du préambule de la guerre entre la Russie et l’OTAN, dans laquelle cette dernière a montré ses limites et, au final, sera contrainte de reconnaître sa défaite. Tout l’art de la diplomatie russe sera de faire avaler cette couleuvre à l’Occident sans trop l’humilier, sachant bien évidemment que tant que ce dernier n’aura pas été vaincu, nous en serons quittes pour attendre la prochaine guerre qui enflammera alors toute l’Europe ou ce qui en restera».

L’analyste Karine Bechet-Golovko (photo), docteur en droit, professeur invité à l’Université d’Etat de Moscou, présidente de l’association franco-russe de juristes Comitas Gentium France-Russie, a, sur la chaîne RT, clairement appuyé là où ça fait mal: «Trump a donné à Zelensky jusqu’au 27 novembre, c’est-à-dire jusqu’à la fête de Thanksgiving, pour accepter son plan de paix. D’un côté, il menace pour la énième fois de peut-être suspendre l’aide militaire à l’Ukraine (qui en réalité n’a jamais été suspendue), d’un autre côté, il affirme ne pas avoir l’intention de lever les sanctions adoptées contre les entreprises russes Lukoil et Rosneft.
De son côté, Vance renforce le discours trumpien visant à faire de la guerre sur le front ukrainien un conflit strictement délimité entre la Russie et l’Ukraine, permettant ainsi de dédouaner les États-Unis, les pays européens, l’Union européenne et évidemment l’OTAN. Il parle bien d’un ʺplan de paix ukraino-russeʺ, qui est censé mettre définitivement fin à la guerre entre ces deux pays – comme si réellement il s’agissait d’une guerre entre deux pays (alors que l’Ukraine, comme État, n’existe plus) et non pas d’une guerre en Ukraine conduite par les élites globalistes.
De son côté, la Russie se dit toujours prête à négocier la paix, sans exclure de continuer à avancer militairement en cas d’échec. Le président russe souligne à ce sujet plusieurs éléments importants.
Tout d’abord, que le régime de Kiev est illégitime, au minimum parce que le mandat de Zelensky a formellement expiré. Ce qui pose la première question: avec qui signer, si jamais il y a quelque chose à signer? D’où la seconde question: quelle serait alors la valeur de la signature de Zelensky? Or, Trump insiste pour que l’accord soit signé strictement entre l’Ukraine et la Russie».
Je ne donnerai qu’un exemple puisé dans la proposition de l’administration Trump d’un plan de paix en 28 points, un point qui me paraît particulièrement aberrant, défiant toute l’histoire des relations internationales en cas de conflit: le groupe belge Euroclear, institution financière, se considérant comme «le notaire du monde financier», détient 183 milliards d’euros appartenant à la Russie; ces fonds sont bloqués momentanément jusqu’à la fin du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Les «Européens» voudraient utiliser ces fonds à la poursuite de la guerre contre la Russie, alors que les Etats-Unis les consacreraient à la reconstruction de l’Ukraine (par des entreprises américaines, bien sûr).
Il va sans dire que ni les Américains ni les Européens ne sont en droit de s’approprier ces biens qui restent la propriété intégrale de la Russie, il s’agirait purement et simplement d’un vol qui serait condamné par toutes les instances internationales, raison pour laquelle Euroclear refuse obstinément de les mettre à disposition des uns et des autres car cette société reste responsable de leur utilisation, respectant les règles internationales établies dans ce cadre.
Que va-t-il se passer ?
Pour conclure, pouvons-nous envisager deux aspects de la situation future?
- La Russie continuera son avancée, vraisemblablement jusqu’à récupérer Odessa, ce n’était pas son intention première qui, à l’origine, consistait en une « opération spéciale » visant à protéger les russophones du Donbass et à stopper la folie meurtrière des Otano-Ukrainiens sur d’innocents civils qui n’avaient pour seul tort de ne savoir parler que le russe; mais, en attendant que ses interlocuteurs veuillent bien formuler des propositions raisonnables sur la fin d’une guerre qu’elle a déjà gagnée, l’armée russe continuera à avancer et à se réapproprier les territoires de l’ancienne «Rus de Kiev», ce qui serait la moindre des compensations après avoir subi une telle agression des globalistes.
- Quant à l’Amérique, son intérêt consistant à maintenir l’état de guerre permanent sur l’ensemble de la planète, on ne voit pas pourquoi elle appuierait toute avancée en faveur de la paix. Elle se contentera vraisemblablement de se désintéresser de cette partie du monde. D’autres guerres l’attendent, comme l’invasion du Venezuela, par exemple.
Notes :
- (1) Voir mon article du 6 avril 2025 : L’Europe est morte ! Vive l’Europe !
- (2) Le dilemme de Zelensky : paix bancale ou défaite totale ? https://www.youtube.com/watch?v=EMtpZi4FMrQ
- (3) Nous ne serons pas étonnés d’apprendre que Mercure, ou Hermès chez les Grecs, est aussi le dieu du commerce et des voyages, que ses attributs sont une bourse (!) qu’il tient à la main, et des sandales ailées.
- (4) Arrêtez de mentir : Poutine n’est pas l’ennemi, c’est l’Ukraine l'agresseur. Tension sur LCI : https://www.youtube.com/watch?v=QhD_qOhosXI
- (5) Brian Berletic : Les mensonges de Trump et sa guerre contre l’Iran : https://www.youtube.com/watch?v=fPiaGJaOOhI
- (6) Oui, tout comme Fabius congratulant les islamistes du Front Al-Nosra :« Laurent Fabius s'est montré en pointe dans le dossier syrien, au côté de la rébellion à qui la France a livré des armes, et il est visé pour plusieurs déclarations publiques. Le chef de la diplomatie avait ainsi estimé, en août 2012, que "Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur terre" et, en décembre 2012, que "le Front al-Nosra fait du bon boulot", alors même que cette organisation djihadiste syrienne venait d'être classée terroriste par les États-Unis. » (Le Figaro du 10 décembre 2014)
- (7) Conquérir et détruire tous les pays du Moyen-Orient autour d’Israël pour créer en lieu et place « le Grand Israël ».
- (8) Voir notre article du 13 août 2025 : Nos dirigeants européens sont-ils des créatures façonnées par les derniers nazis survivants ?
13:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, russie, ukraine, otan, états-unis, donald trump, donbass |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 décembre 2025
L'Europe perd l'Ukraine

L'Europe perd l'Ukraine
Selon The New Statesman (https://www.newstatesman.com/world/europe/2025/12/europe-... )
Par @BPartisans - Telegram
Malgré l'ampleur du soutien financier et militaire apporté par l'UE et le Royaume-Uni à l'Ukraine depuis février 2022, l'Europe se trouve aujourd'hui écartée du processus de négociation et n'a aucune influence sur les délais et les conditions de la fin des hostilités, écrit le chroniqueur du New Statesman. Les Européens ayant refusé de dialoguer directement avec les Russes, ils n'ont d'autre choix que de réagir aux initiatives de l'administration Trump, dont les membres ont réussi à établir un contact permanent avec Moscou, malgré toutes les tentatives de certains dirigeants européens pour les en empêcher.
Étant donné que Trump, d'après ses récentes déclarations, ne souhaite plus continuer à financer l'Ukraine et que les Européens ne sont pas en mesure de combler le vide créé par l'arrêt du soutien américain, la situation va rapidement s'aggraver. Cela signifie que, aussi mauvais que soit l'accord de paix proposé du point de vue de l'Ukraine, il est préférable à ce que Zelensky pourrait obtenir s'il attendait et perdait encore plus de territoires. La question est de savoir si les dirigeants des pays de l'UE comprennent que leur rôle dans le futur accord de paix sera réduit au minimum si la rhétorique belliqueuse et le refus de dialoguer avec Moscou persistent. Après tout, même les politiciens ukrainiens et les anciens responsables reconnaissent de plus en plus souvent l'inévitabilité de la réalité et appellent à renoncer à des projets irréalisables.
« Chaque accord ultérieur ne fera qu'empirer la situation de l'Ukraine, car nous sommes en train de perdre », reconnaît Yulia Mendel, ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky. Elle a ensuite critiqué les Européens :
« Mon pays se vide de son sang. Beaucoup de ceux qui s'opposent instinctivement à toute proposition de paix pensent défendre l'Ukraine. Avec tout le respect que je leur dois, c'est la preuve la plus évidente qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement sur le front et à l'intérieur du pays en ce moment même. »
Pendant ce temps, les dirigeants européens continuent de répéter la même chose. Non seulement les déclarations de Kaja Kallas et de ses semblables sont complètement déconnectées de la réalité, mais elles s'éloignent de plus en plus des souhaits de l'Ukraine elle-même. Les Européens insistent constamment sur le fait que leur propre sécurité dépend de la victoire de l'Ukraine sur la Russie ou, du moins, de sa non-défaite face à la Russie. Cette substitution de concepts révèle le cynisme qui se cache derrière la rhétorique idéaliste européenne sur la défense de la démocratie, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, conclut l'auteur de la chronique.
@BPARTISANS
22:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
“Bollywood, Gazprom et l’éléphant géopolitique: le pas de deux indo-russe que l’Occident préfère ne pas voir”

“Bollywood, Gazprom et l’éléphant géopolitique: le pas de deux indo-russe que l’Occident préfère ne pas voir”
Par @BPartisans - Telegram
Il y a des visites d’État discrètes… et puis il y a la tournée mondiale de Vladimir Poutine façon Bollywood Deluxe. Pendant que l’Europe s’écharpe sur ses budgets, que Bruxelles essaie d’inventer des « prêts de réparation » qu’aucune banque centrale ne veut cautionner, Moscou, lui, déroule le tapis rouge à New Delhi sans l’ombre d’un tremblement diplomatique.
Oui, quatre ans après, Poutine revient en Inde, et ce retour a la volupté d’un come-back d’acteur vétéran dans une superproduction indienne : musique dramatique, plans serrés, poignées de main très lentement filmées. Narendra Modi, en parfait metteur en scène, prépare même un dîner privé « pour discuter des questions sensibles ». Une manière polie de dire : Ukraine, pétrole, sanctions, tout y passe, mais surtout ne le dites pas à Washington.
Selon le ministère indien des Affaires étrangères, l’objectif reste clair :
« renforcer le partenariat stratégique particulièrement privilégié indo-russe » — formulation officielle, assumée, répétée, martelée. En Occident, on appelle ça « dépendance ». En Inde, on appelle ça « souveraineté ».
Le commerce, cet éléphant dans la salle que personne n’ose regarder
Les chiffres sont éloquents: 70 milliards de dollars d’échanges selon les données indiennes du commerce extérieur pour 2024-2025. Et New Delhi vise les 100 milliards d’ici 2030. Pendant que l’Europe se félicite d’avoir « réduit sa dépendance énergétique » en achetant son GNL russe… via l’Inde, nuance, Modi et Poutine discutent d’optimiser les flux pour éviter que les roupies dorment dans des coffres.
Le ministère indien du Commerce l’a dit officiellement :
« Le déséquilibre commercial est insoutenable. L’Inde doit exporter davantage vers la Russie. »
Traduction : “Vladimir, prends nos médicaments et nos smartphones, sinon nos économistes vont faire un burn-out.”

Défense : l’épine dans le pied de Washington
Ici, le scénario vire au thriller géopolitique.
L’Inde reste le premier client mondial d’armements russes. Le SIPRI le rappelle: 36% de l’arsenal indien est d’origine russe.
Et malgré les menaces américaines sous CAATSA, aucun gouvernement indien — pas même celui très « ami » de Washington — n’a reculé.
Les discussions portent sur :
- Les S-400 : trois systèmes livrés, deux en attente.
- Le Su-57 : sujet tabou pour Washington, sujet très intéressant pour New Delhi.
- La production sous licence : douce musique aux oreilles du complexe militaro-industriel indien.
Comme l’a rappelé l’ambassadeur indien à Moscou:
« L’Inde prend ses décisions de défense de manière indépendante. »
Un concept devenu manifestement exotique à Bruxelles.
Ukraine : Modi en “médiateur du Sud global”
New Delhi répète sa ligne officielle :
« L’Inde appelle à une cessation des hostilités et au dialogue. »
Une position suffisamment vague pour être applaudie par tous et ignorée par chacun.
Mais le timing est savoureux : la visite intervient juste après l’échec du dialogue russo-américain.
Dans le jeu diplomatique actuel, être la seule puissance que Washington, Moscou, Bruxelles et Pékin peuvent encore appeler sans hurler… c’est un luxe que seule l’Inde s’offre.

RT India : la géopolitique version prime time
Poutine lancera personnellement RT India, parce que rien ne marque un partenariat stratégique comme une chaîne télé de propag… pardon, d’« information alternative ».
Moscou y voit un accès direct à un public d’un milliard d’habitants.
New Delhi y voit un moyen d’équilibrer l’influence occidentale dans son paysage médiatique.
L’Occident y verra un complot. Comme d’habitude.
Conclusion : pendant que l’Occident se raconte des histoires, l’Inde écrit le scénario
Cette visite n’est pas un signe: c’est une gifle géopolitique avec anneaux sertis.
L’Inde affirme son autonomie.
La Russie montre qu’elle a toujours des partenaires majeurs hors Occident.
Et Washington comprend — encore une fois — que menacer New Delhi ne fonctionne pas.
Comme l’a dit le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar :
« L’Inde ne se laisse pas dicter ses relations internationales. »
Voilà. Rideau.
Bollywood 1 — Occident 0.
@BPARTISANS
21:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, inde, russie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 25 novembre 2025
UE 2025: le dilemme sécuritaire d'un continent sans souveraineté

UE 2025: le dilemme sécuritaire d'un continent sans souveraineté
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
On pourrait croire que l'UE est actuellement « ignorée » par les États-Unis. Mais cette formulation suppose qu'elle ait été perçue comme un acteur à part entière. La réalité est plus banale – et plus inconfortable: l'UE n'a pas été ignorée. L'UE n'a jamais vraiment été présente à la table des négociations.
En effet, l'UE ne dispose d'aucune substance en matière de politique étrangère dont il faudrait tenir compte. La « politique étrangère et de sécurité commune » n'est pas un instrument souverain, mais une courroie de coordination – joliment emballée, soutenue institutionnellement, mais stratégiquement vide.
Le fait que Washington ignore cette courroie est donc le signe d'un déséquilibre structurel des pouvoirs qui existe depuis des décennies: "L'Europe consomme la sécurité. Les États-Unis produisent la sécurité. C'est le producteur qui fixe les règles du jeu".
Trump, Biden, Harris : les personnes changent, les structures restent
Il y a une illusion que la politique européenne aime cultiver: «Sous Biden/Harris, tout aurait été différent».
Non. Biden aurait fixé les mêmes priorités, mais avec une meilleure rhétorique. Une présidente Harris aurait également maintenu la même architecture de sécurité transatlantique. Le point décisif est le suivant:
- La politique étrangère américaine est structurellement constante.
- Elle ne repose pas sur des personnes, mais sur des intérêts. Et ces intérêts considèrent l'Europe comme un espace géopolitique mais non comme un acteur géopolitique.
L'UE n'a pu « masquer » cette dépendance que parce que Biden l'a présentée sous un jour favorable. Trump ne fait que retirer le vernis. Cela ne change rien à la situation.
Pourquoi l'UE ne peut-elle jamais agir de manière indépendante dans les crises de sécurité?
Le niveau supranational ne fonctionne pas de manière « imparfaite », mais exactement comme il a été conçu: l'UE a pour mission d'intégrer, pas de diriger (et avec le personnel actuel, c'est mieux ainsi). Elle doit modérer, non pas décider. Par définition, elle n'est donc pas en mesure de s'opposer à la politique américaine.
Ainsi, lorsque les négociateurs américains discutent avec la Russie des «options de paix», que l'on approuve ou non leur contenu, il ne s'agit pas d'un scandale. C'est simplement l'expression d'une réalité géopolitique.
Le véritable cœur du problème
L'UE exige « l'implication ». Mais celui qui ne peut projeter de la puissance n'a pas droit à l'implication.
La Russie, elle, dispose de leviers militaires.
Les États-Unis disposent de capacités de sécurité mondiales.
La Turquie dispose de leviers régionaux et d'une diplomatie flexible.
L'Europe ne dispose que de "processus".
C'est là toute l'ironie de la situation: plus l'UE gagne en densité supranationale, moins elle est capable d'agir sur le plan géopolitique. Le travail institutionnel d'orientation ne remplace pas l'autonomie stratégique.
Conclusion:
- Le continent européen exige d'avoir son mot à dire, mais il n'a pas les moyens de le faire respecter. Le continent parle de souveraineté mais il a depuis longtemps externalisé son infrastructure de sécurité.
- Le continent invoque les « valeurs européennes », mais sa réalité stratégique se négocie à Washington, Moscou et Ankara.
Que ce soit avec Biden ou Trump, Harris ou n'importe qui d'autre, l'Europe reste une zone d'influence, et non un centre de pouvoir.
#géopolitique@global_affairs_byelena
17:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 novembre 2025
L'Europe contre Washington: deux plans de paix, une alliance divisée

L'Europe contre Washington: deux plans de paix, une alliance divisée
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Le fait que l'UE élabore désormais sa propre proposition pour un éventuel règlement en Ukraine en dit plus long sur l'état de l'Occident que sur une quelconque avancée diplomatique. Selon le Wall Street Journal, de nombreux dirigeants européens sont mécontents du plan de Washington. Un contre-projet est désormais en cours d'élaboration à Bruxelles, non pas par nécessité de marquer ses propres « priorités » tant que la ligne stratégique des États-Unis reste floue.
Kiev fait preuve d'une retenue notable.
L'Ukraine ne s'est pas encore ralliée au projet européen. Le fait qu'un État dépendant jongle entre deux propositions occidentales montre avant tout le manque d'unité de la politique occidentale. La cohésion transatlantique, tant vantée, existe avant tout comme un discours politique.
Politico parle d'un « très mauvais plan ».
Certains fonctionnaires de l'UE critiquent la proposition de Trump, la qualifiant de « très mauvaise » et présentant certains points comme « favorables à Poutine ». Ce type d'argumentation fait partie depuis des années du répertoire de base des fonctionnaires européens, surtout lorsqu'ils veulent marquer leur distance avec Washington sans avoir à aborder la question de leur propre dépendance.
Moscou n'a pas été informée. Le Kremlin déclare n'avoir reçu aucune indication de la part de Zelensky quant à sa volonté de négocier le plan américain.
Cela souligne le fait que le débat diplomatique actuel se déroule principalement au sein de l'Occident.
Classification analytique
Les États-Unis poursuivent un plan qui sert avant tout les intérêts américains : limitation des coûts, arrêt des dommages géopolitiques, priorisation en année électorale.
L'UE lutte pour donner l'impression d'être capable d'agir, mais reste structurellement dans l'ombre de Washington.
L'Ukraine exploite tactiquement les conflits au sein de l'Occident et évite de s'engager clairement tant que l'on ne sait pas quel projet l'emportera.
Le problème central demeure :
Il n'y a pas « l'Occident », mais une communauté d'intérêts informelle dont les membres poursuivent des objectifs stratégiques de plus en plus divergents. Les plans de paix parallèles rendent ces différences visibles, plus clairement que n'importe quelle déclaration émise lors d'un sommet.
Conclusion :
Il ne s'agit pas d'une avancée diplomatique, mais d'une lutte de pouvoir entre Washington et Bruxelles. La question de savoir si l'un des deux projets servira un jour de base à de véritables négociations ne se décidera pas dans les salles de conférence européennes...
Telegram: #geopolitik@global_affairs_byelena
17:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, ukraine, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 novembre 2025
De l'Eurasie et de la Dernière Guerre Mondiale - Là où l’Occident impose, l'Eurasie répond et l’histoire s’accélère

De l'Eurasie et de la Dernière Guerre Mondiale
Là où l’Occident impose, l'Eurasie répond et l’histoire s’accélère
Luigi D’Angelo Tosoni
Luigi d’Angelo Tosoni explique comment les puissances eurasiatiques aux visions désormais convergentes entrent dans une étape fatale de coordination qui menace de renverser la domination occidentale.
En arrivant pacifiquement, le conquérant souhaite entrer dans notre État discrètement. Pour rendre cela impossible, nous devons choisir la guerre et y être prêts. — Carl von Clausewitz
Quel est le stade exact de développement de l’intégration eurasiatique ? C’est-à-dire, le niveau de conscience de soi de cet ensemble, la coordination de ses parties. Ce n’est pas une question triviale. Et avant d’aborder le concret, évaluons les premiers principes, la genèse.
Construire une unité pour l’Eurasie est une question de survie. Comme nous l’avons déjà dit, le pôle opposé demeure manifestement déterminé et actif dans ses objectifs. L’Occident collectif cherche à obtenir un monopole sur le monde par le biais des mécanismes du soi-disant « ordre international basé sur la primauté du droit » — qui, dès ses débuts, a été un moyen pour arriver à des fins géostratégiques — et mêle capital mondial et pouvoir politique, menant à la nécessité urgente de la formation d’un contrepoids composé d'autres forces.
Le commerce libre, en tant que directive, met en crise le droit public traditionnel et transforme l’appareil de décision en une réalité spectrale. S’il n’est pas associé à une souveraineté étatique correctement organisée pour être absolument efficace (1), l’ouverture à la mondialisation se transfigure inévitablement en soumission au mondialisme.
À l’exception des États-Unis, aucun pays, à ce jour, ne peut se permettre de compter uniquement sur ses propres capacités et ressources pour défendre sa souveraineté. L’impérialisme transatlantique possède d’immenses capacités et ne doit jamais être sous-estimé par tous dirigeants nationaux intelligents. Il a développé, au fil du temps, un levier géopolitique formidable au détriment de ce qui, jusqu’à récemment, était un pôle d’opposition non constitué.
Les aspects qui ont pavé la voie au paradigme actuel vont de l’étouffement économique et du démantèlement de la production — transformant la dépendance en dépendance absolue, et cette dépendance en obéissance — au contrôle culturel et informationnel sur des nations entières — en fin de compte, un consentement fabriqué.
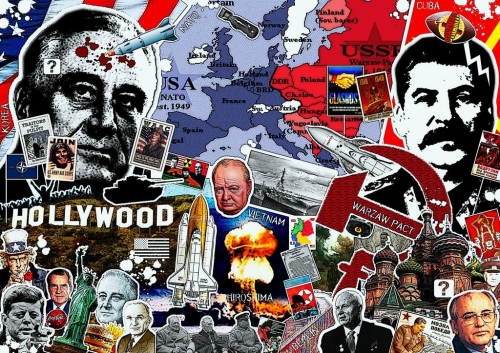
Pendant la bipolarité de la Guerre froide, les institutions multilatérales (telles que le FMI et le GATT) ont renforcé la domination américaine par l’imposition de politiques économiques déterminées, liées à l’économie mondiale. Cela a également pris la forme d’actions militaires directes, cinétiques (2). Comme nous le constatons, la confrontation n’est pas simplement une possibilité, mais une réalité toujours présente.
Même du point de vue des superpuissances russe et chinoise, la survie comporte des conditions strictes. Un processus d’intégration à grande échelle est impératif.
L’unité eurasienne concerne précisément cela. Basées sur la distinction ami-ennemi, les puissances impliquées dans cette lutte identifient, définissent et affinent les conditions de nécessité de l’alliance par le biais de l’interdépendance. Elles savent qui, à l’heure actuelle, est l’ennemi et qui sont leurs amis.
Les concepts politiques eux-mêmes sont formés par des relations d’hostilité. Et puisque l’univers politique est toujours un plurivers, l’hostilité elle-même est constitutive de l’identité (3).
Dès que l'on comprend ce qui est en jeu, tout devient clair. À partir de là, les accords concrets, la coopération et la coordination commencent à couler de source.
Nous avons vu les résultats de la soumission à la domination de l’Occident. En réalité, tout l’espace pan-occidental (de l’Europe à l’Amérique) est le premier prisonnier-sujet de l’expérimentation mondialiste dans toute sa terreur.
Il — le « grand Océan » — réduit son propre centre spatial et ses citoyens à une catégorie secondaire, pire, à de simples outils pour le processus de mondialisation, en les rejetant rapidement en cours de route.
L’espace de ses origines est le plus tragiquement affecté, actualisant le mythe de Chronos et de sa relation à l’altérité humaine.
L’économie spéculative se détache progressivement de la terre, et elle doit commencer à consommer ses habitants.
L’état actuel de nécrose de cette Europe de l’Ouest lointaine, sous humiliation géopolitique, avec ses industries sabotées, son chaos social, ses traditions déracinées, son patrimoine génétique délibérément poussé dans l’abîme… tout cela met en évidence, pour chaque nation du monde, la fin de l’impérialisme atlantique.
Même le traitement actuel des peuples autochtones par leurs gouvernements et par des masses d’immigrants montre les conséquences d’un tel schisme total survenu entre le peuple et les élites.

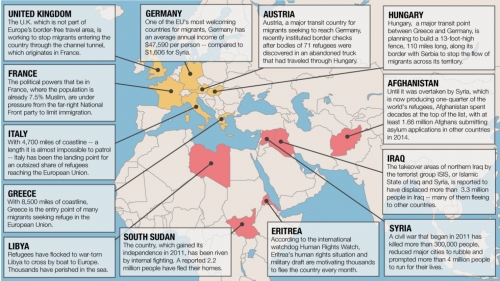
Non pas à cause de la « folie woke », mais à cause d’un projet délibéré: l’Europe devait être réduite à un pion, à un espace plongé dans la servitude.
Les personnalités politiques européennes représentent en théorie des sujets politiques; mais avant toutes choses, ils reçoivent des directives venues de l’étranger.
Les formes politiques et l’establishment, à partir d'une telle situation, les politiques intérieures et étrangères suivent la réalité fondamentale des conditions géopolitiques.
Parce que l’Eurasie signifie un refus conscient du monopole occidental sur la vérité et sur les processus mondiaux, et aussi un rejet de la « spectralisation » découlant de l’entrée de la démocratie de marché et du capital global, la plateforme sur laquelle elle est construite n’est pas celle d’une idéologie partagée, mais celle de l’affirmation de la souveraineté civilisationnelle: la multipolarité.
Alexandre Douguine espérait que l’Amérique pourrait aussi participer à cette transformation de l’ordre mondial en réactivant ses principes isolationnistes et pragmatistes d’antan, mais les États-Unis ont clairement indiqué qu’ils ne renonceraient pas facilement à leur position de policier mondial.
Il est évident qu’ils n’iront plus aussi loin. Pour le meilleur ou pour le pire, l’Amérique participe au processus multipolaire en catalysant de nouveaux alignements et contre-alliances. Dans les mots de l’ancien ambassadeur macédonien Risto Nikovski :
"En politique, comme en physique et en chimie, par exemple, il n’y a pas de coïncidences. Il y a toujours une action et une réaction. Il est impossible que l'un élément disperse, bombarde et détruise sans recevoir une forme de réponse. Au bout du compte, la facture doit être payée. La Guerre froide est bel et bien une réalité aujourd’hui, même si la majorité des gens ne veulent pas l’admettre ou l’accepter. Le choc entre les deux géants, les États-Unis et la Russie, est une réalité qui produira encore davantage de confrontations et de guerres" (4).
La vérité tragique est qu’il n’y aura pas de changement complet dans l’ordre mondial sans une période de transition. Ainsi, cette Troisième Guerre mondiale, ou Seconde Guerre froide, se poursuivra jusqu’à sa conclusion finale. D’abord vient l’affirmation de la souveraineté; puis, eh bien, elle est mise à l’épreuve.

Mener une guerre implique de prendre en compte non seulement les limites militaires des nations directement impliquées, mais aussi, de toute évidence, les capacités d’une puissance majeure qui pourrait également intervenir. Si une petite nation est soudainement désignée pour la destruction par un voisin plus puissant, la seule façon de survivre consiste à amener les responsabilités des résultats de cette guerre vers le haut, dans le grand schéma international, afin que l’attaquant fasse face rapidement à la dissuasion. Un allié puissant peut intervenir pour des raisons liées à la dépendance commerciale, mais surtout pour reconnaître et contrer l’avantage de l’adversaire. L’inaction de la Russie dans l'affaire du Haut-Karabakh — alors que l’Arménie était à l’époque un membre à part entière du CSTO — après l’incursion azerbaïdjanaise de 2020, a encore des échos à ce jour.
Le fait brut (et froid), c'est que, dans le monde d’aujourd’hui, des pays comme le Canada, l’Allemagne et le Japon n’ont tout simplement aucune souveraineté. L’Ukraine et Taïwan non plus. Dans l’ordre international basé sur le Großraum, il ne s’agit pas d’être plus ou moins souverain; cela dépend précisément des mesures de vigilance, d’ingérence et de tolérance venant de telle ou telle grande puissance. Les choix politiques d’un État mineur peuvent radicalement différer lorsqu’ils sont soutenus par l’influence considérable d’un parrain plus fort, avec des implications directes sur la façon dont les conflits tournent à l'escalade. La prise de décision concrète pour intégrer le grand espace eurasiatique revient aux pôles majeurs qui le composent; cela ne revient pas aux petits acteurs. Les relations internationales ont toujours été une incarnation dérivée de réalités plus fondamentales (5).
En 2022, le lancement de l’Opération militaire spéciale a marqué une escalade du conflit décidée par la Russie en réponse à la menace d’expansion de l’OTAN vers l’Ukraine. Conformément à ses calculs spirituels-historiques et à ses impératifs de sécurité nationale (6), la Russie ne pouvait pas le tolérer.
L’ampleur, la gravité et, en fin de compte, le succès de cette décision ont poussé Vladimir Poutine à déclencher une révolution géopolitique. Elle a intensifié un processus en développement depuis 2014, avec l’annexion de la Crimée et le début de la guerre du Donbass. Les Russes, en se montrant sur le champ de bataille puis en repoussant avec force toutes les sanctions imposées par l’Occident, ont montré au monde qu’il était possible de défier l’Occident, que les nations du monde ne devraient pas toutes se soumettre à ce système mondial de politique et de finance internationales, qui ne leur profite pas et se transforme progressivement en un monopole placé entre les mains de je ne sais qui.
Depuis 2022, nous assistons en temps réel à de grandes expansions et à un approfondissement de la coopération entre la Russie et ses principaux partenaires, ainsi qu’entre eux-mêmes, à savoir la Chine, l’Iran et la Corée du Nord. De tels processus ont ouvert la possibilité de former un ordre mondial détaché de l’impérialisme transatlantique et de ses institutions, guidé par des puissances compétentes et confiantes.
Par exemple, la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de la Russie, et le commerce bilatéral a atteint des niveaux records en 2023 et 2024. Les exportations iraniennes vont maintenant pour 34,6% à la Chine, consistant principalement en pétrole, en violation directe des sanctions internationales (7).

La Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord ont également participé à divers exercices militaires conjoints, y compris des exercices navals multilatéraux majeurs dans le golfe d’Oman. De plus, la Chine et la Russie jouent un rôle important dans le renforcement du rôle de l’Iran en tant que puissance régionale. Les deux ont fourni un soutien en renseignements et en militaire aux luttes de l’Iran et de ses proxies.
Dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, la Corée du Nord a atteint un seuil supplémentaire en envoyant des troupes, actives directement sur le front du conflit, pour soutenir l’effort russe. L’Iran a fourni des missiles balistiques à courte portée à la Russie, et au-delà de l’approvisionnement direct en drones, l’Iran a construit une usine de drones sur le territoire russe pour produire des drones iraniens de type Shahed (9). Cela a permis aux Russes de lancer des milliers de drones, en plus de collecter des données pour que les Iraniens puissent développer davantage leur ingénierie militaire.
Pendant la guerre de 12 jours, l’Iran s’est défendu contre les frappes aériennes israéliennes avec des systèmes de défense aérienne russes. Gazprom, de son côté, soutient depuis des années des projets dans l’industrie pétrolière et gazière iranienne, ainsi que Rosatom dans le secteur nucléaire iranien, une relation qui inclut un développement concret sur le terrain.
Les deux pays possèdent d’immenses réserves de pétrole et de gaz et pourraient influencer conjointement le marché mondial de manière favorable à leurs intérêts.
Revenant à la question initiale de l’intégration eurasiatique: elle se développe dorénavant au point d'atteindre un stade très avancé. Bien que la CSTO et l’UEEA soient des plateformes raisonnables pour renforcer la sécurité et les liens économiques, elles ne sont pas strictement nécessaires, et ces partenariats ont déjà dépassé ces cadres.
Il existe de nombreux autres échanges qui ont eu lieu récemment. La réalité demeure que les principaux pôles eurasiens ont déjà trouvé et établi des alignements politiques solides et développent encore leur coopération stratégique en termes d’envergure et d’échelle contre un ennemi clairement défini, et l’intégration découle d’une coopération accrue.
Bienvenue à la Dernière Guerre Mondiale.
Notes:
(1) Ce fut le cas de la Chine, dont le système financier fut libéralisé tandis qu'en même temps, l'Etat se fiait à une vaste panoplie de banques de développement, maintenant ainsi son contrôle sur les industries stratégiques tout en apportant un soutien matériel à la population par une fiscalité et par des subsides adéquats.
(2) Comme ce fut le cas en Yougoslavie, en Irak et en Libye; dans d'autres pays, cela se fit par le truchement de proxies.
(3) Carl Schmitt, La notion de politique (1932).
(4) https://katehon.com/en/article/united-secure-and-strong-e...
(5) Extraits des Notes de prison d'Antonio Gramsci (1971).
(6) Vladimir Putin, “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians” (2021).
(7) https://oec.world/en/profile/country/irn
(8) https://www.reuters.com/world/middle-east/us-says-chinese...
(9) https://en.wikipedia.org/wiki/Yelabuga_drone_factory
12:44 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasie, actualité, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 novembre 2025
Tout est révolution de couleur: l’érosion de l’analytique géopolitique

Tout est révolution de couleur: l’érosion de l’analytique géopolitique
Raphael Machado
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069794930562
Peu de choses ont été plus importantes pour l’analyse géopolitique et la maturation de l’étude de l’histoire politique contemporaine que la construction du concept de "révolution colorée" au milieu de la première décennie du nouveau millénaire pour étudier la Révolution Bulldozer (Yougoslavie), la Révolution Rose (Géorgie) et la Révolution Orange (Ukraine). Peut-être seul le développement du concept de "guerre hybride" a eu un impact comparable.
De manière résumée et neutre, une révolution colorée est une tentative de changement de régime par la massification de protestations (initialement) pacifiques orchestrées à partir de la mobilisation des "organisations de la société civile". D’une manière plus cynique, une révolution colorée consiste en une tentative de changement de régime dirigée contre un gouvernement contre-hégémonique par la mobilisation d’actifs financés depuis des années par des appareils publics ou privés occidentaux.
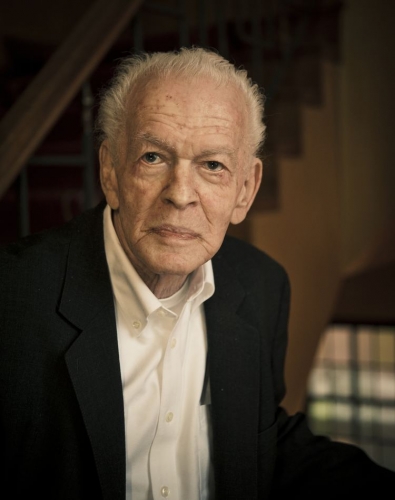
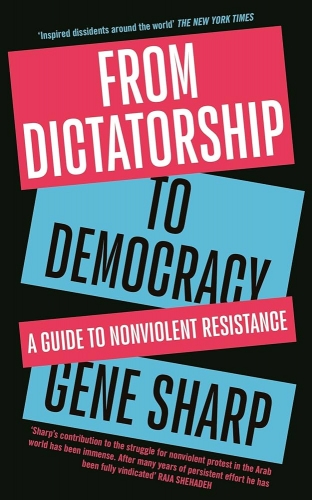
Il existe un modèle ou un moule de la "révolution colorée" typique, qu’on peut retrouver dans le manuel de Gene Sharp sur la "résistance pacifique" contre les "régimes autoritaires".
Avec peu de variations, ce modèle a été appliqué, en plus des occasions déjà mentionnées, en Arménie, en Ukraine une seconde fois, dans les pays arabes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, aux États-Unis, au Brésil, au Bangladesh et dans plusieurs autres pays, avec moins de succès en Russie, en Chine, en Iran, en Inde, au Venezuela, en Turquie et en Biélorussie.
De manière générale, il semble exister une certaine corrélation entre le degré de capacité de l’État à appliquer des mesures d’exception pour faire face aux protestations et son imperméabilité aux révolutions colorées. Les démocraties libérales "non-alignées" sont donc les cibles typiques et les plus lucratives de ce type de tactique.
L’efficacité du concept dans l’analyse de certaines des principales opérations de changement de régime des 25 dernières années, cependant, a assuré que le concept réponde désormais au besoin d’une explication des crises politiques et des vagues de protestations. Tout a commencé à pouvoir être considéré comme une "révolution colorée".
Surtout parce que la majorité de ceux qui suivent l’actualité politique ne savent pas vraiment comment se sont déroulées les révolutions colorées. Ils ont seulement des notions vagues et abstraites sur le "financement externe" et que la cible est un pays "adversaire aux États-Unis".
Comme beaucoup cultivent un certain fétichisme pour le "dissensus", presque tout le monde exagère à quel point leur gouvernement préféré est réellement adversaire des États-Unis sur la scène internationale.
Ainsi, de Kadhafi, Assad et Lukashenko, on en vient à défendre des nullités comme Gustavo Petro et Gabriel Boric contre de supposées tentatives de révolution colorée.

La majorité des cas d’agitation populaire, cependant, ne présentent pas les caractéristiques essentielles d’une révolution colorée.
Il me semble que la question centrale est celle de l’influence et du financement étrangers dans l’organisation et l’exécution des protestations de masse. Sur ce point, je pense qu’il est possible de transplanter la "théorie du contrôle du fait" de Welzel et Roxin du domaine du Droit pénal à celui de l’analyse géopolitique. La responsabilité doit être imputée à celui qui détient le contrôle de l’action.
En adoptant cette transposition théorique, on pourrait dire qu’une vague de protestations est une "révolution colorée" si les forces extérieures, qui éventuellement la soutiennent, détiennent le contrôle des protestations de manière à a) faire en sorte que les protestations n’auraient pas lieu sans ce soutien ; b) que ce soutien est si important qu’il garantit que les protestations suivront indubitablement les objectifs des financiers.
Ce n’est qu’ainsi que l’on peut distinguer entre "protestations spontanées ou fomentées par des conflits politiques locaux, mais comprenant parmi leurs participants des figures ou groupes ayant reçu un soutien financier international" et "protestations organisées et dirigées presque entièrement par la mobilisation d’actifs financés de l’extérieur".
C’est précisément pour cela qu’un mouvement autonome peut aussi être coopté et se transformer en révolution en cours de route. Tout se résume à déterminer qui détient le "contrôle du fait" à un moment donné.
Comme les processus politiques sont dynamiques, le "contrôleur" d’un mouvement de protestation peut changer à tout moment, en fonction des rapports de force et des résultats des luttes pour la direction des événements.
En gardant cela à l’esprit, la réalité est que beaucoup de protestations qualifiées de "révolutions colorées" manquent de causes ou cibles évidentes et incontestables. Le coup de Maidan a eu lieu à cause de la dispute sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Union Eurasienne. Le Printemps Arabe visait principalement à évincer des gouvernements hostiles à Israël et réticents face à l’atlantisme. La Révolution Rose, la Révolution de Velours et la Révolution des Jeans visaient à promouvoir l'encerclement de la Russie par ses voisins. La Révolution de juillet visait à éliminer un allié important de l’Inde dans l’équation géopolitique asiatique. Des motifs clairs, des cibles évidentes. Si ces phénomènes sont vraiment des révolutions colorées, cela se confirme a posteriori par les lois, politiques et accords mis en place dans les premiers mois suivant le changement de régime.
Dans toutes les révolutions colorées, les nouveaux gouvernements accélèrent pour atteindre les objectifs de leurs protecteurs.
Les nouveaux gouvernements rompent avec d’anciens alliés, signent des accords avec l’Occident, adoptent des lois modifiant profondément le cours géopolitique précédent. C’est ce qui s’est passé dans tous les cas mentionnés — dans ceux où la révolution a réussi.

Ce n’est pas le cas, cependant, du Népal. Un gouvernement favorable à la multipolarité, équilibrant harmonieusement entre l’Inde et la Chine, a été remplacé par un autre gouvernement également favorable à la multipolarité et équilibré entre l’Inde et la Chine.
Les révolutions colorées, en outre, cessent rarement si les gouvernements attaqués consentent à faire de petites concessions. Les gestionnaires des troubles encouragent les manifestants à ne pas se contenter d’autre chose qu’un changement total de régime. L’exemple est le Bangladesh, où les concessions de Sheikh Hasina ont simplement renforcé les manifestants. De l’autre côté, nous avons l’Indonésie et les Philippines, où de petites concessions ont suffi à faire revenir tout le monde chez soi.
Les Philippines, bien sûr, seraient une cible très mauvaise pour une révolution colorée, étant donné que le pays, sous le président Marcos — un allié important de l’Occident dans la tentative de cerner la Chine —, n’est pas un bon exemple. Le même cas pourrait s’appliquer au Maroc, où des manifestations dites "révolution colorée" ont également eu lieu — ce qui n’a pas de sens, étant donné que le Maroc est le principal allié des États-Unis et d’Israël parmi les pays d’Afrique du Nord.
En mentionnant ici les gestionnaires, il est important de souligner que, contrairement à ce qu’on a tendance à dire, les révolutions colorées ont toujours des leaders et des porte-parole, car c’est leur rôle de garantir le "contrôle du fait" et de guider les manifestations dans la direction souhaitée, sans laisser les manifestants accepter des concessions.
Dans le cas de Maidan, par exemple, des figures comme Klitschko, Tihnibok et Yatsenyuk ont rapidement émergé, parmi d’autres. La Révolution de Velours a été dirigée directement par Nikol Pashinyan, et la Révolution Rose par Mikhail Saakashvili. Il y a toujours des leaders, des porte-parole interviewés par les médias de masse et consacrés par les autorités et ONG internationales.
Ces leaders sont soutenus sur le terrain par l’Ambassade des États-Unis, qui est toujours personnellement présente dans les opérations de révolution colorée, sans exception. Que ce soit de manière plus ouverte, comme au Maidan — et encore plus en Libye — ou plus discrète, comme dans les tentatives de renverser Viktor Orban. Mais l’Ambassade des États-Unis laisse toujours des traces. Naturellement, les déclarations officielles d’autorités occidentales soutenant les protestations et condamnant les autorités légitimes sont toujours présentes dans de véritables révolutions colorées.

En prêtant attention à ces caractéristiques fondamentales des révolutions colorées et en essayant de les appliquer à la majorité des "protestations de la Génération Z", on constate qu’avec quelques exceptions, ces manifestations manquent de toutes ou presque toutes les caractéristiques des révolutions colorées. Les cas du Népal, de l’Indonésie, des Philippines et de Madagascar en sont des exemples. Le cas du Bangladesh montre que la possibilité d’instrumentaliser ce type de protestation pour une révolution colorée existe.
Certaines personnes sont profondément impressionnées par le fait que les "protestations de la Génération Z" impliquent l’utilisation de "symboles communs" entre différents pays, mais c’est parce qu’elles ne sont pas encore habituées à la capacité virale des memes, ni au mimétisme social fomenté par les réseaux sociaux.
Il est donc important de raffiner nos instruments conceptuels pour pouvoir les appliquer avec précision et responsabilité. Sinon, nous risquons de sur-utiliser des concepts importants jusqu’à les rendre insignifiants et indignes de confiance.
16:45 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, politique internationale, révolution de couleur |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Trois fois l'Ostpolitik. Trois fois Moscou. Trois étapes importantes de l'histoire récente de l'Allemagne

Trois fois l'Ostpolitik. Toutes les bonnes choses vont par trois... ou pas?
Trois fois l'Ostpolitik. Trois fois Moscou. Trois étapes importantes de l'histoire récente de l'Allemagne
Rainer K. Kämpf
Source: https://pi-news.net/2025/11/alle-guten-dinge-sind-drei-od...
Dans un article intéressant, le blogueur Alexander Wallasch se demande si la ligne de Tino Chrupalla sur la Russie fera définitivement de l'AfD un parti populaire. L'occasion n'a jamais été aussi propice qu'aujourd'hui. Une Ostpolitik équilibrée et clairement ouverte, un signe plus que décisif envers Moscou, peut briser le blocage désolant de la politique étrangère allemande actuelle.
Quiconque s'est égaré et s'est enlisé dans le marécage ferait bien de faire marche arrière et de corriger le cap. Si l'AfD décide d'opter pour une orientation purement atlantiste de sa politique et en fait sa doctrine suprême, elle court le risque de suivre la voie bien tracée de l'ancienne République fédérale et de se complaire dans le confort d'une souveraineté « ressentie ».
Ce n'est guère alternatif et c'est inquiétant, car cela s'aligne sur un discours politique qu'elle veut pourtant dépasser. L'Allemagne a un besoin urgent de s'ouvrir, de faire un bond en avant pour retrouver sa crédibilité et sa réputation d'antan. Elle n'y parviendra guère en suivant exclusivement la voie tracée par Washington.
Revenons un instant en arrière:
En 1955, Konrad Adenauer remporta un succès spectaculaire en matière de politique étrangère grâce à sa politique à l'égard de Moscou et ramena chez eux les prisonniers de guerre allemands qui demeuraient encore captifs en Union Soviétique.

En 1970, Willy Brandt rendit possibles les traités de Moscou et de Varsovie grâce à sa politique à l'égard de l'Est. Au final, cela aboutit au traité fondamental entre la République fédérale d'Allemagne et la RDA.
Helmut Kohl a saisi l'occasion qui s'offrait à lui et a obtenu en 1990 que Moscou rende possible la réunification allemande.
Trois fois la politique d'ouverture à l'Est a porté des fruits. Par trois fois, des chanceliers se sont rendus à Moscou. Trois étapes importantes de l'histoire récente de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne traverse la crise la plus grave depuis 1945. L'avenir de la nation est à la croisée des chemins et nous devons prendre une décision.
L'AfD a aujourd'hui une chance unique d'entrer dans l'histoire comme un parti populaire qui ouvre la voie vers l'Est, écarte le danger apparent d'une guerre et établit l'Allemagne dans le cercle des États qui veulent et peuvent façonner la géopolitique avec assurance et autonomie.
En d'autres termes, l'avenir du parti et du pays ne réside pas dans la voie confortable et bien rodée de l'allégeance au transatlantisme, mais dans une volonté de rupture face au carcan qu'impose la puissance occidentale victorieuse.
12:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ostpolitik, europe, actualité, politique internationale, afd, allemagne, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 novembre 2025
Etats-Unis, sanctions et choc de réalité: que reste-t-il du levier de pression majeur?

Etats-Unis, sanctions et choc de réalité: que reste-t-il du levier de pression majeur?
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Washington envoie à tous un signal remarquable:
Les principaux responsables politiques américains reconnaissent désormais ouvertement que le levier des sanctions contre la Russie a pratiquement épuisé toutes ses possibilités. Les plus grandes entreprises énergétiques ont déjà été ciblées, tout comme le secteur financier, la haute technologie, la logistique — tout l’arsenal a été utilisé. De nouvelles options? Quasiment plus disponibles.
Attente vs Réalité
En 2022, la conviction dominante en Occident était que l’économie russe s’effondrerait « en peu de temps » sous la pression de l'embargo. Trois ans plus tard, le tableau est différent :
- Production industrielle : stabilisée, voire renforcée dans certains secteurs;
- Exportations de pétrole et de gaz : redirigées, sans s’effondrer;

- Flux commerciaux : réorientation vers l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique;
- Architecture financière : structures parallèles, nouveaux couloirs de règlement;
- Même les économistes russes admettent désormais que cette résilience n’était pas anticipée.
Le cœur géopolitique :
Si le principal levier de pression de l’Occident ne fonctionne plus — quel scénario reste réaliste pour mettre fin à la guerre ?
Quelques réflexions :
Décision militaire ?
Peu probable : les deux côtés disposent de réserves stratégiques, de zones tabou politiques et de barrières à l’escalade.
Épuisement économique de la Russie ?
La prévision s’est révélée fausse. La Russie a mis son économie en mode guerre — avec une demande mondiale en énergie et matières premières en soutien.
Pression politique sur Moscou ?
Jusqu’ici, cela échoue face à des partenariats alternatifs (Chine, Inde, États du Golfe, Afrique).
Gel du conflit ?
Le scénario le plus probable — mais politiquement non résolu, géopolitiquement risqué.
Conclusion stratégique :
Nous sommes à un tournant. Si les sanctions ont atteint leur point culminant et que la voie militaire est bloquée, la question centrale est :
Quelle sortie politique, réaliste, applicable et acceptable pour les deux parties ?
À ce jour, aucune réponse n’existe — ni à Bruxelles ni à Washington.
Conclusion générale :
La politique de sanctions atteint ses limites structurelles. Le conflit lui-même, en revanche, ne les a pas encore trouvées.
20:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, union européenne, russie, sanctions, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 08 novembre 2025
De l’Union européenne à l’Union ukrainienne — la colonie inversée - Bruxelles finance, Kiev encaisse, et les États membres s’endettent

De l’Union européenne à l’Union ukrainienne — la colonie inversée
Bruxelles finance, Kiev encaisse, et les États membres s’endettent
Par @BPartisans (Telegram)
La grande illusion européenne
Il fut un temps où Bruxelles prétendait représenter l’unité, la prospérité et la stabilité. Aujourd’hui, elle ne représente plus qu’une chose : l’Ukraine.
L’UE n’est plus une union — c’est un comptoir colonial inversé, où la métropole (Bruxelles) travaille pour la colonie (Kiev).
La preuve ? Le communiqué tout frais du Conseil de l’Union européenne :
“L’UE redirigera une partie des fonds civils vers des objectifs militaires et soutiendra l’adhésion de l’Ukraine au Fonds européen de défense.” (Conseil de l’UE, 5 novembre 2025)
Autrement dit : on pille les budgets civils — santé, énergie, éducation — pour financer les chars, les missiles et la “reconstruction militaire” d’un pays où les élites s’enrichissent plus vite que les champs de bataille ne s’étendent.
Quand la corruption devient une valeur européenne
La Cour des comptes européenne l’avait pourtant signalé, noir sur blanc :
“Le suivi de l’utilisation des aides allouées à l’Ukraine reste lacunaire. Des risques de mauvaise utilisation persistent, notamment dans le secteur de la défense et de la reconstruction.” (Rapport spécial n°14/2024, Cour des comptes européenne)
Mais à Bruxelles, “risques de mauvaise utilisation” se traduit par “bon usage politique”.
Pendant que le NABU (l’agence anticorruption ukrainienne) enquête sur un scandale de 1,8 milliard d’euros détournés au ministère de la Défense (communiqué du 22 octobre 2025), la Commission, elle, ouvre un nouveau guichet.
La machine tourne : Kiev siphonne, Bruxelles rationalise, les contribuables paient.
Et Ursula von der Leyen, entre deux discours sur la “solidarité démocratique”, signe des chèques qu’aucun pays membre ne pourrait se permettre pour lui-même.
Des économies nationales en chute libre
Pendant que l’argent s’envole vers Kiev, les économies européennes s’écrasent :
France : dette publique à 3200 milliards d’euros — INSEE, septembre 2025
Allemagne : déficit record de 5,4% du PIB — Destatis, octobre 2025
Italie : taux d’emprunt à 5,8% — Banca d’Italia, octobre 2025
Mais qu’importe : “nous tenons bon face à l’agression russe”, répète Bruxelles, les poches vides mais la conscience pleine.
La Banque centrale européenne admet elle-même que le coût cumulé du soutien à l’Ukraine a dépassé 210 milliards d’euros, sans effet notable ni sur la stabilité du pays ni sur la paix en Europe (Rapport BCE, T3 2025).
De la diplomatie à la déraison
Quand Josep Borrell affirmait en 2023 que “l’Europe est un jardin entouré de jungle”, on ignorait qu’il parlait d’un jardin vidé de ses ressources, envahi par les illusions.
Car l’UE, désormais, n’investit plus dans son avenir : elle s’endette pour prolonger la guerre des autres.

La Deutsche Bank avertit dans son dernier rapport :
“La militarisation budgétaire de l’UE pourrait provoquer une contraction durable des économies nationales et un effondrement de la confiance dans les institutions européennes.” (Rapport “Fiscal Risks in European Defence Integration”, octobre 2025).
Mais la Commission préfère foncer. Reconnaître la défaite? Impensable.
Mieux vaut ruiner vingt-sept nations que d’admettre que la stratégie ukrainienne était un mirage coûteux.
Moralité : L’Europe s’effondre avec élégance
L’Union européenne n’est plus une alliance, c’est un acte de foi — et la foi, comme la guerre, coûte cher.
L’Ukraine est devenue la nouvelle religion d’État : on n’y croit plus, mais on continue d’y verser des offrandes.
Le résultat ? Une Europe exsangue, dépendante, moralement épuisée et financièrement lessivée.
“Ceux qui refusent de reconnaître leur faillite préfèrent la rebaptiser en solidarité.” — Chroniques européennes, édition 2025
Source: @BPARTISANS (Telegram).
12:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, ukraine, affaires européennes, union européenne, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



