lundi, 09 février 2026
Que veulent les États-Unis à Cuba?

Que veulent les États-Unis à Cuba?
Leonid Savin
Outre la composante idéologique qui justifie les actions de l’administration Trump, il existe également, en elles, un fondement économique. Après la déclaration du président américain Donald Trump concernant la nécessité d’organiser un coup d’État à Cuba d’ici la fin 2026, et l’introduction de nouvelles mesures restrictives, y compris l’annulation de tous les vols entre les États-Unis et Cuba, La Havane a réagi en qualifiant cela d’ingérence grossière dans les affaires souveraines d’un autre État et d’une nouvelle infâmie du néo-impérialisme de Washington. Bien que l’histoire des relations entre les États-Unis et Cuba depuis la révolution de 1959 ait été marquée par une hostilité constante des Yankees, la phase actuelle — dans le contexte de l’opération de janvier dernier, visant à kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores, et dans celui des menaces d’attaques aériennes contre l’Iran — est profondément préoccupante.
Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, nourrit également une rancune personnelle contre le gouvernement révolutionnaire de Cuba, qui présente depuis des décennies un modèle politique alternatif au monde. La défaite des États-Unis sur la Playa Chiron en 1961 a été un coup dur pour la réputation de Washington et, en fait, la première victoire sur les Yankees dans l’hémisphère occidental. L’insensibilité de Washington à l’égard de Cuba s’ajoute aux demandes de compensation pour les oligarques fugitifs dont la propriété a été nationalisée après la révolution. Cela est aussi lié aux sanctions américaines contre les navires, y compris ceux qui servent aux croisières touristiques.
Mais Cuba possède également des actifs que des hommes d’affaires comme Trump aimeraient contrôler. Il ne s’agit pas seulement du secteur du tourisme, qui génère une part importante des recettes pour le trésor d’État, mais aussi de l’industrie minière, de la chimie et des industries connexes. Bien que la production de pétrole brut, de chaux, de ciment, d’acide sulfurique, etc., ait diminué au cours de ces dernières années, certains segments méritent toutefois d’être soulignés.
L'Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de‑Acero), dans le cadre de la coopération entre Cuba et la Russie, a lancé en mai 2023 la première phase de production à l'aide d’un four électrique russe. La capacité de production de cette aciérie électrique est de 220.000 à 230.000 tonnes d’acier liquide par an. La modernisation de l’usine métallurgique de La Havane a commencé grâce à un prêt russe. De toute évidence, ce secteur est lié aux intérêts russes.
En 2023, la production de zinc à Cuba a augmenté de 12%, atteignant 58.000 tonnes contre 52.000 tonnes en 2022, grâce à une augmentation de la production à la mine Castellanos, propriété de l’Empresa Minera del Caribe Santa Lucía S.A. Emincar, le seul producteur de plomb et de zinc à Cuba. Le zinc et le plomb sont également nécessaires dans divers secteurs industriels.
Cependant, ce qui est le plus rentable pour Cuba, c’est l’extraction du nickel et du cobalt, qui sont aujourd’hui très demandés. L’organisme principal, responsable de l’extraction, du traitement et de la vente de nickel, est Cubaniquel, qui regroupe 14 entreprises, dont deux producteurs de ce minéral: l’usine Comandante Pedro Soto Alba et l’usine Comandante Ernesto Che Guevara. La première a été fondée à la fin des années 1950 et a commencé la production en 1959. En avril 1960, l’entreprise américaine qui l’exploitait a refusé de payer des taxes conformément aux privilèges accordés par le dictateur Fulgencio Batista, puis a quitté le pays, emportant toute la documentation technique. Mais en avril 1961, les révolutionnaires cubains ont pu commencer la production eux-mêmes. En décembre 1994, une joint-venture a été créée avec la société canadienne Sherritt International, spécialisée dans la production et la commercialisation de sulfures de nickel et de cobalt, ainsi que dans la fabrication, la vente et la livraison d’acide sulfurique aux entreprises nationales. La deuxième usine appartient entièrement à Cuba. Elle a été construite en coopération avec l’URSS et a commencé sa production en 1984.
Il convient de noter qu’en dépit des difficultés d’approvisionnement en énergie et du blocus économique, commercial et financier en cours, orchestré par les États-Unis, les mines cubaines ont été modernisées et leur efficacité améliorée, ce qui a permis en 2024 d’atteindre une production totale de 32.000 tonnes, dépassant les chiffres de 2022 et 2023. En 2025, Sherritt International a produit 25.240 tonnes de nickel et 2729 tonnes de cobalt dans l’usine combinée Moa Nickel S.A., située dans la province de Holguín. Les Canadiens eux-mêmes reconnaissent que l’incertitude géopolitique dans la région influence la situation dans cette industrie.

Il convient également de citer un facteur lié à la détérioration actuelle des relations entre les États-Unis et le Canada. Dès mars 2025, le Premier ministre de la province canadienne de l’Ontario, Doug Ford, a averti que si les États-Unis imposaient de nouveaux tarifs, la province réduirait ses exportations d’électricité vers les États frontaliers des États-Unis et cesserait d’approvisionner en nickel. Selon la douane américaine et l’Agence de protection des frontières du Canada, au cours des trois dernières années, près de la moitié des importations américaines de nickel provenaient du Canada, tandis que 40 à 50% des exportations de nickel canadien étaient destinés aux États-Unis.
Alors que le Canada commence à coopérer plus activement avec la Chine, il ne faut pas exclure que ses exportations de nickel soient redirigées vers là-bas. Le 24 janvier 2026, Trump a déjà menacé d’imposer des tarifs douaniers de 100% si le Canada signait un nouvel accord commercial avec la Chine.
Ajoutons à cela qu’à la fin de 2025, la Monnaie américaine (US Mint) et l’un de ses fournisseurs, Artazn, ont commencé à explorer des moyens de réduire le coût de la production de nickel à moins de 5 cents, puisque les pièces de cinq cents aux États-Unis sont composées à 75% de cuivre et à 25% de nickel, et que, au cours des dix dernières années, le prix de ces métaux a presque doublé.
En seulement un an, le prix du nickel a augmenté de plus de 15%. Et celui du cobalt de plus de 160%. En janvier 2026, le prix du nickel s’élevait à 18.500 dollars la tonne.
Et si les réserves naturelles du Groenland doivent encore être exploitées, après une étude géologique approfondie, à Cuba, toutes les réserves actuelles et potentielles sont déjà connues. Selon un rapport de la Direction générale de l’industrie minière cubaine, à leur taux de production actuel, le nickel pourrait être extrait et exporté en 17 à 20 ans, et Cuba se classe au cinquième rang mondial pour ses réserves de nickel et au troisième pour ses réserves de cobalt.
Par conséquent, la rhétorique politique des États-Unis sur la « menace communiste » venant de Cuba cache des intérêts économiques plutôt matériels.
12:13 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, états-unis, nickel, canada, sanctions, blocus, caraïbes, amérique ibérique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 février 2026
Devises, pouvoir et détermination politique

Devises, pouvoir et détermination politique
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Dans le débat géopolitique, on parle actuellement beaucoup des monnaies. De la perte progressive de l’importance du dollar, de la montée du yuan, de nouveaux systèmes de paiement et de mécanismes commerciaux alternatifs. Tout cela est pertinent, mais cela reste incomplet si l’on oublie la question du pouvoir.
Car, historiquement, une règle simple prévaut : aucune monnaie mondiale n'est solide sans soutien militaire.
Ce n’est pas parce que le dollar est « pratique » ou parce que les marchés financiers américains sont si attractifs qu’il domine. Il est dominant parce que les États-Unis ont, pendant des décennies, été prêts à défendre politiquement, et en dernier recours militairement, leurs intérêts économiques, le long des voies maritimes, dans les régions de production de biens ou de ressources, aux points stratégiques.
C’est précisément ici que se trouve le point névralgique de la stratégie chinoise.
Aujourd’hui, la Chine est une grande puissance économique. Le volume des échanges, les capacités industrielles, l’étendue technologique — tout cela est indiscutable. Mais la force économique ne remplace pas la détermination stratégique. Et jusqu’à présent, la question reste ouverte de savoir si Pékin est prêt à défendre ses intérêts également là où les instruments économiques ne suffisent plus.
Le Venezuela et l'Iran ne sont donc pas des sujets marginaux
Ce sont des cas-tests :
– Le Venezuela a montré à quel point il est facile de neutraliser les intérêts énergétiques chinois sous pression américaine.
– L’Iran est le véritable marqueur: c’est un nœud pour l’énergie, le transport et l’ensemble de la connexion eurasienne de la Chine.
Si l’Iran tombe, c’est plus qu’un acteur régional qui vacille.
Alors aussi, les éléments clés de la stratégie eurasienne chinoise — la fameuse Route de la Soie — risquent de s’effondrer. Des projets d’infrastructure sans sécurité politique sont vulnérables. Et la vulnérabilité est exploitée dans la lutte pour le pouvoir.

La stratégie américaine est remarquablement claire:
Ce n’est pas la grande guerre qui est menée, mais le découpage progressif des options. Isoler les partenaires, perturber les chaînes d’approvisionnement, couper les flux d’énergie, augmenter les risques politiques. Pas d’attaque frontale — mais une pression permanente qui réduit l’espace stratégique.
Jusqu’à présent, la Chine y répond par esquives et gain de temps. C’est rationnel — mais risqué. Car le temps ne travaille pas automatiquement pour celui qui attend. Souvent, il travaille pour celui qui agit.
Dans cette configuration, un autre point devient crucial: la Chine, seule, est vulnérable stratégiquement. Pas économiquement, mais en termes de sécurité. Une autre situation ne naît qu’avec l’axe russo-chinois, qui changerait fondamentalement le calcul du risque de Washington. C’est précisément pour cela que la politique américaine tente de maintenir ces deux acteurs séparés et de les engager bilatéralement.
La conclusion peut donc être bien plus désagréable: nous vivons une période de transition, particulièrement dangereuse.
– L’ancien hegemon n’est plus tout-puissant, mais il reste suffisamment fort pour détruire,
– les challengers sont capables de riposter, mais hésitent à montrer cette capacité ouvertement.
Tant que cela perdure, peu de choses changeront dans la stratégie américaine. Il n’existe pas encore de « frontière militaire » à laquelle on pourrait se heurter. Et sans cette frontière, les tests, les pressions et les décalages continueront.
La question centrale n’est donc pas: quelle monnaie domine?
Mais: qui est prêt à défendre son ordre, si nécessaire — et qui espère que l’adversaire trébuche un jour tout seul ?
Il reste incertain si cet espoir sera fondé. L’histoire semble plutôt aller dans le sens contraire.
#géopolitique@affaires_mondiales_par_elena
17:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, chine, états-unis, devises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 février 2026
Le gros bâton : les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer

Le gros bâton: les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer
par Shen Sheng
Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2026/02/il-grosso-bastone-usa...
Les propos du Premier ministre belge Bart De Wever marquent un changement de ton en Europe : la « protection » américaine devient un levier de pression contre les mêmes alliés. La prise de conscience des coûts de la dépendance s’accroît, mais l’autonomie reste encore loin.
SOURCE DE L’ARTICLE : https://giuliochinappi.com/2026/02/04/il-grosso-bastone-u...
Le nombre de dirigeants occidentaux qui lancent des avertissements sévères contre la pratique, adoptée par le passé, d’une dépendance excessive aux États-Unis, augmente. Le Premier ministre belge Bart De Wever a mis en garde, lors d’un forum de haut niveau sur « L’avenir de l’Europe » organisé par un média belge de première importance, que l’Europe s’est longtemps appuyée sur le « gros bâton » des États-Unis pour sa protection, pour découvrir que ce même bâton est maintenant brandi contre ses propres alliés. En plus de ses observations selon lesquelles l’Europe pourrait passer de « vassal heureux » à « esclave misérable » si elle ne trace pas de lignes rouges, ses paroles sont devenues virales sur les réseaux sociaux dès lundi.
Fin janvier, De Wever a prononcé une série de déclarations cinglantes lors du forum annuel de début d’année « L’avenir de l’Europe », co-organisé par les principaux quotidiens économico-financiers belges De Tijd et L’Echo. En abordant des thèmes tels que l’autonomie stratégique européenne, la transformation des relations transatlantiques, une intégration plus profonde du marché intérieur de l’UE et la fin de l’excès de dépendance vis-à-vis des États-Unis, il a lancé des avertissements nets sur les risques d’une subordination prolongée.
Certains observateurs ont souligné que les paroles de De Wever résonnent comme un sentiment similaire exprimé lors du discours très suivi du Premier ministre canadien Mark Carney à Davos. Tous deux montrent une réflexion plus lucide des alliés traditionnels de l’Occident sur la dépendance passée aux États-Unis et la vague d’angoisse actuelle.

Un moment crucial
Dans la vidéo, De Wever a déclaré que l’Europe a longtemps compté sur le « gros bâton » de Washington pour sa sécurité, mais qu’elle découvre maintenant que ce même levier est de plus en plus utilisé contre ses propres alliés. « C’est un moment crucial », a-t-il dit, ajoutant que la situation actuelle a mis en lumière les vulnérabilités de l’Europe et l’a forcée à faire face à des vérités inconfortables concernant sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.
Il a également soutenu que la vision de l’Europe par le président américain Donald Trump est fondamentalement hostile à l’UE en tant que force politique et économique unifiée. Lorsqu’il affirme « aimer l’Europe », selon De Wever, il entend « 27 pays séparés qui vivent en vassaux ou tendent vers l’esclavage », notant que l’économie collective de l’UE est la seule capable de rivaliser avec celle des États-Unis. « Et cela ne lui plaît pas », a-t-il ajouté.
Certains médias décrivent la fermeté récente de certains dirigeants occidentaux envers les États-Unis comme une transition d’un accommodement prudent à une attitude plus assertive, dans le contexte des menaces tarifaires de Trump et des demandes concernant le Groenland. The Guardian l’a qualifié de « moment de vérité pour l’Europe », tandis que la BBC a écrit que « l’Europe abandonne la stratégie douce-douce avec Trump».
Un expert chinois a indiqué lundi au Global Times que ce n’est pas un tournant soudain, mais le résultat d’un processus de longue durée. L’Europe, longtemps traitée comme un « instrument » de l’hégémonie mondiale américaine, a désormais reconnu les coûts de sa dépendance vis-à-vis de Washington.
 « Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.
« Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.
Jiang a dit que l’observation de De Wever selon laquelle le « gros bâton » américain est maintenant dirigé contre ses alliés équivaut, en substance, à admettre ce qui suit: l’Europe ne s’est jamais vraiment appuyée sur de véritables garanties de sécurité institutionnalisées, mais sur la « bonne humeur » de l’Amérique.
La vidéo du forum a également suscité une vague de réactions parmi les utilisateurs européens, dont beaucoup ont exprimé leur soutien aux propos du Premier ministre. Un utilisateur, @dirkschneider1608, a écrit : « Il est temps que le bla-bla constant dans les conseils européens se transforme en actions concrètes. Le moment, c’est maintenant, pas dans cent ans, pas dans une décennie. Sinon, nous finirons dans l’assiette à manger de Trump».
En commentant ses interactions récentes avec Trump et l’avenir des liens transatlantiques, De Wever s’est dit « le plus pro-américain qu’on puisse trouver », mais a souligné que les alliances doivent reposer sur le respect mutuel. « Pour danser le tango, il faut être deux, dans un mariage, il faut s’aimer mutuellement », a-t-il dit, comparant la relation transatlantique à un partenariat qui exige de la réciprocité et non des concessions unilatérales.
Vues différentes, même situation
Les références explicites aux « lignes rouges » et à l'« esclavage » ne sont pas évoquées pour la première fois par le Premier ministre belge, lequel utilise désormais un langage assez dur. Lors du même forum de Davos où le Premier ministre canadien Mark Carney a prononcé un discours très commenté, De Wever a déclaré : « Nous étions dans une position très défavorable à cette époque. Nous dépendions des États-Unis, alors nous avons choisi d’être indulgents. Mais maintenant, tant de lignes rouges sont franchies qu’il ne vous reste qu’un choix: exiger le respect de soi… ». Il a souligné que « être un vassal heureux, c’est une chose, être un esclave misérable, c’en est une autre ».
De manière similaire au Premier ministre belge, le chancelier allemand Friedrich Merz a également souligné la nécessité pour l’Europe de l’unité et de l’autosuffisance. Lors d’un discours au parlement allemand jeudi, Merz a loué «l’unité et la détermination» de l’Europe à réagir face aux menaces tarifaires de Trump durant la crise du Groenland, et a exhorté le continent à agir avec plus de confiance sur la scène mondiale, comme le préconise DW. « Nous étions tous d’accord pour ne pas nous laisser intimider par les menaces de taxes », a-t-il dit. « Si quelqu’un pense pouvoir faire de la politique en menaçant d'imposer des tarifs contre l’Europe, ce quelqu'un sait maintenant que nous pouvons et nous voulons nous défendre. »
« Ces dirigeants européens ont compris le coût de la dépendance, mais ils n’ont pas encore acquis la capacité de s’en libérer », a déclaré Jiang, ajoutant qu’il s’agit d’une situation où « la conscience s’est réveillée, mais les muscles ne sont pas encore développés ». L’expert a analysé que, en raison de divisions internes, de carences militaires et de pressions extérieures provenant des États-Unis, l’autonomie stratégique de l’Europe ne peut pas être atteinte du jour au lendemain et que l’Europe pourrait rester longtemps suspendue entre dépendance et autonomie.
Malgré cette situation, il existe aussi d’autres voix. Selon Reuters, lundi, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré lors d’une conférence organisée par l’International Institute for Strategic Studies à Singapour, que l’Allemagne « n’est pas neutre » entre les États-Unis et la Chine, et qu’elle restera toujours plus proche de Washington malgré les tensions récentes.
Zhao Junjie, chercheur senior à l’Institut d’études européennes de l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré au Global Times que les propos du ministre allemand ne reflétaient pas la réalité changeante que traverse l’Europe. Il a ajouté que les manœuvres politiques internes en Allemagne influencent aussi les déclarations de Wadephul.
Selon Zhao, il existe en Europe trois principales orientations concernant la relation avec les États-Unis. Actuellement, la déception et la distanciation prédominent, exprimées par de nombreux dirigeants européens, car la base de valeurs et la confiance entre l’Europe et les États-Unis ont été structurellement endommagées, et les liens transatlantiques ne reviendront jamais à la « belle époque ».
La deuxième orientation est celle de la contradiction et de l’alternance : tout en reconnaissant des frictions croissantes avec Washington, on affirme que l’alliance n’est pas encore rompue et qu’il reste de l’espoir pour des réparations.
La troisième, relativement rare, consiste à continuer d’affirmer le rôle de leader des États-Unis dans l’OTAN et en Occident, en insistant sur la préservation du cadre actuel d’alliances malgré la fracture transatlantique.
« Quelle que soit la vision qui l’emportera, en Europe, un consensus se forme : les relations transatlantiques ne reviendront pas comme avant, et une période de profonde réorganisation et de désengagement stratégique s’amorce », a déclaré Zhao.
« Un changement de marée dans l’histoire est un processus long, tortueux, plein de contradictions. Il est normal, pas exceptionnel, que différents pays et différentes personnes aient des opinions divergentes. Dans un paysage mondial en mutation, la coexistence de positions divergentes est la norme, tandis que la Chine a maintenu de manière cohérente ouverture, confiance et calme stratégique », a ajouté Zhao.
20:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, états-unis, actualité, affaires européennes, politique internatuionale, bart de wever |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 février 2026
Cinq élections qui pourraient bouleverser la donne politique en Occident
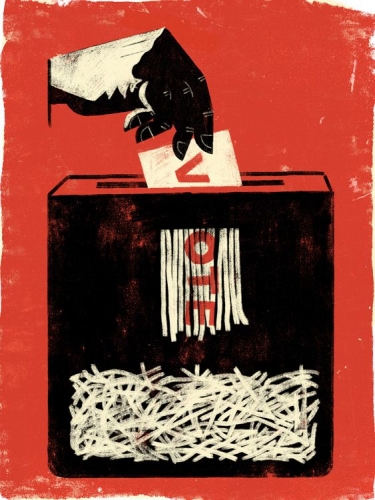
Cinq élections qui pourraient bouleverser la donne politique en Occident
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
L'année 2026 sera une année électorale et donc potentiellement une année clé pour les démocraties européennes. Qu'il s'agisse de sécurité, d'énergie, de changements géopolitiques, de souveraineté ou de migration, ces élections auront un impact sur l'UE. En avril 2026, les Hongrois éliront un nouveau parlement. Depuis 2010, Orban a réussi, avec sa coalition de centre-droit Fidesz-KDNP, à remporter quatre élections consécutives. Budapest est devenue une plaque tournante du conservatisme européen.
Orban a notamment mené une politique migratoire restrictive, ce qui lui a valu des sanctions juridiques, des pressions financières et politiques de la part de l'UE. Et pour la première fois, toute l'opposition hongroise se rallie derrière une seule figure, Peter Magyar et son parti Tisza, pour défier Orban. Tisza appartient au groupe PPE et se montre très pro-UE. Une défaite d'Orban sera perçue comme un succès stratégique des institutions et de la politique de l'UE.

Les États-Unis d'Amérique, la Suède, la Slovénie et l'Allemagne
Les élections de novembre 2026 aux États-Unis, les élections dites de mi-mandat, sont également importantes. Il s'agit d'un test crucial pour Donald Trump, car il ne dispose que d'une faible majorité à la Chambre des représentants. Il peut jouer plusieurs atouts : la croissance économique, la lutte contre l'immigration clandestine, la guerre contre la drogue, les interventions à l'étranger. Cela suffira-t-il à lui permettre de conserver sa majorité ou va-t-il la perdre ? Et surtout, quelles en seront les conséquences pour l'Europe ?

Les Suédois éliront un nouveau parlement en septembre 2026, après quatre ans de gouvernement au cours desquels les Démocrates suédois ont pu influencer la politique migratoire et sécuritaire en accordant leur soutien au gouvernement de centre-droit. Seront-ils récompensés pour cela ? Les récents sondages indiquent que les sociaux-démocrates ont la faveur des électeurs. Y aura-t-il un nouvel accord avec les conservateurs en Suède ? En Slovénie, le populiste de droite Janez Jansa (photo) espère revenir au pouvoir avec son parti SDS après les élections de mars. Cela signifierait un renforcement du bloc de droite en Europe de l'Est.
Enfin, plusieurs élections régionales auront lieu en Allemagne, où les « etablierte Parteien » (les partis établis) observent avec inquiétude la montée en puissance du parti populaire Alternative für Deutschland. Dans certains Länder est-allemands, l'AfD dépasse largement les 35% des intentions de vote, si l'on en croit les sondages. Non, nous ne nous ennuierons certainement pas sur le plan politique en 2026.
19:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, politique, actualité, europe, hongrie, slovénie, suède, allemagne, états-unis, midterms 2026 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sur la nouvelle stratégie militaire américaine
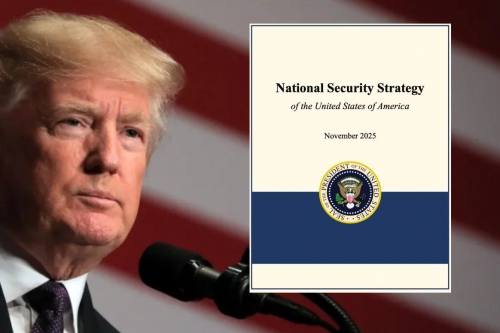
Sur la nouvelle stratégie militaire américaine
Leonid Savin
Le 23 janvier 2026, le Département de la Guerre des États-Unis a publié la Stratégie de Défense Nationale, sous-titrée « Restaurer la paix par la force pour un nouveau âge d’or de l’Amérique ». Un vestige important qui attire immédiatement l’attention sur le titre du document est qu’il concerne la défense, non la guerre, même s’il serait plus correct de le désigner comme une stratégie de guerre, puisque le Pentagone a finalement été renommé selon la logique des actions agressives des États-Unis à l’étranger depuis de nombreuses décennies, ce qui est déjà devenu une sorte de norme.
La stratégie se concentre déjà sur l’hémisphère occidental dès les premières pages et présente même une sorte de carte datant de l’époque des Lumières, avec, d’ailleurs, la désignation du Golfe du Mexique, que Donald Trump a tenté de renommer immédiatement après son retour à la Maison Blanche. « Cette stratégie est fondamentalement différente des stratégies grandioses des administrations post-Guerre Froide passées, qui étaient déliées d’un focus concret sur les intérêts pratiques des Américains », indique la section sur l’environnement de sécurité. Ce qui peut être noté concernant les différences, c’est le changement dans le terme terrorisme. Le nouveau document divise ce phénomène en deux sections : le narco-terrorisme et le terrorisme islamique. Si la première innovation est directement liée à la direction vénézuélienne (et, apparemment, sert de signal d’alarme pour d’autres politiciens en Amérique latine), la seconde ravive la phobie des néoconservateurs de l’ère George W. Bush, en insistant sur la diabolisation de l’islam en tant que tel.
Bien que plusieurs dispositions poursuivent la tendance des deux dernières décennies. Il s’agit d’une désignation des principales menaces sous forme d’États. Quatre pays sont restés inchangés : la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Mais, en général, il est dit que « les intérêts américains sont également menacés à travers tout l’hémisphère occidental. Dès le 19ème siècle, nos prédécesseurs ont reconnu que les États-Unis doivent jouer un rôle plus puissant et dirigeant dans les affaires de l’hémisphère afin de préserver la sécurité économique et nationale de notre nation. C’est cette compréhension qui a donné naissance à la Doctrine Monroe et au Corollaire Roosevelt qui a suivi. Mais la sagesse de cette approche s’est perdue, puisque nous avons considéré notre position dominante comme acquise, même lorsque celle-ci commença à s’éroder. En conséquence, nous avons vu l’influence de nos adversaires croître, du Groenland dans l’Arctique jusqu’au Golfe d’Amérique, le canal de Panama, et des lieux plus au sud. Cela menace non seulement l’accès des États-Unis à des terrains clés dans tout l’hémisphère ; cela rend également les Amériques moins stables et moins sûres, sapant à la fois les intérêts américains et ceux de nos partenaires régionaux. »
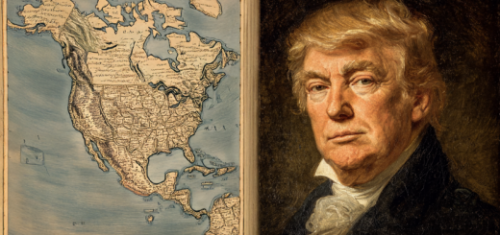
Ajoutons que la sagesse s’est également perdue dans le fait qu’au moment du discours de James Monroe au Congrès américain, ce pays avait un territoire bien plus petit et, comme l’a correctement noté le président Monroe, n’était jamais intervenu dans des guerres européennes. Mais depuis le 19ème siècle, Washington a adopté une politique offensive, notamment par l’annexion de parties du Mexique et d’anciens territoires espagnols, sans parler des nombreuses interventions du 20ème et 21ème siècles.
Et, en général, la division en hémisphères est une abstraction, tout comme la projection de Mercator donne des dimensions de continents qui ne correspondent pas à leurs échelles réelles. Le point est que les États-Unis essaient non seulement de préserver leur hégémonie, mais aussi de revendiquer le droit exclusif d’intervenir dans les affaires d’autres États (ce qui contredit les promesses électorales de Donald Trump).
Et à propos de la Russie :
« La Russie restera une menace persistante mais gérable pour les membres orientaux de l’OTAN dans un avenir proche. En effet, bien que la Russie souffre de diverses difficultés démographiques et économiques, sa guerre en cours en Ukraine montre qu’elle conserve encore de profonds réservoirs de puissance militaire et industrielle. La Russie a aussi démontré qu’elle possède la résolution nationale nécessaire pour soutenir une guerre prolongée dans son voisinage immédiat. De plus, bien que la menace militaire russe soit principalement concentrée sur l’Europe de l’Est, la Russie détient également le plus grand arsenal nucléaire mondial, qu’elle continue de moderniser et de diversifier, ainsi que des capacités sous-marines, spatiales et cybernétiques qu’elle pourrait utiliser contre le territoire américain. »

À la lumière de cela, le département veillera à ce que les forces américaines soient prêtes à défendre contre les menaces russes pour le territoire national américain. Le département continuera également à jouer un rôle vital au sein de l’OTAN, en calibrant mieux la posture et les activités des forces américaines en Europe afin de mieux tenir compte de la menace russe pour les intérêts américains ainsi que pour les capacités de nos alliés. Moscou n’est pas en position de revendiquer l’hégémonie européenne. L'OTAN européenne dépasse la Russie en échelle économique, en population, et en puissance militaire latente. En même temps, bien que l’Europe reste importante, elle possède une part plus petite et en diminution de la puissance économique mondiale. Il s’ensuit que, même si nous sommes et resterons engagés en Europe, nous devons — et nous donnerons la priorité — à la défense du territoire américain et à la dissuasion de la Chine », indique le document.
Cela mène à la conclusion que les États-Unis ont besoin des membres européens de l'OTAN pour continuer à affaiblir la Russie et les utiliser comme tampon contre la menace. Comme la Russie n’a pas l’intention d’établir son hégémonie dans la partie européenne du continent (ce qui n’est tout simplement pas rationnel et ne correspond pas aux intérêts stratégiques des États-Unis), ce passage contredit l’affirmation précédente selon laquelle la Russie représenterait une menace pour le flanc est de l’OTAN.
Mais lorsque nous lisons des documents anglo-saxons, nous devons essayer de penser de manière anglo-saxonne. Bien sûr, Washington interprète les actions de la Russie strictement selon ses propres critères. L’intérêt des États-Unis à transférer la responsabilité et les coûts de l'« endiguement de la Russie » aux satellites européens est également compréhensible, puisqu’ils sont plus proches de leurs problèmes, et devront aussi faire face à la Chine, qui est la deuxième puissance militaire mondiale.
Une section spéciale de la stratégie est consacrée à la modernisation militaire américaine. Comme le montrent les activités des chefs précédents du Pentagone, il s’agit d’un processus continu où l’armée américaine s’adapte à la situation actuelle et demande régulièrement des financements au Congrès pour toutes sortes de risques. Beaucoup de projets antérieurs ont échoué complètement, tandis que d’autres ont été réorganisés pour répondre à de nouveaux besoins. Dans cette optique, le secrétaire à la guerre actuel, Pete Hegseth, partage la même enthousiasme de ses collègues et propose de renforcer la base industrielle et matérielle des forces armées américaines.
En résumé, les auteurs de la nouvelle stratégie s’inquiètent davantage de la présence d’autres acteurs dans l’hémisphère occidental ainsi que de la montée en puissance militaire de la Chine. Les termes « narco-terrorisme » et « terrorisme islamique » sont dangereux non seulement en tant qu’outils de diabolisation dans un récit, mais aussi, compte tenu de l’expérience historique précédente, peuvent être utilisés comme justification pour des interventions militaires. Sinon, le document suit la ligne des stratégies précédentes.
17:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, défense, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 janvier 2026
Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis

Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis
par Giulio Chinappi
Source: https://telegra.ph/Il-problema-pi%C3%B9-grande-dellEuropa...
Qui aurait jamais imaginé qu’un conflit, inédit depuis des générations entre les États-Unis et l’Europe, finirait par éclater, avec le Groenland comme épicentre de cette tempête géopolitique?
Dimanche, heure locale, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré sans détour: je crois que les Européens finiront par comprendre que le meilleur résultat sera que les États-Unis maintiennent ou reprennent le contrôle du Groenland». Le même jour, les ambassadeurs des 27 pays de l’UE se sont réunis à Bruxelles, évaluant l’imposition de droits de douane pour 93 milliards d’euros (108 milliards de dollars) ou des restrictions d’accès pour les entreprises américaines au marché de l'Union. Un jour plus tôt, les États-Unis avaient annoncé qu’ils appliqueraient une nouvelle taxe de 10% au Danemark et à sept autres pays européens à partir du 1er février, jusqu’à ce qu’un accord pour l’achat complet et total du Groenland soit conclu.
En apparence, la dernière réponse européenne semble indiquer qu’enfin, l’Europe pourrait passer de la défense passive à la riposte active. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Les droits de douane de 93 milliards d’euros en représailles n’ont pas encore été appliqués. Certains responsables ont noté que cette mesure, ainsi que le soi-disant instrument d'anti-coercition (Anti-Coercition Instrument, ACI), qui peut limiter l’accès des entreprises américaines au marché intérieur de l’UE, «est en cours d’élaboration pour donner aux dirigeants européens un levier dans les négociations cruciales avec le président des États-Unis lors du Forum économique mondial de Davos cette semaine». Mais, selon les rapports, ils attendront jusqu’au 1er février pour voir si Washington donnera suite à la menace tarifaire, avant de décider d’adopter des contre-mesures.
De plus, peu après l’annonce des droits de douane américains, l’équipe de reconnaissance allemande composée de 15 personnes a brusquement interrompu sa participation à l’Opération Arctic Endurance, un exercice militaire au Groenland dirigé par le Danemark pour 2026, et a quitté l’île arctique. Auparavant, sept pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande, avaient déployé au total 37 militaires au Groenland. Au moment de la publication, Berlin n’a fourni aucune explication publique pour ce retrait, bien que les analystes l’attribuent largement à la pression tarifaire.
Les États-Unis ont transformé la plaisanterie sur l’«achat du Groenland» en une pression concrète et sérieuse, probablement parce qu’ils ont jugé à juste titre que l’Europe ne réagirait pas de manière énergique. Pendant des années, l’Europe a mal interprété ses propres opportunités de développement ainsi que les changements qui s'opéraient dans le paysage mondial, devenant excessivement dépendante de liens profonds avec les États-Unis et remettant à plus tard, sine die, la coopération avec des partenaires plus vastes, y compris la Chine et la Russie. En conséquence, l’Europe est devenue de plus en plus vulnérable au harcèlement américain, facilement pressurable et manipulable, avec une capacité de riposte limitée.
Par exemple, après l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’Europe a cessé, de manière tranchée, ses approvisionnements en gaz en provenance de Russie, sans faire montre de beaucoup de sagesse politique ou de capacité à évaluer les conséquences concrètes d'une telle décision, pour ensuite se retrouver à faire face à d’énormes coûts économiques et sociaux. Le même schéma s’applique à la Chine. Autrefois florissante grâce à la coopération économique, les relations entre la Chine et l’Europe ont changé lorsque l’Europe a suivi la ligne américaine, en regardant la Chine à travers un prisme idéologique plutôt que comme un partenaire pragmatique.
Dans ses relations avec les États-Unis, l’Europe choisit souvent le compromis, allant jusqu’à l’acquiescement. Lors de la guerre commerciale, l’Europe a pratiquement capitulé sans se battre, ce qui pourrait avoir ouvert la voie aux États-Unis qui peuvent, dès lors, viser ouvertement l'annexion d'une portion du territoire européen.
«Qui sont nos ennemis? Qui sont nos amis?»: c’est là une question de première importance pour toute révolution nécessaire, une phrase bien connue et familière à la majorité des Chinois. Aujourd’hui, apparemment, l’Europe a besoin de cette sagesse. Dans les relations internationales, il n’y a ni amis ni ennemis permanents: l’Europe doit donc faire face à la situation avec réalisme et lucidité.
L’Europe a longtemps cru que les États-Unis étaient ses amis, mais les États-Unis voient-ils l’Europe de la même façon?
Malgré la présence de bases militaires américaines au Groenland et des preuves qui réfutent les affirmations sur la présence de navires de guerre russes et chinois dans la région, les États-Unis auraient pu obtenir facilement ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse de ressources minérales ou de routes maritimes arctiques, en renforçant leurs liens militaires avec le Groenland. Cependant, cette fois, Washington s'exprime clairement sur un point: les Américains ne recherchent plus seulement la coopération mais exigent la souveraineté pleine et entière sur le Groenland. Et ils estiment que l’Europe n'opposera probablement que peu de résistance sérieuse.
L’escalade des actions et de la rhétorique américaines montre au monde que, pour les États-Unis, le Groenland est une priorité incontournable. La vraie question est maintenant de savoir si l’Europe pourra faire comprendre à Washington qu’elle est, elle aussi, déterminée à défendre la souveraineté territoriale de ses États membres souverains.
14:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, groenland, affaires européennes, souveraineté, souveraineté européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 janvier 2026
Seward, Trump et la tentation groenlandaise

Seward, Trump et la tentation groenlandaise
par Alessandro Mazzetti
Source: https://www.destra.it/home/seward-trump-e-la-tentazione-g...
Après les nombreux événements rocambolesques du Venezuela, qui, tous, demandent encore à être éclaircis, les déclarations de Trump concernant la nécessité pour les États-Unis d’acquérir le Groenland font écho. Ces affirmations de Washington ont suscité à la fois de l’indignation et de l’inquiétude, non seulement à Copenhague, mais dans toutes les capitales européennes.
Une surprise en partie injustifiée, car ce n’est certainement pas la première fois que Washington tente d’acheter l’île verte, découverte par Erik le Rouge. Nous allons essayer d’éclaircir un peu la situation en proposant une lecture différente de celles qui ont jusqu’à présent été publiées. Comme mentionné, le désir américain pour le Groenland est très ancien. Le premier à envisager son achat fut le secrétaire d’État de Lincoln, William Henry Seward (photo, ci-dessous), qui est devenu célèbre pour l’achat de l’Alaska par les États-Unis. Selon Seward, l’acquisition de la possession russe ne visait pas seulement à intégrer le Canada et à amorcer un processus d’américanisation de la domination anglaise, mais aussi à relancer la possibilité d’un autre achat potentiel: le Groenland.
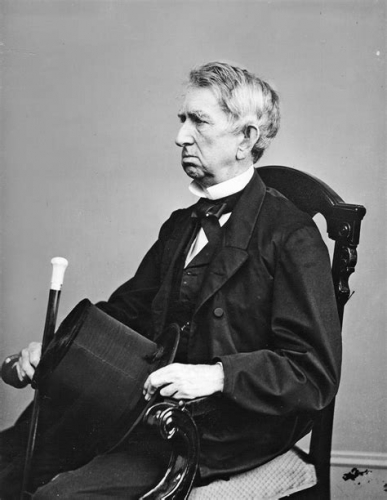
En résumé, la doctrine Monroe, ou plutôt l’intention derrière, était de créer un bloc politique-culturel anglo-saxon et germanique, qui pourrait également bénéficier de l’achat du Groenland et de l’Islande. L’offre fut rejetée par la monarchie danoise, et le projet de Seward fut interrompu. Le second cas remonte à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir défendu l’île, installé des bases militaires et des centres d’observation météorologique, les Américains ont fait une proposition au gouvernement danois, qui la refusa poliment.
Ce n’est pas la première fois que Trump tente d’acheter l’île; cela remonte à août 2019. Pourquoi cet intérêt renouvelé ? Il est plausible d’en identifier deux raisons principales. La première est la nécessité de renforcer la doctrine Monroe, avec un projet qui, comme le démontrent les pressions exercées par la Chine et la Russie en Amérique du Sud, ainsi que le dynamisme du Mexique, date de plus de 150 ans. La seconde raison réside dans l’application des règles de Montego Bay 1982 (UNCLOS), permettant la création des Zones Économiques Exclusives, qui étendent jusqu’à 200 milles marins la souveraineté sur les eaux nationales.
Ce sujet met en évidence la nécessité pour les États-Unis de renforcer leur système de défense militaire, mais surtout d’accroître leur contrôle sur la route arctique, en raison de la guerre économique féroce en cours. Washington sait pertinemment que, depuis 2017, des navires chinois empruntent régulièrement ces routes, grâce à l’ouverture de l’Arctique. De plus, Pékin est actif dans ces zones depuis plus de vingt ans: les entreprises de l’ancien empire d'Extrême-Orient sont présentes depuis longtemps en Groenland, notamment à Kvanefjeld pour l’uranium, à Cittronen Fjord pour le zinc, à Illoqortormiut pour l’or, et à Isua pour le fer. La stratégie chinoise consiste à construire des infrastructures, ce qui leur confère un avantage stratégique considérable face à leurs concurrents. La Chine prévoit depuis des années de réaliser, à coûts très faibles et avec une main-d’œuvre locale, le réseau d’infrastructures indispensables pour relancer économiquement et commercialement l’île. En 2016, la proposition de Pékin pour réactiver l’ancienne base navale Blue West dans le fjord d’Arsuk a été rejetée délicatement par le gouvernement danois.
Les demandes chinoises pour la construction de pistes d’atterrissage et de nouveaux ports se sont intensifiées ces dernières années, tandis que le gouvernement de Copenhague a souvent repoussé ces offres pour ne pas heurter la sensibilité américaine. La tentative de Washington d’acheter économiquement le Groenland répond principalement à des besoins économiques et commerciaux, car dans un monde dominé par une économie maritime, celui qui contrôle les routes et les ports contrôle le cœur de l’économie. Bien que géographiquement et anthropologiquement le Groenland fasse partie du continent américain, l’île reste une possession européenne. Une acquisition pour des raisons non économiques serait impossible, car cela signifierait une rupture irrémédiable du monde occidental et la fin de l’Alliance atlantique.
22:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, william henry seward, états-unis, alaska, groenland |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Arndt Freytag von Loringhoven, vice-président des services de renseignement allemands (BND): «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis»

Arndt Freytag von Loringhoven, vice-président des services de renseignement allemands (BND): «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis»
L’ancien diplomate et agent de renseignement Arndt Freytag von Loringhoven voit la relation avec les États-Unis à un point historiquement bas – et, même, n’exclut pas la fin de l’OTAN.
par Manfred Ulex
Source: https://www.anonymousnews.org/deutschland/bnd-vize-europa...
Arndt Freytag von Loringhoven (photo, ci-dessous) a été vice-président des services de renseignement allemands, soit du Bundesnachrichtendienst (BND) de 2017 à 2020, et auparavant secrétaire général adjoint de l’OTAN pour le renseignement. Dans une interview avec la Berliner Zeitung, il a fait des déclarations remarquables. En regard de la relation transatlantique qui s'est détériorée entre l’Europe, ou l'UE, et les États-Unis, il a déclaré :
« Les relations transatlantiques sont à un point bas sous Donald Trump, il n’y a rien à enjoliver. Trump s’intéresse aux deals et aux affaires, pas à la préservation des valeurs, à la démocratie et au droit international. Dans son monde, les États autoritaires lui semblent souvent plus proches que l’Europe. Conséquence: l’Europe ne peut plus faire confiance aux États-Unis. »
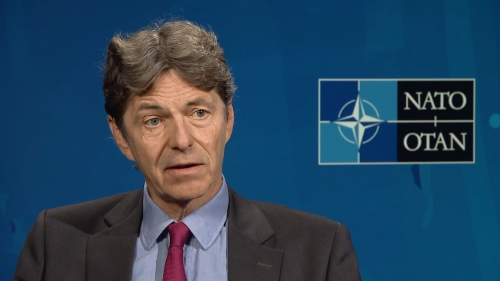
Il en a déduit que «l’Europe doit devenir plus souveraine» – tout en soulignant qu’elle n’aura plus l’influence mondiale qu’elle avait auparavant. Il réclame notamment que le gouvernement allemand fasse preuve de plus de fermeté – il ne suffit pas de souligner que «la situation est complexe», comme l’a fait le chancelier Friedrich Merz à propos de l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela. La même règle s’applique à Groenland: «Une annexion du Groenland devrait être condamnée comme une violation claire du droit international».
En réponse à la question d’une éventuelle confrontation militaire au sein de l’OTAN sur cette grande île, il a répondu: «Trump veut le Groenland, je le vois de la même façon. Pour l’instant, je n’exclurais rien. Il existe bien sûr aussi l’option que les États-Unis n’iront pas aussi loin pour lancer une action militaire – mais tenteront de renégocier les relations, notamment en matière de sécurité, de ressources et de routes maritimes dans l’Arctique. Il est dans l’intérêt de tout l’Occident que la Russie et la Chine ne comblent pas cette lacune. Tant que cela se fera dans un processus de négociation ordonné et équitable, nous pourrons accompagner cela positivement. Mais une attaque militaire dans le but d’une annexion doit être clairement condamnée par l’Allemagne». Il a souligné :
« Une action militaire d’un partenaire contre un autre, surtout s’il s’agit du plus puissant allié – ici, la différence avec Chypre –, ébranlerait profondément la crédibilité de la promesse de solidarité. L’OTAN ne pourrait alors plus projeter de dissuasion. Même si elle ne se dissout pas formellement, comme cela semble être le cas actuellement, elle perdrait toute pertinence. »
En ce qui concerne Amazon, Google, Apple et autres, von Loringhoven a constaté une dépendance européenne énorme vis-à-vis des États-Unis: «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis. Nous sommes devenus dépendants de l’Amérique d’une manière qui nous limite énormément sur le plan sécuritaire. L’Europe doit devenir souveraine – dans le numérique comme dans la défense».
Cela ne sera pas facile, a-t-il également souligné: «C’est évidemment un défi de taille, ce qui signifie: développer ses propres capacités en IA, infrastructures cloud, puces, réseaux – la guerre du futur sera numérique et menée avec des systèmes autonomes. La dépendance aux Américains est particulièrement grande, en plus du nucléaire, dans ce qu’on appelle les ‘strategic enablers’, c’est-à-dire dans la reconnaissance, les capteurs et les transports aériens à grande échelle».
21:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De la souveraineté comme état d'urgence: la géopolitique à l'ère de Trump - Commentaire métaphysique sur les événements de 2025–2026

De la souveraineté comme état d'urgence: la géopolitique à l'ère de Trump
Commentaire métaphysique sur les événements de 2025–2026
Alexander Douguine
La mort du droit international et la triomphe de la « Power Politics »
Question : Alexandre Geliévič, tournons-nous vers les turbulences qui ont surgi au passage de l'année 2025 à l'année 2026. Nous assistons à une escalade synchrone: Venezuela, Groenland, la nouvelle rhétorique de Trump, instabilité autour de l’Iran. Pourquoi ce «projectile» géopolitique à têtes multiples est-il tombé de manière si rapidement à intervalles réduits?
A.D. : Nous sommes témoins d'un moment de vérité — la réalisation des plans que Donald Trump a déjà formulés lors de la campagne électorale de 2024–2025. Ce qui était alors perçu comme de l’extravagance, du vandalisme diplomatique ou du grotesque irréalisable — je veux parler des idées d’annexion du Groenland, de absorption du Canada ou d’invasion directe du Venezuela — prend aujourd’hui forme concrète. Trump n’a pas seulement déclaré la transition vers la Power Politics (politique de puissance), il a commencé à la mettre en œuvre de manière implacable.
Sa maxime récente — « international law doesn't exist » (le droit international n’existe pas), et la seule source de légitimité étant le soi de l’acteur — n’est rien d’autre qu’une définition pure et distillée de la souveraineté. Car selon Carl Schmitt, le souverain est celui qui prend une décision en situation d’exception (Ausnahmezustand). Toute guerre, toute rupture de l’équilibre mondial, constitue une situation d’exception par excellence. Et celui qui impose sa volonté dans ce chaos — est le souverain, peu importe s’il correspond ou non aux normes juridiques.
Il faut s'en rendre compte: le droit international n’est toujours que le produit du consensus des vainqueurs. Lorsque l’architecture juridique existante cesse de satisfaire la voracité des grandes puissances — comme ce fut le cas en Angleterre aux 16ème–17ème siècles, lorsqu’elle s’est arrogée le monopole des mers, provoquant un conflit avec le monde ibérique — la guerre commence. Trump a déclaré: ce moment est arrivé.
Le système a commencé à pourrir dès la dislocation de l’URSS, lorsque des traîtres dans notre direction ont commis un crime allant au-delà de la catastrophe — ils ont remis à l’ennemi les clés du «Grad» (armes et missiles) sur un plateau d’argent. Avec la disparition du camp socialiste, la structure du droit international s’est affaissée et a commencé à s’éroder. Et alors que les libéraux rêvaient d’un monde global, Trump a brutalement interrompu ces rêves: d’abord, renforcer l’hégémonie américaine et l’État-nation, promouvoir le mondialisme est dès lors remis à plus tard. Nous sommes au cœur de la Troisième Guerre mondiale, dans le processus de redéfinition de la carte du monde.
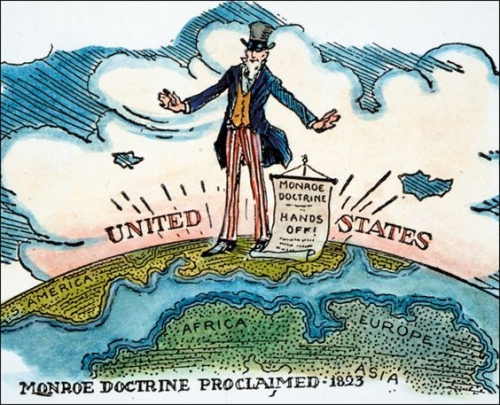
Néo-Monroïsme et fin des petites souverainetés
Trump a actualisé la fameuse «doctrine du dollar de Monroe». Si James Monroe, au 19ème siècle, postulait la libération de l’Amérique de toute influence européenne, Trump a inversé cette thèse: cela signifie désormais la gestion directe et totale de Washington sur tout l’hémisphère occidental. Comme Tucker Carlson l’a justement noté, il s’agit du passage de la République à l’Empire.
Dans cette situation, la Russie n’a pas d’autre choix ontologique que de se proclamer "Empire" à son tour et d’affirmer la Doctrine de Monroe eurasienne: « L’Eurasie — pour les Eurasiens. »
- Trump déclare: "L’hémisphère occidental appartient aux États-Unis".
- Nous devons répondre: "L’hémisphère oriental est la sphère de domination de la Russie et de la Chine (ainsi que de l’Inde)".
Nous entrons dans l’ère d’un monde tripolaire. Le destin de l’Europe dans cette configuration est désastreux et imprévisible — elle risque de devenir la victime de la prochaine guerre pour le Groenland entre les États-Unis et l’OTAN, et les élites bruxelloises, déjà totalement désemparées, sont prêtes à collecter des fonds pour la «défense du Danemark».
Pour nous, l’impératif est clair: devenir un pôle souverain de puissance. Dans cette nouvelle topologie mondiale dure, les petits États-nations appartiennent au passé. La notion de souveraineté pour les pays sans bouclier nucléaire est forcément annulée.
- L’Arménie, par exemple, n'a pas les moyens d'être souveraine.
- La Géorgie ou l’Azerbaïdjan, de la même façon, ne peuvent pas davantage être souverains.
- Le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan ou le Kirghizistan ne peuvent pas être souverains.
Soit ils deviennent partie intégrante de notre Union, de notre "Grand Espace" (Grossraum), soit ils deviennent une plateforme du Front Occidental (ou de la Chine). Il n’y a pas d’autre alternative. L’époque des «Confédérations neutres» est terminée.
L’Étranglement Énergétique et la « Pensée après Gaza »
Question : Ne se met-il pas en place, contre nous, une stratégie d’étranglement énergétique par la chute des prix, compte tenu des réserves disponibles au Venezuela, en Iran et des ambitions arctiques des États-Unis?
A.D. : Les risques sont colossaux, de fait. Trump, en attaquant notre flotte fantôme et en imposant des sanctions, cherche à nous priver du «droit de respirer». L’énergie est une arme. L’attaque contre Maduro, la pression sur l’Iran, les revendications sur le Groenland — tous ces éléments forment une chaîne de blocages de nos perspectives arctiques, des perspectives arctiques qui nous ont été données par Dieu.
Mais répondre en « exprimant une préoccupation » ou faire appel au vieux droit international — c’est montrer une faiblesse que Washington et Bruxelles ne cessent de railler. Nous sommes déjà dans un monde où le «chant du prophète Jérémie» est inapproprié.
De plus, je suis convaincu: une prochaine opération de changement de régime se prépare contre la Russie.
- D’abord, ils ont, par le truchement d'Israël et des États-Unis, éliminé la direction du Hamas et du Hezbollah.
- Ensuite, ils ont tué des officiers de la Garde révolutionnaire iranienne (IRGC) et des scientifiques nucléaires iraniens.
- Maintenant — une attaque de drones contre la résidence de notre président et une attaque contre la triade nucléaire.
C’est une «marque noire». Il n’y a plus de lignes rouges. Notre réponse doit être un régime dans lequel chaque jour devient la «Journée de l'Orechnik». Les attaques doivent viser les centres de décision, la direction politique du régime terroriste ukrainien.

Nous devons maîtriser la philosophie terrifiante qui s'est instaurée — cette philosophie, c'est la pensée de l'après-Gaza. Comme Adorno a questionné la possibilité de la poésie après Auschwitz, nous devons comprendre: en 2026, la référence, qu'on le veuille ou non, c'est Gaza.
- Soit tu transformes l’ennemi en Gaza.
- Soit tu deviens toi-même Gaza.
C’est une conclusion anti-humaniste, véritablement immorale, mais nous n’avons pas d’autre choix, vu les circonstances. Les vainqueurs — Netanyahu, Trump, Zelensky — ne sont pas jugés. Nous, par humanité, ne considérions pas les Ukrainiens comme des ennemis, car nous croyions qu’ils faisaient partie de notre propre peuple. Mais en regardant Zelensky, Boudanov, Malyuk — je ne vois pas en eux des expressions de notre peuple. Ils relèvent d'une ontologie différente, qui nous est étrangère. Et si nous continuons à jouer à l’humanisme et à basculer dans des mièvreries à la «Tchebourachka», à célébrer des mariages au milieu de l’apocalypse — il n’y aura plus ni mariages ni Tchebourachka ni Russie.
Trump: Ennemi honnête et chance de victoire
Question: Il y a un an, vous avez qualifié Trump de «chance», car il n’est pas un maniaque du même type que les mondialistes fous. Votre opinion a-t-elle changé après un an de son mandat?
A.D.: Trump est à la fois un ennemi et une chance. Le fou, c’était Biden avec son mondialisme hypocrite, qui a déclenché la guerre en Ukraine. Trump, lui, incarne la volonté de puissance; il a abandonné «le langage du mensonge» parce qu’il n’en a plus besoin. Son monde — c’est celui de la formule «Je peux le faire et je le ferai».
Au cours de cette année, Trump a évidemment évolué — au départ de l'intéressant programme MAGA, il s'est malheureusement rapproché des néoconservateurs. En politique intérieure, il n’a rien fait — ni arrestations de corrompus, ni purges promises (où en est l’affaire Epstein?). Mais en politique étrangère, il s’est montré bien plus interventionniste que prévu.
Mais c’est cela, sa «sincérité». On ne peut pas jouer avec lui à la diplomatie truquée — car, dans ce cas, il sort simplement une arme. Il ne comprend que le langage de la force. Et c’est notre chance. Nous devons agir en miroir: ne pas expliquer, ne pas justifier, mais prendre ce qui nous revient. Trump ne respecte que ceux qui sont capables de réduire l’ennemi en ruines — comme Israël avec Gaza (que Trump, il faut le noter, a tacitement approuvé).
Phénoménologie du cynisme
Question : Mais qu’en est-il de ses tweets sur «l’esprit d’Anchorage» et de son amitié avec Poutine?
A.D.: C’est un cynisme absolu, cristallin. Trump loue avec le même pathos la «grande boisson diététique» qu’il boit à flots, et les négociations avec le leader d’un pays insulaire comme Vanuatu. Il ne tente même pas de mentir — il retransmet simplement le flot qui jaillit de sa conscience, où tout est «great».
Sa tentative de «sauver l’Ukraine» par une trêve a été pour nous un piège mortel, et, heureusement, son arrogance impériale a rapidement ramené tout à l’ordre — aux ultimatums que nous avons rejetés. Trump est transparent. Quand il ne dit pas directement «Je vais vous tuer», il le sous-entend. Nous avons appris à lire ces pensées. Il n’y a plus de place pour les illusions et les négociations. Il ne reste que la Volonté de la Victoire — la volonté de triomphe, laquelle sera exclusivement appuyée sur ses propres forces.
15:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, états-unis, donald trump, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 janvier 2026
L’Antéchrist 2.0: la vision de Peter Thiel

L’Antéchrist 2.0: la vision de Peter Thiel
Source: Дугин об Антихристе 2.0: Визионерство Питера Тиля
Par Alexandre Douguine
Au printemps de l’année dernière, en réfléchissant aux premiers pas de Trump au pouvoir, j’ai écrit un article où je soulevais la problématique d’un « État encore plus profond ». La logique était la suivante: si Trump a déclaré la guerre à l’État profond et, si, malgré tout, on lui a permis d’accéder au pouvoir, n’existe-t-il pas en Amérique (et, plus généralement, en Occident) une instance encore plus puissante et secrète, que j’ai provisoirement appelée l'«État encore plus profond» (Deeper State)?
Ce matériel, publié simultanément en anglais, a été pris très au sérieux par les cercles MAGA, ce qui a suscité un débat: existe-t-il réellement, et si oui, qu’est-ce que cela pourrait être? Plusieurs versions ont été proposées. J’ai suggéré que l'«État encore plus profond» pourrait être constitué des cercles de pouvoir influents, dont les porte-parole sont les technocrates de la Silicon Valley, Peter Thiel étant le plus influent et le plus intellectuel d’entre eux.
Ce qui m’a frappé, c’est son soutien à l’idée de Curtis Yarvin (et en partie de Nick Land) sur la « Lumière Obscure » et la mise en place d’une «monarchie américaine» avec Trump comme empereur, ainsi que ses plans pour créer une ville utopique du futur au Groenland. Konstantin Malofeev a récemment écrit à propos de ce projet: «Le Groenland ne sera pas seulement un centre d’extraction minière. Il sera aussi le plus grand lanceur de fusées au monde. Il existe d’autres plans commerciaux beaucoup plus américains. L’idéologue du second mandat de Trump, Peter Thiel (créateur de PayPal, Palantir, investisseur dans Facebook, etc.), à travers l’entreprise Pronomos Capital, est le principal investisseur de la startup Praxis.


L’objectif de Praxis est de construire une ville ultramoderne dans laquelle l’intelligence artificielle, la blockchain et les cryptomonnaies seront activement utilisées pour sa gestion. Minimiser l’intervention de l’État (le directeur du projet, Dryden Brown (photo), s’est inspiré du livre «La Grève» d’Ayn Rand). Une ville de technocrates, sans religion, sans conscience, avec des chiffres à la place des mots. Le Groenland a été choisi comme siège.
Et maintenant, Ken Howery, co-fondateur de PayPal avec Thiel, devient ambassadeur des États-Unis au Danemark. Sur son site, la ville de Praxis affirme compter déjà plus de 150.000 citoyens, avec un volume total d’investissements supérieur à 1,1 billion de dollars. La liste comprend des personnes de 80 pays et 429 villes. Curieusement, il n’y a pas un seul Groenlandais. Ni même leur représentant. Parmi les investisseurs réputés, on trouve Alameda Research, de Sam Bankman-Fried. Avant d’être condamné à 25 ans pour fraude sur la plateforme FTX, il était membre de la bande pédophile d’Epstein et propriétaire d’un « penthouse polyamoureux » à la méthamphétamine pour l’élite aux Bahamas. Une des versions démo de la «ville du futur». Une dictature numérique pure, sans ornements. Intelligence artificielle pour des personnes dans une extase éternelle. Inhumanité dans le sens le plus complet du terme».

Mais je n’étais pas certain que cela soit ainsi, et j’ai suggéré que l'on observe Peter Thiel avec plus d’attention. Thiel lui-même a également rejoint le débat, directement ou indirectement, soulevant des thèmes caractéristiques de notre école de pensée: le règne de l’Antéchrist, la fin des temps, la figure de Katekhon, l’existence de l’âme, le rôle du libéralisme et des Lumières radicales en tant qu’idéologie du diable.
Avant même la COVID, j’ai reçu la visite d’émissaires de Thiel qui m’ont proposé d’ouvrir un grand dialogue sur la géopolitique du futur, le rôle de la terre et de la mer, du pétrole et du gaz, de l’esprit et de la matière. Il a été découvert que je possédais des investissements assez importants dans une de nos principales banques commerciales. Il s’intéressait à l’eurasisme et, aussi étrange que cela puisse paraître, au traditionalisme et à l’eschatologie.
Ces relations n’ont pas connu de développement majeur, en partie parce que j’étais soumis à des sanctions très sévères depuis 2014, ce qui compliquait les contacts. Convaincu qu’il ne pouvait pas m’inviter aux États-Unis, Thiel avait promis de venir en Russie, mais la pandémie de COVID-19, la guerre et la campagne électorale de Trump ont alors commencé, dans laquelle Thiel et d’autres technocrates de la Silicon Valley (notamment Elon Musk) ont joué un rôle décisif. Le dialogue a également été repoussé sine die.
Cependant, ce qui est intéressant, c’est que Thiel a accordé une interview sensationnelle au New York Times, dans laquelle il a longuement parlé de l’Antéchrist, puis il a prononcé tout un cycle de quatre conférences spécialement consacrées à ce sujet.
Voici comment l’IA d’Elon Musk (Grok) présente ces conférences, qui, par définition, se veulent anti-woke, c’est-à-dire qu’elle prétend être « objective » et se distancer de la propagande dure du libéralisme globaliste, qui est en partie «liée» à d’autres versions de l’IA (cette thèse n’est pas totalement justifiée, car d’autres plateformes d’IA, avec la programmation adéquate, peuvent être configurées dans différents registres idéologiques, parfois très radicaux).


Peter Thiel, entrepreneur et investisseur connu, a donc donné une série de quatre conférences sous le titre général «L’Antéchrist» («The Antichrist: A Four-Part Lecture Series») en septembre et octobre 2025. Ces conférences ont été programmées par l’organisation à but non lucratif ACTS 17 Collective (Acknowledging Christ in Technology and Society, («Reconnaître le Christ dans la technologie et la société»), qui cherche à développer une communauté «chrétienne» dans le domaine technologique. Les événements se sont déroulés à San Francisco.
Ils étaient strictement privés et non officiels (sans enregistrements ni retransmissions officielles), et il a été demandé aux participants de ne pas divulguer leur contenu publiquement. Les billets étaient vendus uniquement en privé, non transférables et non remboursables, et ils se sont rapidement écoulés. Le public comprenait des centaines de personnes, principalement des invités de l’industrie technologique, des chrétiens, des intellectuels et des sympathisants de Thiel. Chacune de ces soirées avait prévu des boissons, une conférence, une session de questions-réponses avec le modérateur Peter Robinson (ancien rédacteur de discours de Reagan) et le public, ainsi que des desserts. À l’extérieur, il y avait des protestations avec manifestations et musique, mais à l’intérieur, l’ambiance était calme et savante.
Les conférences étaient structurées comme une série cohérente, dans laquelle chacune s’appuyait sur la précédente. Thiel, basé sur sa foi chrétienne (influencé par René Girard et d’autres penseurs), a relié la figure biblique de l’Antéchrist aux problèmes actuels de la science, de la technologie, de la politique et de la mondialisation. Il a défini l’Antéchrist comme «le roi maléfique, le tyran ou l’anti-messie qui apparaît à la fin des temps» et a averti que ses manifestations pouvaient prendre la forme d’institutions mondiales, de réglementations et d’attitudes anti-technologiques qui mèneraient au blocage et à l’apocalypse.
Thiel s’est inspiré de la théologie, de l’histoire et de la littérature, citant René Girard, Francis Bacon, Jonathan Swift, Carl Schmitt, John Henry Newman, Vladimir Soloviev et d’autres. Il a également évoqué le concept de «Katekhon», la force qui retient l’Antéchrist (d’après Thessaloniciens, 2) et l’a relié à des structures contemporaines telles que Trump, MAGA et les États-Unis.

Voici une brève description de chaque conférence avec ses thèmes principaux :
Conférence 1: «La connaissance doit augmenter» (15 septembre 2025)
Thème principal: la relation entre l’Antéchrist et l’Armageddon, ainsi que le rôle de la science et de la technologie. Thiel a affirmé que l’Antéchrist exploite les peurs face aux menaces existentielles (guerres, rumeurs de guerres, apocalypse technologique) pour prendre le contrôle et arrêter le progrès. Cela mène à l’immobilisme déjà observé dans le monde. Exemples clés: références à Daniel 12:4 («la connaissance se multipliera») et Matthieu 24:6; Los Alamos comme symbole de l’escalade des menaces. Thiel a averti que les peurs (par exemple, de l’intelligence artificielle ou des armes nucléaires) sont utilisées pour exercer un contrôle global.
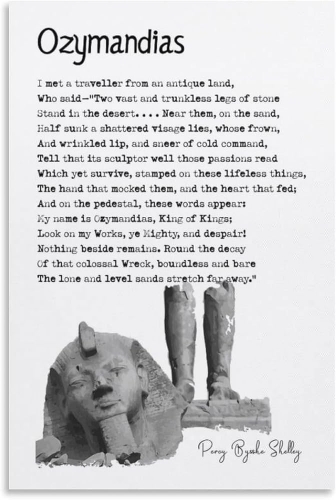
Conférence 2: «L’empire et la relation de l’Antéchrist avec le gouvernement» (22 septembre 2025)
Thème principal : Les formes de gouvernements antéchristiques et leur évolution. Thiel a discuté de comment les gouvernements peuvent être antiscientifiques ou pro-scientifiques, antéchristiques ou pro-chrétiens, et comment la mondialisation (Daniel 12:4 : «beaucoup vagueront») conduit à «un monde unique»: «l’Empire de l’Antéchrist», qui réprime la science. Il a illustré cela par des exemples littéraires: La nouvelle Atlantide de Bacon, Les voyages de Gulliver de Swift, Watchmen d’Alan Moore (où Ozymandias est la figure de l’Antéchrist, cherchant la paix par un gouvernement mondial) et One Piece d’Eiichiro Oda (le monde futur réprime la science, le héros est chrétien).
Cependant, dans un article écrit par Thiel sur le même sujet, le même projet de Bacon était identifié à la création de la «civilisation de l’Antéchrist» et de sa «Nouvelle Atlantide» comme prototype de l’époque moderne européenne, considérée comme satanique. Il est évident que Thiel passe d’un extrême à l’autre dans l’eschatologie.
Conférence 3 : « Comment une seule personne peut conquérir le monde et à quelle vitesse elle doit agir pour y parvenir » (29 septembre 2025)
Thème principal: Comment une seule personne (l’Antéchrist) peut conquérir le monde en une seule vie. Thiel insiste sur la «vitesse»: l’Antéchrist doit être jeune (idéalement 33 ans, comme le Christ, Bouddha ou Alexandre le Grand) pour accumuler richesse et pouvoir rapidement. Les figures plus âgées (comme Xi Jinping ou Trajan) ne conviennent pas. Exemples: Napoléon (30 ans), Hitler (50, mais trop tard); dans la littérature: le chapitre 33 de Tite-Live sur l’histoire romaine, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien (les hobbits atteignent la maturité à 33 ans).
Le thème de la vitesse et de l’accélération est central dans toute la philosophie des «Lumières Obscures» (accélérationnisme de droite) et joue un rôle clé dans la construction de stratégies politiques, économiques et militaires.
Bien que Trump ne corresponde pas à la description des trentenaires, le vice-président Jay D. Vance, qui a été promu à cette charge justement par Peter Thiel, y correspond. Mais, en observant le comportement de Trump lors de son deuxième mandat, on peut supposer qu’il s’est fixé un objectif difficile à atteindre: vivre jusqu’à 90 ans par cette voie. Et encore une fois, l’ambiguïté: d’un côté, Thiel semble critiquer l’Antéchrist, le mettre en garde, mais, de l’autre, dans de nombreux aspects, il lui témoigne une sympathie ouverte.
Conférence 4: «La Nouvelle Rome» (6 octobre 2025)
Thème principal: Le «Katekhon» contemporain et la «nouvelle Rome» de l’Antéchrist. Thiel a identifié les États-Unis comme un potentiel Katekhon (qui retient l’Antéchrist), mais avec des traits d’unipolarité et d’hégémonie (OTAN, dollar, rôle de «gendarme mondial»). San Francisco, en tant que centre séparé de Washington, risque de devenir l’épicentre de l’État global. Après la Seconde Guerre mondiale, le Katekhon était l’anticommunisme (1945-1989), aujourd’hui, c’est la bureaucratie. Exemples: Guantanamo (la formalisation affaiblit); Russie/Poutine: trop faible; les Juifs comme résistance à l’Antéchrist (selon Soloviev).
Thiel parle des Juifs de manière aussi paradoxale que tout le reste. Il se fonde sur leur définition dans le Nouveau Testament comme «durs de cœur», c’est-à-dire obstinés. Thiel dit: par leur entêtement, les Juifs n’ont pas accepté le Christ, et par cette même obstination radicale, multipliée par leur dureté, ils n’accepteront pas non plus l’Antéchrist (mais ce n’est pas certain).
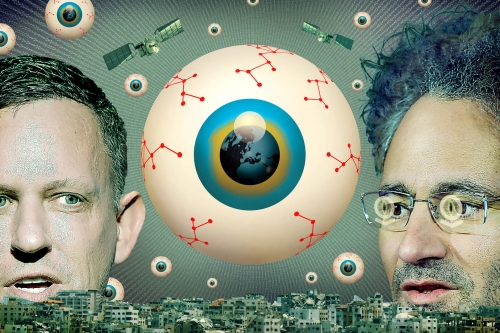
En général, Thiel exprime des opinions libertariennes: il voit l’Antéchrist dans la centralisation, les réglementations (par exemple, dans les tentatives de contrôler l’IA), l’activisme climatique (Greta Thunberg comme «légionnaire de l’Antéchrist») et les organisations mondiales comme l’ONU, qui mènent au blocage et à la fin du monde. Il soulignait que la technologie est «un nouveau miracle, même s’il est noir», qui s’oppose à tout cela, et appelle à la vigilance.
Ces conférences font suite à ses interventions précédentes sur des thèmes similaires (par exemple, en 2023 à Paris et en 2025 à Oxford), mais la série de San Francisco est la plus détaillée.
En lisant tout cela, il est difficile de ne pas ressentir que nous ne sommes pas aux États-Unis, mais dans les conférences de la «Nouvelle Université» de Moscou de la fin des années 1990 et du début des années 2000, où, avec les intellectuels du cercle de Ioujinsky et la jeunesse néo-traditionaliste la plus avant-gardiste, nous discutions de thèmes très proches, où religion, géopolitique, mystique, philosophie, science et relations internationales s’entrelacent dans un champ extravagant.
À l’époque, pour les observateurs extérieurs, cela semblait marginal et excentré. Personne ne penserait à qualifier de «marginales» ou «excentrées» des figures comme Peter Thiel, Elon Musk, Alex Karp, et encore moins J. D. Vance ou Trump, qui s’inspirent clairement de ces idées. Mais tout peut arriver.
Ainsi, l’«État encore plus profond» (Deeper State), s’il est réellement proche des projets techno-oligarchiques des «Lumières Obscures» (cela semble le être, mais cela demande une recherche plus approfondie), se présente sous la lumière suivante :
1. Il reconnaît que le mondialisme libéral, l’idéologie des droits de l’homme, le wokisme, la politique de genre et l’agenda écologique ne fonctionnent plus. C’est ce que Thiel appelle l’«Antéchrist collectif»: le Parti démocrate des États-Unis, les dirigeants libéraux contemporains de l’UE, les écologistes, les ONG, les partisans de l’immigration incontrôlée, les fanatiques de la «société ouverte» (Soros et son fils). La bureaucratie étatique inefficace est aussi incluse dans cette catégorie. Jusqu’ici, tout est correct, et nous sommes tout à fait d’accord. C’est le projet de la modernité occidentale: déchristianisation, matérialisme, athéisme, anti-christianisme et, finalement, satanisme pur.
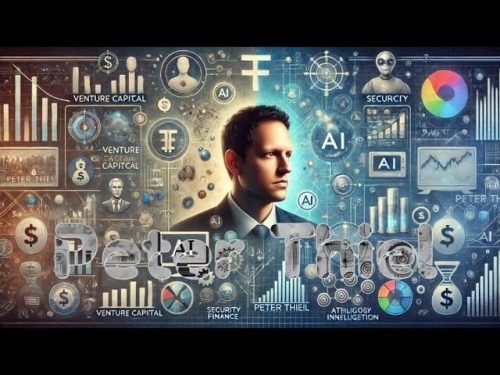
2. Contre les mondialistes, Thiel propose de soutenir le «Katekhon», la figure du Retenant. Et d’établir un Empire mondial. Déjà sans aucun signe de droits de l’homme ou de démocratie. Mais qu’est-ce que cet «Empire»? À sa tête, les États-Unis et le monarque américain (Trump ou son successeur). L’aristocratie héréditaire est formée par les technocrates, et leurs vassaux, les programmeurs. Le reste deviendra une main-d’œuvre brute, dont le besoin disparaîtra progressivement, et les personnes à faible quotient intellectuel seront simplement remplacées par des robots ou des algorithmes. Le monarque américain se fusionnera avec une intelligence artificielle puissante (AGI) et la Singularité se produira. Autrement dit, dans cette version, l’«Empire» c’est les États-Unis (d’où le corollaire de Trump à la doctrine Monroe, la capture du président du Venezuela et les plans d’annexion du Groenland puis du Canada), et le Katekhon, c’est l’Intelligence Artificielle.
3. Le concept d’«âme immortelle» sera réutilisé, mais dans un contexte assez sinistre. Selon Thiel, le changement de sexe n’est que la première étape (il a lui-même une orientation non traditionnelle). Ensuite, il faut apprendre à transférer la conscience (= l’âme) d’un corps à un autre, qu’il soit humain, mécanique ou autre. Ce sera la victoire de la «religion», mais d’une manière très particulière. Son prototype est la même organisation qui a organisé les séminaires de Thiel à San Francisco (Acknowledging Christ in Technology and Society, «Reconnaître le Christ dans la technologie et la société»).
Si le premier point de ce programme d’accélération de droite peut être accepté, les points second et troisième, bien qu'évoquant vaguement quelque chose de familier (Empire, Katekhon, immortalité de l’âme... on a déjà entendu cela quelque part, mais c’est précisément l’idée russe !), appliqués aux États-Unis, à l’intelligence artificielle et au posthumanisme, créent l’image de l’authentique Antéchrist, mais version 2.0. En lieu et place de l’Antéchrist déjà existant, les technocrates proposent un Antéchrist à venir. C’est une invitation à faire un pas de plus sur le même chemin vers l’abîme que l’Occident a parcouru durant toute l’époque moderne.
Si tout cela est vrai, alors la différence entre le simple «État profond» (le libéralisme globaliste classique) et l’«État encore plus profond» devient claire. Ce ne sont que deux phases logiques du même processus historique. Ainsi, dans l’Apocalypse, une corne de la bête a déplacé les autres jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une.

Compte tenu de ce que Trump fait actuellement en politique mondiale, abolissant le droit international, envahissant des États souverains, kidnappant des dirigeants légitimes, emportant pétrole et minéraux d'où bon lui semble, bombardant des installations nucléaires et, de surcroît, soutenant ouvertement le régime franchement démoniaque de Kiev, la thématique des séminaires de Thiel cesse d’être quelque chose d’abstrait.
Cependant, ce n’est qu’une première approche du problème de l’«État encore plus profond» après une année de présidence de Trump. Parallèlement, d’autres thèmes ont émergé, divisant même les plus fidèles supporters de Trump en deux camps antagonistes. Et ces thèmes sont liés à notre sujet. Je leur consacrerai mes prochains articles.
15:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, alexandre douguine, peter thiel, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 14 janvier 2026
Tout comme ses prédécesseurs, Donald Trump ne voit pas d'un bon oeil le monde multipolaire qui se profile à l'horizon

Tout comme ses prédécesseurs, Donald Trump ne voit pas d'un bon oeil le monde multipolaire qui se profile à l'horizon
Marcel Bas
Source: https://www.facebook.com/roepstem
L’escalade actuelle sous l'égide de l’administration Trump (notamment les récentes actions contre Maduro au Venezuela et la montée des tensions en Iran) constitue la dernière étape d’un plan américain quinquennal, mis en œuvre avec un succès variable par les gouvernements successifs de Bush à Biden. Ce plan consiste à briser l’axe énergétique entre la Russie, la Chine, l’Iran et le Venezuela. Nous assistons actuellement à la réalisation spectaculaire, sans ambiguïté, de ce plan sous nos yeux. Bien entendu, cela n’a rien à voir avec une volonté de libérer les peuples de dictateurs ou de fanatiques religieux.
Ceux qui pensent que Trump, contrairement à ses prédécesseurs, aurait un réel intérêt pour un monde multipolaire se trompent. La seule chose que Trump remet en question, c’est la nécessité d’habiller la politique étrangère unilatérale traditionnelle des États-Unis avec des discours néoconservateurs sur la diffusion de la démocratie ou le respect de l’ordre international basé sur des règles (souvent déstabilisé par les États-Unis eux-mêmes) et du droit international. Non, l’objectif de Trump et de ses alliés n’est pas la diffusion de la démocratie, mais le maintien de l’hégémonie financière sur le commerce mondial de l’énergie.
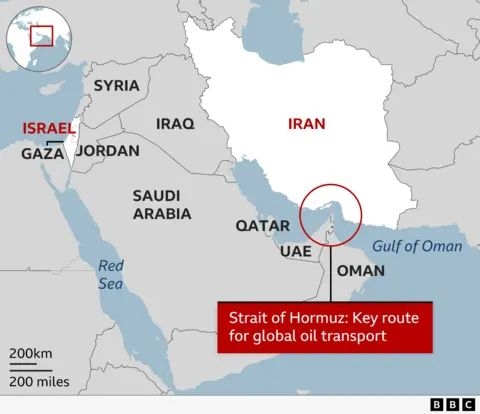
Trump cible le Venezuela et l’Iran parce que le Venezuela possède d’importantes réserves de pétrole, et parce que l’Iran contrôle une part essentielle de l’infrastructure énergétique. Le détroit d’Hormuz est la principale voie logistique dans le monde. En cherchant à provoquer un changement de régime à Téhéran, Trump tente d’influencer directement cette route maritime stratégique. Qui contrôle le détroit d’Hormuz, contrôle l’approvisionnement énergétique du Japon, de l’Inde et surtout de la Chine.
Regardez le comportement de Trump vis-à-vis de la Chine : il cherche constamment à la bloquer.
La Chine et surtout l’Iran jouent un rôle central dans la résistance au dollar américain. L’Iran commerce déjà largement en devises locales et en or. Un régime occidental à Téhéran écraserait immédiatement cette ‘révolte financière’ et rétablirait le pétrodollar en tant que seule norme. Depuis des années, les États-Unis ont vu avec inquiétude comment l’Iran et la Russie renforçaient leurs liens militaires et économiques (notamment via la livraison de drones et de technologies de missiles). En déstabilisant l’Iran par l’ingérence de la CIA et en appliquant de sévères sanctions économiques, les États-Unis tentent d’atteindre l’allié principal de la Russie au Moyen-Orient et de bloquer une route cruciale vers l’océan Indien (le corridor de transport Nord-Sud).
La Chine dépend fortement de l’Iran pour ses approvisionnements pétroliers, qui n’ont pas besoin de transiter par des eaux contrôlées par les États-Unis. Un changement de régime en Iran obligerait la Chine à soumettre sa sécurité énergétique à des conditions américaines. La même logique s’applique désormais au pétrole vénézuélien, dont la Chine dépend également. Les États-Unis peuvent ainsi contraindre la Chine à faire accepter leurs conditions pour ses approvisionnements en pétrole.

Ce n’est pas une nouvelle politique élaborée par Trump, mais la continuation d’un projet plus profond, d’une ambition institutionnelle que les néoconservateurs rêvent depuis longtemps. On se souvient tous que le président Bush parlait de ‘l’ Axe du Mal’, et qu’Obama et Biden ont utilisé des sanctions et une cyber-guerre (avec Stuxnet). La CIA mène depuis des décennies des opérations visant à affaiblir la stabilité intérieure de l’Iran (soutien à des groupes d’opposition, sabotage économique). Trump va maintenant porter le coup de grâce.
On peut considérer l’enlèvement de Maduro comme un modèle pour des interventions passées ou futures à l’étranger. Cela fonctionne comme suit: les États-Unis créent d’abord une implosion économique, puis reconnaissent (ou désignent) un nouveau gouvernement, en utilisant cette situation créée de toutes pièces comme base juridique pour confisquer les richesses nationales (pétrole et or) et les ramener au système dollar.
Les actions contre le Venezuela et l’Iran sont deux faces d’une même pièce, car les États-Unis poursuivent la même politique de guerre préventive contre la formation d’un monde multipolaire. En contrôlant les réserves pétrolières du Venezuela et les routes de transit de l’Iran, Washington crée une ‘embargo énergétique’ autour de la Chine. La victime ultime ne sera pas seulement un président en fonction à Caracas ou un ayatollah à Téhéran, mais la souveraineté de chaque pays qui tente d’échanger hors du contrôle de la Réserve fédérale américaine. L’Amérique du Sud a déjà dans sa poche Trump, avec sa réaffirmation de la doctrine Monroe.
13:43 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, donald trump, états-unis, iran, venezuela |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 janvier 2026
Général français: "Nous devons combattre les Américains!"

Général français: "Nous devons combattre les Américains!"
Cristi Pantelimon
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005135564621
C'est probablement la première fois que nous entendons un tel discours: lors d'un débat télévisé, un général français, Nicolas Richoux (photo), a avancé l'idée d'une lutte armée entre Européens et Américains, dans le cas où ces derniers attaqueraient le Groenland, un pays «allié».
D'autres signes indiquent que le Groenland sera une pomme de discorde dans les relations «transatlantiques».
Le vice-chancelier allemand Lars Klingbeil a envoyé des messages clairs de solidarité avec le Danemark, tandis que Friedrich Merz a relativisé l'idée d'envoyer des troupes européennes en Ukraine sans l'accord de la Russie.
Les relations internationales sont dominées par le conflit principal entre les États-Unis et l'axe Russie-Chine. Cependant, il existe également un conflit potentiel important au niveau des relations entre les États-Unis et l'Europe. Ce dernier conflit découle du premier.
Les États-Unis aspirent à un monde «souverainiste» selon leur propre définition, c'est-à-dire un monde dans lequel les États-Unis pourraient démanteler toute alliance d'États, qu'elle soit de type BRICS (mondiale ou à potentiel mondial) ou de type UE (locale), afin que les États-Unis restent ainsi le souverain absolu parmi les souverains.
Les BRICS, tout comme l'UE, ont un potentiel économique et stratégique qui gêne la puissance américaine. La dilution de ces structures serait à l'avantage de Washington.
Les attaques contre le Venezuela et l'Iran sont des attaques contre les BRICS (tout comme les tracasseries à l'encontre de l'Inde), tandis que l'exportation du souverainisme vers l'Europe (tout comme le conflit en Ukraine) sont des chocs électriques infligés à l'UE et à l'UE et à la Russie (prises ensemble).

Il est donc naturel que, dans l'hypothèse où le conflit avec l'axe Russie-Chine s'épuiserait (bien qu'il y ait des signes contraires), les États-Unis soient de plus en plus enclins à porter des coups à l'autre alliance qui les gêne, à savoir l'UE.
Le problème est que le Groenland est stratégiquement situé à la fois dans la cour des BRICS (l'axe Russie-Chine et le contrôle de la route arctique) et dans celle de l'UE (étant un territoire appartenant à un État membre de l'UE).
Une attaque contre le Groenland aura des répercussions sur les deux structures avec lesquelles les États-Unis sont en conflit.
Pour l'instant, seuls les Européens ont réagi – et nous voyons qu'ils l'ont fait avec dureté – à l'idée américaine de contrôler le Groenland.
La solidarité des pays nordiques, mais aussi des pays baltes, avec le Danemark est également intéressante : la région baltique était l'une des plus engagées dans la guerre contre la Russie, une région où l'OTAN venait de s'installer... Voilà qui montre que les choses peuvent être relativisées.
Le refroidissement des relations entre les États-Unis et l'Europe sur la question du Groenland ne peut que profiter à l'axe Russie-Chine, qui, pour l'instant, ne ressent pas le besoin de s'immiscer...
Référence: https://www.boursier.com/.../le-general-nicolas-richoux...
16:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas richoux, france, europe, affaires européennes, géopolitique, groenland, otan, états-unis, arctique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 janvier 2026
La question du Groenland intensifie les contradictions entre l’Europe et les États-Unis

La question du Groenland intensifie les contradictions entre l’Europe et les États-Unis
Source: https://mpr21.info/groenlandia-agudiza-las-contradiccione...
L’Arctique est devenue une voie d'évitement pour la Russie et la Chine, en raison du contrôle impérialiste sur les principales routes maritimes. Groenland, un territoire autonome du Danemark, a toujours été un maillon clé dans les plans de l’OTAN. Aujourd’hui, il occupe une place unique dans un nouveau théâtre d’opérations. C’est une base avancée dans le nord de l’Atlantique et un point d’appui pour la surveillance militaire de l’Arctique.
Bien qu’il ait déjà été l’objet de controverses politiques ces dernières années, l’île revient sur le devant de la scène suite aux déclarations d’un général français, Nicolas Richoux (photo), sur la chaîne de télévision LCI.

Ce général n'évoque pas seulement la fin de l’OTAN, mais il nous signale aussi que les contradictions entre les États-Unis et l’Europe ont atteint un point de non-retour. Pour la première fois, Richoux place les États-Unis du côté des adversaires. Il affirme que la pression militaire américaine sur l’île constitue une « ligne rouge » que les États-Unis ne peuvent pas franchir, même de manière rhétorique.
Il est possible que l’Europe doive non seulement envoyer des troupes en Ukraine, mais aussi au Groenland, car son rôle dans le théâtre d’opérations de l’Atlantique Nord a changé. Située à la croisée entre l’Europe et l’Amérique, le Groenland n’est pas un territoire neutre dans le paysage militaire. Il abrite des installations stratégiques, principalement américaines, liées à la défense antimissile et à la surveillance aérienne. Cependant, pour les Européens, l’île reste un territoire associé à un État allié, le Danemark, membre de l’OTAN, ce qui lui confère une forte valeur symbolique et politique.
Face à la possibilité d’une action militaire contre un territoire allié, Richoux a soutenu que l’Europe ne pouvait pas se contenter de simples protestations diplomatiques. Les signaux d’alerte d’une attaque devraient entraîner une réponse immédiate, y compris le déploiement de forces européennes. « S’il y a des indices, nous devons envoyer des troupes là-bas [...] Je pense que nous devrions lutter contre les Américains. S’ils nous attaquent sur le territoire d’un allié, ils doivent être considérés comme des félons historiques. »
Le général a affirmé que l’inaction remettrait en cause la crédibilité des engagements collectifs. Il a également souligné que permettre à un allié d’agir sans réagir sur le territoire d’un autre affaiblirait l’ensemble du système de sécurité mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale.
Interrogé sur les conséquences pratiques d’une éventuelle annexion du Groenland par les États-Unis, Richoux n’a pas évité le sujet du conflit militaire. Il a déclaré qu’en cas de telle situation, l’Europe devrait accepter l’idée d’un affrontement direct, croyant qu’une attaque contre un territoire allié ne pourrait rester sans réponse.
Derrière cette apparition médiatique se cache une préoccupation de plus en plus profonde et répandue: les alliances occidentales ont disparu et de plus en plus de personnes envisagent la possibilité d’un affrontement militaire avec les États-Unis, et ce, pas seulement sur le plan économique et diplomatique.
20:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, nicolas richoux, groenland, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
„Dans deux mois, nous nous occuperons du Groenland“: Mette Frederiksen prédit «la fin de l’OTAN» en cas d’annexion par les États-Unis

„Dans deux mois, nous nous occuperons du Groenland“: Mette Frederiksen prédit «la fin de l’OTAN» en cas d’annexion par les États-Unis
Menaces de Washington, avertissements de Copenhague et rejet clair de Nuuk: le débat récemment ravivé sur le Groenland pourrait mettre à rude épreuve l’alliance transatlantique.
Sophie Barkey
Source: https://www.berliner-zeitung.de/news/trump-in-zwei-monate...
Après les déclarations récentes du président américain Donald Trump concernant le Groenland, l’inquiétude refait surface au Danemark face à une éventuelle annexion américaine de l’île autonome de l’Atlantique Nord. Trump avait précédemment déclaré que les États-Unis «s’occuperaient du Groenland dans environ deux mois».

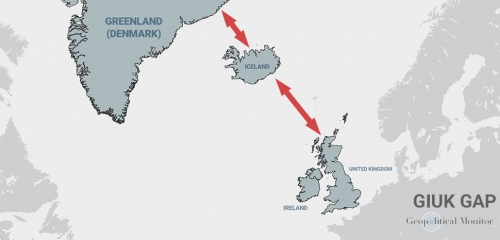
Note de la rédaction: L’intention de s’emparer du Groenland sans craindre de faire voler l’OTAN en éclats dérive bien évidemment d’une volonté bien arrêtée de contrôler les réserves de matières premières de cette grande île mais aussi de rapprocher les Etats-Unis d’un point névralgique de la défense russe, où se concentrent les bases de la péninsule de Kola, déjà menacée par la récente adhésion de la Finlande, jadis neutre, à l’OTAN. Il s’agit aussi de maîtriser totalement la double trouée GIUK (Groenland-Islande-United Kingdom) qui, pendant la seconde guerre mondiale, avait permis aux marines anglo-saxonnes d’approvisionner les armées de Staline. Pendant la guerre froide, l’objectif de l’amiral soviétique Gortchkov était de verrouiller cette trouée pour protéger la presqu’île de Kola et les ports de Mourmansk et d'Arkhangelsk, comme l’amiral allemand Doenitz voulait verrouiller cette même trouée pour empêcher l’approvisionnement des armées soviétiques. Les visées de Trump sur le Groenland semblent être une première étape : après le Groenland viendra l’Islande et les possessions norvégiennes de la zone atlantique/arctique, l’île Jan Mayen et les Spitsbergen. Les Etats-Unis sacrifient délibérément leurs alliés scandinaves (RS).
„Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale, et le Danemark ne sera pas en mesure de le faire“, a déclaré Trump dimanche à bord de son avion présidentiel Air Force One. „Nous parlerons du Groenland dans 20 jours“. Dans un entretien téléphonique avec le magazine américain The Atlantic, il a également souligné: „Nous avons absolument besoin du Groenland. Nous en avons besoin pour la défense.“
 Mme Frederiksen réagit avec des mots très durs
Mme Frederiksen réagit avec des mots très durs
La Première ministre danoise Mette Frederiksen (photo) a alors averti qu’une attaque contre un partenaire de l’OTAN signerait la fin de cette alliance militaire. Si les États-Unis décidaient de lancer une telle attaque, „alors tout serait fini“, a déclaré Frederiksen dans une interview avec la chaîne danoise TV2. Cela concerne l’OTAN et aussi l’architecture de sécurité après la Seconde Guerre mondiale. Son gouvernement, a-t-elle ajouté, fait „tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne se produise pas“.
Frederiksen a appelé les États-Unis à cesser leurs „menaces contre un allié historique“. Il est „absolument absurde de dire que les États-Unis devraient prendre le contrôle du Groenland“.
Le chef du gouvernement groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a également rejeté les menaces de Trump avec fermeté. „C’en est fini maintenant“, a déclaré Jens Frederik Nielsen, chef du gouvernement groenlandais. „Plus de pression. Plus d’allusions. Plus de fantasmes d’annexion“, a-t-il écrit sur Facebook. „Nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts à la discussion“, a-t-il souligné. Cela doit se faire „par les canaux appropriés et dans le respect du droit international“.
 Le débat sur le Groenland est ravivé
Le débat sur le Groenland est ravivé
Peu avant, la commentatrice de droite Katie Miller avait publié sur la plateforme X une image du Groenland avec le drapeau américain et la brève légende „SOON“ („bientôt“). La provocation venait donc du cercle immédiat de la Maison Blanche, car Miller est l’épouse de Stephen Miller, chef adjoint du personnel pour la politique et conseiller en sécurité intérieure du président Donald Trump. À Copenhague, cette publication a suscité de l’agitation et de nouveaux débats sur le partenariat en matière de sécurité entre le Danemark et les États-Unis.
Depuis son entrée en fonction, Trump a régulièrement évoqué l’idée de prendre le contrôle du Groenland, ce qui a provoqué des tensions diplomatiques entre Washington et l’Europe. Le président américain justifie depuis son intérêt pour cette île danoise en évoquant des enjeux stratégiques pour la sécurité des États-Unis.
Les États-Unis disposent déjà de la base aérienne Pituffik, la présence militaire la plus au nord sur le sol groenlandais – un site stratégique dans la compétition géopolitique entre les États-Unis, la Chine et la Russie pour l’influence dans l’Arctique. Pékin et Moscou ont également, à une date récente, accru leur présence dans les eaux autour du Groenland. (avec AFP)
14:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, groenland, danemark, affaires européennes, atlantique nord, arctique, donald trump, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 janvier 2026
Groenland: même la cheffe du gouvernement danois met en garde contre la fin de l'OTAN

Groenland: même la cheffe du gouvernement danois met en garde contre la fin de l'OTAN
Source: https://opposition24.com/politik/groenland-selbst-daenema...
Ce que le site web Opposition24 avait déjà mentionné est désormais confirmé par des sources officielles: les menaces du président américain Donald Trump à l'encontre du Groenland ne sont pas du théâtre politique, mais constituent un danger réel pour l'OTAN. Comme le rapporte ntv, même la Première ministre danoise Mette Frederiksen met ouvertement en garde contre le fait qu'une attaque des États-Unis contre le Groenland mettrait de facto fin à l'alliance militaire (source: ntv.de).
Trump a une nouvelle fois déclaré que les États-Unis avaient « absolument » besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il souhaite « s'occuper de cette question » dans les semaines à venir. Des déclarations qui ont depuis longtemps déclenché l'alarme en Europe. La cheffe du gouvernement danois qualifie le débat au sein de l'OTAN d'« absurde » et affirme sans ambiguïté : si les États-Unis attaquaient un membre de l'OTAN, « tout serait fini ». Elle ne fait pas seulement référence à l'OTAN, mais à l'ensemble de l'ordre sécuritaire mis en place après la Seconde Guerre mondiale.

Le chef du gouvernement groenlandais, Jens Frederik Nielsen, rejette également avec véhémence les fantasmes d'annexion américains. Il a déclaré que son pays n'accepterait pas d'autres menaces ou tentatives de pression. Néanmoins, cet incident montre à quel point la situation est grave. Washington parle ouvertement de revendications territoriales sur une île appartenant à un allié, ce qui est sans précédent.
Cela confirme exactement l'analyse d'Opposition24: Trump est prêt à faire éclater l'OTAN si elle entrave ses intérêts stratégiques (cf.: https://opposition24.com/politik/trump-droht-mit-groenlan... ).
Alors qu'à Bruxelles, on parle encore de «dialogue» et de «discussions», la réalité est tout autre. Ceux qui sont prêts à ne pas exclure l'option militaire remettent en question toute la logique de l'alliance.
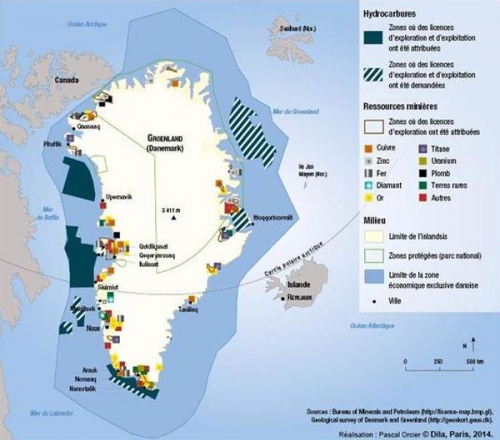
Le contexte géostratégique est particulièrement explosif. Le Groenland se trouve sur une trajectoire de missile potentielle entre la Russie et les États-Unis, dispose de matières premières précieuses et gagne énormément en importance en raison de la fonte des glaces. Le fait que Trump veuille placer cette région sous contrôle américain s'inscrit dans le cadre d'un nouvel impérialisme américain qui ne se sent plus lié par le droit international ou la loyauté envers l'alliance.
Alors que les responsables politiques allemands et européens réagissent encore de manière apaisante, la cheffe du gouvernement danois exprime ouvertement ce qui est en jeu. L'OTAN ne sera stable que tant que sa puissance la plus forte respectera ses propres règles. Si Washington les dénonce, il ne restera plus grand-chose de l'alliance.
16:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, affaires européennes, actualité, groenland, danemark, otan, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 05 janvier 2026
Intervention militaire au Venezuela, symptôme de l'effondrement de l'Occident

Intervention militaire au Venezuela, symptôme de l'effondrement de l'Occident
Nicolas Maxime
Source: https://www.facebook.com/nico.naf.735
« America First ». Donald Trump a bâti son discours sur la promesse de rompre avec les « guerres sans fin » et l’ingérence extérieure, allant même jusqu'à revendiquer le prix Nobel de la paix. Pourtant, Donald Trump a annoncé aujourd’hui avoir capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse afin de les extrader vers les États-Unis, où ils seront inculpés et jugés pour trafic de drogue et terrorisme.
Alors qu’il fustigeait les interventions de ses prédécesseurs au Moyen-Orient, le président américain n’a eu aucun scrupule à traiter un État souverain comme un simple pion dans sa stratégie de domination régionale. En orchestrant une opération militaire sur le sol vénézuélien, Trump n’a pas agi en isolationniste, mais en héritier direct de la doctrine Monroe.
Trump assure que les États-Unis contrôleront le pays jusqu’à une « transition démocratique » et que les compagnies pétrolières américaines pourront y opérer librement. On a donc compris quel était l’intérêt sous-jacent de cette attaque contre le Venezuela, dans la droite ligne de l’invasion de l’Irak en 2003 : prendre le contrôle des ressources énergétiques d’un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde.
Déjà, Trump menace la Colombie des mêmes représailles. Les conséquences seront néfastes en termes d’insécurité pour l’ensemble de l’Amérique du Sud, avec le risque majeur d’une déstabilisation régionale durable, voire de conflits internes et de guerres civiles.
Trump, derrière son anti-interventionnisme affiché, poursuit en réalité la même fuite en avant néoconservatrice que ses prédécesseurs, sans se soucier des effets dévastateurs sur les peuples concernés. Comme l’a analysé Emmanuel Todd, ce qui se manifeste ici, c’est le nihilisme de notre société en phase terminale, incapable de reconnaître ses propres limites et de proposer un projet politique et moral autre que l’expansion militaire pour imposer ses vues économiques.
L’intervention militaire américaine au Venezuela est un symptôme supplémentaire de l'effondrement de l'Occident, révélant l’incapacité d’un système en décomposition à se réinventer autrement que par la force.
20:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, occident, venezuela, amérique ibérique, amérique du sud, amérique latine, caraïbes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jongler et faire semblant de gagner - La nouvelle phase de la puissance américaine

Jongler et faire semblant de gagner
La nouvelle phase de la puissance américaine
Adnan Demir
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554418813540
Après la période de la Guerre froide, le système mondial s’est largement construit autour d’une architecture de puissance centrée sur les États-Unis. Cette architecture ne reposait pas seulement sur la supériorité militaire; elle dépendait également de la production de consentement à travers la justification du droit, du droit international, des finances mondiales, des institutions multilatérales et du discours sur un «ordre fondé sur des règles». La puissance hégémonique des États-Unis puisait non seulement dans leur capacité à utiliser la force, mais aussi dans un cadre normatif qui permettait de rendre cette utilisation invisible la plupart du temps et de la légitimer. Cependant, ces dernières années, les pratiques de la politique étrangère américaine montrent que ce cadre s’effrite rapidement et que la puissance entre dans une nouvelle phase.
Aujourd’hui, de nombreuses actions présentées comme des « succès » militaires ou politiques indiquent, lorsqu’on les examine de près, plutôt une légitimité en déclin qu’une expansion de la domination. L’hégémonie est un phénomène qui, dans l’histoire, ne se consolide qu’en gagnant le consentement ; quand elle n’est imposée que par la force, elle n’est pas durable. Si une puissance choisit de suspendre le droit, de désactiver des institutions et de normaliser l’usage brut de la force pour atteindre ses objectifs, cela indique plutôt un état d'usure que le sommet de la puissance. Dans ce contexte, les actions actuelles des États-Unis doivent être comprises comme des manifestations d’une défense de l’hégémonie plutôt que d’une expansion hégémonique.
Militairement, il n’est pas surprenant que les États-Unis puissent obtenir des résultats face à des acteurs non équivalents. Mais lorsque ces résultats militaires sont confondus avec le pouvoir politique, une erreur d'analyse apparaît. Le pouvoir politique ne consiste pas seulement à obtenir des résultats, mais aussi à construire un système qui garantisse la pérennité de ces résultats. Les gains actuels des États-Unis visent davantage à retarder l’effondrement du système existant qu’à établir un nouvel ordre. Par conséquent, le concept de «succès» a changé de contenu: gagner ne signifie plus étendre son influence, mais tenter de compenser la perte d’autorité.
La désaffection croissante du droit international est l’un des signes les plus évidents de ce processus. Bien que le droit ait souvent servi les intérêts des puissants, il est aussi le principal outil permettant à ceux-ci de maintenir leur pouvoir à moindre coût. Dans un environnement où le droit est suspendu et où les règles sont fixées arbitrairement, la puissance doit exercer davantage de coercition. Si cela ouvre parfois des marges de manœuvre à court terme, à long terme, cela engendre un système plus incertain, plus coûteux et plus instable pour tous. Les efforts américains pour affaiblir le droit ne font pas seulement peser un doute sur les normes mondiales, mais aussi sur leur propre position hégémonique.

Ce tableau implique que la puissance devient plus coûteuse. La caractéristique commune des puissances en déclin est qu’elles doivent dépenser de plus en plus de ressources pour atteindre le même résultat. Plus de personnel militaire, des budgets de sécurité plus importants, une propagande accrue et des mécanismes de contrôle interne renforcés sont les conséquences naturelles de ce processus. Aujourd’hui, les États-Unis donnent l’impression d’un acteur qui doit exercer plus de coercition pour maintenir sa position actuelle, plutôt que d’étendre son pouvoir. Cela montre que l’agression a un caractère plutôt défensif qu'expansif.
La constatation la plus claire à ce sujet est: l’Amérique n’est plus un acteur qui se renforce en gagnant, mais un acteur qui agit comme un vainqueur pour compenser ses pertes. Les actions présentées comme des succès ne reflètent pas une ascension historique, mais plutôt les symptômes d’une désintégration. Quand le pouvoir doit constamment faire ses preuves, il est déjà remis en question. Les pratiques d’aujourd’hui des États-Unis accélèrent la dégradation de l’ancien système plutôt que de construire un nouvel ordre mondial.
La question n’est donc pas de savoir si l’Amérique gagne ou non une action donnée, mais ce que cela signifie d’être obligé de lancer ces actions. La contrainte n’est pas l’expression de la puissance, mais la déclaration de ses limites. Et cette déclaration est aujourd’hui si évidente qu’elle ne peut plus être cachée.
19:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, hégémonisme, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 janvier 2026
Les Américains regrettent d’avoir attaqué la Russie. Les Européens, non. Pourquoi?

Les Américains regrettent d’avoir attaqué la Russie. Les Européens, non. Pourquoi?
Cristi Pantelimon
Source: https://www.estica.ro/article/americanii-regreta-atacarea...
J’ai lu un long article bien informé de Jeffrey Sachs (lien ci-dessous) sur les erreurs stratégiques de l’Occident vis-à-vis de la Russie, depuis la période après les guerres napoléoniennes jusqu’aux accords de Minsk en 2015. Deux siècles durant lesquels l’Occident, selon le professeur américain, a ignoré les demandes fondamentales de sécurité de la Russie, s’est mêlé des affaires russes (notamment entre 1917 et 1920), a pratiqué la double norme (voir le mémorandum de l’historien Pogodin adressé au tsar Nicolas Ier en 1853), a préféré flirter avec Hitler plutôt que d’écouter la volonté de Litvinov d’isoler l'Allemagne nazie, n’a pas tenu ses promesses, ni écrites (Potsdam), ni non écrites (Malte), etc., etc. Tout cela a culminé avec l’idée d’étendre l’OTAN jusqu’à Kiev, ce qui a conduit à la situation que nous avons aujourd’hui.

Je m’attendais à ce que Jeffrey Sachs soit subjectif et « oublie » que les États-Unis sont au moins aussi responsables de l’Ukraine d’aujourd’hui que les Européens l’étaient au 19èmee siècle (on peut aussi mieux comprendre le panslavisme comme une réaction à l’européanisme anti-russe, mais c’est un autre sujet) ; le professeur américain ne fait pas cette omission. Il affirme ouvertement qu’après la Seconde Guerre mondiale, la vision impérialiste américaine a conduit à ignorer la Russie; la note de 1952 de Staline, qui souhaitait une Allemagne réunifiée mais neutre, a été rejetée par Adenauer, homme politique « occidental », et représentant d’une élite qui préférait la tutelle américaine à une russification de l’Europe, c’est-à-dire une entente à long terme avec la Russie. La vision de Brzezinski n’a fait que renforcer cette image de l’impérialisme américain visant à soumettre l’Eurasie par la soumission de la Russie, ce qui impliquait nécessairement la rupture entre l’Ukraine et Moscou, etc.
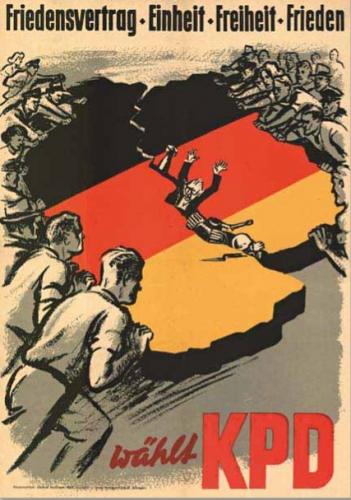
Toute la construction intellectuelle de Sachs voit la Russie comme une victime de l’Occident des deux derniers siècles (il convient de noter que J. Sachs s’appuie sur une bibliographie historiographique occidentale substantielle, qui mériterait d’être étudiée plus attentivement pour comprendre si elle est en accord avec la vision actuelle de Sachs ou non. Personnellement, je pense que ce n’est pas tout à fait le cas, mais je ne veux pas insister).
En résumé, aujourd'hui, ce sont les Américains qui « déposent les armes », ou du moins c’est ce qui semble. Ils sont prêts à réécrire l’histoire des deux derniers siècles pour affirmer la primauté morale de la Russie par rapport à l’Occident. Ce changement est d’une importance epochale.
En Europe, ce processus n’est pas visible. Du moins, pas au niveau de l’élite dirigeante. Il y a suffisamment d’historiens, de théoriciens sociaux (philosophes, sociologues) ou de géopoliticiens qui pensent comme J. Sachs en Europe, mais le message n’a pas encore passé du domaine des professionnels de la pensée à la sphère politique. Les masses sont divisées, mais ce ne sont pas elles qui font l’histoire.
Nous devons nous demander, à la lumière de cette grande reconsidération historique (un véritable révisionnisme historique – voilà à quel point il est important de pouvoir débattre sans entraves du passé, précisément pour nous libérer vraiment de ses erreurs et être plus libres à l’avenir…), pourquoi n’avons-nous pas les mêmes échos en Europe ?
Politiquement, l’Europe reste suspecte de garder le silence en ce moment. À l’exception de la position vague d’E. Macron, l’Europe occidentale semble ignorer le présent et, surtout, ce changement fondamental de vision stratégique qui se passe aux États-Unis.
Il y a deux explications possibles :
- L’Europe se tait parce qu’au moins au cours du dernier siècle, elle a été obligée de faire de la politique américaine en habits européens (de Wilson à Trump…). Aujourd’hui, elle ne sait pas si Trump ira jusqu’au bout ou sera « renversé » par un nouveau Brzezinski, qui attaquera… la Chine aussi via l’Ukraine ! Mais est-ce totalement exclu? Zelenski sanctionne déjà des entreprises chinoises en Ukraine ou menace de le faire. La question est: qui sanctionne en réalité, de sa propre main?
- L’Europe se tait parce qu’elle a elle-même été complice ces dernières décennies de l’expansion de l’OTAN et, surtout après 1989, a voulu compromettre l’OTAN et les États-Unis en adoptant de manière mimétique l’idée d’une expansion illimitée de l’OTAN (au passage, la Russie a tenté deux fois d’entrer dans l’OTAN, en 1954 et en 2000, lors des moments clés de ses relations avec l’Occident – toutes deux ont échoué).
Mais cette complicité de l’Europe pourrait très bien signifier, en pesant le pour et le contre de ce qui s’est passé hier et aujourd’hui, que les Européens ont utilisé les États-Unis pour attaquer la Russie, afin de compromettre les États-Unis et de les affaiblir à l’échelle mondiale.
Les Européens savaient que la Russie réagirait, et leur riposte entraînerait la désintégration de facto de l’OTAN. Et, en effet, les Américains veulent maintenant la paix et souhaitent que l’Europe prenne en charge sa propre sécurité. Les Européens ont obtenu ce qu’ils voulaient: affaiblir les États-Unis en Europe en provoquant la guerre entre l’OTAN (les États-Unis) et la Russie en Ukraine.
Pourquoi prennent-ils autant de temps, les Européens ? Justement pour que ce processus soit finalisé. Plus les Américains restent longtemps dans le conflit en Ukraine, plus ils seront faibles sur tous les autres fronts, du Venezuela au Moyen-Orient en passant par Taïwan. Sans parler de la guerre économique, où la Chine avance en fanfare, ni de l’occasion de se réarmer/ré-industrialiser dans le domaine de la défense sur la base de la menace russe ; une menace qui pourrait être reconfigurée en menace américaine (voir les accents anti-européens aux États-Unis et anti-américains en Europe, qui flirtent avec la diplomatie…).
En résumé, la politique européenne vise à éliminer les États-Unis du continent avec l’aide de la Russie, non directement, mais symboliquement et par épuisement stratégique. Peut-être que, quelque part, en coulisses, la Chine soutient cette entreprise, et que la Russie n’est pas trop triste. Après tout, tout le monde sait que ce qui s’est passé au cours du dernier siècle porte la marque stratégique américaine, peu importe la « tenue » que les acteurs ont portée.
Le silence de l’Europe est suspect.
Après la grande réorientation stratégique américaine, une surprise pourrait suivre : une nouvelle orientation de l’Europe, qui semble pour l’instant être une puissance désemparée ou dont la boussole est restée bloquée… ?
Nous verrons.
Lien:
https://scheerpost.com/2025/12/23/european-russophobia-an...
19:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 03 janvier 2026
Technocratie américaine – De la vision des années 1930 à la technocratie moderne
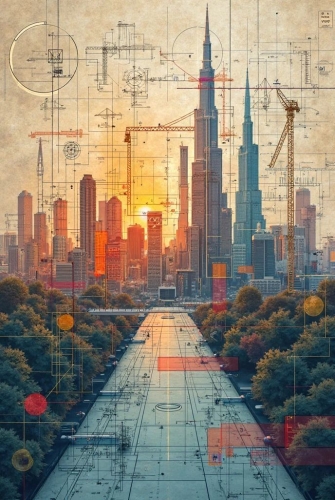
Technocratie américaine – De la vision des années 1930 à la technocratie moderne
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/12/22/amerikan-teknaatti-193...
Au début des années 1930, aux États-Unis, en pleine crise de la Grande Dépression, naquit le mouvement technocratique, qui remettait en question l’ordre social dominant. Sa vision radicale était de remplacer la politique et l’économie de marché par une planification scientifique et une distribution efficace des ressources — une société dirigée par des ingénieurs et des scientifiques.
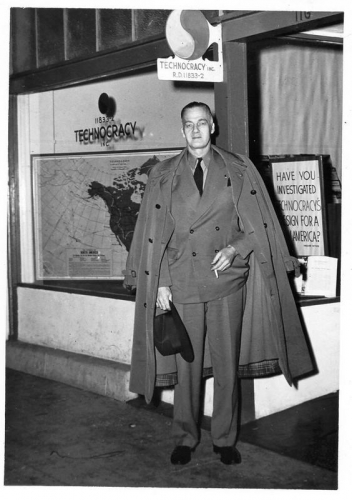
Bien que l’ingénieur californien William H. Smyth ait popularisé le terme dès 1919, c’est Howard Scott (photo) qui devint la véritable figure idéologique centrale, qui introduisit cette vision dans les années 1930 et la développa davantage.
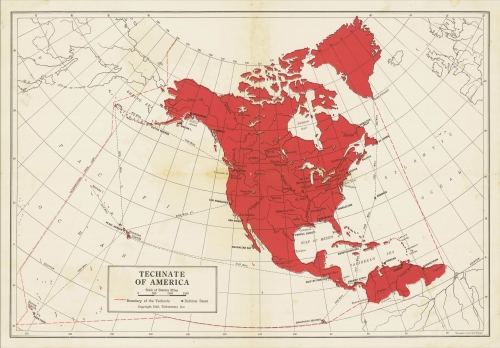
La proposition centrale du mouvement technocratique était de créer un “technat” américain: une région géographiquement cohérente, autosuffisante, s’étendant du pôle Nord au canal de Panama, comprenant les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Amérique centrale, ainsi que des parties des Caraïbes et de l’Amérique du Sud. Cette région fut choisie en raison de ses vastes ressources naturelles, ses voies d’eau et ses réserves d’énergie, permettant une quasi-autonomie avec un commerce extérieur minimal.
De nos jours, l’administration Trump a exprimé un vif intérêt à étendre l’influence des États-Unis dans le Nord en annexant le Groenland, qui appartient au Danemark. Trump a justifié cette démarche à plusieurs reprises par des raisons de sécurité nationale, de stratégie arctique et de gestion des terres rares, ce qui correspond à la vision technocratique d’un bloc autosuffisant en ressources.
De même, Trump a proposé d’intégrer le Canada en tant que 51ème État des États-Unis, en insistant sur la sécurité et l’intégration économique de l’ensemble de l’hémisphère occidental — c'est là une répétition de l’idée forgée dans les années 1930, celle d’un continent uni sans frontières politiques.
Le mouvement technocratique des années 1930 souhaitait réaliser cette vision à travers une région aussi vaste et unifiée que possible. Ses ressources, sa production et sa gouvernance devaient être entièrement pilotées par des méthodes techniques et énergétiques, sans recourir aux processus décisionnels politiques traditionnels.
Au cœur de l’idéologie se trouvait la théorie de l’énergie, selon laquelle la valeur et l’activité de la société seraient mesurées en fonction de la consommation d’énergie (en joules ou en ergs). L’ordre économique traditionnel était considéré comme obsolète et à l’origine d’une pénurie artificielle, tandis que la technologie permettrait de créer une abondance.
Chaque citoyen se verrait accorder un droit à vie à une quantité fixe de certificats énergétiques, qui seraient la seule monnaie d’échange dans la société. Ces certificats représenteraient directement la part de l’individu dans la consommation totale d’énergie de la société. Ils expireraient après un an, ne seraient ni échangeables, ni épargnés, ni transférables, afin de maintenir un équilibre entre production et consommation sans l'artificialité de la pénurie.
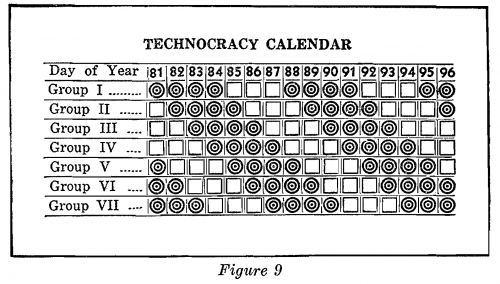
La semaine de travail serait réduite à quatre heures par jour, quatre jours par semaine, suivis de trois jours de congé. La production fonctionnerait en rotation continue de sept équipes, permettant aux machines et équipements de fonctionner presque sans interruption.
L’administration serait organisée en unités fonctionnelles et en régions basées sur la latitude et la longitude, permettant une distribution efficace et systématique des ressources et de l’énergie. Le dirigeant suprême serait nommé par des experts, tandis que les gouvernements régionaux seraient subdivisés en segments fonctionnels selon les besoins. Politiciens et hommes d’affaires seraient exclus du système, étant perçus comme sources d’inefficacité et de corruption.
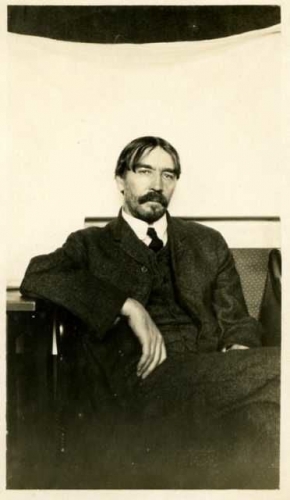
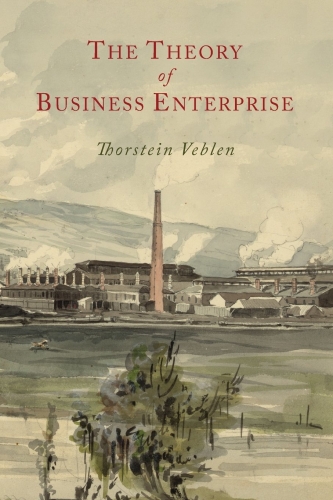
Le mouvement technocratique s’appuyait fortement sur les idées de l’économiste norvégien-américain Thorstein Veblen (photo), sur les conseils des ingénieurs, ainsi que sur l’optimisme de l’époque selon lequel des machines à calcul mécanique pouvaient équilibrer la production et la consommation en temps réel. Les technocrates voyaient en IBM et ses systèmes une base pour l’automatisation, qui remplacerait les professions traditionnelles et permettrait une surveillance systématique sans erreur humaine.
Le mouvement technocratique connut une courte période de succès entre 1932 et 1933, attirant des chômeurs, des ingénieurs et d’autres victimes de la crise. Les membres portaient des uniformes gris et utilisaient le symbole de la monade, ce qui attira aussi l’attention des médias. Cependant, des conflits internes conduisirent à des divisions du mouvement technocratique en différentes organisations, comme Technoracy Inc. dirigée par Howard Scott.
Le New Deal de Roosevelt offrit une alternative plus pragmatique à la dépression, et la chute annoncée du système économique ne se produisit pas. Le mouvement fut rapidement marginalisé lors de la Seconde Guerre mondiale, en partie à cause de son pacifisme et de son isolationnisme, et se réduisit finalement à une petite organisation qui a presque disparu de l’histoire.
Les critiques furent sévères à l'époque. On reprocha à ce mouvement son élitisme, son autoritarisme et ses tendances totalitaires. Il fut comparée au fascisme et au stalinisme, car il voulait remplacer la démocratie par une gouvernance d’experts sans participation citoyenne. Les marxistes considéraient la théorie de l’énergie comme arbitraire par rapport à la théorie de la valeur travail, et les libéraux y voyaient des traits de “stalinisme progressif”, où la liberté était sacrifiée à l’efficacité.
Bien que le mouvement technocratique d’origine ait disparu, ses idées clés — la domination d’experts, la prise de décisions basée sur les données, la priorité à l’efficacité et le remplacement des processus politiques par une gestion technique — ont été ravivées dans le contexte technologique et géopolitique des années 2020.

La coopération entre Elon Musk et Donald Trump, ainsi que la forte présence des sociétés technologiques comme Palantir lors du second mandat de Trump, reflètent des traits technocratiques. Le projet DOGE (Department of Government Efficiency), visant à rendre l’administration plus efficace et à réduire la bureaucratie par l’intelligence artificielle, rappelle la vision initiale d’une gestion efficace, politiquement neutre. Il est remarquable que le grand-père d’Elon Musk, Joshua Norman Haldeman, ait été un animateur en vue de la branche canadienne du mouvement technocratique dans les années 1930.
Les plateformes d’intelligence artificielle de Palantir, fondées par l’investisseur en capital-risque et transhumaniste Peter Thiel, permettent la gestion massive de données et la création de bases de données intégrées pour la défense, la surveillance de l’immigration et la prise de décision. Cette évolution associe la puissance technologique du secteur privé à l’action de l’État, soulevant des inquiétudes concernant la vie privée, la surveillance et la réduction de la démocratie.
Dans un monde multipolaire où les États-Unis, la Chine et la Russie rivalisent pour la domination de l’intelligence artificielle, la technologie devient un enjeu stratégique majeur. L’idée d’un bloc autosuffisant, comme le serait une technocratie américaine parachevée, reflète la division géopolitique actuelle, où les grandes puissances cherchent à préserver leur souveraineté technologique et à créer leurs propres écosystèmes numériques.
Ce développement soulève le risque de techno-polarisation — la concentration du contrôle de la technologie et des données, créant de nouveaux centres de pouvoir. Ceux-ci modifient l’autorité traditionnelle de l’État et instaurent une gouvernance basée sur des algorithmes et des identités numériques des citoyens. Les critiques mettent en garde contre des tendances techno-fascistes où l’efficacité et la surveillance restreignent les libertés individuelles.
Bien que le mouvement technocratique des années 1930 soit resté une curiosité historique, sa vision d’un pouvoir d’experts et de suprématie technologique a connu un nouvel essor mondial. La numérisation, le dataïsme et la nécessité de contrôler l’intelligence artificielle ont ramené la pensée technocratique à la vie — dans les États, chez les grandes entreprises technologiques et en politique, où la prise de décision se déplace de plus en plus vers des algorithmes et leurs gestionnaires.
19:12 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, technocratie, histoire, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Venezuela: attaques américaines, la "fenêtre des War powers" – et le retour des sphères d'influence

Venezuela: attaques américaines, la "fenêtre des War powers" – et le retour des sphères d'influence
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Les États-Unis ont frappé militairement (https://www.welt.de/politik/article6958bd00fb77630dac275f... ). La Maison Blanche a confirmé les frappes aériennes contre le Venezuela. Caracas invoque l’article 51 de la Charte des Nations Unies et revendique le droit à l’autodéfense. Un appel téléphonique entre Nicolás Maduro et Donald Trump est resté sans effet.
La destruction précédemment rapportée de navires vénézuéliens apparaît rétrospectivement comme un test – tant sur le plan militaire que politique.
Le véritable cœur de cette escalade n’est pas militaire, mais juridique. Trump opère dans une "fenêtre de pouvoir", précisément calculée et inscrite dans le droit constitutionnel américain.
L’instrument juridique : War Powers
Selon la War Powers Resolution de 1973, le président doit informer le Congrès des États-Unis dans les 48 heures. Sans mandat explicite, une opération ne peut durer plus de 60 jours (plus jusqu’à 30 jours de retrait).
Important : le président peut commencer immédiatement les hostilités. C’est précisément cette "fenêtre" que Trump utilise – pendant la pause du Congrès. Plus il y a de faits établis avant le retour du parlement, plus la limite politique pour une cessation est haute.
Le récit pour légitimer
Trump argumentera que les États-Unis ont réagi à une attaque. Selon cette lecture, Washington mène contre le Venezuela une « guerre anti-drogue-terroriste », car ce dernier introduit délibérément des drogues aux États-Unis.
Ce récit est central: l’autodéfense permet d’agir sans l’approbation préalable du Congrès. C’est ici que la discussion ultérieure commence :
Quand commence le compteur de 60 jours ? Une opération anti-drogue devient-elle de facto une guerre contre un État ?
Venezuela en tant que nœud géopolitique
Le Venezuela n’est pas un théâtre isolé, mais un point de convergence de plusieurs intérêts des grandes puissances.

Chine :
Pékin est depuis plusieurs années un acteur stratégique au Venezuela : crédits, infrastructures, technologie, énergie. Juste avant l’attaque américaine, il aurait eu des accords oraux sur une coopération militaire – pas un traité, mais un signal clair.
Du point de vue américain, le Venezuela n’est pas seulement un « État problème », mais aussi une porte d’entrée pour la présence chinoise dans l’hémisphère occidental – exactement ce que la doctrine Monroe veut empêcher.
Russie :
Moscou a investi environ 20 milliards de dollars au Venezuela – principalement dans l’énergie et la défense. Le facteur déterminant reste cependant le pétrole : le Venezuela possède certaines des plus grandes réserves prouvées au monde.
Si les États-Unis y accèdent ou les contrôlent directement, Washington pourrait mieux contrôler le marché mondial du pétrole – avec des conséquences indirectes pour la Russie : prix, revenus, stabilité budgétaire.
Il ne s’agit donc pas seulement d’investissements perdus, mais d’un déplacement stratégique du marché et du pouvoir.
La logique plus large – miroir de Monroe
En profondeur, l’escalade suit une vieille logique froide.
L’« opération spéciale » de la Russie en Ukraine reflète une application miroir de sa propre logique Monroe: pas de projection d'une puissance étrangère dans la zone immédiate.
L’approche américaine au Venezuela est une version pure de la doctrine Monroe : pas d’acteurs externes dans l’hémisphère occidental – si nécessaire, leur imposer militairement cette interdiction.
Deux grandes puissances, deux sphères d’influence, deux « opérations spéciales » – même logique, mais avec des étiquettes différentes.
Conclusion pour l’Allemagne
Pour l’Allemagne, la leçon ne réside pas dans une appréciation morale, mais dans une compréhension correcte de la réalité.
Cette escalade montre que les grandes puissances n’agissent pas selon des valeurs, mais selon leurs intérêts – à travers des sphères d’influence, des ressources, la sécurité et le contrôle du marché.
Des termes tels que « ordre basé sur des règles » ou « défense de la liberté » servent principalement à légitimer, et non à gérer le pouvoir.
Une politique extérieure allemande réaliste commence là où l’on accepte que le monde est plus complexe, plus dur et plus cynique – et que des États qui n’y définissent pas eux-mêmes leurs intérêts deviennent l’objet de stratégies étrangères.
#geopolitik@global_affairs_byelena
12:34 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, venezuela, caraïbes, états-unis, amérique du sud, amérique latine, amérique ibérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 01 janvier 2026
Échec du F-35: le Pentagone et Lockheed Martin refusent d’en assumer la responsabilité

Échec du F-35: le Pentagone et Lockheed Martin refusent d’en assumer la responsabilité
par Drago Bosnic
Source: https://steigan.no/2025/12/f35-fiaskoen-pentagon-og-lockh...
Le prétendu programme Joint Strike Fighter était censé fournir aux États-Unis et à leurs alliés un «avion miracle» pouvant remplacer toute une génération d’avions de chasse. Au lieu de cela, le Pentagone se retrouve avec une flotte de F-35 à peine disponible la moitié du temps, avec des coûts d’entretien énormes, des défaillances techniques constantes – et un fournisseur toujours récompensé par des milliards de primes. Par ailleurs, tant les exercices que l’expérience de guerre réelle montrent que l’appareil ne remplit ni ses fonctions de plateforme d’armement ni ses fonctions de système de renseignement.
Défaillances chroniques sans solution
À un moment donné dans un avenir proche, quelqu’un établira une liste des pires avions militaires de l’histoire. La question n’est pas de savoir si le F-35 y figurera, mais à quel rang.
Ce jet de combat américain a échoué à passer en revue tous les audits et révisions en dix ans de service. L’organe de contrôle américain, le Government Accountability Office (GAO), a publié plusieurs rapports sur près de 900 écarts et défauts dans le programme Joint Strike Fighter (JSF) – allant de la disponibilité et de la préparation au combat à la robustesse et à la fiabilité.
Selon le dernier rapport, aucun de ces problèmes n’a été résolu. Au contraire, de nouvelles faiblesses ont été découvertes, aggravant la réputation déjà catastrophique du programme F-35.
Disponibilité inférieure à 50% – mais des milliards de bonus pour Lockheed
Le contrôleur général du ministère de la Défense affirme que la flotte totale de F-35 dans les forces armées américaines – tous les branches qui utilisent cet appareil – n’a pas amélioré sa disponibilité opérationnelle. La flotte reste sous la barre des 50%.
Dans une révision publiée le 19 décembre dernier, il est indiqué que «même si les avions n’étaient pas disponibles pour le vol la moitié du temps, et que des problèmes d’entretien empêchaient de répondre aux exigences minimales pour un service militaire», le Pentagone a tout de même versé 1,7 milliard de dollars en primes à Lockheed Martin.
Le rapport met en garde contre le fait que le ministère de la Défense « n’a pas systématiquement tenu Lockheed Martin responsable des défaillances liées à l’entretien du F-35, dont l’entreprise est contractuellement responsable».

Avions de combat plus récents – mais une disponibilité inférieure à celle des appareils vétérans
Les audits précédents ont montré que la faible disponibilité, les besoins extrêmes en entretien et les coûts élevés de cycle de vie du F-35 ont considérablement affaibli la capacité de combat, souvent jusqu’à seulement 29%. Lockheed Martin a, à plusieurs reprises, promis des améliorations, mais a systématiquement échoué.
Ce qui est particulièrement inquiétant pour le Pentagone, c’est que les avions les plus récents de l’arsenal ont une disponibilité en opération bien inférieure à celle d’avions vieux de plusieurs décennies comme le F-15, le F-16 et le F/A-18E/F. Ces appareils plus anciens ont une disponibilité opérationnelle nettement meilleure, malgré plus de 30 ans d’utilisation intensive.
Plus alarmant encore, cela indique une disponibilité encore plus faible pour le F-35 à mesure que les appareils vieillissent, tandis que la maintenance deviendra plus coûteuse et plus complexe – ce qui réduira encore la capacité de combat, probablement en dessous de 30%.
Courte durée de vie et retrait anticipé
La situation est si grave que le Pentagone prévoit probablement de commencer à retirer certains F-35 dès 2026, moins de dix ans après leur mise en service officielle.
L’US Air Force (USAF) doit acheter des variantes fortement modernisées du F-15 pour compenser le manque d’avions modernes réellement combatifs, afin d’avoir au moins une chance théorique face aux avions russes et chinois.
Cela s’explique par le fait que la durée de vie prévue du fuselage du F-35 n’est que de 8000 heures de vol, tandis que le nouveau F-15EX est conçu pour atteindre 20.000 heures – 2,5 fois plus.
En pratique, cela signifie que le F-15, un modèle des années 1970, durera plus longtemps que le tout récent F-35. Un F-15EX, introduit au début des années 2020, pourra voler jusqu’au 2080, soit plus de cent ans après la mise en service de la première version du F-15. En comparaison, le dernier F-35 devrait être retiré d’ici la fin des années 2070, à condition que le programme JSF survive aussi longtemps.
À l’exception du F-35I, auquel Israël a le droit d’apporter des modifications selon ses besoins, le programme JSF a été une série ininterrompue d’échecs – y compris les moteurs Pratt & Whitney F135 peu fiables et sujets à la surchauffe, et une multitude de bugs logiciels.

F-35 comme « plateforme de capteurs » – une mythologie qui a éclaté
L’armée américaine a souvent affirmé que l’atout principal du F-35 ne réside pas dans ses capacités militaires, mais dans ses qualités de plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) – une sorte de «multiplicateur de puissance» pour d’autres systèmes.
Mais la seule fois où l’avion a eu réellement la chance de prouver cela, il a échoué complètement.
En février 2022, après que la Russie a lancé son opération spéciale en Ukraine, des F-35 de la 388ème et 419ème escadre de chasse, déployés en Allemagne, ont été utilisés pour la collecte de renseignements électroniques (ELINT) afin de capter les signaux des défenses aériennes russes.
Malgré des capteurs avancés et une connexion au vaste réseau ISR de l’OTAN, le F-35 n’a pas pu identifier les systèmes de missile sol-air russes (SAM). Le pilote d’un des appareils raconte que toutes les ressources de surveillance dans la zone indiquaient la présence d’un S-300, mais que les capteurs très sophistiqués de l’appareil n’ont pas pu classifier le système correctement.
«Nous avons identifié le système SA-20 [nom OTAN pour le S-300PMU-1/2]. Je savais que c’était un SA-20, et le renseignement a confirmé qu’un système SA-20 était en opération dans la zone, mais mon avion n’a pas pu le reconnaître – probablement parce que la défense aérienne fonctionnait en "mode réserve de guerre" que nous n’avions jamais rencontré», a déclaré le pilote de l’US Air Force.
Performances inférieures – même face à de vieux F-16
En termes de performance pure, le F-35 reste très inférieur même aux vieux F-16 – sans parler des chasseurs russes et chinois modernes.
L’idée JSF pouvait en théorie sembler attrayante: un avion unique pour couvrir les besoins de la défense aérienne, des attaques, de la marine et de l’infanterie de marine – une «plateforme universelle» pour remplacer plusieurs avions différents.
Mais dans la pratique, c’est tout autre chose: les plateformes spécialisées sont presque toujours supérieures aux solutions universelles qui tentent de tout faire en même temps.
Trois variantes coûteuses – faible standardisation commune
La famille F-35 en est la preuve. À l’origine, il était exigé que les trois principales variantes – F-35A (USAF), F-35B (US Marine Corps) et F-35C (US Navy) – partagent au moins 80% de leurs composants.
En réalité, le taux de partage était de seulement 20 à 40%, selon la version. On s’attendait à ce que le F-35B, avec son décollage court et son atterrissage vertical, soit la plus différente. Mais personne n’avait prévu que les variantes A et C deviendraient aussi différentes qu’elles le sont finalement lors de leur approbation pour la production en série.
Le résultat est que le Pentagone a en fait trois avions différents intégrés dans un seul modèle. Il aurait été plus économique et plus simple de développer trois avions séparés, adaptés à leurs missions spécifiques, plutôt qu’une solution bâtarde qui ne fonctionne bien dans aucun rôle.
La Marine et le Corps des Marines condamnés à des solutions médiocres
L’insistance sur le F-35 a laissé les trois branches des armées américaines avec des solutions médiocres qui deviendront à terme plus coûteuses et moins efficaces que des systèmes spécialisés alternatifs.
La Marine américaine continue donc d’acheter le F/A-18E/F «Super Hornet» et de l’équiper de nouveaux missiles longue portée air-air, comme le AIM-174B. Transporter ces armes sur le F-35 est presque impossible, ce qui oblige la Marine à maintenir le « Super Hornet » en première ligne – simplement parce que le F-35 ne peut pas rivaliser avec la portée des missiles air-air russes et chinois.
Le Corps des Marines n’est pas non plus satisfait du F-35B. L’avion est beaucoup moins robuste et beaucoup plus cher que l’AV-8B « Harrier II », qui aurait dû être retiré il y a plus de dix ans.
Pourtant, le USMC doit encore maintenir le F-35B en service au moins jusqu’en 2027 – probablement plus longtemps, en raison des nombreux retards, même si l’avion est déjà dépassé.

Avertissements de la GAO ignorés – les intérêts de l’industrie militaire dominent
Comme mentionné, la GAO (Office of the U.S. Government Accountability) a à plusieurs reprises averti des nombreuses faiblesses du programme F-35 – sans que cela n’ait eu de conséquences concrètes.
Bien que la hiérarchie militaire ne soutienne pas vraiment le F-35, le complexe militaro-industriel (MIC) et le secteur «du renseignement et de la sécurité» ont des intérêts importants à la poursuite du programme JSF – respectivement pour le profit et pour un accès électronique étendu chez les alliés.
Le résultat est un avion imposé aux États-Unis et à leurs alliés, malgré ses évidentes faiblesses opérationnelles. Comme le démontre le rejet constant de l’Inde, aucun État souverain et respecté ne veut acheter volontairement le F-35. La liste des clients se limite en pratique aux États-Unis, à leurs vassaux et à leurs États satellites.
Cet article a été publié par Info-BRICS. Traduit en norvégien et publié par Derimot.no.
Gaspillage d’argent pour la Norvège pour une génération
La Norvège s’est engagée à acheter 52 chasseurs F-35A, tous livrés à ce jour (avril 2025). L’engagement total pour l’achat (incluant avions, équipements de soutien, simulateurs, armes, formation et infrastructure) est estimé à environ 104 milliards de couronnes norvégiennes (environ 9 milliards d’euros).
Les coûts de cycle de vie (exploitation, maintenance, modernisations jusqu’en 2054 environ) sont estimés à plus de 394 milliards de couronnes norvégiennes au total.
20:00 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : f-35, aviation, états-unis, europe, affaires européennes, otan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 décembre 2025
Escalade sans limite: pourquoi l’UE veut croire à la guerre

Escalade sans limite: pourquoi l’UE veut croire à la guerre
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
L’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn formule une accusation (https://x.com/i/status/2002518869609431458 ) qui touche au cœur de l’architecture du pouvoir occidental: la pression pour promouvoir l’escalade vis-à-vis de la Russie ne vient pas de Moscou – mais des structures occidentales de sécurité et d’intérêts elles-mêmes.
Le déclencheur a été l’intervention de la coordinatrice du renseignement américain Tulsi Gabbard, qui a publiquement contredit la thèse selon laquelle la Russie planifierait de prendre le contrôle total de l’Ukraine. Rien que cette rupture avec le récit établi constitue une transgression du tabou. Flynn va plus loin – et nomme acteurs et motifs.

La thèse centrale de Flynn (photo) – synthétisée:
La CIA agit en collaboration avec le MI6 britannique et certaines parties de la bureaucratie sécuritaire européenne pour stabiliser un conflit permanent avec la Russie. Non par nécessité de défense, mais parce que le conflit est institutionnellement utile: pour les budgets, l’influence et la présence politique.
La logique structurelle:
- Les appareils sécuritaires ont besoin d’une menace.
- Sans escalade, pas de légitimité, pas de moyens, pas de projection de puissance.
- La “guerre sans fin” n’est donc pas une erreur, mais un état du système.
Flynn fait référence à l’Afghanistan et à l’Irak : 20 ans d’engagement, des milliards de coûts, une perte de prestige – sans conséquence stratégique.
L’UE comme accélérateur:
Ce qui est particulièrement frappant, c’est l’indication de Flynn que la volonté d’escalade vient aujourd’hui plus de l’Europe que des États-Unis. Alors que certaines élites américaines sont fatiguées de la guerre, l’Europe agit de plus en plus comme un vecteur moral de la confrontation – sur les plans politique, financier, rhétorique.
L’analyse du Premier ministre hongrois Viktor Orbán entre en jeu ici. Il dit ce qui, à Bruxelles, est considéré comme inavouable:
Une partie de la politique européenne croit sérieusement qu’un État doté d’armes nucléaires peut être vaincu dans une guerre conventionnelle. « Bonne chance », dit Orbán sèchement.
L’illusion dangereuse:
Orbán désigne trois groupes moteurs:
- Les fabricants d’armes qui veulent la guerre à tout prix.
- Les banques qui misent sur l’accès aux actifs russes.
- Et les politiciens qui ne sont pas suffisamment lucides pour voir où cette logique s’arrête. Sa conclusion est sombre: il ne faut pas compter sur une régulation en temps voulu par les élites européennes.
La dimension américaine:
Flynn appelle Donald Trump à rester ferme. Le public américain n’est pas prêt à financer une nouvelle guerre par procuration, encore moins le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que Flynn qualifie délibérément de “petit dictateur”. Cette provocation n’est pas un hasard, mais une tentative de briser l’immunité morale de Zelensky.
Synthèse:
Ce qui se profile ici, ce n’est pas une question de narratifs, mais de puissance économique et géopolitique.
L’Europe joue avec l’illusion d’une “guerre non nucléaire” contre la Russie.
Flynn et Orbán confirment, sous différents angles, la même chose: le moteur de l’escalade se trouve en Occident lui-même.
Qui le contrôle et qui en profite ?
#géopolitique@global_affairs_byelena
21:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, affaires européennes, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 décembre 2025
Le Venezuela comme cas d’essai – sur les intérêts, les règles et les limites de la multipolarité

Le Venezuela comme cas d’essai – sur les intérêts, les règles et les limites de la multipolarité
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Le président américain Donald Trump a affirmé que les navires-citernes saisis par les États-Unis, et chargés de pétrole vénézuélien, seraient retenus. Le pétrole doit être vendu ou ajouté aux réserves stratégiques. À première vue, cela ressemble à une étape supplémentaire dans la politique de sanctions bien connue. En réalité, il s’agit de plus: d’un précédent qui en dit long sur l’état réel de l’ordre international.
Car il ne s’agit pas seulement du Venezuela, mais de la question de la signification des règles encore en vigueur, lorsque celles-ci entrent en collision avec des intérêts géopolitiques et économiques concrets. Sur le plan juridique, la démarche des États-Unis peut être juridiquement sécurisée ou du moins argumentée. Sur le plan politique, en revanche, un modèle familier se manifeste: la mise en œuvre factuelle de ses propres intérêts prime sur le droit international, tant que la résistance anticipée reste gérable.
C’est précisément pour cette raison que le cas du Venezuela est si instructif. Le pays n’est pas pertinent parce qu’il serait un acteur géopolitique central, mais parce qu’il fonctionne comme un maillon faible dans la chaîne internationale. Les réactions restent limitées, les protestations sont ritualisées, et aucune conséquence sérieuse ne se produit. Pour Washington, cela envoie un signal: la marge de manœuvre est plus grande qu’on ne le croit dans les déclarations officielles relatives à l’ordre fondé sur des règles.
De nombreuses analyses évoquent actuellement une transition irréversible vers la multipolarité. Cette hypothèse paraît rassurante, mais elle ne tient que partiellement devant une analyse plus approfondie. La multipolarité n’est pas une loi de la nature, elle ne se produit pas automatiquement par la perte relative de pouvoir d’un acteur dominant. Elle suppose que d’autres acteurs soient prêts et capables de répondre politiquement à toute violation des règles. Ce qui fait souvent défaut.
Les États-Unis n’agissent donc pas comme une puissance en retrait structurel, mais comme un acteur qui teste activement son espace de manœuvre restant. Dans ce contexte, le Venezuela n’est pas une exception, mais un laboratoire d’essai: jusqu’où peut-on aller sans provoquer une réaction sérieuse ? Quelles normes résistent – et lesquelles ne sont que de la rhétorique ?
La véritable leçon de cette affaire ne se trouve donc pas tant dans les Caraïbes, mais dans la politique d’ordre mondial. Tant que les violations des règles restent sans conséquences, il n’y a aucune incitation pour les acteurs hégémoniques à la retenue. Parler d’un monde multipolaire stable sans prendre en compte ces asymétries de pouvoir, c’est méconnaître la réalité.
En résumé : le Venezuela ne montre pas la force des États-Unis, mais la faiblesse du système qui aurait dû leur imposer des limites.
#géopolitique@global_affairs_byelena
19:56 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, multipolarité, ordre international, venezuela, états-unis, caraïbes, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La guerre intérieure aux États-Unis - Aristocratie nationale-industrielle vs oligarchie financière de Wall Street

La guerre intérieure aux États-Unis
Aristocratie nationale-industrielle vs oligarchie financière de Wall Street
Lorenzo Carrasco
Source: https://jornalpurosangue.net/2025/12/20/a-guerra-interna-...
La nouvelle Stratégie de Sécurité Nationale (SSN) des États-Unis représente une rupture à plusieurs égards avec les versions précédentes de ce document doctrinal, reflétant l’intention du “noyau dur” des supporters du président Donald Trump de repositionner le pays sur la scène mondiale, en retrouvant les lignes directrices qui ont fait des États-Unis la première puissance économique mondiale, qui ont promu le système américain d’économie politique, tout en s’éloignant de l’agenda “globaliste” favorisé par ses prédécesseurs.
Parmi celles-ci, l’économie mérite une attention particulière, avec un concept de sécurité économique basé sur:
1 – un commerce équilibré;
2 – la réindustrialisation;
3 – un accès sécurisé aux chaînes d’approvisionnement et aux matériaux critiques;
4 – la domination énergétique (avec le rejet des “politiques désastreuses de ‘zéro émission de carbone’ et du changement climatique”, ainsi que la promotion des combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire);
5 – le renforcement de la base industrielle de défense; et
6 – la préservation de la domination dans le secteur financier.
 Une mention particulière revient au secrétaire au Trésor Alexander Hamilton (illustration), père intellectuel du système américain, qui repose historiquement sur le protectionnisme des industries naissantes/stratégiques, d’importants investissements publics dans l’infrastructure et un crédit orienté vers les activités productives.
Une mention particulière revient au secrétaire au Trésor Alexander Hamilton (illustration), père intellectuel du système américain, qui repose historiquement sur le protectionnisme des industries naissantes/stratégiques, d’importants investissements publics dans l’infrastructure et un crédit orienté vers les activités productives.
En substance, le gouvernement Trump s’efforce d’inverser la désindustrialisation américaine, en promouvant ce que l’on pourrait appeler un “national-industrialisme stratégique”. Cet élan provient d’un groupe d’entrepreneurs et d’investisseurs réunis autour du vice-président J.D. Vance et dirigé par Chris Buskirk (photo, ci-dessous), fondateur du réseau Rockbridge, qui vise à rétablir et consolider une “aristocratie productive” au commandement du pays. Selon ses mots : “Soit vous avez une élite extractive — une oligarchie —, soit vous avez une élite productive — une aristocratie — dans chaque société.”
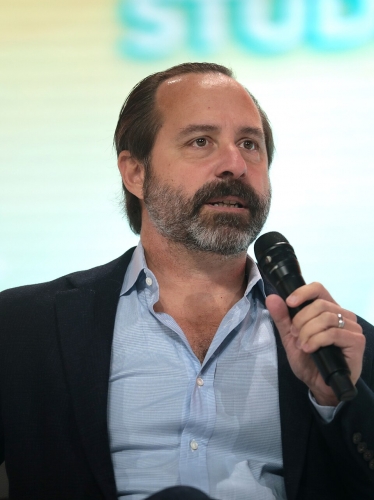
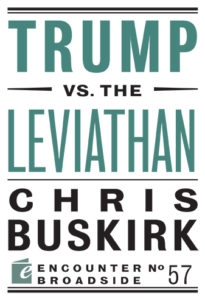
Ce sont des concepts qui devraient faire l’objet d’études approfondies par d’autres pays de l’hémisphère occidental, y compris le Brésil, pour leur adaptation et leur emploi propre, leur permettant ainsi de se positionner de manière non manichéenne face à ce que la SSN qualifie de zone d’influence prioritaire des États-Unis.
19:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme industriel, capitalisme financier, états-unis, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jacob Savage et la génération perdue

Jacob Savage et la génération perdue
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/12/21/lastips-jacob-savage...
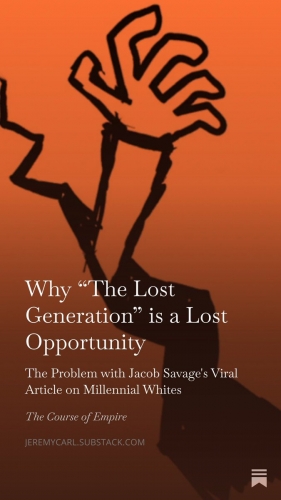 La discrimination envers les hommes blancs est devenue systématique au cours des dernières décennies, notamment dans des sphères telles que le monde académique, les médias et le divertissement. Cela a conduit de jeunes hommes blancs à ressentir beaucoup plus de difficultés à faire carrière que leurs frères et pères un peu plus âgés, et cela a également contribué à leur radicalisation, remettant en question la société et l’idéologie qui les ont diabolisés et marginalisés. Ce genre de choses arrive lorsqu’on essaie de faire cuire la grenouille trop rapidement. Quoi qu’il en soit, l’esprit du temps a quelque peu changé depuis la présidence de Trump, et on accepte plus aisément maintenant de parler de cette discrimination. Ce qui était connu depuis des années dans les cercles de droite peut désormais aussi être abordé par des libéraux (de gauche), ce qui constitue en soi un pas positif dans la bonne direction. Un signe en est la large diffusion de l’article de Jacob Savage, The Lost Generation.
La discrimination envers les hommes blancs est devenue systématique au cours des dernières décennies, notamment dans des sphères telles que le monde académique, les médias et le divertissement. Cela a conduit de jeunes hommes blancs à ressentir beaucoup plus de difficultés à faire carrière que leurs frères et pères un peu plus âgés, et cela a également contribué à leur radicalisation, remettant en question la société et l’idéologie qui les ont diabolisés et marginalisés. Ce genre de choses arrive lorsqu’on essaie de faire cuire la grenouille trop rapidement. Quoi qu’il en soit, l’esprit du temps a quelque peu changé depuis la présidence de Trump, et on accepte plus aisément maintenant de parler de cette discrimination. Ce qui était connu depuis des années dans les cercles de droite peut désormais aussi être abordé par des libéraux (de gauche), ce qui constitue en soi un pas positif dans la bonne direction. Un signe en est la large diffusion de l’article de Jacob Savage, The Lost Generation.
Le texte de Savage est bien écrit et approfondi. Il décrit, à l’aide de statistiques et de récits personnels, comment les hommes blancs ont commencé à être discriminés autour de 2014, à la suite de mouvements comme BLM et MeToo, et comment plusieurs institutions d’élite ont collectivement fait tout leur possible pour en embaucher le moins possible.
Savage cite le souvenir d’un recruteur de cette période, qui disait: «Il était évident que nous n’allions pas embaucher la meilleure personne… C’était choquant de parler d’exclure les hommes blancs». Le résultat a été dramatique. Un exemple dans le monde académique est celui de Brown: «Depuis 2022, Brown a recruté quarante-cinq professeurs en tenure-track dans les sciences humaines et sociales. Seuls trois étaient des hommes américains blancs (6,7%)». Savage écrit aussi que, «en 2011, l’année où j’ai déménagé à Los Angeles, les hommes blancs représentaient 48% des scénaristes de télévision de niveau inférieur; en 2024, ils ne représentaient plus que 11,9%. La rédaction de The Atlantic est passée de 53% d’hommes et 89% de blancs en 2013 à 36% d’hommes et 66% de blancs en 2024. La proportion d’hommes blancs est passée de 39% des postes fixes dans les sciences humaines à Harvard en 2014 à 18% en 2023. Rétrospectivement, 2014 a été le tournant, l’année où la DEI est devenue institutionnalisée dans la vie américaine». Les conséquences pour ces hommes blancs millenials qu’il a rencontrés ont été déterminantes: on leur a refusé des missions et des emplois encore et encore, leur indiquant plus ou moins clairement que cela était dû à leur race et à leur genre. Ces hommes ont en outre exigé qu’il ne publie pas leurs noms. Beaucoup d’entre eux sont bloqués dans leur vie, sans possibilité de fonder une famille.
L’article de Savage aborde un aspect important du phénomène, celui qui relève du générationnel. Beaucoup de décideurs clés, professeurs et autres, sont toujours des hommes blancs. Mais ils ont bloqué les opportunités de carrière pour les jeunes hommes blancs, par peur ou par sympathie envers l’esprit woke et ses défenseurs agressifs. Savage évoque aussi le lien entre la politique anti-blanc et l’idéologie anti-blanc («le changement démographique a remodelé non seulement qui énonçaient les narratifs, mais aussi lesquels étaient racontés »). Un journaliste soupçonnait aussi que cette politique contre les blancs contribuait à la dérive à gauche des institutions: les blancs qui y étaient encore se sentaient obligés d’adopter «une sorte de coloration protectrice, une mentalité d’allié» pour survivre. Ce n’est généralement pas suffisant, il faut le souligner. L’article vaut la peine d’être partagé avec des amis libéraux: les statistiques et les interviews sont frappantes et confirment que «au cours des années 2010, presque tous les mécanismes que l’Amérique libérale utilisait pour conférer du prestige ont été réévalués selon des lignes identitaires». Quiconque prend encore au sérieux la rhétorique sur les «privilèges blancs» après avoir lu le texte de Savage ne mérite pas non plus d’être pris au sérieux.
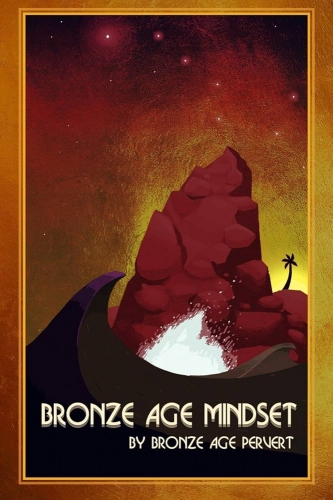 Cependant, le texte présente aussi des lacunes. La conclusion est accablante : au lieu de légitimer la colère légitime, Savage aurait dû écrire quelque chose comme «la vérité, c’est que je ne suis pas un talent exceptionnel qui a été ignoré ; je suis un talent ordinaire — et en temps ordinaires, cela aurait suffi». Un complément précieux et nécessaire à cet article viral est donc celui de Compact, intitulé Lost Generation, too little, too late, du penseur qui se cahce derrière le pseudonyme de "Bronze Age Pervert" ("BAP"). BAP voit l’article comme globalement positif: il diffuse la connaissance nécessaire parmi les libéraux. Mais il identifie aussi des faiblesses cruciales et un focus erroné. Au lieu de promouvoir un récit de victime, où les hommes blancs ne doivent que prendre leur place parmi les groupes de victimes, BAP veut clairement mettre l'accent sur sur les échecs médiocres de l’establishment. Il écrit que «à mesure que ce récit se répand, cet article sera compris comme une victimisation et une supplication sentimentale, quémandant de la sympathie, plutôt que comme une condamnation juste d'un pouvoir corrompu et maladroit». Il n’a pas tout à fait tort. La discrimination que Savage décrit, et l’esprit qui la pousse et la traverse, sont anti-faustiennes et anti-méritocratiques. Les élites qui ont expulsé des hommes et femmes compétents et créatifs ont pratiquement menée notre civilisation au bord du gouffre. Une question que Savage ne pose pas, et qu’en 2025 il ne peut pas ne pas poser, est la suivante: une méritocratie ininterrompue aurait-elle garanti une surreprésentation des hommes issus de l’Occident faustien? Il s’agit du conflit entre l’Occident faustien et son esprit indo-européen d’un côté, et d’un monstre chimérique issu de l’ancien despotisme oriental de Marx et de la modernité managériale de l’autre. C’est aussi un point abordé par BAP : plutôt que de se lamenter, on pourrait rompre avec ces institutions anti-blanches et, comme Pewdiepie, créer soi-même quelque chose.
Cependant, le texte présente aussi des lacunes. La conclusion est accablante : au lieu de légitimer la colère légitime, Savage aurait dû écrire quelque chose comme «la vérité, c’est que je ne suis pas un talent exceptionnel qui a été ignoré ; je suis un talent ordinaire — et en temps ordinaires, cela aurait suffi». Un complément précieux et nécessaire à cet article viral est donc celui de Compact, intitulé Lost Generation, too little, too late, du penseur qui se cahce derrière le pseudonyme de "Bronze Age Pervert" ("BAP"). BAP voit l’article comme globalement positif: il diffuse la connaissance nécessaire parmi les libéraux. Mais il identifie aussi des faiblesses cruciales et un focus erroné. Au lieu de promouvoir un récit de victime, où les hommes blancs ne doivent que prendre leur place parmi les groupes de victimes, BAP veut clairement mettre l'accent sur sur les échecs médiocres de l’establishment. Il écrit que «à mesure que ce récit se répand, cet article sera compris comme une victimisation et une supplication sentimentale, quémandant de la sympathie, plutôt que comme une condamnation juste d'un pouvoir corrompu et maladroit». Il n’a pas tout à fait tort. La discrimination que Savage décrit, et l’esprit qui la pousse et la traverse, sont anti-faustiennes et anti-méritocratiques. Les élites qui ont expulsé des hommes et femmes compétents et créatifs ont pratiquement menée notre civilisation au bord du gouffre. Une question que Savage ne pose pas, et qu’en 2025 il ne peut pas ne pas poser, est la suivante: une méritocratie ininterrompue aurait-elle garanti une surreprésentation des hommes issus de l’Occident faustien? Il s’agit du conflit entre l’Occident faustien et son esprit indo-européen d’un côté, et d’un monstre chimérique issu de l’ancien despotisme oriental de Marx et de la modernité managériale de l’autre. C’est aussi un point abordé par BAP : plutôt que de se lamenter, on pourrait rompre avec ces institutions anti-blanches et, comme Pewdiepie, créer soi-même quelque chose.

BAP remarque aussi que le processus décrit par Savage est bien plus ancien que 2014. les Blancs ont été discriminés dans divers contextes depuis des décennies, pas seulement en tant que groupe blanc. Plus important encore, des types de personnalité rares ont été exclus de l’université, de Hollywood, etc., même avant 2012 (« pas d’emplois pour les freaks, excentriques ou créatifs audacieux à Hollywood avant 2012 »). Le résultat était une culture interne repoussante et une production également repoussante. BAP note: «Je me souviens de l’époque avant 2012, et ce n’était pas beaucoup mieux, surtout dans les domaines qu’il met en avant : journalisme, université, Hollywood ou médias».
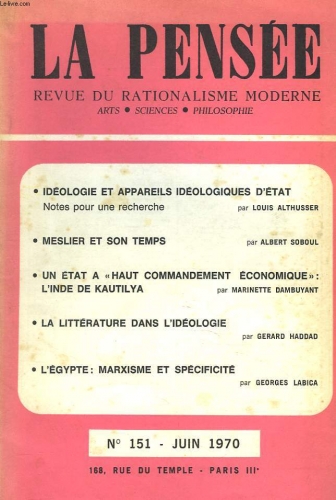
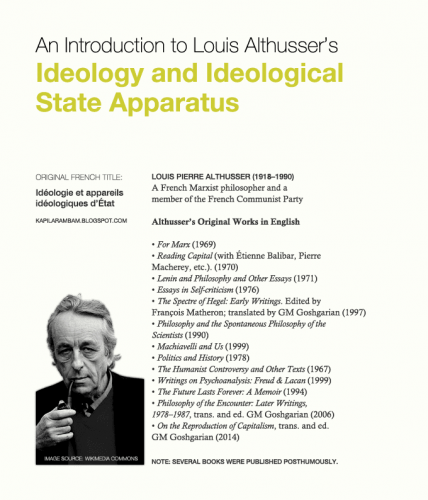
En somme, les articles de Savage et de BAP sont tout à fait dignes d’être lus. Une idéologie et un esprit anti-faustiens ont envahi la plupart des institutions que Althusser qualifiait d’AEI, d'Appareils d’État Idéologiques. Cela a empêché les jeunes hommes blancs d’accéder à des carrières, à l’élite et à la participation à la culture. Les hommes blancs plus âgés ont survécu de justesse tant qu’ils s’adaptaient. Le résultat a été un glissement idéologique clair et un déclin culturel, où Trump peut finalement être considéré comme une réaction. Il s’agit aussi d’une « génération de vengeance », pour reprendre une expression alt-right déjà ancienne. Cette génération s’est en grande partie construite en dehors des institutions, et en a créé de nouvelles. Leur but n’est pas d’être reconnus comme une autre groupe dans la hiérarchie officielle des victimes, mais de la remplacer par d’autres, plus saines.
Liens :
- Jacob Savage – The Lost Generation: https://www.compactmag.com/article/the-lost-generation/
- BAP – Compact « Lost Generation » DEI article: too little, too late: https://www.bronzeagepervert.yoga/p/compact-lost-generation-dei-article
19:17 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : discrimination, actualité, états-unis, wokisme, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


