Rechercher : BONNAL SCHILLER
Les Tintin de la Fin des Temps

Les Tintin de la Fin des Temps
Nicolas Bonnal
On était en 1976. J’avais quinze ans et plus trop d’illusions en politique (Chirac ? Cochin ? La liste Weil ! Le PS ! Les Européennes !). On avait beaucoup attendu l’album, après l’étrange et drolatique Vol 714 pour Sydney qui recyclait le Matin des magiciens de Pauwels et Bergier : et l’on fut servi.
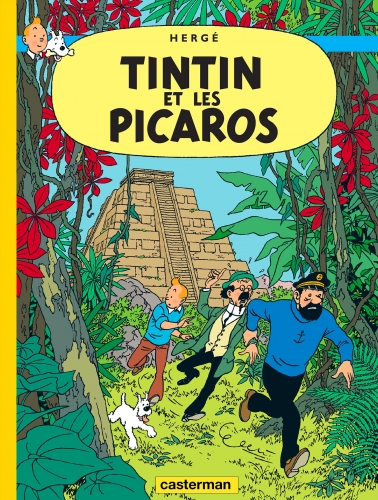
Les Picaros furent insultés ou incompris. C’était un album ingrat et exigeant, l’équivalent du cinéma d’auteur…
On voyait bien qu’Hergé avait renoncé à sa mythologie jugée réac par l’Ennemi ; comme si l’on pouvait encore pratiquer le voyage absolu dans les années 70 marquées par le tourisme de masse, les vols charter, les tropiques à l’encan et l’abominable Guide du routard. Le vacancier occidental, bien reproduit depuis en Asie, fut le yéti, l’abominable homme des plages. Revoyez-les, ces Bronzés, ce qu’ils ont fait à l’Afrique et à la montagne. En revoyant l’Eternel retour avec Madeleine Sologne et Jean Marais, je la trouve sublime, cette montagne enneigée : elle ne l’est plus. Elle a été déniaisée et, comme dit Pagnol, l’honneur ça ne sert qu’une fois. Stations de ski… Et vous avez vu dans Rt.com à quoi ressemble l’Everest ? A un WC géant.

C’est qu’avec la société de consommation (la mort, en vieux latin) la télé était passée par là avec le couillon tout-terrain Séraphin Lampion : bagnole, télé, Pastis, rigolade. Sans oublier la profanation du voyage que l’on nomme tourisme. 1.5 milliard de touristes maintenant… Pauvre Tintin, pauvre voyage initiatique. On pense à Céline (toujours) :
« Je voudrais voir un peu Louis XIV face à un "assuré social"... Il verrait si l'Etat c'est lui ! »
Le touriste a remplacé Ulysse comme l’assuré social vacciné son Roi-Soleil. C’est la vie.

Tintin et les picaros fonctionne comme une fiction aventurière à rebours. On voyage, mais c’est pour se faire enfermer (cf. la cabine spatiale...), se faire observer par un tyran et ses caméras. Tintin prend le relais de Patrick McGoohan dans Le Prisonnier. Il est dans une luxueuse villa où plus rien ne se passe, puisqu’il faut s’y terrer. On est dans la société de surveillance, de Foucault (bof…) ou autre. On est devant des miroirs (coucou la Bête…) puis on seconde un général pataud humilié par sa « grosse américaine » ; car courageusement Hergé a assumé sa misogynie jusqu’au bout, et il aura eu raison de le faire : voyez Ursula, Hillary, voyez Sandrine ou la folle écologiste teutonne. La guerre est femme. Relire Molière...
Pour ce qui est de la surveillance, Hergé nous avait prévenus dans On a marché sur la lune et la cauchemardesque Affaire Tournesol. La belle aventure sous les Tropiques ou dans les déserts était terminée, on allait vers un Grand Enfermement, car on est devenus du « coke en stock ». Tout cela au cours des années soixante, quand Debord écrit sa Société du Spectacle. Ce même Debord (cité par mon ami Bourseiller) écrit alors qu’on assiste « à un processus de formation d’une société totalitaire cybernétisée à l’échelle planétaire ».
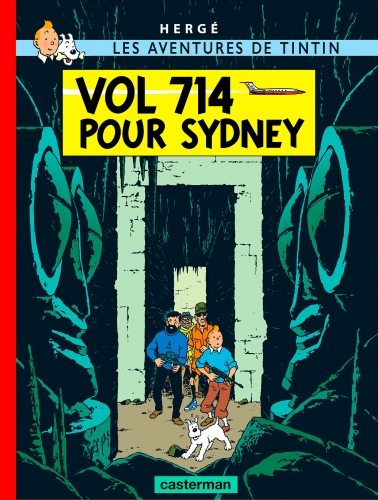
Quand on y pense bien c’est aussi le sujet de Vol 714 pour Sydney qui sonne même le glas d’une humanité hypnotisée et téléguidée par des extraterrestres. L’aventure tropicale mène à une caverne d’épouvante. La même entropie claustrophobe est à l’œuvre dans les Bijoux de la Castafiore (chaste fleur ou casse ta fiole ?) : Haddock est coincé, handicapé, blessé, paralysé, engueulé et sevré. La Castafiore qui le castre matin midi et soir en fait une « âme de grand enfant un peu naïf » victime de paparazzi et de l’air du temps. Il ne leur manque plus que les pédopsychiatres à nos deux héros qui ont défié le Tibet, les déserts et les glaces. Mais déjà Saint-Exupéry nous mettait en garde :
« Ces voyages, le plus souvent, étaient sans histoire. Nous descendions en paix, comme des plongeurs de métier, dans les profondeurs de notre domaine. Il est aujourd’hui bien exploré. Le pilote, le mécanicien et le radio ne tentent plus une aventure, mais s’enferment dans un laboratoire. Ils obéissent à des jeux d’aiguilles, et non plus au déroulement de paysages. Au-dehors, les montagnes sont immergées dans les ténèbres, mais ce ne sont plus des montagnes. Ce sont d’invisibles puissances dont il faut calculer l’approche. Le radio, sagement, sous la lampe, note des chiffres, le mécanicien pointe la carte, et le pilote corrige sa route si les montagnes ont dérivé, si les sommets qu’il désirait doubler à gauche se sont déployés en face de lui dans le silence et le secret de préparatifs militaires. »
C’est dans Terre des hommes. On relira avec profit ici cette lettre à un général. C’est vrai que Tintin c’est un petit prince qui aurait grandi – mais pas trop. Un ado héroïque, jeune héros d’une Europe encore éprise de sport et d’aventures, de voyages et d’initiation. Après la guerre, Hergé, qui a été arrêté, insulté et persécuté (mais pas fusillé !) comprend quel camp (celui de Bohlwinkel, vous vous souvenez…) a gagné, et vers quoi on se dirige. Alors on s’adapte, comme dit Céline. La grande épopée arthurienne et hyperboréenne de l’Etoile mystérieuse, récit qui balaie les trouilles apocalyptiques venues de cette Bible-blob (excellent petit film avec Steve McQueen) qui n’en finit pas de nous aliéner, sont laissées derrière et les savants partent vers le Grand Nord à la découvertes des îles fortunées des mythologies grecques et celtes. Quel enchantement ces BD tout de même. Elles furent mon dernier trampoline.
 Revenons-en à Tintin et à nos picaros puisque c’est le dernier.
Revenons-en à Tintin et à nos picaros puisque c’est le dernier.
Quand notre héros sans progéniture (prolétaire au sens strict il n’a jamais rien possédé) passe dans la jungle, la même impression d’irréalité le poursuit. Le général Alcazar bouffonne au milieu d’ivrognes, il est soumis à son ogresse américaine qui prend le relais de la Castafiore, et il rêve de cruauté dont il serait cette fois l’auteur et non plus la victime. La même banalité des changements dictatoriaux reproduit celle des élections démocratiques, lesquelles laissent le consommateur électeur éternellement insatisfait (voir Obama, Sarkozy, Blair, Berlusconi et le reste). Debord toujours :
« Ainsi se recompose l’interminable série des affrontements dérisoires mobilisant un intérêt sous-ludique, du sport de compétition aux élections. »
La dernière bulle de l’album montre d’ailleurs que l’éternel pays du tiers-monde restera misérable avec le changement de pouvoir. Hergé ne se fait pas d’illusions sur nos sociétés, et il le donne à lire. Voilà pourquoi aussi Tintin ne joue plus au matamore : il joue soft, comme on dit, prend un tour politiquement correct, non-violent, et il prépare sa révolution…orange.
Car le grand intérêt pour moi de l’album réside dans l’apparition du commando de touristes. Tintin au pays des touristes? Mais oui, et cela montre l’entropie accélérée des décennies de la société de consommation, qui ont davantage changé la planète que des milliers d’années d’histoire, et qui ont définitivement altéré l’humanité et son rapport au réel. Tintin, l’homme de l’Amazonie et de l’Himalaya, de l’Hyperborée et des tombeaux égyptiens, se retrouve dépassé, rattrapé, humilié par un quarteron de salariés en retraite venus faire la fête sous les tropiques, avec un masque de carnaval. John Huston a très bien tapé aussi sur les touristes dans la Nuit de l’iguane, film flamboyant avec un Richard Burton tordant comme jamais.
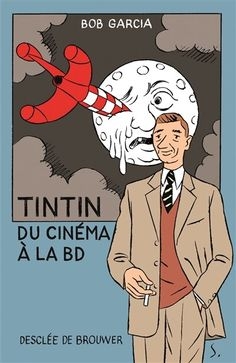 Et il va les utiliser, ses figurants, en faire des acteurs malgré eux de son jeu politique dérisoire (changer de président). Tintin crée, dis-je, une révolution orange, de celles qu’on avait vues dans les pays de l’ex-bloc soviétique, quand la CIA lançait des manifestations contre un pouvoir ilote et pas très roublard qui devait aussitôt se démettre sous les applaudissements de la presse et des médias de l’ouest. De ce point de vue, et encore génialement, Hergé se fait le prophète du monde sans Histoire où nous vivons ; et qui est fondamentalement un monde de jouisseurs lassés qui ne veut plus d’histoires – il ne veut même plus qu’on lui en raconte. C’est pourquoi il utilise son nouveau héros, depuis plusieurs épisodes, depuis L’affaire Tournesol ou depuis Coke en stock, qui inaugure la série des albums crépusculaires du grand maître, et qui est là pour se moquer de ses personnages, j’ai nommé Séraphin Lampion, qui exerce l’honorable profession d’assureur. C’est d’ailleurs quand elle lui claque la porte au nez que la Castafiore se fait dérober son émeraude par la pie voleuse. Revoyez aussi cet épisode où la télé du décidément nuisible Tournesol-Folamour rend ivres et tremblotants ces spectateurs...
Et il va les utiliser, ses figurants, en faire des acteurs malgré eux de son jeu politique dérisoire (changer de président). Tintin crée, dis-je, une révolution orange, de celles qu’on avait vues dans les pays de l’ex-bloc soviétique, quand la CIA lançait des manifestations contre un pouvoir ilote et pas très roublard qui devait aussitôt se démettre sous les applaudissements de la presse et des médias de l’ouest. De ce point de vue, et encore génialement, Hergé se fait le prophète du monde sans Histoire où nous vivons ; et qui est fondamentalement un monde de jouisseurs lassés qui ne veut plus d’histoires – il ne veut même plus qu’on lui en raconte. C’est pourquoi il utilise son nouveau héros, depuis plusieurs épisodes, depuis L’affaire Tournesol ou depuis Coke en stock, qui inaugure la série des albums crépusculaires du grand maître, et qui est là pour se moquer de ses personnages, j’ai nommé Séraphin Lampion, qui exerce l’honorable profession d’assureur. C’est d’ailleurs quand elle lui claque la porte au nez que la Castafiore se fait dérober son émeraude par la pie voleuse. Revoyez aussi cet épisode où la télé du décidément nuisible Tournesol-Folamour rend ivres et tremblotants ces spectateurs...
Les Picaros liquident donc l’univers de Tintin. En Amérique du sud, le mot picaro désigne aussi l’escroc, l’agioteur, maître des sociétés modernes, c’est-à-dire baroques. La crise immobilière, le boom touristique, « les détritus urbains qui recouvrent tout (Lewis Mumford, plus grand esprit américain du dernier des siècles) », c’est la faute au picaro. Il n’y a plus d’histoire, il n’y a plus non plus de géographie, la technologie l’a décimée. Il n’y a plus d’exotisme, les carnavals, les festivals et les voyages en groupe l’ont décimé, ainsi que la culture. Il n’y a plus de spiritualité non plus, au sens de Malraux, non plus, ce qui signifie que ce siècle lamentable NE SERA PAS AU FINAL.

On comprend que l’album ait déchaîné l’ire de certains aficionados, notamment de droite (ils veulent toujours du rab, du grain à moudre ceux-là), pour reprendre un terme latino. Ici Hergé a repris une vieille ficelle du métier, comme lorsque Conan Doyle avait voulu mettre fin aux aventures de Sherlock Holmes, fatigué qu’il était d’être dépendant ad vitam de sa création. Mais il l’a fait en gardant son personnage en vie, en le normalisant, en le glissant dans un monde d’ombres médiocres. C’est plus dur à supporter, quand on s’est voulu l’héritier d’Homère ou de Virgile, de Rabelais (quart et cinquième livre) ou de Jules Verne. On découvrira notre texte sur le cosmonaute comme machine à conditionner (fr.sputniknews.africa).
On peut remercier Hergé d’avoir décrit l’enfer américano-tiers-mondiste où nous survivons patibulaires. Il était moins fatigué qu’il en avait l’air. Avant de mourir, alors que nous évoquions les dernières élections présidentielles, Jean Parvulesco (qui était un acteur né et figura dans A bout de souffle) me disait : « la race humaine est fatiguée ».
Il nous reste les bêtes et certains paysages.
Sources :
https://www.dedefensa.org/article/lettre-de-saint-ex-pour...
https://www.dedefensa.org/article/saint-exupery-contre-la...
https://fr.sputniknews.africa/20170317/nasa-farce-vraie-m...
samedi, 15 juin 2024 | Lien permanent
Bernanos et la ”masse disponible” des temps totalitaires

Bernanos et la "masse disponible" des temps totalitaires
Nicolas Bonnal
« Leur soumission au progrès n'a d'égale que leur soumission à l’Etat… »
Bernanos avait rêvé au début, juste après la Libération, et ça donne la France contre les robots, livre qui doit être oublié – même par les ignares et les distraits - car il est dépassé un an ou deux après. Le grand esprit déchante vite (« votre place est parmi nous ! » lui chantait de Gaulle qui part vite aussi) et cela donne ensuite les prodigieuses conférences de « La Liberté, pour quoi faire ? », où le grand esprit pragmatique et non visionnaire remet tout le monde à sa place : la démocratie vaut les dictatures et le christianisme est crevé, surtout celui qui veut se moderniser. On relira mon texte fondamental (je pèse mes mots, car on est en enfer, on y est vraiment) sur Bruckberger qui va plus loin que Bernanos quand il découvre que l’Inquisition est la source et le prototype des méthodes totalitaires modernes.

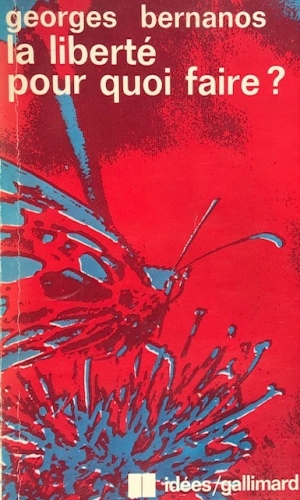
Robert Steuckers m’a appris que j’étais publiquement insulté par certains pour citer Bernanos. C’est un immense plaisir et un intense hommage. Je vais citer au maximum sans commenter, en remerciant encore ma Tetyana qui m’a tout scanné ; on commence par « cette masse affreusement disponible » qui vote pour l’Europe, pour Macron-antifasciste-républicain-humaniste, pour la guerre, pour le vaccin, pour l’Europe, pour l’Otan, pour le mondialisme, pour le Grand Reset, pour le totalitarisme informatique, pour tout.
Or cette masse bascule de Pétain à de Gaulle comme cela, par mouvement mécanique, par mouvement de balancier :
« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ont pas attendu notre permission pour soupçonner que la France de 1940- formée d'une majorité de gaullistes et d'une poignée de pétainistes - ne forme réellement qu'UNE SEULE MASSE AFFREUSEMENT DISPONIBLE, dont l'événement de Munich avait déjà permis de mesurer le volume et le poids, qui s'est retrouvée presque tout entière à l'Armistice pour rouler dans le pétainisme par le seul effet de la pesanteur, jusqu'à ce que l'invasion de l'Afrique du Nord, rompant l'équilibre, l'ait fait choir sur l’autre pente… La masse française, cette masse électorale suicidaire, cherche aujourd'hui à tâtons un autre fait irréparable… Au terme de notre évolution, il ne subsistera de l’Etat qu’une police, une police pour le contrôle, la surveillance, l’exploitation et l’extermination du citoyen (la liberté pour quoi faire ?). »


Et d’ajouter :
« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ignorent plus que la Résistance ayant été l’œuvre d'une poignée de citoyens résolus, qui électoralement ne pouvaient pas compter pour grand-chose, il était fatal que la réorganisation de la Démocratie parlementaire réduisît la Résistance à rien. »

On connait mon admiration pour Stefan Zweig, citoyen du monde et apatride comme moi (les patries ayant toutes été exterminées par l’américanisme il ne reste qu’à se trouver un hôtel – et un bon), qui écrit sur cette masse affreusement disponible dans son inoubliable Monde d’hier : « la masse roule toujours immédiatement du côté où se trouve le centre de gravité de la puissance du moment ». Monde d’hier, Livre de Poche, p. 469 pour les curieux. On ajoute pour les gourmets : « Ceux qui criaient aujourd’hui « Heil Schuschnigg ! » hurleraient demain « Heil Hitler ! ». C’est la page suivante…
Heil Biden ! Heil Davos ! Heil Ursula ! Heil climat !...
On connaît le nombre exorbitant (mais toujours insuffisant) d’homosexuels dans nos élites françaises, européennes et mondialistes. Zweig ajoute cette note page 365 :
« Déjà les sociétés secrètes fort mêlées d’homosexuels étaient plus puissantes que ne le soupçonnaient les chefs de la république… ».
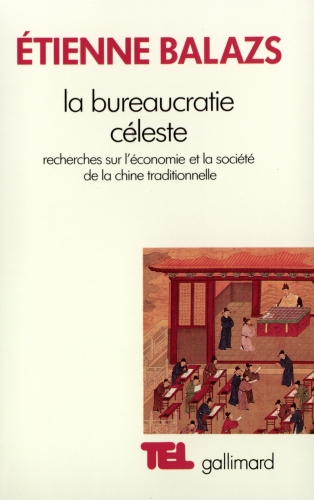
On relira mes textes sur Zweig et sur les eunuques de Balasz qui dans la Chine ancienne drivaient déjà une économie et une société totalitaires (on ne pouvait ni marcher ni se vêtir comme on voulait, comme au temps du Covid et du changement climatique…). Voir La bureaucratie céleste, Tel, Gallimard, pp. 36-37, 73-75., où Balasz décrit des guerres d’extermination eunuques de proportions… bibliques. La brave Chine des Brics est le modèle de Fink et de Davos.
Bernanos n’aime pas qu’on le dise pessimiste (le terme est insultant, c’est vrai) ; mais voici ce qu’il écrit sur l’optimiste :
« L'optimisme est un ersatz de l'espérance, dont la propagande officielle se réserve le monopole. Il approuve tout, il subit tout, il croit tout, c'est par excellence la vertu du contribuable. Lorsque le fisc l’a dépouillé même de sa chemise, le contribuable optimiste s'abonne à une revue nudiste et déclare qu’il se promène ainsi par hygiène, qu'il ne s'est jamais mieux porté. »
Sur le pessimisme :
« Le mot de pessimisme n'a pas plus de sens à mes yeux que le mot d'optimisme, qu'on lui oppose généralement. »
Le problème, le vrai problème c’est la dévaluation du matériel humain ; et là Bernanos surprend avec des arguments… en or massif (Zweig en parle aussi au début de ses mémoires) :
« Les événements n'ont pas plus de volume qu'avant, ce sont les hommes qui sont dévalués. La dévaluation de l’homme est un phénomène comparable à celui de la monnaie. N'attendez pourtant pas que les dévalués conviennent de leur dévaluation! Si le billet de mille francs pouvait parler, il dirait que le bifteck est devenu aussi précieux que l'or, il n'oserait jamais avouer que c'est lui qui ne vaut plus que cent sous. Ainsi les hommes dévalués préfèrent se venger sur l'histoire de leur dévaluation. Ils sont de plus en plus enclins à nier l’histoire, à ne voir en elle que l'ensemble des fatalités historiques... »

La fin de l’étalon-or a signifié pendant la guerre la tuerie interminable : le citoyen ne valait plus rien et l’Etat pouvait imprimer et exterminer tout ce qu’il voulait.
La fin des hommes c’est la Révolution Française, et la conscription par la Convention :
« En décrétant la conscription obligatoire, la Convention nationale a trahi la civilisation et fondé le monde totalitaire. Dès qu'il suffit d'un décret pour que tous les citoyens appartiennent à l'Etat, pourquoi ne lui appartiendraient-ils pas toujours, de la naissance à la mort ? ».

Le problème c’est qu’il en est tout content le citoyen : comme dit Tocqueville : il faut enlever et la peine de vivre et le trouble de penser ! C’était déjà fait longtemps avant la télé, notez. L’imprimerie, toujours…
Le combat contre l’homme et la liberté est le même partout, derrière les slogans (« tu es à la solde de Wall Street et du mikado ! ») :
« Tout homme qui pense a compris que l’Amérique et la Russie s'opposent plus économiquement qu'idéologiquement, une nation de trusts est toujours menacée de devenir brusquement totalitaire. La Russie s’emploie de plus en plus à créer un type d'ouvrier à grand rendement aussi semblable que possible à l'ouvrier… »
Les extrêmes (d’ailleurs jamais si éloignés que cela, on l’a vu au moment de notre « pandémie ») ont vite fait de se rejoindre :
« Car ce monde n'est pas nouveau. Capitaliste ou marxiste, libéral ou totalitaire, il n'a cessé d'évoluer vers la centralisation et la dictature. Le régime des trusts ne saurait nullement s'opposer au collectivisme d'Etat, puisqu'il n'est qu'une phase de l'évolution que je dénonce. »
On se demande si Bernanos aurait fini libertarien (Chesterton était considéré comme un chrétien-libertarien, mais vous imaginez un parti ?) : no state, no war, no taxes, comme disent nos amis de lewrockwell.com. Trop simple ou trop évident ?
La course au gigantisme :
« Les trusts ont concentré peu à peu la richesse et la puissance autrefois réparties entre un très grand nombre d'entreprises, pour que l'Etat moderne, le moment venu, distendant sa gueule énorme, puisse tout engloutir d'un seul coup, devenant ainsi le Trust des Trusts, le Trust-Roi, le Trust-Dieu... Non, ce monde n'est pas nouveau. »
Répétons qu’on est en enfer :
« Qui peut croire ce monde digne d'amour? A quoi bon aimer ce qui s'est voué soi-même à la haine ? Dieu n'y réussit même pas, il se résigne à laisser subsister l'enfer. Le Fils de Dieu est mort et on pourrait dire que l'enfer survit au Fils de Dieu. Oh! vous pouvez parfaite trouver scandaleux de m'entendre comparer le monde moderne à l'enfer. Mais c'est là une impression que n'ont pu manquer d'avoir les habitants de Nagasaki, à moins que le temps hélas ! ne leur ait fait défaut pour cela. »

Car le lendemain de la guerre, rebelote avec déjà le plan Monnet :
« La France a des raisons de ne pas s'enthousiasmer pour le plan Monnet! On lui demande de construire des machines, encore plus de machines, de se sauver par la machinerie. Elle ne croit plus à la multiplication indéfinie des machines… »
Pierre Gille (d’ailleurs écarté depuis) remarque dans son excellente préface :
« Bernanos attendait de la Libération de la France une insurrection des forces de l’esprit… Et que voit-il, ce même monde recommencé comme si rien ne s’était passé… ».
C’est qu’il a ses adeptes ce monde religieusement adoré de l’américanisme. Céline parle dans des pages immortelles des Français parfaitement enthousiastes, Bernanos des amateurs de radiations (elles les rendent radieux !) :
« Supposez que demain - puisque nous sommes dans les suppositions, restons-y - les radiations émises sur tous les points du globe par les usines de désintégration modifient assez profondément leur équilibre vital et les sécrétions de leurs glandes pour en faire des monstres, ils s'arrangeront très bien de leur condition de monstres, ils se résigneront à naître bossus, tordus, ou couverts d'un poil épais comme les cochons de Bikini, en se disant une fois de plus qu'on ne s'oppose pas au progrès. Le mot de progrès sera le dernier qui s'échappera de leurs lèvres à la minute où la planète volera en éclats dans l'espace. »
Et dans ce monde, comme au moment du refus du vaccin nocif et inutile l’homme libre sera le monstre à abattre:
« La menace qui pèse sur le monde est celle d'une organisation totalitaire et concentrationnaire universelle qui ferait, tôt ou tard, sous un nom ou sous un autre, qu'importe ! de l'homme libre une espèce de monstre réputé dangereux pour la collectivité tout entière, et dont l’existence dans la société future serait aussi insolite que la présence actuelle d'un mammouth sur les bords du lac Léman. Ne croyez pas qu'en parlant ainsi je fasse seulement allusion au communisme. Le communisme disparaîtrait demain, comme a disparu l'hitlérisme, que le monde moderne n'en poursuivrait pas moins son évolution vers ce régime de dirigisme universel auquel semblent aspirer les démocraties elles-mêmes. »
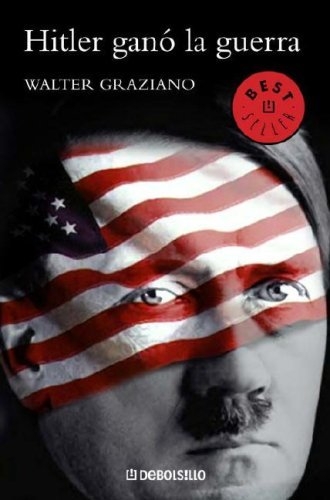
En 45, Hitler a gagné la guerre (voyez l’amusant livre homonyme de Graziano). Schwab et Ursula y mettront bon ordre :
« Il est clair qu'il reste partout des foyers d'infection totalitaire dans le monde. Le totalitarisme a été battu grâce à ses propres méthodes, par des méthodes totalitaires… Les dictatures ont été les symptômes d'un mal universel, dont souffre toute l'humanité. La civilisation des machines a considérablement amoindri dans l’homme le sens de la liberté. Les disciplines imposées par la technique ont peu à peu sinon ruiné, du moins considérablement affaibli les réflexes de défense de l’individu contre la collectivité. »
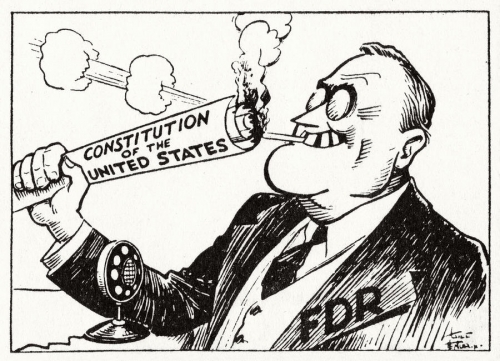
On sait que tout passe par le contrôle de l’Etat, surtout aux USA, pays du
vendredi, 19 juillet 2024 | Lien permanent
Weimar 1941-1942: la Société Européenne des Ecrivains

Weimar 1941-1942: la Société Européenne des Ecrivains
par Christophe Dolbeau
Au soir du 4 octobre 1941, trois écrivains français, Jacques Chardonne, Marcel Jouhandeau et Ramon Fernandez, embarquent dans un train de nuit qui va les conduire en Allemagne où les autorités les invitent à participer à un congrès littéraire. Ils seront rejoints ultérieurement par quatre de leurs confrères, Abel Bonnard, Pierre Drieu la Rochelle, Robert Brasillach et André Fraigneau. Favorables au nazisme, pragmatiques, opportunistes ou simplement séduits par le discours européen de leurs interlocuteurs allemands, ces sept hommes apportent ainsi leur caution à une ambitieuse entreprise du Dr Gœbbels : mobiliser les écrivains derrière la bannière du Reich pour construire une Europe nouvelle.
À la découverte du Reich
À un peu plus d’un an de l’armistice franco-allemand et tandis qu’une bonne moitié de la France est occupée, ce voyage est tout sauf anodin. Il démontre qu’une page est en train de se tourner et que certains intellectuels sont prêts à jouer la carte allemande. Ce phénomène n’est pas circonscrit à la France et dès l’escale de Cologne, nos voyageurs retrouvent un petit groupe de collègues arrivés des quatre coins du continent. Il y là une romancière bulgare, Fani Popowa-Mutafowa (1), membre du mouvement fascisant des « Ratniks » (Combattants), un essayiste et poète croate, Antun Bonifačić (2), proche du gouvernement oustachi, le jeune poète et dramaturge finnois Arvi Kivimaa (3), le Danois Svend Fleuron (4), auteur d’ouvrages sur la nature et les animaux sauvages, et son compatriote Ejnar Howalt (5), dramaturge et militant du parti national-socialiste danois, le philosophe fasciste italien Alfredo Acito, les phalangistes espagnols Ernesto Giménez Caballero (6) et Luis Felipe Vivanco (7), le Norvégien Kåre Bjørgen (8), disciple de Quisling, le Suédois Einar Malm (9), le poète frison Rintsje Piter Sybesma (10) et les Flamands Ferdinand Vercnocke (11) et Filip de Pillecijn (12). Pour accueillir et guider cette quinzaine d’invités, les organisateurs de la tournée ont mobilisé toute une escouade de jeunes talents au premier rang desquels se détachent l’historien Karl-Heinz Bremer (13) et le lieutenant Gerhard Heller (14), deux hommes qui jouent à Paris un rôle capital. Autour d’eux sont également du voyage les poètes Moritz Jahn (15), Karl-Heinz Bischoff (16), Friedrich Schnack (17) et Hans Baumann (18), ainsi que le dramaturge August Hinrichs (19) et le romancier et traducteur Carl Rothe (20). Les autorités ne lésinent pas : les visiteurs sont traités de façon royale et entre deux pèlerinages culturels, ils ont droit à toutes sortes d’attentions. On les emmène voir la maison de Stefan George, à Bingen, puis le foyer natal de Gœthe, à Mayence, avant de leur faire déguster quelques bons crus rhénans et de les recevoir en grandes pompes à Heidelberg. À Munich, le groupe est hébergé au Bayerischer Hof, l’un des plus beaux hôtels de la ville, où il rencontre Hanns Johst (21), le tout puissant président de la Chambre des Écrivains du Reich. À Salzbourg, les voyageurs assistent à une représentation des Noces de Figaro et le lendemain, ils sont à Vienne où le bourgmestre leur offre le souper. Ils visitent ensuite Baden, la station thermale qu’affectionnait Beethoven, et font le tour de la demeure de Schubert, avant de prendre part, à la Hofburg, au grand dîner d’apparat qu’offre en leur honneur le coruscant Reichsstatthalter de l’Ostmark, Baldur von Schirach. Le 21 octobre, une dernière étape conduit enfin les visiteurs à Berlin où ils rencontrent Carl Schmitt et visitent Babelsberg, la nouvelle chancellerie et le ministère de la propagande où le Dr Gœbbels leur adresse quelques mots de bienvenue. Leur périple touristique s’achève là car le 23 octobre, ils sont attendus à Weimar où vont débuter les rencontres poétiques (Dichtertreffen) dont ils sont les hôtes d’honneur.
Littérature et Ordre Nouveau
Le 24 octobre 1941, c’est donc dans la grande Weimarhalle et sous un oriflamme frappé d’une Croix de fer, d’un livre et d’un glaive que s’ouvre le congrès qui a pour thème « la littérature dans l’Europe de demain ». Le groupe des invités étrangers s’est étoffé de quelques personnalités et il compte désormais une bonne trentaine de membres. Au nombre des gens qui sont venus directement figurent les Français Abel Bonnard, Pierre Drieu la Rochelle, Robert Brasillach et André Fraigneau que nous avons cités plus haut, les Flamands Felix Timmermans (22) et Ernest Claes (23), les Néerlandais Jan de Vries (24) et Jan Eekhout (25), le Finlandais Veikko Antero Koskenniemi (26), le Suisse John Knittel (27), le Norvégien Lars Hansen (28), l’Italien Arturo Farinelli (29), les Roumains Niculae I. Herescu (30) et Ion Sân-Giorgiu (31) et les Hongrois József Nyirö (32) et Lörinc Szabó (33). Après le discours d’inauguration que prononce Wilhelm Hægert, chef de la section « littérature » au ministère de la Propagande et vice-président de la Chambre des Écrivains, plusieurs orateurs allemands, dont Hanns Johst, Hans Baumann, Bruno Brehm (34) et Mauritz Jahn, se succèdent à la tribune pour évoquer qui le rôle phare de la race germanique dans l’essor et la défense de la culture européenne, qui la croisade contre le communisme ou qui encore la place du poète en temps de guerre et la nécessité de célébrer l’héroïsme sous toutes ses formes.. Au-delà de ces allocutions plus ou moins inspirées, l’événement majeur de ces journées reste toutefois la décision que prennent les participants de pérenniser le climat amical du congrès et de formaliser leur coopération en se regroupant de façon permanente au sein d’une nouvelle association, la Société Européenne des Écrivains (Europäische Schriftsteller-Vereinigung ou ESV). Cette initiative a, semble-t-il, pour origine une suggestion conjointe du Prix nobel norvégien Knut Hamsun, du Flamand Stijn Streuvels (35) et de la romancière finnoise Maila Talvio (36), et le Dr Gœbbels en a, bien sûr, aussitôt saisi tout l’intérêt : placée sous le haut patronage de son ministère, la nouvelle association ne pourra que contribuer au rayonnement culturel du Reich et favoriser la collaboration en Europe. À titre personnel, le ministre y voit aussi une belle revanche sur le PEN club international qui a exclu son pays en 1934, et plus précisément sur son président d’alors, H. G. Wells, un individu qui prétend n’avoir « jamais rencontré un homme plus juste, plus candide et plus honnête » que Joseph Staline…
La Société Européenne des Écrivains (ESV) se choisit un président en la personne du romancier italo-bavarois Hans Carossa (37), deux vice-présidents, M.M. Koskenniemi et Giovanni Papini (38), et un secrétaire général qui sera Carl Rothe. Les statuts de l’association ne seront signés que le 27 mars 1942 (39), au terme du premier exercice. Ils sont assez souples et dénués de connotation politique. L’article deux précise que le but de la société est « l’encouragement des contacts personnels et des rencontres entre écrivains des nations européennes, la discussion et la solution de tâches et de désirs communs dans toutes les branches de la littérature ; la consultation compétente en matière juridique et économique » (40) ; l’article cinq indique que l’association « se divise en groupes nationaux qui sont représentés par leurs porte-parole » ; l’article sept stipule que « l’on n’est membre qu’à titre purement personnel » et que « l’on n’acquiert pas la qualité de membre par une adhésion volontaire mais uniquement par une nomination », cette dernière étant faite par le président de la société, sur proposition du porte-parole du groupement national (article 8). Le siège social est établi à Weimar (article 3) et la cotisation fixée à dix Reichsmarks (article 12). Entre deux flâneries dans Weimar, une visite de la maison de Gœthe et un dîner au château de Tiefurt, les congressistes participent à différents ateliers. Parmi divers projets, ils envisagent de créer une grande bibliothèque ouverte aux membres de la société et se promettent d’encourager activement la diffusion dans toute l’Europe des meilleures œuvres des auteurs contemporains. Dans l’immédiat, ils se fixent néanmoins pour premier objectif de lancer une publication de prestige qui servira de vitrine à l’association. Les protecteurs allemands de l’ESV ayant donné leur accord et promis quelques crédits, le premier numéro du mensuel Europäische Literatur verra le jour en mai 1942. Dirigé par Wilhelm Ruoff, il s’agit d’un magazine très éclectique et non dépourvu d’attraits qui traite aussi bien de la poésie japonaise que de la littérature espagnole contemporaine, de la poésie lyrique croate ou du point de vue danois sur les lettres américaines, qui aborde de grands thèmes comme le Danube, le Rhin ou Dante en Allemagne, et consacre de nombreux reportages aux auteurs de l’ESV (41).
Les premières rencontres européennes s’achèvent le dimanche 26 octobre pour faire place à la Semaine du livre de guerre allemand qu’inaugure Joseph Gœbbels. Dans son allocution d’ouverture, le ministre ne manque pas de saluer les invités étrangers. Ceux-ci étaient présents, le matin même, lorsque le Reichsminister est allé fleurir les tombes jumelles de Gœthe et de Schiller, et dans la soirée, ils prennent part à un dîner d’adieu suivi d’une représentation de l’Iphigénie en Tauride de Gœthe. Le lendemain, les congressistes regagnent leurs pays respectifs, à l’exception de Bonnard, Drieu la Rochelle, Brasillach et Fraigneau qui font un crochet à Jäckelsbruch où Arno Breker les reçoit dans son atelier, puis à Berlin où ils s’entretiennent avec quelques travailleurs français. À leur retour, tous les invités de Weimar vanteront la parfaite courtoisie de leurs hôtes, l’organisation impeccable de leur séjour et l’ambiance particulièrement conviviale du congrès ; tous souligneront également les belles perspectives de réconciliation et de renaissance européenne qu’ouvrent de telles rencontres.
Un indéniable succès
Dès la fin de l’année 1941, la toute nouvelle Société Européenne des Écrivains commence à s’organiser et ses « groupes nationaux » à recruter. Un certain mystère demeure, aujourd’hui encore, sur la composition du groupe français dont on ne connaît avec certitude que ceux de ses membres qui se sont rendus à Weimar. On peut toutefois supputer que des gens comme Alphonse de Châteaubriant, Ernest Fornairon, Edouard Dujardin ou Camille Mauclair ont pu y appartenir mais ce ne sont que des suppositions. Apparaît aussi à Paris, en février 1943, un hebdomadaire baptisé Panorama dont les objectifs sont fort proches de ceux de Europäische Literatur (42) et dont les collaborateurs sont souvent les mêmes. Moins de cachotteries, en revanche, pour la Finlande où l’on sait précisément qu’une cinquantaine d’écrivains, dont Mika Waltari (43) et Viljo Kajava (44), figurent dans le groupe local de l’ESV. En Norvège, Knut Hamsun a rejoint l’association et en Suède, Sven Hedin (45) a fait de même. En Croatie et outre Antun Bonifačić que nous avons déjà mentionné, l’association compte 17 membres dont Mile Budak (46), Slavko Kolar (47), Mihovil Kombol (48), Milan Begović (49), Dobriša Cesarić (50), Zvonko Milković (51) et Ivan Goran Kovačić (52). En Espagne, où le recrutement de l’ESV n’est pas bien connu, il est probable que fassent partie de l’association quelques-uns des poètes (53) qui signent, en 1941, le recueil Poemas de la Alemania eterna, mais il s’agit là encore d’une hypothèse. La Belgique, de son côté, est un pays où l’ESV – qui dispose de deux groupes – rencontre un franc succès. Chez les Flamands, la plupart des auteurs nationalistes et « völkisch » – Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Filip de Pillecijn, Ferdinand Vercnocke, Emiel Buysse (54), Ernest Claes, Cyriel Verschaeve (55), Gerard Walschap (56), Wies Moens (57) et Antoon Thiry (58) – en font partie (59), et quant à la « section wallonne et belge de langue française », elle rassemble, entre autres, les romanciers prolétariens Pierre Hubermont (60) et Constant Malva (61) (photo ci-dessous), l’académicienne Marie Gevers (62), le journaliste Pierre Daye (63), le traducteur Guillaume Samsoen de Gérard (64), le régionaliste Joseph Mignolet (65), le rexiste Lucien Jablou (alias Franz Briel) et même le très curieux Sulev Jacques Kaja (66).

Conformément aux statuts de l’association comme aux vœux de ses membres, la Société Européenne des Écrivains se réunit une seconde fois à l’automne 1942, entre le 7 et le 11 octobre. Cette fois, il n’y a pas eu de balade touristique et les conditions de guerre se font sentir : l’hébergement est bien moins luxueux et les menus frugaux. Dans un rapport à son ministre de tutelle, l’un des participants italiens se plaindra notamment de l’omniprésence de la soupe de pommes de terre et de la margarine… Quoi qu’il en soit, de nombreux auteurs étrangers ont cependant fait le déplacement. La Finlandaise Maila Talvio est présente, tout comme ses compatriotes Veikko Antero Koskenniemi, Mika Waltari, Viljo Kajava, Örnulf Tigerstedt (67) et Tito Colliander (68). On dénombre également cinq Français, M. M. Jacques Chardonne, Pierre Drieu la Rochelle, André Fraigneau, André Thérive et Georges Blond (69), le Roumain Liviu Rebreanu (70), le poète hollandais Henri Bruning (71), le dramaturge danois Svend Borberg (72) et le romancier slovaque Jozef Cíger-Hronský (73). Contrairement au premier congrès, la délégation italienne est cette fois plutôt fournie avec les académiciens Arturo Farinelli, Antonio Baldini (74) et Emilio Cecchi (75), le philosophe et musicologue Giulio Cogni (76), les universitaires fascistes Mario Sertoli et Alfredo Acito, le critique Enrico Falqui (77) et les deux valeurs montantes que sont Elio Vittorini (78) et Giaime Pintor (79).
Ce second congrès a pour thème « le poète et le guerrier » et en l’absence de Hans Carossa comme de Papini, c’est le Finnois Koskenniemi qui préside. Comme l’année précédente, la plupart des orateurs sont des écrivains allemands – Edwin Erich Dwinger (80), Wilhelm Ehmer (81), Wilhelm Schäfer (82), Gerhard Schumann, Georg von der Vring (83) et Hermann Burte (84) – mais deux Italiens, Arturo Farinelli et Emilio Cecchi, sont également invités à s’adresser à l’assemblée. Si les communications et les débats restent très académiques, l’association prend toutefois, sur le plan pratique, une décision importante, celle d’attribuer, pour la première fois, une bourse d’encouragement à deux jeunes auteurs : la Finlandaise Irja Salla (85) et le Croate Dobriša Cesarić. La guerre et ses enjeux sont bien évidemment au cœur de toutes les conversations des congressistes auxquels Joseph Goebbels ne manque pas de rappeler, dans son discours de clôture, que le conflit en cours n’est pas seulement un combat entre des forces matérielles mais aussi un affrontement entre des forces spirituelles et que les écrivains n’ont d’autre choix que de s’engager. Le 11 octobre, les écrivains se séparent et pour la plupart, ils ne se reverront pas : du fait de la tournure négative du conflit et de l’intensification des bombardements aériens sur l’Allemagne, il n’y aura, en effet, pas d’autre réunion plénière de l’ESV jusqu’à la dissolution officielle de l’association, en 1948. En 1943, néanmoins, plusieurs membres de l’ESV – Robert Brasillach, Ernesto Giménez Caballero, Pierre Daye, Filip de Pillecijn, Ferdinand Vercnocke, Örnulf Tigerstedt – se rendront à Katyn pour témoigner de l’ampleur du massacre commis par les Soviétiques : ce sera sans doute la dernière manifestation officielle de l’association.
Une initiative novatrice
 À l’issue de cette brève évocation de la Société Européenne des Écrivains,
À l’issue de cette brève évocation de la Société Européenne des Écrivains,
mercredi, 27 novembre 2013 | Lien permanent
E. v. Salomon: Der tote Preusse

Der tote Preuße
Das verkörperte Abbild des 20. Jahrhunderts: Vor hundert
Jahren wurde der Schriftsteller Ernst von Salomon geboren
von Markus Klein - Fefunden auf: http://www.geocities.com/wbuecher/dertotepreusse.htm
Als "zu menschlich für Hitler" - so charakterisierte Carl Zuckmayer Ernst von Salomon in seinem Dossier über deutsche Künstler und Intellektuelle 1943/44 im Exil für den amerikanischen Geheimdienst. "Zu menschlich" ist sicher der falsche Begriff, aber wie anders hätte Zuckmayer den amerikanischen Universalisten Salomons Nominalismus verdeutlichen sollen?
Universalisten und Nominalisten sind nach Armin Mohlers Definition antagonistische Menschentypen. Der Universalist glaubt, daß der Wirklichkeit eine geistige Ordnung zugrunde liegt. Diese kann er nicht nur durchschauen, sondern auch definieren und formulieren. Er kann also auch seine Handlungen mit dieser universalen Ordnung in Übereinstimmung bringen, sie somit gar ordnungsphilosophisch und heilsgeschichtlich legitimieren. Der Nominalist hingegen zeichnet sich dadurch aus, daß für ihn die Allgemeinbegriffe dem Wirklichen durch den Menschen erst nachträglich verliehen worden sind. Hinzu kommt, daß er weder den Kampf als immer vermeidbar ansieht, noch ihn scheut, noch davor zurückschreckt, seinen Gegner - den er durchaus schätzen kann - im entscheidenden Falle zu vernichten. Keinesfalls jedoch (im Unterschied zum Universalisten) würde er einen Gegner nurdeswegen vernichten, weil dieser dem Glauben an eine andere geistige Ordnung anhängt.
Wie sehr die Amerikaner Universalisten sind, wird heute im Krieg gegen "das Böse" auf der Welt deutlicher denn je. Wer wollte, konnte es jedoch auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg erkennen. Ernst von Salomon war einer, der dies damals schon gesehen hat: "Ich schreibe jetzt, weil ich eine Zeit überbrücken will, bis wieder die Möglichkeit besteht, anständige Filme zu machen, und weil ich was gegen die Amerikaner habe, und das muß heraus, sonst platze ich."
Heimat bedeutete ihm nichts, Identität alles
Was dabei herauskam, war "Der Fragebogen" von 1951, und er war ein Fanal. Ernst von Salomon schrieb in ihm die Geschichte der ersten fünfzig Jahre des 20. Jahrhunderts, das "Wie-es-gewesen"-ist, einen - im Sinne Theodor Lessings - "Teppich, geknüpft aus Fäden aller Art". Mit bitterbösem Zynismus führte er durch seine Ausführlichkeit den Entnazifizierungsfragebogen der Amerikaner ad absurdum und setzte gleichzeitig zum Kampf um die Nation nach der zweiten deutschen Niederlage in jenem Jahrhundert an, den er schon nach der ersten so vehement begonnen hatte.
Damals schon hatte Ernst von Salomon auf sich aufmerksam gemacht, zunächst durch Taten in den Reihen der "Phantasten der Tat", wie sie Herbert Cysarz genannt hat, und seit 1930 durch eine Trilogie des deutschen Nachkrieges. Nichts anderes hatte ihn hier schon zur Niederschrift veranlaßt, als was ihn zum "Fragebogen" zwang: Die Suche nach der eigenen Identität und die der Deutschen, die sich nur durch die Erzählung finden lassen konnte - um sie hernach den universalistischen Ansprüchen der Siegermächte entgegenzusetzen.
Selbst wer zur Zeit des "Neuen Nationalismus" noch um seine literarisch verbrämten Paukenschläge herumgekommen war, den "Fragebogen" konnte keiner umgehen. Er stand als Monument souveränen deutschen Daseinsanspruches jeder ideologisch und geschichtsphilosophisch hergeleiteten Geschichtsschreibung entgegen. Er demaskierte die heilsgeschichtlich begründeten Legitimationen und die damit einhergehende und durch Begriffsumbesetzung funktionalisierte Pauschal- und Kausalgeschichtsschreibung. Ernst von Salomon reklamierte so erfolgreich bis zu seinem Lebensende für sich, "Den Deutschen" Stimme und damit Anspruch auf eigene Existenz zu verleihen: "Heute bin ich ein Vertreter der fünften Zone, der deutschen Zone, der Deutschen, die in der Zerstreuung leben wie die Juden. Wollen Sie etwas davon wissen? Der - täuschen wir uns nicht - weitaus größere Teil der Deutschen, der heute stumm ist, abwartend, mißtrauisch, angegriffen, ohne sich verteidigen zu können, wo er wirklich Verantwortung trug, kann nicht einfach als nichtexistent betrachtet werden. Ich habe das Glück, nicht zu diesen zu gehören, und von ihnen gehört zu werden."
Vor nunmehr einhundert Jahren wurde Ernst von Salomon am 25. September 1902 im damals preußischen Kiel geboren. Was ihn prägte, war die preußische Haltung, die Strenge gegen sich selbst, die preußischen Tugenden, und nicht zuletzt der "Preußische Sozialismus". Um diesen Staatsgeist Preußens drehte sich sein ganzes Leben; er war sein Ziehvater, sein Mythos, sein Ziel, und nicht zuletzt sein Surrogat für die zerstörte deutsche Identität. Heimat bedeutete ihm nichts, Identität alles. Dazu trug neben dem Elternhaus vor allem seine Erziehung im Königlich-Preußischen Kadetten-Vorkorps bei. Hier lernten die Kadetten staatliche Tugenden, bis sie durch Erlaß der alliierten Machthaber in Deutschland Ende 1918 in den tobenden Bürgerkrieg hineingeworfen wurden.
Auf Seiten der Sozialdemokraten in einem der von ihnen ins Leben gerufenen Freikorps glaubte er, unter deren Parole "Kampf dem Bolschewismus" den Staat zu schützen gegen internationalistische Bestrebungen. Die gleichfalls staatsauflösenden Tendenzen des liberalen Parteienstaates blieben den Freikorpskämpfern zunächst verborgen, und so ließen sie sich zum ersten Male in diesem Jahrhundert zu Zwecken mißbrauchen, die nicht die ihren waren, die ihrem Staatsdenken geradezu konträr waren. Sie schlugen im Auftrag der selbsternannten Regierung kommunistische Aufstände nieder, übten Polizeiaktionen aus und wurden unwissentlich zu Parteigängern einer ideologisch bestimmten Bürgerkriegspartei im Ringen um die Macht in Deutschland. In Weimar jedoch, eingesetzt zum Schutze der "Nationalversammlung", merkte von Salomon erstmals, daß er hier fehl am Platze war.
Er desertierte ins Baltikum, wo erstmals seit dem Kriege deutsche Truppen wieder auf dem Vormarsch waren. Er glaubte Deutschland an der Front zu finden, doch diese Front war keine deutsche: Die deutschen Truppen kämpften im Auftrag der Engländer gegen die Bolschewisten um die Sicherung des Nachkriegs-Status quo. Das begriffen sie indes erst, als die Engländer ihnen ob ihrer Erfolge in den Arm fielen und die deutsche Regierung sie fallen ließ und ächtete. Da eskalierte ihr Idealismus und wurde zum Exzeß. Die Anerkennung des Versailler Diktatfriedens machte sie innerlich frei. Sie glaubten sich als die letzten Deutschen überhaupt, wurden irregulär, kämpften und mordeten ohne Idee und ohne Ziel, bis sie sich geschlagen und verbittert um die Jahreswende 1919/20 ins Reich zurückziehen mußten. Hier aber erwartete sie Undank, Mißtrauen, ideologischer Haß und die Auflösung. So kam es, daß sie sich Kapp zur Verfügung stellten, der ohne Vorbereitung und völlig unzulänglich zu putschen versuchte. Als in der Folge des zwangsläufigen Scheiterns dieses Putsches die Gewerkschaften unter kommunistischer und internationalistischer Parole erneut die Macht in Deutschland zu übernehmen versuchten, ließ sich der Leutnant von Salomon als Zeitfreiwilliger in den Reihen der Wehrmacht, die das Ruhrgebiet "säuberte", erneut mißbrauchen.
Er glaubte, Deutschland an der Front zu finden
Anschließend trieb es ihn in die in dem ihr zugedichteten Rahmen nie existente "Organisation Consul" in dem Irrglauben, in dieser geheimen Widerstands- und Terrororganisation gegen die französischen Besatzer und gegen deutsche Kollaborateure die Republik zu untergraben. Unterbrochen nur durch die Kämpfe um Oberschlesien im Sommer 1921, wo die Franzosen durch die Unterstützung Kongreßpolens versuchten, Deutschland auch vom Osten her zu schwächen, verselbständigten sich diese Widerstandskämpfer immer mehr und entglitten der Reichswehr. Enttäuscht und desillusioniert über die Unzulänglichkeit des liberalen Staates verrannten sie sich in die Idee, durch politische Morde zugleich die Republik zu destabilisieren und die Grundlagen für eine "nationale Revolution" zu legen.
Ihre Aktionen gipfelten am 24. Juni 1922 im Mord an Walther Rathenau. In dem Juden Rathenau, der doch eigentlich "von vornherein auf der Seite seiner Gegner" stand (Harry Graf Kessler), hatten sie geglaubt - und wurden darin unterstützt von skrupellosen und zumeist deutsch-völkischen Parteipolitikern -, den einzig begnadeten Vertreter des Liberalismus zu erkennen, der der Republik Stabilität verleihen könnte und dies zum Schaden der Deutschen und zum Nutzen des internationalen Wirtschaftsimperialismus mißbrauchen würde. Aber eigentlich redeten sie sich nur etwas ein: "Es war die Demokratie, es war die politische Begründung, die wir suchten. Wir suchten welche - da war es, zum Beispiel - Erfüllungspolitik. Für uns war der Krieg nicht aus, für uns war die Revolution nicht beendet."
Zu der Zeit, als Ernst von Salomon erkannt hatte, daß dies nicht nur ein fataler und sträflicher Irrtum gewesen war, sondern daß er mit dem Mord auch gegen sein eigenes Gesetz, das Preußentum, verstoßen hatte, war es zu spät. Wegen Beihilfe zu Zuchthaus und Ehrverlust verurteilt, war die Zelle gleichwohl fruchtbar für ihn geworden. Hier hatte er sich gelöst von den völkischen und ideologischen Verblendungen, hatte begonnen, zu sich selbst zu finden. Weihnachten 1927 aufgrund einer Amnestie freigelassen, stieß er unmittelbar in Berlin in die Kreise des "Neuen Nationalismus" und geriet über seinen Bruder Bruno in die revolutionär-romantische Schleswig-Holsteinische Landvolkbewegung, der Hans Fallada in seinem Roman "Bauern, Bonzen und Bomben" ein Denkmal gesetzt hat.
Von September bis Dezember 1929 deshalb in Moabit inhaftiert, schrieb Ernst von Salomon unter hartnäckigem Zusetzen von Ernst Rowohlt, der in Salomon den künftigen Erfolgsautor witterte, sein erstes Buch: "Die Geächteten". Diese Autobiographie, "die zugleich so etwas wie eine Selbstbiographie der ganzen Zeit ist" (Paul Fechter), verdiente, wie Ernst Jünger in einer Besprechung schrieb, schon deshalb gelesen zu werden, "weil es das Schicksal der wertvollsten Schicht jener Jugend, die während des Krieges in Deutschland heranwuchs, erfaßte."
Der zweite Teil dieser Nachkriegstrilogie, die nahezu unlesbare und gleichwohl brisant-interessante "Stadt", entstand 1932: "Die Stadt war ein Versuch, eine Bestandsaufnahme, eine Übung literarischer Art, bei der ich es auf ganz gewisse abseitige Probleme des Schreibens absah. Der Stoff ist sicher interessant, doch ohne Verbindlichkeit für mich; er diente mir nur zu einer Verschärfung aller Fragestellungen." Und der dritte Teil, der Abschluß seines "Neuen Nationalismus", der zugleich sein literarisch schönstes Werk werden sollte, "Die Kadetten", war in der so andersartigen Wiener Atmosphäre entstanden. Hier lernte von Salomon im Winter 1932/33 auf Einladung Othmars Spanns dessen Austro-Universalismus kennen, um sich darob seiner preußischen Herkunft und seines eigenen Nominalismus' nur um so bewußter zu werden: "Alle großen Bewegungen in der Welt, das Christentum wie der Humanismus, wie der Marxismus, sie alle werden von einer Art Krankheit befallen, eine göttliche Krankheit, der erhabenen Pest des ganzheitlichen Anspruchs. Das macht die Dinge so einfach für den, der sich bekennen will, und so schwer für den, der sie betrachtet. Ich, ich bin kein Bekenner, ich bin ein leidenschaftlich beteiligter Betrachter. So wurde ich kein Nationalsozialist, und so mußte ich mich von Othmar Spann trennen."
Von Salomon repräsentiert die Wirren seiner Zeit
Zurück in Berlin, wo die NSDAP bemüht war, eine Stringenz zwischen sich und den Freikorps zu apologetisieren, war es erneut von Salomons vordringliches Anliegen, den Verfälschungen in der Geschichtsschreibung des Nachkrieges entgegenzuwirken. So entstanden seine beiden Bücher "Nahe Geschichte" und das monumentale "Buch vom deutschen Freikorpskämpfer" als Korrektive nationalsozialistischer Geschichtsklitterung. Als jedoch ernste Schwierigkeiten mit der NSDAP entstanden, zog er sich aus Rücksicht auf seine jüdische Lebensgefährtin, die er während des Dritten Reiches als seine Ehefrau ausgab, aus allen kompromittierenden Kreisen, unter anderem auch aus dem Kreis um Harro Schulze-Boysen, zurück und "emigrierte" als Drehbuchautor zur UFA.
Der Nationalsozialismus war für ihn - und Hitler voran - "der größte Verfälscher der deutschen Geschichte". Salomons und der Deutschen Dilemma aber bestand darin, daß der Krieg auch ein deutscher Daseinskampf war und nicht nur rassenideologische Züge trug. So mußten sie zwangsläufig wieder in die Phalanx der nationalsozialistisch verfälschten deutschen Schicksalsgemeinschaft einscheren. Erst 1944 sollte dieser Schulterschluß endgültig aufbrechen.
Doch daß die Sieger des Weltkrieges diese Verfälschung der deutschen Nation und ihres Daseinsanspruches nur zu gerne aufgriffen und darüber die deutsche Identität zu zerstören suchten, sollte Ernst von Salomon nach seinem "automatic arrest" von Mai 1945 bis September 1946 unverzüglich zum Kampf um deutsches Subjektbewußtsein treiben. Schon in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war ihm klar geworden, daß sich die Maßnahmen der Besatzungsmächte und ihrer deutschen Handlanger "nicht gegen einen Angeklagten richtet, sondern gegen ein Volk, dem bewiesen werden soll, daß es keine anständigen Menschen hervorzubringen vermochte, und daß ihm zu dienen in jedem Falle unanständig war." Dieses System aber empfand er als eines, "das eine fatale Ähnlichkeit mit jenem hat, das zu bekämpfen diejenigen Leute in der kleidsamen Uniform der Sieger in dieses Land gekommen sind". Gerade die Sieger nämlich überschritten das Maß der von ihnen den Deutschen auferlegten moralischen Beschränkungen weiter als jemals zuvor. Salomons Reaktion darauf war eindeutig: "... niemand mag es verargt werden, sich wohl zu hüten, mit einer Macht anzubinden, welche so groß ist, daß sie es in sich erträgt, die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki unter der Begleitung des Chorals ‚Onward, Christian Soldiers!' platzen zu lassen, ohne dabei selber zu platzen."
Ab Juni 1947 reifte in Ernst von Salomon der Plan, seine und die Geschichte der Deutschen im zwanzigsten Jahrhundert niederzuschreiben und den Deutschen als Lesern wie in einem Spiegel vorzuhalten. Über den "Fragebogen" hinaus noch bemühte er sich um Überwindung der ideologischen Weltbürgerkriegsfronten, die die Deutschen so unmittelbar spalteten. Sein Engagement, u.a. in den Reihen der aufkommenden und damals noch nicht eindeutig gesellschaftspolitisch orientierten Friedensbewegung, im Demokratischen Kulturbund Deutschland und für die Deutsche Friedens-Union brachte ihm jedoch Urteile und Verurteilungen ein, die von Unverständnis strotzten. Von "Nationalbolschewismus" über "Unverbesserlichkeit" bis hin zum "German enemy of Germany" reichte die Spannweite der Urteile, und immer wieder nahm ihn die eine oder die andere Partei in Beschlag, berief sich auf ihn als Zeugen und Mitstreiter, während die andere ihn verdammte.
Nur seine tatsächliche Identität als unideologisch bestimmter Deutscher wollte oder sollte nicht ins Bewußtsein gelangen. Die "Objektisierung" der Deutschen durch eine alle Bereiche erfassende langfristige Umerziehung war zu weitgehend, die Bereitschaft der besiegten und individualisierten Einzelnen zum Identitätswechsel zu groß gewesen, um Ernst von Salomon zu folgen. Sein Erfolg, auch der des "Fragebogens", blieb ein literarischer.
Absolute Toleranz gegen jede politische Idee
Sein Versuch, die Staatsidee Preußens in seinem posthum veröffentlichten Werk "Der tote Preuße" zu erklären und plausibel zu machen, wurde aufgrund des nur zu einem Drittel fertiggestellten Torsos ein Fehlschlag. Daß er sich als Schriftsteller und Drehbuchautor durch Trivialitäten seinen Lebensunterhalt und den seiner 1948 gegründeten Familie sichern mußte, wurde ihm zudem noch verübelt. Doch mit Veröffentlichungen im Zusammenhang mit seiner Bemühung um deutsche Selbstbehauptung war mit zunehmendem Alter der Bundesrepublik kein Geld mehr zu verdienen. Je weiter die um die Jahrhundertwende geborene Generation von der Bühne abtrat, desto geringer wurde der Bedarf und das Verständnis für solche Bemühungen. Spätestens 1968 war Ernst von Salomon zum lebenden und unverstandenen Fossil geworden - selbst für seine eigenen Nachkommen. Am 9. August 1972 starb er in Stöckte (Winsen/Luhe).
Ernst von Salomon ist das verkörperte Abbild des 20. Jahrhunderts, ist Exponent eines deutschen Geschichtsabschnitts, der - mit größerem Abstand - dereinst erneut "die deutsche Romantik" genannt werden könnte. Leidenschaftlich beteiligt an den vielschichtigen Abenteuern seiner Zeit repräsentiert er die oft fatalen Wirren und Brüche, mit denen die Deutschen in "seinem" Jahrhundert konfrontiert waren. Sein Leben stellt subjektiv wie objektiv eine stellvertretende Kontinuität dar, nämlich die der Deutschen in eben jener Zeit, die so von Ideologien überfrachtet war. An ihm ist die Geschichte und das wegen der dauernden Verfälschung zwangsläufige Scheitern der im eigentlichen Sinne - um ihrer Identität willen - unideologischen Deutschen in dieser Epoche nachzuvollziehen.
Salomons auf Schiller zurückgehender Idealismus, sein Engagement für absolute Toleranz gegen jede politische Idee macht ihn heute noch interessant. Nach dem Zusammenbruch der ideologischen Nachkriegsidentitäten, die die Deutschen so lange quer durch alle Lager getrennt haben, ist ein Wiederentdeckung von Salomons in Deutschland so begrüßenswert wie selten zuvor. Vielleicht könnten die Deutschen über ihn endlich einen unideologischen Zugang zu ihrer Geschichte und damit zu sich selbst finden.
mardi, 08 mai 2007 | Lien permanent
Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962)
 Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962): le philosophe de la rénovation religieuse
Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962): le philosophe de la rénovation religieuse
La trajectoire de Jakob Wilhelm Hauer est peut-être la plus étonnante en ce siècle de bouleversements et d'horreurs guerrières, de bagarres idéologiques et d'aplatissement culturel. Né dans un milieu piétiste à Ditzingen-Bompelhof en Souabe, dans une famille de paysans et d'artisans jadis émigrés d'Autriche vers la Forêt Noire, au temps où la monarchie des Habsbourg tolérait mal les protestants dans ses états. La famille Hauer est très pauvre, la vie est dure et tragique à Ditzingen: deux jeunes sœurs meurent le même jour lors d'une épidémie de scarlatine; Jakob Wilhelm, fort affaibli, survit. Dès son jeune âge, il doit aider son père à gagner maigrement sa vie. Mais cette rude expérience, cette jeunesse triste, lui livre un trésor incomparable: il expérimente et intériorise la solidarité entre les membres d'une communauté de sang. Jamais ce sens de la solidarité n'a fléchi chez lui. Cet exemple familial est à la base du principal concept que Hauer théorisera, avec son ami Martin Buber: Das Gemeinsame, la communauté. Devant les cadavres de leurs deux petites fillettes, les parents de Hauer avaient formulé un vœu: si le garçon survit, il devra être au service de Dieu. Dieu a exaucé le malheureux couple: Hauer, en dépit de toutes les difficultés matérielles, deviendra pasteur et missionnaire; il fréquentera le lointain Gymnasium et il étudiera la théologie, avec l'aide du pasteur de Ditzingen, qui lui donne des cours particuliers d'une telle qualité qu'en entrant à l'école des missionnaires à dix-huit ans, le jeune Hauer est plus calé que ses condisciples. En 1900, il part à pied à Bâle pour entrer au séminaire des missionnaires. Il y est un élève modèle, un “bûcheur” hors ligne, mais qui lit, à l'insu de ses supérieurs, des livres prohibés, “païens”: l'Edda, Goethe, Schiller, Nietzsche, la Divine Comédie de Dante, et surtout Das Wesen des Christentums de Harnack. Sa foi chrétienne est fort ébranlée, mais il le cache, car il a vraiment envie d'être missionnaire, de quitter l'Europe et de partir à l'aventure dans un pays lointain, exotique. On lui réserve un poste en Inde, sur la côte de Malabar. Mais auparavant, il doit connaître l'anglais. La mission lui paie un stage à Edimbourg en Ecosse.
Il effectuera sa première mission en Inde à Palghat, où il entre en contact avec la civilisation et la culture indiennes. C'est là, au fond, que tout va basculer: Hauer ne convertira aucun Indien. C'est l'Inde qui va le convertir, qui va lui faire découvrir sa propre “indo-européanité”. Après un premier séjour là-bas, de 1908 à 1909, il étudie à Oxford de 1910 à 1915, avec juste une interruption: un séjour dans un camp de concentration anglais, réservé aux “alien ennemies”. Mais il peut retourner à l'université, avec la promesse de ne pas s'évader. C'est à Oxford que Hauer approfondit ses connaissances de l'Inde et surtout des techniques du Yoga. Ses travaux le rendent éminemment suspect aux yeux des supérieurs du séminaire des missionnaires de Bâle. La rupture avec le christianisme est irrémédiable. Elle est consommée en 1920, où Hauer devient Privatdozent en histoire des religions, attaché à l'Université de Tübingen. Mais la routine de l'université l'ennuie. Il cherche à poursuivre sa vocation de missionnaire, non plus au service d'un protestantisme fortement teinté de piétisme, non plus sous des cieux exotiques, mais au profit d'une vision religieuse ancrée dans la nature, dans les paysages, axée sur la charité communautaire, sur l'esprit de solidarité avec les siens, sur l'ascèse et la discipline intérieure qu'enseigne le Yoga indien, et, enfin, sur ce sentiment, encore diffus chez lui, d'une fibre religieuse commune à tous les Indo-Européens, de l'Islande au Gange. Pour enseigner cette vision religieuse surplombant tout ce qui est établi, bousculant toutes les conventions universitaires, il faut un terrain vierge. Et qu'offre l'Allemagne d'après 1918 comme “terrain vierge”, sinon les mouvements de jeunesse alternatifs, issus du Wandervogel d'avant 1914? Il fréquentera d'abord le groupe Die Neuen, animé par un pasteur, Rudolf Daur, qui commence, lui aussi, à s'émanciper des dogmes chrétiens, puis fonde une véritable école alternative, organisée sur le modèle des ligues de jeunesse: le Bund der Köngener, dont il devient automatiquement le premier “chancelier”.
Ce Bund der Köngener est trop peu connu; pourtant, il fut le théâtre de débats inimaginables aujourd'hui, où tout est contingenté, politisé, dogmatisé, hyper-simplifié et médiatisé. Les tenants des idéologies ou des confessions les plus diverses et, apparemment, les plus contradictoires, ont pris la parole à cette tribune alternative, y ont confronté leurs points de vue et ceux qui avaient vraiment abjuré toute forme de dogmatisme stérilisant y ont enrichi leur bagage religieux, théologique ou philosophique. Le Bund der Köngener est sans nul doute le meilleur exemple d'anti-dogmatisme en ce siècle où des millions d'hommes se sont écharpés pour ne pas s'être écoutés. Martin Buber y a présenté son humanisme et son “enracinement” juifs, de même qu'une vision du Reich (allemand) reposant sur les traditions juives, où le peuple serait éduqué et discipliné dans son intériorité et non pas par le truchement d'un appareil d'Etat coercitif; Karl Otto Paetel, rédacteur du Manifeste national-bolchevique, qui partira s'engager dans les Brigades Internationales et connaîtra l'exil à New York après la défaite de l'Espagne républicaine, y a défendu son idéal du paysan-soldat; Ernst Krieck, le pédagogue allemand, membre de la NSDAP et grand pourfendeur de Heidegger, y a pris la parole; des communistes, des protestants, des catholiques y ont dialogué. Mais les passions politiques faisaient rage dans cette Allemagne au bord de la guerre civile, où SA et SS étaient prêts fondre sur leurs homologues des ligues communistes et du Reichsbanner social-démocrate. Des propagandistes nazis obtus décrètent que le Bund der Köngener est “enjuivé” par la présence de Buber; les chrétiens déplorent la présence de non-chrétiens; les “rouges” refusent de dialoguer avec Krieck et Bäumler (spécialiste du matriarcat de Bachofen, de Nietzsche et du “romantisme tellurique”; membre de la NSDAP); etc. Hauer et Buber tentent de maintenir la sérénité du débat, y parviennent, mais réduisent automatiquement le nombre de participants et ne bénéficient plus d'aucune publicité.
L'idéal des Köngener était de créer une sorte de solidarité interconfessionnelle entre tous ceux qui, sur la Terre, souhaitaient sauver l'essentiel des messages religieux, le sens des communautés, devant le raz-de-marée de la modernité désaxante, déracinante, individualisante. Leurs adversaires disaient d'eux qu'ils voulaient créer une “religion-esperanto”... Reproche infondé dans le sens où la qualité des interventions et des intervenants éloignait leurs démarches de tout affadissement ou aplatissement de style “espérantiste”. A partir de 1933, quand le pouvoir change de mains à Berlin, le Bund der Köngener, dont le statut est celui d'un mouvement de jeunesse, change de nom et d'objectifs pour ne pas devoir se dissoudre dans les jeunesses hitlériennes. Finalement, Hauer fonde la Deutsche Glaubensbewegung, à laquelle se joint toute une série d'autres associations de recherches religieuses (qui mériteraient aussi d'être analysées plus en profondeur). L'association doit faire les concessions d'usage au nouveau parti totalitaire pour pouvoir continuer à exister en toute indépendance. Hauer et ses amis souhaitent surtout que les recherches religieuses demeurent indépendantes, n'aient pas à s'aligner sur les diktats d'un parti ou à s'inféoder à une église ou à un “christianisme germanique”. En 1935, Hauer et le Comte Ernst zu Reventlow remplissent le Palais des Sports de Berlin, pour parler de religion et de métaphysique! La puissance de ce mouvement patriotique mais alternatif, de ces tenants d'une révolution intérieure (Buber!), devient suspecte. Les attaques ne cessent plus: c'est dans le parti et non pas dans une “association extérieure” qu'on réalisera la révolution (même la révolution intérieure); on interdit aux membres de la jeunesse hitlérienne de faire partie de la DGB; finalement, Heydrich en devient membre pour mieux la contrôler. La présence du chef de la police fait perdre au mouvement tout son aura. Hauer est contraint d'adhérer aux différentes instances du parti, afin de conserver ses chaires. Buber se réfugie en Palestine. Mais les modestes nominations de Hauer le compromettront après 1945. L'indéfectible amitié de Martin Buber, émigré en Palestine en 1938 après la “Nuit de Cristal”, le tirera d'affaire. Et la grande aventure de ces deux formidables complices pourra continuer jusqu'à la mort de Hauer en 1962. Les associations qu'ils ont fondées ou patronnées dans les années 50 continuent de travailler aujourd'hui.
Les années 30 sont aussi l'occasion pour Hauer d'approfondir ses connaissances de la religiosité indienne, de développer sa critique des dogmatismes, de réfléchir sur la métaphysique indo-aryenne du combat et de l'action, de poursuivire une quête mystique germanique en tentant, à la suite de Maître Eckart, de dégager une vision thioise du divin et de la foi (dont un texte paraîtra en français en 1935: «Le mouvement de la foi germanique», in Revue des vivants. Organe de la génération de la Guerre, IX, 1935, pp. 1491-1504). Parallèlement à cette triple recherche, Hauer tente une réflexion en profondeur sur les assises physiques et somatiques des religiosités enracinées et sur les questions impassables de la mort et de l'immortalité. En 1937, paraît un livre qui reprend l'essentiel de ses recherches en indologie, Glaubensgeschichte der Indogermanen. Dans la préface à cette anthologie, Hauer insiste sur le caractère nécessairement “proche de la vie” et “ancré dans un peuple précis” de toute religiosité vraie, durable et authentique. Il y livre aussi, de façon très concise, ses méthodes de recherche et ses conclusions. Notamment la différence entre foi (Glaube) et religion (Religion). «Par “religion”, j'entends le monde des formes religieuses, qui, en tant que partie de la culture globale d'un peuple, est soumis aux lois du devenir et de la disparition. La foi, en revanche, est l'expérience originelle de la réalité ultime et le domaine des forces intérieures, vivantes dans les tréfonds de l'âme des peuples et des races. C'est de l'interaction de ces forces que nait le monde des formes religieuses. Celles-ci sont symboles, indices, de ce domaine de l'intériorité. Voilà pourquoi on ne peut pas écrire d'histoire de la foi sans d'abord écrire une histoire de la religion. Les faits relevant de l'histoire de la religion doivent nous guider, de façon à ce que nous puissions aller à la rencontre de cette vie intérieure et que nous puissions en saisir le sens, créativement. Ainsi jaillira la connaissance sur base de laquelle nous pourrons oser une histoire de la foi. Mais nous ne serons saisis par ce sens que si ce sens est apparenté à notre propre essence».
La religiosité indo-européenne est une religiosité de l'action, notamment de l'action guerrière. Pendant toute sa vie, Hauer s'est insurgé contre un a priori sur le Yoga, considéré comme un exercice purement contemplatif. A priori évidemment faux, car, écrit-il dans la préface de Glaubensgeschichte der Indogermanen, une forme particulière du Yoga, dans la tradition zen du bouddhisme japonais, est le pilier porteur d'une noblesse guerrière, les Samouraïs, qui ont fait l'Empire nippon. «Ma conviction est qu'il est impossible de comprendre la civilisation indo-aryenne sans comprendre le Yoga, tout comme il est impossible de comprendre l'hellenité en excluant l'orphisme ou le platonisme, ou de comprendre la germanité, si on ôte la mystique de son patrimoine (ici, j'entends “mystique” au sens totalement positif de “voie vers l'intériorité”. Sans cette voie vers l'intériorité, dans quelque forme que ce soit, il n'y a pas d'indo-européanité, ni même de germanité). L'homme indo-européen déploie certes une puissance d'action hors mesure et fait montre d'une volonté indomptée d'agir sur le monde; mais il sent instinctivement qu'il court un grand danger, si cet agir sur le monde extérieur n'est pas compensé par un retour aux tréfonds de l'âme et un rassemblement des forces qui y résident, pour les opposer ensuite au monde extérieur. La religiosité indo-européenne tourne donc autour de deux pôles: d'une part, une pulsion qui la conduit à plonger dans les tréfonds de l'âme pour y découvrir ses lois et, d'autre part, une foi active en Dieu et dans le destin, impliquant un sens très austère et très sérieux de sa responsabilité dans le monde. Dans la tension qui résulte de cette opposition, jaillit la formidable dynamique de l'histoire de la foi indo-européenne, cette dynamique qui lui donne son élan constant».
En conséquence, la tradition indienne et le yoga ne peuvent pas être considérés comme des fuites hors du monde: «... Au contraire, c'est ici une joie d'être dans le monde qui est à l'œuvre, un sens d'être abrité dans le monde (Weltgeborgenheit) qui donne le ton». Le monde n'est donc pas dépourvu d'essence (divine), il n'est pas opposé à Dieu ou aux dieux (gottwidrig). Il n'est pas nié au profit d'un espoir de voir advenir un monde “tout-autre”, parfait, où le tragique n'aurait plus sa place. Au contraire, le monde et ses conditions, ses tragédies et ses deuils, est accepté comme tel et opposé à une intériorité inconditionnée, qui est présente dans le monde, qui peut arraisonner ce monde, que les esprits les plus lucides et les plus clairvoyants ont la faculté de saisir.
Revenons aux événements du XXième siècle. La tension qui a existé entre les autorités du Troisième Reich et la Deutsche Glaubensbewegung est indéniable. Mais en 1945, qu'est-ce qui a incité les autorités anglo-saxonnes à ostraciser Hauer, à le suspecter de collaboration avec le régime, au-delà des titres honorifiques ou autres que lui avaient octroyés des fonctionnaires zélés et propagandistes? La dernière activité de Hauer pendant la guerre a été de mettre sur pied un “Institut Indien” à l'Université de Tübingen. Pour mener cette tâche à bien, il collabore avec le leader des indépendantistes indiens, Subha Chandra Bose, allié de l'Axe et des Japonais, pour qui il recrute des troupes. Ni les Américains ni les Anglais ne peuvent avaliser cette politique, qui aurait pu sérieusement ébranler la puissance des Anglo-Saxons pendant le conflit et qui a jeté les premières bases de l'indépendance indienne de 1947. Hauer paiera cher cette collaboration somme toute bien innocente avec Subha Chandra Bose. Il est arrêté le 3 mai 1945 et interné dans un camp de concentration allié. En 1947, il est relâché. Très vite, il remonte son institut indépendant d'études religieuses, qui devient l'Arbeitsgemeinschaft für freie Religionsforschungen und Philosophie. Plus tard, en 1957, avec les Prof. Heller, Brachmann et Berger, Hauer participe à la création de la Freie Akademie. Il en restera le président jusqu'à sa mort. La Freie Akademie poursuit toujours ses travaux aujourd'hui.
A partir de 1950, dans une ambiance plus sereine, sans arrière-fond de guerre civile, Hauer poursuit ses travaux et élargit l'éventail de ses préoccupations: réflexions sur la crise religieuse contemporaine, notion de destin, mythes et cultes des peuples primitifs, religiosité de l'“homme occidental”, réflexions sur la tolérance, étude sur le matriarcat, etc. Il meurt le 18 février 1962.
Trois grandes leçons doivent être tirées de l'œuvre de Hauer. D'abord, c'est toujours ce fameux “facteur X”, soit la “réalité intérieure”, qui détermine la vie religieuse et l'histoire de chaque peuple. Ce “facteur X” peut se retirer du monde, replonger dans les tréfonds de l'âme, pour revenir fortifié et agir sur la trame des événements. L'Europe finira donc par retrouver sa vision tragique du monde, cette tension fructueuse entre intériorité et arraisonnement du monde. Ensuite, la notion, partagée avec Martin Buber, de “communauté”, plus exactement, Das Gemeinsame. Tous les représentants d'un même peuple partagent une variante bien précise de l'idée (platonicienne) de “communauté”. C'est leur épine dorsale religieuse et historique. Sans cette notion, un peuple dépérit. Mais comment empêcher ce sentiment de la communauté d'être étouffé par l'idéologie dominante, rationaliste, matérialiste et individualiste? Par la tolérance. Et la tolérance selon Hauer et Buber est la troisième grande leçon que nous devons retenir. La tolérance, ce n'est pas tout accepter indistinctement, c'est au contraire se hisser largement au-dessus des opinions idéologiques conventionnelles, pharisiennes et mesquines. De ce fait, la tolérance selon Hauer n'est pas un facteur de dissolution, mais un principe qui permet de dégager l'essentiel et d'unir les hommes sur la base de cet essentiel et, ainsi, de mettre un terme à des querelles stériles, comme celles qui ont ensanglanté ce XXième siècle. Cette tolérance-là il faut la graver dans son cœur et dans son cerveau. Pour rester fidèle aux deux seuls hommes qui ont su rester haut au-dessus de la mêlée: Hauer et Buber.
Detlev BAUMANN.
SOURCE: Margarete DIERKS, Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962). Leben. Werk. Wirkung, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1986, 607 p., DM 88, ISBN 3-7953-0510-1 (Bibliographie très complète, livres, articles et recensions). Précisons que les éditions Lambert Schneider sont celles qui éditent les œuvres complètes de Martin Buber. Dans la politique éditoriale de la maison, les deux amis restent donc unis, par-delà la mort.
Sur la Deutsche Glaubensbewegung: Ulrich NANKO, Die Deutsche Glaubensbewegung. Eine historische und soziologische Untersuchung, Diagonal-Verlag, Marburg, 1993, 372 p., DM 39,80, ISBN 3-927165-16-6.
lundi, 26 avril 2010 | Lien permanent
La corrispondenza tra Julius Evola e Gottfried Benn
La corrispondenza tra Julius Evola e Gottfried Benn
 L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro Julius Evola è quella di essere un “nazista”, più che di essere stato (come innumerevoli altri uomini di cultura italiani) un “fascista”. Accusa ovvia e prevedibile, ma superficiale, che si basa su alcune apparenze: il suo retroterra culturale che si rifaceva ad una certa filosofia tedesca (a partire da Nietzsche); il suo essere caratterialmente più “tedesco” che “italiano, il suo interessamento tra le due guerre per far conoscere nel nostro Paese una certa cultura di lingua tedesce (da Bachofen a Spengler a Meyrink); i suoi contatti con la Germania del Terzo Reich; il suo aver ricordato come avesse conosciuto Himmler, visitato ai castelli dell’Ordine, tenuto conferenze in ambienti diversi come l’Herrenklub da un lato e le SS dall’altro; l’aver scritto articoli sulla politica estera, interna, culturale ed economica della Germania nazionalsocialista e sulle stesse SS (articoli di cui si ricordano gli eventuali apprezzamenti ma non le innumerevoli riserve critiche); e così via. Da tutto questo sfondo gli orecchianti derivano l’etichetta appunto di “nazista”: raramente si va alle fonti e si leggono nel loro complesso, a partire almeno dal 1930, con articoli e saggi su “Vita Nova” e “Nuova Antologia”, sino agli interventi su “Il Regime Fascista”, “Lo Stato” e “La Vita Italiana” del maggio-luglio 1943.
L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro Julius Evola è quella di essere un “nazista”, più che di essere stato (come innumerevoli altri uomini di cultura italiani) un “fascista”. Accusa ovvia e prevedibile, ma superficiale, che si basa su alcune apparenze: il suo retroterra culturale che si rifaceva ad una certa filosofia tedesca (a partire da Nietzsche); il suo essere caratterialmente più “tedesco” che “italiano, il suo interessamento tra le due guerre per far conoscere nel nostro Paese una certa cultura di lingua tedesce (da Bachofen a Spengler a Meyrink); i suoi contatti con la Germania del Terzo Reich; il suo aver ricordato come avesse conosciuto Himmler, visitato ai castelli dell’Ordine, tenuto conferenze in ambienti diversi come l’Herrenklub da un lato e le SS dall’altro; l’aver scritto articoli sulla politica estera, interna, culturale ed economica della Germania nazionalsocialista e sulle stesse SS (articoli di cui si ricordano gli eventuali apprezzamenti ma non le innumerevoli riserve critiche); e così via. Da tutto questo sfondo gli orecchianti derivano l’etichetta appunto di “nazista”: raramente si va alle fonti e si leggono nel loro complesso, a partire almeno dal 1930, con articoli e saggi su “Vita Nova” e “Nuova Antologia”, sino agli interventi su “Il Regime Fascista”, “Lo Stato” e “La Vita Italiana” del maggio-luglio 1943. Visione aristocratica
Julius Evola non fu né “fascista” né “antifascista” (come già scriveva polemicamente sul suo quindicinale “La Torre” all’inizio del 1930), e di conseguenza non fu poi né “nazista” né “antinazista”: fu allora un incerto, un attendista, un ipocrista, un – come si suol dire – “pesce in barile”? No: del fascismo, e quindi del nazismo, accettò quelle idee, tesi, posizioni, atteggiamenti, scelte pratiche che si accordavano con quelle di una Destra Tradizionale e, poi, di quella che è stata definita la Rivoluzione Conservatrice tedesca. Una visione all’epoca ghibellina, imperiale, aristocratica che – se pur “utopica” – lo allontanava di certo dalla Weltanschauung populista “democratica” e “plebea” del fascismo ma soprattutto del nazismo, il cui materialismo biologico gli era del tutto insopportabile. Non si tratta di giustificazioni a posteriori, come qualcuno ha malignamente pensato leggendo le pagine de Il cammino del cinabro (1963), dato che Evola non è quello che oggi si suol dire un “pentito”: non ha mai rinnegato o respinto nulla del suo passato; anche se ha rettificato e preso le distanze da alcune sue posizioni giovanili (tutti dimenticano quel che scrisse circa Imperialismo pagano del 1928: “Nel libro, in quanto seguiva – debbo riconoscerlo – lo slancio di un pensiero radicalistico facente uso di uno stile violento, si univa ad una giovanile mancanza di misura e di senso politico e ad una utopica incoscienza dello stato di fatto”: non “pentimento” bensì logica maturazione di un uomo di pensiero). E che non si tratti di giustificazioni, lo stanno a dimostrare i documenti che nel corso degli anni, dopo la sua morte nel 1974, vengono lentamente alla luce dagli archivi pubblici e privati italiani e tedeschi. Da essi emerge un Julius Evola tutt’altro che “organico al regime” come addirittura si è scritto, ma nemmeno tanto marginale come si credeva: un saggista, giornalista, polemista, conferenziere che proseguì tra alti e bassi e che, dopo la crisi del 1930 con la chiusura de “La Torre” e la sua emarginazione, accettò di avvicinarsi a personaggi come Giovanni Preziosi, Roberto Farinacci, Italo Balbo, cioè si potrebbe dire i fascisti più “rivoluzionari” e “intransigenti”, per poter esprimere le proprie idee critiche al riparo di quelle nicchie, agendo come una specie di “quinta colonna” tradizionalista per tentare l’utopica impresa di “rettificare” in quella direzione il Regime: e così iniziò a scrivere a partire dal marzo 1931 su “La Vita Italiana”, dal gennaio 1933 su “Il Corriere Padano” e “Il Regine Fascista”, e quindi – uscito dal “ghetto” dei caduti in disgrazia – dall’aprile 1933 su “La Rassegna Italiana”, dal febbraio 1934 su l’autorevole “Lo Stato” e sul “Roma”, dal marzo 1934 su “Bibliografia Fascista”.
Sorvegliato speciale
Nonostante ciò Evola venne costantemente sorvegliato dalla polizia politica sia in Italia che all’estero: la corrispondenza controllata, gli amici che frequentava identificati (anche le amiche), le sue affermazioni in confidenza riferite, varie volte gli venne tolto il passaporto per le cose assai poco ortodosse che andava a dire sul fascismo e nazismo nelle sue conferenze in Germania e Austria. Come risulta dai documenti ormai pubblicati dei Ministeri degli Esteri e dell’Interno del Reich e da quelli provenienti dall’Ahnenerbe, era appena tollerato: non era un vero nemico, ma le sue idee non venivano apprezzate dai vertici nazionalsocialisti, dato che era considerato un “romano reazionario” che aspirava a far “sollevare l’aristocrazia” e non accettava molto il riferimento tedesco a “sangue e suolo”.
Un’adesione molto critica, dunque, quella di Julius Evola tale da non poterlo semplicisticamente definire né un “fascista”, né un “nazista” di pieno diritto. Il suo punto di riferimento era invece la Konservative Revolution ed i suoi esponenti dell’epoca. Sentiamo le sue stesse parole tratte da Il cammino del cinabro: “Già l’edizione tedesca del mio Imperialismo pagano, dove le idee di base erano state staccate dai riferimenti italiani, aveva fatto conoscere il mio nome in Germania negli ambienti ora indicati. Nel 1934 feci il mio primo viaggio nel nord, per tenere una conferenza in una università di Berlino, una seconda conferenza a Brema nel quadro di un convegno internazionale di studi nordici (il secondo Nordisches Thing, promosso da Roselius) e, cosa più importante di tutto, un discorso per un gruppo ristretto dell’Herrenklub di Berlino, il circolo della nobiltà tedesca conservatrice la cui parte di rilievo nella politica tedesca più recente è ben nota. Qui trovai il mio ambiente naturale. Da allora, si stabilì una cordiale e feconda amicizia fra me e il presidente del circolo, barone Heinrich von Gleichen. Le idee da me difese trovarono un suolo adatto per essere comprese e valutate. E quella fu anche la base per una mia attività in Germania, in seguito ad una convergenza di interessi e finalità”.
Altri contatti e collegamenti in quest’area conservatrice furono con il filosofo austriaco Othmar Spann e il principe Karl Anton Rohan, sulla cui “Europaische Revue” Evola aveva esordito sin dal 1932 e su cui continuò a pubblicare sino al 1943. Si tenga conto dell’anno. Il 1934 fu importante: dal 2 febbraio usciva il quotidiano di Cremona “Il Regime Fascista” una pagina quindicinale intitolata con stile tipicamente evoliano “Diorama Filosofico. Problemi dello spirito nell’etica fascista”, pubblicato con varia periodicità e interruzioni sino al 18 luglio 1943.
Mancano ancora studi complessivi su una iniziativa che fu unica nel Ventennio come intenti e complessità: un vero e proprio progetto culturale con cui Julius Evola intendeva esporre costruttivamente e criticamente il punto di vista della Destra tradizionale e conservatrice rispetto al fascismo. Su quella pagina scrissero molti autorevoli esponenti della cultura europea di tale tendenza: italiani, ma anche tedeschi, austriaci, francesi, inglesi. Fra i tedeschi anche il medico e poeta Gottfried Benn, con cui Evola era in contatto epistolare a quanto pare sin dal 1930.
Nella prima metà del 1934 uscì anche l’opera principale che Julius Evola aveva scritto – incredibilmente e per l’età e per l’attività che in quel momento stava svolgendo – fra il 1930 e il 1932: Rivolta contro il mondo moderno presso Hoepli; e venne effettuato quel viaggio in Germania ricordato nell’autobiografia. Durante la tappa berlinese vi fu il primo incontro diretto con Benn: molti erano i punti in comune fra il medico-scrittore, che era di dieci anni più vecchio di Evola (era nato nel 1886 e sarebbe morto nel 1956), e quest’ultimo. Di Benn si tende og gi a mettere in risalto il suo aspetto nichilista, ateo e astratto dagli aspetti più orribili della realtà umana, e si tende a dimenticare il suo apporto alla Rivoluzione Conservatrice tedesca. Sta di fatto che il contatto fra Evola e Benn ad una certa comunanza di idee portò ad un famoso saggio-recensione alla traduzione tedesca di Rivolta che apparve sul fascicolo del marzo 1935 della rivista «Die Literatur» di Stoccarda. È una specie di “canto del cigno” in cui Benn espone le sue idee e concorda con la «visione del mondo» evoliana: infatti, quello fu “il suo ultimo testo in prosa pubblicato sotto il Terzo Reich”, perché in seguito Rosenberg e Goebbels gli vietarono di scrivere alcunché. Recensione di profonda analisi di cui Evola stesso riconosceva l’importanza e volle porre in appendice alla sua raccolta di saggi L’arco e la clava (Scheiwiller, 1968), mentre adesso sarà posta in appendice alla nuova edizione di Rivolta che uscirà entro il 1998. Egli stesso amava ricordare soprattutto una frase: “Un ‘opera, la cui importanza eccezionale apparirà chiara negli anni che vengono. Chi la legge, si sentirà trasformato e guarderà l’Europa con un sguardo nuovo”.
“Rivolta” in Germania
Ora a confermare e precisare i rapporti Evola-Benn vi sono tre lettere del primo al secondo che sono state rintracciate da Francesco Tedeschi, studioso soprattutto dell’Evola artista, nello Schiller-Nationalmuseum Deutsches Literaturarchiv (Handschriften Abteilung) di Marbach, e che qui si pubblicano grazie alla sua fattiva collaborazione e al suo consenso: due manoscritte sono del 30 luglio e del 9 agosto 1934, una dattiloscritta del 13 settembre 1955 e se ne dà la traduzione integrale dovuta a Quirino Principe. Dai primi due scritti emergono alcuni fatti noti ed un altro assolutamente nuovo: i fatti noti sono che Benn ed Evola già si conoscevano almeno per lettera (“Ella ha ripetutamente mostrato un cordiale interesse per le mie fatiche”: 20 luglio), che sono effettivamente incontrati nel corso del viaggio evoliano in Germania (“Le sarei molto obbligato se ella mi offrisse le possibilità di punti di vista e di una più lunga conversazione tra noi due”: 9 agosto), che esisteva un reciproco apprezzamento su una medesima Weltanschauung “conservatrice” o “tradizionale” (“l’assoluta competenza che a mio giudizio Ella possiede su questi argomenti e la Sua grandissima conoscenza e intelligenza delle tradizioni cui io mi ricollego”: 20 luglio), che entrambi non si riconoscevano nel nazismo da poco salito al potere (“sono sempre più convinto che a chi voglia difendere e realizzare senza compromessi di sorte una tradizione spirituale e aristocratica non rimanga purtroppo, oggi. e nel mondo moderno, alcun margine di spazio; a meno che non si pensi unicamente a un lavoro elitario”: 9 agosto).
Il fatto nuovo e di enorme interesse è nella richiesta avanzata da Evola il 20 luglio, e accettata da Benn nella sua risposta (che non possediamo) del 27 luglio, di “sottoporre a revisione il manoscritto della traduzione” tedesca di Rivolta effettuata da Friedrich Bauer. Il particolare era del tutto sconosciuto ed Evola non ne ha mai parlato anche se esso – la revisione linguistica da parte di un poeta noto e apprezzato come Gottfried Benn – avrebbe potuto dare lustro al suo maggior libro. Non pare ci siano dubbi che tale revisione sia stata effettivamente compiuta, non tanto per i ringraziamenti alla “gentilissima intenzione” (9 agosto), quanto per il fatto che si danno specifici riferimenti sul manoscritto della traduzione stessa presso la casa editrice tedesca e, si può dedurre, per l’ampio interesse manifestato da Benn con la recensione su “Die Literatur” (il libro aveva dunque visto la luce entro il marzo 1935): non solo, allora, adesione alla “visione del mondo” esposta nell’opera, ma anche l’averla considerato come un testo al quale – per averne rivista la traduzione – si è particolarmente vicini. Un nuovo tassello che si aggiunge a comporre il quadro (ancora incompleto) del rapporto fra Julius Evola e la cultura conservatrice tedesca fra le due guerre. Si può quindi immaginare che il contatto epistolare con il medico poeta sia continuato ma per ora non se ne hanno altre tracce.
Ci si sposta allora in avanti di vent’anni, al 1955. La lettera del 13 settembre s’inquadra nel tentativo del filosofo di riprendere i contatti proprio con quegli esponenti anticonformisti che aveva conosciuto negli anni Trenta e Quaranta: si sa che nel 1947 aveva scritto a Guénon, nel 1951 a Eliade e Schmitt, nel 1953 a Jünger, per ricollegarsi ad un discorso intellettuale interrotto dagli eventi bellici, ma anche per proporre traduzioni dei loro libri in italiano, dato che potevano essere utili per una nuova Kulturkampf. Spesso le sue aspettative andarono deluse: non tutti erano rimasti fermi su certe idee, ovvero non ritenevano opportuno il momento per ricordarle, a causa dell’ombra negativa che ancora si stendeva su di loro dopo il 1945. E proprio per i suoi “recenti successi letterari” Benn non intese forse rispondere a quello che era stato un po’ più di un conoscente, dato che non risultavano altre lettere di Evola nel Nationalmuseum: sicché, si deve pensare che gli “antichi rapporti” non vennero ripresi. Certo è che Evola non faceva mistero di essere rimasto lo stesso (“Io sono sempre rimasto sulle mie antiche posizioni, per quanto riguarda l’orientamento intellettuale e i miei interessi prevalenti”) e non è detto che tali precisazioni non siano state controproducenti …
Quel che è invece un po’ singolare è il non ricordare a dovere il tipo di rapporti intercorsi vent’anni prima: non solo l’incontro a Berlino, ma la reciproca conoscenza delle opere e la questione di Rivolta. Il mancato accenno alla revisione della traduzione, ma anche al saggio su “Die Literatur” (poi però fatto pubblicare tredici anni dopo in appendice a L’arco e la clava, come si è già ricordato) è dovuto ad una défaillance mnemonica, o magari ad un senso di opportunità, per non imbarazzare forse il medico-poeta? È anche vero che Benn sarebbe morto solo dieci mesi dopo, il 7 luglio 1956, a settant’anni, e quindi ogni illazione può essere valida. Così come resta aperta ogni ipotesi sul perché Julius Evola, sia nelle lettere private, sia nel la sua autobiografia pubblica, abbia dimenticato molti episodi e personaggi importantissimi nelle vicende della sua vita: e non certo in senso positivo, tali da accrescere l’importanza della sua opera complessiva. Forse normalissimi vuoti di memoria come possono accadere a tutti, ma forse anche quella tendenza “impersonale” a minimizzare un certo suo lavoro conferendo così poca importanza – tanto da non ritenere che certi particolari valessero la pena di essere citati – a determinati momenti della sua vita. Sta di fatto, comunque, che queste lettere a Gottfried Benn riempiono in modo significativo una delle tante lacune che ancora rimangono per ricostruire compiutamente l’intensa vita di Julius Evola.
Note
(1) Il cammino del cinabro, Scheiwiller, Milano, 1972, p.79.
(2) Heidnischer Imperialismus, Armanen Verlag, Lipsia, 1933.
(3) Cioè, da un lato gli esponenti della “tradizione prussiana” e dall’altro la corrente di quegli scrittori, come Moeller van den Bruck, Bluher, Jünger, von Salomon e così via, che era stata definita Rivoluzione Conservatrice.
(4) Il cammino del cinabro cit., p.137.
(5) Alain de Benoist, Presenza di Got!fried Benn, in Trasgressioni n.19, 1990, p.84.
(6) Circa la Rivolta scrive Evola a Giuseppe Laterza in una lettera da Karthaus in Alto Adige del 16 settembre 1931: “Sono in via di ultimarlo, quindi non so precisamente circa la sua lunghezza … “ (cfr. La Biblioteca ermetica, a cura di Alessandro Barbera, Fondazione J. Evola, Roma, 1997, pp.57-58).
(7) Lionel Richard, Nazismo e cultura, Garzanti, Milano, 1982, p.280.
(8) Cito in Il cammino del cinabro cit., p.138.
* * *
Tratto da Percorsi di politica, cultura, economia (6/1998).
mardi, 06 avril 2010 | Lien permanent
Quelle philosophie politique de l'écologie?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Robert STEUCKERS
Quelle philosophie politique de l'écologie?
Les bons scores des Verts français à la suite des dernières campagnes électorales dans l'Hexagone, la persistance des Grünen ouest-allemands et les sondages favorables aux listes écologistes en Belgique pour les prochaines élections (12% à Bruxelles!) obligent tous les militants politiques, de quelque horizon qu'ils soient, à développer un discours écologique cohérent. En effet, pour la décennie qui vient, pour les premières décennies du XXIième siècle, se dessine une nouvelle bipolarité entre, d'une part, les nationaux-identitaires, animés par une forte conscience historique, et, d'autre part, les Verts, soucieux de préserver le plus harmonieusement possible le cadre de vie de nos peuples. Cette bipolarisation est appelée à refouler graduellement dans la marginalité les anciennes polarisations entre partisans du laissez-faire libéral et partisans de l'Etat-Providence. C'est en tout cas ce qu'observe un professeur américain, Peter Drucker (1), dont la voix exprime des positions quasi officielles. Toutes les formes de libéralisme, malgré le sursaut tapageur des années Reagan, sont appelées à disparaître en ne laissant que les traces de leurs ravages moraux et sociaux; en effet, les impératifs de l'heure sont des impératifs globaux de préservation: préserver une conscience historique et préserver un cadre de vie concret contre les fantasmes de la «table rase» et contre le messianisme qui promet, avec un sourire vulgairement commercial, des lendemains qui chantent. Ces impératifs exigent des mobilisations collectives; dès lors, beaucoup de réflexes ne seront plus de mise, notamment l'engouement dissolvant pour l'individualisme méthodologique, propre du libéralisme, avec sa sainte horreur des obligations collectives structurantes qui, elles, parient sur le très long terme et ne veulent pas se laisser distraire par les séductions de l'instant (le «présentisme» des sociologues).
Le libéralisme politique et économique a engendré la mentalité marchande. C'est un fait. Même si d'aucuns, dans des clubs agités par une hayekite aigüe, croient pouvoir prouver que les choses auraient pu tourner autrement. On connaît le bon mot: avec des "si", on met Paris en bouteille. L'histoire est là qui montre l'involution lente mais sûre du libéralisme théorique d'Adam Smith à la déliquescence sociale totale que l'on observe chez les hooligans de Manchester ou de Liverpool, chez les consommateurs de crack du Bronx ou dans la déchéance ensoleillée et sidaïque de San Francisco. Le fantasme libéral de la perfectibilité infinie (2), qu'on lira à l'état pur chez un Condorcet, a induit les peuples à foncer bille en tête vers les promesses les plus fumeuses, dans une quête forcenée de plaisirs éphémères, de petits paradis d'inaction et de démobilisation. La jouissance hédoniste de l'instant est ainsi devenue le telos (le but) des masses, tandis que les gagneurs, plus puritains, tablaient sur la rentabilité immédiate de leurs investissements. Jouissance et rentabilité immédiates impliquent deux victimes: l'histoire (le temps), qui est oubliée et refoulée, et l'environnement (l'espace), qui est négligé et saccagé, alors que ce sont deux catégories incontournables dans toute société solidement assise, deux catégories qui résistent pied à pied aux fantasmes du «tout est possible - tout est permis» et qu'il sera toujours impossible de faire disparaître totalement.
Ce résultat navrant du libéralisme pratique, de cette vision du monde mécanique (qui a le simplisme extrême des mécaniques) et de ces suppléments d'âme moralisants (participant d'une morale auto-justificatrice, d'une morale-masque qui cache l'envie intempérante de tout avoir et tout maîtriser), nous force à adopter
1) une philosophie qui tienne compte du long terme, tout en préservant
a) les ressources de la mémoire historique, laquelle est un réceptacle de réponses acquises et concrètes aux défis du monde, et
b) les potentialités de l'environnement, portion d'espace à maintenir en bon état de fonctionnement pour les générations futures;
2) une pratique politique qui exclut les discours moralisants et manipulateurs, discours gratuits et a fortiori désincarnés, blabla phatique qui distrait et endort les énergies vitales.
Enfin, l'état du monde actuel et la bipolarisation en train de s'installer nous obligent à déployer une stratégie précise qui empêchera 1) les rescapés du bourgeoisisme libéral d'investir le camp des «identitaires historicisés» et 2) les rescapés de l'égalitarisme caricatural des vieilles gauches, vectrices de ressentiments, d'investir le camp des «identitaires éco-conscients». Cette stratégie peut paraître présomptueuse: comment, concrètement, réaliser un double travail de ce type et, surtout, comment affermir une stratégie en apparence aussi détachée des combats quotidiens, aussi régalienne parce que non partisane et non manichéenne, aussi réconciliatrice de contraires apparemment irréconciliables? Les traditions gramsciennes et la métapolitique nous ont enseigné une chose: ne pas craindre les théories (surtout celles qui visent la coincidentia oppositorum), être attentif aux mouvements d'idées, même les plus anodins, être patient et garder à l'esprit qu'une idée nouvelle peut mettre dix, vingt, trente ans ou plus pour trouver une traduction dans la vie quotidienne. Organiser une phalange inflexible d'individus hyper-conscients, c'est la seule recette pour pouvoir offrir à son peuple, pour le long terme, un corpus cohérent qui servira de base à un droit nouveau et une constitution nouvelle, débarrassée des scories d'un passé récent (250 ans), où se sont multipliés fantasmes et anomalies.
Une société de pensée a pour mission d'explorer minutieusement bibliothèques et corpus doctrinaux, œuvres des philosophes et des sociologues, enquêtes des historiens, pour forger, en bout de course, une idéologie cohérente, souple, prête à être comprise par de larges strates de la population et à s'inscrire dans la pratique politique quotidienne. Les idéologies qui nous ont dominés et nous dominent encore dérivent toutes d'une matrice idéologique mécaniciste, idéaliste, moralisante. Le libéralisme dérive des philosophies mécanicistes du XVIIIième siècle et de l'idéalisme moralisant et hédoniste des utilitaristes anglais. Ce bricolage idéologique libéral ne laissait aucune place à l'exploration féconde du passé: dans sa méthodologie, aucune place n'était laissée au comparatisme historicisant, soit à la volonté de se référer à la geste passée de son peuple pour apprendre à faire face aux défis du présent, à la mémoire en tant que ciment des communautés (où, dans une synergie holiste, éléments économiques, psychologiques et historiques s'imbriquent étroitement), si bien qu'un Jacques Bude (3) a pu démontrer que le libéralisme était un obscurantisme, hostile à toute investigation sociologique, à toute investigation des agrégats sociaux (considérés comme des préjugés sans valeur).
Par ailleurs, la philosophie linéaire de l'histoire que s'est annexée le libéralisme dans sa volonté de parfaire infiniment l'homme et la société, a conduit à une exploitation illimitée et irréfléchie des ressources de la planète. Pratique qui nous a conduit au seuil des catastrophes que l'on énumerera facilement: pollution de la Sibérie et de la Mer du Nord, désertification croissante des régions méditerranéennes, ravage de la forêt amazonienne, développement anarchique des grandes villes, non recyclage des déchets industriels, etc.
Le marxisme a été un socialisme non enraciné, fondé sur les méthodes de calcul d'une école libérale, l'école anglaise des Malthus et Ricardo. Il n'a pas davantage que le libéralisme exploré les réflexes hérités des peuples ni mis des limites à l'exploitation quantitative des ressources du globe. En bout de course, c'est la faillite des pratiques mécanicistes de gauche et de droite que l'on constate aujourd'hui, avec, pour plus bel exemple, les catastrophes écologiques des pays naguère soumis à la rude férule du «socialisme réel». A ce mécanicisme global, qui n'est plus philosophiquement défendable depuis près d'un siècle, se substituera progressivement un organicisme global. Les pratiques politico-juridiques, l'idéologie dominante des établissements, notamment en France et en Belgique, sont demeurées ancrées solidement dans le terreau mécaniciste. L'alternative suggérée par le mouvement flamand, appuyée par les sociologues de la Politieke Akademie créée par Victor Leemans à Louvain dans les années 30 (4), a été soit éradiquée par l'épuration de 1944-51 soit récupérée et anémiée par la démocratie-chrétienne soit refoulée par une inquisition têtue qui ne désarme toujours pas. Or cette alternative, et toute autre alternative viable, doit se déployer au départ d'une conscience solidissime de ses assises. Ces assises, quelles sont-elles? Question qu'il est légitime de poser si l'on veut prendre conscience de la généalogie de nos positions actuelles, tout comme les néo-libéraux avaient exhumé Adam Smith, Mandeville, Condorcet, Paine, Constant, etc. (5), au moment où ils se plaçaient sous les feux de la rampe, avec la complaisance béotienne de la médiacratie de droite. L'archéologie de notre pensée, qui conjugue conscience historique et conscience écologique, a ses propres chantiers:
1) Les textes de la fin du XVIIIième siècle, où on lit pour la première fois des réticences à l'endroit de la mécanicisation/détemporalisation du monde, portée par des Etats absolutistes/modernistes, conçus comme des machines entretenues par des horlogers (6). L'idéologie révolutionnaire reprendra à son compte le mécanicisme philosophico-politique des absolutismes. L'hystérie des massacres révolutionnaires, perçue comme résultat négatif du mécanicisme idéologique, induit les philosophes à re-temporaliser et re-vitaliser leur vision du politique et de l'Etat. Dans sa Critique de la faculté de juger (1790), Kant, auparavant exposant des Lumières, opère une volte-face radicale: les communautés politiques ne sont pas des systèmes d'engrenages plus ou moins complexes, mais des Naturprodukte (des produits de nature) animés et mus par une force intérieure, difficilement cernable par la raison. Le poète Schiller prendra le relais du Philosophe de Königsberg, popularisant cette nouvelle attention pour les faits de monde organiques. Dans ce Kant tardif, l'organicisme que nous défendons prend son envol. Intellectuellement, certains libéraux, cosmopolites et universalistes qui battent l'estrade du petit monde parisien depuis quelques années, se revendiquent d'un Kant d'avant 1790; le philosophe de Königsberg s'était pourtant bien rendu compte de l'impasse du mécanicisme désincarné... Remarquons, par ailleurs, qu'un Konrad Lorenz a puisé énormément de ses intuitions dans l'œuvre de Kant; or, ne l'oublions pas, il pourfend simultanément deux maux de notre temps, a) l'égalitarisme, stérilisateur des virtualités innombrables et «différenciantes» des hommes, et b) le quantitativisme, destructeur de l'écosystème. Notre axe philosophique part de la volte-face de Kant pour aboutir aux critiques organicistes très actuelles et pionnières de Konrad Lorenz et, depuis son décès, de l'épistémologie biologique de ses successeurs (Rupert Riedl, Franz Wuketits). De cette façon, nous formulons une double réponse aux défis de notre fin de siècle: 1) la nécessité de replonger dans l'histoire concrète et charnelle de nos peuples, pour ré-orienter les masses distraites par l'hédonisme et le narcissisme de la société de consommation, et 2) la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder l'environnement, soit la Terre, la Matrice tellurique des romantiques et des écolos...
2) La révolution épistémologique du romantisme constitue, pour nous, la carrière immense et féconde, où nous puisons les innombrables facettes de nos démarches, tant dans la perspective identitaire/nationale que dans la perspective éco-consciente. C'est un ancien professeur à la faculté des Lettres de Strasbourg, Georges Gusdorf (7), qui, dans son œuvre colossale, a dévoilé au public francophone les virtualités multiples du romantisme scientifique. Pour lui, le romantisme, dans sa version allemande, est mobilisateur des énergies populaires, tandis que le romantisme français est démobilisateur, individuo-subjectif et narcissique, comme l'avaient remarqué Maurras, Lasserre et Carl Schmitt. En Allemagne, le romantisme dégage une vision de l'homme, où celui-ci est nécessairement incarné dans un peuple et dans une terre, vision qu'il baptise, à la suite de Carus (8), anthropocosmomorphisme. Gusdorf souligne l'importance capitale du Totalorganizismus de Steffens, Carus, Ritter et Oken. L'homme y est imbriqué dans le cosmos et il s'agit de restaurer sa sensibilité cosmique, oblitérée par l'intellectualisme stérile du XVIIIième. Nos corps sont des membres de la Terre. Ils sont indissociables de celle-ci. Or, comme il y a priorité ontologique du tout sur les parties, la Terre, en tant que socle et matrice, doit recevoir notre respect. Philosophie et biosophie (le mot est du philosophe suisse Troxler) se confondent. Le retour de la pensée à cet anthropocosmomorphisme, à ce nouveau plongeon dans un essentiel concret et tellurique, doit s'accompagner d'une révolution métapolitique et d'une offensive politique qui épurera le droit et les pratiques juridiques, politiques et administratives de toutes les scories stérilisantes qu'ont laissées derrière elles les idéologies schématiques du mécanicisme du XVIIIième.
3) Dans le sillage de la révolution conservatrice, le frère d'Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger (1898-1977), publie Die Perfektion der Technik (1939-1946), une sévère critique des mécanicismes de la philosophie occidentale depuis Descartes. En 1970, il fonde avec Max Himmelheber la revue Scheidewege qui paraîtra jusqu'en 1982. Cette œuvre constitue, elle aussi, un arsenal considérable pour critiquer le fantasme occidental du progrès infini et linéaire et dénoncer ses retombées concrètes, de plus en plus perceptibles en cette fin de siècle.
4) Enfin, dans les philosophies post-modernes, critiques à l'égard des «grands récits» de la modernité idéologique, le fantasme d'un monde meilleur au bout de l'histoire ou d'une perfectibilité infinie est définitivement rayé de l'ordre du jour (9).
Dans la sphère métapolitique, qui n'est pas «sur orbite» mais constitue l'anti-chambre de la politique, la tâche qui attend cette phalange inflexible des militants hyper-conscients, dont je viens de parler, est d'explorer systématiquement les quatre corpus énumérés ci-dessus, afin de glâner des arguments contre toutes les positions passéistes qui risqueraient de s'infiltrer dans les deux nouveaux camps politiques en formation. Traquer les reliquats de libéralisme et les schématisations d'un intégrisme religieux stupidement agressif —qui relève davantage de la psychiatrie que de la politique— traquer les idéologèmes désincarnants qui affaiblissent en ultime instance le mouvement écologique, traquer l'infiltration des réflexes dérivés de la vulgate jusqu'ici dominante: voilà les tâches à parfaire, voilà des tâches qui exigent une attention et une mobilisation constantes. Mais elles ne pourront être parfaites, que si l'on a réellement intériorisé une autre vision du monde, si l'on est intellectuellement armé pour être les premiers de demain.
Robert Steuckers,
Bruxelles, 15 août 1990.
dimanche, 31 janvier 2010 | Lien permanent
Hommage à Sigrid Hunke (1913-1999)

Hommage à Sigrid Hunke (1913-1999)
« Je possède une force en mon âme, totalement et immédiatement réceptive à Dieu » (Maître Eckhart)
Le 15 juin 1999, Sigrid Hunke est retournée à la Grande Unité de la vie et de la mort. Sa vie et son œuvre ont eu et garderont une importance considérable pour notre communauté unitarienne. Nous voulons dès lors nous souvenir d’elle, ici, avec gratitude et respect. Ecoutons ses propres paroles :
Profondément enraciné !
« Lorsque je jette un regard rétrospectif, c’est toujours cette même image qui me revient, qui s’anime, si vivante, devant mes yeux, cette image qui m’a accompagnée si souvent dans la vie : un ciel immense plein de nuages sombres qui chassent, très haut au-dessus de pâturages vallonnés, où se blottissent les fermes entre de puissants châtaigniers, fouettés par la tempête. Chaque jour, je faisais le même chemin et je me pressais contre ce mur de vent invisible et, lentement, je prenais conscience de me trouver là au beau milieu de la lutte des éléments, et j’avançais ainsi sur mon chemin en solitaire… A cette époque-là, … j’ai appris ceci : tout ce qui, —à la façon de ces arbres battus par la tempête et par les averses, se maintient, tout en croissant et en portant des fruits,— doit être solidement enraciné, doit toujours, et sans cesse, puiser ses sèves profondément hors du sol de ses racines, hors de ce sol primordial et divin. Seules les occupations vides de sens, fébriles, sans ancrages solides dans la religiosité finissent lamentablement, sans résistance et dans l’indifférence, par déboucher sur ces platitudes intérieures, ce vide et cet assèchement de l’âme, propre de tout ce qui reste collé à la superficialité du monde matérialiste. Ceux qui veulent aller à l’essentiel, qui veulent créer des valeurs et se réaliser eux-mêmes dans cet acte de création, doivent sans cesse se replonger dans leurs propres profondeurs, pour offrir leur poitrine aux assauts de la vie et puiser dans cette source intérieure les forces pour lancer de nouveaux projets, afin, leur vie durant, de porter et de projeter cet essentiel dans leur vie quotidienne, dans leur profession, dans leur famille et leur communauté ».
Représenter l’unité du monde dans notre communauté, approfondir le sens de cette unité, voilà ce que fut le projet de Sigrid Hunke. Avec les mots simples que nous venons de rappeler ici, elle nous transporte au centre même de sa vision religieuse du monde, qui est aussi la nôtre. En se référant à Wilhelm Hauer et à Friedrich Schöll, elle a été pendant douze ans la vice-présidente de la « Communauté religieuse des Unitariens allemands » ; elle nous a transmis ce qui, à ses yeux, était « l’autre religion de l’Europe », la vraie religion de l’Europe, celle qui allait permettre au divin « de revenir dans sa réalité » (Schöll). Dans de nombreux écrits et discours, elle nous a explicité cette pensée et cette religiosité unitariennes, elle nous a montré son enracinement profond dans la philosophie et la théologie de l’antiquité, du moyen âge et de notre époque contemporaine. Elle nous a expliqué la profondeur et l’ampleur de cette vision unitaire de Dieu et du monde.
Comme par un coup de fanfare, Sigrid Hunke, nous a communiqué, en 1969, à Heide, dans une allocution à l’occasion d’une fête, quelles seraient les thèses fondamentales de son livre La vraie religion de l’Europe. Elle a cité un témoin majeur dans l’histoire de la pensée européenne, Nicolas de Cues : « Qu’est donc le monde sinon la manifestation du Dieu invisible ? Qu’est donc Dieu, sinon l’invisibilité du visible ? N’est-ce pas cet Un, que l’on atteint dans tout ce que l’on peut atteindre ? ».
« Le monde est le déploiement de tout ce que Dieu tient plié en lui. Dieu est le conteneur de tout ce qui se déploie en tout. Il est en tout être, sans pour autant être identique à lui ». En prononçant et en faisant siennes ces paroles de Nicolas de Cues, Sigrid Hunke oppose à la vision du monde chrétienne-dualiste, pour laquelle Dieu et le monde sont fondamentalement différents, la vision unitarienne, où Dieu et le monde sont Un, où ils forment une unitas, la seule unité qui soit.
La vie de Sigrid Hunke
Sigrid Hunke est née en 1913 à Kiel, dans la famille d’un libraire. Elle a étudié dans sa ville natale, puis à Fribourg et à Berlin, les religions comparées, la philosophie et la psychologie, la philologie germanique et l’histoire. Ses maîtres furent notamment Hermann Mandel, Martin Heidegger et Nicolai Hartmann. En 1940, elle passe sa thèse de philosophie avec Eduard Spranger. Elle épouse ensuite le futur diplomate de la RFA, Peter H. Schulze, à qui elle donnera trois enfants : un fils, actuellement professeur d’histoire contemporaine, et deux filles, l’une enseignante, l’autre médecin. Je cite ces éléments biographiques pour montrer que Sigrid Hunke, connue surtout par ses livres, n’a nullement été une philosophe enfermée dans sa tour d’ivoire, mais qu’elle a été une femme complète, épouse et mère, et qu’elle a pu incorporer ces expériences existentielles dans son œuvre. Ecoutons-la :
« Après mon Abitur, j’ai d’abord choisi une formation musicale, pour ensuite me retrouver sur les bancs de l’université et dans mon bureau personnel pour réaliser mon propre travail créatif. A part quelques compositions, j’ai ainsi écrit quelques nouvelles et romans, jusqu’au jour où j’ai été prise d’une véritablement passion pour l’essai scientifique. Chaque fois le désir d’écrire un livre de cette nature était mu par un motif très précis et une nécessité intérieure. Bien que j’ai été une enfant calme et que, très tôt, je me suis sentie attirée par la poésie et les nouvelles poétiques de Storm, Ginskey et Binding, en tant que femme mariée, je me suis sentie interpellée et provoquée par des conceptions générales et stupidement répétées que je tenais pour superficielles et irréfléchies voire pour inexactes : chaque fois, ce fut un défi profond, l’occasion de débattre et de combattre, contre moi-même et contre d’autres. Le résultat fut toujours un livre ».
Reprenons un à un ses principaux ouvrages ; nous nous apercevrons de la diversité et de la variété des intérêts de Sigrid Hunke, et aussi de sa passion pour la vérité et de sa soif de connaissances. Ainsi, en 1955 paraît Am Anfang waren Mann und Frau [= A l’origine, il y avait l’homme et la femme], une psychologie des relations entre les sexes, un livre qui a été lu dans les commissions du Bundestag, quand il s’agissait de codifier les articles assurant l’égalité en droit de l’homme et de la femme. Dans une dédicace qui m’était adressée personnellement, dans la seconde édition de ce livre, en 1987, Sigrid Hunke a écrit : « Dans le mythe germanique, les deux versions confondues, il y avait à l’origine l’Homme et la Femme, non pas comme deux principes opposés, mais comme les deux facettes d’une unité, facettes qui ont émergé en même temps et pourvues toutes deux également par les dieux d’esprit, d’âme et de force vitale ».
Dans Le Soleil d’Allah brille sur l’Occident, paru en 1960, Sigrid Hunke s’est révélée comme une grande spécialiste de la culture arabe. Le livre a été traduit en sept langues. En 1974, Sigrid Hunke est nommée membre d’honneur du « Conseil Supérieur des Questions Islamiques », en tant que femme, qu’étrangère et que non-musulmane ! Dans l’hommage qu’il lui a rendu à l’occasion de ses 70 ans, Gerd-Klaus Kaltenbrunner l’a appelée « l’ambassadrice non officielle de la culture allemande dans les pays arabes ». Son enracinement religieux dans cette vraie religion de l’Europe, l’a conduite à réfléchir sur les origines les plus lointaines des cultures et des peuples de la Terre, à reconnaître leurs spécificités et à les respecter.
Sur la jaquette de son ouvrage Das Reich und das werdende Europa [= Le Reich et l’Europe en devenir], paru en 1965, qui m’a inspiré pour mes cours d’histoire, on pouvait lire : « … seule une Europe mérite nos efforts, sera durable et témoignera d’une vitalité culturelle : celle qui héritera des meilleures traditions, puisées dans la force morale la plus originelle et la plus spécifique, force toute entière contenue dans l’idée d’Empire et dans le principe de la chevalerie ; cet héritage essentiel devra être transposé dans la nouvelle construction politique… ».
Les livres de Sigrid Hunke
Les autres livres de Sigrid Hunke ont également été essentiel pour nous :
◊ Europas andere Religion – Die Überwindung der religiösen Krise (= L’autre religion de l’Europe. Le dépassement de la crise religieuse), 1969. Ce livre fondamental a été réédité in extenso en 1997 sous le titre de Europas eigene Religion (= La religion spécifique de l’Europe) chez l’éditeur Grabert. Il a connu aussi une édition de poche en 1981 : Europas eigene Religion – Der Glaube der Ketzer (= La religion spécifique de l’Europe – La foi des hérétiques) chez Bastei-Lübbe.
◊ En 1971 paraît Das Ende des Zwiespaltes – Zur Diagnose und Therapie einer kranken Gesellschaft (= La fin de la césure dualiste – Diagnostic et thérapie d’une société malade).
◊ En 1979, parution d’un autre ouvrage fondamental, toujours dans la même trajectoire : Glauben und Wissen. Die Einheit europäischer Religion und Naturwissenschaft (= Foi et savoir. L’unité de la religion européenne et des sciences naturelles).
◊ Chez Seewald en 1974 paraît un manifeste : Das nachkommunistische Manifest – Der dialektische Unitarismus als Alternative (= Le manifeste post-communiste – L’unitarisme dialectique comme alternative). L’“Association internationale des femmes-philosophes”, à laquelle appartenait Sigrid Hunke, a été fort enthousiasmé par la parution de ce manifeste et a demandé à l’auteur de le rendre plus accessible au grand public. L’association y voyait l’ébauche d’un monde futur.
◊ En 1986, Sigrid Hunke publie Tod, was ist dein Sinn ?, ouvrage sur le sens de la mort (cf. la recension de Bertrand Eeckhoudt, « Les religions et la mort », in : Vouloir, n°35/36, janv.-févr. 1987).
◊ En 1989, paraît Von Untergang des Abendlandes zum Aufgang Europas – Bewußtseinswandel und Zukunftsperspektiven (= Du déclin de l’Occident à l’avènement de l’Europe – Mutation de conscience et perspectives d’avenir). Sur la jaquette du livre, Sigrid Hunke est décrite comme un « Spengler positif », vu son inébranlable foi en l’avenir : « Dans un processus monstrueux de fusion et de recomposition, l’Occident chrétien est en train de périr inexorablement dans ses valeurs et ses structures, on aperçoit déjà partout, —entre les ruines et les résidus des vieilles structures dualistes, dangereusement hostiles les unes aux autres, se diffamant mutuellement,— poindre les nouveaux développements évolutifs d’une Europe future. Celle-ci reposera sur la loi essentielle d’unicité et d’holicité tapie originellement au fond de l’homo europaeus et se déployant dans tous les domaines humains et culturels. Ceux-ci reviendront à eux-mêmes et, grâce à un ancrage plus profond dans leur propre spécificité, s’élèveront puissamment à un niveau de culture supérieur ».
Les affirmations contenues dans ce livre, l’attitude positive de Sigrid Hunke, nous apparaissent comme un défi, comme un appel que nous avons le devoir de suivre.
Sigrid Hunke a reçu plusieurs prix et distinctions honorifiques pour ses travaux, dont la « Kant-Plakette » en 1981 et le « Prix Schiller du Peuple allemand » en 1985. Elle était aussi la Président de la « Communauté religieuse des Unitariens allemands ».
En tant qu’Unitariens, nous avons été renforcés dans nos convictions par la personnalité et l’œuvre de Sigrid Hunke. Surtout Europas eigene Religion / La vraie religion de l’Europe a été pour nous un guide permanent, un fil d’Ariane dans l’histoire spirituelle de notre continent. Pour nous, Sigrid Hunke demeurera inoubliable et immortelle.
Bernhard BÜHLER,
Au nom de la « Ligue des Unitariens allemands ».
(Hommage paru dans Glauben und Wirken, juillet-août 1999).dimanche, 30 décembre 2007 | Lien permanent
Over Oswald Spengler (NL)

TEKOS:
Over de actualiteit van Oswald SPENGLER
De Duitse denker Oswald Spengler (1880-1936) weet al vanaf de Eerste Wereldoorlog conservatieve cultuurcritici te inspireren. Tegenwoordig wordt hij zelfs als "groene" onheilsprofeet omarmd. Het oude Europa is gevoeliger voor cultuurpessimisme dan voor het "vooruitgangsgeloof", schrijft de germanist Jerker Spits.
De oude dame Europa lijkt om de zoveel jaren vatbaar voor de koorts van het cultuurpessimisme. Ook nu weer is er sprake van een herleving. Hedendaagse conservatieve denkers mogen daarbij graag teruggrijpen op de Duitse filosoof Oswald Spengler, die als geen ander verlangde naar een herstel van oude tradities die in de moderne maatschappij verloren waren gegaan.
In zijn jonge jaren was Oswald Spengler een romanticus. Maar zoals veel Duitse dichters en denkers ontwaakte hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. "Ik verbaas me er nog steeds over", zou hij later schrijven, "hoe ik tot mijn vijfentwintigste in een droom leefde. Hulpeloos, angstig, maar toch gelukkig. Wat heb ik toen niet allemaal opgeschreven!"
Na de oorlog eiste Spengler van zijn land een radicale en meedogenloze aanpassing aan de rationele, technische tijd. Hij treurde niet langer om wat verloren ging. De mens moest de nieuwe krachten van zijn tijd omarmen. Vanaf zijn dertigste zou hij zijn tijdgenoten provoceren met een loflied op de techniek. "Voor de prachtige, zeer intellectuele vormen van een snel stoomschip of een staalfabriek geef ik alle rommel van de huidige kunstnijverheid inclusief schilderkunst en architectuur weg.”
Spengler leefde als privégeleerde in München. Hij meed de artistieke kringen van de Beierse hoofdstad. Zijn zelfgekozen isolement en afkeer van de Münchense bohémien is opmerkelijk als je bedenkt welke grootheden zich daar in die tijd ophielden: de schrijvers Thomas en Heinrich Mann, de dichters Stefan George en Rainer Maria Rilke, de kunstenaars Alfred Kubin, Franz von Stuck, Wassily Kandinsky, Paul Klee. Maar geen van hen beschouwde Spengler als zijn gelijke. Ook in Thomas Mann zag Spengler een decadente romanticus, een kunstenaar die niet met zijn tijd was meegegaan. Werk ging bij hem sowieso voor vriendschap. In de gedachtenwisseling met artistieke tijdgenoten was hij niet bijzonder geïnteresseerd. Ik spreek nog liever met een meisje dat ik van de straat pluk, dan met die kunstenaarsbende.”
 Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”
Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”
De mens moest volgens hem zijn leven aanpassen aan de ontwikkelingsfase van de cultuur. De belangen van het individu waren ondergeschikt aan het collectief waartoe hij behoorde.
"Der Untergang" gaat uit van het onderscheid tussen Kultur en Zivilisation. Spengler volgde hierin een specifiek Duitse traditie die sinds het einde van de negentiende eeuw vorm had gekregen. In de Eerste Wereldoorlog zagen jonge Duitsers zich als de verdedigers van de "ideeën van 1914" – de cultuur. Zij verdedigden die tegenover de "ideeën van 1789" – de civilisatie. Duitsland moest naast een oorlog ook een geestelijke strijd voeren: tegen Russische barbaren in het Oosten en tegen materialisme en winstdenken in het Westen. Duitsland zou het Westen moeten redden van de Angelsaksische kruideniersgeest en ontspoorde vrijheid. De "civilisatie" van langs elkaar levende individuen stond tegenover de "cultuur" waarin de mens de band met de gemeenschap, het verleden en de eigen natie levend houdt.
Spengler was verklaard tegenstander van de Zivilisation. Kwantiteit zou het daarin afleggen van kwaliteit. De Gemeinschaft zou plaats maken voor de Gesellschaft. De mens zou een "intellectuele nomade" worden, omdat hij niet langer leefde in het besef onderdeel van een gemeenschap te zijn.
Dit wereldbeeld was in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog niet ongewoon. Ook Thomas Mann verklaarde in zijn "Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918) dat democratie, politiek zelf "het Duitse wezen" vreemd is. Mann schreef "De Duitse aard, dat is cultuur, ziel, vrijheid en niet civilisatie, maatschappij, stemrecht, literatuur." Later schreef de Nobelprijswinnaar niet zonder ironie: De overwinning van Engeland en Amerika bezegelt en beëindigt het lot van onze ouder wordende cultuur. Wat nu volgt, is de Angelsaksische wereldheerschappij, dat betekent de volmaakte civilisatie. Waarom niet? Men kan er comfortabel in leven.”
Maar niet iedereen kon deze stap nemen. Het Duitse Bildungsbürgertum klampte zich vast aan de Duitse Kultur – en vond in Spengler zijn intellectuele leidsman.
Oswald Spengler was overtuigd van zijn missie. Ik had als kind al het idee dat ik een soort van Messias moest worden. Een nieuwe zonnereligie stichten, een nieuw Duitsland, een nieuwe Weltanschauung.” Van valse bescheidenheid had Spengler geen last: Ik schrijf het beste Duits, dat op dit moment in boeken te lezen is.”
In zijn brieven en dagboekaantekeningen lijkt hij zijn grote voorbeeld Friedrich Nietzsche naar de kroon te willen steken. En net als zijn voornaamste inspirator werd Spengler geplaagd door langdurige depressies. Niemand weet wat het betekent met zulke ideeën te vechten, waarvan de bittere ernst de zelfmoord dichterbij brengt, dagenlang geen woord te spreken, geen ander mens te zien. En dan, in de uiterste terneergeslagenheid, wijn, muziek of een paar schrijvers (Shakespeare, Baudelaire, Hoffmann) te hebben. Wat heb ik door die eenzaamheid niet verloren! Hoeveel energie, die ik anders aan andere dingen had kunnen besteden!”
Toen het eerste deel van "Der Untergang des Abendlandes" in 1918 verscheen, raakte intellectueel Duitsland in Spenglers ban. Alle belangrijke Duitse intellectuelen namen kennis van het boek. Thomas Mann prees het in de hoogste bewoordingen. De filosoof Georg Simmel noemde het de belangrijkste geschiedenis van de filosofie sinds Hegel”. Kritiek was er uit de hoek van egyptologen en oriëntalisten die zich beklaagden over onnauwkeurigheden in Spenglers beschrijving van de wereldgeschiedenis. Maar de honderdduizenden lezers schoven deze professorale kritiek spottend terzijde. Het ging hen niet om de verschillen tussen de vijfde en zesde Egyptische dynastie.
Het Duitse Bildungsbürgertum had omstreeks 1920 het idee dat er na Goethe, Schiller en Nietzsche een verval was ingetreden. In de ogen van veel lezers was er geen andere auteur dan Oswald Spengler die dit zo treffend wist te verwoorden. Al snel werden hem leerstoelen aangeboden. Spengler wees deze handreikingen vriendelijk maar beslist af. Hij wilde geen gewone geleerde zijn. Intellectuele vrijheid ging bij hem boven maatschappelijke status. Bovendien verafschuwde Spengler de academische filosofie van zijn tijd haast net zo hevig als Schopenhauer dit een eeuw voor hem had gedaan. "Filosofische vakwetenschap is filosofische onzin.”
Veel lezers duidden Spenglers boek als een schets van de ondergang van de westerse wereld. Alsof Spengler vol nostalgie zou hebben teruggeblikt op verloren erfgoed. Maar van deze romantische visie wilde Spengler na de Eerste Wereldoorlog juist afscheid nemen.
In de jaren twintig vroeg een rijke Duitse Spengler om raad: waar moest zij, nu de westerse wereld spoedig zou ondergaan, haar aandelen onderbrengen? Al in 1921 klaagde Spengler over het modewoord ’ondergang’ als gevolg van zijn titelkeuze. (Het is veelzeggend dat het woord ontbreekt in de oorspronkelijke titel van het werk: "Konservativ und liberal".) Hij schreef immers niet alleen over wat verdween, maar ook over wat nieuw was en de toekomst zou bepalen.
Spengler zag de wereld om hem heen veranderen. Bildung, geestelijke aristocratie en esthetische fijnzinnigheid verdwenen in een maatschappij die voor de wetten van de markt boog. De mens, het door Goethe en Humboldt geprezen vrije en zelfbewuste individu, ging op in de massa, werd gereduceerd tot consument en arbeidskracht.
Tussen de werkelijkheid van alledag en de idealen van de Duitse gymnasia gaapte volgens Spengler een onoverbrugbare kloof. De opkomst van de massamaatschappij, de groeiende rol van volkse sentimenten baarden hem zorgen. De moderne massamedia zouden de mens een illusie van vrijheid geven, maar hem in werkelijkheid op geraffineerde wijze tot slaaf maken. Eens durfde men niet vrij te denken; nu mag men het, maar kan het niet meer.”
Niet zonder reden wordt Oscar Spengler wel beschouwd als een van de "geestelijke wegbereiders" van het nationaal-socialisme. Daarmee deelde hij immers de afkeer van de slappe Weimarrepubliek en de voorliefde voor het krachtige Pruisendom. Maar vrijwel onmiddellijk na de machtsovername van Hitler in 1933 viel de filosoof in ongenade. En ook Spengler zelf nam al snel afstand van het nieuwe regime, in zijn boek "Jahre der Entscheidung". Wat de nationaal-socialisten bovenal in Spengler hinderde was zijn afwijzing van ieder vooruitgangsidealisme. Het gevolg was dat zijn boeken en denkbeelden niet meer in het openbaar genoemd mochten worden.
Zijn ster verbleekte. Op 8 mei 1936, kort voor zijn 56ste verjaardag, stierf hij aan een hartaanval. Na 1945 raakte de filosoof meer en meer in vergetelheid.
In de optimistische jaren negentig, na de val van het communisme, leek de ondergang van het Avondland verder weg dan ooit. Francis Fukuyama voorspelde in "Het einde van de geschiedenis" de verdere zegetocht van de westerse democratie en het liberalisme.
Na 11 september 2001 kwam hier verandering in. Er bleken andere culturen die de westerse hegemonie betwistten. En in het Avondland zelf ging de aandacht steeds meer uit naar de schaduwzijden van de massademocratie. Mondigheid zou zijn ontaard in brutaliteit en schaamteloosheid, het ter discussie stellen van autoriteit zou burgers hebben wijsgemaakt dat regels altijd en overal moeten worden aangevochten, de "massacultuur" zou de democratie "verzwelgen".
Het werk van Spengler werd langzaam herontdekt. Ook onder hedendaagse cultuurfilosofen leeft kritiek op de massacultuur, op de genivelleerde maatschappij, waarin de meerderheid niet alleen beslist over de zetels in het parlement, maar ook over de collectieve moraal. En je hoeft Spenglers antwoorden – een vlucht naar voren, de "roofdiermens" als de enig mogelijk overgebleven "hogere" vorm van leven – niet te beamen om de geldigheid van zijn tijdsdiagnose te onderkennen.
Een groeiend aantal intellectuelen staat wantrouwend tegenover de wil en de smaak van de massa. Zij richten hun pijlen op de mondiale "gelijkschakeling". Overal verschijnen dezelfde merken, dezelfde levensstijlen, eenzelfde vrijgevochten manier van denken, verdwijnen tradities ten gunste van geldelijk gewin of persoonlijke geldingsdrang.
De Nederlandse filosoof Ad Verbrugge spreekt in zijn bestseller "Tijd van onbehagen" in vergelijkbare termen als Spengler over de schaduwzijden van globalisering en de ongeremde werking van de vrije markt. Soms met nogal overtrokken commentaar. Zo is de huidige liberale consumptiemaatschappij volgens Verbrugge even totalitair als het fascisme en het communisme”.
Ook voor de Franse filosoof Alain Finkielkraut is de moderne massacultuur gespeend van alle grote gedachten – een geestelijk barbarendom, maar burgerlijk en comfortabel ingericht, zoals Spengler het al beschreef. De waarschuwende roep van Spengler is eveneens bij Finkielkraut hoorbaar: nog teert het Westen op zijn rijke verleden, maar eens zal de beschaving, als zij niet door haar culturele elite verdedigd wordt, onder daverend geruis ineenstorten. Dankbaar grijpt Finkielkraut de plunderingen van jonge Arabieren in de Parijse voorsteden aan: de barbaren staan aan de poorten van de stad.
Sommigen zien in deze conservatief geïnspireerde cultuurkritiek een terugkeer naar riskante denkpatronen en een hang naar obscurantisme. Zij bekritiseren de hang naar traditie, naar oude zekerheden, de revitalisering van het christelijk geloof, de terugkeer naar het denken over geschiedenis als "heilsgeschiedenis".
En de affiniteit met Spenglers tijdsdiagnose blijft geenszins beperkt tot conservatieve denkers. Al in 1997 haalde De Groene Amsterdammer Spengler van zolder, om te waarschuwen tegen een "pulpdemocratie" waarin "de emoties van de massa regeren". De banvloek die progressieve intellectuelen na de Tweede Wereldoorlog over Duitse denkers uitspraken, is gebroken. Ook in Duitsland zelf is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor Spengler, onder wetenschappers én bij filosofen als Peter Sloterdijk.
De laatste jaren wordt Spengler ook gezien als een ’groene’ onheilsprofeet avant la lettre. Voorzag hij niet al in 1918 de "ondergang" van onze leefomgeving, waarschuwde hij dus eigenlijk niet al voor de opwarming van de aarde en de gekkekoeienziekte? De receptie van zijn werk is daarmee terug bij af. Hij is niet meer dan de leverancier van een trefwoord waaraan je je eigen angsten kunt verbinden.
Toch blijft Spengler een ongemakkelijk denker. Vooral zijn instinctieve afkeer van het verstand is problematisch. Hij enthousiasmeert en vervoert méér dan dat hij overtuigt. Spengler was een metafysicus en zag zichzelf als dichter-filosoof. Hij hechtte meer waarde aan een esthetische blik dan aan strenge logica. Tijdgenoten zagen in hem niet ten onrechte een nieuwe Nietzsche, met alle gevaren van dien.
Als een van de eerste Europese filosofen richtte Spengler zijn blik op niet-westerse culturen en voorspelde hun opkomst. Maar voor de steeds belangrijker rol van Amerika bleef hij blind. Hij voorzag niet dat uitgerekend de door hem zo verafschuwde massademocratie en vrije markt een wereldmacht zou voortbrengen.
Johan Huizinga merkte al op dat het Angelsaksische deel van de wereld slechts in geringe mate gevoelig is voor ondergangsfantasieën. Ook nu lijkt het oude Europa gevoeliger voor een spengleriaans cultuurpessimisme dan voor een vooruitgangsgeloof zoals dit door Fukuyama werd uitgedragen en door de huidige Amerikaanse president wordt gekoesterd. Aan de horizon van George W. Bush gloort een universele civilisatie naar Amerikaans model.
Fukuyama schijnt intussen zijn bekomst te hebben gekregen van het neoconservatieve geloof van zijn president. Zijn verre Duitse voorganger was er al langer van overtuigd dat alleen opkomst en ondergang werkelijk bestaan. Wie een keer over het Forum van Rome heeft gewandeld, moet beseffen dat het geloof in een eeuwig voordurende vooruitgang een waanbeeld is”.
De Nederlandse schrijver en essayist Menno ter Braak (1902-1940) bezocht in maart 1935 een lezing van Oswald Spengler aan de Leidse universiteit. De zaal zat "propvol". Men was dus gekomen om Oswald Spengler te zien, meer nog dan om hem te horen waarschijnlijk. Het zijn vaak de philosophen van de heroische ondergang der cultuur, die het meeste publiek trekken, omdat zij profeteren.” Een briljant spreker was Spengler volgens Ter Braak niet. Hij spreekt zoals zijn gehele uiterlijk is: als een superieure schoolmeester, die zijn publiek iets doceert. Geen enkel effect, ook geen spoor van rhetoriek; bijna onbeweeglijk staat Spengler achter de lessenaar. [...] Even knipperen de oogleden, als er duizend jaar achteloos in de zaal worden geslingerd; een handbeweging is dat niet eens waard.”
Na Spenglers overlijden, een klein jaar later, schrijft Ter Braak: Zijn dood betekent voor Europa het verlies van een onafhankelijke geest, een onverzoenlijke aristocraat van de militaire soort, die zijn verachting voor de massa en de massabijeenkomst [...] eens uitdrukte door de woorden: "Den Neandertaler sieht man in jeder Volksversammlung". Het is dit soort stramme aristocratie, die langzaam maar zeker romantisch wordt en uitsterft. In Spengler beleefde zij een verbintenis met de geest en het aesthetisch raffinement, die vermoedelijk na hem niet vaak meer zal voorkomen.
lundi, 21 janvier 2008 | Lien permanent | Commentaires (1)
Gottfried Benn und sein Denken

Gottfried Benn und sein Denken
Bewährungsprobe des Nationalismus
Arno Bogenhausen
Ex: http://www.hier-und-jetzt-magazin.de/
Eine neuerschienene Biographie des Dichterphilosophen gibt uns Anlaß, über das Verhältnis von nationalem Bekenntnis und geistigem Solitär nachzudenken. Gunnar Decker, der mit seiner Arbeit weit mehr bietet als Raddatz („Gottfried Benn, Leben – niederer Wahn“) und auch gegenüber Helmut Lethens gelungenem Werk („Der Sound der Väter“) einen Zugewinn erbringt, ist als Angehöriger des Jahrgangs 1965 eindeutiger Nachachtundsechziger, damit weniger befangen und im Blick getrübt als die Vorgänger. Bei ihm finden sich Unkorrektheiten wie die beiläufige Bemerkung: „Es gehört zur Natur der Politik, daß sie jeden, egal wie gearteten, Gedanken konstant unter Niveau verwirklicht.“ Dennoch sind auch für ihn Benns Berührungen mit dem Nationalsozialismus und die folgende „aristokratische Form der Emigration“ im Offizierskorps der Deutschen Wehrmacht ein Grund zu längerer Reflexion; allein drei der sechs Kapitel sind den Jahren des Dritten Reiches gewidmet.
Benns Hinwendung zum NS, die 1933 in Rundfunkreden, Aufsätzen und dem Amt des Vizepräsidenten der „Union nationaler Schriftsteller“ zum Ausdruck kam, ist unbestritten. Sie war nicht äußerer Anpassung geschuldet, sondern beruhte auf der Überzeugung, an einer historisch folgerichtigen Wende zu stehen. Der Verächter des Fortschrittsgedankens und jeder programmatischen Erniedrigung des Menschen hoffte, „daß ein letztes Mal im Nachklang ferner dorischer Welten Staat und Kunst zu einer großen, einander begeisternden Form fänden“ (Eberhard Straub). Am 23. 9. 1933 schrieb er einer Freundin in die Vereinigten Staaten, „daß ich und die Mehrzahl aller Deutschen … vor allem vollkommen sicher sind, daß es für Deutschland keine andere Möglichkeit gab. Das alles ist ja auch nur ein Anfang, die übrigen Länder werden folgen, es beginnt eine neue Welt; die Welt, in der Sie und ich jung waren und groß wurden, hat ausgespielt und ist zu Ende.“
Diese Haltung wird ihm bis heute zum Vorwurf gemacht. Es beginnt 1953 mit Peter de Mendelssohns Buch „Der Geist der Despotie“, in dem zugleich Hamsun und Jünger in Moralin getaucht werden. Sehr schön liest sich bei Decker, warum die Vorwürfe ihr Thema verfehlen: „Auf immerhin fast fünfzig Seiten wird Benns Versagen behandelt, das letztlich in seinem Unwillen gegen ein moralisches Schuldeingeständnis gründet. Das überzeugt den Leser nur halb, denn de Mendelssohn argumentiert fast ausschließlich moralisch – und da fühlt Benn sich immer am wenigsten gemeint. In diesem Buch klingt einem ein Ton entgegen, wie später bei den 68ern mit ihrer ebenso ekstatischen wie pauschalen Anklage der Vätergeneration. Oder auch – auf anderer Ebene – wie bei manchem DDR-Bürgerrechtler, dem die DDR abhanden gekommen ist und der darum aus seinem Bürgerrechtssinn eine Ikone macht, die er pflegt.“
Benn hat seinen zahllosen Interpreten, die nach Erklärungen suchten, ihre Arbeit kaum erleichtert. Tatsächlich sind weder gewundene Rechtfertigungsversuche noch tiefenpsychologische Studien, wie sie Theweleit betrieb, vonnöten, um das angeblich „Unverständliche“ zu deuten. Der Denker selbst hat 1950 in öffentlicher Ansprache eine ganz schlichte, in ihrer Einfachheit allen Theorienebel beiseite fegende Aussage getroffen: „Es war eine legale Regierung am Ruder; ihrer Aufforderung zur Mitarbeit sich entgegenzustellen, lag zunächst keine Veranlassung vor.“
Das eigentliche Problem liegt somit nicht in Benns Entscheidung, mit der er – auch unter Intellektuellen – nun wirklich nicht alleine stand, sondern in der Unfähigkeit der Verantwortlichen, mit ihr umzugehen. Klaus Mann stellte als inzwischen ausländischer Beobachter nicht ohne Befriedigung fest: „seine Angebote stießen auf taube bzw. halbtaube Ohren … Benn hört vor allem deshalb auf, Ende 1934, Faschist zu sein oder zu werden, weil es keine passende Funktion für ihn gibt im nationalsozialistischen Züchtungsstaat.“
Vom NS-Ärztebund, der diskriminierende Anordnungen erließ, über fanatische Zeitungsschreiber, die ihm ungenügende völkische Gesinnung attestierten, bis zu Funktionären, denen der Expressionismus insgesamt undeutsch vorkam, schlug ihm Ablehnung entgegen. Seine virile Unbefangenheit in sexuellen Angelegenheiten wurde ihm 1936 von einem Anonymus im „Schwarzen Korps“ verübelt: „er macht auch in Erotik, und wie er das macht, das befähigt ihn glatt zum Nachfolger jener, die man wegen ihrer widernatürlichen Schweinereien aus dem Hause jagte.“ Benn sah sich danach zu der ehrenwörtlichen Erklärung gezwungen, nicht homophil zu sein. Die Parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutze des nationalsozialistischen Schrifttums hielt der Deutschen Verlags-Anstalt vor, „völlig überholte Arbeiten“ zu publizieren und übermittelte der Geheimen Staatspolizei, Gedichte Benns zeugten von „pathologischer Selbstbefleckung“, weshalb zu bedenken sei, „ob der Verleger nicht zur Rechenschaft gezogen werden soll“. Ein mit der „Säuberung“ der Kunst befaßter Maler-Autor warf ihm „Perversitäten“ vor, die an „Bordellgraphik und Obszönitätenmalerei“ erinnerten; es sei angebracht, seine Aufnahme in das Offizierskorps „rückgängig zu machen“. Boshafte Unterstellungen gipfelten darin, seinen Familiennamen auf das semitische „ben“ zurückzuführen und ihm eine jüdische Herkunft anzudichten. Lediglich seinem Fürsprecher Hanns Johst, der bei Himmler intervenierte, verdankte Benn, nicht mit weiterreichenden Maßnahmen überzogen zu werden.
Worum es hier geht, ist nicht die Beweinung eines „dunklen Kapitels deutscher Geschichte“. Benn selbst schrieb 1930 an Gertrud Hindemith: „Vergessen Sie nie, der menschliche Geist ist als Totschläger entstanden und als ein ungeheures Instrument der Rache, nicht als Phlegma der Demokraten, er galt dem Kampf gegen die Krokodile der Frühmeere und die Schuppentiere in den Höhlen – nicht als Puderquaste“. Die Agonalität des Lebens war ihm vertraut, und angesichts der Praxis heutiger Bürokratien, die mißliebige Geister einer durchaus größeren Drangsal überantworten, als sie ihm widerfuhr, soll auch nicht leichthin der Stab über eine „offene Diktatur“ gebrochen werden. Daß aber die einmalige Gelegenheit vertan wurde, eine Persönlichkeit dieses Grades für den neuen Staat zu gewinnen, war kaum verzeihlich. Jene Nationalsozialisten, die Benn schlechthin verwarfen, begaben sich – man muß es so hart sagen – auf das Niveau des Bolschewismus herab. In kleinbürgerlich-egalitären Horizonten und ideologisch miniaturisierten Maßstäben befangen, erkannten sie nicht, daß ihnen ein Großer gegenüberstand, dessen Werk – was immer man im einzelnen ablehnen mag – den Deutschen zur Ehre gereichte. (Dasselbe gilt für eine Reihe weiterer, die alles andere als vaterlandslose Gesellen waren, aber ins Abseits gerieten; man denke nur an George, Jünger, Niekisch, Schmitt und Spengler, von dem übrigens Benn schon 1946 schrieb, er „wäre heute genauso unerwünscht und schwarzbelistet wie er es bei den Nazis war“.)
Das traurige Bild, das der Nationalsozialismus in diesem Punkte abgab, wird besonders deutlich im Vergleich mit dem faschistischen Italien, das es verstand, die vitalen Impulse des Futurismus aufzunehmen und in seine vorbildliche Pluralität zu integrieren. Benn versuchte in mehreren Aufsätzen, die futuristische Idee auch den Berliner Staatsmännern schmackhaft zu machen. Als Marinetti, der Verfasser des Futuristischen Manifestes, in seiner Eigenschaft als Präsident des italienischen Schriftstellerverbandes Berlin besuchte und ihm zu Ehren ein Bankett gegeben wurde, hielt Benn in Vertretung für Hanns Johst die Laudatio. Doch sein Mühen blieb vergeblich. Unterlagen doch selbst die weit weniger buntscheckigen Expressionisten, um deren Bewertung zunächst noch ein innernationalsozialistischer Richtungsstreit tobte, den Dogmatikern des Volkstümlichen.
Nach der sog. „Niederschlagung des Röhm-Putsches“ schreibt Benn seinem Lebensfreund Friedrich Wilhelm Oelze: „Ein deutscher Traum, wieder einmal zu Ende.“ Später wird er die Gebrechen des nationalsozialistischen Staates so beschreiben: „Ein Volk will Weltpolitik machen, aber kann keinen Vertrag halten, kolonisieren, aber beherrscht keine Sprachen, Mittlerrollen übernehmen, aber faustisch suchend – jeder glaubt, er habe etwas zu sagen, aber keiner kann reden, – keine Distanz, keine Rhetorik, – elegante Erscheinungen nennen sie einen Fatzke, – überall setzen sie sich massiv ein, ihre Ansichten kommen mit dicken Hintern, – in keiner Society können sie sich einpassen, in jedem Club fielen sie auf“.
Dennoch schließt sich Benn nach 1945 nicht den Bewältigern an. Seine Rückschau bleibt auf wenige Anmerkungen beschränkt und verfällt zu keiner Zeit in Hyperbeln. „Der Nationalsozialismus liegt am Boden, ich schleife die Leiche Hektors nicht.“ Die von den Siegern geschaffene Nachkriegsordnung analysiert er nicht weniger beißend: „Ich spreche von unserem Kontinent und seinen Renovatoren, die überall schreiben, das Geheimnis des Wiederaufbaus beruhe auf ‚einer tiefen, innerlichen Änderung des Prinzips der menschlichen Persönlichkeit’ – kein Morgen ohne dieses Druckgewinsel! –, aber wo sich Ansätze für diese Änderung zeigen wollen, setzt ihre Ausrottungsmethodik ein: Schnüffeln im Privat- und Vorleben, Denunziation wegen Staatsgefährlichkeit … diese ganze bereits klassische Systematik der Bonzen-, Trottel- und Lizenzträgerideologie, der gegenüber die Scholastik hypermodern und die Hexenprozesse universalhistorisch wirken“.
Anwürfe seiner „jüngsten Vergangenheit“ wegen lassen ihn kalt. Einem denunzierenden Journalisten teilt er mit: „Über mich können Sie schreiben, daß ich Kommandant von Dachau war oder mit Stubenfliegen Geschlechtsverkehr ausübe, von mir werden Sie keine Entgegnung vernehmen“. Und entschuldigt hat er sich nie.
Völlig falsch wäre es, Benns Haltung gegenüber dem NS als die eines Linksstehenden begreifen zu wollen. Was ihn von parteiförmigen Nationalsozialisten unterschied, läßt sich in derselben Weise von seinem Verhältnis zu den linksgerichteten Elementen sagen: eine erhabene Position gegenüber geistiger Konfektionsware und ein Bestehen auf der ehernen Reinheit des Wortes, das nicht im trüben Redefluß der Gasse untergehen soll. Im Todesjahr schreibt er: „Im Anfang war das Wort und nicht das Geschwätz, und am Ende wird nicht die Propaganda sein, sondern wieder das Wort. Das Wort, das bindet und schließt, das Wort der Genesis, das die Feste absondert von den Nebeln und den Wassern, das Wort, das die Schöpfung trägt.“
Bereits 1929 erregte Max Hermann-Neiße mit einer Rezension in der linksgerichteten „Neuen Bücherschau“ Aufsehen, in der er Benn anläßlich des Erscheinens seiner „Gesammelten Prosa“ so charakterisierte: „Es gibt auch in dieser Zeit des vielseitigen, wandlungsfähigen Machers, des literarischen Lieferanten politischer Propagandamaterialien, des schnellfertigen Gebrauchspoeten, in ein paar seltenen Exemplaren das Beispiel des unabhängigen und überlegenen Welt-Dichters, des Schöpfers eines nicht umfangreichen, aber desto schwerer wiegenden Werkes, das mit keinem anderen zu verwechseln ist.“ In dieser Distanz zur politischen Reklame liege aber nicht – und dies ist der entscheidende Punkt – ein Mindermaß an Radikalität, sondern vielmehr eine Größe, die weit über das kleinliche Tagesgeschehen hinausgehe: „Er macht den Schwindel nicht mit. Den hurtige, auf billigen Erfolg versessene Schreiber dieser niveaulosen Epoche schuldig zu sein glauben, sich dümmer stellen, als sie sind, und mit biederer Miene volkstümlich zu reden, wenn einem der Schnabel ganz anders und viel komplizierter wuchs. Und bleibt mit einem Stil, der das Gegenteil von populär ist, zuverlässiger, weiter gehend und weiter wirkend Revolutionär, als die wohlfeilen, marktschreierischen Funktionäre und Salontiroler des Propagandabuntdrucks. Statt des gewohnten ‚kleinen Formats’ der Sekretäre eines politischen Geplänkels um Macht- und Krippenvorteile spricht hier ein Rebell des Geistes, ein Aufruhrphilosoph, der in Kulturkreisen denkt und mit Jahrhundertputschen rechnet.“ Hermann-Neißes Darstellung rief bei den Kollegen des Redaktionskollegiums, den KPD-Funktionären Kisch und Becher, Empörung hervor. Beide traten unter verbalen Kanonaden aus der Schriftleitung aus, womit sie nachträglich bewiesen, zu eben jenen zu gehören, die kritisiert worden waren.
Zu einem gleichartigen Vorfall kam es zwei Jahre später, als Benn eine Rede zum sechzigsten Geburtstag Heinrich Manns auf einem Bankett des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller hielt und wenig später einen Essay über den Literaten veröffentlichte. Obgleich er viel Lobenswertes an ihm fand, bewies er erneut seinen klaren Blick, indem er feststellte, „daß harmlose junge Leute bei ihm den Begriff des nützlichen Schriftstellers ausliehen, mit dem sie sich etwas Rouge auflegten, in dem sie ganz vergehen vor Opportunismus und Soziabilität. Beides, was für Verdunkelungen!“ Nun war es so weit: beginnend mit dem schriftstellernden Architekten Werner Hegemann wurde das Etikett des „Faschisten“ an Benns tadellosen Anzug geklebt.
Der so Entlarvte antwortete mit einem Artikel in der „Vossischen Zeitung“ und mokierte sich, ob es ein Verbrechen sei, den Dichter als Dichter und nicht als Politiker zu feiern. „Und wenn man das in Deutschland und auf einem Fest der schriftstellerischen Welt nicht mehr tun kann, ohne von den Kollektivliteraten in dieser ungemein dreisten Weise öffentlich angerempelt zu werden, so stehen wir allerdings in einer neuen Metternichperiode, aber in diesem Fall nicht von seiten der Reaktion, sondern von einer anderen Seite her.“
Noch Jahre später, als Benn im Reich schon auf verlorenem Posten stand, versäumten es marxistische Ideologen nicht, ihn zu attackieren. 1937 brachte Alfred Kurella, der es einmal zum DDR-Kulturfunktionär bringen sollte, im Emigrantenblatt „Das Wort“ seine „Entrüstung“ über Benn zum Ausdruck und stellte fest, der Expressionismus sei „Gräßlich Altes“ und führe „in den Faschismus“.
Benn hatte seine weltanschauliche Verortung schon im Januar 1933 auf den Punkt gebracht, als eine linkstotalitäre Phalanx unter Führung Franz Werfels in der Deutschen Akademie den Antrag stellte, man müsse gegen Paul Fechters „Dichtung der Deutschen“ mit einem Manifest vorgehen. (Decker hierzu: „Nimmt man heute Paul Fechters Buch zur Hand, schüttelt man erstaunt den Kopf … Das große Skandalon, den Haß, die Geistfeindschaft, den Rassismus, gegen die eine ganze Dichterakademie glaubte protestieren zu müssen, sucht man in dem Buch vergeblich.“) Damals schrieb Benn in einer eigenen Manifestation: „Wer es also unternimmt, den denkenden, den forschenden, den gestaltenden Geist von irgendeinem machtpolitisch beschränkenden Gesichtswinkel aus einzuengen, in dem werden wir unseren Gegner sehen. Wer es gar wagen sollte, sich offen zu solcher Gegnerschaft zu bekennen und Geisteswerte wie etwas Nebensächliches oder gar Unnützes abzutun, oder sie als reine Tendenzwerte den aufgebauschten und nebelhaften Begriffen der Nationalität, allerdings nicht weniger der Internationalität, unterzuordnen, dem werden wir geschlossen unsere Vorstellung von vaterländischer Gesinnung entgegensetzen, die davon ausgeht, daß ein Volk sich … trägt … durch die immanente geistige Kraft, durch die produktive seelische Substanz, deren durch Freiheit wie Notwendigkeit gleichermaßen geprägte Werke … die Arbeit und den Besitz, die Fülle und die Zucht eines Volkes in die weiten Räume der menschlichen Geschichte tragen.“
In dieser Formulierung ist Benns Verständnis der Nation als eines geistig begründeten Raumes fokussiert. Unter Berufung auf die Großen der Vergangenheit (Schiller und Herder werden namentlich genannt) plädiert er schließlich für „unser drittes Reich“, weit oberhalb der von Klassen-, Massen- und Rassenpolitik durchfurchten Ebene.
Benn dachte nach 1933 nicht daran, Deutschland zu verlassen, und seine Meinung von denen, die es taten, war nie eine gute. 1949 schrieb er an Oelze: „Wer heutzutage die Emigranten noch ernst nimmt, der soll ruhig dabei bleiben … Sie hatten vier Jahre lang Zeit; alles lag ihnen zu Füßen, die Verlage, die Theater, die Zeitungen hofierten sie … aber per saldo ist doch gar nichts dabei zutage
mardi, 17 janvier 2012 | Lien permanent


