samedi, 30 mars 2019
Mondialisation et prolifération de l'hostilité...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de François-Bernard Huyghe, cueilli sur son site Huyghe.fr et consacré aux changements de forme de la guerre provoqués par la mondialisation. Spécialiste de la stratégie et de la guerre de l'information, François-Bernard Huyghe enseigne à la Sorbonne et est l'auteur de nombreux essais sur le sujet, dont, récemment, La désinformation - Les armes du faux (Armand Colin, 2015) et Fake news - La grande peur (VA Press, 2018). Avec Xavier Desmaison et Damien Liccia, François-Bernard Huyghe vient de publier Dans la tête des Gilets jaunes (VA Press, 2019).
Pas d'idée de paix sans définition de la guerre
Comment sait-on que l'on est en guerre ? Il y a quelques années, la question aurait été absurde. La guerre était l’affaire des États (ou de groupes armés qui voulaient s’emparer de l’État, donc du monopole de la violence légitime, et il était alors convenu de parler de «guerre civile»).
- La guerre entraînait certains actes de langage : on la proclamait pour mobiliser son camp, au moins moralement, on la déclarait à l’autre, on l’exaltait par des discours, on la concluait par un écrit, tel un traité, on l’inscrivait dans les livres d’histoire ou sur des monuments. Le but était d’imposer le silence : silence des armes, silence du vaincu qui renoncerait à s’adresser à la postérité et à énoncer sa prétention politique
- L’état de guerre – une période avec un début et une fin- supposait des codes spécifiques : elle était ou bien juste ou bien injuste au regard du droit des gens ; des professionnels, les militaires (et eux seuls), avaient en fonction des circonstances le droit de tuer ou pas Chacun savait s’il était combattant (éventuellement « sans uniforme ») ou civil. La distinction ennemi privé / ennemi public était indépassable (extros contre polemos en grec, hostis contre innimicus en latin, etc..)
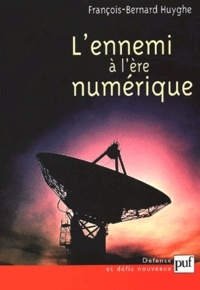 - La guerre se déroulait en un lieu connu : front, champs de bataille, zones occupées ou libérées. Un coup d’œil sur la carte montrait quelles troupes progressaient et lesquelles se repliaient.
- La guerre se déroulait en un lieu connu : front, champs de bataille, zones occupées ou libérées. Un coup d’œil sur la carte montrait quelles troupes progressaient et lesquelles se repliaient.
- La guerre s’accompagnait de destruction à commencer par un taux de mortalité anormal. : cette expérience du sacrifice revenait à chaque génération par cycles et apparaissait comme inhérente à la condition humaine. La belligérance, catégorie anthropologique fondamentale, stimulait les plus fortes passions de notre espèce.
- Les belligérants savaient qu’ils participaient à un conflit armé collectif ayant des fins politiques. Ils continuaient à s’infliger des dommages ou à occuper leur territoire respectif, jusqu’à la victoire ou au compromis (traité). Victoire ou compromis devaient modifier un rapport de souveraineté ou de pouvoir et s’inscrire dans l’Histoire. Le vaincu reconnaissait sa défaite ou disparaissait comme acteur (massacré, par exemple).
En termes de communication, de normes, de temps, d’espace, de forces, de conscience et de finalité, la distinction entre guerre et paix était aussi fondatrice qu’incontestable.
Tout ce que nous venons de rappeler correspond à une vision « classique » européenne ; celle de penseurs aussi divers que Clausewitz, Hegel, Weber, Schmitt, Freud, Caillois, Bouthoul, Aron, … et qui paraît aujourd’hui si désuète.
Les nouvelles violences
Sans même parler de la guerre froide dont la principale caractéristique fut de ne pas éclater à partir de la seconde moitié du XX° siècle, apparurent des formes de conflits inédites, certaines virtuelles ou fantasmées :
- Affrontements entre acteur étatique et combattants qui se considèrent comme armée de libération ou se réfèrent à une notion similaire. Reste à savoir à partir de quel degré d’organisation, permanence, visibilité (une « guerre clandestine » est-elle une vraie guerre ?), suivant quels critères politiques relatifs à la noblesse ou au sérieux de sa cause, un belligérant mène une vraie guerre de partisan. Sinon, il s’agit d’émeutes, d’incidents, de raids de groupes armés… relevant plus ou moins de la police et du maintien de l’ordre. Pour ne prendre qu’un exemple, dans les années 50, il n’y avait pas une guerre mais des « événements d’Algérie ». Quarante ans plus tard, l’État algérien se demandait s’il faisait la guerre aux maquis islamistes ou s’il s’agissait de maintien de l’ordre.
- La question devient cruciale soit lorsqu’il y a pluralité d’acteurs armés, comme la prolifération des milices au Liban dans les années 80, soit quand la distinction entre politique et criminalité devient presque indiscernable. En Amérique latine ou dans des le « triangle d’or » proche de la Birmanie, bien subtil qui sait distinguer une bande armée de trafiquants de drogue d’une guérilla.
- La distinction militaire/civil est remise en cause par la tendance à mobiliser des combattants sans uniforme, et la propension croissante des conflits à tuer bien davantage de civils que de militaires. Au moins d’un côté (voir le fantasme du « zéro mort »). Quand des milices massacrent des civils qui ne se défendent guère, comme au Darfour, faut-il continuer à parler de guerre ? Dans un tout autre genre : quand un membre d’une société militaire privée accomplit-il une mission de sécurité, est-il un assistant d’un « vrai » militaire et quand commence-t-il à « faire » la guerre ? Où passe la frontière entre terrorisme, guerre secrète, guerre du pauvre, guérilla ?
- Inversement, le système international - pour ne pas dire l’Occident – a inventé des interventions armées inédites des représailles sanctions jusqu’aux interventions humanitaires. Elles doivent séparer des protagonistes ou protéger des populations. Le discours des puissances intervenantes souligne qu’elles mènent une guerre « altruiste » censées ne leur apporter aucun avantage. Elles disent lutter contre des criminels ou ennemis du genre humain, contre des dirigeants et non des peuples qu’elles sont au contraire venues sauver. De là le droit d’ingérence qui autorise le recours à la force armée pour empêcher des violences inacceptables. Les opérations militaires, que nous nommerions « de contrôle », se multiplient, pour maintenir la violence armée des pauvres et des archaïques (conflits ethniques par exemple) à un degré supportable .
- Les situations intermédiaires -pas vraiment la paix, pas encore la guerre - se multiplient. Ainsi, en Afghanistan, la guerre contre les talibans est censée être finie, et pourtant les troupes de la coalition doivent utiliser des armes lourdes. Corollairement, des citoyens de pays industrialisés peuvent ignorer dans combien de conflits ou d’opérations de « maintien de la paix » sont engagés leurs troupes et ne pas ressentir l’état de belligérance. Pour reprendre le même cas, la perte de quelques soldats d’élite français en Afghanistan en 2007 a soulevé moins d’émotion que certains accidents de la route. Le sentiment de sécurité qu’éprouvaient la plupart des Européens (mais moins d’Américains depuis 2001), l’idée que la guerre est une vieillerie dont le droit, la démocratie et la prospérité nous ont délivrés, tout cela serait apparu proprement stupéfiant il y a quelques décennies.
 - Les stratèges ne cessent d’imaginer des formes de conflit où les armes prendrait une forme inédite ; ils intègrent dans leurs panoplies des outils informationnels au sens large qui agissent plus sur les esprits que sur les corps. Qu’il s’agisse de priver l’adversaire de ses moyens de communiquer, de le désorganiser ou de le désinformer, de percer tous ses secrets, de le sidérer psychologiquement, de rendre la force plus intelligente et mieux ciblée…, les spécialistes de la Revolution in Military Affairs et des diverses cyberwar et autres information warfare, n’ont jamais manqué d’imagination. Parallèlement, les notions de guerre de quatrième génération, de faible intensité, guerre continue ou celle, chère aux stratèges chinois, de guerre sans limite, reflètent les formes inédites du conflit technologiques, psychologiques, économiques, et devient de moins en moins évident que la guerre se pratique avec ces outils reconnaissables que sont les armes.
- Les stratèges ne cessent d’imaginer des formes de conflit où les armes prendrait une forme inédite ; ils intègrent dans leurs panoplies des outils informationnels au sens large qui agissent plus sur les esprits que sur les corps. Qu’il s’agisse de priver l’adversaire de ses moyens de communiquer, de le désorganiser ou de le désinformer, de percer tous ses secrets, de le sidérer psychologiquement, de rendre la force plus intelligente et mieux ciblée…, les spécialistes de la Revolution in Military Affairs et des diverses cyberwar et autres information warfare, n’ont jamais manqué d’imagination. Parallèlement, les notions de guerre de quatrième génération, de faible intensité, guerre continue ou celle, chère aux stratèges chinois, de guerre sans limite, reflètent les formes inédites du conflit technologiques, psychologiques, économiques, et devient de moins en moins évident que la guerre se pratique avec ces outils reconnaissables que sont les armes.
- Parmi les catégories utilisées pour décrire les nouvelles formes de l’affrontement armé, celle de guerre asymétrique est particulièrement révélatrice. Elle porte sur les moyens employés (guerre du pauvre contre guerre du riche high tech et surarmé), sur la stratégie (attrition contre contrôle), mais elle porte aussi sur les objectifs. Pour le fort la règle est : annuler ou limiter l’action du faible. Pour le faible : durer, infliger une perte sur le terrain moral ou de l’opinion, démoraliser celui que l’on ne peut désarmer, lui rendre le prolongement du conflit insupportable. La guerre asymétrique repose plus sur l’utilisation de l’information que sur celle de la puissance et partant contredit toutes les conceptions classiques. Elle postule que la victoire stratégique n’est pas une addition de victoires tactiques ; elle déplace la question de la légitimité de la guerre (donc de la croyance qui la soutient) non pas en amont de la guerre mais comme son objectif même.
Ces tensions et contradictions trouvent leur point culminant le jour où les États-Unis proclamèrent une « Guerre globale au terrorisme ». Elle appelle la notion complémentaire de « guerre préemptive » autorisant une intervention armée à l’étranger contre des groupes terroristes ou contre des tyrans susceptibles de les aider et/ou de posséder des armes de destruction massive.
Guerre des absolus
La plus grande puissance de tous les temps ( qui, a priori devrait avoir le moins à craindre) considère que l’état de guerre existe est susceptible de durer plus d’une génération. Et ce jusqu’à la disparition de tout acteur hostile (État Voyou, groupe terroriste), de toute intention hostile (le terrorisme, ceux qui haïssent la liberté, l’extrémisme violent, pour reprendre diverses formulation des dirigeants américains) et de tout instrument hostile (les Armes de Destruction Massive). Il est tentant d’en déduire qu’il s’agit d’une guerre perpétuelle pour une paix perpétuelle. On n’y nomme ni son adversaire, ni sa limite, ni les conditions de sa victoire. Faire du monde « un lieu plus sûr pour la démocratie » est un programme politique pour Sisyphe. Six ans de Guerre Globale au Terrorisme semblent indiquer que, loin d’éliminer les régimes hostiles, les groupes armés (y compris avec l’arme de l’attentat suicide) et les ADM (en Iran ou en Corée), elle semble les encourager.
Symétriquement, la guerre comme jihad défensif voire offensif (Daech voulait rien moins qu’étendre le califat à la planète) telle que la prônent les groupes islamistes n’est pas moins surprenante : elle est licite aux yeux de ses acteurs (elle est commandée par Dieu et constitue une obligation). Non seulement elle ne connaît pas de limites dans son extension territoriale ni dans le choix de ses victimes (pratiquement n’importe qui sauf un jihadiste est « éligible »). Il n’est pas certain qu’elle vise à une victoire (sauf à supposer la conversion de l’humanité entière à la variante salafiste du sunnisme). Au contraire,le jihad trouve sa propre justification non dans la réalisation de fins politiques, mais en lui-même, comme occasion de sanctification par le martyre ou comme compensation mimétique (ben Laden parle même de « talion ») des souffrances et humiliations subies par l’Oumma.
Et dans les deux cas, la dimension symbolique du conflit prédomine. D’un côté montrer la résolution des États Unis et démentir qu’ils soient un « tigre en papier ». De l’autre, infliger une humiliation à l’Occident orgueilleux et idolâtre. Et, si l’on remonte plus haut, ce sont deux guerres de conversion : il s’agit de faire disparaître une croyance qui offense le droit universel dans le premier cas (la haine de la liberté des terroristes), qui contredit loi divine dans le second (la haine de Dieu des juifs, des croisés et des apostats).
Chacun est libre de penser que « guerre » n’est qu’une catégorie juridico-philosophique particulièrement héritée de la pensée classique voire une très longue parenthèse historique (pour certains commençant au néolithique) et dont ni l’universalité, ni la perpétuité ne sont démontrées. Ou peut aussi la considérer comme degré dans les violences que les hommes s’infligent sans trop se soucier des catégories.
Notre propos n’est pas une quelconque forme de nostalgie envers les bonnes guerres d’autrefois qui se faisait au moins dans l’ordre et la discipline et que nous n’avons pas connues. Simplement il faudra apprendre à vivre avec ce paradoxe : mondialisation et affaiblissement du principe de souveraineté politique, autrefois considéré comme belligène, n’impliquent pas la fin de l’hostilité mais sa prolifération et sa privatisation.
François-Bernard Huyghe (Huyghe.fr, 22 mars 2019)
00:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois-bernard huyghe, polémologie, conflit, conflictualité, mondialisation, globalisation, hostilité, ennemi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


