Le nomos de la terre – dans le droit des gens du Jus publicum europaeum
par Michel Bourdeau
Ex: http://infonatio.unblog.fr/
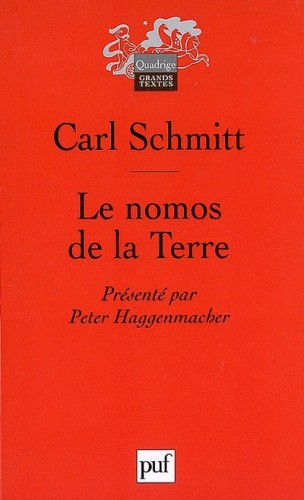 Si le nom de Carl Schmitt n’est plus tout à fait inconnu en France, où plus d’une dizaine de ses ouvrages ont déjà été traduits depuis 1972, sa personnalité reste encore très controversée. Grand théoricien du droit constitutionnel et international de l’Allemagne de l’entre deux guerres, son attitude à l’égard du nazisme lui valut d’être emprisonné plus d’une année après 1945. Refuser d’aller plus loin serait pourtant regrettable, comme ceux qui voudront bien ouvrir Le nomos de la terre s’en rendront rapidement compte. Publié en 1950 et composé dans des conditions difficiles, ce gros ouvrage offre une vue d’ensemble sur la pensée de l’auteur et passe à bon droit pour son oeuvre maîtresse.
Si le nom de Carl Schmitt n’est plus tout à fait inconnu en France, où plus d’une dizaine de ses ouvrages ont déjà été traduits depuis 1972, sa personnalité reste encore très controversée. Grand théoricien du droit constitutionnel et international de l’Allemagne de l’entre deux guerres, son attitude à l’égard du nazisme lui valut d’être emprisonné plus d’une année après 1945. Refuser d’aller plus loin serait pourtant regrettable, comme ceux qui voudront bien ouvrir Le nomos de la terre s’en rendront rapidement compte. Publié en 1950 et composé dans des conditions difficiles, ce gros ouvrage offre une vue d’ensemble sur la pensée de l’auteur et passe à bon droit pour son oeuvre maîtresse.
En opposition au positivisme juridique, accusé de verser dans un universalisme vide, Carl Schmitt plaide pour une approche concrète du droit, et met en conséquence l’espace au centre de sa conception : tout ordre juridique est d’abord un ordre spatial. C’est pourquoi, parmi les différents textes législatifs, la loi par excellence est le nomos, les grecs désignant par ce mot (qui vient de nemein : partager) le processus fondamental qui lie localisation et loi. Mais l’espace se présente ici bas sous deux formes contrastées : terre et mer, terre ferme et mer libre, auxquelles correspondent deux ordres spatiaux différents. Cette opposition donne lieu à des développements captivants sur la définition des eaux territoriales, le partage des mers, les guerres maritimes et la piraterie, ou encore sur la question de savoir si la mer est à tous ou à personne, res omnium ou res nullius. Par ce biais, la pensée de Schmitt puise également aux sources mythiques de l’histoire du droit.
Comme le Husserl de L’arche Terre ne se meut pas ou le Comte du Grand Fétiche, il nous invite à faire retour sur ce fait primitif et primordial qu’est notre existence terrestre. Le pari du livre, nous dit la préface, est de chercher le sens qui habite la terre.
L’idée est développée sur le cas du droit des gens, du jus publicum europaeum. Après une première partie présentant la notion de nomos de la terre, les trois suivantes examinent donc tour à tour la genèse (16ième siècle), l’épanouissement (17-19ième siècles) puis le déclin (20ième siècle) de ce droit public européen. Cette histoire se confond avec celle de la guerre, l’originalité du droit public européen consistant, à cet égard, à avoir voulu non abolir la guerre mais la circonscrire. Faute de pouvoir rendre ici toute la richesse de ces analyses, on n’en retiendra que les deux termes : la sortie du moyen âge et l’après 1918, dont nous ne sommes toujours pas sortis.
Dans le premier cas, l’événement décisif a été la découverte ou, pour parler avec les Espagnols, la conquête du nouveau monde. Les célèbres leçons de Francisco de Vitoria (1492-1546) sur les Indes et le droit de guerre, où l’on a voulu voir le début d’une nouvelle idée du droit, appartiennent en réalité encore au moyen âge. Leur auteur est un théologien et sa théorie de la guerre juste présuppose une instance supérieure aux belligérants, en l’occurrence le pouvoir spirituel de la papauté. Pour naître, le droit public européen a dû précisément s’affranchir de la tutelle de la théologie. Silete theologi; silence, théologiens : tel était alors le mot d’ordre. Pour mettre fin aux guerres civiles religieuses qui faisaient rage en Europe, il a fallu séparer le politique du religieux. Le concept moderne d’État est le fruit des efforts des légistes pour définir une sphère neutre, indépendante, où les membres des diverses confessions puissent cohabiter pacifiquement. Schmitt aimait en particulier à se reconnaître dans l’un d’eux, Jean Bodin, victime comme lui des revers de fortune qui guettent les conseillers du prince.
L’engagement personnel est encore plus visible dans le second cas, l’auteur n’ayant jamais caché sa farouche hostilité au Traité de Versailles ou à la Société des Nations. Le livre tout entier trouve même son point de départ dans une réflexion sur le sort réservé à l’Allemagne après la double défaite de 1918 et 1945, sort qui n’est pas conforme au droit public européen péniblement constitué dans les siècles antérieurs et qui en consacre la fin. A la différence du traité de Vienne qui avait réorganisé durablement l’Europe, les traités qui mirent fin à la première guerre mondiale n’instauraient aucune paix véritable, faute d’avoir défini un nouvel ordre spatial. En revanche, une nouvelle conception de la guerre s’y faisait jour. Le droit public européen avait renoncé à l’idée de guerre juste pour lui substituer celle d’ennemi respectable, de justus hostis. Mais les destructions massives rendues possibles par la technique moderne ont besoin d’ennemis absolus. Après 1918, la guerre d’agression est transformée en crime. La fin logique des hostilités ne sera donc plus une paix négociée mais une reddition inconditionnelle, concept forgé aux États-Unis lors de la guerre de Sécession; corrélativement, la diabolisation de l’ennemi permet le retour de l’idée de guerre juste, la Société des Nations se substituant à la papauté dans le rôle d’instance supérieure décidant du bien fondé de la cause.
Le déclin du droit public européen marqua aussi le déclin de l’ordre spatial européo-centré instauré au seizième siècle et les pages consacrées à la montée en puissance de « l’hémisphère occidental », c’est-à-dire des États-Unis apportent, sur la politique nord-américaine, un éclairage inattendu. Aujourd’hui où tout le monde a en tête le God bless America, Carl Schmitt décrit la bonne conscience inébranlable de ses habitants, persuadés d’appartenir à un monde nouveau, meilleur; il rappelle que dans sa fonction première, la doctrine Monroe devait former un cordon sanitaire destiné à empêcher les moeurs et les institutions corrompus du vieux continent de se propager outre Atlantique. Quand les États-Unis se décident, non sans peine, à sortir de leur isolement, leur suprématie devient vite éclatante. Alors que du traité de Westphalie (1648) à la conférence de Berlin (1885) c’est l’Europe qui décidait de l’ordre spatial de la terre, à Paris, en 1919, c’est le monde qui décide de l’ordre spatial de l’Europe. Celle-ci, en reconnaissant explicitement la doctrine Monroe, à l’article 21 du pacte de la Société des Nations, avalisait cet état de fait : elle s’interdisait d’intervenir dans le nouveau monde, sans contrepartie équivalente de l’Amérique, qui désormais est à la fois présente et absente sur le continent européen.
Le Congrès ayant refusé de ratifier le Traité de Versailles pour signer avec l’Allemagne une paix séparée, les États-Unis ne siègent pas à Genève; du moins officiellement car, par le biais des États sud-américains dont ils se sont réservés le droit de faire et défaire à leur gré les gouvernements, ils y sont bien présents et les décisions de Washington pèsent lourd à Londres, à Paris ou à Berlin. Rétrospectivement, on est tenté de donner raison à Carl Schmitt lorsqu’en 1950 il constatait que le Traité de Versailles avait engendré non un ordre mais un désordre spatial et laissait donc sans réponse la question d’un nouveau nomos de la terre. Aujourd’hui où il n’est question que de nouvel ordre mondial, force est d’admettre que nous ne sommes guère plus avancés.
Peter Haggenmacher achève son utile présentation en indiquant quelques faiblesses de l’ouvrage. Pour bien en évaluer les thèses, il conviendrait en particulier de s’interroger sur leurs liens avec une pratique dont on sait qu’elle a été problématique. Il n’est cependant pas nécessaire de partager toutes les idées de l’auteur pour être impressionné par la force avec laquelle elles sont exposées et reconnaître que l’ouvrage est tout simplement passionnant.
Michel Bourdeau




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Les commentaires sont fermés.