mardi, 30 juillet 2024
La "guerre civile" en France

La "guerre civile" en France
par Maurizio Lazzarato
(Ndlr: le texte qui suit provient d'un intellectuel marxiste de la vieille école, qui enseigne en France et qui analyse ici le néolibéralisme policier de Macron, en le qualifiant de "néofascisme" comme le veut la mode en France et les tics langagiers de l'université française, saoûlée de son idéologie "républicaine". Précisons aussi que Lazzarato soutient "La France Insoumise", qui a pourtant aidé Macron à se remettre en selle. Mis à part la présence de ce tic langagier récurrent, souvent lourd et pesant, l'analyse de Lazzarato qui démontre le recours à la violence policière d'un néolibéralisme, en faillite depuis la crise de 2008, est juste. A nos lecteurs de traduire en un langage normal et compréhensible cette dénonciation de la violence nouvelle, laquelle est bel et bien libérale, essentiellement libérale: les mouvements, dénoncés comme "totalitaires" dans les médias mainstream et dans les officines universitaires, n'ont jamais été que des révoltes justifiées contre l'inhumanité du tout-économique libéral).
Source: https://www.sinistrainrete.info/teoria/28507-maurizio-lazzarato-la-guerra-civile-in-francia.html
La tendance contemporaine à l'alliance entre libéraux et fascistes, que nous avons vue à l'œuvre au 20ème siècle et qui est réapparue sous nos yeux ces dernières années, a été remise en cause en France par ce que les luttes de ces dernières années ont réussi à sédimenter. Mais la situation est loin d'être résolue : Macron, qui reste président de la République, veut continuer à mener jusqu'au bout l'expropriation des salaires, des revenus et des services, le génocide, la guerre ; Hollande et le Parti socialiste sont déjà prêts à poignarder le programme du Nouveau Front populaire ; le Rassemblement national a augmenté sa force parlementaire. Bref, la France est un pays divisé. Dans cette situation, les mouvements sociaux joueront un rôle décisif : seule une lutte de classe pressante pourra construire les rapports de force qui sont aujourd'hui dans la balance et faire avancer La France Insoumise.
* * * *
Dans la nuit où l'on a célébré la victoire électorale sur les fascistes, la sagesse populaire écrivait sur un mur "Notre sursaut est un sursis". C'est encore plus vrai le lendemain matin. Mais c'est plus qu'un sursaut, et la trêve dépendra du rapport de force qui se construira dans les semaines et les mois à venir.
La longue séquence de lutte des classes sans classe et sans révolution (qui a commencé sous la présidence de Hollande), malgré le fait qu'aucune des revendications des différents mouvements (Loi travail, Gilets Jaunes, retraite, banlieues etc.) n'ait réussi à s'imposer, elle a provoqué un séisme qui ébranle les institutions de la République, ancré électoralement le bloc féroce des intérêts du grand capital représenté par Macron, et ouvert la voie à une première rupture du consensus gauche/droite autour de la contre-révolution libérale-capitaliste qui a gouverné pratiquement depuis Mitterrand en 1983 jusqu'à Macron.
La tendance contemporaine à l'alliance entre libéraux et fascistes (dont la dernière concrétisation est le gouvernement Hollande mis en place le 2 juillet) a volé en éclats par ce que les luttes ont sédimenté au niveau institutionnel. Le résultat des élections montre que la France est profondément divisée et on voit mal qui et comment elle pourrait se recomposer à moyen/long terme, avec un RN (Rassemblement national) représentant 10 millions d'électeurs français sur 49, qui a accru sa force parlementaire, consolidé son implantation territoriale et vise déjà les élections présidentielles. La situation est plus proche de celle des Etats-Unis que de celle de l'Italie, où les fascistes se sont installés au pouvoir sans problème, dans un pays assoupi et en déclin à tous égards.
L'évolution de la situation dépendra, pour commencer, de la manière dont la crise institutionnelle sera résolue. La constitution et le système politique français n'envisagent pas une telle issue, qui s'apparente davantage à un scrutin proportionnel, ne permettant pas l'établissement immédiat d'une majorité et aboutissant donc à un transfert contre nature du pouvoir du "monarque républicain" vers le parlement.
Elle dépendra ensuite également de la capacité de résistance du NFP (Nouveau Front Populaire) car le parti socialiste, "ressuscité" uniquement parce que FI (France Insoumise) lui a accordé plusieurs circonscriptions, est le parti le plus problématique de la coalition. C'est précisément de son ventre que sont sortis Macron - et nombre de ses ministres - et une partie de l'électorat qu'il a ensuite régulièrement massacré. Macron dans sa parabole politique est passé d'une majorité absolue à une majorité relative à une situation où il n'a plus les cartes en main. Sa coalition doit tout au désistement, aux électeurs qui se sont bouchés le nez pour voter pour elle. D'ailleurs, ses nouveaux élus savent qu'ils doivent plus à Attal, qui a pris le parti du "front républicain" sans ambiguïté dès le départ, qu'au "roi" de l'Olympe - "Jupiter", comme l'appellent les Français avec mépris - qui a été ambigu et hésitant jusqu'au bout sur la question.
Macron n'est que le dernier d'une série de libéraux socialistes qui ont fait plus pour imposer le néolibéralisme que toutes les droites réunies - la liste des ignominies est sans fin). Hollande, ex-président, l'un des pires de la bande, s'est fait élire et est prêt à poignarder dans le dos le programme du NFP, basé sur un keynésianisme de gauche qui a de quoi affoler les classes dirigeantes - un plan qui comprend la retraite à 60 ans, l'augmentation du salaire minimum de 15 %, l'abolition d'une énième loi planifiée contre les chômeurs, etc. Bien loin de la radicalité du PC historique - toute relative s'il est vrai que François Tosquelles, fondateur du POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) pendant la guerre civile espagnole et plus tard inventeur de la psychothérapie institutionnelle, se plaignait que pendant qu'ils faisaient la révolution, le PC se battait pour les congés payés. C'est dire si nous sommes loin des débats et des enjeux du siècle dernier.

Mais le rôle décisif sera joué par les mouvements. Dans une situation où la majorité (s'il y en a une ! trop tôt pour le dire) du NFP composite, avec un programme abhorré par la droite libérale, sous le feu croisé des marchés, avec un RN qui se tient coi en pensant encaisser les dividendes de la situation inédite dans trois ans (lors des élections présidentielles), seule une lutte de classe pressante pourra construire les rapports de force qui sont aujourd'hui dans la balance. Seule la capacité de mobilisation permettra d'imposer le programme d'une coalition où la seule force qui a rompu avec le "consensus de Washington", le consensus sur le génocide et sur l'atlantisme, est la FI.
Mais tout est encore en suspens, ce n'est qu'une des coalitions possibles, nous connaîtrons probablement une période d'instabilité institutionnelle et politique prolongée.
Libéralisme et fascisme
Essayons maintenant de comprendre ce qui se cache sous les fissures produites par les vagues électorales : la grande crise du capitalisme et des Etats occidentaux, qui ne sont pas encore sortis de la débâcle financière de 2008 et qui n'ont que la guerre, la guerre civile et le génocide comme seule véritable solution. C'est dans ce cadre que se jouera le destin du NFP et du fascisme. Prendre un peu de distance par rapport à l'actualité immédiate peut nous aider à lire ce qui pourrait se passer.
La relation entre le capitalisme, le fascisme et le libéralisme n'est pas conjoncturelle, mais structurelle.
Le transfert d'un des modes d'exercice du pouvoir (législatif, exécutif, administratif) des libéraux aux fascistes est un classique du 20ème siècle. Le fascisme et le nazisme historique ont été portés au pouvoir par des libéraux, des capitalistes, des banquiers, après que le "marché" a lamentablement échoué, entraînant les sociétés européennes dans la Grande Guerre et la Guerre civile mondiale. Les bolcheviks ont saisi la balle au bond et fait la révolution avec un écho immédiat dans le monde entier, notamment en Europe, terrorisant les classes dirigeantes prêtes à tout pour anéantir le programme d'abolition de la propriété privée, qui reste l'alpha et l'oméga du capitalisme - Keynes écrivait que les grands propriétaires préféreraient éteindre le soleil et les étoiles plutôt que de céder un pouce de pouvoir et de perdre un gramme de profit.
Face à l'effondrement de la gouvernance libérale et à l'escalade de la guerre civile, la droite et une bonne partie des capitalistes ont préféré céder le pouvoir aux nazis et aux fascistes, laissant libre cours à la violence contre le "vrai" danger, le bolchevisme.
Le néolibéralisme, qui se voulait une alternative au libéralisme classique, produit les mêmes résultats : guerre, guerre civile, génocide, fascisme. Il est entré dans le coma en 2008 et est mort depuis quelques années. En Occident, le "marché" ne décide plus de rien, si tant est qu'il ait jamais décidé de quoi que ce soit. Les États-Unis choisissent pour tout le Nord ce qu'il faut produire, où il faut s'installer et ce qu'il faut consommer. Ils dictent à tous les vassaux ce qu'il faut exporter et vers qui, quels droits, sur quelles marchandises, quels pays producteurs. L'allocation des technologies est l'œuvre du Pentagone. Le marché est désormais complètement subordonné à la sécurité nationale des États-Unis, c'est-à-dire à leur volonté d'hégémonie.
Dans les pays du Sud, le capitalisme est géré par l'État, de sorte que le marché est étroitement contrôlé par son ennemi le plus acharné. Cela semble fonctionner assez bien du point de vue de l'accumulation. Même le "pilote automatique" de la finance semble être contrôlé par la politique (ce qui a également été le cas en Occident pendant les trente glorieuses).
J'ai assisté avec stupéfaction à des conférences universitaires en Italie où le néolibéralisme, le capital humain, l'entrepreneur de soi-même, etc. sont encore discutés, comme si nous étions encore dans les années 1980 ou 1990, comme si ces concepts avaient jamais été opérationnels. Les économies de marché ont été administrées par des États, même sous le soi-disant néolibéralisme, sauvées par les monnaies souveraines et maintenant sauvées par l'État militaire et les fascismes. Le capitalisme dans son ensemble doit périodiquement faire la guerre et recourir à la violence fasciste pour ne pas s'effondrer.

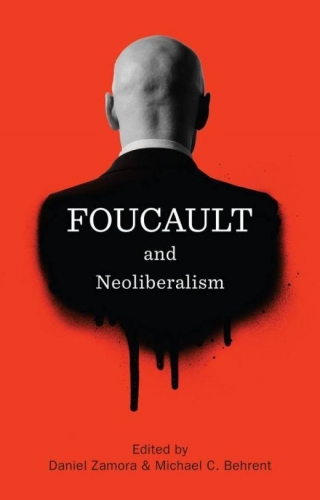
Michel Foucault a fait circuler des fables sur l'ordo- et le néolibéralisme que même les intellectuels de gauche les plus subtils répètent comme des perroquets. Néolibéralisme et fascisme sont étroitement liés parce que le second était, au début des années 1970, la condition du premier. Ce n'est pas le marché, ce ne sont pas les hommes d'affaires qui ont bombardé la Moneda et tué Allende, massacré des milliers de militants socialistes et communistes dans toute l'Amérique latine, contraint à l'exil autant d'entre eux : c'est l'alliance entre les fascistes et la puissance souveraine des États-Unis qui l'a fait. La convergence inaugurale entre fascisme et néolibéralisme dans l'organisation de la guerre civile, disparue de la reconstruction de Foucault et de ses continuateurs [1], se reproduit aujourd'hui, au crépuscule de la gouvernementalité libérale.
Pour comprendre comment cela se répète encore aujourd'hui, il faut considérer d'autres formes d'exercice du pouvoir, au premier rang desquelles l'accumulation du capital.
Avec le début de la contre-révolution, les fascistes ont été immédiatement sortis des égouts. L'"obligation" antifasciste est éliminée parce que la stratégie choisie n'envisage aucune médiation, elle va à la confrontation des classes, à la "guerre civile", tantôt souterraine tantôt ouverte, intensifiant le racisme et le sexisme dans le but de diviser le prolétariat.
L'alliance entre libéraux et fascistes a déjà été institutionnalisée par Berlusconi (1992) il y a plus de trente ans. Son premier gouvernement réunit des libéraux de droite et des fascistes. L'un d'entre eux dirigera la boucherie de Gênes.
La légitimité électorale du bloc d'intérêts économico-financiers nationaux et mondiaux que Macron représente a explosé avec les élections européennes. Avec seulement 7% des électeurs ayant voté pour le président, son gouvernement, qui a fait de la France un pays "business-friendly", n'a ni crédibilité ni solidité.
La gouvernementalité néolibérale, déjà fortement érodée par la crise de 2008, a été délégitimée par la succession de mouvements politiques en France (contre la Loi Travail, Gilets Jaunes, lutte pour les retraites, révolte des banlieues). C'est la cause première de l'usure du pouvoir macronien que les élections ont enregistrée. Le régime de guerre et de génocide d'une part, la guerre civile d'expropriation des salaires, des revenus et des services gagnée en un siècle et demi de révolutions d'autre part, exigent que les procédures démocratiques qui ont toujours été étanches au capitalisme soient privées de leur pouvoir.
Mais la situation n'a pas le caractère dramatique de la première moitié du 20ème siècle, pas de danger "bolchevique" à l'horizon. Macron pense peut-être que le moment n'est pas encore venu de céder le pouvoir alors qu'il a longtemps hésité, comme beaucoup d'autres dirigeants de droite, avant de rejoindre le bloc républicain contre le fascisme. C'est son Premier ministre qui lui a forcé la main. Il n'y a rien à attendre de quelqu'un qui a ouvert la porte au RN, en reprenant pratiquement tous ses mots d'ordre, et qui a mis en œuvre en même temps l'une des politiques de classe les plus féroces que l'on ait vues en Europe. Le "tir de barrage" dont ils rêvaient tous était en réalité dirigé contre le FN. Quand ils ont compris qu'ils pouvaient se rattraper sur le dos des militants du NFP qui votaient massivement, contrairement aux électeurs de droite, en respectant la règle du désistement, ils ont rejoint le front républicain.
Guerre civile ?
Macron, pendant la très courte campagne électorale, a évoqué le danger d'une guerre civile en cas de victoire des "extrêmes" et l'Elysée a organisé une fuite sur l'utilisation possible de l'article 16 de la constitution accordant les pleins pouvoirs au président (dictature présidentielle).
Ces deux observations sont très intéressantes.
L'intensification de l'initiative capitaliste après la crise financière, dont l'objectif était de la faire payer aux classes populaires, a été traitée par Macron sous la forme d'une guerre civile. La stratégie choisie a été d'aller jusqu'au bout du mot d'ordre de la contre-révolution : pas de médiation, pas de compromis, pas de dialogue, de sorte que la seule force capable de gérer le conflit était la police.
Beaucoup de camarades s'étonnent de l'utilisation du terme "guerre civile" qu'ils ne conçoivent, ma foi, que de manière métaphorique. Le problème de ces camarades est grave: ils ont une conception "eurocentrique" de l'exercice du pouvoir, comme toute la philosophie politique et la politologie occidentales. Juger le pouvoir, c'est mettre sur un pied d'égalité son exercice à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de la France métropolitaine, car le niveau d'utilisation de la violence et les dispositifs et techniques utilisés pour la mettre en œuvre sont certes différents, mais il s'agit du même pouvoir, géré par les mêmes hommes.
Macron utilise une grande violence coloniale classique en Kanaky (9 morts et 1675 arrestations lors des émeutes de mai dernier), en Afrique (où l'élimination physique de l'ennemi est une pratique courante) et dans une grande partie des DOM-TOM et de la violence plus "démocratique" de la métropole. Mais, je le répète, c'est le même pouvoir qui utilise la guerre civile ouverte dans les colonies et la "guerre civile lente", comme Marx définit, dans le 8ème chapitre du Capital, la lutte de la classe ouvrière sur la journée de travail. "Guerre civile lente, plus ou moins voilée" parce qu'elle n'est pas concentrée dans l'espace et le temps comme la première.

Macron gouverne depuis le début de son mandat par l'intermédiaire de la police, dont la violence n'a cessé de monter, atteignant des niveaux inquiétants avec les Gilets Jaunes. Les lois d'exception votées au moment des attentats de 2015 ont été intégrées au droit commun et largement utilisées par les préfets contre les luttes opposées au recul de l'âge de la retraite.
L'utilisation de la police comme mode de "gouvernement" manifeste que la situation est toujours en équilibre, "exceptionnelle" parce qu'imprévisible, difficile à stabiliser parce qu'ouverte en permanence à des rapports de force changeants et risquant en permanence d'échapper aux pouvoirs constitués. La distinction entre normalité et urgence n'a plus lieu d'être puisque, au 20ème siècle, la différence entre paix et guerre a cédé la place à leur contamination.
La police est la force la plus appropriée pour intervenir lorsque la normalité et l'exception, la guerre et la paix se confondent. W. Benjamin rappelle que la police, en réprimant, ne se contente pas d'appliquer la loi, mais la crée par sa propre action, dans son affrontement avec la lutte des classes. La police n'est pas seulement un pouvoir qui conserve le droit, mais aussi un pouvoir qui le fonde. Elle est le pouvoir constituant en action, elle est l'état d'exception en action, elle est la guerre civile en action. La violence policière est fondatrice de droit", elle n'édicte pas de lois, mais "prend toutes sortes de décrets (...) ainsi, "pour garantir la sécurité", elle intervient dans d'innombrables cas où la situation juridique n'est pas claire".
Le pouvoir qui pose le droit (l'exception) et le pouvoir qui le conserve (les lois) sont confondus dans le même acte, il n'y a pas d'opposition entre pouvoir constituant et pouvoir constitué dans la pratique du pouvoir. C'est la seule façon de pouvoir maîtriser une guerre civile qui, bien que "lente", mine continuellement la stabilité et le fonctionnement du pouvoir et menace de s'accélérer. Le pouvoir fait un usage constant et systématique de la police parce qu'elle intervient dans des situations d'incertitude, qui ne peuvent être anticipées par le législateur, exerçant une violence à la fois instituée et instituante.
Dans la reproduction continue de la crise, l'ordre n'est pas garanti, il doit être construit, reconstruit et légitimé sans relâche, car, malgré l'absence de subjectivités révolutionnaires, il ne parvient pas à stabiliser les rapports de force entre les classes : le pouvoir ne parvient pas à les enfermer dans son commandement, qui, au contraire, risquent continuellement de présenter leur visage révolté et subversif. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets Jaunes et la succession des luttes en France.
Mais c'est aussi une puissance minée par les rapports de force internationaux qui voient l'Occident sur la défensive, paniqué par le déclin de son hégémonie et donc prêt à déchaîner les plus grandes violences.
Cela paraît impossible, mais on continue à écrire des analyses terriblement locales de la situation politique française, alors même que le pays transalpin est complètement englouti dans une guerre globale et une guerre civile.
La France, comme tout l'Occident, est deux fois en guerre : contre la Russie (en vérité, contre la Chine, qui menace sa suprématie) et contre les Palestiniens (contre le prolétariat du Grand Sud), tandis que les pays occidentaux connaissent des "guerres civiles" qui, de "lentes" qu'elles étaient, deviennent dynamiques, en particulier aux États-Unis. La France envoie des armes à Israël et légitime le génocide tout en menaçant d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Le génocide palestinien a continuellement plané sur la campagne parce que son principal argument pour criminaliser ceux qui s'opposent au massacre en cours, l'antisémitisme, a été martelé par tous les médias consensuellement unifiés, contre LFI, l'image d'un "danger rouge" inexistant. Au contraire, le RN "ontologiquement" antisémite a été légitimé comme antiraciste. En tout état de cause, l'opération Corbyn a échoué.
La manière dont on juge la phase est importante, car l'action politique en dépend. Il me semble que l'on peut dire, sans crainte d'être contredit, que nous nous trouvons dans une superposition de guerres, de guerres civiles, de génocides, de montée des fascismes qui rendent difficiles les prédictions, les anticipations, les calculs "stratégiques" (y compris économiques), de sorte que les classes dirigeantes ont tendance à confier à l'extrême droite le rétablissement de l'ordre et de l'autorité qui assure un minimum de certitudes. Les milieux économiques, après le vote, ont fait savoir qu'ils voulaient "de la stabilité et de la visibilité", c'est-à-dire de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Ils prendront celui qui leur assurera le mieux cela.
Dans un régime de guerre (et aussi de guerre civile "lente"), la visibilité est minimale, la direction à prendre ne se dessine pas facilement, le choix est hésitant : "Nous reconnaissons qu'il est beaucoup plus difficile de s'orienter dans la guerre que dans n'importe quel autre phénomène social parce qu'elle implique moins de certitude, c'est-à-dire qu'elle est encore plus une question de probabilité".

Cette citation du président Mao est certainement un reflet d'un texte de Clausewitz qui mérite d'être cité, car il nous donne une image de ce qu'est la crise permanente que nous vivons depuis le lancement de la contre-révolution au début des années 1970, dont le mot d'ordre, au fur et à mesure qu'il se précisait, "pas de médiation", implique une logique de guerre (civile).
"La guerre est le domaine du hasard. Aucune autre sphère de l'activité humaine n'est en contact aussi permanent avec le "hasard".
Il accentue l'incertitude en toutes circonstances et entrave le cours des événements. En raison de l'incertitude de toute information, de l'absence de base solide et de ces interventions constantes du hasard, l'homme qui agit se trouve continuellement confronté à des réalités différentes de celles qu'il attendait [...] les trois quarts des éléments sur lesquels se fonde l'action restent dans le brouillard d'une plus ou moins grande incertitude.
C'est dans cette situation d'impossibilité de calcul (à tous points de vue, économique et politique) que les "gouvernements démocratiques" montrent toutes leurs limites et que la police et les fascistes deviennent indispensables. La relation entre État et fascisme, entre État et dictature, est inscrite dans le fonctionnement du premier. Pour le comprendre, il est peut-être utile de se référer à la théorie du "double État" d'Ernst Fraenkel, élaborée à partir du fonctionnement de l'État nazi.
Le nazisme n'a pas simplement introduit et perpétué l'état d'exception, comme Agamben semble le croire, en ignorant complètement la force et le rôle que le capitalisme a joué dans cette période. Parallèlement à l'état d'exception a continué à fonctionner ce qu'Ernst Fraenkel appelle l'"état normatif", l'état des lois.
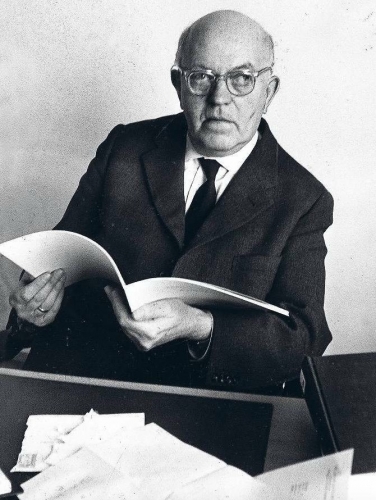
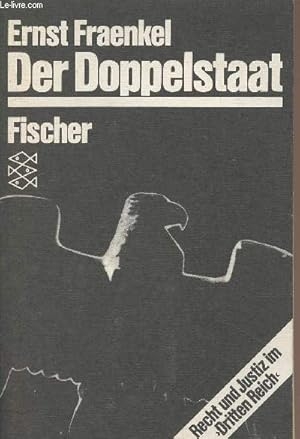
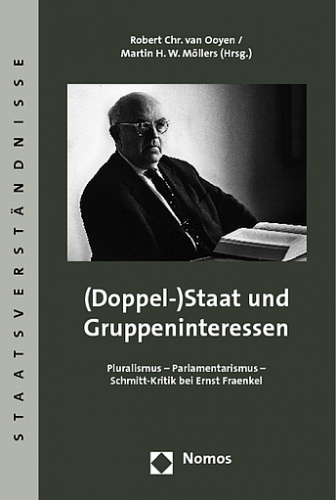
La théorie de Fraenkel peut être résumée en disant que plusieurs États coexistent au sein de l'État. L'État nazi a fonctionné sur la base de deux régimes politico-juridiques différents : un régime "normatif" qui garantissait la régulation juridique des contrats, des investissements, de la propriété privée, tout en assurant des services de toute nature aux Allemands, et un régime caractérisé par la discrétion, l'exceptionnalisme, un pouvoir arbitraire d'une grande violence qui privait de leurs droits une partie de la population (juifs, socialistes, communistes, syndicalistes révolutionnaires, handicapés, homosexuels...).
Cette double organisation de l'État (État administratif et État souverain) n'a jamais été l'apanage du seul État nazi ; même la constitution française est ainsi construite, laissant une large place à la décision incontestable du monarque républicain. Dès son origine, l'État occidental a été organisé selon ce dualisme. Pendant longtemps, le régime souverain avec toutes ses prérogatives (le roi a la "prérogative" de pouvoir agir contre la loi existante) s'est exercé, dans sa forme la plus pure, dans les colonies, tandis que le régime réglementaire s'exerçait en métropole. Lors de l'insurrection de 1848, la violence souveraine a été transférée des colonies, où elle s'exerçait sans limites, vers la métropole, afin de réprimer la révolte avec l'aide de l'armée coloniale (effectuant un véritable massacre !). Toute la tradition libérale considère que l'État de droit ne peut exister et se fonder que sur ce pouvoir souverain absolu - Tocqueville, par exemple, considérait que la dictature pour les musulmans d'Algérie et la démocratie pour les Français étaient nécessaires, mais que la seconde ne pouvait exister sans la première.
Dans la Constitution française, ces deux régimes sont clairement énoncés. L'article 16, évoqué lors de la campagne électorale, qui donne les pleins pouvoirs au président (copié-collé de l'article 48 de la République de Weimar) affirme le fondement non démocratique du pouvoir. L'Etat contient en lui-même la réalité de la dictature, de l'arbitraire, du despotisme, il ne doit pas les rechercher à l'extérieur de lui. Par exemple, la Cour suprême américaine a encore récemment affirmé cette vérité : le président est au-dessus des lois.
De même, l'économie capitaliste a une tendance irrésistible à se débarrasser de la démocratie. Hans Jünger Krahl, connu en Italie mais pas pour sa contribution politique majeure, précise la différence entre le capitalisme contemporain et celui du 19ème siècle : "La tendance relevée par Marx, d'un développement capitaliste favorable au socialisme, s'est appliquée au capitalisme concurrentiel. Le capital monopoliste et l'impérialisme ne développent plus "une tendance au socialisme mais plutôt à la barbarie fasciste". Des raisons structurelles président à la complicité du capitalisme, du fascisme et de la guerre.
La configuration du vote a montré une forte résistance contre le fascisme mais aussi contre le macronisme. L'intensification de la crise, l'affrontement guerrier en cours, l'aggravation du racisme, du sexisme, la stabilisation probable du RN comme premier parti ("populaire" après tout), seront la toile de fond de la lutte institutionnelle dans les mois à venir. La grande détermination dont ont fait preuve les luttes de ces dernières années et aussi de ce dernier mois sur le terrain électoral, laisse aussi la voie ouverte à l'intensification de la " guerre civile " que Macron pratique sans scrupule depuis le début de son mandat dans un crescendo impressionnant.
Au-delà du concept d'inégalité
La stratégie de concentration des richesses entre les mains de quelques-uns et d'appauvrissement du plus grand nombre se poursuit, un processus qui s'approfondit encore avec les guerres. La situation ne peut plus être caractérisée par le concept d'"inégalité", nous sommes en train de le dépasser. L'État de droit et la démocratie s'avèrent impuissants face à la poursuite de la mutation du capitalisme et constituent plutôt des obstacles à éliminer. La démocratie, l'État de droit, contrairement à l'idéologie dominante, semblent de moins en moins compatibles avec le capitalisme.
Dans l'actualité occupée par les guerres, les génocides, les fascismes, une nouvelle, symptôme important de l'évolution du capitalisme actuel et autre visage de la grande violence que nous vivons, semble avoir échappé à l'attention de la plupart : un entrepreneur, Elon Musk, PDG de Tesla, a exigé et obtenu une rémunération annuelle de 56 milliards de dollars. Dans l'ancien capitalisme industriel (mais encore dans les années 1950), le rapport entre le salaire de l'ouvrier et la rémunération du maître était au maximum de 1 à 20. Dans les années 1980, de 1 à 42. Dans les années 2000, de 1 à 120 et progressivement jusqu'à 1 à 56 aujourd'hui.
Mais ici, l'écart est vertigineux, la quantité devient qualité. Les deux réalités sont incommensurables. Les termes du rapport sont de grandeurs totalement différentes, il s'agit de deux "races" différentes, d'êtres humains hétérogènes. Le rapport n'a pas de sens, il ne répond à aucune "rationalité" économique, comme le prétendait encore le capitalisme il y a cinquante ans.
La "non-relation" est ce qui a toujours défini la situation coloniale. Cette relation qui n'a plus de légitimité économique, qui est un rapport de force pur et dur, s'installe aussi dans les pays du Nord.
On peut se demander s'il s'agit encore de capitalisme ou si nous ne sommes pas plutôt en présence d'un nouveau type d'aristocratie qui impose des rentes à des seigneurs, dont la légitimité n'est rien d'autre que l'arbitraire du pouvoir absolu. Un exemple : Robyn Denholm, présidente de Tesla, a expliqué aux actionnaires dans une lettre que le "salaire" sert à "maintenir l'attention d'Elon et à le motiver pour qu'il se concentre sur la réalisation d'une croissance incroyable pour notre entreprise". Musk "n'est pas un manager typique" et pour le motiver "il faut quelque chose de différent".
56 milliards d'euros, c'est une rente qui implique une conception de la société où une minuscule aristocratie règne sur une masse (plèbe? foule?) partageant la misère, produisant une surabondance de hiérarchies parmi les pauvres.
Mais Musk n'est pas l'exception bizarre d'un entrepreneur étrange: ce processus s'incarne aussi en Argentine, où Milei a ce capitalisme et ces capitalistes comme point de référence.
Là où le néolibéralisme est né dans les années 1970, le capitalisme connaît une nouvelle mutation: la volonté politique est d'imposer la dictature inconditionnelle de la propriété privée, la privatisation de tous les rapports sociaux. Une dystopie qui n'a même plus besoin de la terreur du coup d'État. Les rapports de force que la composition de classe contemporaine parvient à imposer sont si faibles, si déséquilibrés en faveur du capital, qu'il suffit de montrer une tronçonneuse et de donner quelques concerts pour s'affirmer.
Quand Milei crie "freedom", "liberty", l'explication lyrique se trouve chez Peter Thiel, milliardaire et cofondateur de PayPal: "Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles.
La démocratie a une toute autre origine que le capitalisme, elle est l'expression de l'irruption des masses dans l'histoire et de leur désir de justice et d'égalité. Seule la lutte des classes civilise le capitalisme qui, en soi, n'a rien de démocratique ni de progressiste. Le pouvoir exercé dans l'entreprise, qui est son modèle de pouvoir, est despotique, malgré toutes les théories managériales qui tentent de le masquer en vantant la "participation".
Avec Musk, d'autres milliardaires (Murdoch, par exemple, et Thiel lui-même) financent et font activement campagne pour l'élection de Trump. Nous trouvons ici une autre raison de l'existence du fascisme, économique cette fois - une vérité confirmée par le fonctionnement de l'économie anti-ouvrière sous Mussolini ou Hitler. Après tout, l'agenda de la contre-révolution avait déjà été marqué dans les années 1970 par la critique de la démocratie menée par la Trilatérale.
Ce que veut Milei (mais c'est exactement le projet de Macron, Draghi, de l'Eurocratie, etc.) est très bien exprimé par ces milliardaires trumpiens: revenir à avant le New Deal, à avant le Welfare - c'est-à-dire à avant la révolution soviétique - mais aussi à avant la révolution française (un rêve des ordo-libéraux allemands, la nostalgie de l'époque où il y avait un "ordre" des classes). En effet, Thiel poursuit : "Les années 1920 ont été la dernière décennie de l'histoire américaine au cours de laquelle il était possible d'être véritablement optimiste en politique. Depuis 1920, la forte augmentation des bénéficiaires de l'aide sociale et l'extension du droit de vote aux femmes ont fait de la notion de "démocratie capitaliste" un oxymore".
L'État, en France, au lieu d'être le principal ennemi du marché, assure une véritable rente aux entreprises par la fiscalité, mais surtout par l'assistanat : 230 milliards par an dont elles n'ont pas à rendre compte, privilège accordé par le "monarque républicain". La destruction du modèle social a cet objectif fondamental : transférer les ressources des hôpitaux, des écoles, des assurances sociales, etc. vers les riches et les nouveaux entrepreneurs/rentiers.
En Italie, la loi sur "l'autonomie différenciée" a été adoptée et prévoit un traitement "différencié" de la qualité des services publics fournis aux citoyens italiens, services qui varient en fonction de la région de résidence. L'égalité est toujours liée à la lutte des classes, le libéralisme se fonde sur la différenciation de la richesse et de la propriété.
Autant de choses que les dispositifs biopolitiques les plus raffinés ne parviennent pas à nous expliquer. Ils séparent le pouvoir de l'argent, l'assujettissement de la propriété privée, ce qui est impossible et suicidaire dans le capitalisme. Il est impossible de séparer les rapports de production des rapports de pouvoir, et ces derniers semblent indifférents à la modernité et au progrès, à l'avancée de la science et de la technologie.
Il faut prendre très au sérieux ce phénomène "argentin" et de la Silicon Valley, car c'est l'autre visage du fascisme contemporain, qui ne vient pas du fascisme historique, comme Meloni en Italie ou Le Pen en France, mais des sommets les plus avancés de la recherche technologique et des techniques financières.
Face à l'hyper-modernité, il faut toujours remettre l'analyse "ancienne" du Manifeste de Marx. Le problème politique est toujours la propriété privée, et l'objectif révolutionnaire reste son abolition. C'est autour de sa préservation et de la lutte contre son abolition que se cristallisent tous les fascismes, réactions, guerres et génocides. Quel que soit l'axe de l'action politique que l'on privilégie, écologie, féminisme, racisme, penser amorcer des voies de libération, de rupture, de résistance sans toucher à la propriété est une naïveté qui se mesure à l'aune de la grande violence que le pouvoir déchaîne lorsque ses privilèges sont remis en cause. Et le privilège des privilèges, c'est la propriété - du travail des autres, des femmes, de la nature, des autres êtres humains.
Un pâle ersatz de la lutte marxienne pour l'abolition de la propriété privée se trouve dans la théorie inoffensive des "biens communs" qui semble ignorer que sa condition de viabilité est l'"expropriation violente des expropriateurs".
Nous n'avons pas bougé d'un pouce par rapport au Manifeste. Ou plutôt, le capitalisme est toujours resté fidèle au premier "droit de l'homme" qu'il reconnaît : être propriétaire.
Le racisme classique qui sous-tend le fascisme est passé de biologique à culturel et s'accorde parfaitement avec le racisme du darwinisme social des fascio-capitalistes de la Silicon Valley. Ensemble, ils rendent la démocratie superflue.
Lutte des classes sans classe, lutte des classes sans révolution
L'acteur principal, dont dépendra l'issue de l'affrontement institutionnel actuel, reste la lutte des classes. Tout dépendra de la capacité à lui donner une continuité et une radicalité. La France a connu une succession de luttes impressionnantes au cours du mandat de Macron, dont l'objectif était de s'opposer aux réformes qui, dans l'esprit de Jupiter, devaient conclure l'expropriation des salaires et des revenus gagnée au siècle précédent, transférant d'énormes richesses du plus grand nombre vers une minorité. Ces luttes ont toutes été plus ou moins vaincues, tandis que la puissance néocoloniale française a été battue à plusieurs reprises en Afrique et a dû recourir à la violence pour se maintenir en Kanaky.
Sur les causes de la défaite qui se perpétue depuis des décennies et du sentiment d'impuissance qui se répand, mais aussi sur les victoires qui prennent pour l'instant la forme d'une crise institutionnelle et d'un succès électoral, il serait nécessaire d'ouvrir un débat. La conjoncture actuelle semble ressembler, à quelques différences près, à la situation de la fin du capitalisme compétitif qui a plongé dans la Première Guerre mondiale : guerre, guerre civile, lutte des classes et révolution. Ce quimanque aujourd'hui par rapport à il y a un siècle, ce sont les classes et la révolution. Le débat sur la faiblesse (mais aussi sur ses rares moments de force) de cette composition de classe, dépourvue de ces deux armes, doit aborder des questions difficiles mais décisives : la reformulation même du concept de classe et de révolution.
Les formidables luttes françaises se sont déroulées sans classe, où par "classe" je n'entends pas un groupe social homogène avec des intérêts communs qui déterminent mécaniquement le comportement politique. La classe n'a pas une existence sociologique, mais politique. La classe est le résultat de la lutte des classes.

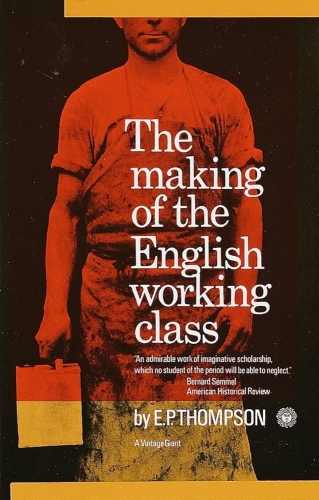
L'historien marxiste E. P. Thompson pose correctement les termes de la question en utilisant la métaphore de la machine et en suggérant, entre autres, que la classe, même la classe ouvrière, a toujours été non pas une identité, mais une multiplicité:
Les sociologues qui ont arrêté la machine à remonter le temps et sont descendus dans la salle des machines pour regarder, nous disent qu'ils n'ont pas pu identifier et classer une classe. Ils ne peuvent trouver qu'une multitude de personnes avec des professions, des revenus, des hiérarchies de statut et tout le reste. Bien sûr, ils ont raison, car la classe n'est pas telle ou telle partie de la machine, mais la manière dont la machine fonctionne une fois qu'elle est mise en mouvement - pas tel ou tel intérêt, mais la friction des intérêts - le mouvement lui-même, la chaleur, le bruit du tonnerre. La classe est une formation sociale et culturelle (qui trouve souvent une expression institutionnelle) qui ne peut être définie de manière abstraite ou isolée, mais uniquement en termes de relations avec d'autres classes ; et, en fin de compte, elle ne peut être définie que dans le temps, c'est-à-dire dans l'action et la réaction, le changement et le conflit. Lorsque nous parlons d'une classe, nous pensons à un corps très vaguement défini de personnes qui partagent le même ensemble d'intérêts, d'expériences sociales, de traditions et de systèmes de valeurs, qui sont disposées à se comporter comme une classe, à se définir dans leurs actions et leur conscience par rapport à d'autres groupes de personnes selon des modalités propres à la classe. Mais la classe elle-même n'est pas une chose, c'est un événement.
Comment traduire cette dernière phrase ? Mais la classe elle-même n'est pas une chose, c'est un événement ? S'agit-il de ce qui se produit ? Est-ce ce qui est fait au fil du temps ? Est-ce ce qui se construit à travers les stratégies qui naissent de l'affrontement avec l'ennemi ?
La classe ne doit pas être interprétée comme un processus de totalisation, ni comme un dispositif de réduction de la multiplicité. La classe n'est pas non plus la représentation politique d'un groupe sociologiquement défini - comme les ouvriers. La classe est l'organisation, toujours provisoire, toujours en formation, toujours en devenir d'une multiplicité qui, dans la polarisation, invente les armes (organisation et formes de lutte) pour se défendre et attaquer l'ennemi commun. Si la multiplicité, aujourd'hui comme hier, est une réalité incontournable de l'action politique, le dualisme l'est tout autant.
Le fascisme nous oblige à reconnaître que le problème ne peut être contourné, même électoralement. Pour s'opposer à l'imminence du danger fasciste, il y a eu une course au "front", c'est-à-dire à une polarisation autour de laquelle les différents points de vue pouvaient se composer : une multiplicité de partis agit à l'intérieur de la polarisation exprimée dans le système de la constitution formelle. La relation multiplicité/dualisme des mouvements, agissant au sein de la constitution matérielle du capitalisme, est une équation plus difficile à résoudre. Il ne faut pas se faire d'illusions : il n'y a pas d'alternative à la polarisation parce que le pouvoir est exclusif et totalisant. Exode, fuite, désertion, contournement, etc. sont des mots qui ne mordent pas sur le réel, qui ne déterminent pas les rapports de force.
La classe, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est pas une convergence générique de luttes ou une intersection irénique de mouvements, une collection de formes de vie, un assemblage cumulatif de relations à elle-même. Elle se forme dans la relation/le conflit avec d'autres classes, avec l'État mais, aujourd'hui, également dans la relation avec la guerre, la guerre civile, le génocide, le nouveau fascisme. Elle est le résultat d'une action stratégique : "action et réaction" qui se produisent dans le temps, où il s'agit de saisir l'"opportunité" dans les situations déterminées par le "pari des luttes" d'attaquer ou de se défendre.
Le capitalisme (État/Capitalisme) a gagné et continue de gagner parce qu'il a toujours pratiqué la lutte des classes, c'est-à-dire qu'il impose des dualismes (d'exploitation, de domination, de propriété) auxquels la multiplicité des mouvements ne peut opposer une force adéquate parce qu'au lieu d'imposer des polarisations (ruptures, révolutions) en définissant l'ennemi - ce qu'il est ensuite contraint de faire précipitamment lorsqu'il est aux portes du pouvoir - il les subit.
La classe se constitue et agit dans un cadre déterminé par les rapports de force. Ce cadre s'appelle aujourd'hui guerre, guerre civile, fascisme. Ce n'est qu'à l'intérieur de ces rapports qu'une force politique peut se construire.
La classe n'a pas une identité définie une fois pour toutes, elle évolue en fonction de la situation. Chaque changement dans les rapports de force la reconfigure. Lisons une autre déclaration lucide de Thompson :
Mais en termes de taille et de force, ces groupes sont toujours en hausse ou en baisse, leur conscience de l'identité de classe est soit brillante, soit à peine visible, leurs institutions sont agressives ou simplement maintenues en place par habitude (...) La politique se préoccupe souvent de cela précisément : comment la division en classes aura-t-elle lieu, où la ligne sera-t-elle tracée ? Et son tracé n'est pas (comme le pronom impersonnel incite l'esprit à l'accepter) une question de volonté consciente - ou même inconsciente - de "ça" (la classe), mais le résultat de compétences politiques et culturelles. Réduire la classe à une identité, c'est oublier exactement où se situe l'action, non pas dans la classe, mais dans les hommes.
Ces hommes ont été, pendant un siècle et demi, les révolutionnaires, parce qu'ils étaient capables de "tracer des lignes de démarcation". Mais à partir de la fin des années 70, la pensée critique nous a incités à abandonner le dualisme de la lutte des classes, en la séparant des actions micro-politiques, en privilégiant la production de la subjectivité, le rapport à soi, les formes de vie, de sorte que nous ne sommes plus en mesure d'anticiper ou de combattre les dualismes de la guerre, de la guerre civile, du génocide, et des nouveaux fascismes. J'espère que le danger fasciste a fait prendre conscience à tous que les différences, les multiplicités en tant que telles sont impuissantes si elles ne peuvent pas déterminer des instruments pour agir dans la lutte des classes, c'est-à-dire dans l'affrontement macro-politique. Le terme de classe peut être changé, ce qu'il importe de maintenir c'est le refus de fermer son élaboration, c'est le refus de lui imposer une identité (qu'est-il arrivé à la classe ouvrière !). Le processus de sa formation dépend de l'évolution de sa composition et de ses luttes, mais aussi d'événements "extérieurs" comme la guerre. Celle-ci est un moment charnière depuis que le capitalisme est devenu impérialisme et monopole. Le vote des crédits de guerre par la social-démocratie allemande et européenne en 1914 l'a placée pour toujours du côté de l'État et du capital, entraînant un profond changement dans le concept de classe.
La révolution a agi de la même manière, en opérant une discrimination au sein du prolétariat, en traçant de nouveaux contours de classe. Aujourd'hui, la révolution semble avoir disparu, mais ce n'est pas nouveau. Pendant longtemps, la lutte des classes s'est déroulée sans classe et sans révolution. Les révolutions héroïques, mais les premières victoires prolétariennes, les premières insurrections qui n'ont pas été suivies du massacre des insurgés, ont eu lieu lorsque la lutte des classes est passée de la "lente" guerre civile à l'organisation de l'affrontement concentré dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à la révolution. Tous les acquis des 150 dernières années sont le résultat de la menace de la révolution, suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des classes dirigeantes qui ne comprennent que les rapports de force, qui ne se plient qu'à l'utilisation d'une force comparable ou supérieure à la leur. Même la social-démocratie n'est possible que lorsque la révolution est en place ou possible.
Il est clair que seule une consolidation de la lutte des classes exprimée par une organisation de sa force, seule la capacité à déterminer des lignes de fractures radicales, pourra lever la "sursis" qui nous menace encore et vaincre l'alliance toujours présente entre libéraux, capitalistes et fascistes.
Notes:
[1] Pierre Dardot et Christian Laval, après avoir écrit 500 pages sur le néolibéralisme en suivant complètement les indications de Foucault (La nouvelle raison du monde), se sont vus reprocher par le premier Latino-Américain qu'ils ont rencontré d'avoir annulé les guerres civiles sanglantes dont il était issu. Comme leur maître Foucault, ils ont non seulement adopté un point de vue eurocentrique, mais ont semé une confusion, toujours d'actualité, en identifiant capitalisme et néolibéralisme. Dans leur livre Le choix de la guerre civile , ils tentent de mettre une rustine, qui est manifestement pire que le trou, en rejetant le "concept de guerre civile mondiale", qui est la différence spécifique introduite par l'impérialisme du 20e siècle. Une fois de plus, ils suivent Foucault, dont la définition de la guerre civile se limite au 19e siècle et ignore le saut effectué par le capitalisme, l'État (guerre mondiale totale et impérialisme) et la lutte des classes (guerre civile mondiale). Ils continuent à parler de néolibéralisme alors que la gouvernance est devenue "fasciste" et la guerre.

Maurizio Lazzarato vit et travaille à Paris. Parmi ses publications chez DeriveApprodi : La fabbrica dell'uomo indebitato (2012), Il governo dell'uomo indebitato (2013), Il capitalismo odia tutti (2019), Guerra o rivoluzione (2022), Guerra e moneta (2023). Son dernier ouvrage est World Civil War? (2024).

Recension du livre de M. Lazzarato, "Gouverner par la dette" (en anglais): https://www.theoryculturesociety.org/blog/review-maurizio-lazzarato-governing-by-debt
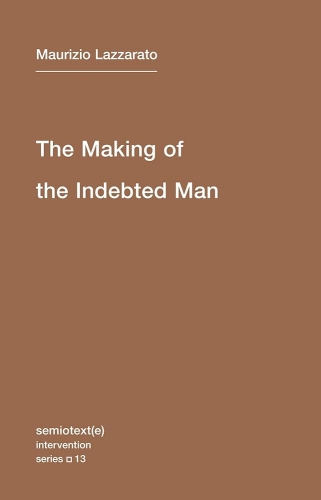
Recension du livre de M. Lazzarota, "La fabrication de l'homme endetté" (en anglais):
https://www.amazon.com/-/es/Maurizio-Lazzarato/dp/1584351152
14:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.