mardi, 16 décembre 2025
Face à la crise, une autre Europe

Face à la crise, une autre Europe
Pierre Le Vigan
La crise est en Europe, l’Europe est en crise. Nous l’analysions en 2012. Si les choses se sont aggravées, les origines de la crise économique restent les mêmes : la crise des économies et des sociétés européennes est avant tout une crise de la domination d’une certaine économie, financiarisée. Au détriment des producteurs européens.
 Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.
Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.
1 - La crise remonte, dit-on, à 2008. Estimez-vous que ses causes sont beaucoup plus anciennes ?
Depuis 2007 se sont succédé une crise financière (les ’’subprimes’’, des crédits à taux élevés amenant à une flambée des prix de l’immobilier) puis une crise bancaire, avec la faillite de certains établissements de crédit en 2008. Cela a généré une crise des Etats eux-mêmes, prenant en charges les déficits des banques, les renflouant et les sauvant. Ceci s’est manifesté par un déficit accru de leurs budgets, notamment sociaux, mais aussi par une réduction de leurs dépenses, même dans les domaines régaliens (défense, police, justice). Ce sont ensuite les banques, sauvées par les Etats, qui ont prêtés aux Etats, incapables de boucler leurs budgets sans déficits.
Compte tenu de la globalisation des systèmes financiers, la crise venue des Etats-Unis s’est diffusée partout. La seule crise des ‘‘subprimes’’ a abouti à la perte de quelques 2000 milliards de dollars, soit environ le PIB de la France d’alors (2008). Puis est intervenu le plan de sauvetage des banques américaines. Il a été de l’ordre de 700 milliards de dollars. Les Etats ont ensuite mis sur pied des plans de relance de l’économie : ce furent des plans nationaux. Ils ont eu un effet très modeste. En 2012, dans les plupart des pays d’Europe, la non-croissance s’est confirmée, quand ce n’est pas la récession pure et simple. Le chômage s’aggrave, les plans de réduction des déficits sont à l’évidence intenables, et pas seulement en Grèce.
C’est dans la mesure où aucun problème économique n’a été réglé début 2020 que le Covid a été un prétexte pour engager une dévalorisation massive de l’argent (du Capital) par la mutualisation partielle des dettes d’Etat, et par un plan de relance (subventions et emprunts de 750 milliards d’euros). C’est l’hélicoptère à Covid qui a déversé ces sommes, créées par la planche à billets, sur l’Europe. Ces sommes ne correspondent à aucune valeur dans l’économie réelle. Tout ceci était prévu auparavant au nom de l’ « urgence » écologique. Mais il a été plus facile de faire passer ces mesures au nom du Covid 19, à partir d’une savante orchestration de la peur d’une maladie fort peu létale. Le Covid (c’est le virus du covid et non la maladie du covid) a ainsi été l’occasion de faire sauter des verrous qui étaient de moins en moins tenables et de moins en moins tenus : les 3 % de déficit des budgets publics, le taux de 60 % d’endettement. Sur ces 2 critères, la France est à 9 % de déficit, et 120 % de dette. Autant dire que le Covid a été le moyen, qui ne doit pas grand-chose au hasard, d’opérer une transformation du management du Capital. C’est ce que l’on appelle la Grande Réinitialisation (Great Reset), à la suite de Klaus Schwab qui en a défendu le projet dans un livre.
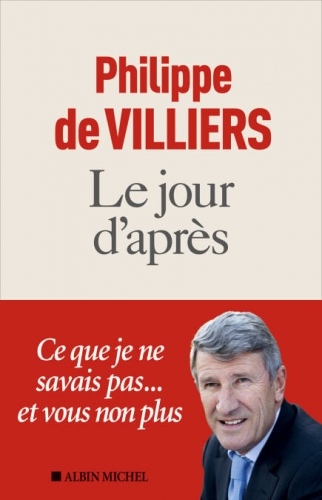 Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes.
Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes.
Ayant acté la totale désindustrialisation de notre pays, nos gouvernants n’ont gardé qu’un objectif : le contrôle de la population et les profits des gros actionnaires. Déjà, Jospin, de 1997 à 2002, avait largement privatisé. De 2012 à 2017, le gouvernement Hollande s’est lancé dans une politique de soumission accrue à la finance. « Dans 5 ans, Hollande sera un géant ou un nain », affirmait Emmanuel Todd (Marianne, 5 octobre 2012). On a vu le résultat. La politique de Macron depuis 2017 a consisté à la fois à essayer de comprimer les dépenses publiques – mais sans réduire aucunement l’immigration, tout au contraire – notamment à comprimer les indispensables dépenses régaliennes, et à brader à l’étranger ce qu’il restait de nos fleurons industriels. Seuls les profits de la finance intéressent Macron (c’est son cœur de métier) et seuls ces profits sont la préoccupation de ceux qui l’ont porté au pouvoir comme délégué du Capital. Ces gens sont bien entendu les ennemis de notre pays.
* * *
Il faut toutefois remonter avant 2008 pour comprendre la crise. Ses racines sont plus anciennes. Elles remontent à la fin de la convertibilité du dollar en or (1971), à la suraccumulation du capital, dont la genèse est analysée dans Le Capital de Marx (livre III, chapitre 15), à sa perte consécutive de profitabilité, aux différentes formes de dévalorisation de ce capital par obsolescence accélérée, au surenchérissement des matières premières du à leur caractère limité, au coût croissant de leur extraction.
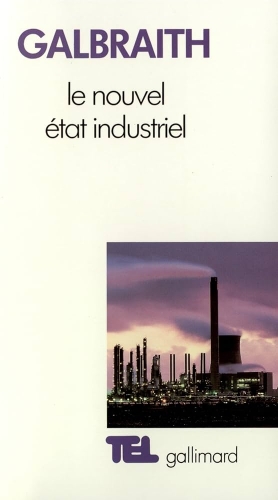 Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).
Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).
Depuis la fin du fordisme, nous n’avons pas de modèle viable. La richesse se concentre à un pôle de la société, et la pauvreté partout ailleurs. C’est la « société en sablier » (Alain Lipietz, 1998). 50 % des Américains se partagent un peu plus de 1 % de la richesse du pays. 50 % de la population mondiale se partagent 2 % de la richesse mondiale. Il n’est pas besoin d’être un égalitariste forcené pour constater que cet écart est excessif, malsain et même suicidaire. Quand, il y a un siècle, un patron gagnait quelque 30 fois le salaire de son ouvrier le moins bien payé, l’écart est passé à 400 ou 500 fois. Le travail devient rare, les machines ont remplacé les hommes et, plus encore, les hommes les moins bien payés remplacent sans fin ceux qui sont encore un peu mieux payés. Les Cambodgiens remplacent les ouvriers Chinois, en attendant d’être remplacés eux-mêmes par des Africains quand ceux-ci seront pleinement intégrés au marché mondial.
 Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.
Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.
« L’universel, c’est le local moins les murs », dit Miguel Torga. Il est temps de réhabiliter le local car l’universel qui prétendrait se passer du local tuerait la vie elle-même dans sa chair. Ce n’est pas un hasard si c’est un « petit » peuple comme les Islandais, héritier d’une longue tradition démocratique, qui a donné le signal de l’indépendance retrouvée. De même que c’est dans la « petite » Suisse qu’il y a encore quelques éléments d’une vraie démocratie. « Small is beautiful ». Small peut en tout cas être plus efficace que le gigantisme.
2 - Au-delà d’une simple crise économique, pensez-vous que nous avons affaire à une crise beaucoup plus profonde ?
 Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise.
Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise.
La crise économique est d’abord une crise de la domination de la vie par l’économique. « L’économisme est bien la grande idéologie actuelle », écrit Peter Ulrich. « Antérieurement, pas une seule forme d’argumentation idéologique n’a exercé d’influence comparable dans le monde. La critique de l’économisme ou la critique de la ratio économique exempt de toute limitation consiste, dans la perspective des sciences humaines, à rattraper un peu ce que le siècle des Lumières a réalisé. » C’est effectivement le paradoxe : les Lumières ont prétendu porter un projet d’émancipation, mais ont abouti à une nouvelle crédulité, à un nouvel obscurantisme : la croyance en la toute-puissance autorégulatrice de l’économie. C’est la traduction philosophique d’une réalité sociologique et politique, et celle-ci a été justement dénoncée sous le nom de dictature de l’argent.
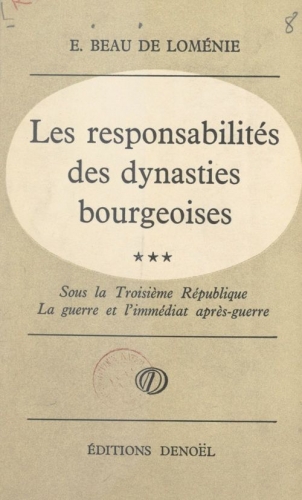 « L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.
« L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.
Avec l’Habeas Corpus de 1679, nous sommes passés de l’idée d’une société bonne à celle de justice dans les rapports sociaux, ce qui n’est pas la même chose. L’équité dans les rapports entre individus est nécessaire, mais elle n’a de sens que dans le cadre d’une pensée du bien commun. Nous sommes ensuite passés avec le triomphe de l’individualisme au XVIIIe siècle à la référence à l’idée d’intérêt comme seul facteur de légitimation : donner libre cours à la recherche de son intérêt serait la meilleure façon d’accroitre la richesse sociale globale, identifiée à ce qui reste du bien commun. Ce qui est bon pour moi serait automatiquement bon pour tous. C’est la Fable des abeilles (1714-1729) de Bernard Mandeville. C’est une habile façon de moraliser la recherche de son intérêt individuel. On n’est pas obligé d’être convaincu.
Si le bien commun n’est que ce qui est mesurable, alors, en effet, comment trouver quelque chose de plus rigoureusement mesurable que la richesse monétaire ? C’est pourquoi une solution purement économique à une crise qui n’est pas qu’économique n’a pas de sens. « Le refus d’envisager d’autres approches de la crise par les partis au pouvoir un peu partout en Europe, leur incapacité à penser hors du tout économique (entendez libéral) ne relève ni d’un complot, ni d’un manque d’imagination. Elle reflète à la fois les rapports de force actuels entre les acteurs et illustre combien le référentiel des hommes politiques est déphasé par rapport à la crise actuelle », écrit Michel Leis. Une civilisation meurt quand ses élites ne comprennent pas la nature d’un processus en cours, ou quand elles en sont complices – ce qui est le cas. Les « élites », ou plutôt les classes dirigeantes sont le moteur du productivisme effréné, de la mondialisation capitaliste, de la consommation et consumation de la planète par l’homme
La crise actuelle est d’une nature très différente des crises précédentes, comme par exemple celle qui a succédé à la défaite de 1870. Alors que l’éducation se répandait dans les années 1870-1880, nous sommes confrontés à une décivilisation, comme l’écrit Renaud Camus. L’homme se re-primitivise. C’est l’obsolescence de l’homme, et pas seulement celle des objets, qui menace. La technophilie devenue technofolie asservit l’homme. Appareillé, des écouteurs aux oreilles, tenu en laisse par ses propres instruments, devenu un appendice de ses propres prothèses, un périphérique de ses propres appareils, l’homme est devenu l’objet de ses objets.
 Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire.
Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire.
3 – Peut-on imaginer un instant que les politiciens français et européens actuels soient capables de résoudre cette crise ?
Il n’y a pas de nouveau de Gaulle, capable de prendre des décisions historiques tranchantes, fussent-elles douloureuses. Non que les hommes politiques français et européens soient tous médiocres. Jean-Pierre Chevènement, Arnaud Montebourg, quelques autres parfois n’ont pas formulé des analyses sans intérêt. Le problème est que la plupart des hommes politiques ont du mal à s’élever au-dessus des préoccupations économiques à court terme. Tout est fait au demeurant pour cela, toute la logique du système consiste à faire des élus des relais du système. La dévalorisation et même l’oubli de la culture générale, des humanités, de la culture historique contribuent aussi à leur enlever le recul qui serait nécessaire pour dépasser les préoccupations gestionnaires à court terme.
Dans le même temps, tout est mis en place pour limiter, voire interdire l’expression du peuple sur les sujets essentiels. Or, ce ne peut être que du peuple qu’un sursaut pourrait venir, en liaison bien entendu avec des activités militantes. « Il se trouve des époques violentes où l’Etat renaît pour ainsi dire de ses cendres et reprend la vigueur de la jeunesse … mais ces évènements sont rares », écrit Rousseau (Contrat social, livre II, chapitre VIII).
Il faut un événement déclencheur. Les couvercles les mieux arrimés finissent par sauter sous la pression. Demain est entre les mains du peuple. « Le peuple, qui a l'avenir et qui n'a pas le présent ; le peuple, orphelin, pauvre, intelligent et fort ; placé très bas, et aspirant très haut ; ayant sur le dos les marques de la servitude et dans le cœur les préméditations du génie » (Victor Hugo, préface de Ruy Blas).
4 – Face à cette crise, une autre Europe est-elle concevable ? Si oui, laquelle?
Je souhaite que les nations d’Europe pèsent dans le même sens: indépendance vis-à-vis des Etats-Unis, rapprochement sans asservissement avec la Russie. Je sais que les nations d’Europe pèseront plus ensemble que séparées. A condition que certaines ne soient pas le cheval de Troie de puissances non européennes. Je suis européen de cœur et je veux une Europe-puissance, mais pas seulement une Europe-puissance, je veux aussi une Europe comme modèle de civilisation. Une Europe-équilibre face aux excès de la modernité.

Nous refusons « la fourmilière américaine tout comme soviétique », disaient les non conformistes des années trente. Aujourd’hui, il s’agit de refuser tout aussi bien la financiarisation/désindustrialisation des économies américaines et européennes que le contrôle social de la Chine « Populaire » et son modèle de développement (à quel prix humain et écologique ?). Une dictature capitalo-communiste, dans le cadre d’une société de surveillance et d’une citoyenneté « à points » ? Non merci. Il faut aussi refuser la désindustrialisation chez nous et le développementisme à tout prix ailleurs pour une autre raison : l’un est la condition de l’autre, l’un est l’autre face de l’autre. C’est parce qu’il n’y a plus d’industrie en Europe – et surtout en France – qu’elle est en Asie.
Il faut assurément que l’Europe retrouve une économie industrielle, que seule l’Allemagne garde (relativement d’ailleurs, car elle est largement sous-traitée en Europe de l’est). Mais ce retour à l’industrie doit se faire de manière ordonnée et responsable par rapport à l’environnement. (il est à noter que notre agriculture productiviste est infiniment plus dévastatrice par rapport à l’environnement que ne le seraient nombre d’industries disparues du paysage de notre pays).
Concernant la méthode, l’objectif d’une Europe confédérale, ce que j’appelle l’Empire européen (un Empire non impérialiste, qui serait l’organisation de la diversité des peuples européens), me parait souhaitable, mais il est évident qu’une Europe confédérée n’a de sens que si elle est aux mains des peuples. Or, la « construction » européenne actuelle en est très éloignée. Dés lors, il faut savoir faire un pas en arrière quand on va dans une mauvaise direction. C’est pourquoi ceux qui prédisent la sortie de l’euro et pensent que nous devons l’anticiper, ou ceux qui pensent que l’euro devrait devenir une simple monnaie commune (si cela est possible), et non pas unique, ne me paraissent pas forcément de « mauvais Européens ».
 La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde.
La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde.
PLV
Pierre Le Vigan a publié :
L’effacement du politique, La barque d’or
Le grand empêchement. Comment le libéralisme entrave les peuples, Perspectives libres-Cercle Aristote
Eparpillé façon puzzle. Macron contre le peuple et les libertés, Perspectives libres-Cercle Aristote
Le Coma français, Perspectives libres-Cercle Aristote
17:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, crise, crise de 2008, libéralisme, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Écrire un commentaire