Un épais silence a vite recouvert la nouvelle. Ni le monde politique ni le monde financier n’ont très envie de s’étendre sur le sujet. Pourtant, le désastre est immense : Dexia est en faillite, et cette faillite est désormais comparable à celle du Crédit lyonnais. Jeudi, la banque franco-belge a publié le premier prix de sa mort annoncée dès octobre. En 2011, elle a enregistré une perte de 11,6 milliards d’euros. Ajoutés aux 6 milliards d’euros perdus depuis trois ans, l’addition s’élève déjà à plus de 18 milliards d’euros!
18 milliards d’euros perdus dans le silence. A titre de comparaison, les pertes anticipées du régime de retraite à l’horizon de 2020 étaient de l’ordre de 20 milliards d’euros. Et le gouvernement jugea qu’il n’y avait pas une minute à perdre : il fallait dans l’urgence mener une réforme bâclée et injuste. Mais manifestement, les milliards des systèmes sociaux ne pèsent pas le même poids que les milliards du monde financier.
Cette facture ne reflète que les premiers comptes de son démantèlement en cours, devenu inévitable depuis octobre (voir Dexia se meurt, Dexia est morte). La séparation de sa banque commerciale belge, reprise en urgence par l’Etat belge, lui coûte 4 milliards d’euros ; la cession d’autres activités, 500 millions de pertes ; les pertes sur la dette grecque, qu’elle avait conservée à la différence de tant d’autres banques et qu’elle a dû déprécier à hauteur de 75 %, 2,3 milliards ; les produits de couverture qui y étaient liés, plus d’1 milliard ; la liquidation d’une partie de son portefeuille obligataire et de ses produits toxiques, près de 2 milliards, etc.
L’addition ne peut que s’alourdir dans le temps. Le bilan de Dexia s’élève encore à plus de 500 milliards d’euros. Il reste plus de 100 milliards dans le portefeuille obligataire de la banque franco-belge. L’ensemble a été logé dans une structure de défaisance (une bad bank), qui bénéficie d’une garantie de 90 milliards d’euros de la part des Etats belge, français et luxembourgeois. Pour assurer ses financements au jour le jour, la banque ne survit plus que sous la respiration artificielle de la Banque centrale européenne. Celle-ci lui assure au moins 35 milliards d’euros de financement à court terme et lui a prêté 20 milliards d’euros supplémentaires dans le cadre du grand emprunt (LTRO) lancé par Mario Draghi, fin décembre.
L’Etat français, de son côté, a volé à son secours en reprenant la filiale française spécialisée dans le financement des crédits aux collectivités locales, Dexia Municipal Agency (ex-Crédit local de France) avec la Caisse des dépôts et la banque postale. Ce sont 15 milliards d’euros, au bas mot, qui vont être mobilisés dans cette opération.
On jongle avec les milliards, sans qu’il soit possible, à ce stade, de prédire le coût final de cette faillite. L’évolution de la crise de la dette, de la zone euro, des marchés financiers, comme l’exécution de l’extinction du groupe bancaire sont autant de facteurs qui peuvent modifier de façon spectaculaire l’équation. Mais quelles que soient les circonstances, le prix s’annonce déjà énorme pour les finances publiques. Car une fois de plus, ce sont les Etats qui sont appelés à la rescousse d’une finance privée défaillante.
Un sauvetage sur mesure
Même si le monde bancaire a jeté un voile pudique sur le cas Dexia, les raisons de cette faillite, évidente depuis 2008, sont connues : l’hubris. Poussés par une volonté de pouvoir, une soif d’argent, déguisées sous les prétextes de la mondialisation et du libéralisme, ses dirigeants ont sombré dans toutes les folies financières (voir notre enquête « Dexia une faillite d’Etat »). Ceux-ci ont arraché, pour leur seul profit, une structure publique spécialisée dans le financement des collectivités locales pour en faire un immense hedge fund privé, mais semblant toujours sous la protection de l’Etat.
Au plus fort de son développement, la banque franco-belge avait engagé plus de 250 milliards d’euros dans d’innombrables produits structurés opaques. Elle était devenue rehausseur de crédit aux Etats-Unis, un des premiers acteurs sur le marché des subprimes, financier des municipalités américaines et japonaises. Quatorze salles de marché travaillaient en permanence pour les activités du groupe, pour assurer son financement et spéculer pour son compte.
« La crise nous a déstabilisé », a avancé comme excuse Pierre Richard, grand organisateur de l’aventure Dexia depuis le début. Sans la crise, la banque aurait tout de même explosé : à sa période de « gloire », les besoins de financement à court terme de la banque s’élèvaient à plus de 260 milliards d’euros ; 46 % de ses financements étaient assurés par les marchés.
Mais à cette faillite originelle s’ajoute désormais une autre question : le sauvetage de Dexia, tel qu’il a été organisé et mené depuis trois ans, convenait-il ? D’autant qu’il n’a pas empêché la faillite finale.
En octobre 2008, dans la panique de la chute de Lehman Brothers, Nicolas Sarkozy presse le gouvernement belge de voler au secours de Dexia, au bord de l’effondrement. Le monde bancaire multiplie les alarmes auprès de l’Elysée : « Dexia est en danger. Sa faillite représente un risque systémique pour le système bancaire. »
Michel Pébereau, le président de BNP Paribas, est dans le bureau de Christine Lagarde, alors ministre des finances, pour écrire lui-même le plan de sauvetage de la banque franco-belge, au plus fort de la crise. La solution s’impose : seule, la puissance publique a les moyens d’éviter le désastre.
Les Etats français, belge et luxembourgeois vont se porter au secours de Dexia. Curieusement, ils ne la nationalisent pas, sans autre condition. Ils préfèrent souscrire à une augmentation de capital d’un peu plus de 6,5 milliards d’euros, pour le plus grand bonheur des actionnaires précédents. Alors que ces derniers auraient dû tout perdre, ils se voient au contraire ménagés : la recapitalisation des Etats se fait à 9,90 euros par action, alors que le cours est déjà à peine de 6 euros. D’emblée, les Etats acceptent de prendre une moins-value de 2,2 milliards d’euros, dont 900 millions d’euros pour les finances publiques françaises. Aujourd’hui, ils ont tout perdu.
« Cela restera comme la seule recapitalisation de l’histoire réalisée au-dessus de son cours de Bourse », ne peut s’empêcher de souligner un connaisseur du dossier, toujours très étonné par le traitement privilégié réservé aux actionnaires précédents. Il y avait manifestement des intérêts à ménager.
Dans les discussions, Nicolas Sarkozy a imposé que Pierre Mariani, son ancien bras droit au ministère du budget en 1993, devenu par la suite banquier à BNP Paribas, prenne la direction opérationnelle de Dexia. Pour respecter les apparences diplomatiques, Jean-Luc Dehaene, le roi du compromis à la belge de ces vingt dernières années, est nommé président de conseil de surveillance.
Quelle est alors la mission de ce curieux attelage ? D’abord, gagner du temps. Les dirigeants financiers et politiques sont persuadés que la crise n’est que momentanée, que tout va revenir très vite comme avant. De plus, par tradition, les banquiers estiment que le temps est le meilleur allié pour déminer les situations explosives : les vieilles dettes et les erreurs finissent toujours par s’oublier sous la poussière des années. Et puis, comme dans le cas de la crise grecque, cela permet à chacun de prendre ses dispositions et de ne pas être pris par surprise.
Qui aurait porté les pertes ?
Pierre Mariani devient ainsi syndic de faillite. Pendant des mois, il s’active à nettoyer le bilan de la banque. Les activités américaines sont vendues, le portefeuille obligataire est réduit de 265 milliards à une centaine de milliards, d’autres filiales cédées. Fin 2010, il assure que la banque est en voie de se redresser, avant que tout ne s’écroule huit mois plus tard. « Le sauvetage de la banque était jouable, si la deuxième crise de la dette n’était pas survenue à l’été 2011, si l’agence de notation Moody’s ne nous avait pas dégradé », a expliqué à plusieurs reprises Pierre Mariani. Pour lui, c’est cet enchaînement fatal qui a scié net la banque. En quelques semaines, la banque s’est retrouvée étranglée.
L’explication n’a jamais totalement convaincu. Dexia était-elle vraiment sur la voie de la convalescence ? N’a-t-on pas gagné seulement du temps pour désamorcer les dossiers les plus graves, notamment les engagements américains qui mettaient en danger l’Etat français ?
Côté belge, on soupçonne Pierre Mariani de n’avoir travaillé que pour sauvegarder les intérêts français plutôt que ceux de la banque. Dès le printemps, surviennent une série de démissions chez les dirigeants belges de la banque, dont celle du directeur financier de la banque, marquant leur désaccord avec la conduite de Dexia.
Jugé comme la caricature du haut fonctionnaire français froid et arrogant, il est reproché à Pierre Mariani d’écarter tous les avis internes au profit des seuls conseils du cabinet Bain, généreusement payé au passage : plus de 100 millions d’euros. « Toute la banque a alors été vidée de sa substance », dit un ancien dirigeant belge.
Si le démantèlement était inévitable, pourquoi alors ne pas l’avoir mis en œuvre dès 2008 plutôt que d’avoir laissé le problème perdurer trois années ? Car la liquidation en bon ordre et sans trop de dégâts de la banque, de son portefeuille, de ses actifs semble encore plus difficile aujourd’hui qu’hier. « Peut-être était-il possible d’aller plus vite sur certaines ventes. Mais le démantèlement était impossible en 2008. A l’époque, le bilan de Dexia est de 650 milliards d’euros. Il était beaucoup plus gros que celui de Lehman Brothers. Cela représentait un risque systémique pour le secteur bancaire européen. Vendre vite aurait alors cristallisé les pertes. Qui les aurait portées ? Les autres banques n’ont pas eu à souffrir de ce désastre. Il n’y a pas eu de scandale », explique un proche du dossier, imbibé du mode de pensée de l’Inspection des finances.
Pour Bercy, pour l’Inspection des finances, il n’y a effectivement pas de scandale autour de Dexia. La banque va peut-être coûter plus cher aux finances publiques que le sauvetage de la Grèce mais l’important est que cela ne fasse pas de bruit. Les milliards de pertes sont en train d’être passés en douceur. Et désormais, on sait qui porte les pertes : les Etats.
En toute impunité
La Belgique a déjà dû débourser quatre milliards d’euros pour assurer la continuité de l’activité de banque de dépôts de Dexia dans le pays. Pour assurer la continuité d’une banque de crédit aux collectivités locales, la France a quant à elle dû revoir son plan de sauvetage tel qu’il avait été adopté en novembre par le parlement : la charge, transférée pour l’essentiel à la Caisse des dépôts, était trop lourde même pour l’institution gérant l’épargne publique des Français.
Au travers d’une usine à gaz, l’Etat va devenir actionnaire à hauteur de 46,3 %, aux côtés de la Caisse des dépôts et de La Poste pour recréer une banque des collectivités locales. Il est déjà prévu de détourner 12 milliards d’euros du Livret A pour assurer le financement de la banque et permettre aux collectivités de renégocier leurs 70 milliards d’emprunts toxiques.
Il faut enfin gérer l’extinction de la banque. Dans le plan de démantèlement prévu, les Etats belge, français et luxembourgeois se sont portés garants de fin de vie du bilan de Dexia. Celui s’élève encore à 500 milliards d’euros, c’est juste une fois et demie l’endettement de la Grèce. Mais là aussi, les chiffres sont sobrement tus. Les Etats ont tout accepté sans faire le tri sur les risques.
La garantie des trois Etats est de 90 milliards, dont 45 milliards pour la Belgique, 39 milliards pour la France et 6 milliards pour le Luxembourg. Pour la Belgique, la garantie représente 15 % de son PIB. La commission européenne, pourtant si sourcilleuse sur la rigueur des finances publiques, ne s’est pas beaucoup émue de cet engagement hors bilan. « On fait comme si cet engagement était sans risque, comme si les garanties ne devaient jamais être appelées. Mais qui le peut dire ? », remarque un proche du dossier.
Dans son communiqué de résultat, Dexia souligne elle-même les périls qui subsistent. Elle conditionne sa survie jusqu’à une fermeture ordonnée au maintien des Etats, à une rémunération très faible de ces garanties, à une acceptation de ces conditions par la Commission européenne. « En l’absence de mesures complémentaires correctrices, la non-matérialisation de l’une ou plusieurs de ces hypothèses pourrait avoir un impact sur la situation de continuité d’exploitation de Dexia et engendrer des tensions sur la situation de liquidité et de solvabilité du groupe. » En un mot, la banque peut sauter à tout moment et nous avec.
Devant une telle faillite financière, économique, morale, il serait légitime que les Etats demandent au moins des comptes. Le scandale du Crédit lyonnais avait conduit à des enquêtes parlementaires, à des explications publiques, à un procès et des condamnations. Mais sur Dexia, rien.
L’ancien dirigeant, Pierre Richard, inventeur de cette machine infernale, continue à couler des jours tranquilles comme conseiller de la Banque européenne d’investissement et parfois auprès du gouvernement sur la réforme des collectivités locales. Au titre d’ancien président de Dexia, il touche une retraite-chapeau, qui vient donc en supplément de sa pension normale, de 600.000 euros par an. Une provision de 11 millions a été constituée dans le bilan de Dexia pour assurer son versement.
Lors du conseil d’administration de Dexia, entérinant les pertes colossales, les administrateurs ont indiqué qu’ils étudiaient les éventuelles voies de recours pour suspendre cette retraite extraordinaire. Mais ils ne sont pas sûrs d’aboutir. Car désormais, dans ce monde, même quand les Etats paient les faillites privées, le contrat l’emporte sur la loi.
Les autres anciens dirigeants de la banque bénéficient eux aussi de la totale impunité, reconnue au monde de la finance en général, aux inspecteurs des finances en particulier. Bruno Deletré, ancien responsable des produits structurés chez Dexia, est désormais directeur général du Crédit foncier. Gérard Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit Local, est devenu directeur général délégué en charge du pôle entreprises et institutionnels de Crédit Mutuel-Arkéa. Alain Delouis, ancien directeur Dexia SA, a trouvé refuge chez Natixis comme directeur des ressources humaines. Sans oublier Gilles Benoist, qui a présidé aux débuts de l’aventure de Dexia aux côtés de Pierre Richard, qui dirige maintenant la CNP et aspire à en devenir président.
Il est vrai qu’il aurait été dommage pour le monde bancaire et financier de se priver de tant de talents. D’autant que « les banques n’ont rien coûté à l’Etat », comme le disaient certains…
Mediapart




 Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.
Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.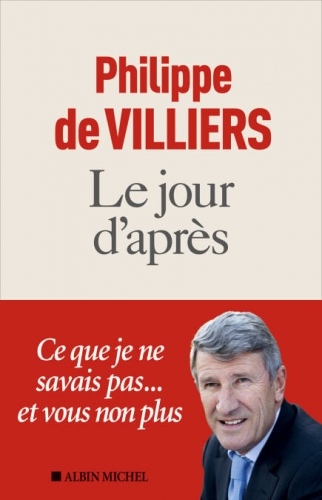 Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes.
Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes. 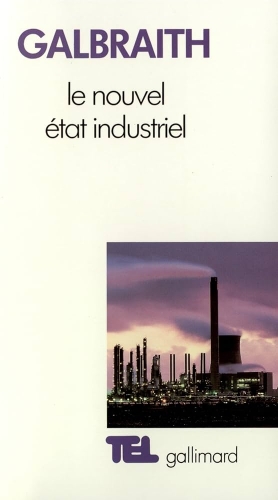 Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).
Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).  Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.
Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.  Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise.
Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise. 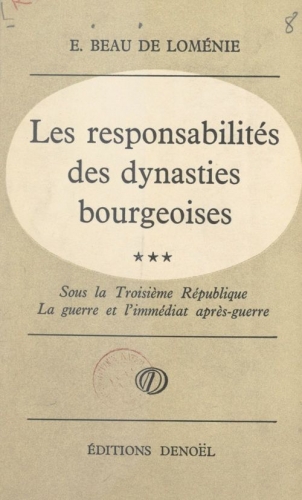 « L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.
« L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.  Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire.
Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire. 
 La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde.
La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde. 
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Ex: http://mediabenews.wordpress.com/