vendredi, 11 décembre 2020
Stanislaw Ignacy Witkiewicz - Le Désastre et l’Adieu

Luc-Olivier d’Algange:
Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Le Désastre et l’Adieu
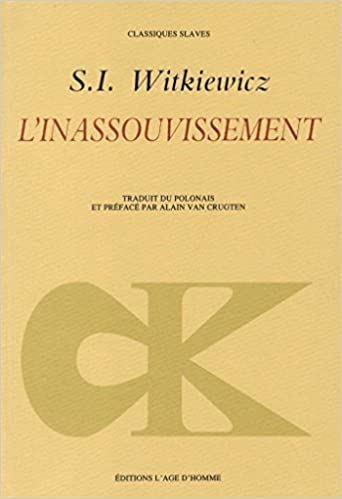 Stanislaw Ignacy Witkiewicz fut une des figures majeures de l’avant-garde polonaise de Zakopane avec ses amis Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Tadeusz Kantor, lequel fut son metteur en scène. Né le 24 février 1885 à Varsovie, il mit fin à ses jours en 1939, après s’être adonné à la littérature, au théâtre, à la philosophie, à la peinture, à la photographie, dans un jaillissement créateur ininterrompu. Surtout connu comme homme de théâtre, il est aussi l’auteur de plusieurs romans qui subvertissent radicalement, à l’égal de James Joyce, l’art romanesque, parmi lesquelles, Les 622 chutes de Bungo, L’Adieu à l’automne et L’Inassouvissement, autobiographie hallucinée et uchronie terrifiante et prophétique, que les éditions Noir sur Blanc ont pris l’heureuse initiative de rééditer dans la « Bibliothèque de Dimitri », ainsi intitulée en hommage à Vladimir Dimitrijevic, fondateur des éditions L’Âge d’Homme. Peu d’œuvres auront davantage fait se heurter, en présence d’un désastre grandiose, le passé et l’avenir, ce qui disparaît et ce qui doit advenir – au point de révoquer en doute la nature même de l’existence des êtres et des choses, et à peu près tout ce que nous pensions savoir de l’esprit humain. L’occasion nous est ainsi donnée de revenir sur cette pensée en action qu’est l’œuvre polyphonique de Witkiewicz.
Stanislaw Ignacy Witkiewicz fut une des figures majeures de l’avant-garde polonaise de Zakopane avec ses amis Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Tadeusz Kantor, lequel fut son metteur en scène. Né le 24 février 1885 à Varsovie, il mit fin à ses jours en 1939, après s’être adonné à la littérature, au théâtre, à la philosophie, à la peinture, à la photographie, dans un jaillissement créateur ininterrompu. Surtout connu comme homme de théâtre, il est aussi l’auteur de plusieurs romans qui subvertissent radicalement, à l’égal de James Joyce, l’art romanesque, parmi lesquelles, Les 622 chutes de Bungo, L’Adieu à l’automne et L’Inassouvissement, autobiographie hallucinée et uchronie terrifiante et prophétique, que les éditions Noir sur Blanc ont pris l’heureuse initiative de rééditer dans la « Bibliothèque de Dimitri », ainsi intitulée en hommage à Vladimir Dimitrijevic, fondateur des éditions L’Âge d’Homme. Peu d’œuvres auront davantage fait se heurter, en présence d’un désastre grandiose, le passé et l’avenir, ce qui disparaît et ce qui doit advenir – au point de révoquer en doute la nature même de l’existence des êtres et des choses, et à peu près tout ce que nous pensions savoir de l’esprit humain. L’occasion nous est ainsi donnée de revenir sur cette pensée en action qu’est l’œuvre polyphonique de Witkiewicz.
Ce précipité du temps porté à incandescence ne relève en rien de la fantaisie ou de l’arbitraire d’une subjectivité : la situation historique nous renseigne ; Witkiewicz se donne la mort à l’entrée des troupes étrangères dans son pays. Le passé était détruit, et l’avenir au « nivellisme », autrement dit à la suprême égalité de la mort. Mais avant de se donner la mort, cet homme qui fut prodigieusement un grand vivant fit de l’art, de la littérature, de la philosophie, de l’amour, de la science, de l’ivresse autant d’expériences métaphysiques, mues par une énergie et une discipline peu communes. Avant de quitter le monde qu’il avait prodigieusement honoré de son intelligence et de ses passions, Witkiewicz, qui se considérait d’abord comme un philosophe, écrivit donc des romans, considérant que la genèse d’une pensée vaut autant que la pensée elle-même dans ses résultats et qu’un roman, diachronique plus que synchronique, témoigne mieux qu’un traité de ces temporalités abruptes ou bouleversées qui révèlent des causes lointaines et des effets indiscernables, sans plus céder à l’illusion scientiste des expériences reproductibles. Là où les systèmes traitent de cas généraux, avec des paramètres en nombres limités, le roman décrit des cas particuliers, avec des paramètres en nombre infini. Là où les systèmes définissent l’humanité en général, le roman va à la rencontre des hommes de chair et de sang, les « frères, les vrais frères », comme disait Miguel de Unamuno.

Witkiewicz se pose ainsi la question de l’individu, au moment où il lui semble que celui-ci est sur le point de disparaître. Qu’est-ce qu’un individu ? Pour lui, l’individu – ce qui ne peut se diviser – est un irréductible, un indivis, et aussi, comme en témoigne la dernière phrase de L’Adieu à l’Automne, un drôle d’individu, une sorte de mauvais sujet, un mal-pensant.
Dès lors qu’elle échappe à la réduction au plus petit commun dénominateur et qu’elle ose être un défi aux convenances, la pensée ne témoigne plus que pour elle-même. Toutefois, écrit Witkiewicz, « la caractéristique du moment, c’est que l’âme médiocre, se sachant médiocre, a la hardiesse d’affirmer les droits de la médiocrité et de les imposer partout ». Les six décennies qui nous séparent de sa mort, l’une après l’autre, confirment ses vues : « Le nivellisme : cette idée maniaque était comme un fleuve dans lequel s’écoulaient depuis un certain temps, comme de petites rivières, toutes ses autres pensées ; ce fleuve se jetait dans la mer : dans l’idée s’une société d’automates désindividualisés. S’automatiser au plus vite et cesser de souffrir ! »
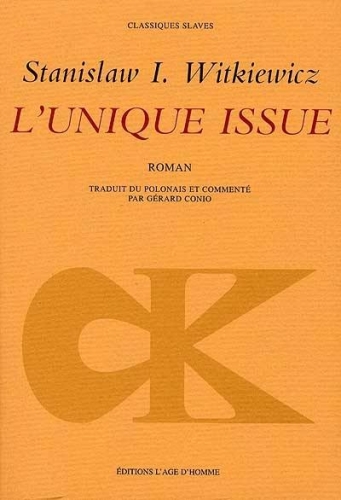 Ce que Witkiewicz nomme le « nivellisme » ne porte pas seulement atteinte à ses goûts ; et il serait trop facile d’opposer le généreux sens commun aux préférences aristocratiques de l’esthète. Ce « nivellisme » est aussi et surtout une négation de la nature humaine dans ses nuances et gradations. Emprisonné dans un seul temps, dans un seul état de conscience et d’être, une seule destinée, nous voici, tel du bétail, au nom du bonheur collectif ou de « l’homme nouveau », livrés à la pire des régressions. Le « nivellisme » sera donc une mise en demeure, à celui qui ne voudra pas s’y résigner, de sauver, une dernière fois avant l’« Adieu », toutes les puissances de l’intelligence, de l’imagination et du désir humain.
Ce que Witkiewicz nomme le « nivellisme » ne porte pas seulement atteinte à ses goûts ; et il serait trop facile d’opposer le généreux sens commun aux préférences aristocratiques de l’esthète. Ce « nivellisme » est aussi et surtout une négation de la nature humaine dans ses nuances et gradations. Emprisonné dans un seul temps, dans un seul état de conscience et d’être, une seule destinée, nous voici, tel du bétail, au nom du bonheur collectif ou de « l’homme nouveau », livrés à la pire des régressions. Le « nivellisme » sera donc une mise en demeure, à celui qui ne voudra pas s’y résigner, de sauver, une dernière fois avant l’« Adieu », toutes les puissances de l’intelligence, de l’imagination et du désir humain.
Les hallucinogènes, les narcotiques et excitants divers seront, par exemple, pour Witkiewicz, non des complaisances au désespoir et à la confusion, mais des clefs ouvrant à divers états de conscience qui aiguiseront, à l’inverse, la lucidité qu’ils ont pour fonction d’exacerber ou de troubler. De même la culture encyclopédique, loin de ramener au bercail d’un savoir commun, sera pour l’auteur de L’inassouvissement une mise en abyme de l’étonnement : pouvoir être quelques instants l’infini à soi-même et comme la toute-possibilité du monde, mais détachée : « Ensuite un soleil gigantesque, de grands chats paresseux, des serpents et des condors tristes, tous devenaient lui-même et en même temps n’étaient pas du tout lui. »
Toute philosophie, nous le savons depuis Nietzsche, est toujours autobiographique. Celle de Witkiewicz est un combat dans le désastre, un « Adieu » au monde héraldique, en abyme, où le visible fût plus mystérieux encore que l’invisible dont il est l’empreinte. Un « Adieu » au monde complexe, tourmenté et fallacieux qui devra laisser place à un monde déterminé, banal, simple et sincère – celui des derniers des hommes dont parle Nietzsche – où la conscience réduite à l’utilité sociale se laissera borner par une morale puritaine, où l’existence comme une corolle frémissante, une corolle épouvantée, s’étiolera dans la communication de masse et l’éclairage sans ombre portée des salles d’opération.
Avant que cette banalité ne fît oublier les fastes qui la précédèrent, avant l’« Adieu », avant « l’oubli de l’oubli » des hommes heureux, des amnésiques, qui, je cite, « ne sauront plus rien de leur déchéance », autrement dit avant la bestialisation et l’infantilisation totale de l’espèce, qui rebutera définitivement la beauté du monde, Witkiewicz évoquera donc le moment inaugural de la pensée : « Donc tout existe quand même. Cette constatation n’était pas aussi banale qu’elle pouvait paraître. L’ontologie subconsciente, animale, principalement animiste, n’est rien à côté du premier éblouissement de l’ontologie conceptuelle, du premier jugement existentiel. Le fait de l’existence en lui-même n’avait jusqu’alors représenté pour lui rien d’étrange. Pour la première fois il comprenait l’insondabilité abyssale de ce problème ».
 Avant donc la culture commune « conviviale, festive, et citoyenne », avant « l’homme-masse » – et je renvoie ici à l’excellente post-face à L’Adieu à l’Automne, d’Alain van Crugten, pour la comparaison avec Ortega –, Witkiewicz retourne aux ressources profondes de la culture européenne, à l’esprit critique, à l’ontologie conceptuelle qui laisse entre les hommes et le monde, entre les hommes entre eux, entre la certitude et le doute, entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être, une distance, une attention, lesquelles nous rendent à la possibilité magnifique et terrible d’être dissemblables et seuls, au lieu d’être voués, de naissance, à cette fusion sociale purement immanente, ce grégarisme, qui évoque bien davantage la vie des insecte que l’humanitas. Quoi qu’on en veuille, et l’œuvre de Witkiewicz est ici anticipatrice, sinon prophétique ; le « nivellisme », nous y sommes, menacés par la facilité, et « cette sensation de triomphe et de domination qu’éprouvera en lui chaque individu moyen ». L’individu moyen, se concevant et se revendiquant comme moyen sera non le maître sans esclave rêvé par les utopies généreuses, mais l’esclave sans maître, c’est à dire le dominateur le plus impitoyable, le plus résolu, le mieux armé, par sa quantité, le plus administratif, le mieux assis dans sa conviction d’incarner le Bien.
Avant donc la culture commune « conviviale, festive, et citoyenne », avant « l’homme-masse » – et je renvoie ici à l’excellente post-face à L’Adieu à l’Automne, d’Alain van Crugten, pour la comparaison avec Ortega –, Witkiewicz retourne aux ressources profondes de la culture européenne, à l’esprit critique, à l’ontologie conceptuelle qui laisse entre les hommes et le monde, entre les hommes entre eux, entre la certitude et le doute, entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être, une distance, une attention, lesquelles nous rendent à la possibilité magnifique et terrible d’être dissemblables et seuls, au lieu d’être voués, de naissance, à cette fusion sociale purement immanente, ce grégarisme, qui évoque bien davantage la vie des insecte que l’humanitas. Quoi qu’on en veuille, et l’œuvre de Witkiewicz est ici anticipatrice, sinon prophétique ; le « nivellisme », nous y sommes, menacés par la facilité, et « cette sensation de triomphe et de domination qu’éprouvera en lui chaque individu moyen ». L’individu moyen, se concevant et se revendiquant comme moyen sera non le maître sans esclave rêvé par les utopies généreuses, mais l’esclave sans maître, c’est à dire le dominateur le plus impitoyable, le plus résolu, le mieux armé, par sa quantité, le plus administratif, le mieux assis dans sa conviction d’incarner le Bien.
Notons, en passant, la différence fondamentale entre une Église, qui unit les hommes en les considérant comme une communauté de pécheurs, et ces communautés d’« hommes nouveaux », qui se considèrent, dans leur médiocrité, littéralement impeccables et parfaits, sans plus rien avoir à apprendre du passé, et relisons contre eux, comme un alexipharmaque, c’est à dire un contre-poison, les romans provocants, vénéneux, vénériens, sarcastiques, lyriques, coruscants, métaphyiques, cruels et humoristiques de Witkiewicz, relisons dans les heures, et nous savons que les heures, par étymologie sont des prières qui nous restent avant d’être dissous dans la communication de masse, avant d’être, dans l’informe, la proie au pire conformisme !
En lisant les romans de Witkiewicz, on reconnaît qu’il fut homme de théâtre, tant ils semblent se dérouler dans un espace où l’alentour aurait été aboli dans une sorte de frayeur intersidérale. Un vide métaphysique, sans plus de civilisation, ni de spectateurs semble entourer les personnages, dans leur étrangeté même. Sur la scène de l’œuvre, deux configurations du passé s’entrebattent. L’une est liée à la forme, à l’Idéa, au « double regard » platonicien, qui voit les choses comme déjà advenues et comme devant advenir, réminiscence « de ces instants où la vie contemporaine mais lointaine et comme étrangère à elle-même, rayonnait de cet éclat mystérieux que n’avaient habituellement pour lui que certains des meilleurs moments du passé ». L’autre est liée à la force de dissolution, de nostalgie mauvaise : « Être un taureau, un serpent, même un insecte, ou encore une amibe occupée à se reproduire par simple division, mais surtout ne pas penser, ne se rendre compte de rien. » Autrement dit, être parfait, sans péché, sans manque, sans attente, sans transcendance… Nous en sommes là. L’heure est, selon la formule rimbaldienne, « pour le moins très sévère ». La témérité spirituelle est requise. L’« Adieu » est une oraison funèbre, mais sans pomposité, à des êtres humains téméraires et fragiles, à des êtres humains imparfaits, livrés à l’incertitude et au doute, à l’exaltation et à l‘acédie, et cette imperfection, pour Witkiewicz, et pour nous qui consentons à être les hôtes du romancier, vaut infiniment mieux qu’une perfection planifiée, une perfection considérée comme due par d’éternels revendiquants, épris du bonheur de l’amibe – perfection qui ne saurait être réalisée qu’au prix d’une terrible réduction procustéenne. Nous y sommes.
L’« Adieu » de Witkiewicz est un « Adieu » à l’imperfection, c’est à dire un « Adieu » à l’Inassouvissement, à l’insatisfaction, un « Adieu » à la beauté escarpée, anfractueuse, déroutante. Un « Adieu » à la fragilité des hommes seuls, désemparés, pessimistes, audacieux et frémissants. Un « Adieu » à des hommes, qui sont des personnages flamboyants et farfelus alors que nous sommes sur le point d’entrer dans un monde de figurants tristes, ternes et sérieux. Et l’on se souviendra de La Bruyère écrivant : « le barbare est celui qui prend tout au sérieux ».
Luc-Olivier d’Algange
Stanislaw Ignacy Witkiewicz, L’Inassouvissement, Éditions Noir sur Blanc, 2019.
00:15 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stanislaw ignacy witkiewicz, luc-olivier d'algange, lettres, lettres polonaises, pologne, littérature, littérature polonaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.