
Parution du numéro 492 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Jean Bastier
Céline vu par Marc Fumaroli
Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève
Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du numéro 492 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Jean Bastier
Céline vu par Marc Fumaroli
Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève
Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)
C’est sans doute une infirmité de ma part ; les livres de Philippe Sollers m’ont toujours laissé indifférent, exception faite de Femmes (1983), qui doit d’ailleurs beaucoup à Céline, et La Guerre du goût (1994), recueil de ses meilleures critiques. En raison de son art d’esquiver les questions embarrassantes, celui que Pierre Assouline nommait (devant lui) “le roi des pirouettes” a pourtant de fervents admirateurs, notamment dans la nouvelle génération. En témoigne l’essai enthousiaste de Yannick Gomez qui analyse les liens entre son œuvre et la musique, domaine qu’il maîtrise ô combien. Mais le chapitre qui intéressera davantage ceux qui me lisent, c’est évidemment celui intitulé “Céline – Sollers”. Une anecdote à ce sujet : on sait que celui-ci s’est toujours targué d’avoir été l’un des grands artisans de la réhabilitation littéraire de l’auteur de Nord. Il l’écrit d’ailleurs noir sur blanc dans ses Mémoires.

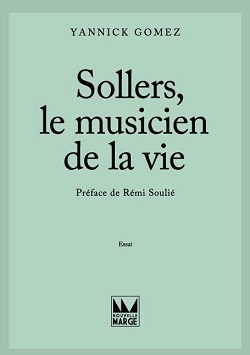
Avec malice, Jérôme Dupuis releva qu’après avoir écrit en 1963 un bref article sur Céline dans les Cahiers de l’Herne, il fallut attendre… 1991 pour lire un nouveau texte de lui sur le sujet¹. Et de préciser que la grande période de traversée du désert, ce furent les années 60, 70 et 80, où Sollers jugeait plus urgent de célébrer Lacan, Mao ou Casanova. Dans le BC, je me gardai de réfuter ces propos, factuellement exacts, mais précisai que, chaque fois qu’il en eut l’occasion, Sollers défendit Céline dans les médias. Ce fut notamment le cas en 1976 dans une émission télévisée à lui consacrée². Mon papier se concluait ainsi : « Céline reconnaîtra les siens ! » Manifestement touché par cette défense, Sollers m’envoya la dernière livraison de sa revue L’Infini avec un mot courtois. Il a tous les défauts du monde, relevait un critique, sauf ceux des esclaves qui obéissent aux ordres des prescripteurs. Et c’est vrai qu’il m’est toujours apparu comme un homme libre, allant jusqu’à faire sien le précepte baudelairien revendiquant le droit de se contredire.

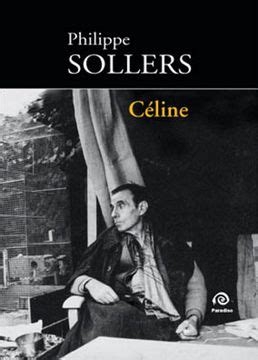
Un admirateur de Céline est assurément mal placé pour reprocher à Sollers d’avoir succombé aux sirènes de la politique totalitaire. Passé du communisme au maoïsme, il ne renia jamais vraiment son passé gauchiste et demeurait nostalgique de la comédie débridée du printemps 68 dont la France ne se remit jamais, comme en atteste l’état de son école et de son université. Dans son fameux article La France moisie ³, Sollers raillait un ministre de l’Intérieur (de gauche) qui avait eu l’audace de fustiger ceux qu’il appelait, doux euphémisme, les “sauvageons”. Et il prenait bien entendu la défense du “héros” libertaire de mai 68 qui termina sa carrière parlementaire en se faisant l’apologiste du capitalisme et de l’économie de marché. Mais, comme le disait Céline (citant la sœur de Marat), ces volte-face sont là turpitudes humaines qu’un peu de sable efface. Ce qu’on retiendra de Sollers, c’est sa vaste érudition à la fois musicale et littéraire ainsi que ce goût de la conversation qui le fait davantage appartenir au XVIIIe siècle qu’à notre période déclinante dont il déplorait à juste titre l’inculture et la frivolité.
• Yannick GOMEZ : Sollers, le musicien de la vie (préface de Rémi Soulié), Éditions Nouvelle Marge, 2025, 141 p. (18 €). Voir aussi Hommages à Philippe Sollers, Gallimard, 2023, 142 p. (12 €)
Notes:
15:22 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, philippe sollers, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le paganisme de Tolkien
Sergio Valero Ruiz
L'œuvre de Tolkien est catholique, aussi catholique que l'âme elle-même. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un paganisme réinterprété et recouvert de christianisme. Dans ses propres lettres, l'auteur affirme que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre religieuse et catholique, mais qu'il n'en a pris conscience qu'après l'avoir écrite et révisée.
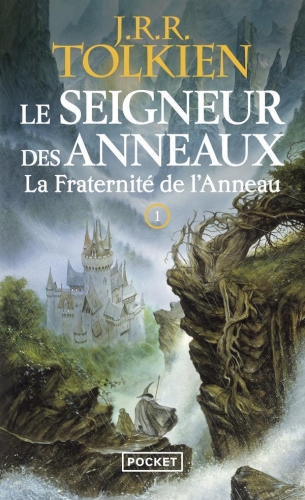 « Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »
« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »
Et en effet, son œuvre est catholique. Juste qu'il faut rappeler ce qu'est le catholicisme: un paganisme revêtu a posteriori de christianisme. Un paganisme qui transparaît à travers l'histoire, l'art et le symbolisme. Le religieux est implicite, comme il le souligne lui-même, car cet héritage païen est inconscient. Il y a une spiritualité, une religiosité fusionnée dans l'intrigue et la symbolique — mais ce n’est pas celle du récit hébraïque, mais celle d'une épopée européenne et d'une métaphysique propre à l'Antiquité pré-chrétienne. Seulement, cette dernière est reformulée dans le contexte chrétien, comme l'ont fait les premiers chrétiens de leur temps.
Tolkien croyait, tout comme certains des premiers chrétiens qui se nourrissaient de sources païennes, que le paganisme était une moitié de vérité, où pouvait se deviner la véritable vérité chrétienne ultérieure. Et ainsi, ils percevaient le paganisme comme un antécédent, une préparation au message du Christ. À l’image de Nicolás Gómez Dávila, qui disait que le christianisme possédait deux anciens testaments: la Bible juive et l’Antiquité classique. De cette façon, son christianisme conscient et son paganisme inconscient s'harmonisaient, tout en justifiant la consommation de la coupe des démons (comme on disait boire aux sources classiques). Cependant, la réalité nous montre qu’au sein de la vision du monde spirituelle européenne, le paganisme a été nécessaire, tandis que le christianisme est contingent.

Le débat ne porte pas sur le fait que l'œuvre de Tolkien soit catholique ou non, ni même si Tolkien lui-même était très religieux. La réponse à ces deux questions est un oui profond et catégorique. La véritable question est bien plus ancienne et a été discutée dès l'époque de Celse, Porphyre et Julien l’Apostat: que le christianisme puise dans le paganisme sa théologie, son anthropologie et sa métaphysique. Le paganisme existe par lui-même, mais le christianisme, en particulier dans sa forme catholique, ne peut exister que grâce au paganisme. Car sans le paganisme, celui que les Pères de l’Église méprisaient tout en en buvant le nectar, le christianisme ne serait qu’une des nombreuses sectes juives. Et ce que l'œuvre de Tolkien expose a peu de choses à voir avec une secte juive du Moyen-Orient, et beaucoup avec une vision du monde européenne archaïque.
Tout catholique a, qu'il le sache ou non, une âme païenne (littéralement, car le concept d'âme immortelle provient du platonisme). Et que, par conséquent, l'âme de Tolkien, ainsi que son œuvre, parce qu’elle est imprégnée de catholicisme, est essentiellement païenne. Tolkien, comme tout catholique, est un païen inconscient.
21:48 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, catholicisme, paganisme, j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
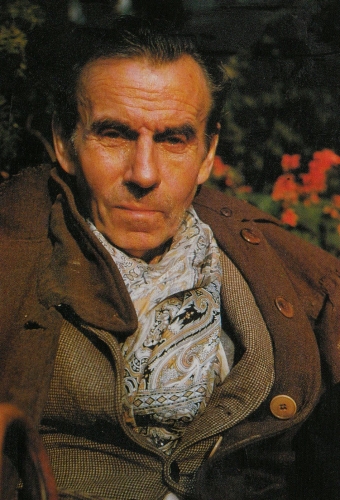
Parution du n°491 du Bulletin célinien
 Sommaire:
Sommaire:
Céline’s London. Le mystère de La Belle Sauvage
Céline au programme du baccalauréat ? Histoire d’un mythe
Dans la bibliothèque de Céline : Ibsen, L’Impérialisme germaniste dans l’œuvre de Renan, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche
Londres de Céline et Londres (Albert). La prostitution et la honte.
N’en déplaise à certain célinien acrimonieux¹, le BC poursuit son bonhomme de chemin et s’achemine vers le 500e numéro. Et ce en dépit de l’âpre anticélinisme qui prospère d’année en année. Tout est fait pour donner de Céline l’image la plus univoque possible. C’est ce qui a encore été fait récemment en adaptant à l’écran le podcast (à charge) , “Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour”, diffusé l’année passée sur France Inter. « J’ai été tellement recouvert de toutes les ordures et les merdes que cent mille tonnes de parfums d’Arabie ne me feraient pas encore sentir bon ! » écrivait-il en exil.
Que dirait-il aujourd’hui ?… Rendant compte de ce documentaire, la presse emboîte le pas, dénonçant “un homme monstrueux habité par une noirceur inouïe”. Quant à l’objectif de cette initiative, il n’est guère dissimulé par certains : extirper Céline du “panthéon des lettres françaises” et pour cela “déboulonner” la statue. Certes, on peut critiquer l’homme. Céline souhaitait la victoire de l’Axe et, pendant l’Occupation, n’a pas mis une sourdine à son antisémitisme obsessionnel.
Mais pourquoi énoncer des contrevérités dans ce qu’il faut bien appeler un réquisitoire ? Les plus flagrantes ont trait aux deux guerres mondiales : Destouches embusqué à Londres car réformé en 1915 par piston² (ceci pour la première) et Céline nazi intégral appelant de ses vœux le génocide (pour la seconde). Une volonté à peine dissimulée de réduire son rayonnement littéraire est ici à l’œuvre.
Dans un courriel adressé à un téléspectateur qui s’était plaint de ce parti-pris, la personne en charge de la médiation des programmes de France Télévisons a répondu que « s’intéresser à un sujet nécessite de choisir un angle ». Et d’ajouter cette précision chafouine : « Retenir certains aspects d’un sujet ne signifie pas occulter tous les autres dans l’absolu, potentiellement abordés lors de prochains programmes sur le thème, abordé sous un angle différent »³. Le hic, c’est que lorsqu’il est question de Céline, c’est toujours le même angle.
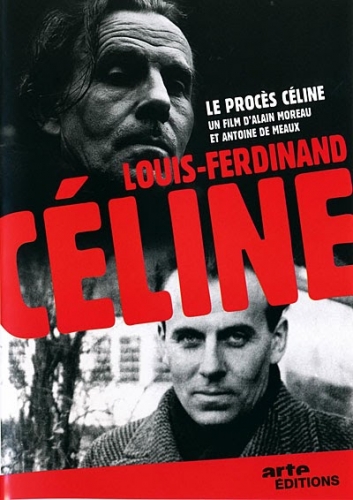
Pour rappel : Antoine de Meaux (“Le procès Céline”, Arte, 2011), Jean-Baptiste Pérétié (“Voyage au bout de Céline”, France 5, 2011), Christine Lecerf (“Louis-Ferdinand Céline au fond de la nuit”, France Culture, 2019), Élise Le Bivic (“Céline : les derniers secrets”, France 5, 2021), pour ne citer que les plus récentes émissions. Toutes font le procès de Céline et méconnaissent ce qui fait la grandeur de l’écrivain. C’est un choix délibéré. Et cela s’aperçoit jusque dans les détails. Ainsi, évoquant la réception critique de Voyage au bout de la nuit, il est précisé que la presse fut partagée. Non pas en raison du langage et du style novateurs de ce premier roman mais parce qu’« on ne sait pas encore où situer politiquement Céline » (!) Il suffit d’analyser le dossier de presse pour se rendre compte que la ligne de partage ne se situe pas sur ce plan. On se plaît à rêver d’une émission où serait mis en relief ce qui fait l’originalité et la valeur de l’œuvre. Un angle pour une fois différent…

• Philippe COLLIN et Florence PLATARETS : « Face à l’histoire. Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour », Production Agat Films. Diffusé le 14 décembre 2025 sur France 5.
16:41 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 490 du Bulletin célinien
Sommaire :
 Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)
Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)
Une fausse citation d’Erasme chez Céline
Dans la bibliothèque de Céline : Hamlet
James Salter lecteur de Waugh et de Céline.
Céline fut un “collaborateur” pour le moins atypique. Henri Godard a indiqué qu’il s’est tenu à l’écart de toute collaboration officielle. C’est le moins que l’on puisse dire. Pendant l’Occupation, cet électron libre n’a pas arrêté de morigéner les uns et les autres (politiques et journalistes) estimant qu’ils n’étaient pas à la hauteur de la situation. Histoire de doper les ventes, les historiens ne rechignent pas à le mettre en couverture de leur livre. Ce fut le cas d’un spécialiste de l’Épuration en France¹ ; c’est aujourd’hui celui d’un jeune historien qui publie sa thèse de doctorat sur les écrivains collaborateurs. Il y analyse ce que sont devenus les deux cents (!) écrivains frappés à la Libération. Et de s’interroger sur la postérité littéraire d’écrivains mineurs mais aussi de Rebatet, Morand, Maurras,… et Céline auquel il consacre tout un chapitre.
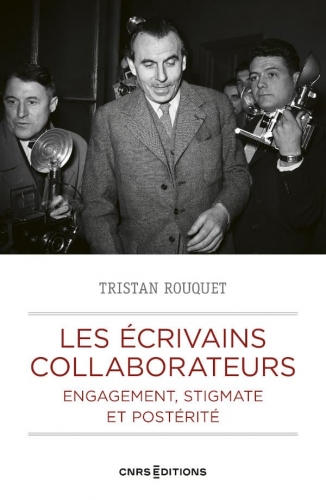
D’entrée de jeu, il passe en revue les éléments de nature, on le conçoit aisément, à exaspérer ceux qui honorent la mémoire des intrépides ayant combattu l’envahisseur. C’est le cas de l’auteur, attaché scientifique à un musée de la Résistance. Quels sont ces éléments qui datent tous du début de ce siècle ? Dans l’ordre : l’inscription (suivi du retrait) de Céline au recueil des Célébrations nationales du ministère de la Culture (2011) ; l’entrée de Drieu la Rochelle dans la “Bibliothèque de la Pléiade” (2012) ; l’édition de la correspondance de Morand et Chardonne (2013) ; la réédition des Décombres de Rebatet (2015) ; l’initiative (avortée) de la réédition des pamphlets par Gallimard (2018) ; la présence de Maurras et Chardonne dans Le Livre des Commémorations nationales (2018) ; la réapparition de manuscrits inédits (2021) suivie de leur publication avec succès. Cela fait beaucoup. Et montre que, pour ce qui le concerne, Céline est tout sauf un écrivain maudit².

L’auteur affirme pourtant que celui-ci est auréolé de ce statut par ses biographes. Et, selon lui, Céline, seul, sut convertir sa déchéance en littérature. Là où il serait magistral, c’est que, devenu un “auteur canonique” (Voyage au bout de la nuit fut inscrit au programme de l’agrégation des lettres modernes en 1993 et en 2003), il n’en devient pas pour autant un écrivain figé. L’intérêt suscité est entretenu par sa légende sulfureuse qu’il a contribué à bâtir par ses romans d’après-guerre dans lesquels il raconte son exil ignominieux aux yeux de ceux qui n’accepteront jamais de le lire. Céline renverse en outre le stigmate en imposant l’image qu’il a de lui-même, évitant dans ses romans d’expliquer son engagement en faveur de l’Axe. C’est la conclusion de l’auteur, un tantinet jargonnante: «Il s’agit d’élaborer et de diffuser une narration qui s’empare de la marque infamante pour la réajuster à une illusion biographique acceptable. Cependant, si le renversement du stigmate est unanimement reconnu, alors la provocation qu’il porte disparaît. Afin d’éviter cette routinisation du charisme, tout l’enjeu revient alors à entretenir la tension entre la canonisation et l’impiété.» Pari réussi pour Céline au grand dam de ses contempteurs qui auraient préféré que son œuvre ne lui survive pas.
• Tristan ROUQUET, Les écrivains collaborateurs (Engagement, stigmate et postérité), CNRS Éditions, coll. “Nationalisme et guerres mondiales”, 2025, 448 p. (26 €)
18:39 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, louis-ferdinand céline, collaboration, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Les influences celtes dans la littérature moderne
Source: https://www.facebook.com/groups/269177069889276
Les Celtes, avec leur riche héritage mythologique, leurs légendes envoûtantes et leur culture profondément ancrée dans la nature et le surnaturel, ont laissé une empreinte indélébile sur la littérature moderne. Leur univers, peuplé de héros comme Cú Chulainn, de fées, de druides et de quêtes magiques, continue d’inspirer les auteurs du monde entier. Que ce soit à travers le fantastique, la fantasy ou même la poésie contemporaine, les motifs celtiques apportent une dimension mystique et intemporelle aux récits.

Un héritage mythologique riche
Les mythes celtes, transmis oralement avant d’être consignés par écrit, regorgent de récits épiques et de symboles puissants. Des œuvres médiévales comme les Mabinogion gallois ou les cycles irlandais (comme le Cycle d’Ulster ou le Cycle du Graal) ont posé les bases d’une narration où se mêlent aventure, magie et moralité. Ces récits ont influencé des générations d’écrivains, notamment au 19ème siècle, lors du renouveau celtique. Des auteurs comme William Butler Yeats ont puisé dans le folklore irlandais pour créer une poésie mystique, mêlant mythologie et nationalisme culturel. Ses poèmes, comme The Stolen Child ou The Wanderings of Oisin, évoquent un monde où les frontières entre le réel et l’autre monde (Tir na nÓg) sont ténues, un thème récurrent dans la littérature moderne.

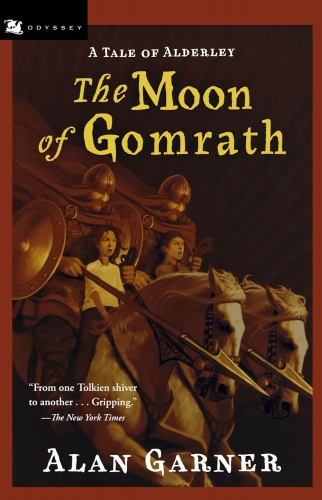
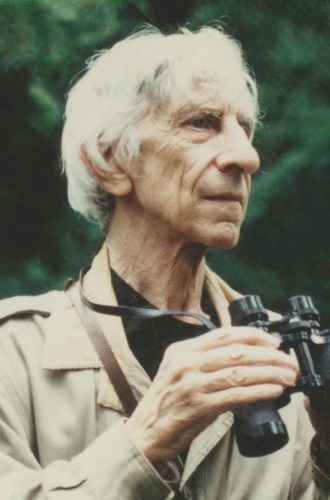
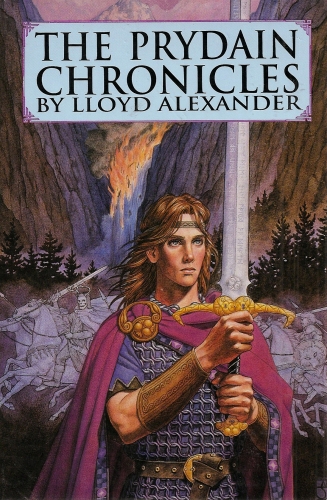
La fantasy : un terrain de prédilection
Le genre de la fantasy doit beaucoup aux Celtes. J.R.R. Tolkien, par exemple, s’est inspiré des langues et des légendes celtiques pour façonner l’univers de La Terre du Milieu. Bien qu’il ait surtout puisé dans la mythologie nordique, des éléments comme les elfes, les quêtes héroïques et les forêts enchantées trouvent des échos dans les récits celtes. Plus directement, des auteurs comme Alan Garner (The Moon of Gomrath) ou Lloyd Alexander (Les Chroniques de Prydain) ont puisé dans les Mabinogion pour créer des mondes où la magie celtique est omniprésente.
La série Harry Potter de J.K. Rowling n’est pas exempte d’influences celtiques: le choixpeau magique rappelle les objets enchantés des légendes, tandis que les créatures comme les farfadets ou les kelpies sont directement issus du folklore celtique. Même Game of Thrones de George R.R. Martin emprunte aux Celtes, avec des personnages comme les "Enfants de la Forêt", qui évoquent les Tuatha Dé Danann, le peuple féerique irlandais.

Le réalisme magique et le surnaturel
Les Celtes ont aussi marqué le réalisme magique, un genre où le surnaturel s’immisce dans le quotidien. Des écrivains irlandais comme Lady Gregory ou John Millington Synge (photo) ont retravaillé les contes traditionnels pour les adapter à une audience moderne. Aujourd’hui, des romanciers comme Alice Hoffman (La Prophétie des sorcières) ou Juliet Marillier (La Fille du brouillard) intègrent des éléments celtes pour créer des atmosphères où la magie est palpable. Les fées, les malédictions et les métamorphoses, thèmes chers aux Celtes, y occupent une place centrale.

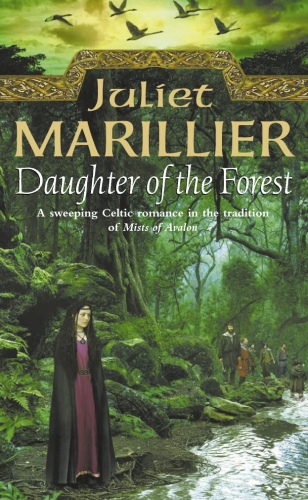
La poésie et la quête identitaire
La poésie moderne, notamment en Irlande et en Bretagne, a souvent utilisé les symboles celtes pour explorer des questions d’identité et de résistance culturelle. Seamus Heaney, prix Nobel de littérature, a réinterprété les mythes irlandais dans des recueils comme North, où la légende de Sweeney Astray devient une métaphore de l’exil et de la quête de soi. En Bretagne, des poètes comme Xavier Grall ou Anjela Duval ont célébré la langue et les paysages breton en s’inspirant des anciens récits.
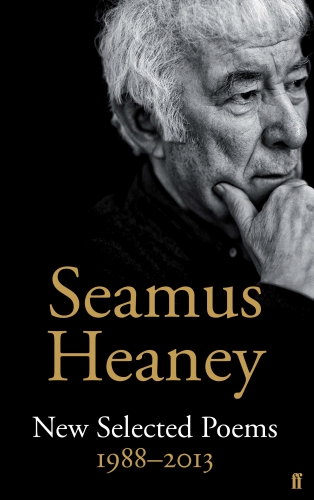
Les héros et les archétypes celtiques
Les héros celtes, comme le roi Arthur (dont la légende est en partie d’origine celtique) ou Finn MacCool, incarnent des archétypes universels: le guerrier noble, le sage, le trickster. Ces figures réapparaissent dans des œuvres contemporaines, comme Les Brumes d’Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui réinterprète la légende arthurienne sous un angle féminin et celtique. Même les super-héros modernes, comme Thor dans les comics Marvel, empruntent des traits aux dieux celtes (comme le marteau de Thor, qui rappelle celui du dieu celtique Sucellos).

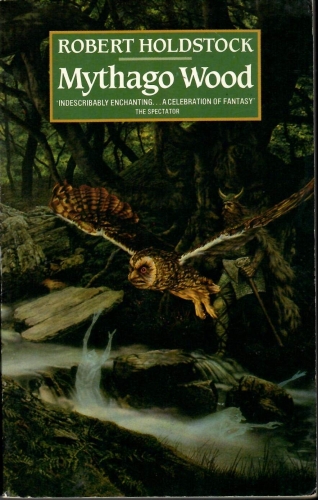
La nature et le sacré
Les Celtes vénéraient la nature, et cette spiritualité se retrouve dans des œuvres écologistes ou animistes. Robert Holdstock, dans Mythago Wood, explore une forêt où les mythes prennent vie, un thème typiquement celtique. De même, Diana Gabaldon (Outlander) mêle histoire et légendes écossaises, où les pierres dressées et les cercles de mégalithes jouent un rôle clé.
Un héritage vivant
Aujourd’hui, les influences celtes se retrouvent aussi dans la littérature jeunesse (Les Chroniques de Spiderwick de Tony DiTerlizzi) ou les romans graphiques (Sláine, de Pat Mills, inspiré des guerriers celtes). Les jeux vidéo (The Witcher, Dragon Age) et les séries (The Witcher, Cursed) perpétuent cette tradition, prouvant que les récits celtes continuent de captiver.
En conclusion, les Celtes ont offert à la littérature moderne un réservoir inépuisable de symboles, de récits et de magie. Leur héritage, à la fois poétique et sauvage, permet aux auteurs d’explorer des thèmes universels : la quête, la frontière entre les mondes, et la connexion profonde entre l’humain et la nature. Que ce soit pour évoquer un passé mythique ou pour créer des mondes imaginaires, leur influence reste vivace, témoignant de la puissance intemporelle de leurs légendes.
18:45 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, celtisme, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
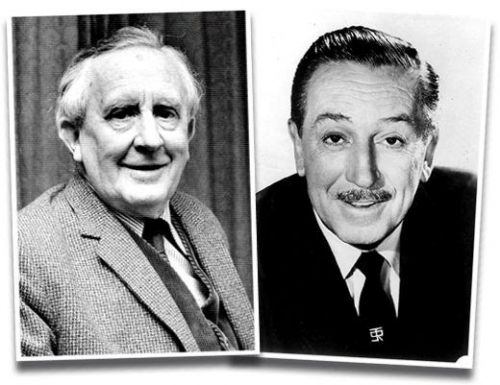
L’antipathie de J.R.R. Tolkien envers Disney
Études Historiques
Source: https://www.facebook.com/SBdeHolanda
L’antipathie de J.R.R. Tolkien envers Disney n’était pas une critique occasionnelle proférée par un vieil universitaire s'opposant aux nouveaux médias. Ce n’était ni de l’envie professionnelle ni du traditionalisme automatique. C’était une opposition philosophique profonde, enracinée dans des conceptions radicalement différentes de la fonction qu'ont les histoires et de ce qui se passe lorsqu’elles sont modifiées.
Le conflit a commencé avec une coïncidence presque inquiétante, en 1937.
Cette année-là, Tolkien a publié Le Hobbit, un livre pour enfants apparemment simple, mais qui était en réalité une mythologie soigneusement construite, façonnée par sa formation en linguistique, son immersion dans la littérature ancienne et ses convictions sur la façon dont les histoires portent un poids moral et spirituel. Il avait passé des années à créer non seulement une intrigue, mais tout un monde — avec des langues, des histoires et des cultures — qui conférait à la narration une profondeur bien au-delà de sa surface aventureuse.

Quelques mois après la sortie du Hobbit dans les librairies britanniques, Disney a lancé Blanche-Neige et les Sept Nains, le 21 décembre 1937. Ce fut le premier long métrage d’animation de l’histoire — un exploit technique, un pari commercial et un phénomène culturel immédiat. Lorsqu’il est arrivé dans les cinémas britanniques au début de 1938, il représentait tout ce que le divertissement moderne pouvait atteindre: attrait de masse, innovation technologique et succès financier sans précédent.
Ce moment n’était pas une simple coïncidence. Il a présenté au public, en même temps, deux visions radicalement différentes des contes de fées. L’une était la tentative d’un professeur d’Oxford de créer une nouvelle mythologie à partir de traditions narratives anciennes. L’autre était l’effort d’un studio hollywoodien pour transformer de vieux contes en quelque chose capable de remplir des salles de cinéma.
Tolkien et son ami proche, C.S. Lewis, sont allés voir Blanche-Neige ensemble — probablement poussés par la curiosité face à ce film révolutionnaire dont tout le monde parlait. Tous deux étaient des érudits de la littérature médiévale, profondément engagés dans les contes de fées et la mythologie, et prenaient les histoires au sérieux comme porteuses de vérité et de sens, pas comme un simple divertissement.
Aucun d’eux n’a été impressionné.
Lewis a noté dans son journal qu’il trouvait le film “écoeurant”. La réaction de Tolkien était plus profonde — et a duré toute sa vie. Ce qu’il a vu à l’écran l’a perturbé de manières qui ont modelé sa vision des adaptations et de la culture populaire par la suite.

Ce malaise n’était pas technique. Tolkien a immédiatement reconnu le talent de Disney — l’animation était inédite, l’art indéniable, le fait extraordinaire. Ce qui le dérangeait, c’était l’intention, la philosophie, ce en quoi Disney croyait que les contes de fées devraient être.
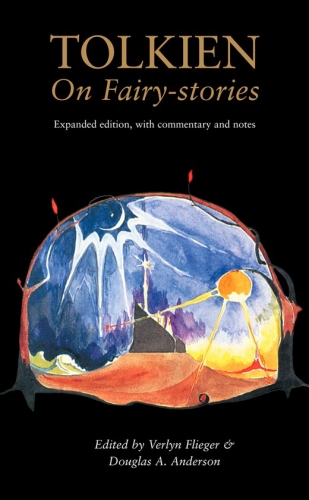
Pour Tolkien, comme il l’a expliqué soigneusement dans son essai Sur les Histoires de Fées et dans plusieurs de ses lettres, les contes de fées n’étaient pas un divertissement décoratif pour enfants. Ils étaient des outils anciens avec des buts sérieux: affronter la peur, explorer la perte, reconnaître le danger et traiter les conséquences morales à travers le symbole. Ils étaient du mythe — des récits qui portaient des vérités sur la condition humaine de façons que la fiction réaliste ne pouvait pas.
Les contes authentiques, croyait Tolkien, conservaient une qualité qu’il a appelée l'“eucatastrophe” — un retournement soudain et jubilatoire qui semble miraculeux précisément parce que l’obscurité précédente était réelle et terrible. La fin heureuse n’a de sens que si le danger, la peur et la possibilité réelle d’échec étaient présents. Cela ne peut pas être fabriqué uniquement par sentimentalité.
L’approche de Disney, aux yeux de Tolkien, transformait ces récits dangereux et moralement complexes en quelque chose de fondamentalement différent. Les éléments anciens restaient — nains, reines maléfiques, forêts enchantées — mais ils étaient remodelés en sentimentalisme, humour et spectacle, pensés pour une consommation universelle et un succès commercial.

La reine maléfique de Blanche-Neige était clairement mauvaise, totalement vaincue et sans ambiguïté morale. Les nains devenaient un soulagement comique, avec des personnalités facilement exploitables dans des produits dérivés. L’obscurité apparaissait, mais toujours contrôlée, toujours résolue avec facilité, toujours subordonnée au message rassurant que tout irait bien. Les aspérités avaient été poncées.
Pour Tolkien, c’était une forme de corruption. Pas par malveillance délibérée, mais parce qu’ils transformaient quelque chose créé pour un but précis en autre chose, ne conservant que l’apparence extérieure. Comme traduire de la poésie en prose: les mots peuvent être corrects, mais l’essence qui faisait de cela de la poésie se perd.
Dans une lettre de 1964 à un producteur intéressé par l’adaptation de son œuvre, Tolkien a été clair: il disait ressentir une “antipathie profonde” envers le travail de Disney, croyant que son talent — qu’il reconnaissait — semblait “irrémédiablement corrompu”. Toute histoire touchée par Disney, craignait Tolkien, risquait d’être aplatie: morale, mais superficielle; visuellement riche, mais spirituellement vide.
Ce n’était pas de l’animosité personnelle. Tolkien n’a jamais rencontré Walt Disney. Il ne commentait pas son caractère. Son opposition était entièrement philosophique — un désaccord sur ce que sont les histoires, ce qu’elles doivent faire et ce qui arrive quand elles sont modifiées pour atteindre un public plus large.
Le désaccord central était le suivant : Disney croyait que les histoires atteignent leur but ultime lorsqu’elles sont simplifiées pour le public de masse. Les situations morales complexes deviennent une simple lutte du bien contre le mal. Les personnages ambigus deviennent héros ou méchants. Le danger devient gérable, l’obscurité contrôlable, les fins sans équivoque, heureuses. Pour Disney, c’était démocratisant — amener des contes de fées à des millions qui ne liraient jamais les originaux.

Tolkien croyait que les histoires prennent leur force justement en conservant leurs ombres, leurs complexités et leurs dangers. L’ambiguïté morale de Gollum, le vrai danger de la tanière de Laestrygon, des personnages capables de courage et de mesquinerie en même temps — ces éléments n’étaient pas des obstacles à la compréhension. Ils étaient le point central. Ils rendaient les histoires vraies à l’expérience humaine et capables de transmettre un sens réel.
Une des deux visions cherchait à moderniser le mythe, à le rendre accessible et agréable. L’autre voulait protéger le mythe de la modernité, en conservant ce qui le rendait mythologique, et pas simplement divertissant.
Ce n’était pas une nostalgie naïve. Tolkien savait que les histoires changent toujours lorsqu’elles sont racontées. Mais il distinguait les changements organiques, réalisés par des conteurs sincèrement impliqués dans le matériau, des changements imposés par des impératifs commerciaux et des exigences du marché de masse.
Pour lui, les modifications de Disney relevaient clairement de la seconde catégorie.
Cette conviction a profondément façonné la résistance de Tolkien aux adaptations cinématographiques tout au long de sa vie. Il a été approché plusieurs fois pour adapter Le Seigneur des Anneaux et a toujours résisté — en partie parce qu’il craignait, à juste titre, que son œuvre soit “disneyfiée”.

Il imaginait Sam comme un soulagement comique, Gollum comme un méchant simple, des personnages comme Boromir ou Denethor réduits à des catégories claires, Mordor adouci pour un public familial, et des moments d'eucatastrophe fabriqués par sentimentalité plutôt que par un danger réel.
Ces peurs n’étaient pas paranoïaques. Elles se basaient sur la pratique courante à Hollywood et ce que Disney avait fait avec les contes traditionnels.
Pour Tolkien, il vaut mieux peu de lecteurs découvrant la vraie chose que des millions consommant un substitut commercialisé.
La question qu’il a soulevée reste d’actualité :
Quand les histoires sont adaptées pour le grand public, que perd-on ?
Lorsque la complexité morale est simplifiée et l’obscurité domptée, avons-nous encore le même mythe — ou seulement quelque chose qui y ressemble?
Tolkien a passé sa vie à défendre l’idée qu’il devient, dans ce cas, autre chose.
Et tout a commencé, curieusement, avec deux hommes sortant d’un cinéma en 1938, perturbés non pas par l’échec de Blanche-Neige, mais par son immense succès à faire quelque chose que personne ne croyait que les contes de fées devaient faire.
18:50 Publié dans Cinéma, Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : j. r. r. tolkien, walt disney, blanche-neige, mythes, dessins animés, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Julien Gracq et la tentation élitiste
Claude Bourrinet
Contrairement à André Breton ou à Sartre, Gracq s'est toujours bien gardé d'être entouré, a fortiori de prendre la tête d'un mouvement, ou de s'intégrer à l'une de ces « avant-gardes », ou à l'un de ces courants littéraires, qui ont caractérisé le XXe siècle, surtout français, du moins jusqu'à ce que ces rivières – ou ces ruisseaux – se perdent dans les sables du marais stérile de la fin du millénaire. Il a semblé se retrancher dans une tour solitaire, idée qui ne lui aurait du reste pas répugné. "Je peux me plaire (ô combien!), dit-il, dans un pays vide. Non dans un pays peuplé de figurants." Ces comédiens, qui servent de décor, pullulent dans le milieu intellectuel, où les effets valent plus que le fond, où les combinaisons remplacent la voie étroite, ou règne la formule hugolienne ; « Ad augusta per angusta ». Il l'affronte d'ailleurs ouvertement au début des années 50, mais se retire rapidement. Jeu de mains (à plume), jeu de vilains. Ses années seront ponctuées, dorénavant, entre deux années scolaires, par le retour studieux et estival dans la maison familiale, à Saint-Florent, et, imperturbablement, chaque mois de septembre, par une expédition en Deux-chevaux sur les « Grands chemins », souvent de France.

L'explication de cette tentation semi-érémétique était, aux yeux des professionnels du livre et de ses consommateurs, une affaire d'orgueil, ou de tactique. Peut-être les deux. Comme on répliqua, selon Sainte-Beuve, à quelqu'un qui annonçait le vœu de Chateaubriand de se retirer dans un ermitage: «M. de Chateaubriand veut une cellule, mais c'est une cellule sur un théâtre», on voyait dans le snobisme de Gracq une posture, dont le silence pouvait faire du bruit et intéresser ses ventes. Cette accusation eut cours surtout au moment de son refus du prix Goncourt. Mais au fond, on lui en voulut toujours de ne pas être de la maison.
Certes, sa promotion à l'Ecole Normale Supérieure avait été l'aboutissement royal d'un cursus qui était celui de l'élite «des enfances bourgeoises, et même petites-bourgeoises», solution de continuité sociale et culturelle, qui fut, jusque dans les années soixante, moment où l'Ecole de masse tendit à s'imposer, une situation «normale» et acceptée. En Hypokhâgne, durant l'année 1928, au lycée Henri IV, il porte monocle et cravate blanche. Rue d'Ulm, ils étaient «vingt-huit à trente pour la section Lettres, et nous nous connaissions exactement». Les meilleurs élèves de France, le gratin. «Une – ou deux – ou trois figures de proue que distinguaient la singularité de l'esprit, le brio intellectuel parfois presque inquiétant, l'évidence des aptitudes extra-universitaires. […] Une demi-douzaine d'hommes spéciaux, comme on aurait dit au temps de Robespierre, qui avaient repéré et choisi de bonne heure leur créneau, étroit et peu fréquenté, et qui, larguant tout autre souci, marchaient déjà d'un pas assuré vers une direction des Hautes Etudes ou une chaire au Collège de France. Un ou deux égarés, étrangers au moule universitaire, qui semblaient être entrés là par distraction: souvent les plus amusants de tous. […]. Le reste destiné à peupler, sans nouveauté, les khâgnes et les universités de province. Mais aucune bille n'avait encore été capturée par sa case ; les jeux roulaient toujours ; le champ des possibles, pour les carrières, débordait de beaucoup celui des probabilités – pour quatre ans encore chacun portait dans sa giberne le bâton de maréchal de Jaurès ou de Péguy, de Bergson ou de Giraudoux, et guettait du coin de l'oeil, dans l'oeil du camarade, l'étincelle naissante de hautes aptitudes ou de la haute ambition. »
Passons sur l'idée fugace, qu'il se vît tenir rang dans la dernière brigade. Somme toute, son métier de professeur de géographie et d'histoire n'était qu'un gagne-pain, fort agréable, et pourvoyeur de temps libre appréciable. L'enseignement n'était pas, pour lui, une vocation, même si ses élèves le jugèrent comme excellent pédagogue.

Durant toute sa vie d'écrivain, il regretta son isolement, dans un monde littéraire de plus en plus agité par les sollicitations médiatiques. Au début du mois de février 2000, Le Monde titrait, à son sujet, une de ses déclarations désabusée, qu'on jugea provocatrice: «En littérature, je n'ai plus de confrères». On vit, dans cette déclaration, de la superbe. Le dernier à avoir été du niveau exigeant où il tentait de se tenir avait été André Breton (photo). Après 1966, il n'y a plus rien. Or, un écrivain veut toujours savoir ce que ses écrits valent. Il y a les lecteurs, certes: il rassembla des amoureux – peu nombreux en regard des admirateurs de l'émission de Bernard Pivot, Apostrophes - de son œuvre, et qui n'étaient pas loin de se considérer comme des initiés. Mais le véritable jugement ne peut venir que d'un égal. Non dans un sens hiérarchique, déplacé à ce propos, mais qui ait la même vision de l'écriture, qui appartienne au même monde que lui.
 En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »
En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »
 Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.
Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.
La référence au Graal n'est pas loin. Gracq conte qu'à 18 ans, il cessa, sans drame, de se rendre à la messe. Ce qui ne signifie pas qu'il n'ait gardé, au plus profond de lui, un sens mystique tendu. Il rappelle les sensations tenaces de son enfance, qui allaient dans cette direction: «J'ai été élevé dans le catholicisme, dans un pays qui est très croyant, Saint-Florent, et une chose me frappait: une colline, avec, au sommet une église abbatiale, une abbaye très importante, une espèce de bulle sacramentelle. Plus que le sacré, me frappait et me séduisait la confrérie des gardiens du sacré. Cela apparaît avec les chevaliers.»
Cette tonalité religieuse, mystique, rejaillit aussi quand, dans son essai sur Breton, il interprète le surgissement et le destin du surréalisme. Là aussi transparaît la tentation élitiste. Et bien qu'il n'acceptât jamais de se couler dans le groupe surréaliste, il reprend à son compte, en 1948, la destinée manifeste d'un cercle semi-clandestin, de « vrais fidèles » d'un medium, Breton, « traversé » par les esprits de Sade, de Nerval, de Baudelaire,de Rimbaud, de Lautréamont, de Nouveau, de Jarry, de Vaché, de Rigaut, de Desnos, de Dali, «phénomène de transsubstantation» étonnant, qui l'investit d'un pouvoir charismatique. Il est traversé littéralement par le meilleur de leur esprit, il est le conducteur élu du fluide. «Aucune opération intellectuelle précise n’élucide ce contact miraculeux.» On a l'impression d'être «report[é]" à l’époque où l’«Esprit» visitait familièrement les hommes et à travers eux prophétisait en liberté».


Gracq s'est beaucoup inspiré de son ami Monnerot, condisciple à l'Ecole Normale, sociologue du socialisme et ayant médité sur les rapports entre la poésie et le sacré, notamment dans les cercles surréalistes. Il ne s'agit pas de trop porter attention, aux «germes de socialisation» qui ponctuent la trajectoire du cercle, que Monnerot appelle le «set», groupé autour de Breton entre les deux guerres, «café qu’on hante, habitude des réunions périodiques, promenades en commun, fréquentation de lieux «électifs», jeux d’esprit pratiqués, rites sommaires». Autre chose était la «puissance d’éveil» que le surréalisme recelait, «l’attente galvanisante d’une espèce d’an mil qui littéralement jetait les esprits en avant d’eux-mêmes, les exorbitait», «l’«esprit» qui aiguillonnait le groupe[...] avec la vigueur hallucinatoire d’une terre promise».
Monnerot parle d'«aristocratie du miracle» «ordonné autour d’une «révélation générale» et par là ne se différenciant pas par essence de telle ou telle communauté d’ «élus» à ses débuts».
Le groupe suggère « l’idée d’un ordre clos et séparé, d’un compagnonnage exclusif, d’un phalanstère que tendent à enclore on ne sait trop quelles murailles magiques (l’idée significative de « château » rôde aux alentours) qui paraît s’imposer dès le début à Breton », « beaucoup plus proche, par ses contours surtout exclusifs, de la Table ronde ou de la chevalerie en quête du Graal que de la communauté chrétienne initiale ». On a là une « appartenance, qui nous renvoie à la source même du sentiment religieux et qu’on ne peut se refuser plus longtemps – que cela plaise ou non – à qualifier de mystique ». On sait que cette « mystique » s'est nourrie en partie de doctrines satanistes, sadienne, par provocation, dans un désir de blasphémer, de profaner un christianisme abhorré. Mais une mystique tout de même, qui ne demandait, selon Gracq, qu'à être retournée positivement.
 Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».
Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».
Bien qu'en situation d'échec en 1948 (et comme le faisait remarquer Breton, entre le surréalisme d'avant-guerre et ce qu'il en reste à la Libération, il y a Buchenwald et la Bombe), Gracq voit dans l'émergence de petits groupes, de happy few portés par une flamme mystique authentique, se traduisant par ce qu'il appelle le Grand Oui (au monde), à l'opposé du projet existentialiste qui mise sur le collectif, et songe à subvertir le réel par la volonté sociale et politique, une alternative à la sclérose civilisationnelle de l'Occident – selon un schéma que lui a légué Oswald Spengler. Ces fraternités chevaleresques, il ne les trouvera jamais.
18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, surréalisme, élitisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Hommage à Didier Carette
par Luc-Olivier d'Algange
Grande tristesse d'apprendre la mort de Didier Carette. Avec lui s'en vont encore la liberté, la générosité et l'audace, - autant de rares vertus qui feront que les médias n'en parleront guère. Directeur du théâtre Sorano à Toulouse qu'il revivifia durant une décennie, il en fut éloigné pour des raisons « politiques ».

Que dire, sinon citer l'une des Feuilles orphiques ou pythagoriciennes qu'il aimait, et citer ses œuvres, dont la diversité et l'amplitude dépassèrent, de très loin et de très haut, tous les engagements partisans. Sa devise, populaire et aristocratique: «faire du théâtre non pour tous, mais pour chacun».
"Ceci est consacré à Mnémosyne,
Quand tu seras sur le point de mourir, tu t'en iras vers les demeures bien construites d'Hadès.
A droite, il y a une source près de laquelle se tient un cyprès blanc.
C'est là que les âmes des morts descendent et qu'elles s'y rafraîchissent.
De cette source surtout ne t'approche pas car tu en trouveras une autre, en face, d'où s'écoule l' eau fraîche qui vient du lac de Mnémosyne.
Au-dessus d'elle se trouvent les gardiens, ils te demanderont du plus profond de leur coeur,""ce que tu fais, et où tu vas, cherchant, dans les ténèbres du sombre Hadès.
Dis : je suis fils de Terre et de Ciel étoilé, mais je suis desséché par la soif et je meurs.
Donnez-moi vite l'eau fraîche qui s'écoule du lac de Mnémosyne.
Alors par le vouloir du roi des enfers, ils te traiteront avec bienveillance et te laisseront boire à la source de Mémoire.
Alors tu chemineras sur la voie sacrée, parmi les autres Mystes, dans la gloire de Dionysos."

En rappel de ses oeuvres:
Metteur en scène :
2010
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…
2009
Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…
2008
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…
Le Frigo de Copi mise en scène Didier Carette
2007
Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams mise en scène Didier Carette
Banquet mise en scène Didier Carette
2006
Rimbaud l'enragé – Une saison en enfer mise en scène Didier Carette
Le Bourgeois gentilhomme de Molière mise en scène Didier Carette…
2005
Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette
Homme pour homme de Bertolt Brecht mise en scène Didier Carette…
2003
Folies Courteline de Georges Courteline mise en scène Didier Carette
Peer Gynt de Henrik Ibsen mise en scène Didier Carette

2002
Satyricon de Pétrone mise en scène Didier Carette
La Nonna de Roberto Cossa mise en scène Didier Carette
1999
Karamazov d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette
Nuit blanche d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette
1998
Le Cas Woyzeck d'après Georg Büchner mise en scène Didier Carette
1997
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette
1989
Les Grandes Journées du père Duchesne de Jean-Pierre Faye mise en scène Didier Carette
1987
La Mère la joie... de Marie de Sévigné mise en scène Didier Carette
1986
Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…
Il n'y a plus d'aventuriers d'après André Malraux mise en scène Didier Carette
1983
Pntgrl-Rabelais de François Rabelais mise en scène Didier Carette

Comédien :
2010
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…
2009
Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…
2008
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…
1997
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette
1994
Le Voyage à Bâle de Pierre Laville mise en scène Simone Amouyal
1992
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Jacques Rosner
1986
Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…
1982
Le Labyrinthe d’Armand Gatti mise en scène Armand Gatti
1980
Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…
1968
Le Chien du général de Heinar Kipphardt mise en scène Maurice Sarrazin…

Auteur :
2005
Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette
2003
Armada de Didier Carette
1994
Le Torero de salon d'après Camilo José Cela… mise en scène Henri Bornstein
1992
Armada de Didier Carette mise en scène Simone Amouyal
Traducteur:
2008
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…
Scénographe:
1997
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette
Collaborateur artistique:
2013
Nana d'après Émile Zola mise en scène Céline Cohen…
1980
Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…
Voir aussi: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2018/12/05/d...
18:28 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : didier carette, hommage, théâtre, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Je n’ai vraiment compris Dominique de Roux — cet esprit décapant, aristocratique dans son goût de déplaire — qu’en lisant Pasolini. L’un est devenu le miroir de l’autre. Ils ont vécu deux vies brèves, à la même époque, dans un même refus instinctif des appartenances bourgeoises. Je n’ose imaginer ce que leur rencontre aurait pu créer. Sans doute un explosif plus puissant que la bombe à hydrogène.
Par Frédéric Andreu
Dominique de Roux et Pier Paolo Pasolini partagent une posture rare : celle des dissidents de l’intérieur. Ils semblent appartenir à un camp — De Roux au paysage littéraire français, Pasolini à la gauche italienne — tout en le contredisant radicalement de l’intérieur. De Roux l’affirme sans détour : « Je n’ai jamais appartenu à aucun camp. » Il cultive ce qu’il nomme « une liberté contre la meute », une intransigeance qui le pousse à attaquer le cléricalisme, les orthodoxies morales et le confort intellectuel de son époque.
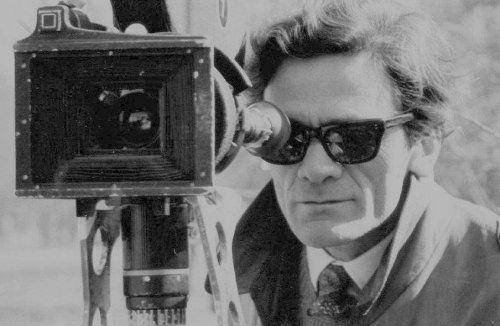
Pasolini, lui, est un hérétique déclaré au sein de la gauche italienne. Il écrit dans les Écrits corsaires :« La gauche m’a toujours considéré comme un hérétique. » Hérétique, il l’est en effet : farouchement contre l’avortement, qu’il voit comme une capitulation devant la logique utilitariste ; contre le théâtre de Mai 68, qu’il accuse d’être une gesticulation bourgeoise plus qu’une révolution ; contre la consommation, qu’il juge « obscène », un acte « grossier » qui uniformise les consciences et détruit toute authenticité populaire. Il ira jusqu’à dire que la société de consommation est « plus fasciste que le fascisme ».
Son amour va à la tradition, à l’homme cosmique, humilié par la machine, effacé par le consumérisme.
« TOUT mon amour va à la tradition
Je viens des ruines, des églises,
des retables d’autel, des villages oubliés des Apennins et des Préalpes
où ont vécu mes frères ». (Poésie en forme de rose, 1964)
Ce dissident politique est aussi un dissident esthétique : son cinéma est un anti-Hollywood radical. Pasolini refuse les corps lisses, les récits consolants, les couleurs de studio. Il filme à contre-jour de l’Occident cinématographique : théâtre filmé, visages non-professionnels, dialectes, rites archaïques, ascèse de la lumière. À l’usine à rêves, il oppose une fabrique du réel — une vérité nue, biblique, parfois cruelle, mais jamais trompeuse.

Chez De Roux comme chez Pasolini, la dissidence s’accompagne d’un burlesque féroce. De Roux n’hésite pas à tourner en dérision certaines figures religieuses — le cardinal Daniélou « la calotte sur le tête », l’abbé Bruckberger notamment — avec une ironie d’une précision chirurgicale. Il critique les masques, les formes.
Pasolini, à son tour, met en scène dans Uccellacci e uccellini un corbeau marxiste, pédant et bavard, caricature hilarante de l’intellectuel de gauche. Il disait de ce personnage : « Le corbeau parle comme un intellectuel, mais il reste un oiseau : il critique tout, mais ne change rien. » (L’image même du politicien macronoïde parvenu aujourd’hui au pouvoir).
Ce burlesque n’est pas un divertissement : c’est une arme critique. Le rire démasque plus sûrement qu’un discours doctrinal.

Dans la vie, pourtant, une rencontre a eu lieu : celle de Dominique de Roux avec Maurice Ronet, acteur intense, silencieux, qui partageait avec lui une même mélancolie active et une même exigence artistique. Leur dialogue, bien réel, laisse entrevoir ce que De Roux pouvait susciter chez des artistes à la sensibilité aiguë, et ce qu’il était capable de reconnaître chez eux.
Et c’est là que naît une forme de nostalgie imaginaire : il est profondément regrettable que De Roux n’ait jamais rencontré Pasolini. Tout laissait pourtant croire que leurs routes, parallèles, auraient pu un jour se croiser : mêmes années, mêmes combats, même détestation des conformismes. L’un apportant son feu littéraire, l’autre son feu cinématographique. Leur face-à-face aurait sans doute été incandescent — trop incandescent peut-être pour une époque qui ne savait pas accueillir ce genre de fulgurance. En un sens, Gombrowich a été, pour de Roux, une sorte de Pasolini, mais sans la même radicalité.
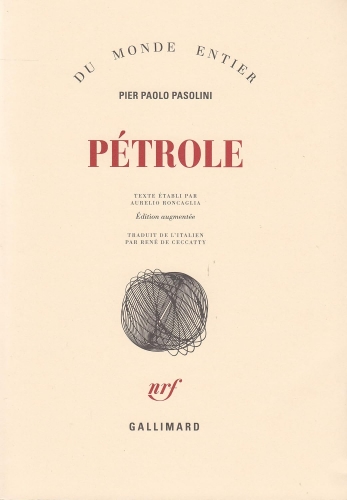
Les deux (h)auteurs quittent la scène, en nous laissant orphelins : De Roux est parti trop tôt, sans avoir tourner toutes les pages de la vie ; Pasolini, assassiné de la pire des manière, n’a pu achever son livre le plus incendiaire, Pétrole, resté comme une voix interrompue. (On n’a pas idée en France du vide laissé par cette disparition).
De Roux et Pasolini : deux dissidents, vraiment. Et, à leur manière, une paire parfaite, même sans s’être connus.
19:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, dominique de roux, lettres, littérature, lettres italiennes, lettres françaises, littérature italienne, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Mishima et l’esprit chevaleresque
La passion de Mishima pour l’Espagne
Source: https://revistahesperia.substack.com/p/mishima-y-el-espir...
Le code d’honneur caldéronien
Mishima était un lecteur vorace. Il semble qu’il ait été familiarisé dès son plus jeune âge avec les auteurs de notre Siècle d’Or espagnol. En particulier, le théâtre baroque et ses thèmes de l’honneur et de la gloire l’attiraient beaucoup. Et ici, Calderón de la Barca était, pour lui, notre étoile la plus brillante.

Mishima découvrit que le peuple espagnol et le peuple japonais partageaient un même concept de l’honneur. L’honneur calderonien était similaire à celui du Bushido, le code des samouraïs, car tous deux se placent au-dessus des volontés des rois et des seigneurs. « Au roi, il faut donner la terre et la vie, mais pas l’honneur, car l’honneur, c’est le patrimoine de l’âme, et l’âme n’appartient qu’à Dieu. »
Dans un contexte historique, un hidalgo était un chevalier de la petite noblesse. Mais avec le temps, il en est venu à signifier noble et généreux. Dans la tradition espagnole, l’esprit hidalgo trace un arc allant des chevaliers médiévaux jusqu’à la Légion de Millán-Astray. Notre passé est rempli de chapitres héroïques, des exploits des Tercios aux derniers combattants des Filipinas. Ce sens de la vie était également très présent dans nos arts et nos lettres jusqu’au début de la décadence.

Luis Díez del Corral
Ce professeur fut procureur sous le régime franquiste, juriste, politologue et disciple d’Ortega y Gasset. Dans les années soixante, il fit une tournée au Japon pour parler de l’Espagne des Austriacos (des Habsbourgs). Lors de ses conférences, il expliquait le sens de l’honneur caldéronien et de l’esprit chevaleresque. Mishima voyait dans cette attitude face à la vie une fraternité avec la tradition japonaise.
Une anecdote espagnole qui fit le plaisir de l’auteur nippon fut le geste du marquis de Benavente après avoir été contraint par l’empereur Charles Quint de recevoir dans son palais de Tolède le Connétable de Bourbon. Le marquis respecta la volonté impériale, qu’il considérait comme une humiliation, puis incendia son palais car il n’était pas disposé à vivre là où un traître l’avait fait. Mishima affirmerait que cette action était l’équivalent le plus précis du code d’honneur samouraï :
« L’un des nôtres aurait obéi sans rechigner, comme Benavente, à l’ordre de son « daimyō » ou du « shogun », puis aurait commis un seppuku. Comme en Espagne cette tradition n’existe pas, l’acte de Benavente est un symbole parfait. C’est la même chose, d’une autre manière. »
Après une des conférences, Mishima s’approcha pour discuter avec Díez del Corral. La présence de la célébrité japonaise attira dans la salle un essaim de journalistes et une masse énorme d’amateurs. Les deux échangèrent d’abord leurs impressions sur leurs goûts communs, puis se séparèrent de la foule pour continuer leur conversation en privé durant plusieurs heures. Ce fut le début d’une belle amitié qui dura dans le temps et conduisit les intellectuels à se rendre visite mutuellement dans leurs pays respectifs. Lors de ses voyages en Espagne, Mishima en profita pour vivre de près deux traits de notre identité qui l’impressionnaient le plus : la tauromachie et le flamenco.
Dans une interview, lorsqu’on lui demanda qui il sauverait si une bombe atomique devait dévaster l’Europe, Mishima répondit que ce serait le philosophe allemand Martin Heidegger et l’historien espagnol Díez del Corral.

La Légion et le Bushido
Une autre chose qu’aimait Mishima dans l’âme espagnole était la Légion. Il n’était pas surprenant, puisque Millán-Astray avait étudié le Bushido, et a même écrit la préface de sa traduction en espagnol. Le fameux militaire espagnol, boiteux, manchot et aveugle s’inspira du code samouraï pour fonder sa milice. Il l’a lui-même déclaré : « Et aussi, je me suis appuyé sur le Bushido pour soutenir le credo de la Légion, avec son esprit légionnaire de combat et de mort, de discipline et de camaraderie, d’amitié, de souffrance et de dureté, de répondre au feu. Le légionnaire espagnol est aussi samouraï et pratique l’essence du Bushido: Honneur, Courage, Loyauté, Générosité et Esprit de Sacrifice. Le légionnaire espagnol aime le danger et méprise la richesse».
Dans ces légionnaires, qui criaient « Vive la mort » et dont l’hymne s’appelait El novio de la muerte, Mishima voyait une attitude épique très similaire à celle qu’il défendait. Évidemment, les slogans légionnaires ne répondaient pas à une impulsion d’autodestruction, mais étaient des consignes pour donner du courage à ceux qui étaient prêts à tout sacrifier pour défendre des causes supérieures à leur propre vie.

Une problématique de culture
Mishima comprenait que le code d’honneur caldéronien partageait une ressemblance avec l’honneur japonais « plus que n’importe quel autre schéma de dignité personnelle des pays occidentaux ». Le 24 septembre 1969, il publia dans le journal The Times de Londres un article intitulé A problem of culture. Il y parle de « l’esprit espagnol du samouraï » et énumère ses préférences et ses fétiches. Juan Antonio Vallejo-Nágera considère dans Mishima ou le plaisir de mourir que cet article est très important pour comprendre l’idéologie politique de l’écrivain.
L’auteur nippon loue les Espagnols devant le public britannique et souligne leur conscience collective de la mort, l’idéal du « bon mourir » hérité des Tercios sous la proclamation du « ¡Viva la Muerte ! » et la défense de la tauromachie comme un exemple de résistance face à l’uniformisation occidentale. Il affirme aussi que seul un Espagnol aurait pu dire qu’il était « meilleur honneur sans navires que navires sans honneur » — une attitude qui aurait semblé insensée pour le reste des nations.
Mishima ajoutait dans cet article qu’il se considérait comme « un Don Quichotte ; bon, un Don Quichotte mineur contemporain ». Et c’est ainsi qu’il unissait à jamais l’esprit du samouraï à celui du hidalgo, terminant ainsi sa recherche.

L’heure des hidalgos
Don Quichotte de la Mancha est un archétype du véritable hidalgo. C’est un homme qui vit humblement et qui, influencé par la lecture des livres de chevalerie, décide de sortir du confort de sa vie et de mettre ses armes au service des nécessiteux. L’ingénieux hidalgo disait que « la chose dont le monde avait le plus besoin était de chevaliers errants et que l’on ressuscitât la chevalerie errante ».
François Bouqsuet appliquait une réflexion similaire aux temps modernes : « Je crois profondément que, s’il y a lutte — et il y en a — ce n’est pas une lutte de classes dont il s’agit, mais la lutte millénaire des poètes, des chevaliers, contre la classe prédominante des êtres grossiers et vulgaires (…) une lutte entre ceux qui soutiennent les colonnes du temple et ceux qui les profanent et les détruisent. »
Dans une époque marquée par la vulgarité et le narcissisme, l’esprit hidalgo nous offre un code différent. Un style qui allie l’exigence de soi à la défense d’idées nobles. On peut trouver dans l’esprit hidalgo une référence pour avancer (même avec beaucoup d’efforts et d’erreurs) debout dans un monde en ruine.
18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, japon, espagne, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
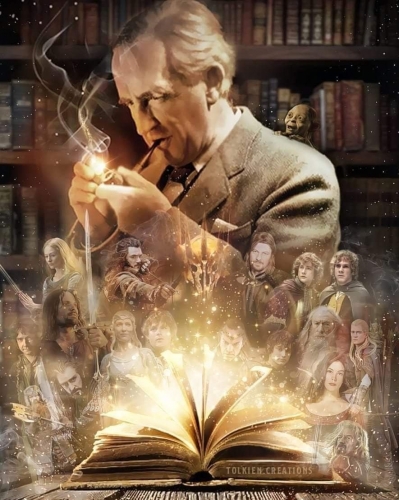
Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien
par Ralf Van den Haute
La lecture de l'épopée Le Seigneur des Anneaux[1] ne révèle pas toute la portée mythique de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, qui fournit dans Le Silmarillion[2] la véritable clé de son univers. On y trouve une description de l'origine du monde, des dieux et du « Mal ». Le statut de ce dernier dans l'œuvre de Tolkien correspond à plusieurs égards aux différentes manifestations du Mal dans la mythologie germanique. Le but de cet article est d'examiner cet aspect et de retracer certaines similitudes entre le Mal dans l'œuvre de Tolkien et la mythologie germanique telle qu'elle nous est transmise par les Eddas[3] .
Le « Mal » dans l'œuvre de Tolkien ne correspond pas à la définition qui nous a été transmise par le monothéisme chrétien: il faut plutôt le considérer comme un ensemble de forces destructrices qui défient la vie et l'ordre divin, comme on le retrouve dans l'Edda.
Dans la littérature fantastique, et plus particulièrement dans le genre appelé « fantasy héroïque », Tolkien jouit indéniablement d'une popularité inégalée. Éminent philologue, spécialiste de la grammaire comparée des langues germaniques et indo-européennes, il n'est pas seulement l'auteur d'un récit merveilleux et d'une épopée. Contrairement aux innombrables livres et productions cinématographiques pseudo-mythiques — qui sont dépourvus de toute dimension tragique —, l'œuvre de Tolkien constitue un système mythologique véritablement cohérent, basé sur un mythe cosmogonique et doté d'un cadre dans lequel peut se dérouler une épopée quasi homérique.
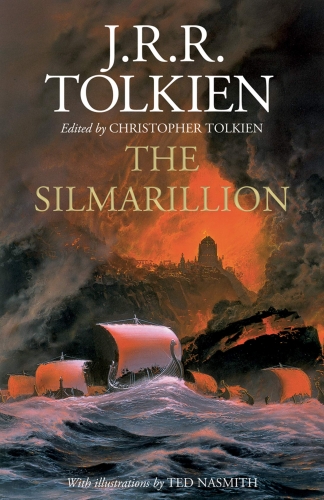
Le Silmarillon, clé de l'œuvre de Tolkien
Tout dans cette œuvre — des anneaux aux épées magiques, des représentants du « Bien » et du « Mal » — est l'expression d'un ordre intérieur propre à l'être humain, tant à l'individu qu'à la communauté du destin. Il s'agit d'un ordre immanent à ce monde, dont l'essence ne peut être comprise en lisant uniquement Le Hobbit[4] - qui a commencé comme une histoire que Tolkien a écrite pour ses enfants - et Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Silmarillion, le lecteur séduit par la Terre du Milieu trouvera les clés indispensables. Bien qu'il ait été publié après Le Seigneur des Anneaux, l'auteur a commencé à écrire le texte dès son retour des tranchées en 1916. Initialement destiné à être inclus dans Le Livre des contes perdus[5] , le manuscrit partiellement inachevé a finalement été publié en 1977 par Christopher Tolkien, le fils de l'auteur.
Dès le départ, Le Silmarillion apparaît comme un livre moins accessible que l'épopée de Tolkien : c'est l'histoire des origines, du commencement lointain – la nuit des temps – qui n'est pas sans rappeler la Völuspá, dans laquelle la mystérieuse Völva raconte les origines et le destin du monde. Le Silmarillion contient tout le contenu mythique qui permet de mieux comprendre Le Seigneur des Anneaux, d'autant plus que les événements du Silmarillion précèdent chronologiquement ceux du Seigneur des Anneaux et en décrivent les causes en détail. Le lecteur y découvre l'élaboration d'un véritable mythe cosmogonique originel, la présence d'un panthéon — dont les fonctions des divinités ne sont pas toujours complètement élaborées — et une vision de la fonction du « Bien » et du « Mal », qui atteindra son apogée dans Le Seigneur des Anneaux.

Certains ont voulu voir dans cette dynamique entre deux forces opposées une allégorie — comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien lui-même a rejeté cette interprétation. Il nous semble plus intéressant d'étudier le statut du « Mal » dans l'œuvre de Tolkien à la lumière de la mythologie germanique telle qu'elle est représentée dans l'Edda. Pourquoi spécifiquement la mythologie germanique ? Germaniste, Tolkien connaissait particulièrement bien plusieurs langues germaniques anciennes telles que le vieux norrois, le vieil anglais et le gothique, et a lui-même traduit et commenté plusieurs textes épiques et mythologiques. Sa connaissance des mythes et légendes germaniques était pour le moins très approfondie. Cette tentative d'analyse succincte n'exclut pas l'existence d'autres influences : certains noms dans le Silmarillon semblent notamment être tirés de l'épopée finlandaise Kalevala. Le quenya et le sindarin, langues elfiques créées par Tolkien, sont quant à elles basées sur le finnois et le gallois. Il est difficile de se prononcer de manière catégorique sur les parallèles entre le Silmarillion et le mythe de la création dans le Mahabarata, car on ne sait pas dans quelle mesure Tolkien connaissait le contenu de ce texte. Certains suggèrent que les sept rivières d'Ossiriand seraient inspirées des sapta sindhu, les sept rivières du Rigveda. Quoi qu'il en soit, il est possible de démontrer de manière convaincante que Tolkien a rédigé un mythe de la création, une mythologie et une épopée héroïque à part entière, qui s'inscrivent dans la lignée de la mythologie germanique et indo-européenne au sens large.
Le mythe fondateur
Le problème du « Mal » ne peut être dissocié de l'ensemble de la cosmogonie. Le mythe tolkienien de la création en fournit lui-même l'explication : il ne s'agit pas d'une création comme acte unique émanant d'une divinité unique et toute-puissante. Cette cosmogonie s'inscrit plutôt dans une conception de l'origine telle que l'a formulée Ernst Jünger dans Besuch auf Godenholm[6] : « La création (...) était possible à chaque point où les flammes de l'inétendu éclataient. »

Dans le Silmarillion, Eru, ou Ilúvatar (illustration) — un nom apparenté à l'allemand Allvater, l'un des nombreux noms d'Odin — crée les Ainur et leur donne trois thèmes musicaux qu'ils doivent élaborer et développer. Ils donnent ainsi forme à Arda, la Terre, et à Eä, le « monde qui est », l'univers.
Ilúvatar ne possède aucune des caractéristiques du dieu jaloux de la Bible ; au contraire, il semble incarner le principe du Devenir. N'envoie-t-il pas ses flammes éternelles à travers l'espace — les flammes de l'inétendu de Jünger —, flammes qui sont à l'origine des mélodies infinies, véritables sculptures musicales ? C'est ainsi que la Terre et l'univers deviennent réalité.

Les Valar, les dieux de la cosmogonie tolkienienne, sont les meilleurs parmi les Ainur. Ils sont quatorze et leurs fonctions sont multiples. Certains Valar présentent des similitudes avec les dieux de notre panthéon familier : il y a ainsi un dieu de la mer (et des eaux en général). Ils correspondent à des forces de la nature, et l'on pourrait ici utiliser le terme de « religion naturelle », si Tolkien ne semblait pas veiller soigneusement à ne jamais inclure de culte religieux ou de forme quelconque d'eschatologie dans son œuvre.
Les Valar, qui participent au chant éternel des Ainur, représentent en quelque sorte les forces de la nature qui façonnent et refaçonnent sans cesse le visage du monde. Ce chant symbolise le devenir : seuls des éléments créateurs peuvent exister. Un monde sans éléments destructeurs serait statique, incomplet et, en l'absence d'une dimension tragique, totalement inintéressant.
Friedrich Gundolf, membre éminent du cercle de poètes autour de Stefan George, suggère que « les dieux subliment toutes les tensions humaines en forces créatrices ».[7] Ces tensions existent également dans l'œuvre de Tolkien ; elles en constituent même le fondement. Quels sont donc les éléments destructeurs nécessaires pour rendre possibles les tensions créatrices ? Le « Mal », en tant que force opposée au « Bien », apparaît déjà dans l'Ainulindalë, où Tolkien raconte le développement des mélodies par les Ainur.

Alors que les Ainur et les Valar façonnent le monde et la vie à travers leur musique, Melkor — lui-même un Valar — développe ses propres mélodies, dissonantes et violentes, qui semblent consister en une négation des harmonies créées par les autres Valar. Les mélodies de Melkor s'ajoutent à l'ensemble des mélodies des Valar : à certains moments, les tonalités harmoniques prédominent, non sans difficulté ; à d'autres moments, c'est la musique dissonante de Melkor qui domine.
Cet antagonisme, mais aussi cette alternance entre les deux forces, reflète la lutte entre les dieux et les Titans, entre l'ordre et le chaos, entre la vie et la mort. Les Valar sont ainsi constamment confrontés à la destruction de leur œuvre, voire à leur propre destruction. Les deux forces sont engagées dans une lutte éternelle, dans laquelle aucune des deux ne peut jamais se vanter d'une victoire définitive.
L'eucatastrophe
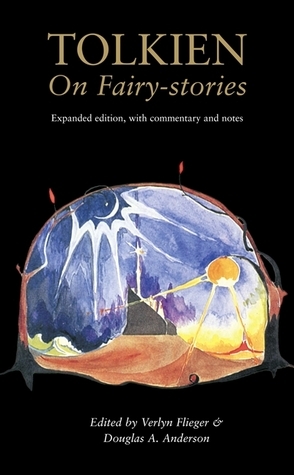 Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »
Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »
Dans cet essai, Tolkien décrit comment la structure du conte de fées, notamment à travers l'eucatastrophe, trouve un écho lointain dans l'histoire du salut chrétien. Tolkien, qui a écrit cet essai une dizaine d'années avant de commencer ses récits, relativise lui-même cette notion lorsqu'il affirme que l'eucatastrophe n'est pas la seule fin possible. Cet essai traite des contes de fées en général, et non spécifiquement du Seigneur des Anneaux, dont la rédaction n'a commencé qu'une dizaine d'années plus tard.
Dans l'eschatologie chrétienne, le Mal est définitivement vaincu lors du Jugement dernier, qui marque la fin de l'Histoire (qui, dans la tradition judéo-chrétienne, a commencé avec l'expulsion d'Adam et Ève du Paradis). Si l'œuvre de Tolkien contient des éléments chrétiens, c'est plutôt dans le personnage de Nienna, une déesse (Valar) qui présente certains attributs de Notre-Dame et plus précisément de la Mater dolorosa, à savoir la tristesse, la compassion et la miséricorde.
Cependant, de nombreux indices suggèrent que le « Mal » n'est pas définitivement vaincu à la fin de la grande bataille dans Le Seigneur des Anneaux. Comme le fait remarquer Paul Kocher dans Master of Middle-Earth[9] : « À en juger par les Âges précédents, le Mal reviendra bientôt. » Lors du dernier conseil avant la bataille, Gandalf, personnage emblématique de l'épopée, déclare que même si Sauron était vaincu et qu'un grand mal était ainsi banni du monde, d'autres se lèveraient.
Par l'intermédiaire de Gandalf, l'auteur relativise davantage l'eucatastrophe, un concept qu'il définit et décrit certes dans un essai, mais dont les perspectives chrétiennes sont finalement absentes tant dans son récit cosmogonique que dans son épopée.

Histoire cyclique
Le « soleil invaincu » est un autre thème récurrent dans l'œuvre de Tolkien : vers la fin du Seigneur des anneaux, le soleil renaît à l'horizon. Tout cela indique que la vision de l'histoire n'est pas linéaire ici : tant que le soleil se lèvera le matin, les grands midis seront inévitablement suivis de crépuscules. La victoire du soleil sur les ténèbres, de l'ordre sur le chaos, est elle-même de nature cyclique.

Le risque et le défi sont donc étroitement liés : la lutte entre les peuples libres (the free people) et les autres — les esclaves des ténèbres, porteurs de destruction et de chaos (les Orques, les Nazgûl, etc.) — revêt ici une dimension véritablement cosmique, mythique et intemporelle. On retrouve cette lutte dans la chasse effrénée du Vala Oromë (ill.), un dieu qui ressemble à Odin à plus d'un titre : le martèlement des sabots de son cheval annonce l'aube et chasse les ténèbres, qui réapparaissent immédiatement derrière lui.
La guerre entre Melkor et les Valar est sans fin et de nature cyclique. Selon Mircea Eliade[10] , la notion de temps chez les peuples archaïques ou les sociétés indo-européennes traditionnelles n'est pas vécue de manière linéaire, mais cyclique. Les rites, les mythes et les fêtes reproduisent les actes originels des dieux, des héros ou des ancêtres mythiques et permettent aux participants de revenir à chaque fois à l'époque primitive (illud tempus).
Eliade fait notamment référence à la tradition védique : les kalpas y sont des époques qui se succèdent à l'infini ; le rituel (agnihotra) permet la régénération du cosmos (au sens de l'Ordre). Eliade estime que le renouvellement périodique du pouvoir royal (dans les traditions iranienne et romaine) constitue une variante indo-européenne de la régénération cosmique.
Lutte éternelle
Peut-on alors compter Le Silmarillio parmi la tradition indo-européenne et plus précisément germanique, dont on sait qu'elle fut l'une des principales sources d'inspiration de l'auteur ? L'Edda nous raconte l'histoire des géants qui ont tué le géant primitif Ymir et ont utilisé les différentes parties de son corps pour façonner l'Univers et le Monde, avant d'être bannis aux confins du Monde par les dieux. Les géants se sont sentis humiliés, et c'est ainsi qu'a commencé une guerre sans fin entre les géants — représentants des forces brutes du commencement du monde et du chaos destructeur — et les dieux, symboles de l'ordre.

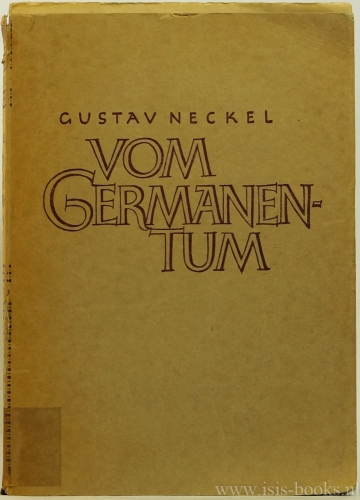
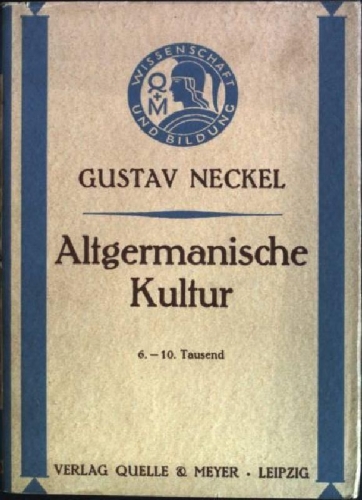
Gustav Neckel y voit un élément mythique très ancien et démontre sa présence dans les récits perses, helléniques et celtiques (principalement irlandais). Dans Vom Germanentum[11] , Neckel parle de l'«*ewigen Kampf dieser entgegengesetzten Gewalten*» (lutte éternelle entre ces forces opposées), dans le même contexte que celui que l'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien.
La vision du monde des Indo-Européens considère la vie comme une lutte éternelle entre des forces qui s'opposent et qui constituent ensemble le Devenir. Tolkien oppose le monde ensoleillé des forêts et des paysages verdoyants et vallonnés, avec ses sources et sa magie, aux déserts, à la désolation des terres arides couvertes de nuages sombres.
En ce sens, la cosmogonie et la mythologie de Tolkien, qui se déploient autour de ce *Streit der aufbauenden mit den niederreißenden Gewalten* (lutte entre les forces constructrices et destructrices, selon Neckel), sont à la fois crédibles et cohérentes.
Les arbres de Yavanna
Dans Le Silmarillion, Tolkien illustre ce cycle à travers l'histoire des deux arbres de Yavanna. Ces deux arbres sont étroitement liés à la mythologie germanique, et plus particulièrement à Yggdrasil, l'if sacré des Germains. Yavanna, tantôt déesse, tantôt arbre sacré reliant la terre et le ciel, veille sur Laurelin et Telperion, deux arbres qui partagent avec l'if sacré des Germains la notion de fertilité et de croissance, ainsi que la menace de leur destruction.

Yggdrasil est en effet constamment menacé par un cerf qui broute son feuillage et par des serpents qui rongent ses racines. Grâce à la présence des Nornes du destin, qui vivent sous ces racines, il ne succombera pas aux attaques sans cesse renouvelées avant le Ragnarök. Yggdrasil reflète la condition humaine et celle du monde dans la mythologie germanique.
Les deux arbres sous la protection de Yavanna finiront par périr, empoisonnés par Melkor : leur disparition marquera la fin de l'ère solaire et le début d'une période sombre, qui ne prendra fin que lorsqu'une des précieuses graines de Telperion redeviendra un arbre. Cela ne se produira qu'au moment où un roi légitime, héritier de l'épée de ses ancêtres les plus lointains et divins, aura reconquis le trône ancestral.
Il s'agit bien sûr d'un mythe de régénération, qui n'est pas sans rappeler le cycle arthurien et les récits de la quête du Graal (Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, mais aussi T. S. Eliot dans The Waste Land[12] ). Le rôle de ces arbres sacrés montre à quel point Tolkien nous plonge dans un univers qui nous est familier.
Loki
Quant au personnage de Melkor, lui aussi semble avoir ses homologues du côté germanique. Tout comme les géants, il a été banni de leur demeure par les dieux. Humilié, il ne cesse de penser à se venger. Il existe une parenté tout aussi évidente entre Melkor, qui est particulièrement rusé, et Loki, le dieu germanique du feu, que Felix Genzmer décrit dans Die Edda[13] comme un fauteur de troubles, un instigateur de tous les malheurs qui frappent les dieux.

Georges Dumézil a consacré une étude approfondie[14] à ce dieu aux multiples facettes. Loki est en effet associé à la ruse et au mensonge. Il est après tout le père de la géante Hel, du serpent Midgard et du loup Fenrir, qui joueront un rôle important dans le Ragnarök. Melkor s'est également forgé une réputation de menteur qui trompe ses victimes par la ruse, la peur, la tromperie et la violence. Les Valar parviennent un jour à le précipiter dans le Néant (nothingness), mais sa place est immédiatement prise par Sauron. Il s'agit clairement d'une fonction essentielle, sinon il n'y aurait eu aucune nécessité de le remplacer.

Loki a engendré des créatures monstrueuses : Melkor fait de même et forme, à partir d'êtres vivants capturés ou enlevés, des races dégénérées, primitives et laides. Les Orques, son chef-d'œuvre — une race monstrueuse et cruelle — sont en effet une dégénérescence de la noble race des Elfes.
La parenté ainsi établie entre Melkor et Loki soulève une question pertinente: alors que Loki vit parmi les Ases à Asgard, Melkor est banni aux confins du monde. Pourquoi les dieux ne se débarrassent-ils jamais complètement de Loki, qui sera finalement responsable de la mort de Balder, le dieu germanique du soleil — un événement qui annonçait le début du Ragnarök et correspond à l'empoisonnement des arbres sacrés par Melkor ?
Après la mort de Balder, les dieux soumettent Loki à d'horribles tortures. À une autre occasion, lorsque Loki se moqua et insulta les dieux, Thor menaça de lui fracasser le crâne avec son marteau. Dans les deux exemples cités, Loki réussit toutefois à échapper à cette punition.
Il en va de même pour Fenrir : bien qu'Odin sache qu'il sera dévoré par ce loup au moment du Ragnarök, il ne le tue pas, mais l'enchaîne. Thor et un géant réussirent un jour à capturer le serpent Midgard ; eux non plus ne le tuèrent pas, mais le laissèrent au contraire libre dans les profondeurs de l'océan, afin qu'il puisse accomplir sa tâche fatidique lors du Ragnarök.
Dans chacun des cas mentionnés, le représentant du Mal — dans toute sa dimension cosmique — parvient à chaque fois à s'échapper alors qu'il est sous le pouvoir des dieux.
Dans le chapitre du Silmarillion intitulé « De la venue des Elfes et de la captivité de Melkor », les Valar capturent Melkor et lui lient les mains avec une corde magique, qui rappelle les chaînes de Fenrir. Pourtant, en échange de quelques vagues promesses, les Valar ne font rien de mieux que de lui rendre sa liberté.
Quand, bien plus tard, ils parviennent enfin à se débarrasser de lui, un successeur endosse immédiatement le même rôle.

Melkor, Loki, Fenrir et le Serpent de Midgard ne sont rien d'autre que les adversaires nécessaires, les ennemis qui confèrent aux dieux leur dimension tragique. Ce sont ces adversaires indispensables qui créent les tensions nécessaires à l'élan créateur du monde.
Gustav Neckel voit dans cette tendance à épargner un ennemi qui s'avérera mortel à l'avenir l'expression mythique d'un ordre cosmique nécessaire, car imposé par le Destin. Même si les dieux avaient voulu détruire ces acolytes du Chaos, ils n'y seraient pas parvenus, car, précise Neckel, le destin est scellé.
Paul Kocher remarque que la survie des héros dans Le Seigneur des anneaux dépend de la chance, de la providence et du destin. Certains personnages de cette épopée connaîtront un destin tragique et héroïque et mèneront une vie risquée.
Quête de régénération
Melkor incarne donc plusieurs aspects du Mal, tels qu'ils sont exprimés dans l'Edda. Soulignons tout d'abord la place du Mal dans la cosmogonie germanique et tolkienienne, telle qu'elle est exposée dans l'Ainulindalë, le premier chapitre du Silmarillion. Il existe ensuite des similitudes indéniables entre la fonction de Melkor et celle de Loki au sein de leurs panthéons respectifs. Melkor n'est pas le diable du monothéisme, mais plutôt un démiurge tragique, sans doute apparenté à Loki, voire à Prométhée.
Ce point de vue est diamétralement opposé à la réinterprétation catholique de l'œuvre de Tolkien. Bien qu'il soit incontestable que Tolkien lui-même était catholique, toute trace d'eschatologie chrétienne est absente de son œuvre.
Dans l'œuvre de Tolkien, on ne trouve aucune trace d'une création du monde ex nihilo. Tout tourne autour d'un mythe de la création dans lequel le Devenir prend forme à travers l'harmonie (l'Ordre), la disharmonie (le Chaos) et la lutte éternelle entre les deux. Melkor, comme Ymir dans la cosmogonie germanique, fait partie des êtres qui précèdent les dieux et n'est pas un ange déchu. Melkor, qui est doté de tous les dons, aspire à l'autonomie et à la domination. Il est le créateur du Chaos, comme les Titans et autres géants dans la tradition indo-européenne.
Et ce Chaos, composante indispensable du devenir, en fait partie intégrante. Melkor confère au monde une dimension tragique qui rend possible l'apparition du héros — une notion qui fait défaut au christianisme, qui préfère vénérer les martyrs qui aspirent à une récompense transcendante.
Nous pouvons conclure que la mythologie créée par Tolkien — même s'il était lui-même catholique — n'a pas un caractère théologique, mais véritablement mythologique, caractérisé par la lutte éternelle entre des forces à la fois opposées et complémentaires: l'Ordre et le Chaos, comme dans les mythes de la création de la tradition indo-européenne.
Le Bien et le Mal dans l'œuvre de Tolkien n'ont pas une dimension morale, mais purement ontologique. Le christianisme aspire au salut ; dans le monde de Tolkien, nous assistons à une quête de régénération, de rétablissement d'un équilibre entre les forces cosmiques. Tout comme dans le Ragnarök, la destruction et la renaissance sont ici indissociables.
Ralf Van den Haute
Notes:
[1] Tolkien, J. R. R. Le Seigneur des anneaux. Londres : George Allen & Unwin, 1955.
[2] Tolkien, J. R. R. Le Silmarillion. Éd. Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1977.
[3] Ralf Van den Haute. Indo-European and traditional mythological elements in Tolkien: A comparative study of the pantheon in « The Silmarillion » and « The Edda », Université libre de Bruxelles, 1984.
[4] Tolkien, J. R. R. Le Hobbit ; ou, Aller et retour. Londres : George Allen & Unwin, 1937.
[5] Tolkien, J. R. R. Le Livre des contes perdus. Partie I. Édité par Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1983.
[6] Ernst Jünger. Besuch auf Godenholm. Francfort-sur-le-Main : Vittorio Klostermann, 1952
[7] Gundolf, Friedrich. Goethe. Berlin : Georg Bondi, 1916.
[8] Tolkien, J. R. R. « On Fairy-Stories ». Dans Essays Presented to Charles Williams, édité par C. S. Lewis, 38–89. Oxford : Oxford University Press, 1947.
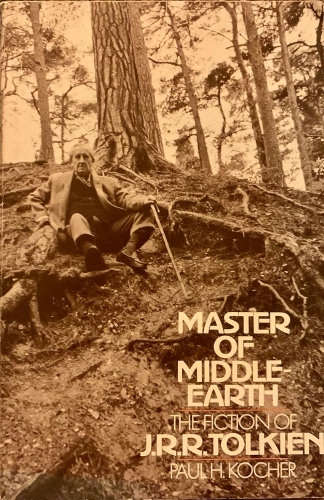
[9] Kocher, Paul H. Master of Middle-earth: The Fiction of J. R. R. Tolkien. Boston : Houghton Mifflin, 1972.
[10] Eliade, Mircea. Le Mythe de l’éternel retour : Archétypes et répétition. Paris : Gallimard, 1949
[11] Neckel, Gustav. Vom Germanentum : Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Leipzig : Harrassowitz, 1944.
[12] Eliot, T. S. The Waste Land. New York : Boni and Liveright, 1922.
[13] Genzmer, Felix (trad.). Die Edda. Iéna : Eugen Diederichs, 1912-1920.
[14] Dumézil, Georges. Loki. Paris : G. P. Maisonneuve, 1948
17:26 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, mythologie, traditions, mythologie germanique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
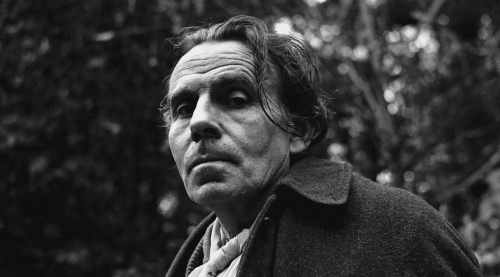
Parution du numéro 489 du Bulletin célinien
 Sommaire:
Sommaire:
Entretien avec Marie Vergneault-Gourdon
Emmanuel Carrère et Céline
Dans la bibliothèque de Céline: G (Galtier-Boissière, La Garçonne, La Gaule…)
Céline sur la Butte (1941)
Actualité célinienne
Point de vue : Céline l’inatteignable.

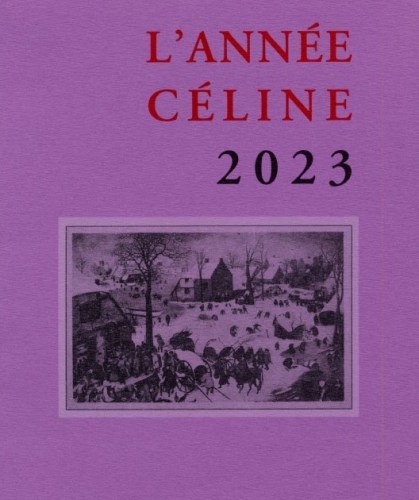

20:23 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, marc-édouard nabe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
Claude Bourrinet
Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.
Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
La révolution romantique
L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.
Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).
Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.
Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.
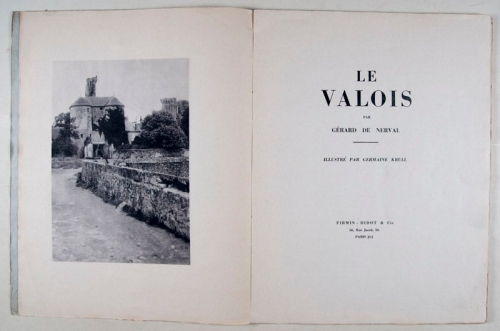
Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …
Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

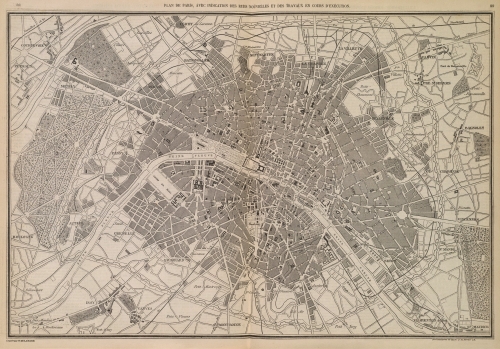

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve
Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).

La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.
Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...
Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.
On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...

Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.
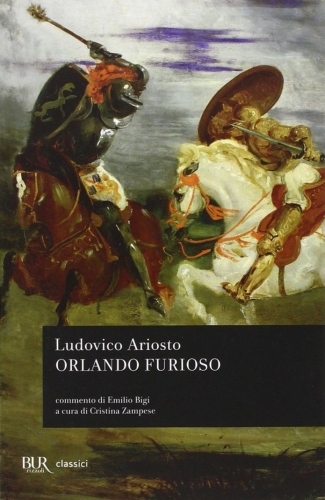
Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.
Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.
La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».

Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.
Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.
Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.
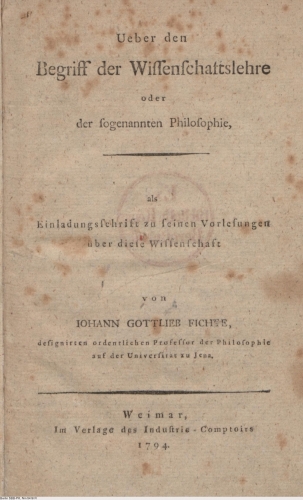
La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).
Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.
Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).
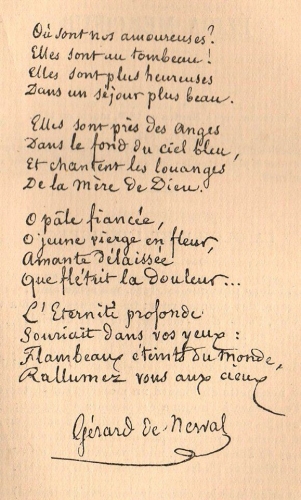
Nerval et l’écriture
Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.
Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.
La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.
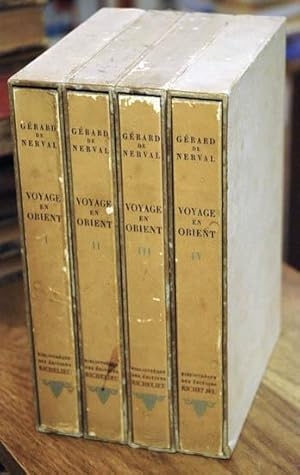
Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.
Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».
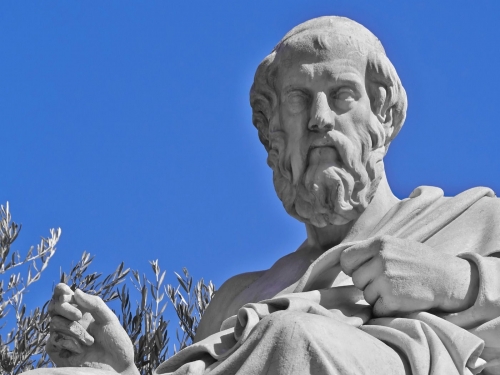
La quête intérieure
Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....
Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.
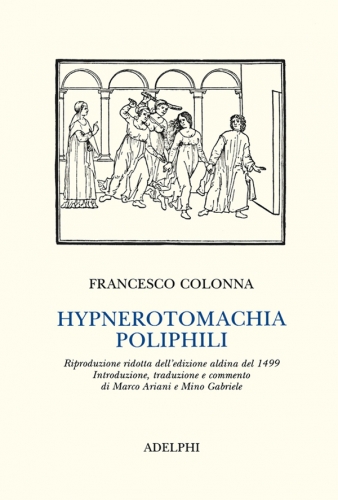
C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.
Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .
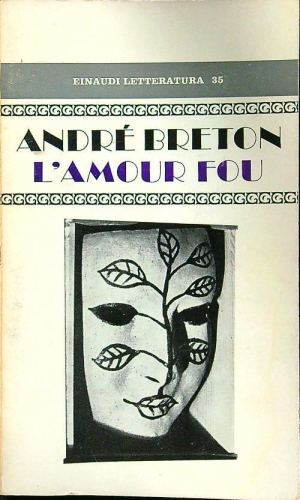
Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.
Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.
La « folie », une voie initiatique
Toutefois, l'œuvre de Nerval n'est pas, à la manière romantique, un épanchement, une confession lyrique, un abri pour le moi, mais le théâtre tragique de son élaboration, de son accomplissement, de son exaucement, dans l'angoisse et la joie. Le verbe est créateur de sens. Il réalise son sens, il est performatif, et c'est pourquoi il est dangereux. Il suit intimement, sans écart, les sinuosités du labyrinthe de la vie, et les éclairs de rêves. Il est lui-même lueur révélante, apocalyptique, illuminante, si l’on ose cette tautologie, et dédale où se dissimule le minotaure, ou bien grotte où s'ébattent les nymphes. Il est la clé qui force le sens, l'Absolu, l’Éternité, le Salut. Mais il est incomplet : il faut trouver la lettre qui manque ; chercher, toujours, sans fin, au-dessus de l'abîme.
Et l'on voit ce qui, soudain, change avec Nerval, et annonce un nouveau continent de la connaissance. Au lieu de se laisser happer par le monde des images, par les visions, de se perdre dans le gouffre de la folie, il tente de maîtriser cet « épanchement », avec une volonté remarquable et poignante, et non seulement d'en considérer les terribles merveilles comme un univers réel, au même titre que celui d'ici, de la terre lourde et laborieuse, mais d'en tirer toutes les leçons, d'en explorer les arcanes pour trouver la lumière. Rappelons l'émouvant et fameux aveu de Baudelaire, pourtant guère prolixe au sujet d'un poète si proche de lui dans le temps et dans l’inspiration, dans la tonalité, répondant au calembour injurieux de Veuillot, qui, dans L'Univers du 3 juin 1855, avait écrit que Nerval avait non pas spiritualisé, mais alcoolisé sa vie : « Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement ? — Et plus récemment encore, — il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, — quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, — si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, — délier son âme dans la rue la plus noire qu’il put trouver, — quelles dégoûtantes homélies !... »
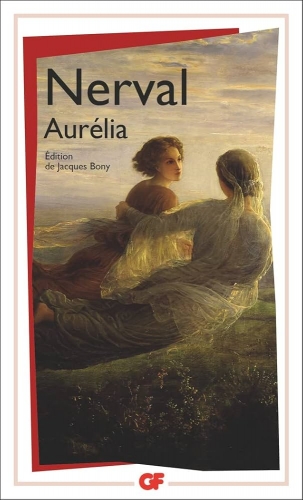
Nerval est peut-être l'être le plus pieux que le XIXe siècle eut sécrété. Dans Aurélia, il indique « les causes d'une certaine irrésolution [les principes de la Révolution, le rationalisme, le scepticisme voltairien] qui s'est souvent unie chez [lui] à l'esprit religieux le plus prononcé ». Il est passé à côté de son temps, et pourtant, il est l'âme d'un âge où la divinité a définitivement quitté la terre désormais désertifiée des hommes, comme l'est la Cythère de 1843, la Cérigo occupée par les Anglais, que surplombe, sur une colline desséchée battue par le clapotis de la Mer de Crète, cette Crète où Ariane dévide son fil, un pendu qui se voit de loin. Il clame dans le désert, en affrontant, dans son propre esprit, le nihilisme qui le ronge comme un monstre chimérique sorti du chaos.
L'expérience du rêve, liée à celle de la nostalgie des origines, transmute sa trajectoire en initiation, en « glissement vers le mythe », comme dit Albert Béguin. C'est retrouver l'aube de l'humanité, l'épanchement du rêve dans la vie réelle, et les déesses, les dieux rendus à la visibilité, à la vénération qui leur est due ; c'est l'expansion du moi, au-delà de la faute originelle, de la mort, de la souffrance, de la solitude, vers une dimension universelle qui concerne l'humanité entière et son destin. Se sauver est retrouver l'harmonie, lui redonner vie, peut-être même rappeler les dieux sur terre, et reconstituer l'Arcadie, l'âge d'or, une nouvelle Cythère, parée d'un amour printanier.

Non sans péril, celui de haute mer. Albert Béguin le rappelle : « Ceux qui se risquent à ces explorations intérieures en ramènent des œuvres singulières et durables, qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et périssable, mais son essence et sa figure mythique. Ils cherchent à rejoindre le plan profond où se déroule, non plus leur propre histoire terrestre, mais leur destinée éternelle. Comme le mystique, ils paient de l'anéantissement de leur personne la plongée dans la nuit. » Heidegger le dit de même : « La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut é-voque le sacré. Le sacré relie le divin. Le divin approche de Dieu. / Ceux qui risquent plus appréhendent, dans l’absence de salut, l’être sans abri. Ils apportent aux mortels la trace des dieux enfuis dans l’opacité de la nuit du monde. »
Nerval dit de lui-même, dans Promenades et Souvenirs : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. » En vérité, Wege – nicht Werke : « Des chemins, non des œuvres », comme écrivait Heidegger quelques jours avant sa mort. Nerval reprocha à Alexandre Dumas de ne produire que des articles de consommation, des objets de divertissement. Lui, expérimentait. Ses livres étaient des quêtes risquées, des jeux d’arène dangereux où danse la corne du taureau. Lorsqu’avec lui, on évoque la « littérature », il est capital de s’enlever de l’esprit l’acception courante, triviale, de ce mot.
Être tout « littéraire », c’est-à-dire rêve, est une autre façon d’affirmer sa folie. Dans une Lettre à Mme Dumas, il s’indigne: "...Mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique [ Nerval évoque la sempiternelle dénonciation de la littérature – vaine, inutile, nuisible – de la part des êtres positifs, ayant pieds sur terre, qui œuvrent pour le Bien commun, et mettent l’utilité pratique, celle des économistes et des banquiers, au-dessus de toute la beauté du monde – qui, le rappelle Gautier, ne sert à rien ], on ne m’a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à ma véracité. Avoue ! avoue ! me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le Dictionnaire médical. À l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un ! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »).
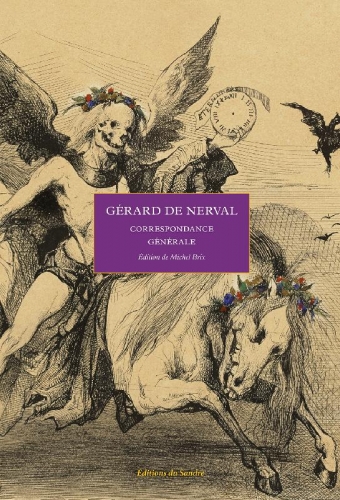
Nerval proteste contre la version clinique, et met l'accent sur la dimension "poétique" (existentielle, en vérité), sur la "voyance", à la suite des romantiques allemands comme Novalis. La "folie" (liée au rêve) est un autre nom pour désigner la création "poétique" (ces deux mots sont des pléonasmes), mais aussi le véritable royaume de la vie humaine, qui ne correspond pas au domaine restreint et restrictif de la conscience "diurne", trop mesquine et trompeuse. La vérité se trouve à l'intérieur de l'être humain, et le monde extérieur est le résultat de la projection de ce contenant trop inexploré. Évidemment, pour un scientifique comme le docteur Blanche (portant très ouvert, adepte de méthodes douces et intelligentes), c'est là une perception entachée de suspicion. Dans les faits, nous ne nous en apercevons pas, mais nous sommes des fous, nous vivons comme des fous. Certes, des fous qui se parent d'un costume "raisonnable", pour donner le change. A moins que nous ne soyons des rêveurs qui croient, parfois, ne pas rêver.
La littérature rend visible, lisible, réelle, cette « folie ». L’île de Calypso, l’antre du Cyclope, dans l’Odyssée, la Terre du Milieu, du Seigneur des anneaux, l’Enfer, de Dante, sont lestés de plus de réalité, de présence (parousia) que le décor urbain évanescent, exsangue et fantomatique de nos besoins erratiques, qui, de la maison au supermarché, de la voiture au bureau, ornent notre vacuité existentielle ; et Julien Sorel, Hamlet, Rastignac, le Grand Meaulnes, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Erec et Enide, Don Quichotte (ce proto-Nerval), Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, sans parler du pharmacien Homais, et même, dans les Évangiles, Pierre, Paul, ou Jean, existent davantage, que mon voisin, ou que le ministre de l’économie du moment, et me sont peut-être comme des étoiles à suivre, ou à ne pas suivre. Ils sont la réalité, en vérité. Peut-être la plus authentique, celle qui possède un sens. Ne dit-on pas que les femmes du peuple montraient Dante du doigt, considérant le teint cuivré de son visage comme le témoignage irréfutable de son séjour en Enfer ? Elles avaient la foi du charbonnier. Combien ont cru que Malraux avait participé à la guerre civile de 1927, à Shanghai, et qu’il avait même été l’un des chefs de l’insurrection ? Ernst Jünger, quant à lui, entre deux coups de feu, lisait avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. » Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année.
Les paysages mentaux et le théâtre de nos songes, tout « imaginaires » qu’ils soient, peuplent davantage, même le jour, la salle obscure de notre existence, que ce que l’on appelle la « réalité », mais qui ne se résout qu’à une cascade de données sans signification véritable. Et nous ne sommes essentiellement cette « folie » : grande ou petite.
Note:
(1) « Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d’employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d’un livre unique : la lecture suivie de ces pages est ce qu’on nomme la vie réelle ; mais quand le temps accoutumé de la lecture (le jour) est passé et qu’est venue l’heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l’ouvrant au hasard à tel ou tel endroit et tombant tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissions pas ; mais c’est toujours dans le même livre que nous lisons. »
[…]
« Si l’on se place, pour juger des choses, à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder aux poètes que la vie n’est qu’un long rêve. »
Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819 (mais la publication n'en a été faite, en France, qu'en 1886.
15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, poésie, 19ème siècle, romantisme, romantisme français |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Visionnaires dans l'erreur
Par Juan Manuel de Prada
Source: https://noticiasholisticas.com.ar/visionarios-equivocados...
Beaucoup de récits de science-fiction se sont révélés, avec le temps, prophétiques. Leurs auteurs, de véritables visionnaires capables d’apercevoir des réalités qui, à leur époque, pouvaient sembler inconcevables, ont anticipé avec leur imagination ce que le développement scientifique et technologique rendrait possible plusieurs décennies plus tard. C’est le cas, par exemple, de Jules Verne, qui a prédit l’invention d’engins tels que la télévision, le sous-marin ou les vaisseaux spatiaux. Ou celui de Karel Čapek, qui a anticipé la création de machines qui remplaceraient le travail de l’homme, allant jusqu’à usurper sa place dans la société, machines qu’il a nommées « robots ».
Et, pour couronner le tout, l’influence de ces récits spéculatifs a largement dépassé le domaine purement scientifique pour envahir ceux de la politique et de la sociologie, comme c’est le cas, par exemple, avec des auteurs comme George Orwell ou Aldous Huxley, qui ont anticipé de nouvelles formes de tyrannie, avec une surveillance omniprésente, un langage manipulé et un divertissement « immersif » et idiotisant, des délices sur lesquels reposent nos régimes démocratiques merveilleux et opulents.

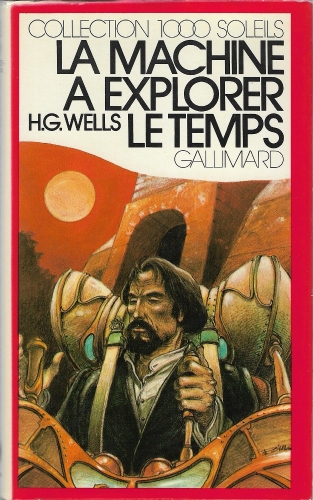
Parmi tous les auteurs classiques de science-fiction, c’est peut-être Herbert George Wells (1866-1946) qui a bénéficié de la plus grande reconnaissance littéraire, avec des œuvres emblématiques telles que La Guerre des mondes, La Machine à explorer le temps ou L’Homme invisible; cependant, aucune de ses anticipations ne s’est réalisée.
Un siècle après que Wells les ait imaginées, ses romans restent, en effet, dans son univers de fiction: les hommes n'ont pas voyagé dans le futur, les martiens n’ont pas envahi notre planète, l’invisibilité n’a pas éliminé notre pauvre enveloppe charnelle. Peut-être ma préférée parmi toutes les œuvres de Wells est La Machine à explorer le temps, où son auteur n’a pas encore sombré complètement dans le pessimisme funeste où il finira par s’engluer dans ses dernières œuvres. Le roman contient des réflexions sur certaines des obsessions les plus récurrentes de Wells (le communisme et le darwinisme, en particulier), mêlées à une intention moraliste peut-être trop accentuée, qui met en garde contre la possibilité d’un avenir inhabitable. La division de l’Humanité en deux races opposées (et également déshumanisées), une belle et douce humanité qui habite à la surface de la Terre, une monstrueuse humanité confinée dans un monde souterrain, constitue une allégorie du destin atroce où nous conduisent les différences de classe; et la fin inexorable – nous avertit Wells – d’une Humanité déshumanisée, sans solidarité ni courage, ne sera autre que l’extinction pure et simple.
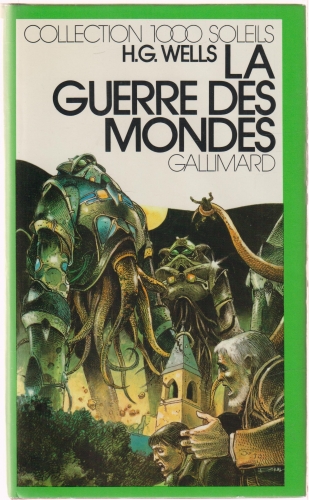
Lorsque Wells exploitait sa faculté singulière de rêver (surtout de cauchemarder), il s’avérait un narrateur inégalé dans l’artifice, la technique, la finesse, la force plastique, l’humour, la variété et la pénétration intellectuelle, bien que sa conception manichéenne de l’univers l’incline toujours à la désespérance, malgré ses proclamations progressistes (ou peut-être justement pour cela).
En revanche, lorsqu’il essayait d’écrire des livres avec des programmes rigoureusement charpentés pour réformer le monde et créer des paradis sur terre (une manie messianique qui s’est approfondie au fur et à mesure qu'il vieillissait), ses livres devenaient de véritables boulets, aussi prolixes que grotesques; souvent contradictoires, mais toujours unis dans sa haine implacable contre le christianisme.
Homme d’origine modeste, de santé robuste, avec une vie sentimentale tumultueuse et des habitudes de travail très disciplinées, moitié communiste, moitié socialiste, mais toujours très anglais et obstinément antireligieux, Wells a évolué, passant de l’euphorie optimiste de sa jeunesse, propre à celui qui croit pouvoir réparer le monde en un clin d’œil, jusqu’au désespoir amer de ses dernières œuvres, où il déclare sans ambiguïté que l’espèce humaine va droit dans le mur, qu’il n’y a pas de sortie possible à cette impasse dans laquelle l’Humanité est entrée, que Homo sapiens a épuisé son cycle et qu’un autre animal devrait venir prendre le relais, suivant les lois du darwinisme.
Les anticipations littéraires de Wells ne se sont pas réalisées; cependant, en ce qui concerne les voyages dans le temps, on pourrait toujours soutenir que notre vie est un voyage constant à la vitesse d’une heure par heure. Mais que Wells n’ait pas démontré dans ses romans la prescience – prenons Verne comme exemple – ne diminue en rien leur valeur littéraire. Au contraire, ses visions politiques sur l’avenir et ses délires darwinistes nous paraissent aujourd’hui, en plus d’être ennuyeuses, complètement erronées (d’où le fait que plus personne ne les lit). Lorsque l’on professe des idées erronées ou délirantes, il vaut mieux se consacrer à une littérature pure et agréable.
17:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, h. g. wells, science fiction |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Drieu: Histoire d’une adolescence
par Andrea Scarabelli (2016)
Source: https://legio-victrix.blogspot.com/2025/11/andrea-scarabe...
Yukio Mishima écrit ses Confessions d’un masque entre vingt et trente ans. C’est en 1949. Bien qu’il ne l’admette pas, il s’agit d’une autobiographie, et c’est précisément pour cette raison qu’elle n’a pas manqué de susciter des polémiques, pour des motifs que nous laissons aux professionnels du scandale. Le livre parle des premières incursions dans la vie d’un adolescent qui vit en lui-même le déséquilibre de son temps. Car c’est là que résident la grandeur ou la misère d’une vie : soit elle parcourt les étapes d’une civilisation entière, incarnant ses fractures, exhibant ses lacérations, soit elle est tout simplement peu intéressante.
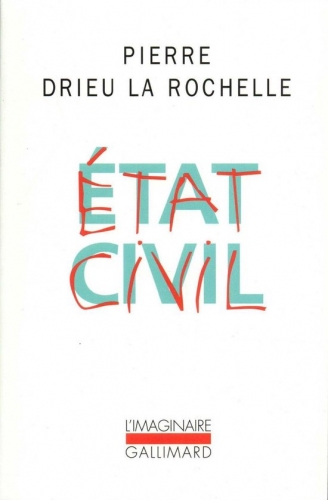 Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…
Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…
Nous sommes en 1921, comme on le disait. Le jeune Drieu n’avait publié que deux livres : Interrogation, en 1917 (récemment traduit en italien par La Finestra), et Fond de Cantine, trois ans plus tard. Ce sont deux recueils de poèmes. Il ne s’était pas encore lancé dans l’écriture des Chiens de paille, ni dénoncé les Comédies de Charleroi, ni mesuré sa France. Il n’était pas encore un « socialiste fasciste », ni n’avait tenté de marquer le siècle, et le lyrisme crépusculaire de ses magnifiques Journaux était encore bien loin, tout comme Gilles et Feu Follet. Avant de plonger dans ces œuvres qui feront de lui un auteur de sa génération, le jeune Drieu avait une petite affaire à régler: son adolescence.
À quel âge écrit-on une autobiographie ? On pourrait répondre : cela dépend de la vie que l’on a vécue. Mais aussi de combien, comme on l’a dit plus tôt, cette autobiographie reproduit le Zeitgeist, l’esprit du temps, devenant un diorama du siècle. Or, État Civil n’est pas seulement un récit d’années fugitives, des premières expériences à l’école, de la découverte d’un monde, des premières fautes et expiations… C’est la narration de la jeunesse d’un siècle qui se serait divisé en deux guerres mondiales, arrivant en retard à sa rencontre avec le destin. Un siècle éternellement en retard sur lui-même: d’où l’importance de livres comme celui-ci, avant-gardes d’une Europe qui aurait pu être, mais ne fut pas, et que le geste suicidaire de Drieu l’a empêché de voir. Un acte d’une extrême compassion, peut-être, commis par l’auteur envers lui-même.
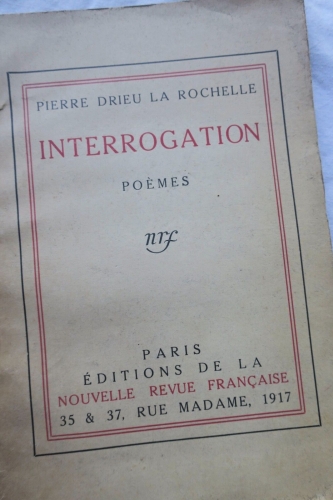
«Tout crépuscule est une aube», écrivait Ernst Jünger. Si Drieu évoque ses expériences juvéniles, ce n’est pas pour fermer la porte à l’enfance, mais pour en préserver intacte toute la fraîcheur. Il suffit de lire quelques pages d’État Civil, autobiographie en l’absence de biographie, pour comprendre: «Les enfants n’appartiennent pas à la même époque, à la même race, au même continent que les hommes. Ils vivent dans des Ères passées ou encore à venir… Armés de tous leurs sens, dotés d’une capacité extraordinaire d’intuition, ils parlent avec tout l’univers une langue mystique qu’ils oublient aussitôt, et habitent des terres vierges». Ils ressemblent aux sauvages: «Comme eux, ils se laissent domestiqués, et comme eux, ils meurent si leur liberté se perd».
 Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».
Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».
Il portera cette enfance avec lui dans les années à venir, dans ses rencontres et ses relations, dans les soirées de gala et les tempêtes d’acier, y infusant ses œuvres et ses articles pour ces revues qui lui coûteront l’excommunication par la culture officielle et l’accès au Panthéon de la Pléiade seulement en 2012, dans une édition d’ailleurs très expurgée et hygiénisée par ceux qui ne se lassent pas de réécrire notre passé. Mais cela n’enlève rien à la valeur de livres comme celui-ci. Le «maudit» Drieu nous connaissait très bien...
13:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre drieu la rochelle, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Deux textes sur Julien Gracq:
Gracq et le groupe des Hussards
Claude Bourrinet
Les Hussards ont l’air de revenir à la mode, actuellement. Je me suis demandé ce que Julien Gracq en avait pensé, et j’ai mené ma petite enquête.
Néanmoins, je dis tout de suite que Les Poney sauvages me sont tombés des mains: trop anglo-saxon, non seulement par le thème (je n’y suis pas opposé en principe, admirant maints auteurs britanniques, mais les membres des services secrets de sa Gracieuse majesté, non !), et, surtout, un style à l’américaine, efficace, qui roule des mécaniques, grande gueule et sentant le whisky, donnant l'impression qu'on va assister à un pugilat de saloon … très peu pour moi. A l’opposé (à propos du style), le style laborieux, qui s’entend écrire, qui veut faire du … style (puisque c’est la marque de la droite), présumé « aristocratique » (c’est-à-dire supposé égotiste, au-dessus du vulgum pecus de la littérature vernaculaire, bien qu’on vise quand même à vendre abondamment), ostensiblement « réactionnaire » (id est attaché aux « valeurs » si galvaudées actuellement, comme du parfum Dior de contrefaçon), en somme l’écriture (si on ose dire) d’un Tillinac, m’irrite à tel point, que ça me donne envie de lire du Marc Lévy.

Toujours est-il que le contraire du mensonge n’est pas toujours la vérité. Je veux dire par là qu’en se hérissant contre l’engagement politique inquisitorial, et désastreux pour la littérature, des ivrognes de gauche, on risque de verser dans la même ornière, en état d’ébriété, mais du côté droit du chemin des certitudes. Ils sont socialo-communistes ? qu’à cela ne tienne ! on sera de droite, de droite dure, et même traînant des souvenirs glauques, de quoi faire pâlir le vendeur de rue de l’Humanité !
C’est bien, ce que leur reprochait le discret et apolitique Gracq : outre qu’il a toujours méprisé les « écoles littéraires » (et les Hussards en sont une), il voyait en eux une bande de jeunes tapageurs (c’était le temps des blousons noirs, des yéyés, de la génération « jeune » en train de naître, et tout cela avait une senteur chewing-gumée d’Amérique, nation roulant à 100 à l’heure, au point d’exporter ses accidents tragiques de bagnole, cette μηχανή moderne à apothéoses pour journaux à sensations), et qui épataient le bourgeois conformiste, comme les sartriens existentialistes l’avaient fait à Saint-Germain-des-Prés. Et cette pétarade langagière se voyait dans la forme. Il disait : « Ils écrivent comme on conduit une décapotable : vite, pour le vent. Moi, j’écris comme on marche dans une forêt la nuit : lentement, pour entendre. » Ces hussards galopent beaucoup, mais on ne sait trop où.
Là, Gracq touche un point essentiel. Ecrire n’est pas jongler. On peut bien aimer le champagne, mais allez trouver du sens aux noces éclaboussantes de lumière ! Certes, ce qui est digne d’intérêt, dans ces orgies crâneuses, ce sont les petits matins blêmes, où l’on traîne sa mélancolie. Il est bon, parfois, de s’inspirer de Nerval. Il est vrai que les Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent, Michel Déon (qui s'acheva en devenant Immortel, en 1979) etc. se réclamaient de Stendhal, lequel s’imposait la gaieté, par devoir beyliste, mais qui passa son existence à se ronger les sangs.
Du reste, et je vais faire une digression: on confond, dans certains milieux, égotisme et égoïsme. Rien n’est plus erroné. L’égoïste prend, l’égotisme donne. L’égoïste se réjouit de son individualisme, l’égotiste est sociable, et même plein de compassion pour le faible, le prisonnier, la victime (il n’est qu’à lire, pour s’en rendre compte, Le Rouge et le Noir, Lucien Leuwen – où le héros éponyme, qui est pourtant officier, est pris de pitié pour les ouvriers, que l’armée s’apprête à charcuter, ou bien La Chartreuse de Parme). L’égoïste est rapace, cherche à accumuler, l’égotiste se dépouille des passions superfétatoires (presque toutes les passions, du reste), pour s’en tenir à l’essentiel : la beauté et l’amour, parfois la pensée. L’égotiste éprouve même un penchant à l’ascétisme, au jansénisme (on trouve cette tentation chez Stendhal, et surtout chez Baudelaire le "dandy", dont le perfectionnisme vestimentaire n'était pas une ostentation de cabotin, mais le SIGNE d'une moralité supérieure). L’égoïste se moque du malheur des autres, pourvu qu’il ait sa pâture, l’égotiste ne se sacrifiera pas a priori pour le bien de l’humanité (imitant ainsi le sage que nous présente La Fontaine dans la dernière fable de son recueil), mais, bien qu’il sache que les happy few ne sont, par définition, pas nombreux, il pensera que son bonheur est susceptible de s’accroître du bonheur d’autrui. L’égoïste ne croit, lui, en rien, il est cynique, et se réjouit d’être supérieur, ce que ne fera jamais l’égotiste, qui fuit le mauvais goût.

L'égotisme se manifeste par ce que Stendhal appelle la chasse au bonheur. Pour Stendhal, c'était l'amour, pour Gracq, c'est l'osmose avec la terre, avec le monde, le "Grand oui". Evidemment, dans les deux cas, il ne saurait être question que de singularité, de recherche individuelle, et de retrait, voire de discrétion. L'égotisme, comme le radical le suppose, concerne le moi. Mais un moi qui n'est pas égoïste, même s'il n'a de compte à régler avec personne. Son apparente hauteur n'est qu'une humilité qui se connaît, et le degré suprême de la modestie.
Pour en revenir à Gracq, sa clarification : « Moi, j’écris comme on marche dans une forêt la nuit : lentement, pour entendre » laisse entendre bien plus que ce qui ne concerne que la forme et le style. Pour lui, l’écriture est une recherche à tâtons dans l’opacité d’un monde parcouru d’énigmes, un méthodique décryptage, comme lorsqu’on lit une carte, des arcanes de la nature, de la vie, de l’existant ; d’où une phrase complexe, emmêlée, distordue, qui procède de surprises en trouvailles, de sensations fines en intuitions subtiles. Tout le contraire des Hussards, dont il appréciait tout de même Blondin et Nimier, tout en leur reprochant, à l’un, d’être trop « alcoolique », et à l’autre, de trop faire claquer la phrase.
* * *

Gracq, Les Eaux étroites et le Sortilège
«Pourquoi le sentiment s'est-il ancré en moi de bonne heure que, si le voyage seul – le voyage sans idée de retour – ouvre pour nous les portes et peut changer vraiment notre vie, un sortilège plus caché, qui s'apparente au maniement de la baguette du sourcier, se lie à la promenade entre toutes préférée, à l'excursion sans aventure et sans imprévu qui nous ramène en quelques heures à notre point d'attache, à la clôture de la maison familière?».
Ces quelques lignes, qu'il faudrait lire et relire, apprendre par cœur comme le verset de la Bible de l'existence, initient ce merveilleux petit récit que Gracq publia en 1976: Les eaux étroites.
Il s'agit avant tout de porter une attention sérieuse à l'épithète « étroite ». Nous ne sommes plus ici à la Pointe du Raz où Gracq, en compagnie de Henri Queffélec (surpris par le regard lointain de son ami), reçut comme un coup de fouet au cœur le sentiment saisissant de la gravité massive du Continent eurasiatique, et l'aspiration « sans idée de retour » du grand large, qui le propulsait vers un infini d'aventure et de joie, ouvrant ainsi « les portes » de l'amor fati (et de la littérature). Il ne s'agit pas non plus que cette osmose qui procède de l'immobilité consécutive à un abandon sur la Terre enchanté, extase mystique (ce sont ses mots) qu'il éprouva dans les Flandres, durant la guerre, en 1940, ou en 1925, quand il était collégien au lycée Clemenceau, à Nantes, et qu'il se « récréait », avec ses camarades, comme chaque semaine, dans la prairie de Mauves : «... une après-midi, allongé dans l'herbe haute et regardant couler la Loire au ras des prés, j'eus tout à coup l'esprit ensoleillé par une bizarre illumination quiétiste: le sentiment, au moins approximatif, qu'il était parfaitement indifférent, et en même temps parfaitement suffisant et délectable, de me tenir ici ou d'être ailleurs, qu'une circulation instantanée s'établissait entre tous les lieux et tous les moments, et que l'étendue et le temps n'étaient, l'un et l'autre, qu'un mode universel de confluence. Si je compare à un ensoleillement cette sensation de passivité à la fois enivrée et comblée, c'est qu'elle se montra relativement durable, et ne disparut, en s'affaiblissant peu à peu, qu'au bout de deux ou trois heures. »

Assurément, si la première expérience s'apparente à une tension nietzschéenne, dont Gracq, comme le vates de Sils-Maria (1881, révélation de l'Eternel Retour), pressentait l'épuisement (« Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer ! - Ainsi parlait Zarathoustra), celle de la « promenade » sur un « bachot centenaire – bancal, délabré, vermoulu, cloqué de goudron, et parfois dépourvu de gouvernail – sur l'Èvre (photo), « petit affluent inconnu de la Loire » « enclôt dans le paysage de mes années lointaines », qui n'avait « ni source ni embouchure qu'on pût visiter », jure avec l'errance sans limite qu'offre le vaste Océan, dont Baudelaire disait qu'il était une analogie de Dieu (d'un Dieu que Gracq évacue de sa Weltanschauung). Car cette « balade » tranquille est loin de prendre cette teinte tragique qu'induit la pensée de Nietsche. On penserait plutôt à Heidegger commentant Hölderlin, pour qui le voyage du poète à Bordeaux n'avait de sens que dans le retour, « plein d'usage et raison », au pays natal (Heimat), qui n'a certes pas un sens patriotique, mais qui relève de la quête de l'être (terme trop abstrait, au demeurant, dont se méfiait Gracq), de cette « clairière » qui, pour l'auteur des Carnets de grand chemin, s'attache à l'imaginaire, aux souvenirs, aux glissements littéraires de la poésie occidentale, aux sensations, aux rêveries... qui sont autant de retour à soi. Jamais Gracq, alors, ne fut plus près du Nerval de Sylvie, dont Proust a dit qu'il inaugurait une autre manière de voir le monde.
Gracq était géographe de formation et de profession, et, tout comme l'oeil de Jünger avait été formé par la pratique quasi constante de l'entomologie (même en pleins combats, il avait un regard aux aguets pour les insectes, comme pour les shrapnels), il gardait cette précision acribique qui caractérise l'homme de science. Jünger parlait d'approche kaléidoscopique, et Gracq use aussi de cette conciliation entre l'observation froide et la chaleur de l'abandon au courant sensoriel et psychique.


On ne manquera pas de remarquer que, comme pour les mystiques qui empruntent la « voie étroite » (et le titre de ce récit: Les Eaux étroites, nous fait signe) chemin de l'humilité (terme qu'il faut prendre au sens littéral d'intimité simple avec la terre - Gracq emploie par ailleurs le titre d'un ouvrage du géographe allemand Suess ; « La Face de la terre », Das Antlitz der Erde ) – humus – proche d'humiliation – mais chez Gracq, cette idée est à rejeter -, en tout cas de dépouillement, de « pauvreté », de joyeux « délaissement » - comme ces oiseaux du ciel qui ne se soucient pas du repas du lendemain et se satisfont de ce que le bon Dieu leur abandonne dans l'instant -, l'auteur insiste sur la modestie d'une aventure sans aventure, d'une découverte sans « imprévu », comme si l'on retrouvait – expérience onirique bien connue où l'on croit redécouvrir une expérience vécue jadis – un lieu intimement familier (peut-être le cœur du monde) qu'il appelle « notre point d'attache, à la clôture de la maison familière ». Anamnèse platonicienne, mais non de « Là-bas », mais bien d'Ici, dans le monde charnel de la Présence. Pour Gracq, la Parousie est à portée de main. "Habiter, être mis en sûreté, veut dire : rester enclos (eingefriedet) dans ce qui nous est parent (in das Frye), c’est-à-dire dans ce qui nous est libre (in das Freie) et qui ménage toute chose dans son être. Le trait fondamental de l’habitation est ce ménagement. Il pénètre l’habitation dans toute son étendue. Cette étendue nous apparaît, dès lors que nous pensons à ceci, que la condition humaine réside dans l’habitation, au sens du séjour sur terre des mortels." 'Heidegger)
Aussi faut-il, derrière ces derniers mots, voir une acception beaucoup plus large que le simple endroit où l'enfance s'est déployée (l'Èvre se jette dans la Loire, à 1500 mètres de Saint-Florent-Le-Vieil), dont il porte souvenir, mais sans nostalgie ni regret (Gracq est tout d'acceptation jubilatoire du présent, il est l'homme du « Grand oui » au monde). S'il emploie aussi le vocable de « sortilège », en ajoutant que s'attache à lui l'idée de la « baguette du sourcier », c'est qu'il songe à une source souterraine qu'il s'agit de repérer et peut-être de capter (ce qui ne signifie pas capturer, mais se laisser porter par elle). Nous sommes ici en plein conte de fée. Cette source pressentie, à laquelle on aurait accès grâce à un sortilège, c'est peut-être cette « clé », obsession qui revient maintes fois dans ses écrits, et qui était aussi la hantise de Nerval cherchant, à la manière des kabbalistes, la lettre qui manquait pour lire le secret du monde. Et l'on aura garde de ne pas oublier que s'il est un « motif » récurrent de la vie de Gracq, c'est bien celui de la Queste du Graal.

Et l'idée sans doute la plus la plus déroutante pour un Occidental (quoiqu'on la retrouve parmi tous les mysticismes, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident) – et Gracq n'aura jamais été aussi proche du bouddhisme zen - c'est le sens de la gratuité, de la grâce, donc, de ce qui est donné comme ça, sans gain ni profit, sans idée derrière la tête, sans utilité convoitée, comme pur et absolu abandon à ce qui est, à ce qui est offert par l'instant, sans aucune volonté de maîtriser par la pensée le flux des sensations, quiétisme extatique si proche, au fond, de la démarche surréaliste, dont le projet, à la suite de Rimbaud, était de « changer la vie » : « Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. » (André Breton)
14:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : julien gracq, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

James Joyce à Zurich
La plus grande ville suisse a été un lieu important dans la vie de l’écrivain irlandais, à la fois comme lieu de création et comme refuge, ainsi que celui où il est décédé.
Duarte Branquinho
Source: https://sol.sapo.pt/2025/11/05/james-joyce-em-zurique/
Comme son nom l’indique, la Bahnhofstrasse est l’avenue qui relie la gare centrale de Zurich au lac. Je l’ai parcourue tant de fois qu’elle est devenue une routine et a élevé mes exigences en matière de propreté urbaine. Aujourd’hui, je jette un regard oblique et laisse échapper une exclamation spenglerienne en voyant la moindre négligence, comme un rare mégot sur le sol. C’est ironique, car dans ma Lisbonne natale, j’ignore de telles traces laissées par les fumeurs, comme si elles faisaient partie du paysage. C’est la preuve que les lieux s’ancrent en nous…


Cependant, je me souviens avoir admiré la propreté impeccable de cette avenue et noté que cela restait fidèle au commentaire de James Joyce: «Si vous renversiez de la soupe sur la Bahnhofstrasse, vous pourriez la manger directement du sol, sans cuillère».
L’écrivain irlandais, figure centrale du modernisme, a passé une grande partie de sa vie itinérante à Zurich, qu’il fréquentait souvent, et c’est ici qu’il a écrit une grande partie de son oeuvre monumentale Ulysse. Cette œuvre maîtresse fut une de mes lectures précoces car elle se trouvait dans la bibliothèque de mes parents et, interpellé par sa difficulté, je n’y reviendrai que bien plus tard, lors d’un voyage à Dublin, où j’ai suivi ses pas. Déjà à Zurich, malgré l’importance que la ville eut dans la vie et l’œuvre de l’auteur, je n’ai jamais fait de parcours complet et réfléchi, peut-être parce que je me sentais « chez moi », mais je l’ai finalement fait en plusieurs moments séparés.
Dans le bâtiment de l’Universitätsstrasse où Joyce a vécu en 1918, il y a une plaque indicatrice, discrète, mais l’écrivain irlandais a eu plusieurs résidences à Zurich, et il est difficile de suivre sa trace.

Il y a quelques années, je suis allé au James Joyce Pub, dans la Pelikanstrasse, et j’ai aimé la décoration (photo). L’établissement existe depuis 1978 et, bien sûr, l’auteur qui lui donne son nom n’y a jamais mis les pieds. Plus tard, j’ai appris que l’intérieur de style victorien provenait de l'Antique Bar de l’hôtel Jury’s à Dublin, qui a été installé ici après avoir été acheté par une banque suisse. Finalement, il y avait un lien avec l’écrivain irlandais, car Joyce fréquentait l’Antique et l’a mentionné dans son œuvre.

Y avait-il encore d’autres établissements fréquentés par Joyce ? La réponse était évidente: un lieu central où je passe si souvent. Le Café Bar Odeon est un classique de Zurich, ouvert en 1911, dans le style Art Nouveau, qui a vu passer écrivains, poètes, peintres, musiciens, politiciens, scientifiques, car c’était un point de rencontre en ville. Parmi les noms les plus connus qui y sont venus, on compte Stefan Zweig, Somerset Maugham, Hermann Hesse ou James Joyce. Mais aussi Arturo Toscanini, Albert Einstein, Lénine et Benito Mussolini. Ici, se rassemblaient les dadaïstes, et au premier étage, Mata Hari s’est produite, deux ans avant d’être exécutée en France pour espionnage. Aujourd’hui, c’est un lieu historique mais vivant, dont le charme résiste au passage du temps.

James Joyce est retourné à Zurich en 1940 et y a trouvé, l’année suivante, son dernier repos. En mars de cette année, j’ai finalement décidé de visiter la tombe de Joyce, un Ehrengrab, située au fond du couloir central du cimetière de Fluntern, où sont aussi enterrés sa femme Nora, son fils Giorgio et sa femme Asta. Il ne manque que sa fille, Lucia Joyce, qui a été diagnostiquée schizophrène et a été une patiente de C. G. Jung, et qui a été internée au Burghölzi, mais a été transférée dans un hôpital à Northampton, la ville où elle est décédée et où elle repose. L’endroit est discret et parfaitement entretenu, et la statue de Joyce, œuvre de Milton Hebald, nous regarde détendue, tandis qu’il fait une pause de lecture et de cigarette…
18:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, littérature anglaise, littératuree irlandaise, lettres, lettres anglaises, lettres irlandaises, littérature, suisse, zurich |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Frédéric Andreu
« Je ne puis me défendre de l’idée que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière ». En écrivant, nous sommes des Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu ». — Luc-Olivier d’Algange, Entretien avec André Murcie.
Porteur de la lampe poétique, Luc-Olivier d’Algange connaît l’art d’éclairer les blasons d’attente de nos âmes. On lit un texte de lui en se surprenant, parfois, à voir le monde par ses yeux. Et lorsque l’ouvrage se referme et que sa trace narrative s’estompe dans les brumes de l’oubli, il demeure en nous comme un bruissement de feuilles : trace d’une forêt enchantée qu’il a su éveiller en nous.
Les fieffés rêveurs que nous sommes savent que nos images oniriques dérivent parfois jusqu’aux rivages les plus secrets de Mnémosyne, mère des Muses. Peu savent, en revanche, que ces rivages, infrarouges et ultraviolets du monde suprasensible, sont aussi ceux où scintillent les récits de nos légendes. Car le monde légendaire prolonge la lumière naturelle : il fait rayonner, au-delà du visible, ces couleurs interdites au regard, mais familières à l’âme.

Laissant entrer ces fréquences suprasensibles, la prose dalgangienne évoque, par certains côtés, les vitraux d’église traversés par la clarté du sacré. J’ajouterais quelques rares estampes, celles d’Aude de Kerros, dont le magnétisme sourd des mêmes rêveries cheminantes : https://audedekerros.fr
Textes ajourés, estampes magnétiques ou vitraux d’église nous met en contact cette vie dans la vie qui nous attend avant la mort, celle qui pleut en rosée mystique sur les pétales de nos âmes — et non celle qui nous serait promise après la mort.
En contrepoint à l’approche héraldique de Luc-Olivier se tient l’approche étymologique de Philippe Barthelet. J’ai longtemps cherché à comprendre pourquoi deux factures aussi différentes semblaient participer d’une même tradition. Tout récemment, une réponse à cette question s’est imposée à moi: quand Luc-Olivier « remonte » la tradition vers les pistils, bourgeons et fleurs du langage — où butinent tant d’abeilles poétiques ! —, l’auteur du Voyage d’Allemagne descend, lui, vers le sol de cette langue où racines et bulbes des mots forment leurs rhizomes. D’où ces étymons qui émaillent presque chacune de ses phrases.
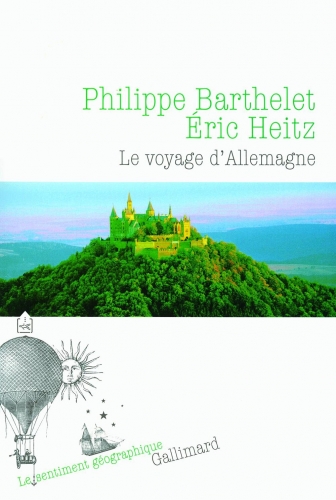
Ces deux explorations, aussi riches de découvertes soient-elles, ne sont pas sans risque : la première peut perdre le Petit Poucet lecteur non averti dans les Holzwege des brumes ésotériques ; la seconde risque de prendre les mots pour les choses. Cependant, mises bout à bout, ces deux œuvres forment un axe lumineux et vertical, absolument nécessaire en ces temps d’avachissement généralisé et de nivellement par le bas.
En elles-mêmes, les œuvres font et sont signes — car tout ce qui est n’est-il pas signe d’autre chose. Elles nous intiment dans l’idée que l’existence n’est que sous l’horizon de notre propre transfiguration, que du point de vue d’elle et d’elle seule. Au coeur de cette attente, les œuvres sont témoins, rappels, voire appels. À la fois balises et boussoles magnétiques, elles ont vocation à nous faire entendre - dans ce monde-ci - les échos de l’autre monde qui veille dans les marges du visible. On peut dire avec Ernst Jünger que l’art agit comme puissance d’orientation. Observons-le dans nos vies intimes : parfois, la montre de l’art se met à sonner quand nous sommes égarés dans les doublures factices de ce monde.Dans ces moments de tourmente, tout se passe comme si quelque chose de nous, en nous, mystérieux et nostalgique, se mettait soudain à résonner avec l’art. Cette résonance rend alors possible d’autres raisonnements plus affûtés que ceux issus de notre logique primaire. Plus encore, l’art nous intime dans l’idée que notre vie entière est, un jour ou l’autre, appelée à changer d’octave, à ôter ses vieux habits de l’âme. D’ailleurs, un des contes recueillis par les frères Grimm, Die Sterntaler, ne dit pas autre chose. Ôtant son unique chemise pour la donner à une enfant plus pauvre qu’elle, la jeune fille du conte voit tomber les étoiles du ciel qui se transforment en ducats d’or. Son vieil habit n’est autre ce qui nous voile la « légende éveillée », l’« imagination vraie » pourtant face à nos yeux de toute éternité. Non seulement l’or tombe dans la nouvelle robe miraculeuse de la jeune fille, mais encore les animaux de la forêt se mettent à lui parler, et elle à les comprendre ! Les fleurs deviennent des sceptres, les êtres apparaissent revêtus de leur manteau de sacre...

Cet écho « transfigurique » — dont le conte de fée conserve l’octave — est sans doute le plus haut et souverain qui dans une vie d’homme, il nous soit donné d’entendre. Mais il contient aussi sa part de risque : l’oubli de lui-même. Une fois sa conscience altérée, il est fatalement remplacé qui, par une théologie créationniste, puis un moralisme fossilisé et enfin une croyance athéiste. Autant de vérités chrétiennes dont Chesterton nous enseigne qu’elles seraient « devenues folles ». Bref, autant de château en ruine, de parodies du plan initial... On peut dire que lorsque le son initial disparaît, il est remplacé par un bruit, lui-même par un autre, et ainsi de suite, jusqu’au règne assourdissant du monde-machine.
« Le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées » écrit si justement Luc-Olivier. La catena aurea où scintillent tant d’oeuvres et de poèmes, agit alors comme un rappel du son primordial, un tocsin ; un antidote et un acte de résistance. S’il déplore, certes, ce paysage de chantier que devient notre monde, cet imaginaire en ruine que la technologie laisse derrière elle, Luc-Oliver d’Algange n’ignore pas non plus que la providence est inscrutable. C’est à travers les murs fissurés des ruines qu’il guette l’aurore. L’oeuvre de Luc-Olivier n’est ni progressiste, ni réactionnaire ; c’est à ce signe que l’on peut dire qu’elle est l’un des maillons de la catena aurea, chaîne d’or de la tradition.
« L’ennemi, c’est la planification du monde : l’homme-machine, le monde sans imprévu, sans feu », écrit Dominique de Roux dans Mémoires de l’inassouvissement. Disciple du faucon royal Dominique de Roux, Luc-Olivier n’ignore pas que des mains visqueuses, toujours à louvoyer et à comploter dans l’ombre, agissent aujourd’hui à ciel ouvert. Leur technologie noire, planificatrice et ensorcelante, brouille le message divin, le détourne de sa finalité libératrice. Ce dispositif vise un but : empêcher notre éveil individuel et collectif. Les grands planificateurs visent en effet moins notre mort physique que notre consentement au déclin et à la zombification. Pour ce faire, ils remplacent nos royaumes, nos récits fondateurs, nos arts et nos dieux par autant de doublures parodiques et subliminales. Leur stratégie a une force, mais aussi une faiblesse, elle est reconnaissable entre toutes. Celle-ci consiste toujours à présenter la copie à la place de l’original, avant de l’imposer comme la norme. Le règne contemporain de l’« art conceptuel » est emblématique de ce processus. Heureusement, Aude de Kerros s’est employée à démasquer le dispositif. Mais sans aller jusqu’à s’interroger sur l’essence de cet art. Pourtant, rien de nouveau sous le soleil. Ce dispositif, à l’œuvre dans la laideur contemporaine, n’est-il pas inscrit dans l’essence même de la technique ? Aussi bien actif dans l’asphalte qui recouvre la terre, l’écran de l’ordinateur qui s’érige en fenêtre, le dispositif ainsi à imposer le faux art pour le vrai.
L’art qui contient un secret, un magnétisme, une orientation, doit être remplacé par un autre, bidulaire, qui n’en contient pas. La finalité du dispositif est d’obombrer notre potentiel transfigurique, d’opacifier la conscience collective. Mais, aussi, à mesure que la vie se parodise en palais de miroir technique et administratif, augmente la nostalgie du fil d’Ariane. C’est donc en ces temps de règne sans partage des Titans et des Cyclopes, que poèmes, estampes et vitraux redeviennent autant d’aiguilles magnétiques de notre horloge intérieure.
Oui, Luc-Olivier d’Algange : la Tradition n’est pas derrière nous, mais devant nous.
Et les œuvres d’art en sont les balises secrètes.
Contacts :
dalgangelucolivier@gmail.com
audedekerros@yahoo.fr
phiiippe.barthelet@orange.fr (s’écrit avec trois « i »)
13:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Gracq, le goût, le jugement, la littérature
par Claude Bourrinet
J'ai tenu à reproduire le texte de Gracq qui suit, et qui appartient aux entretiens accordés à Jean Carrière. Il y est question de "goût", point d'ancrage, s'il en est, de la critique littéraire depuis Montesquieu, depuis le début du XVIIIe siècle. Ce critère de valeur appartient particulièrement au monde du classicisme, ou du néoclassicisme, qui s'inscrit dans la longue tradition romaine d'une culture livresque nécessaire à la sélection des oeuvres. Certaines demeurent "classiques", illustres, donc, et destinées à être étudiées en classe.
Gracq est plus ou moins embrigadé par une certaine droite, il est vrai de moins en moins substantielle, soit qu'elle tende à s'amenuiser avec le nombre de ceux qui lisent encore, ou qu'elle tende même à constituer une minorité parmi ceux qui se contentent d'une consommation d'ouvrages produits industriellement. Gracq a la réputation d'être provincial, terne, grisâtre, sans scandales, sans cette ostentation provocatrice que prisent volontiers les entrepreneurs d'idées de notre pays, de gauche, certes, mais pas toujours. Partant, on a cru l'incorporer dans la cohorte des réactionnaires. A vrai dire, si la droite s'en est réjouie, la gauche littéraire l'a dénoncé comme tel.
C'est évidemment mal le connaître. Les exemples sont extrêmement nombreux de sa dilection à privilégier, parmi les livres qu'il a croisés, ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont sécrété assez de poudre pour faire exploser une ville, comme certaines oeuvres de Stendhal, de Rimbaud, de Lautréamont, des surréalistes, de Claudel et d'autres, ou qui (et ce sont du reste les mêmes) ont ouvert grand les portes sur le vent du large.
Sa conception de la littérature, du moins du roman, appartient de plain pied à la modernité. Pour lui, un roman est tout fiction : le monde supposé "extérieur", les personnages, les indices de réalité, rien n'est lié au "réel". Même la mort, qui termine invariablement ses romans, n'a de valeur qu'imaginaire. C'est-à-dire que ce qui donne consistance à un récit, c'est le verbe, le mot, la phrase. En ce qui concerne son "style", il trace un sillon d'existence avec une entière liberté d'invention, tordant, ses longues phrases, les disloquant, les nouant et les dénouant dans un jeu qui, parfois, semble nous faire perdre la piste, mais nous y ramène par des chemins de traverse. Le "sens" qui se dégage de ses romans trahit aussi une position singulièrement "rebelle", puisque, dans un premier temps, après avoir braisé l'atmosphère où se noient ses personnages dans de noires lumières, il dérive vers les lisières de l'Histoire, entre rêverie et abandon à l'instant, pour finir par choisir, avec joie et gratitude, l'appel de la Terre, non celle des paysans, comme invitait à le faire un Barrès, mais à la façon du poète, qui unifie le monde sur le point concret où s'inscrivent les pas du promeneur.

Gracq n'est pas du tout "classique", ni passéiste, dans tous les domaines. Il se réclame ardemment du romantisme, surtout du romantisme allemand, Novalis, Hölderlin, Arnim, Kleist et d'autres, et surtout des poètes qui ont marqué les différentes ruptures de la poésie française, depuis Nerval et Baudelaire, jusqu'à Breton, en passant par Rimbaud, Lautréamont. Rappelons aussi qu'il était un fervent admirateur de Jünger. La littérature de fauteuil douillet, et la peur d'effaroucher le bourgeois (sans qu'il eût le désir de l'épater, ou de le déranger) n'étaient pas de son monde.
"L'idée de "goût" est difficilement dissociable de celle de « culture », et celle-ci de la digestion et de la longue rumination de la littérature passée. C'est avec le développement de cette culture que le goût est censé se former : plus ou moins conservateur par sa nature, il tient à une tradition, et cherche inconsciemment, peu ou prou, à la prolonger dans le tri qu'il opère de la littérature qui se fait. Pour cette raison, et pour d'autres, c'est une notion peu franche, qui ne s'avoue pas tout à fait pour ce qu'elle est, plutôt hostile à la nouveauté, et qu'il y a intérêt à utiliser le moins possible : l'idée de jugement, par exemple, paraît en matière de littérature, plus claire et plus saine que celle de goût. Le surréalisme, à mon avis, comme le romantisme autrefois, comme tous les mouvements révolutionnaires, a été parfaitement fondé à le suspecter (« Je me fais du goût l'idée d'une grande tache », a écrit à peu près Breton). C'est une idée qui tend à se rasseoir, comme s'est rassise déjà l'idée équivoque de « Beauté ».
13:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 488 du Bulletin célinien, consacré à Roger Nimier
Sommaire :
 Nimier, un an avant
Nimier, un an avant
Hussard un jour… hussard toujours
Prince de la chronique
Entretien avec Marc Dambre et Alain Cresciucci
Esthète et solitaire. Les thébaïdes de Monsieur Nimier
Le Saint-Brieuc de Roger Nimier.
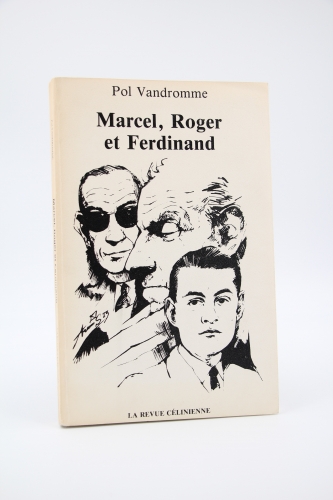
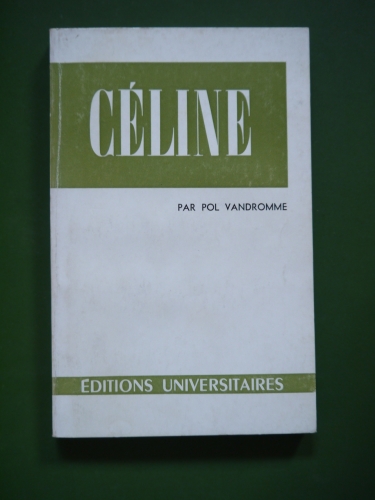
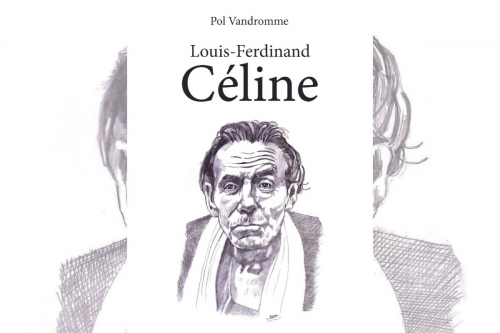
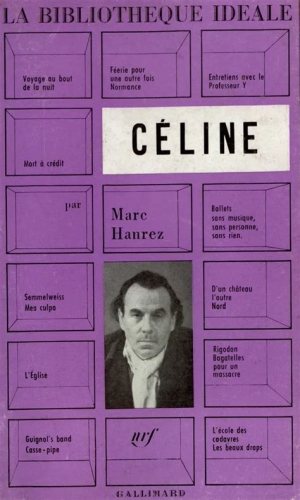
11:53 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, louis-ferdinand céline, littérature française, lettres françaises, revue, roger nimier |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
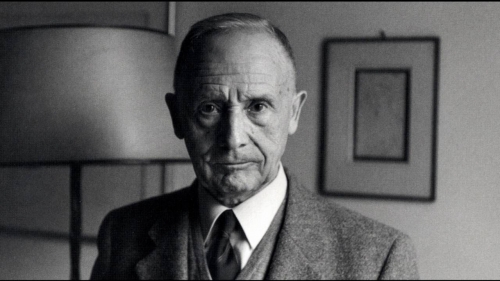
Gracq dans les marges de l'Histoire
Claude Bourrinet
Source: Page Facebook de Claude Bourrinet
L'idée (une des idées), ou plutôt l'image, la chiquenaude qui met en branle l'imagination, ou, si l'on veut, le cerf-volant que l'on envoie dans les airs pour capter la foudre, le déclencheur, donc, qui pré-valut à la rédaction du Rivage des Syrtes, fut la tentation forte de décrire une bataille navale. L'enfant Gracq suivait avec passion, sur les cartes reproduites par L'Illustration, les affrontements des flottes de guerre allemande et anglaise, notamment ce choc des Titans que fut la bataille du Jutland, le 1er juin 1916. Cependant, celle qui aurait dû avoir lieu, entre la flotte d'Orsenna et celle du Farghestan, non seulement ne fut pas écrite, mais elle n'eut pas lieu. « Les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent » envahirent le territoire d'Orsenna sur terre, par le Sud, par le désert.
D'aucuns pourraient s'avouer déçus: une sorte de bataille de Lépante aurait fait bel effet, dans un roman plus ou moins historique (entre l'Antiquité et la Renaissance, entre Mithridate et Venise, il est vrai) ; mais voilà, une sorte de logique romanesque a empêché Gracq de la peindre. Ses « marines », ce sont les vagues qui giflent les côtes bretonnes. Mais, plus que la dimension réaliste (ou romantique), plus que l'anecdote pittoresque, qui manqueraient à l’œuvre, c'est plutôt une certaine conception de la littérature qui est affirmée par l'ellipse. L'écriture romanesque ne vise pas à montrer les choses, mais à en saisir, par les sens et l'intuition, la logique de leur survenue. Ce qui compte, ce n'est pas l' « événement » (il n'y en a guère, chez Gracq), mais ce qui le rend possible, comme l'étreinte pesante et lourde du ciel orageux présage l'éclair et le tonnerre. Tout est dans l'attente intense de cela même qui doit donner sens. Tout le récit du Rivage des Syrtes est la narration d'un crescendo fatal d'une énergie tellurique (symbolisée par le volcan Tângri, qui se profile à l'horizon de la terre farghestane), à travers les expériences sensorielles et passionnelles du héros Aldo. L'orage, qui est le destin de l'Histoire, ne nous est pas donné. On sait seulement, au détour d'une phrase, qu'Orsenna a été détruite par les « barbares ».

Cette charge électrique saturant l'atmosphère prête à crever en cataractes de sang, nous l'avons connu avant les coups de feu du 28 juin 1914, à Sarajevo, où Nedeljko Čabrinović fut une sorte d'Aldo. Mais le héros de Gracq n'est pas nationaliste, et ne médiatise, dans son geste provocateur, aucune idéologie. Les trois coups de canon provenant des batteries côtières faghestanes, sonnent comme un lever de rideau théâtralisé. L'Histoire est une scène où les morts sont vraiment morts, certes, mais Gracq se présente comme le spectateur, et directeur de cet « opéra fabuleux » porté par une trajectoire imaginaire, qui peut, au demeurant, s'apparier à celle d'un individu.
Pourtant, beaucoup de commentateurs n'ont pas manqué d'établir un parallèle entre le désastre annoncé, et la montée du nazisme, vecteur de guerre et de destructions massives. A ce compte, Aldo fut un « collabo », puisqu'il fut appelé à désirer l'offensive désastreuse de l'ennemi, poussé par le désir ardent de transgresser la loi, de franchir la ligne maritime interdite depuis des siècles, déclenchant ainsi sciemment l'apocalypse. Il semble évident que le roman recèle une portion non négligeable de nietzschéisme. En outre, Gracq était alors un grand lecteur d'Oswald Spengler et de Ferdinand Lot. Mais il a pris des distances par rapport aux thèses « dangereuses » de l'auteur du Déclin de l'Occident, ainsi que de Toynbee, qui expliquait, comme Ibn Khaldoun avant lui, l'effondrement des Empires par la conjonction entre les invasion barbares, et la défection insurrectionnelle du « prolétariat » intérieur (ou, dans le roman, par la rébellion d'une famille de rebelles, les Aldobandi, à laquelle Vanessa, qui tient un rôle capital, appartient).

Il considérait surtout ces deux historiens (ou philosophes de l'Histoire) comme des « poètes de l'Histoire », des pourvoyeurs d'archétypes. Les légendes, les mythes, sont des générateurs de motifs imaginaires. L'épopée des Nibelungen (étymologiquement « Ceux du brouillard), par exemple, si chère au wagnérien Gracq, pourrait entretenir maints liens avec Le Rivage des Syrtes ; Aldo, alors, ne serait pas Siegfried, mais le « traître » Hagen, celui qui déclenche tout. A moins, plus justement, qu'il ne soit Kriemhild, qui épouse le roi des Huns, pour se venger, et provoquer le massacre du roi Gunther, et de ses frères. Mais il n'est pas mu par le ressentiment, bien que le résultat soit de même portée. Toutefois, la "liberté" provocatrice, quoique pourvoyeuse de jouissance et d'ivresse, s'avère être une illusion. Une fois le branle donné, le dynamiteur n'aura été qu'un rouage d'une machine qui le dépasse infiniment, et qui poursuit une marche froide et inexorable.
C'est en poète, en visionnaire, que Gracq s'enquiert de la décadence. Qu'importe du reste si elle est occidentale ou non. Il acquiesce au concept d'entropie. Ses images sont, comme chez Spengler, ou Michelet, biologiques. « Tout ce qui existe mérite de périr ». Et il ajoute volontiers, à cette assertion de Hegel, « surtout si le corps est usé, miné par l'âge et la sclérose, vermoulu, et qu'un coup de botte suffit à ébranler jusqu'au fracas de la chute ». Orsenna est bâtie sur des couches superposées d'ossements, de cadavres. Elle est une ancienne puissance qui se survit, juchée sur une mémoire sénile de ressassement d'une gloire évanouie. Sa pulvérisation est donc logique. Le fonctionnaire Marino, fidèle capitaine et gardien de la forteresse maritime des terres du Sud, incarne l'enracinement dans le culte de la Terre et des Morts, et son barrésisme est condamné par le narrateur, lorsqu'il se noie dans la vase puant le cadavre et le bois pourri qui clapote au pied du quai de l'arsenal.

Gracq a rarement évoqué les événements historiques, ni ne s'est engagé après 1938, date à laquelle il a rompu avec le Parti communiste, dix ans après avoir perdu l'habitude de se rendre à la messe. Son sens de l'Histoire doit beaucoup à Chateaubriand, non par une posture « réactionnaire », voire royaliste, qu'il n'eut jamais (bien que né à Saint-Florent-le-Vieil, haut lien des exploits de l'armée de Vendée, et tombeau de Bonchamps), et, si l'on excepte quelques références historiques parsemées, à titre d'exempla, dans ses fragments critiques, il n'évoqua la guerre qu'à travers ses souvenirs de la bataille de Dunkerque – au sens large -, à laquelle il participa en tant que lieutenant. Jamais il ne s'engagea pour un parti ou un autre, quoiqu'il partageât un certain conservatisme « provincial » avec une certaine droite. Il accepta plusieurs invitations de Pompidou, mais uniquement parce que ce dernier avait été l'un de ses condisciples à l’École Normale supérieure. Son refus de dédicacer Les eaux étroites, dans une édition d'art offerte par l'illustrateur à Mitterrand, tenait probablement à la répugnance que lui inspirait le personnage. Sa «ligne», pour autant qu'on le sache par son silence massif à ce sujet, tient en un apolitisme inflexible. Cela ne l'empêchait pas, néanmoins, de jeter des lueurs de compréhension avertie sur des tendances majeurs de l'actualité mondiale (par exemple, son refus de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne). Il ne rejetait pas non plus toute nouveauté. L'abattage des haies du bocage vendéen et breton le réjouit, car il lui permettait de jouir de larges échancrures par lesquelles s'offraient des perspectives et des panoramas que l'amateur de paysages – comme « presbyte » - recherchait.
La question de la rédemption historique est loin d'être résolue dans l’œuvre gracquienne, qui baigne cependant en partie, du moins dans sa composante romanesque, dans l'Histoire (Le Rivage des Syrtes, Un balcon en forêt), tandis que sa seule pièce de théâtre, Le Roi pêcheur, évoque la possibilité du salut, d'un salut qui n'est pas chrétien (Gracq a rejeté toute interprétation chrétienne du mythe du Graal). Le Roi pêcheur finit dans l'incertitude, et l'attente a tout lieu de persister. Le personnage féminin de Kundry est, selon l'auteur, son « porte-parole » : elle est déchirée, comme Baudelaire, entre deux postulations, entre la caducité de la nature humaine, qu'on peut appeler le « péché », et l'espoir, la quête de la grâce. Mais ce n'est pas de ce côté-là que Gracq trouve une issue à l'enfermement, au nihilisme contemporain.
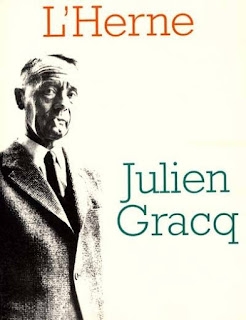 Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).
Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).
Gracq passe, en littérature, pour un « passéiste », voire un réactionnaire. Il a déclaré, avec son ironie mordante que, par moment, il déployait (songeons à son pamphlet, « La Littérature à l'estomac », où il pourfend les « Aristarque » de la critique littéraire), qu'en France, la littérature, du moins la production de grands écrivains, avaient cessé après le XIXe siècle. Son style, très maîtrisé, aristocratique quelque peu, hautain disait certains, et exigeant un lecteur lent et scrupuleux, désignait en lui un adversaire du laisser-aller, de la « libération » de la libido créatrice (ce qui était un contresens : rien de plus érotique, sensuelle, que la prose poétique de Gracq, qui, paradoxalement, est bien plus proche d'une hypothétique « avant-garde » - bien qu'il réprouvât et le terme, et l'idée – pour peu qu'on fasse l'effort de reconnaître en lui la « liberté grande » sans cesse en exercice, qui préside à son travail d'écriture, bien éloignée du conformisme salonnard et universitaire des Écoles littéraires en -isme de l'après-guerre).
Gracq était attaché à une certaine authenticité de vie, et de relation avec le monde. Il la trouvait dans ses liens avec la nature. Ce n'est pas un hasard s'il prisait par-dessus tout la rudesse dépouillée et franche des reliefs hercyniens, de la Bretagne, des Ardennes, des plateaux de l'Aubrac et du Cézallier. Il était l'homme des marges, de l'entre-deux, des zones insolites, à la manière dont les surréalistes désignaient les hasards objectifs pourvoyeurs de « merveilles », qui, parfois, lui octroyaient des « extases » ressemblant étrangement à des expériences mystiques orientales, ou à ce que recherchait Heidegger, quand il parlait des « Clairières de l'être ». Mais s'il s'inspire beaucoup du romantisme allemand, il n'en demeure pas moins un géographe. Comme Jünger, il observe la nature, les paysages, au moyen d'un double regard, de la conjugaison « kaléidoscopique », dit Jünger dans Le Cœur aventureux, d'une interprétation analytique claire et distincte, et d'une plongée « magique » dans le flux de sensations que le monde offre. Un œil scrutateur au cœur du maelström, en quelque sorte. A cette connaissance de lieux remarquables se mêlent également intimement des fragments vivants de souvenirs mythiques, culturels, historique, etc., aboutissant parfois à un état proche du rêve. Mais un rêve conscient.
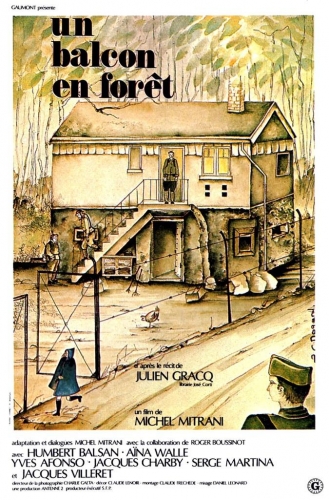
Gracq écrit à un moment où l'Occident est en crise, et le sait. Toute la production littéraire, philosophique, artistique du XXe siècle tente de répondre à ce malaise (et Freud, dans son Malaise dans la civilisation (1929), a réagi peu de temps après Spengler (1918 et 1922)). Gracq refuse de jouer. Il ne « s'engage » pas, il est, non « antipolitique », comme Baudelaire, qui s'essouffle à vilipender la démocratie, les bourgeois, l'égalitarisme, le progrès etc., mais apolitique. Non qu'il n'aille voter, mais il ne se laisse pas ferrer. Son royaume n'est pas de ce monde-là. Son « utopie », son locus amoenus, est de celui qui existe vraiment, qui est tel ou tel lieu, bien concret, bien sentant, bien jouissant, aussi prenant que des élans du cœur et de la chair, et qui ouvre sur le cosmos, dont l'ouverture délimite un périmètre aussi signifiant qu'une fenêtre découpant un paysage éblouissant de beauté convulsive ou gorgée de paix. Avec Gracq, comme avec d'autres (et comment ne pas penser à Kenneth White?), des contrées inconnues s'ouvrent à notre curiosité et à notre sensibilité : ce sont celles qui échappent aux labours de l'Histoire, et qui sont là, devant nos yeux, pourvu qu'on les ait « bien ouverts ».
18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : julien gracq, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Anatole France: Populaire des deux côtés des barricades
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/anatole-france-popul...
Croyez-le ou non, il y a eu des moments où l’extrême gauche et l’extrême droite se sont exprimées d’une seule voix, et un tel exemple concerne l’attaque dirigée contre Anatole France (1844–1924) par le mouvement surréaliste nouvellement formé. France, considéré par ses concitoyens comme le plus grand homme de lettres de l’histoire du pays et lauréat du prix Nobel de littérature en 1921, gisait impuissant sur son lit de mort tandis qu’un groupe de conspirateurs s’employait à rédiger une diatribe virulente dans laquelle leur cible déclinante serait décriée comme un conformiste complaisant, impardonnablement encensé par les deux camps politiques.
Imaginé par André Robert Breton (1896–1966), Paul Éluard (1895–1952) et Louis Aragon (1897–1982), l’article incriminé était un pamphlet de quatre pages intitulé Un Cadavre et visait à noircir le nom du poète, romancier et dramaturge socialiste en réaction au fait que ses œuvres littéraires étaient dévorées en si grand nombre. Bien que France ait été universellement vénéré, Breton expliqua que lui et ses compagnons conspirateurs
« considéraient son attitude comme la plus équivoque et la plus méprisable de toutes : il avait tout fait pour s’attirer l’approbation de la droite comme de la gauche. Il était gonflé d’honneurs et d’autosatisfaction. »
Des phrases acerbes telles que « c’est un vieil homme comme les autres », « un peu de servilité humaine quitte le monde » et « l’homme n’a plus besoin de soulever de poussière » paraissaient bien anodines à côté de la contribution d’Aragon. Intitulé « Avez-vous déjà giflé un mort ? », le poète et romancier décrivait sa cible mourante comme un homme « acclamé simultanément par l’imbécile [Charles] Maurras et le Moscou chancelant » tout en apparaissant comme « l’incarnation de l’ignominie française ».
Alors que la presse parisienne regorgeait de détails croustillants sur l’état de santé déclinant d’Anatole France, les surréalistes étaient désireux de provoquer une réaction et d’attirer l’attention sur eux-mêmes. Le pamphlet devait être distribué le jour même de la mort de France, mais les préoccupations juridiques et morales de leur imprimeur sur la nature du document furent telles qu’il ne fut publié qu’une semaine après son décès.

Comme il fallait s'y attendre, Un Cadavre déclencha un énorme scandale et le journaliste de droite Camille Mauclair (1872–1945) — qui deviendra plus tard collaborateur du régime de Vichy et travaillera pour Revivre : Grand Magazine illustré de la Race — décrivit Aragon et ses acolytes comme des « fous furieux » qui avaient les manières non seulement de « voyous mais de chacals ». Le journal pro-communiste Clarté accusa les surréalistes d’« irréflexion » pour leur attaque contre l’épicentre mondial du marxisme-léninisme, et Breton répondit en qualifiant la Révolution russe de « vague crise ministérielle » pleine « d’une misérable activité révolutionnaire » qui, ironiquement, ne méritait même pas ce nom.
Même France lui-même avait salué la fondation du Parti communiste français (PCF) et fut défendu plus tard par l’écrivain anglais George Orwell (1903–1950) en raison des déclarations humanitaires que l’on trouve dans ses romans. À une occasion, France avait parlé de la folie de vivre dans un pays qui « interdit aussi bien aux riches qu’aux pauvres de dormir sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. » Compte tenu de sa dénonciation de la démocratie libérale, il est donc facile de comprendre pourquoi il pouvait être défendu à la fois par des communistes et des proto-fascistes.
18:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anatole france, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, surréalistes, surréalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Orages d'acier, une expérience littéraire
Claude Bourrinet
 A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »
A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »
Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année. Dans les années soixante, il avait répliqué à Moravia, reprenant un mot de Marx : « Une Iliade serait-elle possible avec de la poudre et du plomb ? »
C’est pourquoi il est nécessaire d’interpréter Orages d’acier non comme un document, mais comme un monument. Comme « document », nous avons ses carnets de guerre, bruts, elliptiques, dont la rédaction est chaotique, parfois allusive, tant la situation était dépendante de l’urgence du moment. Le « monument » fut la réfection qu’en fit Jünger, et qu’il publia sur le conseil de son père. L’écriture y est celle d’un écrivain talentueux, et la fascination qu’elle exerce tient à son intensité et à l’esthétisation d’une expérience qui transcende les mots. Jünger y a sacralisé la guerre, comme « expérience intérieure », en en rendant toute la puissance nihiliste. Mais la séduction qui nous captive provient surtout du regard impassible qu’il jette sur une apocalypse.

Or, il semble que le récit fictionnel, Lieutenant Sturm, publié dans le Hannoverscher Kurier. Zeitung für Norddeutschland, du 11 au 27 avril 1923, et redécouvert au début des années 60, sonne de manière plus authentique, du fait même de son caractère « inabouti », comme s’il s’agissait d’ébauches mêlant témoignage, bribes de romans, rêves… L’exaltation presque « mystique » qu’on trouve dans Orage d’acier peut bien s’y rencontrer, mais corrigé par des réflexions plus désabusées.
16:52 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, première guerre mondiale, livre, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
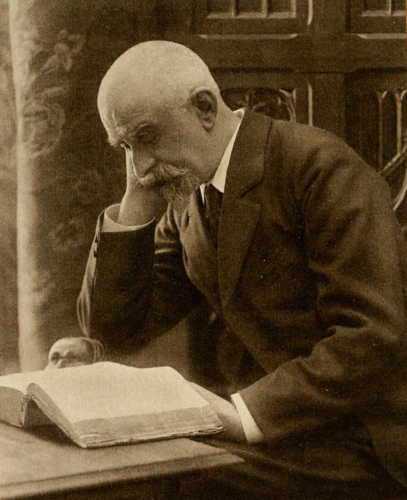
Les Foules de Lourdes, le testament antimoderne de Huysmans
Claude Bourrinet
Je veux qu’on y vienne en procession.
La Vierge
L’homme est un animal adorateur. Adorer, c’est se sacrifier et se prostituer.
Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.
De la vaporisation et de la centralisation du moi. Tout est là.
Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.
Une mystique naturaliste
Il restera toujours un fond naturaliste, chez Huysmans, qui, jusqu'à sa dernière heure où, vêtu de la robe noire et du capuchon des moines de Saint Benoît, il rendit l'âme, éprouvera, comme la présence lancinante d'une basse continue, le souci angoissé de trouver les signes tangible, matériels, du surnaturel, dans un monde livré à la banalité de la décadence, et encore davantage de sa propre existence d'homme souffrant en quête de salut (1).
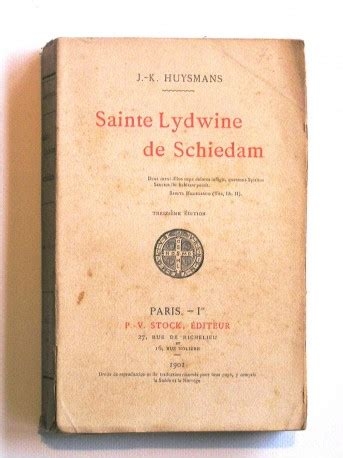 Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.
Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.
Une comparaison avec Les Confessions de Saint-Augustin suffit à mesurer l'écart qui sépare ces deux convertis sur le tard. Chez l'évêque d'Hippone, on se laisse emporter par des élans lyriques de mysticité, par des considérations théologiques et philosophiques de grande portée, qui irrigueront la pensée médiévale, et au-delà. En revanche, chez Huysmans, on suit pas à pas un itinéraire quasi clinique, déroulant les méandres, les avancées et les retours en arrière d'une âme qui est loin de déboucher rapidement sur la voie royale, si tant est qu'elle y soit un jour parvenue, la foi n'étant jamais vraiment acquise. Huysmans était trop écrivain pour s'abandonner, trop écrivain moderne, c'est-à-dire héritier de la littérature qui débuta avec le romantisme, et transféra le souci du monde, la sociabilité innée des écrivains dits « classiques », oublieux de soi et refoulant l' « amour-propre », dans l'univers narcissique et obscur du poète créant sa propre centralité de prophète et Prêtre du moi, sinon du monde, et toujours en quête de vérité.
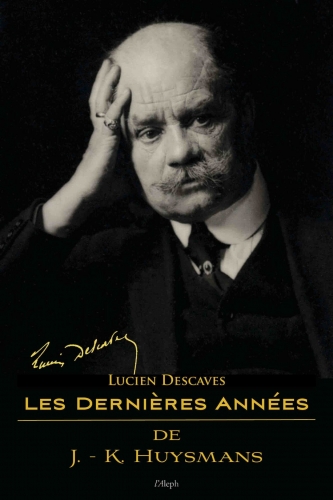 « Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »
« Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »
Il est vrai néanmoins que son écriture, sa création littéraire, passent nécessairement par la révolution existentielle, violente et profonde, qu'il a vécue. (3) Les deux dimensions sont liées, et, contrairement à beaucoup de symbolistes, qui contrecarrent le pessimisme et la décadence par le culte de l'esthétisme, de l'art, du rêve, il unit intimement la douleur angoissée de la recherche religieuse à sa traduction sur la page blanche. La lecture de ses œuvres, à partir de Là-bas, pour ne pas parler d'En Route, impose à n'importe quel lecteur le sentiment d'être confronté à une expérience vécue.
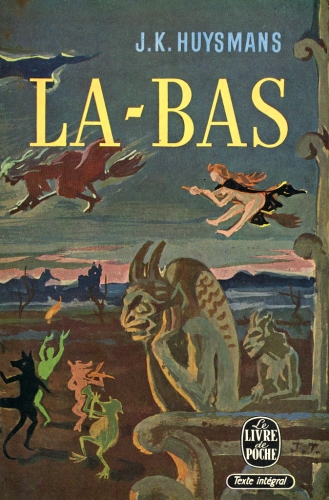
Les étapes douloureuses (doloristes?) de sa conversion, il les a annotées, comme un carnet de route, dans son œuvre: partant du satanisme dans son « Livre noir », Là-Bas (1891) (qui montre, somme toute, un monde surnaturel, un christianisme à rebours, opposé au naturalisme avec lequel il vient de rompre avec fracas avec A rebours (1884)), il saute le pas métaphysique, se convertit.
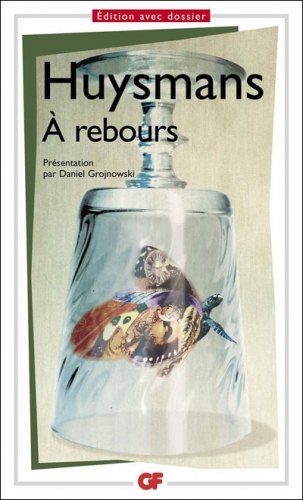
Barbey d'Aurevilly avait eu, dès la parution d'A rebours, la prémonition de ce plongeon religieux: il avait prédit, dans un article du Constitutionnel du 28 juillet 1884, que Huysmans aurait un jour à choisir entre « la bouche d’un pistolet ou les pieds de la croix ». Ce chemin de croix (le Cycle de Durtal) est jalonné d’œuvres comme En route (1895) – il mit quand même trois ans avant de traduire littérairement sa conversion de 1892, à la Trappe d’Igny, où il reçoit les sacrements -, La Cathédrale (1898), L'Oblat (1903).
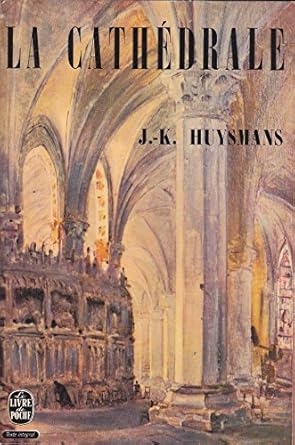

Le dernier livre est la relation de sa tentative de se lier, en 1901, à l'abbaye de Ligugé (photo), dans le Poitou, aventure spirituelle interrompue par l'expulsion de la communauté monastique de Saint Martin, à la suite des lois anti-religieuses de la République franc-maçonne du Petit Père Combe, déclinaison locale – avec le Portugal, en 1911, d'une persécution plus vaste (ou de tentatives, comme en Belgique et en Allemagne), dont font l'objet, sous les pontificats de Léon XIII (1878 – 1903), et Pie X (1903 – 1914), les catholiques européens, y compris en Italie ou en Espagne.
Paradoxalement, cette époque fut aussi, contre un nihilisme de plus en plus rongeur et dissolvant, celle du grand mouvement de conversions littéraires que vont connaître les Lettres françaises au début du XXe siècle avec des auteurs comme Paul Bourget, Péguy, Brunetière, Claudel, Maritain, Jacques Rivière, Psichari, Massignon, Massis, Léon Bloy – qui fut très proche de Huysmans, et se brouilla violemment avec lui -, et d'autres, notamment à la faveur de l'influence d'un abbé très intégré dans les cercles mondains et artistique, l'abbé Mugnier (protrait, ci-dessous), lequel apparaît dans En route, sous les traits de l'abbé Gévresin, mais surtout de celle de l’abbé Gabriel Ferret, mort en 1897, à quarante-cinq ans, à qui Huysmans dédia La Cathédrale (1898).

Le fil conducteur des livres de Huysmans, y compris les premiers, qui étaient naturalistes, sont marqués par une hostilité constante à la modernité, à l'américanisme, à la médiocrité contemporaine, à la bêtise triomphante et à la laideur qui l'accompagne, et fortement imprégnés de pessimisme schopenhauerien, considéré en cette fin de siècle décadente comme si « français » (« Nietzsche déclarait préférer lire Schopenhauer dans sa traduction française plutôt que dans sa version originale », rappelle Clément Rosset). Cette philosophie, à tonalité antimoderne, si tardivement connue, était assez répandue et partagée, explicitement ou implicitement, dans les milieux intellectuels d'alors, et le fut encore davantage au XXe siècle, par exemple par Proust, Céline, Beckett etc., pour n'évoquer que des écrivains français – ou de langue française. Tendance intellectuelle, voire existentielle, violemment contraire à la Weltanschauung chrétienne, mue par l'espérance. Encore faudrait-il tempérer cette opposition, si l'on prend en compte le dogme du péché originel, et un jansénisme qui a beaucoup imprégné la mentalité française, sans oublier un Baudelaire, l'un des maîtres à penser de Huysmans, qui se réclamait de Joseph de Maistre.
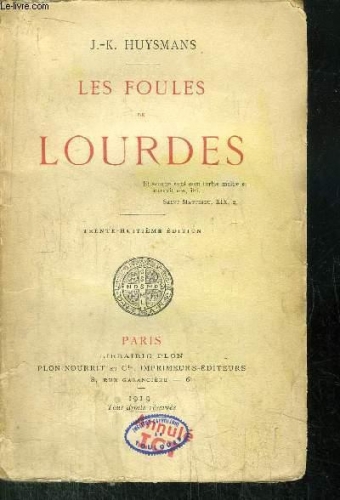
Les foules de Lourdes
Les Foules de Lourdes est le dernier ouvrage de Huysmans, une sorte d'enquête à portée autobiographique, parue un an avant sa mort, le 1er octobre 1906, et relatant un pèlerinage dans la cité mariale, qui dura cinq jours, durant l'été 1904, dont l'écriture est si dense qu'on a l'impression d'un mois de séjour. Il y fut hébergé à la Villa Saint-Antoine par un couple, les Leclaire, qu'il connaissait bien, puisqu'il avait fait construire avec eux une grande demeure, la villa Notre-dame, destinée à accueillir un cercle chrétien d'artistes, non loin de l'abbaye de Ligugé, avant qu'il ne fît profession d'oblat, et quittât les lieux, désertés à la suite de l'expulsion de France des ordres religieux.
Voilà comment Lucien Descaves présente la naissance du projet d'écrire cet opera ultimate: « Vers la fin du mois d’août [1900], il avait été voir passer, en gare de Poitiers, les trains remplis de malheureux qui allaient chercher à Lourdes une guérison miraculeuse. Songeait-il déjà, ayant terminé enfin Sainte-Lydwine, qu’il était en train de raboter, songeait-il à une vision plus directe des souffrances humaines? Je le crois; mais il était sans doute momentanément refroidi par la lecture du roman de Zola. Il revint allégé de cette appréhension. Certes, les descriptions de Zola étaient « justes et admirables »; mais cette revue affreuse des suppliciés conduits vers une guérison hasardeuse par des gens du monde en gants frais et culottes de cyclistes, cela laissait tout de même à l’observateur quelque chose à dire. »
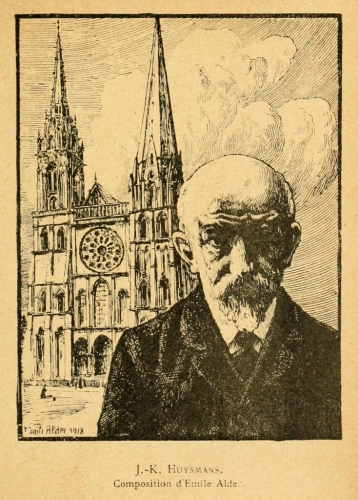
Ce fut du reste à Poitiers que le mal, qui devait l'emporter, commença à être virulent. Lors de son séjour à Lourdes, le cancer à la mâchoire était bien avancé, mais il n'en touche pas un mot. La fin de l’année 1903 et le début de 1904 n’apportèrent à ses maux aucun soulagement.
J'espère montrer que ce récit, qui pourrait tout aussi bien être un roman qu'un reportage, est, selon moi, le chef-d’œuvre de Huysmans. Il mêle en effet, à la manière du romancier, une « intrigue », qui n'est pas rectiligne, mais circulaire, puisqu'il déambule sinueusement entre des points « stratégiques », comme la grotte, le cabinet des médecins qui constatent les miracles, la basilique, oscille de manière itérative, entre la foule et des réduits plus ou moins protégés, entre des personnes bien caractérisées, et l'anonymat des fidèles...
Dans le même temps, il se livre, s'insérant entre des descriptions d'une intensité pathétique et parfois grotesque, à de profondes réflexions religieuses, théologiques, tout en ressassant des griefs (la laideur de l'architecture, la médiocrité des spécimens d'humanité qui arrivent par wagons, les comportements grégaires). Il confronte son écœurement à des justifications, des objections spirituels, toujours hanté par la crainte d'être enferré dans le rets perfides du Malin à l'affût, dont on sent la présence pérenne, même en ces lieux inspirés par la Vierge, et surtout en ces montagnes mélancoliques des Pyrénées, si chargées de mémoire païenne.

Nous verrons que ce que vit alors Huysmans ne concerne pas uniquement le chrétien, le catholique, mais aussi tout homme libre à l'ère des foules. De même, la filiation du monde lourdesque que Huysmans nous livre avec tout le talent de prosateur poétique qui est le sien n'est pas sans une parenté évidente avec l'univers dantesque. La filiation s'incarne par exemple au fil des cercles de souffrances, qui semblent s'aggraver à mesure que le regard aigu du narrateur inscrit dans notre imagination les symptômes monstrueux, à peine supportables, des maux qui tordent ou abattent, transforment en chair palpitante de douleur, en matière souffrante, des âmes qui ont parcouru des centaines de kilomètres dans des wagons cahotants.
Cette tératologie que Huysmans dévide comme une fresque infernale avec des mots puissants, des vocables parfois recherchés dont les sonorités et les couleurs nous font voir et sentir, au point que, tout en étant fascinés, nous sommes terrifiés, saisis de répugnance, sont, comme chez le poète florentin évoluant de bolgia en bolgia, évidemment des symboles: manifestation du péché, même parmi les innocents, les enfants – mais pour l'auteur de Là-bas, il n'y a pas d’innocence, nous sommes tous coupables, et la purulence de la chair est l'image, en vérité, d'une condition frappée par un mal profond, indéracinable. En même temps, comme dans la Divine comédie, nous sommes souvent émus, pris de compassion, d'une pitié irrépressible pour ces êtres touchés par la maladie, non seulement parce que ce sont des humains, comme nous, mais aussi, comme dit Homère, et toute l'Antiquité avec lui, parce que ce sont des mortels. Huysmans nous renvoie à ce que nous sommes, des créatures pathétiques, vaines, chétives, faites pour peiner, et c'est le sceau d'Adam et d'Eve.


Il ne se livre d'ailleurs pas à une taxinomie des pèlerins en fonction de leurs talents. Le savoir, le génie même, n'apparaissent pas dans les critères qui président à ses descriptions. Malgré tout, il établit une hiérarchie: plus on est riche, plus on se livre à la représentation, à la commedia, au théâtre narcissique, et plus on cache sa misère dans les plis compliqués de sa vêture sociale, qui doit se voir; en revanche, quelques êtres simples, naïfs, aussi primitifs que la peinture médiévale qu'il prise tant, qu'ils soient âgés ou enfants, accompagnateurs ou patients, nonnes ou prêtres, trouvent grâce à ses yeux. Mais ils sont peu nombreux. Ils se singularisent par une présence sans arrière-pensée d'amour-propre, comme la rose qui est parce qu'elle est, ou par un sens du devoir plein, total, par cette noblesse de l'action qui, lorsqu'elle est orientée vers le bien, l'amour du prochain, élève jusqu'à la sérénité, et parfois l'extase. Combien d'infirmières, de soignantes, de brancardiers admirables se donnent ainsi à corps perdu ? Ils sont la prémonition du Paradis, que l'on n'entrevoit guère, et auquel on n'a pas accès, hormis dans ces espèces de songes ritualisés et concentrés que sont les prières vécues (toutefois, la majeure partie des malades les débitent à la chaîne, comme des formules magiques).
Et il y a l'espoir. Il fait vivre, en tout cas survivre, et, du moins le croit-on, guérit. Peu. Car à Lourdes, on s'arrête surtout à l'Enfer. Le purgatoire, la santé, qui est le salut sécularisé, pour ainsi dire, ne touche qu'une minorité. Des élus, en somme. Et gratuitement. Pourquoi celle-ci, et pas celui-là, qui aurait mérité autant qu'elle d'être sauvé ?
Il est, dans cette immense circonférence où le centre est dans chaque souffrance incommensurable, un petit cercle avec lequel Huysmans sympathise, dont les membres sont tacitement des complices, ou des happy few maîtrisant les afflux brutaux de vagues sensorielles qui renverseraient celui qui n'a aucun intérêt vital à se retrouver en ces lieux. Le petit groupe avec lequel il lui est possible d'entretenir sereinement des propos abstraits, en tout cas d'ordre rationnel, ou anecdotique, qui comprend, comme on l'a vu, des âmes simples, d'élite, si l'on veut, authentiques, proches sans doute de l’Évangile de Jésus, est constitué de quelques personnages importants dont la tâche à Lourdes implique une mise à distance. Ce retrait se traduit par une capacité à examiner, à penser la situation. Il y a quelques prêtres cultivés, mais qui ont leurs limites (notamment dans leur rapport avec la beauté), et des scientifiques, des hommes de métier, des médecins, dont le réflexe premier, professionnel, est de se montrer sceptique face aux présupposés « miracles ».
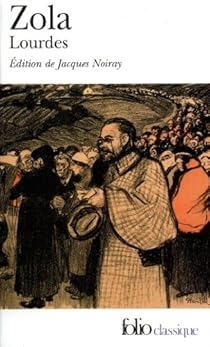 L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.
L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.
 Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.
Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.
Il n'est pas sûr non plus que de nombreux prêtres d'aujourd'hui ne partagent les analyses du neurologue. Nonobstant, l'impression que ce petit cercle échappe à la pression environnante demeure, et le cabinet où les « miraculés » viennent se faire estampiller, ressemble à une redoute au milieu d'un champ de bataille. Pour autant que Huysmans soit un homme sanguin, violent, emporté, submergé par la répulsion (souvent) ou soulevé par l'admiration (rarement), il demeure un être de raison. La meilleure des morales est de savoir penser, dit Pascal.
L'une des questions vitales pour lui, à tel point qu'on se demande si ce n'est pas là le cœur même de sa conversion, est celle de la beauté, de l'esthétique. Il constate amèrement le vandalisme auquel a été soumis la petite cité de Lourdes, la destruction de l'ancienne petite église romane, et l'incroyable vulgarité, grossièreté, des ouvrages édifiés, qu'ils fussent des bâtiments religieux, ou des statues. Huysmans s'attarde beaucoup à ce sujet, et a toujours à l'esprit le phénomène saint sulpicien et son esthétique pompière, inauthentique, plébéienne et démagogique, réplique fidèle, dans le contexte artistique du XIXe siècle, d'un siècle industriel de parvenus, siècle bourgeois, béotien, où les créateurs véritables, écrivains, peintres, sculpteurs, ont eu toutes les peines à se faire entendre, voire à survivre.
L'architecture fut sans doute l’un des point névralgiques de cette maladie de la laideur. Huysmans aurait pu utiliser le vocable kitsch, s'il n'était entré dans la langue française qu'en 1962. La basilique du sacré-cœur de Montmartre en est exemple parfait, un beau furoncle sur une colline, triomphant, qui se voit de loin, et qui domine de sa superbe un Paris livré au diable. Huysmans est sans doute l'écrivain de fin de siècle le plus baudelairien qui fût. Rimbaud le fut aussi à sa manière, mais contrairement à son idole, il aimait la nature, transfigurée, il est vrai. Baudelaire comme Huysmans la détestent. Ils s'y ennuient. En revanche, l'esprit, l'âme, se lisent fidèlement dans la création humaine, dans l'artifice, au sens littéral du terme, c'est-à-dire produit de l'artifex.

Pour Huysmans, une petite église romane, une statue gracile, gothique, par exemple (et non néogothique!) de la Vierge, sont des signes de la présence divine (il s'en est expliqué dans son beau livre, qui a achevé de le rendre célèbre, et lui a octroyé une coquette somme, La Cathédrale). Or, l’Église de son temps partage les goûts de la bourgeoisie décadente de l'époque. Elle s'est empressée de détruire, de vendre, ou d'achever de ruiner des héritages sublimes d'un moyen âge qui, malgré le romantisme, n'était pas encore reconnu comme l'un des sommets de la civilisation européenne (et ce déni durera).
Huysmans est stupéfait de s'apercevoir que le clergé, celui d'en bas comme celui d'en haut, est complètement indifférent à ces questions. L'essentiel, pour la hiérarchie sacerdotale, relève de la mission. Il s'agit de répandre la Bonne parole, d'amener à soi le troupeau, et de l'encadrer. En cela, il est fidèle à ce que l’Église a toujours fait depuis les temps premiers de sa naissance, et surtout de sa prise de pouvoir, au IVe siècle. Que ses œuvres matérielles aient été, de surcroît, souvent belles, appartient à un autre ordre que celui de la simple propagation de la foi.
Or, dès la Contre-Réforme, on entre dans l'ère de l'efficacité et des foules urbanisées. Il est nécessaire de promouvoir une esthétique qui relève du fonctionnement social, et qui touche affectivement. Les prêtres rétorquent à Huysmans qu'il s'agit de se mettre à portée du peuple. A cela, il répond que, de tout temps, les choix artistiques et esthétiques ont été imposés, et la foule des fidèles s'est pliée volontiers à ce geste impératif, d'assigner à des cerveaux souvent incultes l'éclat transcendant d'une beauté, qui est le signe du divin. C'est cela, cette ambition que l'on veut bien croire démesurée, qui est rompue, avec la modernité. En revanche, parallèlement au sentimentalisme de loge du concierge, on mise sur le gigantesque, l'Hénaurme, comme aurait écrit Flaubert. Ce qui est grand, gros, puissant et écrasant, impressionne immanquablement le béotien, avec, il est vrai, un autre patron: il faut que ce soit comme dans la réalité.

Tout est cyclopéen, éléphantesque, à Lourdes, et on peut y voir une prémonition de l'esthétique totalitaire, communiste, mussolinienne, nazie, américaine, sous sa forme new-yorkaise, ou disneyienne. Lourdes, c'est le prototype, dans le style néogothique ou néobyzantin, de Disneyland, et les mêmes questions d'encadrement du « tourisme » se pose.
La procession, allégorie de la modernité en marche
On peut s'interroger sur les raisons véritables de la « conversion » de Huysmans. Il ne s'est rendu à Lourdes qu'en traînant avec réticence son carnet de notes dans ses bagages. Du reste, il nous prévient : « […] je n’aime pas les foules qui processionnent, en bramant des cantiques. »
Pourtant, le récit qu'il fait de son pèlerinage, même si le champ dans lequel il évolue paraît clos, et sent l'enfermé, suit tout de même une ligne, du moins jusqu'à l'approche de la fin, la queue s'éteignant peu à peu, comme un cierge mélancolique et fatigué à bout de flamme. Se dessine en effet, au fil de la narration, un crescendo, dont l'achèvement paroxystique est une « formidable procession » composée de « tout un corps d’armée, trente mille hommes », « un cierge à la main, de la grotte au Rosaire, en passant par les lacets en forme d’M couché qui grimpent sur la colline, derrière la basilique, et, après avoir descendu et remonté les rampes, […] sur l’esplanade pour finalement se fondre, en un seul groupe, dans le cirque immense du Rosaire».

Pour jouir de ce spectacle exceptionnel, Huysmans s'assied « auprès de quelques prêtres, sur les marches de la chapelle. De là, [il] domine, au-dessus du Gave, la basilique, la rampe, l’esplanade, le Rosaire, vus de profil; c’est l’endroit le mieux situé pour assister au gala de la féerie du feu».
Cette procession est en effet placé sous le signe de la lumière. Or, la lumière est le symbole du Divin, son éclat, le signe de sa présence, et c'est pourquoi les églises dites « gothiques », avec leurs vitraux, ont, à partir de l’Évêque de Saint-Denis Suger, pris le pas sur les sombres églises dites « romanes ». Mais la lumière est aussi très présente, en enfer, par la vertu des flammes.
Le choix de l'incendie comme métaphore filée s'est imposé pour décrire cette coulée humaine où tout semble se fondre. « Dans la nuit, la grotte, creusée sous la basilique, flamboie comme une fournaise; c’est de là que part l’incendie propagé par les cierges des pèlerins que l’on ne voit pas ; il semble que des étincelles sautées du fond d’un four ouvert et portées par le vent voltigent dans les lacets de la colline, qui, lentement, s’embrasent ; et les bluettes gagnent du terrain, pétillent déjà dans les arbres derrière l’abside de la basilique et atteignent, peu à peu, en tournant, le parvis, avant de descendre sur la rampe de droite, dans une indescriptible cacophonie de Laudate Mariam, de «Au ciel, au ciel! », mêlés à des cantiques de langues étrangères, tous écrasés, pourtant, par la masse pesante des Ave.
Et voici la basilique qui s’illumine du haut en bas, qui se découpe en des lignes tricolores dans l’ombre et elle paraît plus étriquée, plus chétive encore, sur le fond de ces montagnes que les ténèbres, déchirées par les coups de lumière, agrandissent. La chaufferette ronde, à couvercle, le gueux posé sous ses pieds, le toit du Rosaire, brasille avec la ferblanterie de son dôme et ses oculi rouges. Maintenant, les deux rampes sont en pleine combustion; l’on monte sur l’une et l’on descend sur l’autre; l’on dirait d’une roue de feu, couchée sur le flanc, à demi soulevée du sol, qui tourne, en crépitant, lançant, dans son mouvement giratoire, des gerbes d’étincelles. Les cierges qui grimpent se hâtent, semblent marcher, en poussant des cris de victoire, à l’assaut de la basilique ; et subitement, dans le sillage scintillant, de grands trous se font; le vent a éteint des cierges et des mouches de feu volent pour les rallumer et les trous noirs disparaissent, bouchés par des paquets de flammes !
Et cela tourne, tourne, sans arrêt, dans un vacarme d’Ave soutenu par les cuivres de la fanfare ; au loin, l’esplanade qui déborde, fait songer à une plaine dont la récolte se carbonise, à des champs d’épis en ignition; et les tiges de cette moisson qui brûle projettent un éclairage de théâtre sur les arbres des alentours dont le vert s’albumine et se décolore. »

La description se poursuit, magnifiquement, superbement, et le lecteur est aussi fasciné que le spectateur.
Le XXe siècle en a vu, des processions aux flambeaux ! Ce n'est pas ce qui a manqué dans cet âge de fer et de feu !
Au demeurant, les manifestations collectives de foi ardente, où l'individu se perd et communie avec ses proches par la famille, la résidence, ou la religion, sont très communes dans l'Histoire humaine. C'était, et c'est encore le cas dans les rites chamaniques, ou chez les aborigènes. Jünger, dans un récit de voyage au Japon dédié à Julien Gracq, a décrit ce qu'il a vu à Kiyo-Také, une ville de province, dans les environs de Nikko : « Cette danse, à laquelle n'importe qui pouvait prendre part, se mouvait dans un vaste rond-point, autour d'une chapelle en forme de tour, haute et étroite. Les musiciens qui y jouaient répétaient, des heures et des heures durant, sur des tambours voilés et un instrument au son clair, une cloche, je suppose, un simple motif de quatre notes:
ti-tin...ta-tàm.
Les danseurs et danseuses portaient des kimonos d'été à dessins en damiers et tenaient dans la main de larges chapeaux de paille tressés. Ils tournaient lentement, en mesure, chacun pour soi, brandissant parfois leur chapeau, l'ouverture tournée vers le ciel. Il pleuvait: nous nous trouvions parmi les rangs serrés des spectateurs, sous des parapluies plats de papier.
Ici, les visages, et surtout ceux des jeunes filles, se simplifiaient encore, à mesure qu'ils se rapprochaient de l'extase... »


Songeons aussi au Tatbir (photo), rituel chiite, où, dans une procession fiévreuse, à grands geste, certains exaltés se font saigner le crâne en commémoration de la mort du jeune petit-fils de Mahomet, l'imam Hussein ibn Ali, qui a été tué à la bataille de Kerbala. Les exemples sont légions. Mais ces cas supposent une divinité, ou plusieurs, des croyances, la certitude qu'un monde supra-humain existe vraiment.
Or, la fin du XIXe siècle est cette époque où Nietzsche a annoncé la mort de Dieu. C'est l'âge du nihilisme.
On peut aborder le phénomène de transe collective d'usage à Lourdes, lors des pèlerinage, de deux façons: ou l'on survalorise l'état de fusion «mystique» qui absorbe les fidèles, parfois pour leur bien (Huysmans note que certains paraissent transfigurés, et portent à leur prochain une considération qu'ils ne manifestaient sans doute pas avant de venir en ces lieux saints, et qu'ils abandonneront peut-être, sans doute, en s'en éloignant); ou l'on se concentre sur les réactions individuelles d'un personnage tel que J-K. Huysmans, d'un caractère de chien, jaloux de sa liberté comme un ermite, soucieux jusqu'à la folie de l'authenticité de l'existence, et des relations avec le monde et la vérité.
Huysmans n'a pas reçu la grâce, comme un Pascal. Il n'y a pas vraiment eu, chez lui, de nuit mystique, de Mémorial. Sa « conversion » est un long cheminement, ouvrage de sa volonté. Je ne prétends pas qu'il n'était pas «croyant»: il pensait, manifestement, que Jésus existait vraiment, comme la sainte Vierge, et que les saints, comme Sainte Lydwine de Schiedam, étaient des créatures élues de Dieu, dotées de vertus charismatiques. Mais il n'est pas un mystique, comme Saint Jean de la Croix.
Il semble plutôt avoir réagi comme un être sur la défensive, qui entend préserver une intégrité toujours mise en péril par l'action ubiquiste et dissolvante d'une modernité agressive, stupide, et obscène. De là son retranchement dans l'art (il est poète, c'est-à-dire, au sens où l'entend Roman Jakobson, soucieux au plus au point de la chair et de la peau des mots, de la phrase, du rythme, de la préciosité de la langue), dans la hantise de la beauté, dans les souvenirs éblouis du moyen-âge, de siècles où il était naturel d'être chrétien, de porter en soi un sens, qui est aussi celui, partagé, par la société, par les pouvoirs religieux et politiques. Ce sens, au moment où science et républicanisme communient dans le même culte de l'homme vernaculaire, commun, dans le dernier homme nietzschéen, il faut se le donner, le conquérir, l'arracher à un grand corps, celui de l’Église, qui vit encore quelque peu, mais dont l'on sent bien qu'il est près de l'agonie. Seule l'écriture permet de garder la tête hors de l'eau, et de pouvoir respirer. Tant bien que mal, et souvent mal.
L'un des contemporains de Huysmans, Gustave Le Bon, a écrit, en 1895, un ouvrage célèbre, La psychologie des foules, où il revient, au détour de la description du phénomène holiste de la communauté soudée en acte, sur le sujet de la préservation de l'être singulier dans un milieu oppressant où le collectif l'emporte. Il serait trop long de suivre toutes les étapes de son argumentation. Mais on peut retenir cette phrase, qui s'applique bien à Huysmans : « Les individualités qui, dans la foule, posséderaient une personnalité assez forte pour résister à la suggestion, sont en nombre trop faible pour lutter contre le courant. » Cette vérité s'applique autant à celui qui se fond dans une collectivité fusionnelle ayant pour centre une croyance forte, et comme manifestation des gestes et des sons ritualisés, que pour ce que Jünger nomme Le Rebelle, tentant d'échapper à l'effacement de son existence par l'empire du vide.
Notes:
(1) « Il faudrait, se disait-il [Durtal], garder la véracité du document, la précision du détail, la langue étoffée et nerveuse du réalisme, mais il faudrait se faire aussi puisatier d’âme et ne pas vouloir expliquer le mystère par les maladies des sens ; le roman, si cela se pouvait, devrait se diviser de lui-même en deux parts, néanmoins soudées ou plutôt confondues, comme elles le sont dans la vie, celle de l’âme, celle du corps, et s’occuper de leurs réactifs, de leurs conflits, de leur entente. Il faudrait, en un mot, suivre la grande voie si profondément creusée par Zola, mais il serait nécessaire aussi de tracer en l’air un chemin parallèle, une autre route, d’atteindre les en deçà et les après, de faire en un mot, un naturalisme spiritualiste : ce serait autrement fier, autrement complet, autrement fort ! » (ex: Là-bas. Gallimard. Folio classique, p. 30-81).

(2) « Bienheureuse Lydwine, elle obtient du Ciel la permission de souffrir pour les autres, d’alléger les malades en prenant leurs maux. »
(3) « Que de pressentiments et de signes envoyés déjà par Dieu, qu’il est grandement temps d’agir, de considérer la minute présente comme la plus importante des minutes, et de faire ma perpétuelle volupté de mon tourment ordinaire, c’est-à-dire du Travail ! » Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.
16:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, joris-karl huysmans, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, catholicisme, lourdes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 487 du Bulletin célinien
Sommaire :

Entretien avec Jean-Charles Huchet
Deux façons de citer Céline
Le Pont de Londres vu par Jules Van Erck (1964)
Roland Barthes et Céline
Dans la bibliothèque de Céline (Fables de La Fontaine René Fauchois)
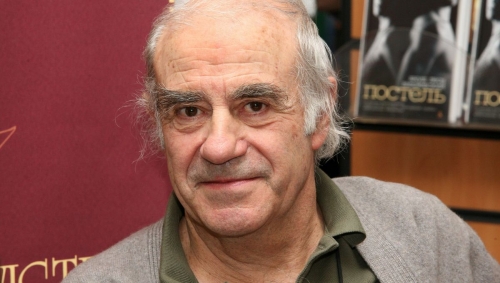
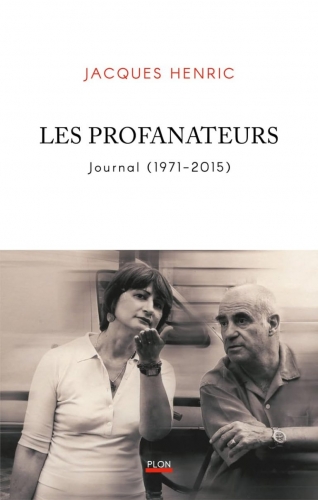
• Jacques HENRIC, Les Profanateurs. Journal (1971-2015), Plon, 2025 (30 €)
19:43 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, revue, lettres, lettres françaises, littérature française, louis-ferdinand céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook