lundi, 18 juin 2007
Spengler's cultural pessimism today

History And Decadence: Spengler's Cultural Pessimism Today
Tomislav Sunic
http://home.alphalink.com.au/~radnat/tomsunic/sunic4.html...
06:15 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 juin 2007
Intervista con Marc. Eemans

Intervista con Marc Eemans, l’ultimo surrealista della scuola di André Breton
Argomentazioni raccolte da K.Logghe e R.Steuckers
All’età di 83 anni, Marc Eemans afferma oggi di essere l’ultimo dei surrealisti. Dopo di lui, si volterà pagina. Il surrealismo sarà definitivamente entrato nella storia. Chi è quest’ultimo dei surrealisti, questo pittore della generazione dei Magritte, Delvaux e Dali, oggi ostracizzato? Qual è stato il suo impatto letterario? Quale influenza Julius Evola ha esercitato su di lui? Questo "brutto anatroccolo" del movimento surrealista getta uno sguardo molto critico sui suoi compari morti. Costoro gliel’avevano fatta pagare per il suo passato "collaborazionista". Recentemente, Ivan Heylen, del giornale Panorama (22/28.8.1989), lo ha intervistato a lungo, abbellendo il suo articolo con un superbo luogo comune che metteva l’accento sulla tumultuosa eterosessualità di Marc Eemans e dei suoi emuli surrealisti. Noi prendiamo il testimone, ma senza dimenticare di interrogarlo sugli artisti che ha conosciuto, sulle grandi correnti artistiche a cui egli è stato a fianco, sui retroscena della sua « collaborazione »...
Il periodo che va dalla sua nascita alla comparsa della sua prima tela, è stato molto importante. Come lo descriverebbe?
Sono nato nel 1907 a Termonde (Dendermonde). Mio padre amava le arti e parecchi suoi amici erano pittori. All’età di otto anni, ho imparato a conoscere un lontano parente, scultore e attivista (1): Emiel De Bisschop. Quest’uomo non riuscì mai a niente nella sua vita, ma ciononostante ha rivestito per me un grande significato. È grazie ad Emiel De Bisschop che entrai per la prima volta in contatto con scrittori ed artisti.
Da dove le è venuta la spinta per disegnare e dipingere?
Ho sempre seguito da molto vicino l’attività di artisti. Subito dopo la prima guerra mondiale, conobbi il pittore e barone Frans Courtens. Poi mi recai un giorno in visita dal pittore Eugène Laermans. E poi ancora da molti altri, tra cui un vero amico di mio padre, un illustre sconosciuto, Eugène van Mierloo. Alla sua morte, venni a sapere che egli aveva preso parte alla prima spedizione al Polo Sud, in qualità di reporter-disegnatore. Durante la prima guerra mondiale, visitai una mostra di pittori che godono oggi di una certa notorietà: Felix Deboeck, Victor Servranckx, Jozef Peeters. Alcuni tra di loro non erano a quel tempo astrattisti. Solo qualche anno dopo si ebbe nell’arte moderna il grande boom della pittura astratta. Quando Servranckx organizzò una personale, entrai in contatto con lui e, da allora, egli mi considerò come il suo primo discepolo. Avevo circa quindici anni quando mi misi a dipingere tele astratte. A sedici anni, collaboravo con un foglio d’avanguardia intitolato Sept Arts. Tra gli altri collaboratori, c’era il poeta Pierre Bourgeois, il poeta, pittore e disegnatore Pierre-Louis Flouquet, l'architetto Victor Bourgeois e il mio futuro cognato Paul Werrie (2). Ma l’astratto non mi attirò a lungo. Per me, era troppo facile. Come ho detto un giorno, è un’aberrazione materialista di un mondo in piena decadenza... E’ allora che entra nella mia vita un vecchio attore: Geert van Bruaene.
Lo avevo già incontrato prima ed egli aveva lasciato tracce profonde nella mia immaginazione: egli vi teneva il posto dello zwansbaron, del "Barone Vagabondo". Ma quando lo rividi all’età di quindici anni, egli era diventato il direttore di una piccola galleria d’arte, il "Cabinet Maldoror", dove tutti gli artisti d’avanguardia si riunivano e dove furono esposti i primi espressionisti tedeschi. È con l’intermediazione di van Bruaene che conobbi Paul van Ostaijen (3). Geert van Bruaene meditava i Canti di Maldoror del sedicente Conte di Lautréamont, uno dei principali precursori del surrealismo. È così che divenni surrealista senza saperlo. Grazie, infatti, a van Bruaene. Io passai dall’arte astratta al Surrealismo quando le mie immagini astratte finirono per amalgamarsi a degli oggetti figurativi. A quell’epoca, ero ancora comunista....
Non sembra che al tempo, effettivamente, l'intelligentsia e gli artisti appartenessero alla sinistra? Lei, d’altronde, dipinse una tela superba, rappresentante Lenin e la intitolò "Omaggio al Padre della Rivoluzione"...
Vede, è un fenomeno che si era già prodotto all’epoca della Rivoluzione Francese. I giovani intellettuali, sia in Francia che in Germania, erano tutti sostenitori della Rivoluzione Francese. Ma via via che quella si evolveva o si involveva, quando il terrore prese il sopravvento, etc., essi si tirarono indietro. E poi arrivò Napoleone. Allora svanì tutto l’entusiasmo. Questo fu il caso di Goethe, Schelling, Hegel, Hölderlin... E non dimentichiamo del resto il Beethoven della Sinfonia Eroica, ispirata dalla Rivoluzione francese e inizialmente dedicata a Napoleone, prima che questi divenisse imperatore. Lo stesso fenomeno si è potuto osservare con la rivoluzione russa. Si credeva che stessero per prodursi dei miracoli. Ma non ve ne furono per nulla. In seguito si ebbe l’opposizione di Trotski il quale credeva che la rivoluzione non fosse che agli inizi. Per lui, bisognava dunque andare oltre!
Non è qui la natura rivoluzionaria o non conformista che alberga nel fondo di ogni artista?
Io sono sempre stato un non conformista. Anche sotto il nazismo. Ben prima dell’ultima guerra, ho ammirato il "Fronte Nero" di Otto Strasser. Quest’ultimo era anti-hitleriano perché pensava che Hitler avesse tradito la rivoluzione. Sono sempre stato all’opposizione. Sono sicuro che se i Tedeschi avessero vinto la partita, io me ne sarei andato ad ammuffire in un campo di concentramento. In fondo, come diceva il mio amico Mesens, noi surrealisti non siamo che degli anarchici sentimentali.
Oltre che per la sua pittura, lei è un uomo notevole anche per la grande diversità delle sue letture. Basta nominare gli autori che hanno influenzato la sua opera...
Mi sono sempre interessato di letteratura. All’Athenée (4) a Bruxelles, avevo un curioso professore, un certo Maurits Brants (5), autore, in particolare, di un’antologia per le scuole, intitolata Dicht en Proza. Nella sua aula, egli aveva appeso alla parete delle illustrazioni raffiguranti gli eroi della Canzone dei Nibelunghi. Inoltre, il mio fratello maggiore era wagneriano. È sotto questo doppio influsso che scoprii i miti germanici. Quelle immagini dell’antica Germania sono rimaste incise nella mia memoria e sono esse che in seguito mi distinsero dagli altri surrealisti. Essi non conoscevano niente di tutto questo. André Breton era surrealista da dieci anni quando sentì parlare per la prima volta dei romantici tedeschi, grazie ad una giovane amica alsaziana. Quella pretendeva che ci fossero già stati dei « surrealisti » all’inizio del XIX secolo. Novalis, in particolare. Io avevo scoperto Novalis tramite una traduzione di Maeterlinck che mi aveva passato un amico quando avevo diciassette anni. Quest’amico era il caro René Baert, un ammirevole poeta che fu assassinato dalla « Resistenza » in Germania, poco prima della capitolazione di questa, nel 1945. Feci la sua conoscenza in un piccolo cabaret artistico di Bruxelles chiamato Le Diable au corps. Dopodiché, divenimmo inseparabili in poesia come in politica, diciamo piuttosto in “metapolitica”, perché la Realpolitik non fece mai per noi. La nostra evoluzione dal comunismo al nazional-socialismo derivò in effetti da un certo romanticismo, nel quale l’esaltazione dei miti eterni e della tradizione primordiale, quella di René Guénon e di Julius Evola, svolse un ruolo primario. Diciamo che questa va dal Georges Sorel del Mythe de la Révolution e delle Réflexions sur la violence all'Alfred Rosenberg del Mythe du XXième siècle, passando per Rivolta contro il Mondo moderno di Julius Evola. Il solo libro di René Baert che potrei definire metapolitico s’intitola L'épreuve du feu (Ed. de la Roue Solaire, Bruxelles, 1944) (6). Per il resto, egli è autore di raccolte di poesie e di saggi sulla poesia e sulla pittura. Un pensatore e un poeta da riscoprire. E poi, per ritornare alla mie letture iniziali, quelle della mia gioventù, non posso dimenticare il grande Louis Couperus (7), il simbolista a cui dobbiamo le meravigliose Psyche, Fidessa ed Extase.
Couperus ha esercitato una forte influenza su di lei?
Soprattutto per quel che concerne la lingua. La mia lingua è d’altronde sempre segnata da Couperus. In quanto di Bruxelles, l’olandese ufficiale mi è sempre sembrato un po’ artificiale. Ma questa lingua è quella a cui va tutto il mio amore... Un altro autore di cui divenni amico fu il poeta espressionista fiammingo Paul van Ostaijen. Feci la sua conoscenza tramite Geert van Bruaene. Allora dovevo avere diciotto anni. Durante una conferenza che van Ostaijen tenne in francese a Bruxelles, l'oratore, da poco mio amico che doveva morire alcuni anni dopo a soli trentadue anni, fissò definitivamente la mia attenzione sul rapporto che poteva esserci tra la poesia e la mistica, come egualmente mi parlò di un misticismo senza Dio, tesi o piuttosto tema con il quale egli ritrovava e Nietzsche e André Breton, il "papa del Surrealismo" che allora aveva appena pubblicato il suo Manifesto del Surrealismo.
Nella sua opera non si possono separare, mistica, miti e surrealismo?
No, io sono in qualche modo un surrealista mitico e, in questo, sono forse il surrealista più prossimo ad André Breton. Sono sempre stato all’opposto del surrealismo piccolo-borghese di un Magritte, quel tranquillo signore che, con la bombetta in testa, portava a spasso il suo cagnolino...
Però all’inizio eravate amici. Com’è sopravvenuta la rottura?
Nel 1930. Uno dei nostri amici surrealisti, Camille Goemans, figlio del Segretario permanente della Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde ( = Accademia Reale fiamminga di lingua e di Letteratura), possedeva una galleria d’arte a Parigi. Fece fallimento. Ma in quel momento, aveva un contratto con Magritte, Dali e me. Dopo questo fiasco, Dalì trovò la sua strada grazie a Gala, che, detto tra noi, doveva essere un’autentica megera. Magritte, ritornò a Bruxelles e cadde in miseria. Tutti dicevano: "Quel porco di Goemans! È a causa sua che Magritte è in miseria". È un giudizio che non ho mai accettato. È il lato “sordido” del surrealismo belga. Goemans, divenuto povero come Giobbe per il suo fallimento, fu escluso dai suoi amici surrealisti, ma ritornerà in auge presso di loro dopo essere diventato ricco circa dieci anni più tardi grazie a sua moglie, un’ebrea russa, che fece del “mercato nero” con l’occupante durante gli anni 1940-44. Dopo il fallimento parigino, Goemans ed io avevamo fatto squadra. Fu allora che comparve il secondo manifesto surrealista, in cui Breton scriveva, tra l’altro, che il Surrealismo doveva essere occultato, cioè astenersi da ogni compromesso e da ogni particolarismo intellettuale. Noi prendemmo questa direttiva alla lettera. Aveva già ricevuto entrambe l’influenza dei miti e della mistica germanica. Avevamo fondato, con l’amico Baert, una rivista, Hermès, dedicata allo studio comparativo del misticismo, della poesia e della filosofia. Fu soprattutto un grande successo morale. Ad un certo momento, avemmo tra la nostra redazione, l’autore del libro Rimbaud il veggente, André Rolland de Renéville. Vi era anche un filosofo tedesco anti-nazista, che era emigrato a Parigi ed era divenuto lettore di letteratura tedesca presso Gallimard: Bernard Groethuysen. Per suo tramite, ci assicurammo la collaborazione di altri autori. Egli ci inviava anche dei testi di grandi filosofi all’epoca ancora poco conosciuti: Heidegger, Jaspers e qualche altro. Fummo dunque i primi a pubblicare testi di Heidegger in lingua francese, compresi dei frammenti di Essere e Tempo.
Tra i nostri collaboratori, avevamo uno dei primi traduttori di Heidegger: Henry Corbin (1903-1978) che divenne in seguito uno dei più brillanti iranologhi d'Europa. Quanto al nostro segretario di redazione, egli era il futuro celebre poeta e pittore Henri Michaux. La sua presenza tra di noi fu dovuta al caso. Goemans era uno dei suoi vecchi amici: era stato suo condiscepolo al Collège St. Jan Berchmans. Egli si trovava in una situazione di bisogno. La protettrice di Groethuysen, vedova di uno dei maggiori proprietari dell'Arbed, il consorzio dell’acciaio, ci fece una proposta: se avessimo ingaggiato Michaux come segretario di redazione, ella avrebbe pagato il suo salario mensile più le fatture della rivista. Era una soluzione ideale. È così che oggi posso dire che il celeberrimo Henri Michaux è stato un mio dipendente...
Dunque, grazie a Groethuysen, lei prese conoscenza dell’opera di Heidegger...
Eh sì. A quell’epoca egli iniziava a diventare celebre. In francese, fu Gallimard che pubblicò per primo qualche frammento di Essere e Tempo. Personalmente, non ebbi mai contatti con lui. Dopo la guerra, gli scrissi per chiedergli alcune piccolezze. Avevo letto una sua intervista dove egli diceva che Sartre non era un filosofo, ma che Georges Bataille, lui sì, lo era. Gli chiesi qualche spiegazione su questo argomento e gli ricordai che ero stato uno dei primi editori in lingua francese delle sue opere. Per tutta risposta, egli mi inviò un biglietto con il suo ritratto e queste due parole: "Herzlichen Dank!" (Cordiali ringraziamenti!). Fu la sola risposta di Heidegger...
Lei avrebbe lavorato per l'Ahnenerbe. Come arrivò lì?
Prima della guerra, avevo stretto amicizia con Juliaan Bernaerts, meglio conosciuto nel mondo letterario sotto il nome di Henri Fagne. Egli aveva sposato una tedesca e possedeva una libreria internazionale in Rue Royale a Bruxelles. Io suppongo che questa attività fosse una libreria di propaganda coperta per i servizi di Goebbels o di Rosenberg. Un giorno, Bernaerts mi propose di collaborare ad una nuova casa editrice. Essendo senza lavoro, accettai. Erano le edizioni fiamminghe dell’Ahnenerbe. Noi pubblicammo così una ventina di libri e avevamo piani grandiosi. Pubblicavamo anche un mensile, Hamer, il quale concepiva i Paesi Bassi e la Fiandra come un’unità.
E lei scrisse su questa pubblicazione?
Sì. Sono sempre stato innamorato dell’Olanda e, in quell’epoca, c’era come un muro della vergogna tra la Fiandra e l’Olanda. D’altronde per un Thiois come me, esistono sempre due muri secolari della vergogna: a Nord con i Paesi Bassi; a Sud con la Francia, perché la frontiera naturale delle 17 province storiche si estendeva nel XVI secolo fino alla Somme. La prima capitale della Fiandra fu la città di Arras (Atrecht). Grazie ad Hamer, ho potuto superare questo muro. Divenni l’emissario che si recava regolarmente ad Amsterdam con gli articoli che dovevano comparire su Hamer. Il redattore capo di Hamer-Paesi Bassi coltivava anch’egli delle idee grand’olandesi. Queste trasparivano chiaramente in un’altra rivista, Groot-Nederland, anche della quale egli era direttore. Finché essa continuò ad uscire durante la guerra, vi scrissi degli articoli. Fu così che Urbain van de Voorde (8) partecipò alla costruzione della Grande-Olanda. Egli è d’altronde, autore di un saggio di storia dell’arte olandese, che considera l’arte fiamminga e olandese come un tutt’uno. Io possiedo sempre in manoscritto una traduzione di questo libro, comparso nel 1944 in lingua olandese.
Ma, in fin dei conti, io ero un dissidente in seno al nazional-socialismo! Lei conosce la tesi per cui si voleva costituire un Grande Reich tedesco nel quale la Fiandra non sarebbe stata che una provincia tra le altre. Io mi dissi: "Va bene, ma bisogna lavorare secondo dei principi organici. Prima bisogna che Fiandra ed i Paesi Bassi si fondano e, solo in questo modo noi potremo partecipare al Reich, in quanto indivisibile entità grand’olandese". E per noi, la Grande-Olanda si estende fino alla Somme! Bisogna che io qui ricordi l’esistenza durante l’Occupazione, di una “resistenza thioise" non riconosciuta come tale alla Liberazione". Io ne feci parte con un numero di amici fiamminghi e olandesi, di cui il poeta fiammingo Wies Moens poteva essere considerato come il capofila. Tutti divennero alla fine vittime della "Repressione".
Era qui l’influenza di Joris van Severen?
Non, Van Severen era in realtà un francofono, uno spirito totalmente segnato dalle mode di Parigi. Egli aveva ricevuto un’educazione in francese e, al fronte, durante la prima guerra mondiale, era divenuto “frontista”(9). Quando creò il Verdinaso, egli gettò uno sguardo al di là delle frontiere del piccolo Belgio, in direzione della francia. Egli rivendicava l’annessione della Fiandra francese. Ma da un momento all’altro, doveva essere votata una legge che avrebbe per lui significato delle persecuzioni. È allora che egli diffuse l’idea di una nuova direzione del suo movimento (la famosa "nieuwe marsrichting"). Egli ridivento “piccolo-belga”. E perdette il sostegno del poeta Wies Moens (10), che creò allora un movimento dissidente che si cristallizzò attorno alla sua rivista Dietbrand della quale divenni un fedele collaboratore.
Lei ha collaborato ad una quantità di pubblicazioni, anche durante la seconda guerra mondiale. Lei non ha rievocato che felicitazioni. In quale misura la repressione l’ha segnata?
Per quel che mi riguarda, la repressione non è ancora finita! Io “collaboravo” per guadagnare la mia pagnotta. Bisognava pure che vivessi della mia penna. Io non mi sono mai occupato di politica. Mi interessava solo la cultura, una cultura fondata sulle tradizioni indo-europee. In più, come idealista grand’olandese, io mi trovavo ai margini degli ideali di grande Germania del nazional-socialismo. In quanto artista surrealista, la mia arte era considerata come “degenerata” dalle istituzioni ufficiali del III Reich. Grazie a qualche critico d’arte, noi potemmo tuttavia far credere ai Tedeschi che non c’era « arte degenerata » in Belgio. La nostra arte doveva essere analizzata come un prolungamento del romanticismo tedesco (Hölderlin, Novalis,...), del movimento simbolista (Böcklin, Moreau, Khnopff,...) e dei Pre-raffaelliti inglesi. Per le istituzioni tedesche, gli espressionisti fiamminghi erano dei Heimatkünstler (dei pittori regionali). Del resto, tutti, compreso James Ensor, ma escluso Fritz Van der Berghe, considerato troppo « surrealista » nel suo ultimo periodo, parteciparono a mostre nella Germania nazional-socialista.
Ma dopo la guerra, fui lo stesso epurato con circa quattro anni di carcere. Nell’ottobre del 1944, fui arrestato e, dopo sei o sette mesi, rimesso in libertà provvisoria, con la promessa che la cosa non avrebbe avuto un “seguito”. Nel frattempo, un uditore militare (11) cercava come un avvoltoio di avere il suo processo-spettacolo. I grandi processi dei giornalisti avevano già avuto luogo: quelli del Soir, del Nouveau Journal, di Het Laatste Nieuws,... A qualsiasi costo il nostro uditore voleva il suo processo. E scoprì che non c’era ancora stato il processo del Pays réel (il giornale di Degrelle). I grandi capi del Pays réel erano già stati condannati, cioè fucilati (come Victor Matthijs, capo ad interim del Rex e redattore capo del giornale). L’uditore ebbe dunque il suo processo, ma con delle seconde linee, dei subalterni al banco degli accusati. Io ero il primo delle terze linee, dei sub-subalterni. Fui arrestato una seconda volta, poi condannato. Restai ancora più o meno tre anni in prigione. Non c’era modo di uscirne! Malgrado l’intervento in mio favore di personaggi di grande calibro, tra cui il mio amico francese Jean Paulhan, ex membro della resistenza e il premio Nobel inglese T.S. Eliot, che scrisse nero su bianco nel 1948, che il mio caso non avrebbe dovuto esigere alcun perseguimento. Tutto ciò non servì a nulla. La lettera di Eliot, che deve trovarsi negli archivi della Procura militare, meriterebbe di essere pubblicata, perché condanna in blocco la repressione selvaggia degli intellettuali che non avevano « spezzato la loro penna », cosa che non vuol dire avere commesso “crimini di alto tradimento”. Eliot fu del resto uno dei grandi difensori del suo amico, il poeta Ezra Pound, vittima della giustizia repressiva americana.
Quando espongo, a volte mi si attacca ancora in modo del tutto ingiusto. Così, di recente, ho partecipato ad una mostra a Losanna sulla donna nel Surrealismo. Il giorno dell’apertura, dei surrealisti di sinistra distribuivano volantini che spiegavano al buon popolo che io ero un sinistro compagno di Eichmann e di Barbie! Non ho mai visto una simile abiezione...
Dopo la guerra, lei ha partecipato ai lavori di un gruppo che portava lo strano nome di "Fantasmagie"? Vi si incontravano figure come Aubin Pasque, Pol Le Roy e Serge Hutin...
Sì. Le Roy e Van Wassenhove era stati tutti e due condannati a morte. (12). Dopo la guerra, ad di fuori dell’astratto, non vi era salvezza. Ad Anversa regnava la Hessenhuis: negli anni 50, era il luogo più all’avanguardia d'Europa. Pasque ed io, avevamo dunque deciso di associarci e di ricreare qualche cosa di « anti ». Abbiamo lanciato "Fantasmagie". In origine, non avevamo chiamato il nostro gruppo in questo modo. Non so più per chi esso era il centro. Ma era l’epoca in cui Paul de Vree possedeva una rivista, Tafelronde. Egli non era ancora ultra-modernista e non apprese che più tardi dell’esistenza del faro Paul van Ostaijen. Fino a quel momento, egli era rimasto un piccolo bravo poeta. Naturalmente, egli aveva un po’ collaborato... Credo che egli avesse lavorato per De Vlag (13). Per promuovere il nostro gruppo, egli promise di dedicarci un numero speciale di Tafelronde. Un giorno, mi scrisse una lettera in cui c’era questa domanda: "Che ne è della vostra "Fantasmagie"?". Egli aveva appena trovano il termine. Noi l'abbiamo conservato.
Qual era l’obiettivo di "Fantasmagie"?
Volevamo istituire un’arte pittorica fantastica e magica. Più tardi, abbiamo attratto scrittori e poeti, tra cui Michel de Ghelderode, Jean Ray, Thomas Owen, etc. Ma cosa più importante per me è la creazione nel 1982, in occasione dei miei 75 anni, da parte di un piccolo gruppo di amici, di una Fondazione Marc Eemans il cui obiettivo è lo studio dell’arte e della letteratura idealiste e simboliste. Di un’attività più discreta, ma infinitamente più seria e scientifica rispetto alla "Fantasmagie", questa Fondazione ha creato degli archivi riguardanti l’arte e la letteratura (in via accessoria anche la musica) quando esse toccano il simbolo e il mito, non solo in Belgio ma in Europa e altrove nel mondo, tutto ciò nel senso della Tradizione primordiale.
Lei ha anche fondato il Centrum Studi Evoliani, di cui è il Presidente...
Sì. Per quanto riguarda la filosofia, sono stato influenzato soprattutto da Nietzsche, Heidegger e Julius Evola. Soprattutto dagli ultimi due. Una persona di Gand, Jef Vercauteren, era entrato in contatto con Renato Del Ponte, un amico di Julius Evola. Vercauteren cercava delle persone che s’interessassero alle idee di Julius Evola e fossero disposte a formare un circolo. Egli si rivolse al Professeur Piet Tommissen, che gli comunicò il mio indirizzo. Io ho letto tutte le opere di Evola. Volevo conoscere tutto sul suo conto. Quando mi sono recato a Roma, ho visitato il suo appartamento. Ho discusso con i suoi discepoli. Essi avevano dei contrasti con le persone del gruppo di Del Ponte. Questi sosteneva che essi fossero stati vili e meschini nelle circostanze della morte di Evola. Egli, Del Ponte, aveva avuto il coraggio di trasportare l’urna contenente le ceneri funerarie di Evola in cima al Monte Rosa a 4.000 m. e di seppellirla nelle nevi eterne. Il mio circolo, ahimè, al momento non è più attivo e manca di persone realmente interessate.
In effetti, bisogna ammettere che il pensiero e le teorie di Julius Evola non sono alla portata di qualsiasi militante di destra o di estrema destra. Per accedervi, si deve avere una base filosofica seria. Certo, ci sono stati degli strambi appassionati di occultismo che hanno creduto che Evola parlasse di scienze occulte, perché egli è considerato come un filosofo tradizionalista di destra. Basta leggere il suo libro Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo per rendersi conto fino a che punto Evola è ostile, come il suo maestro René Guénon, a tutto ciò che può essere considerato come teosofia, antroposofia, spiritismo e chi più ne ha più ne metta.
L'opera di base è il suo libro intitolato Rivolta contro il mondo moderno che denuncia tutte le tare della società materialista che è la nostra e della quale il culto della democrazia (di sinistra, beninteso) è l’espressione più caratteristica. Non sto qui a riassumervi la materia di questo libro densa di 500 pagine circa nella sua traduzione francese. E un’autentica filosofia della storia, dal punto di vista della Tradizione, cioè secondo la dottrina delle quattro età e sotto l’angolazione delle teorie indoeuropee. In quanto “ghibellino”, Evola predicava il ritorno al mito dell’Impero, di cui il III Reich di Hitler non era tutto sommato che una caricatura plebea, così fu particolarmente severo nel suo giudizio tanto sul fascismo italiano che sul nazional-socialismo tedesco, perché essi erano, per lui, delle emanazioni tipiche della « quarta età » o Kali-Yuga, l'età oscura, l’età del Lupo, allo stesso titolo del cristianesimo o del comunismo. Evola sognava la restaurazione di un mondo « eroico-uranico occidentale », di un mondo elitario anti-democratico in cui il « regno delle masse », della « società dei consumi » sarebbe stato eliminato. In breve, tutta una grandiosa storia filosofica del mondo il cui grande eroe fu l’Imperatore Federico II di Hohenstaufen (1194-1250), un autentico eroe mitico...
Lei ha incominciato la sua carriera nella stessa epoca di Magritte. Agli inizi, le sue opere erano anche più quotate delle sue....
Sì e nonostante io fossi ancora un giovane galoppino. Magritte si convertì al surrealismo dopo aver dipinto per qualche tempo in stile futurista, poi cubista, etc. A quell’epoca, aveva ventisette anni. Io non ne avevo che diciotto. Questo significa nove anni di differenza. Io avevo più mano. Fu la ragione che lo spinse a mettermi fuori dal gruppo. A volte, quando eravamo ancora amici, egli mi domandava: "Dimmi, come potrei fare questo...?". Ed io rispondevo: "Magritte, vecchio mio, fai così o così...". In seguito, ho potuto scherzosamente dire che ero stato il maestro di Magritte! Durante l’occupazione, potei farlo esonerare dal Servizio Obbligatorio, ma non mi è stato riconoscente. Al contrario!
Com’è che attualmente lei non beneficia della stessa reputazione internazionale di Magritte?
Vede, lui ed io siamo diventati surrealisti nello stesso periodo. Io sono stato celebre quando avevo vent’anni. Lei constaterà la veridicità delle mie affermazioni consultando la rivista Variétés, rivista para-surrealista degli anni 1927-28, dove troverà delle pubblicità per la galleria d’arte L'Epoque, della quale Mesens era il direttore. Lei potrà leggervi: abbiamo sempre pronte opere di ... Segue una lista di tutti i grandi nomi dell’epoca, tra cui il mio. E poi vi fu il formidabile crack di Wall Street nel 1929: l'arte moderna non ebbe più valore dall’oggi al domani. Io caddi nell’oblio. Oggi, la mia arte è apprezzata dagli uni, rifiutata da altri. È una questione di gusto personale. Non dimentichi inoltre che io sono un « epurato », un « incivile », un « cattivo Belga », anche se sono stato in seguito « riabilitato »... Sono stato anche decorato, alcuni anni fa, con l’ « Ordine della Corona » … e della Svastika, aggiungono i miei nemici! In breve, non c’è posto per un “surrealista che non è come gli altri”. Certi pretendono che « si abbia paura di me », mentre io credo piuttosto di avere tutto da temere da quelli che vogliono ridurmi al ruolo poco invidiabile di « artista maledetto ». Ma dal momento che non si può ignorarmi, certi speculano già sulla mia morte!
Note
(1) L'attivismo è il movimento collaboratore in Fiandra durante la I guerra mondiale. Leggere, su questo argomento, Maurits Van Haegendoren, Het aktivisme op de kentering der tijden, Uitgeve-rij De Nederlanden, Antwerpen, 1984.
(2) Paul Werrie era collaboratore del Nouveau Journal, fondato prima della guerra dal critico d’arte Paul Colin. Paul Werrie vi teneva la rubrica "théâtre". Alla radio, egli animava alcuni trasmissioni sportive. Queste attività non politiche gli valsero tuttavia una condanna a morte in contumacia, tanto serena era la giustizia militare... Egli visse per diciott’anni in esilio in Spagna. Egli si stabilì in seguito a Marly-le-Roi, vicino a Parigi, ove risiedeva il suo compagno di sventure e vecchio amico, Robert Poulet. Tutti e due parteciparono attivamente alla redazione di Rivarol e degli Ecrits de Paris.
(3) Paul André van Ostaijen (1896-1928), giovane poeta e saggista fiammingo, nato ad Anversa, legato all’avventura attivista, emigrato politico a Berlino tra il 1918-1920. Fonda la rivista Avontuur, apre una galleria a Bruxelles ma, minato dalla tubercolosi, abbandona e si dedica a scrivere, in un sanatorio. Ispirato da Hugo von Hoffmannsthal e dagli inizi dell’espressionismo tedesco, egli sviluppa un nazionalismo fiammingo di dimensioni universali, che contava sulle grandi idee di umanità e di fraternità. Si volse in seguito verso il dadaismo e il lirismo sperimentale, la poesia pura. Esercita una grande influenza sulla sua generazione.
(4) L'Athenée è l'equivalente belga del liceo in Francia o del Gymnasium in Germania.
(5) Maurits Brants ha in particolare redatto un’opera sugli eroi della letteratura germanica delle origini: Germaansche Helden-leer, A. Siffer, Gent, 1902.
(6) Nella sua opera L'épreuve du feu. A la recherche d'une éthique, René Baert evoca specialmente le opere di Keyserling, Abel Bonnard, Drieu la Rochelle, Montherlant, Nietzsche, Ernst Jünger, etc.
(7) Louis Marie Anne Couperus (1863-1923), scrittore simbolista o0landese, grande viaggiatore, narratore naturalista e psicologico che mette in scena personaggi decadenti, senza volontà e senza forza, in contesti contemporanei o antichi. Prosa di maniera. Couperus ha scritto quattro tipo di romanzo: 1) romanzi familiari contemporanei nella società de l’Aia ; 2) romanzi fantastici e simbolici basati sui miti e le leggende dell’Oriente; 3) romanzi che mettono in scena antichi tiranni; 4) racconti, schizzi e descrizioni di viaggio.
(8) Durante la guerra, Urbain van de Voorde participa alla redazione della rivista olando-fiamminga Groot-Nederland. Durante l’epurazione, egli sfugge ai tribunali ma, come Michel de Ghel-de-rode, è rimosso dalla posizione di funzionario. Dopo questi guai, egli partecipa sin dall’inizio alla redazione di Nieuwe Standaard che riprende rapidamente il suo titolo De Standaard, e diviene il principale quotidiano fiammingo.
(9) Negli anni 20, il frontismo è il movimento politico dei soldati tornati dal fronte e raggruppati nel Frontpartij. Questo movimento si oppone alle politiche militari del Belgio, specialmente alla sua tacita alleanza con la Francia, giudicata atavica nemica del popolo fiammingo, il quale non deve versare una sola goccia del suo sangue per essa. Il movimento si batte per una neutralità assoluta, per dare un’impronta fiamminga all’università di Gand, etc.
(10) Il poeta Wies Moens (1898-1982), attivista durante la I guerra mondiale e studente all’università fiamminga di Gand tra il 1916 e il 1918, sconterà quattro anni tra il 1918 e il 1922 nelle carceri dello Stato belga. Fonda le riviste Pogen (1923-25) e Dietbrand (1933-40). Nel 1945, un tribunale militare lo condanna a morte ma egli riesce a rifugiarsi nei Paesi Bassi per sfuggire ai suoi carnefici. Il è stato uno dei principali rappresentanti dell’espressionismo fiammingo. Sarà legato, all’epoca del Frontpartij, a Joris van Severen, ma romperà con lui per le ragioni che ci spiega Marc. Eemans. Cfr.: Erik Verstraete, Wies Moens, Orion, Brugge, 1973.
(11) I tribunali militari belgi erano presieduti da « uditori » durante l’epurazione. Si parlava ugualmente di "Auditorato militare". Per comprendere l’abominio di questi tribunali, il meccanismo di nomina di giovani giuristi inesperti, di sottufficiali e ufficiali senza conoscenza giuridiche e di ritorno dai campi di prigionia, al posto di giudice, leggere l’opera del Prof. Raymond Derine, Repressie zonder maat of einde? Terug-blik op de collaboratie, repressie en amnes-tiestrijd, Davidsfonds, Leuven, 1978. Il Professeur Derine segnala la definizione del Ministro della Giustizia Pholien, sopraffatto dagli avvenimenti: "Una giustizia da re negri".
(12) Pol Le Roy, poeta, amico di Joris Van Severen, capo della propaganda del Verdinaso, passerà alla SS fiamminga e al governo in esilio in Germania dal settembre 44 al maggio 45. Van Was-senhove, capo distretto del Verdinaso, poi del De Vlag (Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft), a Ypres, viene condannato a morte nel 1945. Sua moglie versa parecchi milioni all’Auditorato militare e ad alcuni « magistrati », salvando così la vita del marito. In carcere, Van Wassenhove impara lo spagnolo e traduce molte poesie. Egli diverrà l’archivista di "Fantasmagie".
(13) De Vlag (= L Bandiera) era l’organo culturale della Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft. Trattava essenzialmente questioni letterarie, artistiche e filosofiche.
06:05 Publié dans art, Entretiens, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 juin 2007
Mouvement métapolitique à Vienne (19ième) (II)
Intervention de Robert Steuckers lors de la 9ième Université d'été de l'association «Synergies Européennes», Région de Hanovre, août 2001
Les activistes contre l'intellectualisme inerte
Pendant ce temps, les activistes marquent des points. Adler, Pernerstorfer, Friedjung et les frères Braun cherchent à traduire en termes politiques efficaces les idées qu'ils ont cultivées dans les colonnes de Die Telyn et dans les cercles de lectures universitaires qu'ils ont animés. Friedjung est sans doute l'homme qui perçoit le plus rapidement le danger de l'“intellectualisme inerte”, des discussions stériles qui ne débouchent sur rien et, surtout, qui ne communiquent pas leur flamme à des catégories plus vastes de la société. C'est pourquoi le groupe décide de s'allier en 1879 à un jeune orateur politique fougueux, nationaliste et populiste, Georg von Schönerer. Dans un discours électoral de 1875, celui-ci avait réclamé, dans une perspective libérale, progressiste et anti-cléricale, le “maximum de liberté politique pour tous les citoyens”, le bannissement des Jésuites, la reconnaissance de la maçonnerie, la lutte contre la corruption, toutes revendications qui continueront à faire partie du corpus nationaliste germanique, à l'exception de l'indulgence pour la franc-maçonnerie. Avant qu'il n'ait pris contact avec les jeunes autour de Pernerstorfer, Schönerer n'avait qu'une vague conscience des problèmes sociaux réels qui affectaient les classes défavorisées en Autriche.
En 1875, alors qu'il était encore un libéral bon teint sur le fond, Schönerer se distinguait toutefois par sa rhétorique, plus musclée, plus scandée, de ton plus acerbe (scharfe Tonart). Cette caractéristique ira crescendo, deviendra de plus en plus virulente, faisant du coup la célébrité du député fort en gueule. En 1878, en plein Parlement à Vienne, il traite ses collègues députés d'“eunuques de la politique”. En Italie comme en Autriche, voire en Belgique avec Paul Hymans, la critique du statu quo et des lenteurs parlementaires, qui sera le principal cheval de bataille des nationalismes et des fascismes du 20ième siècle, trouve ses racines dans l'aile gauche et populiste du libéralisme.
Schönerer, le député ad hoc
Lors d'une réunion du Leserverein, Anton Haider (ancêtre de Jörg Haider) lance l'idée que leur cercle de lecture, pour trouver sa traduction dans la sphère politique réelle, a besoin de l'appui d'un député capable de défendre le corpus idéologique de la communauté militante étudiante sur les strapontins de la Diète impériale. Pour Anton Haider, les travaux des cercles de lecture sont insuffisants, si un tel appui n'existe pas. Les autres lui répondent qu'il y a pas de député qui corresponde à ce profil. Anton Haider répond : « Il y en a un qui pourrait le devenir… Il s'appelle Schönerer. Il n'est guère connu; il est jeune, élu de fraîche date et n'a pas encore d'orientation bien définie, mais je pense qu'il pourra être d'accord avec nous. Je crois que nous campons déjà sur des positions voisines, sans le savoir. Nous devrions l'inviter et parler avec lui. Je retiens qu'il est la personne adéquate». C'est ainsi que Georg von Schönerer devint membre du Leseverein.
L'alliance entre ce Schönerer et le Groupe de Pernerstorfer conduit à une fusion (qui sera passagère mais qui, en dépit des engagements ultérieurs, différents, ne sera pas pour autant reniée) entre les pionniers du socialisme autrichien et les premiers nationalistes pangermanistes. Les deux idéologies sont au départ étroitement mêlées — et même de manière inextricable— et l'ennemi qu'elles désignent est le libéralisme, qu'elles entendent faire reculer et disparaître, parce qu'il est un crime contre l'esprit, l'art, la moralité publique et le Bien Commun. Cette volonté s'est exprimée dans le fameux «Programme de Linz», résultat du travail politique de Pernerstorfer et de ses amis, plus que de la faconde de Schönerer. L'historiographie conformiste n'évoque cette fusion que rarement —et avec réticence— et le mérite de l'avoir exploré correctement revient au Professeur américain William J. McGrath.
Du “Deutscher Klub” au Programme de Linz
Le Programme de Linz est en réalité le programme du mouvement pangermaniste autrichien, visant un rapprochement avec l'Allemagne de Bismarck, voir l'Anschluß, et un détachement graduel des Allemands d'Autriche-Hongrie de l'Empire des Habsbourg (1). Parmi ceux qui ont forgé ce programme, nous trouvons, outre Pernerstorfer, Friedjung et Adler, le Chevalier von Schönerer et le futur bourgmestre de Vienne Karl Lueger, populiste et antisémite. Certes, à cette époque, l'antisémitisme de Schönerer et de Lueger n'est pas encore trop virulent et ne choque nullement Adler et Friedjung, tous deux d'origine juive. Ce n'est qu'en 1882, à la suite d'un discours tonitruant de Schönerer, de facture nettement antisémite, que leurs rapports vont se relâcher, puis que leurs voies vont se séparer. Pendant cette période fort effervescente de trois années de fusion entre populistes et socialistes, les cercles universitaires changent de forme, les "associations de lecture" de l'Université, réservées aux étudiants, et les "associations de lecture pour universitaires devenus actifs", tel le “Deutscher Klub”, où participent médecins, professeurs, ingénieurs plongés dans la vie économique réelle, agissent en parallèle; à celles-ci s'ajoutent une "association pour les écoles allemandes", visant à défendre la langue et la culture allemandes sur les confins de l'empire (Tyrol, Slovénie, Tchéquie, etc.). Ces activités intenses ont une tonalité plus nationaliste que socialiste, mais d'aucuns, comme Friedjung, Pernerstorfer et Adler, se rendent parfaitement compte qu'il est impossible de créer un parti de masse sur base du nationalisme seul : il faut penser des "passerelles", aussi nombreuses et diversifiées que possibles, tâche à laquelle s'attèleront la métapolitique de Pernersstorfer et la praxis wagnéro-marxienne d'Adler. Nous y reviendrons.
Parallèlement au Programme de Linz, Friedjung avait sorti en 1876 un opuscule, tout aussi programmatique, sous le titre de Ausgleich mit Ungarn (= “Règlement de toutes les questions avec la Hongrie”). Il préconisait une politique générale pour l'Empire, plus nationaliste allemande qu'impériale : 1) séparation définitive entre la partie allemande (la Cisleithanie) et la partie hongroise de l'Empire, afin de faire glisser définitivement la Cisleithanie dans le bloc allemand forgé par Bismarck après les guerres contre le Danemark, l'Autriche-Hongrie et la France. 2) L'autonomie de la Galicie polonophone, afin de réduire le poids des députés polonais catholiques et conservateurs dans le Parlement de Vienne. 3) Imposition de la langue allemande dans toutes les administrations publiques de la Cisleithanie (2). Pour Friedjung : «Les Allemands d'Autriche ne doivent jamais oublier qu'ils ont été politiquement unis aux autres souches germaniques pendant tout le millénaire qui à précédé 1866 [= date de la défaite de l'Autriche face aux armées de Bismarck]». 4) L'indépendance des Etats balkaniques vis-à-vis de la Russie, avec, en compensation pour la Russie, la promesse autrichienne de ne procéder à aucune conquête ou annexion dans la péninsule au Sud-Est de l'Europe. 5) Union douanière avec l'Allemagne des Hohenzollern.
Le volet socialiste contre le manchestérisme
Plus tard, Friedjung ajoutera à ce programme de politique extérieure en revendiquant une liberté de presse pleine et entière, avec droits de réunion et d'association. Ensuite, sur le mode des organisations paysannes, venant en aide au petit paysannat, il revendique la création d'associations ouvrières et l'extension du droit de vote à de plus larges strates de la population. Sur le plan fiscal, Friedjung préconise un allègement général de l'impôt pour les classes modestes, compensé par des taxes plus lourdes sur les produits de luxe et sur les transactions boursières. Friedjung réclame aussi une administration plus diligente et une justice moins onéreuse pour les citoyens aux revenus modestes. Autres revendications : nationalisation des chemins de fer (pour éviter toute réédition de l'affaire von Ofenheim), lois réglementant le travail dans l'industrie, réduction du pouvoir de l'Eglise, lois pour éviter les fraudes dans les opérations boursières. L'objectif général, idéologique, consiste à mettre hors jeu “le libéralisme cosmopolite, qui ignore les besoins authentiques de la communauté nationale” et dont le noyau idéologique fondamental est “le libre développement” (le “laisser faire, laisser passer”), propre du manchesterisme, “qui a fini par détruire la véritable essence de la nation”.
En gestation constante au fil des mois, le Programme de Linz, dans sa version définitive, est publié dans le numéro du 16 août au 1 septembre 1882 de la revue Deutsche Worte (= Paroles allemandes). Les revendications de Friedjung, et celles des autres protagonistes de l'union entre jeunes socialistes et populistes pangermanistes, y trouvent une formulation plus achevée, mais où l'on doit tout de même reconnaître une contradiction : cette version du programme demande une “défense énergique des intérêts autrichiens en Méditerranée” (3).
Primordialité de l'art
Mais la volonté de rédiger un programme, comme celui de Linz, vient essentiellement de Pernerstorfer. Sa volonté était de donner à la politique autrichienne un “contenu allemand”. Pour Pernerstorfer, le groupe aura réussi sa mission quand l'assiduité allemande et l'art allemand, sous toutes leurs formes, auront compénétré la vie publique autrichienne. L'art reçoit donc un statut primordial dans la démarche de Pernerstorfer. Sa motivation est principalement esthétique, car elle est directement inspirée de Richard Wagner et de Friedrich Nietzsche, pour qui il y a unité de l'art et de la politique. Cette primordialité de l'art, ensuite, aura une incidence de premier plan sur la tactique et le style du mouvement. Déjà, pour Friedjung, l'art était le “principe viril” et le remède contre l'impuissance et la paralysie de la politique libérale (on songe aux propos que tiendront un Marinetti puis un Evola quelques décennies plus tard). Les politiciens deviennent trop prudents, trop timorés, ils changent de couleur, ou plutôt, leurs couleurs initiales sont rapidement délavées. Par le recours aux formes sublimes de l'art, les jeunes générations pourront, en s'initiant à la pensée de Wagner et de Nietzsche, “donner pleine expression à leurs enthousiasmes”. Friedjung: «Orphée ose entrer avec sa lyre dans le règne des enfers uniquement parce qu'il sait que dans ces masses obscures vit une vague pulsion endormie, qu'une note juste peut subitement réveiller, la transformant en un sentiment vibrant ». L'art —et la musique en particulier— doit donc servir à réveiller les masses.
L'art comme ciment de la communauté nationale
Dans un article de 1884 de Deutsche Worte, intitulé significativement “Metapolitik”, Pernerstorfer soutient le Prof. Immanuel Hoffmann, un Wagnérien en querelle avec les Bayreuther Blätter, organe officiel de l'orthodoxie wagnérienne, parce qu'il préconise l'introduction du plébiscite, que les orthodoxes jugent inopportune. Hoffmann : « L'art et la religion ne peuvent exister séparément de la politique… L'art véritable ne peut se déployer, selon la parole du Maître (= Wagner), que sur le terrain d'une éthique authentique, et aucun peuple ne pourra avoir un art et une religion authentiques si sa vie politique repose sur le mensonge […] L'erreur historiciste sur laquelle se fonde notre culture actuelle —erreur qui nous permet de la qualifier de culture du mensonge— est de préférer le parfum des fleurs aux fleurs elles-mêmes, d'apprécier les distillations plutôt que l'essence naturelle de la chose, de croire que les élus du peuple sont plus sages que le peuple lui-même». Pernerstorfer soutient donc Hoffmann dans son plaidoyer pour le plébiscite (la votation référendaire), car il donne plus grande cohésion à la communauté nationale. L'art comme ciment de la communauté nationale, le plébiscite comme expression directe de sa volonté sont les deux facettes d'une même réalité. La cohésion sociale passe par la participation de tous à la vie spirituelle et intellectuelle de la communauté nationale, car il ne s'agit pas seulement “de jouir des biens matériels, car ceux-ci ne sont que les simples instruments pour atteindre des fins plus élevées”. Les biens matériels sont là pour offrir à tout individu la possibilité de participer à l'héritage spirituel de la nation, afin d'être un membre réceptif et créatif du grand corps que doit devenir la communauté populaire germanique, ajoutait Pernerstorfer.
La fusion communautaire dans le théâtre grec et l'opéra wagnérien
Comme dans la Grèce antique, le lieu où cette fusion communautaire nationale devra s'effectuer est le théâtre, ainsi que l'avait préconisé le jeune Nietzsche, en assistant aux drames wagnériens. Pour lui, le noyau d'émergence de la communauté nationale allemande résidait tout entier dans les opéras de Wagner, dont le centre de gravité se situe dans l'orchestre exactement comme il se situait dans le chœur du théâtre grec antique. Dans cette perspective, la germanité de la fin du 19ième siècle est la nouvelle hellénité, la restauration de l'hellénité perdue depuis l'antiquité, espérée depuis la renaissance, une hellenité qui ne se contente plus d'être une simple et sèche érudition, mais une hellénité qui renoue avec le théâtre antique, avec la charge de dionysisme que véhiculait la tragédie grecque. Pernerstorfer : « Wagner avait trouvé chez les Grecs le théâtre dans sa pureté idéale et dans tout son sublime; religion et art y fusionnaient et de cette fusion naissait une communauté qui aujourd'hui encore, après plus de deux mille ans, reste l'un des plus beaux rêves de l'humanité ». Pernerstorfer rejoint Wagner quand il s'agit d'exalter le vif sentiment national qui unissait les Grecs : « Les Grecs se sentaient comme une seule nation et ont créé une culture unitaire, si bien que l'esprit populaire hellénique se reconnaissait dans la dramaturgie nationale ».
Pour les Allemands d'Autriche, le chant jouera le rôle de ciment. Lors de manifestations pangermanistes et socialistes, dont celle, historique, du 5 mars 1883, le chant occupe une place centrale. Les participants, généralement des étudiants contestataires de la politique conservatrice du Premier ministre autrichien Taaffe, s'étaient regroupés sous une immense bannière allemande, celle de l'Empire fondé à Versailles par Bismarck. Aucune bannière autrichienne n'était arborée dans la salle. L'orchestre jouait la Marche Impériale (allemande) et les participants chantaient, tour à tour, l'hymne de bataille de Rienzi, quelques partitions du Tannhäuser et le chant de guerre Wacht am Rhein, très populaire à l'époque, y compris en Flandre (4). A la suite de ces préliminaires musicaux et chorégraphiques, Hermann Bahr parle du nationalisme d'inspiration wagnérienne, puis Schönerer monte à la tribune, pour terminer un discours exalté, par un tonitruant “Vive notre Bismarck!”, jugé séditieux par la police, présente dans la salle. La foule se disperse en chantant Wacht am Rhein. Pour Pernerstorfer et ses amis, ce type de manifestation, alliant musique, discours et chants, permet, à terme, de recréer un esprit national, de forger une communauté soudée par des émotions partagées. Quand une telle communauté sera vraiment soudée, quand un maximum de citoyens aura adhéré à l'idéologie implicite, non rationnelle et totalement intuitive, du mouvement, le peuple sera “régénéré”.
Une métapolitique reposant sur l'élément émotif
Le thème central de toute cette effervescence est effectivement la “régénération”, qui naît d'une “explosion unitaire de foi politique”. La métapolitique de Pernerstorfer repose donc entièrement sur l'élément émotif et sur le style tapageur des manifestations politiques, sortes de messes wagnériennes, conçues délibérément pour répudier la rationalité des libéraux et des conservateurs. D'un côté, les passions du cœur, le sens de la justice, la rébellion contre la sécheresse, de l'autre, les hommes “aux cœurs gelés”. D'un côté, le cœur du peuple réel, de l'autre, les idées abstraites du centralisme, du libéralisme, de la culture (des Philistins), la notion de “légalité constitutionnelle”. Dans Deutsche Worte, Pernerstorfer explicite cette position : « La politique des libéraux est trop doctrinaire et dépourvue d'idéalisme pour être capable de susciter de véritables émotions». Plus tard, dans un numéro ultérieur de la revue : «[Eduard Herbst] est le représentant typique d'un style politique cérébral à l'excès : nous n'entendons pas chez lui ce ton d'animateur, propre d'un sentiment national viril; il est incapable de dire quoi que ce soit sur les grands problèmes que nous avons à affronter ». En bref : qui n'adhère pas pleinement au style hellénique-wagnérien est une lopette, ou, pour paraphraser Schönerer, “un eunuque politique”. Herbst, comme les autres libéraux, les von Plener, Sax et von Bründelsberg, se bornent à ânonner des “vérités familières à n'importe quel écolier sur un ton de grande solennité; [à répéter] des citations d'auteurs célèbres avec des airs professoraux devant un public révérencieux”.
«Vers une organisation de parti »
Les blocages qui affectent la société autrichienne de l'époque sont donc dus à un style trop compassé où l'on ne veille qu'à la correction des procédures et non pas à affronter les problèmes réels. Ces mauvaises habitudes doivent être balayées, pensent Pernerstorfer et ses amis politiques. Dans cette optique, Pernerstorfer écrit un maître article dans Deutsche Worte, significativement intitulé “Vers une organisation de parti”. La réflexion initiale qui le motive dans la rédaction de cet article important est la suivante : « La conscience et les aspirations nationales ne se commandent pas, ne s'enseignent pas; il n'est pas possible de les introduire dans les strates les plus larges de la population par le truchement des méthodes traditionnelles d'éducation ». De même, le fonctionnement de toutes les petites sociétés politiques libérales, où la discussion feutrée est toujours de mise, ne peut servir de modèle à la constitution d'un futur parti ou mouvement national, s'adressant aux masses. Les discussions raisonnables des notables libéraux sont valables seulement si le vote est censitaire ou réservé à une petite catégorie de citoyens, votant en toute connaissance de cause, mais en ne tenant compte que de leurs seuls intérêts sectoriels et limités. Les mouvements de masse de l'avenir, pense Pernerstorfer, ont besoin d'une petit groupe choisi, bien formé, qui décide des objectifs à poursuivre et des tactiques à mettre en œuvre. La grande masse ne peut avoir la lucidité rationnelle de la minorité des censitaires. Pour cette raison, le fonctionnement formel des cercles politiques conventionnels du libéralisme doit faire place à un fonctionnement informel : les idées nationales doivent circuler dans toute la population, dans les familles, dans les discussions informelles des citoyens dans les cafés et autres lieux publics. Cibles de cette métapolitique, fonctionnant de manière informelle : les femmes et les jeunes, parce que les unes influencent leurs enfants et leurs maris, et parce que les autres sont les électeurs de l'avenir, à cette époque où les pyramides démographiques ne sont pas encore inversées. L'infiltration discrète de cercles divers, même a priori hostiles au nationalisme, est une nécessité impérieuse.
Une maïeutique au service de la cause nationale
Les membres des cercles nationalistes doivent connaître les opinions de leurs adversaires, percevoir comment il faut les subvertir, les investir pour en retourner la force au profit du nationalisme. Quant aux citoyens sans formation, l'absence de logique dans leurs raisonnements constitue un tremplin métapolitique : dans ce vide, on peut injecter un contenu nouveau, allant dans le sens du combat qu'on s'est assigné. Pernerstorfer, ensuite, préconise de ne pas attaquer les arguments des adversaires de front : il importe de gagner d'abord leur sympathie, pour entamer ensuite un débat fructueux, qui n'est grevé d'aucun ostracisme de nature personnelle. L'exposant de la métapolitique pernerstorfienne se pose d'emblée comme un homme intéressant et affable, qui opère par le biais d'une sorte de maïeutique socratique, c'est-à-dire en ne rejetant pas d'emblée les arguments de l'adversaire, en écoutant ses arguments puis en induisant la conversation vers les positions de bon sens nationalistes. Chants, théâtre, opéra, recours aux émotions populaires, aux sentiments sains du bon peuple, argumentation subtile de type socratique/maïeutique forment le menu de l'activisme politique à l'ère des masses, selon Pernerstorfer.
Le fair play qu'il préconisait ne cadrait pas entièrement avec le ton âpre et violent de Schönerer, qui bascule bien vite dans l'antisémitisme ambiant de la société viennoise et autrichienne. La rupture entre les deux pôles du mouvement pangermaniste et populiste se consommera en 1883, à la suite d'un discours extrêmement violent de Schönerer. Mais la question de l'antisémitisme ne se posait pas de la même façon à l'époque qu'aujourd'hui. William J. McGrath se réfère à George Mosse, spécialiste de cette question dans le contexte germanique : pour Mosse, les jeunes activistes métapolitiques juifs de la Vienne des dernières décennies du 19ième siècle entendaient rompre avec un certain judaïsme de leurs pères, qu'ils jugeaient stéréotypé. Ils s'insurgeaient contre l'image stéréotypée qui faisait d'office du juif un être exclusivement intellectuel et artificiel, privé de racines et de liens à la nature et, par conséquent, parfaitement adapté au milieu capitaliste et urbain, que dénonçaient les nationalistes. Les jeunes activistes juifs et pangermanistes estimaient de fait que ce stéréotypage n'était pas faux en soi et qu'il devait être dépassé par des efforts de volonté : l'homme juif dans la société allemande devait abandonner cet intellectualisme et cette artificialité stérile, retrouver des racines et des liens avec la nature au même titre que les Allemands “chrétiens” ou “aryens”. C'est cette démarche de libération, estimaient-ils, qui devait fonder leur identité politique, sans déterminisme matériel ou racial aucun. L'adhésion à l'esthétique wagnérienne et nationale, à l'art allemand, constitue le fondement volontariste de l'identité politique. Pour l'aile représentée par Schönerer, il y a un déterminisme biologique qui surplombe irrémédiablement ce fondement volontariste.
Travailler à l'émergence d'un bloc populiste solide
Après la rupture avec Schönerer, Adler et Pernerstorfer évoluent vers un socialisme populaire, non déterministe, marqué par Nietzsche et Wagner. Friedjung opte pour la position des libéraux de gauche, favorable à l'émancipation des classes laborieuses et défavorisées. Adler et Pernerstorfer ne réservent pas leur socialisme à la seule classe ouvrière proprement dite, mais l'étendent aux artisans, aux paysans pauvres et à la partie des classes moyennes, dont les revenus sont faibles. L'objectif est d'unir, en un bloc populiste solide, toutes ces classes vivant dans la précarité économique pour qu'elles luttent de concert contre le libéralisme autrichien, qui génère une hiérarchie sociale basée sur l'argent et la quantité, et non sur la qualité et le mérite. Ouvriers, paysans, artisans et représentants de la petite classe moyenne doivent communier dans la foi nationaliste, ciment de leur unité, pour lutter de concert contre la dictature sournoise et indirecte de l'argent, quasi invisible dans les textes de loi ou dans les institutions, mais bien présente dans la société et fort lourde à supporter.
La pensée de ce socialisme est organique. Karl Ausserer, membre du groupe Pernerstorfer, écrit dans la Deutsche Wochenzeitschrift du 16 mars 1884 un article qui exprime parfaitement cette mystique de la nature, présente dans le corpus intellectuel du groupe depuis les années du Schottengymnasium. Ausserer : « Sous les tempêtes hivernales, tout observateur attentif prévoit de longue date l'apparition du printemps, le réveil de la nature… Une force élémentaire invisible est à l'œuvre dans les profondeurs de la Terre; tout est en germination, tout croît, se remplit de lymphe et de suc vital » (Comment ne pas penser à Henri Bergson ou à Maurice Blondel?). Ausserer se réclame ensuite du passé médiéval allemand, surtout de l'époque ottonienne et de celle des Hohenstaufen. La poésie et la musique médiévales allemandes ont été mises en exergue à l'époque par des philologues et des médiévistes tels Victor Scheffel et Julius Wolff. Ausserer : « Ces poètes [du moyen âge] ont fait vibrer les cordes de nos cœurs et leurs chants se sont ancrés dans le peuple… Bien vite, à ces chants, s'est associée la mélodie ».
Pour un équilibre entre émotions et rationalité
Les référentiels et les leitmotive des hommes du groupe de Pernerstorfer sont donc doux, empreints de sagesse et de quiétude, en dépit de la nécessité, qu'ils reconnaissent, d'employer des mots durs pour fustiger les “eunuques politiques”. A la suite de la rupture avec Schönerer, le groupe d'Adler et de Pernerstorfer perçoit le risque de dérive découlant de l'utilisation irraisonnée des “discours âpres” et d'une excitation irréfléchie des émotions populaires. Le 10 mai 1885, Friedjung explique, dans les colonnes de la Deutsche Wochenschrift, que la politique découlant des “discours plus âpres” est pleinement justifiée, car elle met un terme à une tiédeur politique délétère pour amorcer une ère nouvelle, énergique, où l'esprit national se défend avec virilité, mais cette défense virile de la nation ne doit pas s'accompagner d'une atrophie spirituelle, de limitations qui conduisent à la stupidité. Le 31 mai, dans les colonnes de la même revue, Friedjung écrit : « Le sentiment et l'émotion ont leur place dans la politique et sans le soutien précieux de ces facultés —les plus nobles de la nature humaine— la vie publique dégénère trop souvent en un jeu d'ambitions et en un combat fondé uniquement sur les intrigues ». Et il ajoute : « Il faut cependant éviter tout excès de sentimentalisme facile, éviter de se complaire dans les slogans de bas de gamme, vides de sens et trop hauts en couleurs».
Friedjung, après la rupture de 1883, tente donc de redéfinir le style politique du groupe issu du Schottengymnasium et du Leserverein. Les appels à l'émotion doivent recevoir des contrepoids plus réfléchis pour amorcer une stratégie plus vaste, destinée à rameuter l'électorat indécis oscillant entre les libéraux (de gauche) et les pangermanistes populistes. En 1885, cette nouvelle stratégie porte ses fruits : pas moins de 47 députés représentent la mouvance au Parlement, dont de nouveaux élus comme Pernerstorfer, Ausserer et Steinwender. Pernerstorfer, financé par son ami Adler, est élu député socialiste de Wiener Neustadt. Il le restera quasiment pour le reste de ses jours.
L'apport de Victor Adler au socialisme autrichien et les aveux de Kautsky
Victor Adler, qui avait opté plus tôt pour un combat plus socialiste, plus social-démocrate, que ses collègues issus du Leserverein, fera une carrière brillante au sein du parti socialiste autrichien, dont il fut l'un des pères fondateurs. Il assurera une transition sans heurt entre le pangermanisme de sa jeunesse et la sociale démocratie de sa maturité. Médecin de profession, on le surnommait dans les quartiers populaires de Vienne le “Docteur”. Ses discours avaient une teneur psychanalytique avant la lettre, soit avant la vulgarisation généralisée du freudisme. Il avait retenu les leçons de Theodor Meynert, prodiguées à la tribune du Leserverein. Dans un discours prononcé devant une assemblée de socialistes viennois en 1901, Adler révèle sa vision thérapeutico-politique : « Le cerveau est un organe répressif et c'est en cela que réside sa supériorité; mais si le cerveau ne se consacre qu'à la seule répression, il court le risque de ne plus pouvoir activer ses centres moteurs ». Adler fustige les théoriciens rigides, déterministes et marxo-matérialistes de la sociale démocratie allemande et autrichienne : comme le fera plus tard Henri De Man, Adler vise à créer, au sein du parti socialiste, un équilibre entre politique (rationnelle) et psychologie (émotive des masses), ce qui revient à prôner un équilibre entre l'émotivité qui impulse l'action politique à la base et la nécessité d'avoir un cadre doctrinal efficace. Même Karl Kautsky, exposant d'un socialisme positiviste et rationaliste, souvent brocardé par les soréliens et les léninistes pour sa rigidité et ses modérations, reconnaît la qualité et l'efficacité des positions d'Adler : «[Dans les rangs des nationalistes pangermanistes], il a acquis une formation politique et une capacité de traiter les situations et les hommes, qu'avant lui, les chefs de la sociale démocratie autrichienne n'avaient jamais eue. L'arrivée d'Adler dans leurs rangs a mis fin au règne de l'infantilisme politique ». L'aveu est de taille : cela signifie, si l'on retient ces paroles de Kautsky et qu'on les extrapole, sans pour autant les solliciter outre mesure, qu'un socialisme privé du terreau des pensées énergiques (et énergisantes) de l'élan vital nationaliste, pangermaniste, wagnérien et nietzschéen, sombre quasi automatiquement dans la banalité et l'infantilisme…
Le passage au socialisme n'estompe nullement l'élan pangermaniste
Dans d'autres passages de l'œuvre ou des mémoires de Kautsky, nous trouvons d'autres évocations élogieuses d'Adler : « Autour de lui, il y avait un cercle d'intellectuels —des médecins, des avocats, des compositeurs, des journalistes— qui s'intéressaient tous au socialisme et qui étaient très proches de lui. Une seule chose m'éloignait d'eux : le fait qu'ils professaient ouvertement des idéaux pangermanistes… [Les membres juifs de ce groupe] étaient de fervents nationalistes, beaucoup étaient même chauvins… Ils ne voulaient rien avoir à faire avec les Habsbourg et n'exaltaient que les Hohenzollern. Les juifs autrichiens étaient à l'époque les défenseurs les plus passionnés de l'Anschluss, auquel s'opposait clairement Bismarck ». Malgré les sentiments positifs qu'il éprouvait à l'égard d'Adler, Kautsky exprimait souvent son incompréhension face au wagnérisme et au nietzschéisme qu'il avait hérités de son long passage dans le mouvement pangermaniste. Devenu à son tour député socialiste, Pernerstorfer explique les mobiles qui ont animé sa jeunesse, qu'il ne renie pas, dans les colonnes de Deutsche Worte : « J'ai grandi pendant une période de grande exaltation patriotique, mais, dès ma jeunesse, je me suis intéressé aux idées démocratiques et socialistes; je pensais que le pangermanisme, tout comme les autres mouvements nationaux dont s'étaient inspirées les guerres de libération contre Napoléon, étaient de nature démocratique ». Quant à Adler, il n'a jamais cessé de lire et de vénérer les corpus légués par Wagner et Nietzsche. Axiome indépassable de sa pensée : la musique créera le sens communautaire socialiste et national. A ce propos, il écrit : « La musique a le pouvoir de nous guider vers les plus hautes cimes du sentiment, où toutes les particularités disparaissent et où notre regard ne rencontre plus que ce qui est grand et sublime. Le sens le plus élevé de notre solidarité, l'enthousiasme pour la cause sacrée où les masses s'unissent dans la fraternité, ne peuvent s'exprimer par des mots : ils doivent se chanter ».
Un socialisme culturel et non matérialiste
Pour Adler, les objectifs du socialisme ne sont donc pas d'ordre matériel, ne visent pas uniquement à améliorer le bien-être matériel des masses, à en faire des animaux d'élevage gavés, dociles et domptés, mais surtout à élever leur niveau culturel. Il exprime clairement cette idée dans un article de la revue Gleichheit de 1887 : « La révolution économique avance inexorablement sur sa voie, en suivant les lois de la mécanique… mais, simultanément, une autre révolution avance dans la conscience de l'humanité, une révolution intellectuelle qui, elle, est le véritable objectif premier des partis prolétariens sociaux démocratiques ». Les militants socialistes sont dès lors des missionnaires, les missionnaires d'une révolution culturelle, éducatrice qui vise l'élévation morale des classes défavorisées. Les historiens du socialisme international reconnaissent cette spécificité du message d'Adler; ainsi, l'historien britannique G. D. H. Cole: «… le mouvement socialiste viennois se distinguait des autres surtout par les succès qu'il avait remportés dans son travail culturel; les socialistes autrichiens, ou du moins les socialistes viennois, sont devenus le groupe prolétarien le plus cultivé et le mieux préparé du monde ». Pernerstorfer est fier du travail réalisé par ses amis et camarades; lors du congrès des socialistes autrichiens de 1894, il les félicite et ajoute une phrase capitale, qui prouve nettement que l'idéologie de la table rase, propre des socialistes dégénérés et véreux d'aujourd'hui, n'est pas la sienne : « Tout ce qui forme le patrimoine des civilisations du passé et du présent, tout ce qui est noble, grand et beau, se concentre en vous ».
Un socialisme qui table sur le “mythos” plutôt que sur le “logos”
Le socialisme n'a de sens, ajoute McGrath, que s'il patronne une éducation artistique des masses prolétariennes. Pour y parvenir, Pernerstorfer sait qu'on ne peut faire table rase des legs de la religion, des symboles, des mythes, notamment de ceux qui s'exprimaient dans le théâtre de la cité grecque antique. Avant d'autres auteurs importants, notamment de la future “révolution conservatrice”, Pernerstorfer affirme que le socialisme, s'il veut triompher, doit tabler sur le “mythos” plutôt que sur le “logos”. Leitmotiv qui est évidemment d'inspiration wagnérienne et nietzschéenne. Pour lui, un peuple qui ne va plus au théâtre, qui ne dispose plus de théâtres où il peut créer directement ses formes d'expressivité, est un peuple mort-vivant. De même, si le théâtre n'est plus que commémoratif, répétition stérile des mêmes clichés, il ne peut servir de ciment communautaire. Bertold Brecht pour la “gauche” officielle du 20ième siècle, Hanns Johst, dans le contexte national-socialiste, ne diront pas autre chose. Quelques citations puisées dans les articles de Pernerstorfer sont révélatrices à cet effet : « L'immense majorité du peuple est complètement exclue du théâtre et de l'art en général; la dramaturgie, qui, normalement, est intimement liée à la collectivité nationale tout entière, du fait du caractère religieux de ses origines et de son développement, n'est plus que le privilège d'une strate très restreinte de la population ». «Jadis, la nation et le théâtre étaient étroitement liés l'une à l'autre. Ils se développeront à nouveau tous deux lorsque de nouvelles formes de vie, dans la grande ère à venir, se montreront capables de réunifier la nation au niveau culturel le plus élevé, alors naîtra un nouvel art dramatique, qui ne sera en rien inférieur aux plus grandes créations de l'art antique». «Seul le socialisme pourra créer en toute conscience une situation où il n'y aura plus de restrictions sociales empêchant les individus d'évoluer totalement… Alors seulement la souveraineté de l'œuvre d'art, dont rêvait Richard Wagner, deviendra réalité ».
Socialisme = culture, libéralisme = barbarie
Le socialisme est donc au service de l'esthétique, de l'art, et non l'inverse. Il est le contraire du libéralisme, qui crée un monde d'enfer, parce que le beau n'a, pour lui, aucune importance, seules comptent pour lui les plus sinistres abstractions inventées par l'homme : les bilans, les procédures bancaires, l'argent, les accumulations quantitatives, la production d'horribles objets sérialisées, le vacarme d'abominables automobiles. Pour satisfaire le culte insensé voué à ces abstractions, on faisait mourir des enfants, que l'on laissait déchiqueter sous des machines à tisser, comme le montre le film poignant consacré, il y a quelques années, à l'œuvre politique du Père Daens. L'artiste, l'historien, le philologue, le philosophe, le créateur dérangent, au lieu de les respecter et de les choyer, on les condamne à la misère existentielle et morale. L'employé de banque, le comptable, l'ingénieur commercial, le "manager", le producteur tayloriste sont hissés sur le pavois, payés grassement pour ne rien créer de beau et même pour généraliser toujours davantage l'horreur sérialisée qui est leur propre, alors que leurs abjectes et médiocres personnes, par le fait même qu'elles existent, mangent, ch…. et respirent, font chavirer notre civilisation dans un déclin irrémédiable, à l'horizon duquel une misère noire nous attend, une double misère morale et économique, car ce fatras infâme finira par crouler —sa croissance exponentielle ne pouvant se poursuivre à l'infini. Un vrai socialisme aspire à une société débarrassée des maniaques de l'accumulation quantitative sans frein, les émules de la crapule marchande von Ofenheim.
On ne peut être socialiste qu'avec l'indispensable zeste de wagnérisme et de nietzschéisme
L'exemple historique le plus patent qui vient à l'esprit quand on rappelle ces deux équations, chères à Pernerstorfer et Adler —“socialisme = esthétique” et “libéralisme = barbarie culturelle”—, est le sort advenu aux créations architecturales de Victor Horta : celui-ci n'était pas encore décédé que les libéraux, élus par le plus vil des esprits mercantiles, faisaient raser à Bruxelles les immeubles qu'il avait érigés. Plus tard, après la seconde guerre mondiale, quand le socialisme avait vraiment perdu ses dernières plumes culturelles, qu'il avait sombré dans l'horreur matérialiste la plus vulgaire, sa splendide “Maison du Peuple” de la rue Joseph Stevens, près du Sablon, croulait sous les pioches et les bulldozers des démolisseurs, malgré les appels et les pétitions lancées dans le monde entier, notamment par le grand architecte finlandais Alvar Aalto. Le socialisme belge, qui avait partagé avec le socialisme autrichien une volonté d'esthétiser la vie publique, perdait bel et bien ses dernières bribes qualitatives : depuis, il n'a cessé de sombrer dans la fange la plus abjecte, dans la veulerie, la crapulerie et la corruption. Il est aujourd'hui représenté par d'ignobles voyous sans foi ni loi, qui auraient fait honte à des esprits aussi élevés que les fondateurs de la sociale démocratie autrichienne : Engelbert Pernerstorfer et Victor Adler. Avec eux et avec Horta, nous aurions été socialistes sans arrière-pensées, avec l'indispensable zeste de wagnérisme et de nietzschéisme. Avec la vermine qui prétend représenter le socialisme en Belgique aujourd'hui, on n'ose plus revendiquer cette étiquette.
Pour Adler, la politique est l'art de l'action
Victor Adler a bel et bien représenté un socialisme où il y avait équilibre en l'esprit et le cœur, entre l'intellect et les passions. Emile Vandervelde, dans l'hommage qui lui rend immédiatement après sa mort, écrit : « Je n'ai jamais connu personne —et je le répète, personne— en qui se résumaient si bien toutes les qualités de caractère et d'intelligence, ce qui concourait à former un grand chef politique. Il appréciait les grandes motivations idéales mais ne fermait pas les yeux face à la réalité; il avait une parfaite maîtrise des théories et des faits, faisait montre d'un merveilleux équilibre entre l'esprit et le cœur; il avait un pouvoir magnétique qui lui permettait d'entraîner les hommes tout en conservant le calme nécessaire pour les freiner dans leurs moments de colère ». Ces qualités distinguaient Adler de la grande majorité des chefs sociaux-démocrates allemands. Il se désolait de voir combien un Bebel ignorait les ressorts de la psychologie des masses. Ces socialistes allemands étaient des raisonneurs abstraits, des bâtisseurs d'hypothèses rigides. Julius Braunthal observe qu' « Adler n'avait pas la moindre sympathie pour tout ce qui est hypothétique, abstrait et artificieux… Pour lui, la politique était l'art de l'action, l'art de faire ce qui est nécessaire en des circonstances déterminées ».
Adler admirait Jean Jaurès, son style théâtral, sa capacité d'enivrer. Comme lui, il entendait, en toute conscience, valoriser l'aspect théâtral de la politique. Plus spécifiquement, écrit McGrath, un examen approfondi des techniques utilisées par Adler démontre qu'il était un maître de la symbolique politique. Les exemples que souligne McGrath sont intéressants : le combat mené par Adler et ses amis pour faire du 1 mai la fête des ouvriers, d'une part, la grande manifestation qu'ils ont organisée à Vienne pour obtenir le suffrage universel.
Cri d'appel et ligne ondulatoire
Pour Adler, la politique fonctionne correctement, fait vraiment bouger les choses si on table sur l'“appel”, le cri d'appel, le Weckruf, qui consiste à réveiller l'énergie vitale assoupie. L'appel du 1 mai passe par le retour à un mythe païen, celui de la célébration du printemps, de la fête qui inaugure le temps de la fertilité et la période des fleurs. Pour Adler, le 1 mai ne doit pas être une journée de revendications brutales, mais une journée festive. Adler mêle là traditions populaires et éléments glanés dans La Naissance de la Tragédie de Nietzsche. Le choix de la fête, plutôt que de la manifestation purement revendicative, est un choix tactique conscient. Il sait que le parti socialiste doit maintenir vive la conscience des iniquités sociales dérivant du mode de scrutin censitaire en vigueur dans l'Autriche de son temps. Mais, en tant que psychologue, il sait aussi que “l'on ne peut maintenir éternellement la lutte à la température maximale, une température maximale qui n'est possible qu'en certains moments et dans des conditions favorables”. Il serait donc criminel et vain de maintenir une pression constante de type linéaire. Le risque est alors de courir à la catastrophe. Adler ne croit pas à la “ligne droite” mais à la “ligne ondulatoire” (Wellenlinie). Il l'explique au congrès socialiste de 1904 : « Toute activité psychique —et la politique est aussi et surtout une activité mentale— se développe selon un rythme ondulatoire. Dans tout mouvement, il y a des crêtes de vague, mais chacune d'elles est suivie, par nécessité physique, d'un creux, d'une diminution d'intensité qui constitue un moment de pause et prépare une reprise d'intensité dans le mouvement. Aucune activité psychique ne peut se maintenir sur le long terme ou pour toujours à son niveau maximal ». La triple lecture de Schopenhauer, de Wagner et de Nietzsche permet à Adler de mieux saisir la psychologie des masses que ses collègues marxistes conventionnels, qui n'argumentent qu'avec des schémas secs, rationalistes ou positivistes. Par conséquent, tout mouvement socialiste qui s'écarte de la pensée en termes de “rythmes ondulatoires” sombre dans l'apathie ou le ronron politicien. Il n'y a pas de socialisme triomphant qui soit pensable sans apport nietzschéen.
La grande manifestation pour le suffrage universel
La campagne pour le suffrage universel permet une nouvelle fois à Adler de démontrer l'excellence de ses conceptions. Le Premier ministre hongrois Fejérvary annonce en septembre 1905 que la partie hongroise de l'Empire adoptera le suffrage universel masculin. Aussitôt, en Cisleithanie, les esprits s'échauffent et veulent le même statut. Les Tchèques sont en faveur d'une grève générale (prélude à une insurrection?). Adler, plus prudent, opte pour une tactique différente. L'émeute n'arrangerait pas les choses : le gouvernement conservateur risquerait de tenter à son tour le coup de force, comme le gouvernement russe qui vient de mater la révolte de 1905. Adler veut organiser une fête, un Volksfeiertag. Les ouvriers défileront dans le calme, le silence et la dignité (Würde) devant le Parlement, où l'on débat sur la question du suffrage universel masculin. Ils doivent défiler en famille, vêtus de leurs beaux effets du dimanche. Réclamer le suffrage universel ne se fait pas par des cris, des vociférations, des bagarres, mais par le faste d'une procession quasi religieuse ou d'un cortège traditionnel, inscrit dans la liturgie naturelle et agraire qui se profile derrière la liturgie catholique. 250.000 ouvriers allemands d'Autriche et une centaine de Slovaques de Moravie (en désaccord avec les Tchèques) participeront à cet immense défilé silencieux et digne. L'Arbeiter Zeitung écrit le lendemain : « Tous, du sympathisant au simple observateur, garderont le souvenir d'un spectacle sublime (erhabenes Schauspiel) ». L'unité populaire (et celle du prolétariat) ne naît pas d'une organisation rigide et enrégimentée mais d'une authentique communion d'idée et de sentiments. Les ouvriers autrichiens, en défilant calmement devant le Parlement de Vienne, ont prouvé qu'ils n'étaient pas un troupeau ignare manœuvré par des agitateurs. Cette vision, explique l'organe socialiste, est un “cliché libéral”, propre aux “philistins de l'imposture individualiste”. La classe ouvrière viennoise a fait preuve d'autodiscipline, a démontré sa volonté collective qui était, non pas le produit d'une violence destructrice, mais, au contraire, le produit d'un long travail éducatif, métapolitique, sans précédent. Au lendemain de cette gigantesque manifestation couronnée de succès, Victor Adler souligne le contraste entre, d'une part, cette masse puissante par le nombre et la discipline et, d'autre part, l'impuissance du Parlement, ou, pour parler comme Maurras, le contraste entre le pays réel et le pays légal. Adler écrit : « Cette Chambre ne jouit que de peu de crédit dans le peuple… Elle n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit de bon, ni même quoi que ce soit de mauvais : elle est devenue complètement inutile ». L'anti-parlementarisme, dont on a accusé plus tard les fascistes, a des racines socialistes et foncièrement démocratiques. Du moins en Autriche.
Victor Adler traversera les turbulences de la première guerre mondiale et mourra le 11 novembre 1918. Un jour après sa mort, la République est proclamée. Mais ce n'était pas la république dont il avait rêvé dans sa jeunesse, surtout parce qu'elle s'interdisait de réaliser l'Anschluß, l'union des Allemands d'Autriche à la “grande patrie germanique”. Ce ne seront plus les socialistes qui militeront pour cette réunion, mais les nationalistes, héritiers directs d'un ancien associé politique d'Adler : le Chevalier von Schönerer.
Conclusion :
◊ Nous avons retracé, en suivant les démonstrations de McGrath et de Battey, l'histoire d'un mouvement politique à la fois identitaire et universel, un mouvement qui a clairement fait appel aux racines (Nibelungen, poésie et mystères médiévaux, ères des Staufer et des Othoniens, etc.), qui a imité des démarches identitaristes pionnières telles les Eisteddfodd gallois, tout en proposant un modèle universel (et non pas universalistes). Tous les peuples ont le devoir éthique de défendre leurs racines : cette vérité est universelle, mais ne débouche pas, a fortiori, sur un modèle universaliste arasant, qui se poserait comme unique pour toute la planète. Nous constatons aussi que si les composantes spécifiques, fondement de l'identité, sont négligées, passent à l'arrière-plan ou subissent un processus volontaire d'expurgation, le mouvement bascule dans l'inauthentique, dans la répétition stérile de poncifs fonctionnels sans âme puis dans le n'importe-quoi et dans la corruption. Ainsi, l'abandon par les forces socialistes des linéaments nationalistes, identitaristes, wagnériens et nietzschéens a conduit le mouvement socialiste à l'impasse qu'il connaît aujourd'hui : être un mouvement gestionnaire de la gabegie dominante, incapable d'affronter le néo-libéralisme, être un mouvement qui se contente de survivre ou être un mouvement anti-démocratique qui oblitère la variété nécessaire des réalités sociales, estime être l'horizon indépassable de l'humanité (dans ce cas, l'horizon n'est guère éloigné…), impose une forme ou une autre de “pensée unique”.
◊ Le Programme de Linz, la volonté de faire participer les masses par le théâtre, les manifestations chantées ou les processions comme le Volksfeiertag de Vienne lors de la lutte pour le suffrage universel, sont des mixtes audacieux et efficaces de populisme actif, un vrai socialisme. Sans ces dimensions, le socialisme est une imposture.
◊ Une révolution conservatrice réelle doit se vouloir un retour à cette forme de socialisme, postuler à nouveau l'usage des “paroles fortes” ou des “paroles âpres”, se remémorer la notion de “cri d'appel” (Weckruf) telle que l'avait forgée Victor Adler, remettre à l'honneur la pratique des défilés de masse dans la dignité. Une telle révolution conservatrice serait civile, instrumentalisable contre le néo-libéralisme. Personne ne pourrait incriminer une telle idéologie révolutionnaire-conservatrice, puisque l'incriminer équivaudrait à incriminer le mouvement socialiste et démocratique (suffrage universel, journée des huit heures), dont se réclame la “correction politique” actuelle, alors que sa rigidité et sa répétitivité sont le déni absolu du fondement identitariste, de la dynamique de base, de ce mouvement dans sa phase ascendante. Les champions de la “pensée unique”, de la “bien-pensance” (Elizabeth Lévy), de la “political correctness”, rejettent comme “fascistes”, “fascistoïdes” ou “fascistogènes” les éléments qui ont donné au mouvement socialiste et démocratique leur plus forte impulsion, leur dynamique ascendante. C'est la preuve qu'ils ne sont pas démocratiques, parce que sans ces éléments jugés “fascistes” par les terribles simplificateurs d'aujourd'hui, le mouvement démocratique n'aurait jamais connu le succès. L'objectif des champions de la “bien-pensance” est d'éradiquer dans la Cité tout ferment de dynamisme, de clore le bec aux citoyens et d'asseoir définitivement la gabegie dominante, d'en faire l'horizon indépassable de l'histoire.
Robert STEUCKERS.
(Forest/Flotzenberg, Vlotho im Wesergebirge, juillet/août 2001).
Notes:
◊ 1. La volonté de détacher les Allemands d'Autriche, voire l'ensemble des peuples de Cisleithanie (Tchèques, Italophones du Trentin, Slovènes et Allemands) de la partie de l'Empire réunie à la Couronne de Hongrie (Hongrois, Slovaques, Croates) ruine la perspective danubienne de l'histoire allemande. Cette idée, tout à la fois folciste, au sens où l'entendait Herder, et moderne, est en contradiction avec la mission confiée au Traité de Verdun à Louis le Germanique (Ludwig der Deutscher) en 843. Louis avait reçu la mission de conquérir le cours du Danube pour restaurer l'impérialité romaine dans sa plénitude. Le détenteur du titre de Kaiser, Lothaire (Lothar), avait reçu cette dignité parce qu'il régnait sur les deux fleuves qui avaient donné à Caius Julius, de la gens julia, la dignité de Caesar : le Rhône, le Rhin (et dans une moindre mesure le Pô). Abandonner cette perspective d'un bassin danubien unifié est une négation de l'héritage romain, donc de l'avenir européen. C'est évidemment un point du programme du Groupe Pernerstorfer que nous ne saurions partager.
◊ 2. Après que l'Empire austro-hongrois soit devenu “dualiste” en 1867, on a eu coutume d'appeler Cisleithanie la partie occidentale, essentiellement allemande, mais aussi tchèque, avec pour villes principales Prague, capitale du Royaume de Bohème, et Vienne, capitale de l'Autriche et résidence de l'Empereur. Le parlement des peuples de Cisleithanie siégeait à Vienne. Celui de la Transleithanie à Budape
05:10 Publié dans Histoire, Politique, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 juin 2007
Mouvement métapolitique à Vienne (19ième) (I)
Le mouvement métapolitique d'Engelbert Pernerstorfer à Vienne à la fin du 19ième siècle, précurseur de la "révolution conservatrice" (PREMIERE PARTIE)
Intervention de Robert Steuckers lors de la 9ième Université d'été de l'association «Synergies Européennes», Région de Hanovre, août 2001
Analyse :
William J. McGRATH, Arte dionisiaca e politica nell'Austria di fine Ottocento, Einaudi Editore, Torino, 1986 (Original anglais : Yale University Press, 1974), ISBN 88-06-59147-9.
Bret BATTEY, The “Pernerstorfer Circle”, http://faculty.washington.edu/vienna/projects/pern/
Sur Siegfried Lipiner : http://www.bautz.de/bbkl/l/lipiner.shtml
Sur Richard von Kralik : http://www.bautz.de/bbkl/k/Kralik.shtml
Pourquoi avoir choisi cette thématique? Pourquoi avoir ressorti un auteur quasiment oublié? La première raison qui m'a poussé à opérer ce choix et à vous présenter les initiatives d'Engelbert Pernerstorfer c'est justement que le concept de "révolution conservatrice" m'apparaît désormais trop restreint, trop limité, surtout dans le temps. Cinq faisceaux de motivations m'ont amené à réétudier, à partir des recherches de deux Américains, William McGrath et Bret Battey, les activités métapolitiques de la Vienne des trois dernières décennies du 19ième siècle et d'en dégager des idées que l'on peut considérer comme les prémisses —ou comme certaines prémisses— de la future "révolution conservatrice".
◊ La période choisie par Armin Mohler est limitée: elle va de 1918 à 1932, soit une période de quatorze années, qui est trop particulière, trop marquée par la défaite de 1918, par les clauses du Traité de Versailles de 1919, par les débordements proches de la guerre civile (Putsch de Kapp, intervention des Corps francs à Munich, dans la Ruhr et en Silésie), pour offrir une alternative complète au système pour une période non effervescente. Qui plus est, les racines des idées développées par les principaux protagonistes de la "révolution conservatrice" de 1918 à 1932, plongent dans une antériorité qu'il convient également d'explorer. Cette remarque n'enlève rien au mérite de Mohler et à l'excellence de son travail encyclopédique. Mon objectif est de donner une dimension temporelle plus profonde à son concept de "révolution conservatrice", ce qu'il entendait amorcer lui-même, notamment en accueillant favorablement les travaux de Zeev Sternhell.
Réflexions sur les vertus soldatiques
◊ L'accent de la "révolution conservatrice" après 1918 est tout naturellement mis sur les vertus "soldatiques" qui ont été cultivées pendant la première guerre mondiale et se sont avérées nécessaires pour éloigner le danger bolchevique des frontières de l'Allemagne en Silésie et dans l'espace des Pays Baltes et pour le conjurer à l'intérieur même du Reich, notamment dans la Ruhr, à Berlin et à Munich. La figure du combattant de la Grande Guerre est évoquée, de manière sublime, dans l'œuvre d'Ernst Jünger et dans celle de Schauwecker; la figure du combattant des Corps Francs dans les ouvrages d'Ernst von Salomon. Dans l'espace idéologique de la "nouvelle droite" française, avant que celle-ci ne titube d'une démission et d'un aggiornamento à l'autre, Dominique Venner a introduit cette thématique dans un livre à grand tirage : Baltikum. Dans le Reich de la défaite, le combat des Corps-francs. 1918-1923, Robert Laffont, Paris, 1974. Ultérieurement, une version de ce titre est parue dans “Le Livre de Poche”. Sur le même thème, D. Venner a fait paraître plus récemment : Histoire d'un fascisme allemand. Les Corps-francs du Baltikum. Du Reich de la défaite (1918) à la Nuit des Longs Couteaux (1934), Pygmalion/Gérard Watelet, Paris, 1996.
Déjà lors mon intervention dans un colloque d'orientation idéologique, tenu dans une auberge de la Lande de Lüneburg, au début de l'aventure de «Synergies Européennes» en Allemagne, j'avais souligné l'intérêt politique qu'il y avait de suggérer à nos contemporains un projet révolutionnaire-conservateur, qui soit général et civil et non plus seulement soldatique, vu que cet idéal soldatique ne permet plus aujourd'hui de pénétrer les mentalités des masses, celles-ci n'étant plus du tout pétries de cet idéal, du fait de l'éloignement temporel qui nous sépare désormais, de plus en plus, de cette "période axiale" du 20ième siècle (pour reprendre une expression chère à Karl Jaspers, à Armin Mohler et à Raymond Ruyer). Ce qui n'ôte évidemment rien à l'importance intrinsèque et primordiale que revêt une lecture, dans l'adolescence et au début de l'âge adulte, de cette geste héroïque contemporaine, notamment via les livres d'Ernst von Salomon et l'étude de Dominique Venner.
◊ Du fait des impératifs qu'impose la rédaction d'une thèse, comme celle de Mohler, à cause aussi d'un excès d'attention accordé dans certains milieux —cherchant à continuer la "révolution conservatrice"— à l'aspect héroïque de la seule geste soldatique de 1918-1919, la révolution conservatrice historique, réduite à la période étudiée par Mohler, semble une sorte de météorite qui traverse trop rapidement le ciel, un phénomène sans antériorité ni profondeur temporelle. En rester à un tel jugement conduit à une insuffisance doctrinale, à une mutilation idéologique, à une coupure incapacitante. En guise de palliatif, le présent exposé a pour objectif premier de conseiller la lecture de travaux universitaires, généralement anglo-saxons, comme ceux de William McGrath (réf. infra) sur Vienne, que je vais aborder ici, et de David Clay Large sur Munich, que j'aborderai ultérieurement. William McGrath explore l'époque qui va de 1865 à 1914 à Vienne. David Clay Large analyse les vicissitudes culturelles et politiques qui secouent la vie publique à Munich entre 1890 et 1945 (nous nous bornerons à présenter la période qui va de 1890 à 1920, car c'est elle qui nous instruit clairement sur les évolutions idéologiques à l'œuvre dans la capitale bavaroise).
La nostalgie d'une unité idéologique perdue
◊ Après la lecture de ces ouvrages anglo-saxons, nous sommes amenés à constater qu'il n'y avait pas de clivage gauche/droite bien tranché avant la prise de Munich par les Corps Francs en 1919. Ce clivage, aujourd'hui réel, est né du choc frontal entre ces volontaires nationalistes et les gardes rouges de la République des Conseils; une césure binaire, parfaitement tranchée, n'existait pas auparavant. Avant les événements tragiques de Munich (et de Berlin) en 1918 et 1919, les composantes idéologiques, devenues antagonistes, ont connu un stade de “fusion” où elles se mêlaient dans des synthèses civiles, non idéologisées comme dans les années 20, 30 et 40 du 20ième siècle. Cette fusion, perceptible dans les débats de Vienne à la fin du 19ième, à Munich de 1890 à 1914 ou à Bruxelles avec des figures comme Victor Horta ou Charles Buls à la même époque, a suscité des nostalgies —nostalgies d'une unité perdue— que l'on repère dans certains linéaments du complexe “national-bolchevique” (autour d'Ernst Niekisch et de ses revues), dans les tentatives de restaurer un esprit communautaire contre la pesanteur des masses dans le socialisme marxiste ou contre l'individualisme forcené des libéralismes, dans les rangs du Wandervogel ou des mouvements de jeunesse qui ont pris sa succession après 1918, dans le socialisme libertaire préconisé par Gustav Landauer ou, en filigrane, dans l'œuvre de Walter Benjamin, qui a mûri, elle aussi, dans le Schwabing de la Bohème littéraire munichoise.
◊ La saisie en profondeur des racines de notre temps, du contexte idéologique très dense de cette époque qui s'étiolera après la révolution bolchevique, la prise du pouvoir par Hitler et la fin de la seconde guerre mondiale, passe par la nécessité de s'adonner —et de manière intense— à des lectures parallèles, ce qui, hélas, n'a jamais été fait dans notre courant de pensée, où trop souvent, les jugements à l'emporte-pièce ou le culte des chromos figés n'ont cessé de tenir le haut du pavé. Ces lectures parallèles, indispensables à la bonne compréhension des racines de notre temps, impliquent de lire conjointement
◊ 1. les travaux de Zeev Sternhell et de Steve Ashheim, tous deux chercheurs de l'école californienne et israélienne,
◊ 2. l'histoire des mouvements artistiques à Bruxelles et à Vienne (avec l'accent sur le Jugendstil et la Wiener Sezession),
◊ 3. l'histoire du mouvement pré-raphaëlite en Angleterre, avec étude de l'œuvre de Ruskin, du “Fabian Socialism”, des ouvrages de Matthew Arnold et de Thomas Carlyle et surtout impliquent
◊ 4. d'acquérir une bonne connaissance des productions de la maison d'édition d'Eugen Diederichs à Leipzig et Iéna, où l'on a traduit et commenté ces œuvres et où l'on a approfondi ces thématiques.
Méconnaissance des corpus philosophiques qui sous-tendent la “révolution conservatrice”
La première étape dans cette enquête, dans cette historia au sens grec du terme comme nous le rappelle Michel Foucault et son exégète française, Angèle Kremer-Marietti, va nous conduire à Vienne, puis, seconde étape, à Bruxelles, et, troisième et quatrième étapes, à Munich et à Berlin. Car la notion d'enquête, d'historia, est à la base de la méthode archéologique et généalogique que nous ont léguée Wilhelm Dilthey et Friedrich Nietzsche, méthode archéologique/généalogique qui est la marque de l'épistémologie révolutionnaire-conservatrice. La méconnaissance de ce corpus, chez la plupart des exposants naïfs ou prétentieux d'une nouvelle “révolution conservatrice”, conduit à des apories, des quiproquos ou des “maculatures” sans nom. La “nouvelle droite”, et certains personnages qui l'ont animée, en ont donné le triste exemple pendant plus de trente ans. Personnages qui persistent dans leurs insuffisances. Et qui nous traitent d'“anarchistes”, à l'idéologie “peu claire” ou “peu sûre”, parce que nous remontons véritablement aux sources, des sources que, curieusement, ils ne veulent pas connaître, sans doute parce qu'elles les obligeraient à sortir de leurs chromos simplistes ou à relativiser leurs positions trop schématiques. Pire : citer Landauer, Benjamin et Foucault (même par le biais d'Angèle Kremer-Marietti) constitue un crime de “judéophilie” ou de “gauchisme” pour ces esprits bornés, qui osent ériger leurs tristes limites voire leurs obsessions ridicules au rang de paradigmes. Reproche d'autant plus infondé que des exposants non juifs, parfaitement “aryens”, ont défendu exactement les mêmes thèses ou positions. Ces paradigmes figés sont érigés en dogmes fixes, alors que l'objet même de nos préoccupations, la révolution conservatrice et ses antécédents, sont des phénomènes dynamiques, des dynamiques effervescentes, qui ont leur trajectoire; même si les limites de l'idéologie dominante actuelle et des sycophantes qui l'instrumentalisent bloquent ces dynamiques, elles ont encore des impacts, même si ces impacts ne sont plus des flots fougueux d'innovations, mais de minces filets qui ne cessent de filtrer, en dépit de tout : il suffit d'observer les succès de certaines expositions d'Europalia, sur Vienne ou sur d'autres villes, pour le constater. Une nostalgie indéracinable, bien qu'inconsciente ou fragmentaire, continue à attirer les foules vers les productions artistiques ou littéraires de cette époque, productions qui forment aussi l'arrière-plan politique des grands mouvements populaires de la fin du 19ième siècle.
La revue “Die Telyn” au Schottengymnasium de Vienne
Sortir des impasses de la clique parisienne qui prétend réincarner la “révolution conservatrice”, implique justement de poser une démarche archéologique/généalogique. Et cette démarche, pour le volet viennois de notre enquête, aboutit à étudier la trajectoire d'un personnage des plus intéressants : Engelbert Pernerstorfer. Il débute sa longue carrière politique et métapolitique en mars 1867, alors qu'il n'est encore qu'un modeste lycéen, inscrit dans une célèbre école de Vienne, le Schottengymnasium, tenu par des pères bénédictins. A l'origine, cette institution d'enseignement catholique avait été fondée par des religieux issus d'Irlande, qui avaient immigré en Europe centrale, sans doute en même temps que les “Oiseaux Migrateurs”, ces mercenaires irlandais mettant leur épée au service du Saint-Empire contre les ennemis de l'Europe. Engelbert Pernerstorfer et ses amis du Schottengymnasium fondent une revue pour exprimer leurs idées; elle porte le titre de Die Telyn, soit “La Harpe celtique”, clin d'œil, sans doute, à ces bénédictins d'Irlande venus jadis à Vienne, pour accompagner leurs compatriotes soldats. Mais une autre référence celtique anime les jeunes collégiens : la fête de l'Eisteddfodd gallois, remise à l'honneur au Pays de Galles à la fin du 18ième siècle, dans le cadre de ce que l'on a communément appelé le “Celtic Revival”. L'Eisteddfodd consistait en un festival de musique traditionnelle, avec récitations de poésie, avec chants puisant dans le patrimoine mythologique et national irlandais ou gallois. Le choix de l'instrument de musique symbolique de la Verte Eirinn et la référence à l'Eisteddfodd gallois indique clairement que nos collégiens du Schottengymnasium avaient un projet précis : revitaliser la culture populaire, remettre les racines à l'honneur à l'instar des celtisants gallois, afin d'amener, à terme, une révolution politique.
Nature, patrie, art
Dans ce premier groupe autour d'Engelbert Pernerstorfer, nous trouvons Victor Adler (d'ascendance israélite), Max Gruber et Heinrich Friedjung (également d'ascendance israélite). Pourquoi Pernerstorfer a-t-il immédiatement barre sur ses condisciples? Parce que son père a fait la révolution de 1848. Il est d'ascendance modeste. Il est un homme du peuple, alors que les familles des Adler, Gruber et Friedjung appartiennent à une bourgeoisie aigrie, mécontente du rythme trop trépident que prennent la révolution industrielle et la modernité. Pour nos quatre collégiens, trois valeurs doivent être sauvées, restaurées et portées au pinacle de la Cité : la nature, la patrie et l'art. Dans le concret, cela signifie quatre orientations politiques précises : 1) On s'oppose aux Habsbourgs, car on est pangermanique, on veut l'unification générale des Allemands ethniques, unification perçue comme un impératif de la nature; 2) On est socialiste, au sens où la révolution de 1848 a anticipé le mouvement socialiste et où la crise de l'ordre économique existant postule un changement allant dans le sens d'une redistribution plus juste et d'un dépassement du primat accordé par le libéralisme à l'économie et aux accumulations quantitatives de tous ordres. Le socialisme de ces lycéens est proche de celui de Ferdinand Lassalle, qui s'entendra avec Bismarck. Lassalle veut un socialisme étatique, c'est-à-dire un socialisme acceptant les correctifs de l'Etat; 3) On veut se dégager des conventions sociales, qui sont autant d'étouffoirs à la créativité; cette volonté de dégagement vaut autant pour les Catholiques, majoritaires en Autriche, que pour les Juifs ou les Protestants; 4) On veut instaurer une pédagogie, un système d'éducation, permettant à tous d'accéder aux hautes valeurs de la culture, car la culture, les arts et la littérature seront le ciment de la communauté nationale allemande, comme ils ont été le ciment de la conscience nationale et ethnique des Gallois.
Panthéisme irlandais et Nibelungen
Cette quadruple option, prise par notre quatuor de lycéens viennois, s'explique par la psychologie et par une idiosyncrasie particulière. Sur le plan psychologique, leur réaction est, dit McGrath, une réaction de fils contre le monde de leurs pères, en d'autres termes, une révolte juvénile qui anticipe celle du Wandervogel berlinois, né en 1896. McGrath ne formule au fond rien de bien original, sacrifie peut-être un peu trop aisément aux manies freudistes américaines; pour lui, les pères veulent un monde stable, figé, tandis que les fils, par définition —ce qui nous laisse sceptiques— un monde mouvant, effervescent. Sur le plan idiosyncratique, le Schottengymnasium, par le truchement de ses traditions pédagogiques, a provoqué tous les déclics idéologiques chez notre quatuor de lycéens. Ce refuge de bénédictins irlandais en Autriche véhiculait, volens nolens, une tradition irlando-écossaise, plus panthéiste que ne l'étaient les scolastiques de l'enseignement catholique habituel ailleurs en Europe. Ce panthéisme irlandais au sein d'un catholicisme continental, plus rationaliste, explique la double référence celtique : à la harpe (la telyn) et aux fêtes de l'Eisteddfodd gallois. Deux professeurs ont laissé une empreinte philosophique indélébile sur Pernerstorfer et ses jeunes amis, leur ont communiqué les linéaments d'une idéologie alternative : Hugo Mareta et Sigismund Gschwander. Le niveau de leur enseignement est très élevé, dans toutes les branches, mais le dénominateur commun du message que communiquent les pères, dénommés “Schotten”, est un ancrage dans le paysage, dans la terre des forêts entourant Vienne et dans le peuple qui véhicule des traditions authentiques, bien plus anciennes que les poncifs du libéralisme du 19ième. Hugo Mareta, germaniste, initie ses élèves à tous les arcanes des Nibelungen et les plonge dans un univers wagnérien.
Cette référence constante aux racines et à la nature amène les élèves du Schottengymnasium à percevoir le libéralisme ambiant comme une crise de civilisation passagère, comme une ère qu'il convient de dépasser. Pour effectuer la transition, il faut préparer une élite qui sache renouer avec la tradition antérieure. Mais cette élite ne devra pas se contenter de réminiscences stériles du passé, de répétitions interminables de ce qui a été (et ne sera plus) : elle est appelée, au contraire, à l'action politique concrète, qui consistera, dans un premier temps, à rechercher systématiquement des alternatives idéologiques à la fausse culture libérale.
Du lycée à l'université
Le temps du lycée est bref, pour tous les adolescents. La deuxième étape dans la trajectoire du groupe de Pernerstorfer se déroule à l'Université, où ils fondent, le 2 décembre 1871, le “Leseverein der deutschen Studenten Wiens” (= Cercle de lecture des étudiants allemands de Vienne), puis, dans la foulée, la “Burschenschaft Arminia” (la Corporation Arminia). Dans leur formulation, les écrits laissés par le Leseverein sont moins radicaux que ceux de Die Telyn. Mais leur niveau est forcément plus élevé, les rédacteurs acquérant sans cesse savoir et maturité.
Le Prof. McGrath, dans son enquête minutieuse, a retracé l'historique des conférences prononcées à la tribune du Leseverein, ce qui nous permet de mettre en exergue ses idées motrices, telles qu'elles sont apparues au fil du temps. McGrath nous rappelle un débat récurrent sur l'œuvre de Lorenz von Stein, professeur à Vienne jusqu'en 1885. Lorenz von Stein est considéré comme un “conservateur social”, cherchant à réduire la dépendance des ouvriers, en leur donnant un accès à la propriété et à l'instruction. La dépendance ouvrière s'est accrue après les révolutions bourgeoises, française et industrielle : elle est un fruit de la modernité et non pas un héritage de l'Ancien Régime, qui prévoyait des protections diverses pour les pauvres, souvent en nature (vivres, jouissance de logements individuels ou collectifs, terres de pâturages sur les communs, revenus allodiaux, droits de récoltes ou de ramassage divers, etc.). Lorenz von Stein critiquait les théories pré-communistes des théoriciens français (notamment Blanqui). Ce communisme, outrancier, ne peut déboucher que sur l'oppression généralisée et abstraite de tout le peuple et ne permet pas de construire un ordre économique capable de fonctionner sur le long terme. L'alternative, proposée par Lorenz von Stein, est une société organique axée sur le Bien Commun (concept hérité d'Aristote), qui combat l'égoïsme et l'individualisme.
Sur le plan pratique, la société organique et la notion aristotélicienne de Bien Commun induisent la nécessité d'améliorer les conditions de vie des ouvriers et de leur accorder une plus grande mobilité sociale, de permettre une circulation des élites plus fluide. Le socialisme ultérieur de Pernerstorfer et d'Adler découle davantage des idées conservatrices et aristotéliciennes de Lorenz von Stein que de Karl Marx. Et, in fine, tout socialisme efficace, tout socialisme réellement populaire ne fonctionne que sur base d'un héritage organique perceptible, ancien, ancré dans un tissu social, et non pas sur des innovations et des bricolages boiteux, nés de l'esprit de fabrication (Joseph de Maistre).
La référence schopenhauerienne de Karl Rokitansky
Le premier maître à penser philosophique du groupe est Arthur Schopenhauer. Dans le curriculum du Leseverein, ce sera un docteur en médecine, Karl Rokitansky, qui, par le biais de ses conférences, injectera les bases d'un schopenhauerisme pratique dans le corpus doctrinal du groupe. Rokitansky part de l'idée de la solidarité générale unissant toute la vie animale. Il énonce, à partir de cette idée tirée d'une lecture de Schopenhauer, une théorie biosociale, certes darwinienne en même temps que schopenhauerienne, mais solidariste et non pas compétitive. La solidarité, réclamée par Rokitansky, dérive de la notion (bouddhiste) de compassion, énoncée dans l'œuvre de Schopenhauer. L'homme doit dépasser les pulsions négatives qui le poussent à agresser ses concitoyens, à l'égard desquels il doit se montrer solidaire, afin de consolider le Bien Commun. Le schopenhauero-darwinisme de Rokitansky conduit à affirmer un altruisme solidaire, dont le ciment est la culture, qu'il s'agit de défendre et de développer, surtout au sein des masses déshéritées par les pratiques du libéralisme.
Le conférencier Theodor Meynert, psychiatre, va communiquer aux étudiants du Leseverein un corpus reposant à la fois sur Kant et sur Schopenhauer (un corpus qui sera repris plus tard par Konrad Lorenz). Pour Kant, expliquait Meynert, il existe un moi primaire et égoïste et un moi secondaire et abstrait, capable de recul. Ce recul permet la civilisation, induit la solidarité réclamée par son collègue Rokitansky, mais que Meynert appelle le “mutualisme”, idéologie dont la vocation est de réaliser la fraternité. Nous constatons donc que l'époque connaît deux variantes de darwinisme, le darwinisme libéral axé sur la concurrence et le darwinisme solidariste et mutualiste, axé sur la coopération et l'altruisme, deux vertus politiques qui consolident le Bien Commun et rendent les sociétés, qui les pratiquent, plus fortes.
Le scandale von Ofenheim
Ex cursus : Au moment où les étudiants du Leseverein planchaient sur les idées de Lorenz von Stein et écoutaient les conférences de Rokitansky et Meynert, éclate en Autriche, en 1875, un scandale emblématique, celui provoqué par les manigances du financier véreux Victor von Ofenheim. Ce noble dévoyé avait spéculé sur les chemins de fer en Galicie, vendu des actions gonflées démesurément, promis des dividendes pharamineux, attiré par ses leurres des milliers de gogos qui ont évidemment été ruinés. Cité en justice par les actionnaires floués, von Ofenheim entend le Comte Lamezan, véritable aristocrate de robe, prononcer contre lui un réquisitoire sévère. Le Comte Lamezan, proche à certains égards des étudiants du Leseverein, estime que le procès qui se déroule est emblématique : il met en exergue la contradiction —apparemment insoluble— qui existe entre l'éthique et l'économie. Mais en dépit du brillant réquisitoire de Lamezan, von Ofenheim gagne le procès; il déclare, via son avocat, qu'“avec la morale, on ne construit pas de chemins de fer”. Les étudiants, mutualistes, constatent avec énormément d'amertume : «Le système libéral est mauvais, puisqu'il s'avère incapable de sanctionner des activités aussi immorales». L'avocat de von Ofenheim s'en était tiré par une pirouette, en disant qu'il existait certes des tribunaux terrestres pour sanctionner des délits, mais que seul le tribunal céleste pouvait sanctionner l'immoralité.
Troisième orateur de marque dans le Leseverein, le philosophe Johannes Volkelt qui proposera aux étudiants viennois une synthèse entre Kant, Hegel, Schopenhauer et von Hartmann. Le titre de sa première conférence indique qu'il part résolument de Kant : “Kants kategorischer Imperativ und die Gegenwart” (= L'impératif catégorique de Kant et les temps présents). Volkelt avait commencé sa conférence en rappelant que le sujet connaissant (tel que défini par Kant) est instable, vu les limites de ses capacités cognitives. L'homme, sujet connaissant, est jeté dans un monde instable (en ce sens, il préfigure Heidegger). Pour pallier cette instabilité, l'homme doit respecter un code moral extrêmement rigoureux, qui lui donne les recettes de la survie et de la navigation sur la mer, souvent déchaînée, des circonstances existentielles (plus tard Arnold Gehlen parlera de "culture", comme système de palliatifs pour consolider la position de l'homme, être fragile quant à ses dons et capacités naturels). L'exigence morale de Kant est terrible. Elle postule de dépouiller systématiquement l'agir éthique de tout désir, de toute aversion, de tout affect. L'éthique qui en résulte est certes tranquille, mais elle est le résultat d'une lutte perpétuelle que l'homme a à mener contre lui-même. Finalement, ce n'est qu'au terme de cette âpre lutte qu'il est capable d'affirmer pour lui-même et pour les autres, une véritable autonomie. L'autonomie est atteinte seulement quand tous les affects incapacitants, distrayants, dissipants, sont éliminés (cette position de Volkelt est à mettre en parallèle avec la théorie de l'“individu absolu” de Julius Evola).
Volkelt contre l'amollissement généralisé
Au nom de la morale kantienne, Volkelt condamne, devant ses auditeurs du Leseverein, la société contemporaine, parce qu'elle est axée sur la commodité (la Bequemlichkeit), qui, elle, abandonne par principe toute lutte. Volkelt condamne aussi l'orientation des sciences et des techniques de l'époque, dans le sens où elles conduisent à la facilité, qui ruine et fait disparaître la vigueur et l'indépendance de l'homme, par ailleurs garantes dans la durée de son autonomie. Quand il chavire dans la facilité, l'homme abandonne son trésor le plus sacré : l'autonomie. Le jugement de Volkelt est sans appel : “Wir leben in einer Zeit allgemeiner Auspolsterung” (= Nous vivons une époque d'amollissement généralisé) (à lire en parallèle avec Die Perfektion der Technik de Friedrich Georg Jünger). La civilisation moderne, pour Volkelt, conduit donc à la superficialité spirituelle, à la légèreté et à la futilité, où les idéaux sont bannis, où la moralité n'est plus qu'une simple convention, où l'opportuniste est roi. L'affaire von Ofenheim l'a clairement démontré.
L'objet de la métapolitique (et le terme n'est pas anachronique comme nous allons le voir) est de forger une nouvelle éthique, contraire diamétral du libéralisme, de jeter les bases d'un nouvel ordre social et de restaurer le Bien Commun. Par conséquent, il faut remplacer l'individualisme matérialiste des libéraux classiques par une sorte de collectivisme idéaliste, où les salaires et les profits sont proportionnels au travail réellement presté, où les hommes sont animés par la conscience de faire quelque chose d'utile au Bien Commun, et ne poursuivent pas le but pervers de l'enrichissement personnel.
De Kant au binôme Wagner / Nietzsche
Par la suite, le Leseverein abandonne progressivement le kantisme pour adopter les idées de Wagner et de Nietzsche, surtout celles qui évoquent une “métaphysique de l'artiste” (dans le cadre de la “nouvelle droite”, qui n'a jamais évoqué l'œuvre de Pernerstorfer, seul Giorgio Locchi a abordé la relation complexe entre Nietzsche et Wagner).
C'est Victor Adler qui, le premier, a introduit Nietzsche dans le groupe qui participait à la rédaction de Die Telyn. Mais, il s'agissait du premier Nietzsche, pour qui l'art joue un rôle central, constitue la véritable activité métaphysique. La musique, pour ce premier Nietzsche, exprime une volonté collective non individualiste, elle est l'expression d'une sapience, d'une sagesse dionysiaque, présente dans le théâtre d'Eschyle et de Sophocle. Pour rappel, chez ce premier Nietzsche, le théâtre grec constitue une communion de l'homme avec sa propre communauté et avec la nature. Dans la dialectique Apollon / Dionysos, que ses livres sur la tragédie grecque explicitent, un surplus d'apollinisme conduit à la sclérose (comme à Rome), tandis que l'irruption permanente et ininterrompue du dionysiaque donne force et vitalité à la Cité. La Polis grecque, pour Nietzsche, fusionne ses éléments épars, ses différences de classe ou d'origine, dans la communauté mystique du rite dionysiaque. Si le flot dionysiaque vient à s'amenuiser, la Cité entre en déclin, comme ce fut effectivement le cas à partir d'Euripide. Nous assistons alors à l'assèchement des sources organiques, tant et si bien que l'homme de la période hellénistique est devenu trop “théorique”. Le bon fonctionnement de la Cité, hier en Grèce, à l'époque d'Adler et Pernerstorfer dans le monde germanique, implique de limiter l'extension des formes découlant du logos. L'Allemagne a pour mission de corriger par la musique une civilisation qui sombre dans un excès de logos. La musique allemande est l'élément dionysiaque, donc la source vitale, de la culture germanique d'Europe centrale. La fusion communautaire dans la Cité s'opère donc par la voie artistique et non pas par la raison économique.
La métaphysique des artistes et des long-voyants
Adler, comme Nietzsche, appelle l'avènement d'une “métaphysique de l'artiste” (Artistenmetaphysik). Le surhomme de la métaphysique de l'artiste est celui qui s'est auto-transcendé par la création artistique (lato sensu). Il a généré des formes éternelles, a ainsi dépassé la finitude du physique. Nietzsche évoque la nécessité de créer des institutions ou des agences capables de promouvoir les activités de ces créateurs de formes. Ces institutions doivent permettre de voir plus loin et plus clair, les deux valeurs cardinales d'une réforme profonde de l'enseignement et de la société en général sont la clairvoyance et le sens du long terme. Ceux qui participent à des cercles “long-voyants”, comme ceux d'Adler et de Pernerstorfer, doivent se former eux-mêmes et préparer l'avènement d'êtres géniaux, les aider à faire mûrir leurs œuvres. Cette optique vaut sur le plan artistique et littéraire, mais aussi sur le plan politique : il faut faire émerger une capacité de décision, étrangère et différente de l'esprit dominant de l'époque (matérialiste, positiviste, économiciste). L'optique nietzschéenne de Victor Adler entend maintenir intacte la force, la puissance des passions, génératrices de formes esthétiques ou de volontés politiques au service du Bien Commun (cette intuition du jeune Victor Adler est à mettre en parallèle avec l'œuvre de ce dissident russe, décédé trop tôt en 1992, Lev Goumilev, théoricien de la “passionalité” des peuples jeunes et dynamiques; l'estompement des passions conduisant au déclin irrémédiable).
La troisième étape du groupe “Telyn”, dans sa forme initiale, commence le 18 décembre 1878 quand est prononcée la dissolution du Leseverein. Nos jeunes hommes quittent l'Université et se réunissent dans les cafés viennois. Une partie du groupe devient activiste politique avec Adler, Pernerstorfer et Friedjung. Une autre partie décide de s'adonner à l'esthétique, avec Lipiner, von Kralik, Wolf et celui qui deviendra le grand compositeur autrichien Gustav Mahler (auquel le père de Victor Adler avait acheté son premier piano). Les esthètes se réunissent au sein du Gralbund (La Ligue du Graal), fondé en 1905, principalement sous l'impulsion de Richard von Kralik. Cette “Ligue du Graal” est in fine d'inspiration catholique, même si elle mêle à son catholicisme des éléments traditionnels non spécifiquement chrétiens.
Ainsi, les activistes s'entendent autour du “Programme de Linz”, à la fois socialiste et nationaliste, et dont les éléments “nationalistes” sont surtout portés par Friedjung, d'origine israélite. Friedjung entend défendre la langue allemande et milite pour une diminution, sinon une disparition, des taxes levées dans les classes pauvres. Parallèlement aux efforts d'Adler, Pernerstorfer et Friedjung, Georg von Schönerer, socialiste, pangermaniste et antisémite, développera une synthèse plus âpre, plus populiste. Les esthètes se veulent tout à la fois prêtres et poètes, entendent gérer la “passionalité”, la conduire sur des chemins positifs, en faire un ciment de cohésion pour le Bien Commun. Dans ce contexte, Richard von Kralik, dans le cadre du Gralbund, vise à rénover la culture européenne par un recours permanent aux idées-forces de l'antiquité, de la germanité, du christianisme médiéval et de la tradition des mystères, le tout s'inscrivant naturellement dans le cadre du national-catholicisme autrichien.
Richard von Kralik et les “esthètes pythagoriciens"
L'itinéraire de Richard von Kralik est intéressant pour saisir l'évolution des esprits et la synthèse que ceux-ci finissent par proposer dans le cadre de la culture germanique du 19ième siècle. En 1876, deux ans avant d'entrer dans le groupe de Pernerstorfer, von Kralik étudiait à Berlin chez Theodor Mommsen, le spécialiste de la Rome antique à l'époque, et assistait aux leçons de Treitschke et de Hermann Grimm. Il est socialiste, milite au parti, dévore l'œuvre complète de Ferdinand Lassalle, se frotte à l'idéologie marxiste en pleine maturation. En 1878, quand Siegfried Lipiner, ami de Wagner et futur rédacteur des Bayreuther Blätter, l'introduit dans le cercle de Pernerstorfer, il commence à lire Nietzsche, s'enthousiasme pour Wagner, de concert avec Gustav Mahler. Mais la rupture entre Nietzsche et Wagner créera une importante polarisation dans le groupe : les uns acceptent le wagnérisme mystique de la fin, curieux mixte de Schopenhauer, de théorie musicale et de mystique chrétienne, dont Kralik et Mahler. D'autres suivent les critiques de Nietzsche, estimant que Wagner avait subi une “involution”, et que le complexe idéologique de socialisme chrétien et mystique, assorti d'une option végétarienne (que Wagner déclarait “pythagoricienne”), n'avait aucun avenir, n'était qu'une illusion pseudo-religieuse parmi bien d'autres.
« L'homme fort est en mesure de créer pour lui-même une réalité idéale »
Un clivage net commence à séparer les esthètes (pythagoriciens) des activistes. Les wagnéristes végétariens, autour de Kralik, Mahler et Lipiner, considèrent comme totalement futiles les questions d'ordre politique. Richard von Kralik justifie ses positions anti-politiques par une révélation, qu'il aurait eue à la suite d'une dépression : il nie désormais l'existence d'une réalité plus parfaite au-delà du monde sensible des phénomènes. Face à la crise de son ami, Lipiner écrit à Nietzsche, au philosophe naturaliste, tellurique et mystique Gustav Theodor Fechner et à Paul de Lagarde, pour qu'ils fassent en sorte que Kralik change d'avis. Seul Lagarde répondra. Et obtiendra des résultats : Kralik admet à nouveau l'existence d'une sphère idéale transcendant la réalité quotidienne, mais le lien que cette sphère transcendante peut entretenir avec notre monde, passe par la médiation de la mythologie et de la symbolique germaniques, seules capables de faire miroiter l'idéal caché dans le réel. Mais Kralik refuse toujours la politique : «L'homme d'Etat doit savoir que toutes ses luttes ne lui apporteront aucun résultat». Finalement Kralik et Lipiner conviennent qu'aucune alternative valable ne s'offre à l'imperfection du réel; l'homme fort est en mesure de créer pour lui-même une réalité idéale. Ces positions, partagées par nos deux hommes, conduisent à la création en 1881 de la Sagengesellschaft (La Société de la Saga). Elle accueillera ceux qui, par esthétisme, refusent l'engagement politique, fuient la réalité et la sphère publique pour se consacrer à l'art. Lipiner : «Pour nous, le royaume des formes n'est pas un monde merveilleux qui existe pour que l'on s'évade de la vie; pour nous, ce monde est la vraie vie, ou, alors, rien n'est rien».
Pour un art authentique et unitaire
Richard von Kralik décrit l'objectif de la “Société de la Saga”: «L'objectif le plus important me semble le suivant : assurer à notre nation un substrat culturel épique comparable à celui qu'avaient les Grecs, les Indiens et les Perses; par ce projet, nous devons donner une unité à notre héritage de sagas sur les dieux et les héros, comme l'avaient fait Homère, Hésiode et Ferdawsi» (nous reprenons la transcription de ce nom persan, telle que nous l'a léguée Henry Corbin). Cette volonté de retrouver le noyau commun des mythologies indiennes, persanes, grecques et germaniques dérivent d'une lecture de Religion und Kunst de Wagner. La référence à la Perse vient très certainement de Gobineau. La mise en exergue du noyau commun à ces mythologies indo-européennes permettra, pensent les membres de la “Société de la Saga”, de créer un “art authentique et unitaire”. Telle est la mission qu'ils se donnent, à la suite des recommandations de leur maître Richard Wagner. Tâche évidemment titanesque. Mais Richard von Kralik ne baissera pas les bras. Successivement, il s'intéressera aux mystères médiévaux, à la constitution d'un corpus aussi complet que possible des sagas et mythes germaniques, à la quête du mythe faustien dans ses formes originelles, à la poésie de Dante, etc.
L'idéal de Kralik est de faire ré-émerger une culture régénérée, inspirée des mythes, capable de comprendre et de faire comprendre, par ses symboles, ce qui transcende les simples phénomènes. Son intérêt pour le mythe de Faust le conduit, paradoxalement, à prendre des positions anti-faustiennes et à vouloir substituer à la culture faustienne, qu'il qualifie d'aveugle et d'insatiable, une “culture du Graal”, dont Parsifal, héros wagnérien et pur idéaliste (reiner Tor), est le symbole. Cette culture du Graal correspond évidemment aux derniers idéaux de Wagner: mélange de schopenhauerisme, de mystique néo-chrétienne et de compassion bouddhiste.
(A SUIVRE DANS NOS EDITIONS QUOTIDIENNES ULTERIEURES).
06:05 Publié dans Histoire, Philosophie, Politique, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 juin 2007
Petite note sur Wilhelm Stapel

Robert Steuckers:
Petite note sur Wilhelm Stapel
1 juin 1954 : Mort à Hambourg de Wilhelm Stapel. Stapel a commencé sa carrière au sein de la famille politique libérale en Allemagne, mais dans la faction de celle-ci qui était animée par Friedrich Naumann, c'est-à-dire la faction qui avait un sens social aigu et militait en faveur d'un marché commun étendu à l'ensemble de la Mitteleuropa. Cette version non manchestérienne du libéralisme allemand prendre une coloration sociale-nationale, qui s'exprimait dans le “Dürerbund” (= Fédération Dürer) de Ferdinand Avenarius. Plus tard, pour donner corps à son engagement, Stapel s'occupe de la formation de la jeunesse en milieu ouvrier. Il devient ensuite le rédacteur en chef de la revue Deutsches Volkstum, où, dans les années 20, il développera une critique de la démocratie occidentale jugée trop formelle et inorganique. Pour réaliser en Allemagne une démocratie idéale, il faudrait une constitution présidentialiste (à la façon gaullienne dirait-on, sans risquer de faire un anachronisme trop maladroit), un mode de suffrage échelonné et une représentation corporatiste. Un tel corpus n'avait aucune chance de s'ancrer dans les masses. Dans les années 30, Stapel développe une “théologie” du nationalisme allemand, lequel doit déboucher sur une vision impériale et non plus simplement nationaliste. Ses relations avec le national-socialisme seront assez conflictuelles, mais son système de pensée était trop hétérogène par rapport au régime de 1949 pour qu'il ait vraiment été réhabilité.
06:10 Publié dans Biographie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 mai 2007
Note sur le Prince Karl Anton Rohan

Note sur le Prince Karl Anton Rohan, catholique, fédéraliste, européiste et national-socialisteµ
Né le 9 septembre 1898 à Albrechtsberg et décédé le 17 mars 1975 à Salzbourg, le Prince Karl Anton Rohan fut un écrivain et un propagandiste de l'idée européenne. Jeune aristocrate, ce sont les traditions "noires et jaunes" (c'est-à-dire impériales) de la vieille Autriche des familles de la toute haute noblesse qui le fascinent, lui, issu, côté paternel, d'une famille illustre originaire de Bretagne et, côté maternel, de la Maison des Auersperg. Il a grandi à Sichrow dans le Nord-est de la Bohème. Marqué par la guerre de 1914, par les expériences de la révolution bolchevique à l'Est et de l'effondrement de la monarchie pluriethnique, Rohan décide d'œuvrer pour que se comprennent les différentes élites nationales d'Europe, pour qu'elles puissent se rapprocher et faire front commun contre le bolchevisme et le libéralisme.
Après la fondation d'un "Kulturbund" à Vienne en 1922, Rohan s'efforcera, en suivant un conseil de J. Redlich, de prendre des contacts avec la France victorieuse. Après la fondation d'un "comité français" au début de l'année 1923, se constitue à Paris en 1924 une "Fédération des Unions Intellectuelles". Son objectif était de favoriser un rassemblement européen, Grande-Bretagne et Russie comprises sur le plan culturel. Dans chaque pays, la société et les forces de l'esprit devaient se rassembler au-delà des clivages usuels entre nations, classes, races, appartenances politiques et confessionnelles. Sur base de l'autonomie des nations, lesquelles constituaient les piliers porteurs, et sur base des structures étatiques, devant constituer les chapiteaux, des "Etats-Unis d'Europe" devaient émerger, comme grande coupole surplombant la diversité européenne.
Rohan considérait que le catholicisme sous-tendait le grand œcoumène spirituel de l'Europe. Il défendait l'idée d'un "Abendland", d'un "Ponant", qu'il opposait à l'idée de "Paneurope" de son compatriote Richard Coudenhove-Kalergi. Jusqu'en 1934, le Kulturbund de Rohan est resté intact et des filiales ont émergé dans presque toutes les capitales européennes.
Aux colloques annuels impulsés par Rohan (Paris en 1924, Milan en 1925, Vienne en 1926, Heidelberg et Francfort en 1927, Prague en 1928, Barcelone en 1929, Cracovie en 1930, Zurich en 1932 et Budapest en 1934), de 25 à 300 personnes ont pris part. Les nombreuses conférences et allocutions de ces colloques, fournies par les groupes de chaque pays, duraient parfois pendant toute une semaine. Elles ont été organisées en Autriche jusqu'en 1938. Dans ce pays, ces initiatives du Kulturbund recevaient surtout le soutien du Comte P. von Thun-Hohenstein, d'Ignaz Seipel et de Hugo von Hofmannsthal, qui a inauguré le colloque de Vienne en 1926 et l'a présidé. Les principaux représentants français de ce courant étaient Ch. Hayet, Paul Valéry, P. Langevin et Paul Painlevé. En Italie, c'était surtout des représentants universitaires et intellectuels du courant fasciste qui participaient à ces initiatives. Côté allemand, on a surtout remarqué la présence d'Alfred Weber, A. Bergsträsser, L. Curtius, Lilly von Schnitzler, le Comte Hermann von Keyserling, R. von Kühlmann et d'importants industriels comme G. von Schnitzler, R. Bosch, O. Wolff, R. Merton, E. Mayrisch et F. von Mendelssohn.
Rohan peut être considéré comme l'un des principaux représentants catholiques et centre-européens de la "Révolution conservatrice"; il jette les bases de ses idées sur le papier dans une brochure programmatique intitulée Europa et publiée en 1923/24. C'est lui également qui lance la publication Europäische Revue, qu'il a ensuite éditée de 1925 à 1936. Depuis 1923, Rohan était véritablement fasciné par le fascisme italien. A partir de 1933, il va sympathiser avec les nationaux-socialistes allemands, mais sans abandonner l'idée d'une autonomie de l'Autriche et en soulignant la nécessité du rôle dirigeant de cette Autriche dans le Sud-est de l'Europe. A partir de 1935, il deviendra membre de la NSDAP et des SA. En 1938, après l' Anschluß, Rohan prend en charge le département des affaires extérieures dans le gouvernement local national-socialiste autrichien, dirigé par J. Leopold. En 1937, il s'était fait le propagandiste d'une alliance entre un catholicisme rénové et le national-socialisme contre le bolchevisme et le libéralisme, alliance qui devait consacrer ses efforts à éviter une nouvelle guerre mondiale. Beau-fils d'un homme politique hongrois, le Comte A. Apponyi, il travaille intensément à partir de 1934 à organiser une coopération entre l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie.
Après avoir dû fuir devant l'avance de l'armée rouge en 1945, Rohan est emprisonné pendant deux ans par les Américains. Après sa libération, Rohan ne pourra plus jamais participer à des activités publiques, sauf à quelques activités occasionnelles des associations de réfugiés du Pays des Sudètes, qui lui accorderont un prix de littérature en 1974.
L'importance de Rohan réside dans ses efforts, commencés immédiatement avant la première guerre mondiale, pour unir l'Europe sur base de ses Etats nationaux. Très consciemment, Rohan a placé au centre de son idée européenne l'unité des expériences historiques et culturelles de l'Est, du Centre et de l'Ouest de l'Europe. Cette unité se retrouvait également dans l'idée de "Reich", dans la monarchie pluriethnique des Habsbourgs et dans l'universalisme catholique de l'idée d'Occident ("Abendland", que nous traduirions plus volontiers par "Ponant", ndt). Les besoins d'ordre culturel, spirituel, religieux et éthique devaient être respectés et valorisés au-delà de l'économie et de la politique (politicienne). Cet aristocrate, solitaire et original, que fut Rohan, était ancré dans les obligations de son environnement social élitiste et exclusif tout en demeurant parfaitement ouvert aux courants modernes de son époque. En sa personne, Rohan incarnait tout à la fois la vieille Autriche, l'Allemand et l'Européen de souche française.
Dr. Guido MÜLLER.
(entrée parue dans: Caspar von SCHRENCK-NOTZING (Hrsg.), Lexikon des Konservatismus, L. Stocker, Graz, 1996, ISBN 3-7020-0760-1).
06:00 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 mai 2007
Note sur Wilhelm Stapel
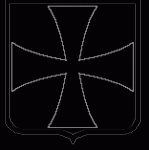
Note sur Wilhelm Stapel
Né le 27 octobre 1882 à Calbe dans l'Altmark et décédé le 1 juin 1954 à Hambourg, Wilhelm Stapel était un écrivain politique, issu d'une famille de la petite classe moyenne. Après avoir achevé des études de bibliothécaire et avoir passé son "Abitur" (équivalent allemand du "bac"), il fréquente les universités de Göttingen, Munich et Berlin et obtient ses titres grâce à un travail en histoire de l'art. Au départ, vu ses orientations politiques, il semble être attiré par le libéralisme, mais un libéralisme de facture spécifique: celui que défendait en Allemagne Friedrich Naumann. Son idée du nécessaire équilibre entre "nation" et "société" le conduit à rencontrer Ferdinand Avenarius et son "Dürer-Bund" (sa "Fédération Dürer") en 1911. Un an plus tard, Stapel devient rédacteur de la revue de cette fédération, Der Kunstwart. Il a conservé cette fonction jusqu'en 1917. A la suite d'une querelle avec Avenarius, Stapel réalise un vœu ancien, celui de passer à une activité pratique; c'est ainsi qu'il prend la direction du "Hamburger Volksheim" (le "Foyer du Peuple de Hambourg"), qui se consacrait à l'éducation de jeunes issus de milieux ouvriers.
A ce moment-là de son existence, Stapel avait déjà entretenu de longs contacts avec le "Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband" ("L'Association Nationale Allemande des Employés de Commerce"), et plus particulièrement avec sa direction, regroupée autour de M. Habermann et de Ch. Krauss, qui cherchaient un rédacteur en chef pour la nouvelle revue de leur association, Deutsches Volkstum. A l'automne 1919, Stapel quitte son emploi auprès du Volksheim et prend en mains l'édition de Deutsches Volkstum (à partir d'avril 1926, il partagera cette fonction avec A. E. Günther). Stapel transforme cette revue en un des organes de pointe de la tendance révolutionnaire-conservatrice. Il s'était détaché de ses anciennes conceptions libérales sous la pression des faits: la guerre d'abord, les événements de l'après-guerre ensuite. Comme la plupart des Jungkonservativen (Jeunes-Conservateurs), son attitude face à la nouvelle république a d'abord été assez élastique. Il était fort éloigné de l'idée de restauration, car il espérait, au début, que la révolution aurait un effet cathartique sur la nation. La révolution devait aider à organiser le futur "Etat du peuple" (Volksstaat) dans le sens d'un "socialisme allemand". Dans un premier temps, Stapel sera déçu par la rudesse des clauses du Traité de Versailles, puis par la nature incolore de la nouvelle classe politique. Cette déception le conduit à une opposition fondamentale.
Bon nombre de ses démarches conceptuelles visent, dans les années 20, à développer une critique de la démocratie "occidentale" et "formelle", qui devait être remplacée par une démocratie "nationale" et "organique". D'une manière différente des autres Jungkonservativen, Stapel a tenté, à plusieurs reprises, de proposer des esquisses systématiques appelées à fonder une telle démocratie. Au centre de ses démarches, se plaçaient l'idée d'une constitution présidentialiste, le projet d'un droit de vote différencié et hiérarchisé et d'une représentation corporative. Pendant la crise de la République de Weimar, Stapel a cru, un moment, que les "Volkskonservativen" (les "conservateurs populaires") allaient se montrer capables, notamment avec l'aide de Brüning (qui soutenait la revue Deutsches Volkstum), de réaliser ce programme. Mais, rapidement, il s'est aperçu que les Volkskonservativen n'avaient pas un ancrage suffisant dans les masses. Ce constat a ensuite amené Stapel à se rapprocher prudemment des nationaux-socialistes. Comme beaucoup de Jungkonservativen, il croyait aussi pouvoir utiliser la base du mouvement de Hitler pour concrétiser ses propres projets; même dans les premiers temps de la domination nationale-socialiste, il ne cessait d'interpréter le régime dans le sens de ses propres idées.
On trouve une explication aux illusions de Stapel surtout dans son ouvrage principal, paru en 1932 et intitulé Der christliche Staatsmann ("De l'homme d'Etat chrétien"), avec, pour sous-titre "Eine Theologie des Nationalismus" ("Une théologie du nationalisme"). Tout ce texte est marqué par une tonalité apocalyptique et est entièrement porté par un espoir de rédemption intérieure. Stapel, dans ce livre, développe la vision d'un futur "Imperium Teutonicum", appelé à remodeler le continent européen, tout en faisant valoir ses propres principes spirituels. Il y affirme que les Allemands ont une mission particulière, découlant de leur "Nomos", qui les contraint à apporter au monde un ordre nouveau. Cette conception, qui permet à l'évidence une analogie avec la revendication d'élection d'Israël, explique aussi pourquoi Stapel s'est montré hostile au judaïsme. Dans les Juifs et leur "Nomos", il percevait un adversaire métaphysique de la germanité, et, au fond, le seul adversaire digne d'être pris au sérieux. Mais Stapel n'était pas "biologisant": pendant longtemps, il n'a pas mis en doute qu'un Juif pouvait passer au "Nomos" germanique, mais, malgré cela, il a défendu dès les années 20 la ségrégation entre les deux peuples.
Le nationalisme de Stapel, et son anti-judaïsme, ont fait qu'il a cru, encore dans les années 30, que l'Etat national-socialiste allait se transformer dans le sens qu'il préconisait, celui de l'idéologie "volkskonservativ". C'est ainsi qu'il a défendu l'intégrité de Hitler et manifesté sa sympathie pour les "Chrétiens allemands". Cela lui a valu de rompre non seulement avec une bomme partie du lectorat de Deutsches Volkstum, mais aussi avec des amis de combat de longue date comme H. Asmussen, K. B. Ritter et W. Stählin. Ce n'est qu'après les pressions d'Alfred Rosenberg et du journal Das Schwarze Korps que Stapel a compris, progressivement, qu'il avait succombé à une erreur. La tentative de son ancien protégé, W. Frank, de lui procurer un poste, où il aurait pu exercer une influence, auprès de l'"Institut pour l'Histoire de la Nouvelle Allemagne" (Reichsinstitut für die Geschichte des neuen Deutschlands), a échoué, après que Stapel ait certes insisté pour que les Juifs soient séparés des Allemands, mais sans accepter pour autant qu'ils perdent leurs droits de citoyens ni qu'ils soient placés sous un statut de minorisation matérielle. Le pogrom du 9 novembre 1938 lui a appris définitivement qu'une telle option s'avérait désormais impossible. A cette époque-là, il s'était déjà retiré de toute vie publique, en partie volontairement, en partie sous la contrainte. A la fin de l'année 1938, il abandonne la publication de Deutsches Volkstum (la revue paraîtra par la suite mais sans mention d'éditeur et sous le titre de Monatsschrift für das deutsche Geistesleben, soit "Mensuel pour la vie intellectuelle allemande").
Sa position est devenue plus critique encore lors de la crise des Sudètes et au moment où s'est déclenchée la seconde guerre mondiale: il s'aperçoit, non seulement qu'il s'est trompé personnellement, mais que le système politique dans son ensemble vient d'emprunter une voie fatale, qui, dans tous les cas de figure, conduira au déclin de l'Allemagne. Par l'intermédiaire de Habermann, qui avait des relations étroites avec C. F. Goerdeler, il entre en contact en 1943 avec certains cercles de la résistance anti-hitlérienne. Beck aurait estimé que le livre de Stapel, paru en 1941 et intitulé Drei Stände ("Trois états"), était capital pour la reconstruction de l'Allemagne. Mais ce lien avec la résistance allemande n'a pas servi Stapel après la guerre, même si J. Kaiser et Th. Heuss avaient tous deux signé pour lui des attestations garantissant sa parfaite honorabilité. On a limité de manière drastique après la guerre ses possibilités de publier. Pour s'adresser à un public relativement large, il n'a pu, après 1945, qu'utiliser le "Deutsches Pfarrerblatt" ("Journal des pasteurs allemands"), qu'éditait son ami K. B. Ritter.
Son dernier livre Über das Christentum ("Sur le christianisme"), paru en 1951, constitue un bilan somme toute résigné, montrant, une fois de plus, que la pensée de Stapel était profondément marquée par la théologie et le luthérianisme.
Dr. Karlheinz WEISSMANN.
(entrée parue dans: Caspar von SCHRENCK-NOTZING (Hrsg.), Lexikon des Konservatismus, L. Stocker, Graz, 1996, ISBN 3-7020-0760-1).
06:10 Publié dans Histoire, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 mai 2007
A propos de Werner Sombart

A propos de Werner Sombart
18 mai 1941: Mort à Berlin du grand sociologue, économiste et philosophe allemand Werner Sombart. Son œuvre est vaste, immensément vaste, mais, en résumé, on pourrait dire qu’il est l’héritier de Marx le plus complet, notamment grâce à son énorme ouvrage en six volumes sur les origines du capitalisme. Sombart est celui qui a complété véritablement le Capital de Marx, en dégageant l’histoire du capitalisme de la gangue des abstractions ou des vœux pieux des militants socialistes, pour la replonger dans l’histoire réelle des peuples européens et de l’économie globale.
Les positions de Sombart l’ont amené à abandonner les tristes insuffisances des politiciens de bas étage se réclamant de Marx —auquel ils ne comprenaient rien— au sein des formations sociales démocrates ou communistes. Ce qui a valu, bien sûr, à Sombart, véritable et quasi seul héritier de Marx, l’étiquette infamante de “fasciste”. Plus tard, l’historien français Fernand Braudel s’appuiera sur bon nombre d’intuitions de Sombart pour développer ses thèses sur l’émergence du capitalisme, à partir de la découverte des Amériques. Pour une approche succincte de l’œuvre de Werner Sombart, cf. : Thierry MUDRY, «Le socialisme allemand de Werner Sombart», in : Orientations, n°12, 1991.
05:20 Publié dans Biographie, Economie, Histoire, Révolution conservatrice, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 mai 2007
O. Spengler's Uneven Legacy

Oswald Spengler's Uneven Legacy
by Donald L. Stockton
http://home.alphalink.com.au/~radnat/spengler/biographica...
06:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 mai 2007
A. Moeller van den Bruck: Über Dostojewski
Bemerkungen über Dostojewski
von Arthur Moeller van den Bruck
http://www.geocities.com/kshatriya_/dostojewski.html...

Die russische Dichtung ist die Dichtung eines jungen Volkes. Nicht das Alter, sondern die Glut, die Unausgebranntheit der Seele entscheidet über die Jugend der Völker. Ursprünglich sind alle Völker gleich alt und gleich jung. Ein noch heute junges Volk aber, wie das russische, ist nach wie vor der Erde und dem Chaos nahe. Für seine Seele ist noch alles Rätsel und Geheimnis in der Welt und der Mensch selbst eine dunkle Sehnsucht nach Schauen und Erkennen. Die Mystik des russischen Volkes: die ist seine Jugend, die ist seine Primitivität, aber auch seine Kraft, und die Extase, mit der und in der es sich einst hinausringen wird über sich selbst — in dieser Mystik allein liegt seine Zukunft und Bestimmung. Die innere Kultur Rußlands wird immer nur eine religiöse, und, wenn man das Wort nicht scholastisch, sondern menschlich versteht, sogar nur eine theokratische sein können. Der Germane wird vorher die vielleicht größte äußere Kultur schaffen, die je die Erde gesehen: geistig ist er der geborene Ideenträger und oft noch kann er als Leibniz oder Kant wiederkehren. Aber geborene Glaubenskünder ist heute allein der Russe, und nur eine slavische Mutter könnte, wenn es bereits Abend geworden in der westlichen Menschheit und der Germane sich ausruht, aus der östlichen Welt noch einmal Buddha oder Jesus gebären. Im Schoße des Slaventums allein ruht als Möglichkeit die Religion, die wir noch haben könnten: jene letzte, äußerste Religion, die in nichts mehr Symbol, die ganz nur Gefühl sein würde. Werden wir sie in Wirklichkeit jemals bekommen? Wir Germanen können es nicht wissen, wir können nur schaffen. Einzig der Slave selbst kann heute schon diese Religion ahnen und glauben. Jedenfalls liegt alles, was im Slaventum geistig geschaffen worden ist, auf dem Wege von seiner latenten Volksmystik zu einer bereits geoffenbarten Weltreligion: vor allem das Beste, was das Slaventum bis heute hervorgebracht hat — die russische Dichtung.
* * *
In der Mitte der russischen Dichtung steht Dostojewski. Wenn die russische Dichtung das größte Russische ist, so ist Dostojewski der größte Russe. Er ist das zentrale Genie Rußlands: Genie im allerhöchsten schöpferischen Sinne eines Mannes, der nie vor ihm Dagewesenes aus dem Boden schlägt. In Dostojewski ist der russische Volkscharakter zum ersten Male zur verkörperten Weltanschauung, zu Wort und Sprache und als ganzes Lebenswerk zu einem einzigen großen Epos geworden. Aehnliches ließe sich freilich auch von Tolstoi sagen, aber Tolstoi ist neben Dostojewski doch mehr der Ausdruck der slavischen Ruhe, des stillen schweigenden, eben erst aufhorchenden Landes, des schweren und noch stumpfen, aber in seiner Stumpfheit urgesunden und Zukunft witternden Bauerntums. Dostojewski dagegen ist weit mehr, Dostojewski ist der Ausdruck des russischen Wahnsinns, der Tragödie im Russentum, der Fleischwerdung all seiner mystischen Verinnerlichung und hektischen Geladenheit. Dostojewski hat wie Tolstoi das Epos des russischen Lebens geschaffen, aber er hat es weit großartiger getan: er hat dieses russische Leben nicht nur ausgestattet mit einem unerhörten Gestaltenreichtum, der ganz Rußland, der das ganze Slaventum in all seinen verschiedenen Nationalitäten, Kasten und Typen, vom simplen Muschik bis zum Petersburger Aristokraten, vom Nihilisten bis zum Bureaukraten, vom Verbrecher bis zum Heiligen in tausend Nuancen umgreift — Dostojewski hat noch mehr getan und ihm auch die Offenbarung einer bewußten russischen Weltanschauung zu Grunde gelegt.
* * *
Dostojewskis eigentliche Tat ist es, daß er Rußland eine Mythologie gegeben — dem modernen Rußland eine moderne, eine naturalistische, eine psychologische Mythologie, herausgeholt nicht aus den Nebeln der Vorwelt, sondern aus denen der Seele. Die Mythologie eines Volkes ist die Verkörperung seines Urwesens in Urfiguren: in dieser Weise mythologisch aber kann in jedem Augenblick in der Entwicklung eines Volkes geschaffen werden — es kommt nur darauf an, daß man ihm wirklich auf den Grund schafft und seine innerste Wahrheit über sich selber aus ihm herausschöpft. Auch die Götter entsprangen einstmals leibhaftig und gegenwärtig einem Menschenauge, dem ersten, das sie in innerer Phantastik erschaute, und sie lagen nicht etwa um ganze Schöpfungsringe genetisch zurück, wie die Menschen dann später glaubten. Trotzdem wird in der Regel die Mythologie eines Volkes an seinem Anfang, an der Wende von seiner vorgeschichtlichen zu seiner geschichtlichen Zeit liegen: sie ist das Erste, was es sich schafft, und sie ist zugleich die Schicht, auf der es dann weiterschafft. Fast alle großen Nationalliteraturen bauen sich denn auch auf einer derartigen mythologischen Vorarbeit auf, die einst schon die Ahnen in unbewußter Dichtung geschaffen haben. Bei dem russischen Volke ist das nicht der Fall: es besitzt nur die Geschichtsberichte seiner Chronisten und dann wohl auch reiche Sagen und Märchenwelten, aber doch kein zentrales Nationalepos im Sinne etwa der Ilias und der Nibelungen, kein grandioses Panorama seiner Vorzeit, in dem seine Ueberlieferungen und Sinnbilder, seine Nationalhelden und Nationalstoffe zusammengegossen und zusammengeschmolzen wären. Infolge dessen hat die russische Dichtung, wenn man sie auf ihre Ursprünge hin ansieht, immer etwas Basisloses, die Fundamente scheinen zu fehlen, die einzelnen Dichter stehen disparat hinter- oder nebeneinander. Das wurde dann erst von Dostojewski ab anders. Vor ihm hatte man sogar noch in romantischen Formen den russischen Ton gesucht. Jetzt holte Dostojewski, nach Puschkins und Gogols Vorgang, all das jahrhundertelang Versäumte nach, stellte breit und mächtig eine russische Typologie auf und gab so, indem er das russische Leben in seinem naturalistischen Nationalcharakter ergriff und gleichzeitig bis auf seinen mystischen Untergrund aufdeckte, auch der russischen Dichtung ein für alle Mal und endgültig ihren Nationalcharakter. Wie französische Dichtung immer skeptisch, deutsche Dichtung immer idealistisch ist, so wird russische Dichtung immer naturalistisch-mystisch sein — oder sie wird nicht russisch sein.
* * *
Der Grund der ganzen Erscheinung, warum sich das russische Volk kein Nationalepos geschaffen, mag einmal in der überstark partikularistischen, beständig dezentralisierenden Rasseentwicklung gelegen haben: man bedenke nur, daß unter einem Dutzend anderer Städte Nowgorod, Kieff, Moskau und schließlich Petersburg die wechselnden, den Entwicklungsgang kreuz und quer durcheinander, bald nach Norden, bald nach Süden verschiebenden Entwicklungsmittelpunkte gewesen sind; und zwar unter ganz anders großen Entfernungen und tragischen Umständen, als wir sie etwa in Deutschland gehabt; denn unsere Entwicklung ist gegen die russische gehalten eine durchaus ruhige gewesen! Dann aber lag auch viel schuld vor allem im russischen Nationalcharakter selbst, in der ganzen Monotonie der slavischen Lebensstimmung. Der Russe träumt, aber handelt nicht, sein Weltbild ist monistisch, nicht dualistisch, das Sein ist für ihn Fatum, Verhängnis, nicht Wille und Gegenwille, ist Gefühl, nicht Tat. Das alles konnte dann sehr wohl im einzelnen Volkslied lyrisch ausströmen, aber niemals in wilden Szenen und unter gewaltigen Kontrasten sich plastisch zusammenballen. Gewiß weitet sich in der russischen Wirklichkeit diese Lyrik unwillkürlich zum Epos, zum Epos der Steppe, der Ferne und der Grenzenlosigkeit. Aber eben dieses Epos ist dann so riesengroß und ungeheuer, daß es alle Tragödien wie Winzigkeiten verschlingt und daß schließlich doch immer nur die Lyrik zurückbleibt. Dennoch ist auch für den Slaven wie für jeden Menschen das Leben Kampf und damit Drama: nur daß dieses Drama sich bei ihm weit kontemplativer, quietistischer, eben psychologischer abspielt. Selbst wenn es sich in rasenden und sogar gräßlichen Taten ausrollt — wie bei Dostojewski immer - , selbst dann ist noch der Hintergrund die Seele, ist das Motiv ein inneres, kein äußeres, ist das Heldentum verschwiegen und still nach innen gekehrt, und nicht etwa die starke und über sich klare Heroik des Westeuropäers. All diese Züge russischen Volkstums aber kehren im Schatten Dostojewskis wieder: Tragödie jagt Tragödie, doch die ewige Epik des Slaventums nimmt sie auf, und was schließlich am tiefsten wirkt, ist die Lyrik. Die gigantische Einheit von allen dreien ist Dostojewskis Monumentalität — und sie ist Rußlands Monumentalität.
* * *
In der Wirklichkeitsmythologie, die Dostojewski geschaffen, ist die Mystik das Bedeutsame für Rußland, doch die Wirklichkeit, die besondere Art, in der Dostojewski Wirklichkeit gegeben hat, ist das Bedeutsame für die Welt. Dostojewskis Nichts-als-Modernität ist Dostojewskis Größe. Unter den Dichtern des neunzehnten Jahrhunderts gehört er zu den ganz Wenigen, die nur Neues, die nur nach Vorne, nur in ständigem unterirdischen Zusammenhang mit der allgemeinen Zivilisationsentwicklung geschaffen haben. Für ihn gab es keine Tradition mehr: nicht die "schöne" Tradition der Antike, noch die "wilde" irgendeiner Romantik. Die einzige Basis, auf der sein Werk ruht, ist seine Zeit. Es hätte die Möglichkeit bestanden, die Typologie, die Rußland jetzt endlich bekommen sollte, russisch-archaistisch aus den vergangenen Jahrhunderten noch nachträglich heraufzuholen. Dostojewski hat das nicht getan: gerade so wie Rußland überhaupt in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit weist, so hat er auch das bis dahin Unterlassene nicht in jener Weise allegorisch-kostümhaft nachgeholt, sondern mit sicherem Instinkt unmittelbar in seine Gegenwart hineingeschaffen und die Seele seines Volkes bloßgelegt, indem er die Seele dieser Gegenwart bloßlegte. Das Psychische seines Naturalismus war dabei das Entscheidende: dadurch ward Dostojewski zum Ersten jener Künstler, wie heute Munch etwa, in deren Kunst ein Stück Zukunft transcendental vorweggenommen und Leben und Ewigkeit psychisch verbunden scheint. Der moderne Zug allein hätte noch nicht genügt, um Dostojewski seine überragende Stellung zu geben und den großen Epikern anzureihen. Modern waren auch schon die englischen Realisten des 18. und die französischen Realisten des 19. Jahrhunderts — Defoe, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant. Aber es war immer noch erst eine mehr sachliche, unpersönliche, einfach berichtende Modernität. Einzig Goethe grub den Realismus mehr in das Seelische und Ewige ein, dadurch, daß er ihm den Grund der Natur und der aufkommenden Naturwissenschaften legte. Doch erst Dostojewski ist noch weiter gegangen und hat alle Naturalist gezeigt, wie auch das moderne Leben wieder seine Mystik und Phantasie hat. Realistisch von diesem modernen Leben erzählen, sogar mit noch vollerer, runderer, körperhafterer Gestaltungskraft, als sie Dostojewski besessen, der bei der Zeichnung selbst der deutlichsten Charaktere stets etwas Gespensterhaftes behielt — dabei wuchtig und breit in der Ausführung: das konnte auch Tolstoi. Aber das moderne Leben in seiner inneren Dämonie ergreifen, mit seinen neuen Schönheiten und Häßlichkeiten, seinen neuen Sittlichkeiten und Unsittlichkeiten, und den Naturalismus, statt ihn etwa gar zur Kopie zu erniedrigen, in Vision wieder auflösen — das konnte erst Dostojewski.
* * *
Die "Dämonen" haben von dieser inneren Dämonie ihren Namen. Sie zeigen, mit welcher Macht und Unheimlichkeit sie durchschlagen kann in der Staats- und Gesellschaftsauffassung des Russen. Dostojewski hat fast in jedem seiner Bücher ein Sondergebiet russischen Seelenlebens aufgedeckt und hell gemacht. "Rodion Raskolnikoff" war sein moralkritischer und der "Idiot" sein ethisch-mystischer Band. Die Dämonen sind sein Revolutionsepos. Das politische und soziale Gebiet ist gewissermaßen das mittlere und vermittelnde, das der russische Ideologe auf seinem Wege zum religiösen und theokratischen trifft. Die Sehnsucht des Russen ist: gut zu sein und Gutes zu tun, schuldlos zu sein und alle Menschen zu lieben. Die Macht, die ihn daran hindert, ist der Staat. Andererseits, sieht er ein, könnte gerade ein vervollkommneter Staat zu diesem Ziele führen. So wird die russischen Gefühlsreligion und Liebesethik zum — Kampf um den Zukunftsstaat. Hinzu kommt zu diesem politischen Utopismus, der sich steigern kann bis zur politischen Mystik, die tatsächliche Minderwertigkeit und Unwürdigkeit desjenigen staatlichen Gefüges, in dem das Slaventum vorläufig politisch repräsentiert wird — des russischen Reiches. Nicht nur Schwärmerei, auch Freiheit und Gerechtigkeit, die unterdrückt und mißhandelt werden, der Ekel vor einer verkommenen Gesellschaft, die Unhaltbarkeit eines verrotteten Wirtschaftsleben führen die russische Jugend zur Politik. Das Fieber, mit dem sie die Menschen ergreift, hat Dostojewski in den "Dämonen" gestaltet. Zahllosen Typen heben sich ab: nihilistische Helden, sozialistische Doktrinäre, Slavophilen, Patrioten; Fanatiker, Intriganten, Maniaken, Idioten; dazu Reaktionäre, Bureaukraten, Blaustrümpfe, Dekadenten, russisches Publikum. Das Staatsleben wird zur Welt. Die Politik wird zum Menschheitsband. Als Dostojewski jung war, hat er selbst, wenn auch mehr passiv, an revolutionären Umtrieben teilgenommen. Immerhin mußte er dafür lange Jahre in Sibirien als Zwangsarbeiter zubringen. Später, als er schon längst der große russische Dichter war, als Religion und Mystik seine Seele erfüllen und seine politischen Anschauungen reif und fest geworden waren in einem ganz bestimmten russischen Nationalismus und slavischen Rassebewußtsein, erinnerten ihn neue Vorgänge an jene Zeit, da auch sein Leben das russischste aller russischen Leben, ein politisches Leben, gewesen. So schrieb er dann die "Dämonen". Sie sind stofflich sein russischstes Buch.
(Einführung zu: F. M. Dostojewski: Die Dämonen. Sämtliche Werke, Erste Abteilung: Fünfter Band. München und Leipzig: Piper, 1906.)
02:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 15 mai 2007
A. Moeller van den Bruck: Dritte Partei
Die dritte Partei für das neue Deutschland
Vor 80 Jahren verfaßte Arthur Moeller van den Bruck sein vielbeachtetes Hauptwerk »Das dritte Reich«
http://www.deutsche-stimme.de/Sites/07-03-Partei.html...

In der tiefen Orientierungskrise, die das deutsche Volk nach dem Ersten Weltkrieg erfaßt hatte, steckte auch der biedere und sozialreaktionäre Patriotismus wilhelminischer Prägung. Junge Nationalisten begriffen die Niederlage nun als Chance, Nationalismus, Preußentum und Sozialismus zu verschmelzen. Gewaltigen Ausdruck fand dieses Sehnen nach einer echten deutschen Gemeinschaft in der 1923 erschienenen Schrift »Das dritte Reich« von Arthur Moeller van den Bruck. Ein Buch, das fanfarengleich die besten Geister zum Banner der Konservativen Revolution rief.
Am 30. Mai 1925 setzte Arthur Moeller van den Bruck seinem zuletzt von Schwermut gedrückten Leben ein frühes Ende. Damit verlor der mythenumwitterte Juni-Klub seinen spiritus rector und die nationalistische Schriftstellerei einen ihren kraftvollsten Visionäre. Wurde Moeller van den Bruck von der Spannung zwischen seinem angestrebten »dritten Reich« und dem entmutigenden Politikalltag der verhaßten Weimarer Republik innerlich zerrissen? Fand der Rechtsintellektuelle keinen Ausweg mehr aus dem Niemandsland, in das er sich mit seiner vagen Geschichtsprophetie begeben hatte?
Sein schillernder Lebenslauf gleicht dem anderer politischer Romantiker. Im April 1876 wurde Arthur Moeller – später hängte er seinem Geburtsnamen den mütterlichen Namen an – als Sohn eines königlich-preußischen Baurates geboren, zu dessen Vorfahren preußische Offiziere, Gutsbesitzer und Pastoren gehörten. Das Gymnasium vor dem Abitur verlassend, führte er nach seiner frühzeitigen Heirat und einem auskömmlichen Erbe ein ungezwungenes Leben im Künstlermilieu. In schlaflosen Nächten las er sich ein beträchtliches kunst- und geistesgeschichtliches Wissen an. Vor der Hinwendung zum politischen Nationalismus stand Moeller bereits im Banne von Nietzsches Lebensphilosophie, einer elitären Kulturkritik und eines kriegerischen Heroismus. Aus dieser Zeit stammen die Zeilen: »Sie ist prachtvoll, die Schlacht, und menschenwürdiger als Selbstgenuß in dumpfem Behagen. Sie gibt uns, gerade wenn es die Schlacht der Geister und Leidenschaften ist, unsere höchsten Könige und besten Helden. Das andere, der ewige Frieden, wäre nicht zu tragen – eine Langeweile, ein Gähnen, das uns nur den Philister gäbe.«
Aus Gründen, die im Dunkeln liegen, siedelte Moeller 1902 nach Paris über. Während seines vieljährigen Auslandsaufenthalts reifte er vom Europäer zum herkunftsbewußten und stolzen Deutschen heran. Aus diesem Geist heraus erschien zwischen 1904 und 1910 die umfangreiche Essaysammlung »Die Deutschen« mit Biographien über deutsche Staatsmänner, Philosophen und Künstler. Darin erklärte sich der Autor ausdrücklich zum »deutschen Nationalisten«.
Erste unverwehbare Spuren in der deutschen Geistesgeschichte hinterließ Moeller durch eine kulturpolitische Großtat: Zusammen mit einem russischen Dichter gab er zwischen 1905 und 1914 die 22-bändige Gesamtausgabe des russischen Dichters Fjodor Dostojewski heraus. Für die geistig rege deutsche Jugend vor und nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Lektüre Dostojewskis zu einem Schlüsselerlebnis. Bei ihm vernahm sie die Stimme der russischen Seele und einer mythischen Lebenswelt, die keinen Zugang zum Liberalismus und Rationalismus des europäischen Westens erlaubte. Von dem Russen übernahm Moeller den raunenden Prophetenton, in dem dieser von »jungen Völkern« und den »Revolutionären aus Konservatismus« gesprochen hatte. Das Vermächtnis Dostojewskis – die Verachtung für den westlichen Materialismus, für Fortschritts- und Vernunftglauben – wurde zu einer geistigen Waffe der jungen Rechtsopposition in Deutschland.
Während eines Italien-Aufenthaltes entwickelte Moeller die Umrisse eines großen Werkes über den Gegensatz von alten Völkern (Franzosen, Engländern und Italienern) und jungen Völkern (Deutschen, Russen und US-Amerikanern), das jedoch Fragment blieb. 1907 nach Deutschland zurückgekehrt, verließ er seit Kriegsausbruch 1914 sein Vaterland nicht mehr. Moeller meldete sich freiwillig zum Waffendienst und kam als Landsturmmann an die Ostfront, wurde wegen eines Nervenleidens aber schon bald in die Presse- und Propagandazentrale der Obersten Heeresleitung versetzt. Im Rahmen dieser Tätigkeit verfaßte er den Aufsatz »Das Recht der jungen Völker«, der sich als Akt geistiger Landesverteidigung verstand. Unter dem Eindruck der Augusttage 1914, als der zivilisatorische Lack der feisten Bürgergesellschaft abplatzte und der erstarrte Wilhelminismus einer schicksalstiefen Volksgemeinschaft wich, leisteten auch Köpfe wie Werner Sombart und Thomas Mann ihre geistigen Kriegsbeiträge.
Während des Krieges veröffentlichte Moeller sein Buch »Der preußische Stil«, seine einzige Arbeit, die nach 1945 neu aufgelegt wurde. Darin wird atmosphärisch dicht, kenntnisreich und in einer feierlichen Tonlage die preußische Kultur und Geisteshaltung unter besonderer Würdigung ihrer Baukunst beschworen. Das Buch ist eine leidenschaftliche Parteinahme für Preußen-Deutschland, das im tobenden Krieg unbedingt zu verteidigen und danach zu erneuern sei. Nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen mit der Nüchternheit und Sachlichkeit der preußischen Staatsidee war indes der romantische Mythos, den Moeller van den Bruck nach der Kriegsniederlage predigte: der Mythos vom Reich, eines neuen, dritten Reiches.
Der Berliner Juni-Klub
Als »Das dritte Reich« 1923 erschien, war der Autor schon ein wichtiger Ideengeber der radikalen Rechten und der intellektuelle »Star« des legendären Juni-Klubs. Dieser Verein, der sich nach dem Monat der Unterzeichnung des Versailler Diktats (Juni 1919) benannt hatte, war in der Berliner Motzstraße 22 ansässig. Dort trafen sich regelmäßig Gelehrte und Publizisten der republikfeindlichen Rechten, deren Auffassungen in der Wochenzeitschrift »Das Gewissen« verbreitet wurden. Mitglieder des Juni-Klubs waren neben Moeller u.a. Eduard Stadtler (»Antibolschewistische Liga«), Max Hildebert Boehm (Buch: »Das eigenständige Volk«), Hans Grimm (Buch: »Volk ohne Raum«) und Hans Blüher, Autor wichtiger Bücher über die Wandervogel-Bewegung. Gäste der elitären Runde waren neben anderen Otto Strasser und Adolf Hitler.
Moeller schwankte anfänglich zwischen den Titeln »Die dritte Partei« und »Der dritte Standpunkt« für sein programmatisches Hauptwerk, dem er schließlich den Namen »Das dritte Reich« gab. Im letzten Kapitel erklärte der Autor: »Die dritte Partei will das dritte Reich. Sie ist die Partei der Kontinuität deutscher Geschichte. Sie ist die Partei aller Deutschen, die Deutschland dem deutschen Volke erhalten wollen.«
Dem Hauptwerk Moellers lag eine niederschmetternde Gegenwartsanalyse des Vaterlandes zugrunde. Die wilhelminische Vergangenheit, schon vor Kriegsausbruch vielfach als überlebt wahrgenommen, war unwiederbring- lich dem Urteilsspruch der Geschichte zum Opfer gefallen. In dieser Lage wandelten sich einige Konservative zu Nationalisten, die dem Konservatismus eine revolutionäre Wendung gaben und damit das geschundene Deutschland wieder aufrichten wollten. Durch die revolutionäre Zerstörung des Dekadenten und Würdelosen – konkret des Systems von Weimar – sollte das wieder ans Licht gebracht werden, was im konservativen Sinne der Bewahrung überhaupt erst lohnte. Die Hauptlehre, die konservative Revolutionäre aus Krieg und Niederlage zogen, war die Herstellung einer mythisch aufgeladenen und solidarischen Volksgemeinschaft. Der Nationalist Franz Schauwecker kleidete eine damals weitverbreitete Ahnung in die Worte: »Wir mußten den Krieg verlieren, um die Nation zu gewinnen.«
Die Erneuerung und Stärkung der niedergeworfenen deutschen Nation war für Moeller das heilige Gebot der Stunde: »Aus Trümmern, die mit dem Staate die Nation zu begraben drohen, hebt sich jetzt als eine sich entringende Gegenbewegung die konservativ-revolutionäre des Nationalismus. Sie will das Leben der Nation. Sie will das, was der alte Staat wollte und jeder Staat wollen muß: aber sie will es nicht von Begriffen aus, sondern vom Erlebnis aus: Sie will nachholen, was versäumt wurde: die Teilhaftigkeit der Nation an ihrer Bestimmung.«
Dieser neue Nationalismus nahm geistig-politisch eine Doppelfrontstellung gegen zwei nur vordergründig feindliche Gesinnungsrichtungen ein: den Liberalkapitalismus und den Kommunismus. Beide Ideologien waren vulgäre Kinder des Aufklärungs- und Fortschrittsglaubens, die sich in ihrer materialistischen Weltsicht und ihrer Feindschaft gegen alle organischen Gebundenheiten von Volkstum, Staat und Tradition trafen. Moeller van den Brucks »dritte Position«, die in einem »dritten Reich« ihre dauerhafte staatliche Form finden sollte, war der nationale Weg jenseits der Abirrungen von Liberalkapitalismus und Kommunismus. Gleichzeitig bescheinigte er dem verflossenen Kaiserreich, bei der Integration aller Volksteile versagt zu haben. Das neue Reich sollte endlich die bisherigen Klassen-, Konfessions- und Stammesgegensätze in einem deutschen Sozialismus aufheben.
Gegen deutschenunwürdige Lebensverhältnisse
Moeller stellte klar: »Für die Deutschen der neuen Generation, die nicht das Bewußtsein einer Klasse, sondern dasjenige der Nationalität haben, ist es unvorstellbar und als Vorstellung unerträglich, daß wir jene zwanzig Millionen in sozialen Zuständen unter uns leben lassen, die nicht menschenwürdig sind, und nicht deutschenwürdig. Diese Menschen der neuen Generation, die nicht Proletarier sein wollen, sind Sozialisten aus Kameradschaft.«
Ohne Scheu verwendete der Autor den Sozialismusbegriff. Dies freilich in scharfer Abgrenzung zur Sozialismus-Rhetorik falscher Arbeiterfreunde und ihres verlogenen Alleinvertretungsanspruchs. Internationalismus und Klassenkampfideologie führte Moeller auf Karl Marx und damit das Judentum zurück. »Er (Marx; Anm.) besaß als Jude kein Vaterland. Also versicherte er dem Proletariat, daß es gleichfalls kein Vaterland habe,« so Moeller. Den Gegensatz von schaffendem und raffendendem Kapital thematisierend, heißt es weiter: »Noch immer wird das große Hindernis für eine dauernde Befriedigung der Klassen und Klassenansprüche in dem Gegensatze von Arbeiter und Arbeitgeber gesucht. Noch immer wird das Kapital dort angegriffen, wo es arbeitet, und nicht dort, wo es wieder vertan, verbracht, verschwendet wird. Nicht Klassen, sondern Typen scheiden die Menschen.«
Dem Liberalkapitalismus warf Moeller wütend vor, der Arbeiterschaft den ihr gebührenden Platz innerhalb der deutschen Nation verweigert zu haben. Der Staat habe die private Wirtschaft an die Zügel zu nehmen und dafür Sorge zu tragen, »daß die Menschen leben und wohnen und arbeiten können, daß ihr wirtschaftliches Dasein in den Bedingungen gesichert ist«. Die besondere Anklage galt dem sogenannten Manchesterkapitalismus, der die erbarmungslose Auspressung der Arbeiter zum Leitprinzip des Wirtschaftens erhoben hatte. Mit der deutschen Kriegsniederlage hatte das Entente-Kapital nie zuvor dagewesene Möglichkeiten, das Herzland Europas und seine Menschen auch wirtschaftlich zu unterwerfen. Nur auf dem Wege der innerdeutschen Klassenversöhnung und Arbeiterintegration unter der Standarte eines deutschen Sozialismus schien der Befreiungsschlag gegen das Entente-Kapital denkbar. In seiner Schrift »Sozialismus und Außenpolitik« erklärte Moeller Völker statt Klassen zu den eigentlichen Ausbeutungsobjekten der Versailler Nachkriegsordnung: »Nicht Klassen, sondern Nationen sind heute die Unterdrückten. Kann es eine andere Außenpolitik für unterdrückte Völker geben als die, welche die Unterdrückung endet?«
Der Blick nach Osten
Auf der Suche nach außenpolitischen Bündnisgenossen für das in eine Paria-Rolle gedrängte Deutschland richtete Moeller – ohne eigentlich in die Gruppe der Nationalbolschewisten eingeordnet werden zu können – seinen Blick nach Osten. Als literarischer Kronzeuge für den Kampf gegen den Nihilismus des Westens diente ihm wiederum Fjodor Dostojewski, der für die unverbrauchten Seelenkräfte des russischen Volkes stand. In »Sozialismus und Außenpolitik« versuchte sich der deutsche Nationalist in einer nüchternen Auslotung deutsch-russischer Bündnismöglichkeiten: »Der deutsche Sozialismus kann sich nur dann für Rußland entscheiden, wenn auch der russische Sozialismus erkennt, daß jedes Volk seinen eigenen Sozialismus hat.«
Wie distanziert der politische Schriftsteller aber der Realpolitik und konkreten politischen Schritten gegenüberstand, zeigte sein Gespräch mit dem Kommunisten Karl Radek über ein deutsch-russisches Bündnis gegen den Imperialismus der Entente-Mächte. Radek, Deutschlandspezialist der Kommunistischen Internationale, stellte Moeller im Juni 1923 – kurze Zeit nach der Erschießung Leo Schlageters durch die Franzosen – die Frage: »Gegen wen wollen die Deutschvölkischen kämpfen: gegen das Ententekapital oder gegen das russische Volk? Mit wem wollen sie sich verbinden? Mit den russischen Arbeitern und Bauern zur gemeinsamen Abschüttelung des Joches des Ententekapitals, oder mit dem Ententekapital zur Versklavung des deutschen und russischen Volkes?« Der so Angesprochene wich den konkreten Fragen aus und lenkte die Diskussion auf weltanschauliche Grundsatzfragen, die eine Verständigung nicht zuließen.
Eine ähnliche Scheu vor greifbarer politischer Selbstverantwortung bestimmte neben weltanschaulichen Auffassungsunterschieden – z.B. in der Rassendoktrin – auch sein Verhältnis zu den Nationalsozialisten. Dies läßt sich an einer Begegnung mit Adolf Hitler festmachen: Nach einem Gastvortrag des NSDAP-Führers vor dem Juni-Klub im Jahr 1922 wandte sich dieser an Moeller mit den Worten: »Sie haben alles das, was mir fehlt. Sie erarbeiten das geistige Rüstzeug zu einer Erneuerung Deutschlands. Ich bin nichts als ein Trommler und Sammler. Lassen Sie uns zusammenarbeiten.« Moeller reagierte zurückhaltend. Nachdem Hitler die Motzstraße 22 verlassen hatte, sagte Moeller zu Rudolf Pechel, dem Herausgeber der »Deutschen Rundschau«: »Pechel, der Kerl begreift‘s nie.«
Streiter gegen den Liberalismus
Die Bedeutung Arthur Moeller van den Brucks lag denn auch nicht in dem Einsatz für Parteipolitik und Tagesfragen, sondern als Ankläger des alles zersetzenden Liberalismus: »Liberalismus hat Kulturen untergraben. Er hat Religionen vernichtet. Er hat Vaterländer zerstört. Er war die Selbstauflösung der Menschheit.« Mit Flammenworten warf er dem Liberalismus vor, die Völker zu zerstören und seinen Angriff auf alle traditionellen menschlichen Bindungen mit verlogenen Freiheitsparolen zu tarnen. Die gezielte Transformation einer gewachsenen Gemeinschaft in eine von bindungslosen Sozialatomen bestimmte Gesellschaft wurde klar erkannt: »Der Liberalismus ist Ausdruck einer Gesellschaft, die nicht mehr Gemeinschaft ist. (…) Jeder Mensch, der sich nicht mehr in der Gemeinschaft fühlt, ist irgendwie ein liberaler Mensch.«
Moellers Entwurf eines dritten Reiches, inhaltlich vage gehalten und in einer suggestiven Sprache verfaßt, begeisterte die nationalen Gegner des Weimarer Systems über alle Maßen. Joseph Goebbels zeigte sich 1925 in seinen Tagebüchern tief beeindruckt: »So klar und so ruhig, und dabei doch von inneren Leidenschaften ergriffen, schreibt er all das, was wir Jungen längst mit Gefühl und Instinkt wußten.« Zeugnis für einen regelrechten Moeller-Kult legte ein deutscher Nationalist ab, als er kurz nach 1933 schrieb: »Es kam – nach den geltenden Anschauungen – etwas ganz Unvernünftiges, es kam die Idee des Dritten Reiches. Und dieser Gedanke packte den deutschen Menschen, er packte politisch Heimatlose und politische Abenteurer, er packte Erdverbundene und Entwurzelte, er packte Naturen, mit denen man nicht sprechen, nicht diskutieren konnte.« Arthur Moeller van den Bruck erlebte die Ausbildung und Geschichtsmächtigkeit seines Mythos vom dritten Reich nicht mehr.
Jürgen W. Gansel
05:00 Publié dans Politique, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dostojewski, der Nihilismus und die Revolution
Dostojewski, der Nihilismus und die Revolution
von Arthur Moeller van den Bruck
http://www.geocities.com/kshatriya_/nihilismus.html...

Die letzte Entscheidung über den Wert einer Idee liegt in ihrer Wirkung: ob durch sie die Menschen steigen oder sinken? Dostojewski erkannt früh, daß Revolution den Menschen nur in seinen Untiefen bestätigt: daß sie ihn aus der Natur reißt, ihn in Tendenzen absondert und in einer Zusammenhanglosigkeit zurückläßt, in der jede volkliche oder staatliche Gemeinschaft aufhört und schließlich an Stelle der Menschenliebe die Eigenliebe übrigbleibt. Es war die Erkenntnis, daß Radikalismus nicht Wurzelung, sondern Entwurzelung bedeutet. Auch Dostojewski war unter den Radikalen gewesen, damals, vor Achtundvierzig, als er im Debattierklub der Petraschewzen verkehrte. Aber schon in dieser ersten Petersburger Zeit war etwas in seiner Witterung, das ihn von den Revolutionären, oder nur von den Liberalen, mit denen er äußerlich übereinstimmte, innerlich entfernte, und das ihn dafür den Slawophilen annäherte, die sich in Moskau allmählich zur Partei zusammenschlossen und sich auch in Petersburg durch ihren Glauben an Rußland von der volklosen Intelligenz der Westler abhoben.. Er las die Bücher der Sozialisten, weil sie, wie er sagte, mit Begeisterung für die Menschheit geschrieben waren. Aber den Fourierismus, für den Petraschewski warb, lehnte er mit Heftigkeit ab, weil er europäisch, nicht russisch war. Und die große Reform der Bauernbefreiung stellte er sich, wie jede Reform in Rußland, von oben, nicht von unten verwirklicht vor. Dostojewski glaubte immer an den Menschen, aber er dachte in Völkern, deren jedem er seine Bestimmung gab. Dem russischen Volke behielt er die Erfüllung des Christentums vor: einen ungeheuren weltgeschichtlichen Umweg, an dessen Ende er die Überwindung der Eigenliebe durch die Menschenliebe sah. Das Christentum war antinational gewesen und deshalb kosmopolitisch gescheitert. Das Menschentum, das Dostojewski verkündete, sollte sich im Russentum verwirklichen. Nirgendwo kam er diesem so nahe wie in Sibirien. Von der Katorga her, wo die Revolutionäre des Lebens dafür büßten, daß ihre Eigenliebe sich gegen die Menschenliebe vergangen hatte, nahm er den Glauben, dessen Verkündung seine eigene Sendung wurde. Er liebte das russische Volk um seiner Zurückgebliebenheit, aber auch um seiner Natürlichkeit, seiner inwendigen Schönheit, seiner mystischen Empfänglichkeit für eine neue naive Sittlichkeit willen. Der Nihilismus dagegen warf die Menschen nur wieder in Egoismus zurück und drohte im Namen einer unreinen Doktrin die gegebenen Bindungen des russischen Lebens zu zerstören, wie diese Verbrecher ihr Leben zerstört hatten. Mit einem politischen Denken, das auf Erhaltung, nicht auf Umsturz gerichtet war, mit einem konservativen Denken, das auf Menschenkenntnis beruhte, von Volkskenntnis herkam und schließlich auf Selbsterkenntnis zurückging, kehrte Dostojewski aus der Verbannung zurück.
Dieser psychologische Konservativismus ist schon bei dem jungen Dostojewski zu belegen: zu einer Zeit, als es den Nihilismus noch nicht dem Begriffe nach gab und er erst in Menschen umging. Dostojewski erkannte in dem Nihilisten den Menschen des 19. Jahrhunderts, und vielleicht noch des 20.: den Ausdruck seiner moralischen Zersetzung, aus der hernach die politische Sprengung der in Rußland überkommenen Lebensformen folgen mußte. Der Nihilismus war eine Krankheit. Sie erfaßte Dostojewski zuerst, weil er besonders aufnahmefähig für die Schwingungen der seelischen Veränderung war, in der sich der neue, der nächste Mensch ankündigte. Dostojewski hatte diese Fähigkeit, alle Leidenschaften der Menschen, die sinnlichen wie die geistigen, in seinem Ich mitzuerleben, indem er sie an sich selbst erlitt. Er kannte als Psychologe alle Symptome, wie er als Politiker alle Systeme kannte. Sie waren alle in ihm gewesen, bevor er als Künstler sie darstellte, als Ethiker sich auf sie einstellte, als Politiker ihnen nachstellte. Beobachtung war bei ihm Selbstbeobachtung. Dadurch unterschied er sich hernach von den Reaktionären, von Dogmatikern und Konventionellen, die urteilten und verurteilten, ohne sich und ohne die Probleme zu kennen. Dostojewski war Wissender. Er begleitete den Verlauf der nihilistischen Erkrankung in jedem einzelnen Falle bis zu dem kritischen Punkte, an dem die Menschen in ihr untergingen. An dieser Stelle kehrte er um und berief sich auf das Volk, das ohne Nihilismus war. Er stellte dem Nihilismus keinen Helden entgegen, der aus dessen eigenem Kreise kam, und man sollte ihn bei Dostojewski nicht erwarten, noch vermissen. Der Nihilist kann niemals zum Helden werden, weil er ohne die Liebe ist, für die das Volk ihn wiederliebt, und ohne das Vertrauen, für das die Menschen ihm wiedervertrauen. Dostojewski steht hier am anderen Ende derselben Achse, auf der in Europa später Nietzsche erschien. Es sind die gleichen amoralischen Probleme, die sie bewegen und aus denen Nietzsche nur die heroische, Dostojewski die ethische Folgerung zog. Nietzsche erhob Kain zu Prometheus. Dostojewski ließ Abel selber zu Kain werden, um Kain zu erschlagen. Auch Nietzsche, der Humanist und Europäer, suchte den Nihilismus zu überwinden: durch eine rhapsodische Übersteigerung des ja, das er gegen ihn warf, als eine Übersteigerung des Ich, das in jenen einsamen Jenseitsbereichen schließlich zurückbleibt, in denen es die Unterscheidung des Guten und des Bösen nicht mehr gibt. Dostojewski dagegen stellte als Heiliger und Prophet den Menschen wieder her, indem er zum Volke zurückfand, zur Unverlierbarkeit des Guten in den Menschen, auf das sie für ihr Zusammenleben angewiesen sind, und deckte als Psychologe und Russe das Böse im Ich auf, die Wurzellosigkeit des volklosen Nur-Ich-Menschen, der sich von der natürlichen Gemeinschaften geschieden hat: den Nihilisten.
Man hat die Einheitlichkeit dieser Entwicklung bestritten und ihr, statt ihre messianische Deutung durch Dostojewski anzuerkennen, eine soziologische Ausdeutung gegeben. Aber der Versuch beruhte auf einer Verwechselung der positivistischen Plattform, auf die er sich stellte, mit der politischen Tatsache, vor der wir stehen: daß Dostojewski konservativ war. Einmal mußte der Versuch ja wohl gemacht werden, und daß er gemacht wurde, ist Zeichen einer fast wissenschaftlichen Rechtschaffenheit, die sich zu geistiger Rechenschaft zwang. Auf die Dauer war für den Positivismus unerträglich, daß ein Dichter von dem Ausmaße Dostojewskis, dessen Schöpfung man unter den größten europäischen gelten lassen mußte, als Politiker Anschauungen gehabt haben sollte, die man in Europa als minderwertig und zurückgeblieben zu verschreien pflegt. Aber schon in diesem Zusammenhange werden Voraussetzungen verkannt. Der Konservativismus, den Dostojewski bekannte, beruhte nicht auf Rektion, obwohl er die Uwaroffsche Formel einschloß: Autokratie, Orthodoxie, Nationalität. Reaktion wäre für Dostojewski auch nur ein Egoismus der Menschen gewesen, ein Eigennutz der Klassen, eine Habsucht der Sphären, die einen größeren Bereich ihres Machtraumes, der ihnen durch das Wachstum des Volkes genommen war, künstlich oder gewaltsam wiederherstellen zu wollen. Dostojewski stand auch hier ganz auf der Seite des Volkes. Schon aus altruistischen Gründen hatte er, genau wie Tolstoi, und wie jeder Russe, in seiner apostolischen Lehre soziale Elemente. Aber das ist ja das Große an Dostojewski, und an den russischen Psychologen überhaupt, daß sie die ökonomischen Probleme eine Schicht tiefer erfassen, als die europäischen Positivisten sie sehen: nicht im Wirtschaftlichen, sondern im Menschlichen. Der Versuch, seinen Konservativismus vom Politischen ins Soziologische umzudeuten, übersah Erlebnisse, die Dostojewski gehabt hatte, die aber der Positivist gar nicht zu haben vermag, weil sie zwischenwirklich sind, nicht nachrechenbar, und doch unleugbar. Hierin gehörte vor allem das Erlebnis der russischen Nationalität. Während die beiden ersten Dogmen der Uwaroffschen Formel, Autokratie und Orthodoxie, auch für Dostojewski nur Formen bedeuten, die dem Russentum durch Überlieferung angepaßt waren, Schutzformen, die seine aufrührerische Geistigkeit brauchte und die sich in seiner zerworfenen Geschichte immerhin bewährt hatten, war für ihn die Nationalität ganz Inhalt: war Problem, und das gegenwärtigste und doch geheimnisvollste Phänomen, das es auf Erden gibt. Wenn man eine wirtschaftliche Auslegung des russischen Lebens geben wollte, dann müßte man mit der Feststellung beginnen, daß der Russe derjenige Mensch ist, dem Wirtschaft völlig gleichgültig bleibt. Die russische Nationalität erscheint inniger als jede europäische noch in animalisch-mystischen Lebensursprüngen verwurzelt und nicht ökonomischen Lebensbedingungen festgelegt. Sie ist nicht auf Fürsorge und Wohlfahrt eingestellt, nicht auf banalen Ausgleich des Daseins und schematische Vollkommenheit seiner Einrichtungen, sondern auf Triebe, auf die Widersprüche der Leidenschaften, auf die Heftigkeit von Zuneigung oder Abneigung, auf die Spontanität von Liebe und Haß. Jede Sozialreform in Rußland, die stets irgendwie Agrarreform sein wird und schon deshalb der Natur so nahe bleibt, wie der Phalanstere fern, kommt aus einem Triebe im Volke. Das Wichtigste ist immer der Mensch, nicht die Wirtschaft. Die verhängnisvolle Selbstverschwendung des Russen, in die er im Wirtschaftlichen umschlägt, seine Gier, Fleischlichkeit, Maßlosigkeit, ist nur das Gegengewicht seiner Anspruchslosigkeit, das aber gleich dieser auf Verachtung des Wirtschaftlichen, nicht auf Abhängigkeit von ihm beruht — nicht anders wie im Politischen das angeborene Empörertum des Russen nur der Gegensatz zu sein scheint, den ein Volk ständig aus sich hervorbringen und von sich abstoßen muß, dessen Wesen ein ewig beunruhigter und doch stets wiederhergestellter Konservativismus ist.
Dostojewski deckte den Nihilisten zuerst in Belinski auf. Es liegt eine eigentümliche Verbindung von Verhängnis und Sinnlosigkeit darin, daß Dostojewski als politischer Verbrecher verurteilt wurde, weil er im Debattierklub der Petraschewzen einen Brief vorgelesen hatte, der gerade von Belinski und gerade an Gogol geschrieben worden war: von dem liberalen Publizisten westlerischer Richtung an den slawophilen und nun wirklich reaktionär gewordenen Satiriker des russischen Kosmos. Dostojewski hat in seiner Rechtfertigungsschrift angedeutet, daß ja durchaus noch nicht ausgemacht gewesen sei, auf welchem Standpunkte er selber nun eigentlich gestanden habe: auf dem des schmähenden Belinski oder auf dem des geschmähten Gogol. Das ist nicht nur persönlich, das ist auch psychologisch durchaus glaubwürdig. Dostojewski stand damals noch zwischen den Parteien. In seinem Gefühl hatte er sich längst gegen die Revolution entschieden. Aber mit seinem Bekenntnis zögerte er noch vor Konservativismus zurück. Der Nihilist in ihm zögerte. Damit Gefühl auf dem Wege über das Erlebnis zum Bekenntnis werden konnte, mußte er die Verbannung auf sich nehmen: Belinski aber war der Anlaß, der kleine zufällige und unwichtige Schicksalsanlaß in einem großen nötigen und wichtigen Leben. Auch in diesem Leben war Schuld und war Sühne: Dostojewski wurde mit Sibirien geprüft und mit der Katorga gestraft, weil er sich wider seine konservative Vorbestimmung in jugendlicher Hingabe mit der revolutionären Bewegung eingelassen hatte. Von Belinski war er ursprünglich in die sozialistischen Lehren der westlichen Länder eingeführt worden, und er hatte sich für sie begeistert, weil sie selbst begeisternd waren, oder wenigstens, wie er von den sozialistischen Büchern sagte, "mit Begeisterung für die Menschheit geschrieben". Doch schon damals stieß ihn zurück, daß Belinski die sozialistischen Ideen in einer unreifen und vorlauten Abwandlung gegen die christlichen ausspielte und mit Atheismus großtat. Noch in dem Briefe Belinskis an Gogol, den Dostojewski vorlas, war Voltaire auf die Höhe von Christus erhoben worden. Je mehr Abstand er zu diesen Ideen bekam, durchschaute er sie, die den Leib über den Geist setzten, die Wirtschaft über den Menschen stellten, in ihrem Vergänglichkeitswert: durchschaute er vor allem die Menschen selbst, die sie vertraten. Belinski und Christus: das ging schon gar nicht, das war keine Gleichung, das war Gotteslästerung. Der Gedanke an Belinski verließ Dostojewski nicht wieder. Er trug ihn mit sich als eine Kränkung, die ihm angetan worden war, die er selbst sich angetan hatte, und die er sich nie verzieh. Spät noch, im "Tagebuch", kam er auf die alte Abrechnung zurück, die er mit ihm hatte: "Dieser Mensch hat Christus vor mir beleidigt und war doch niemals imstande, sich selbst oder irgendeinen von allen diesen Führern der ganzen Welt in Gleichwertigkeit an die Seite von Christus zu stellen: er vermochte nicht zu sehen, wie viel kleinliche Eigenliebe, Zorn, Ungeduld, Reizbarkeit, wie viel Kleinlichkeit, vor allem aber Eigenliebe in ihm selbst und in allen den anderen verborgen war!" Hier liegen Dostojewskis menschliche Erfahrungen in jenen Petersburger Zeiten. Er hatte erlebt, daß Menschen, die ihr Hirn nur mit Doktrinen nährten und sich aus Tendenz, Partei und Propaganda mit Aufklärung beschäftigten, dadurch als Menschen nicht besser sondern schlechter wurden. Er hatte erlebt, was es heißt, ein Nihilist sein. Einmal, im "Kleinen Helden", den er zwischen Petersburg und Sibirien schrieb, umriß er die Gestalt eines dieser Nihilisten der Gesellschaft, die er im Kreise der Petraschewzen kennen gelernt hatte, dieser Leute mit der "fertigen Phrase", dieser Menschen mit dem Spürsinn für das "nächste Schlagwort", die sich voll moderner Aufgeklärtheit gegen die Idealität der Dinge zu wenden pflegen, ohne zu ahnen, daß jedes "geringste Gefühl der Schönheit und des Erhabenen wertvoller ist als ihr ganzes schleimiges Weichtierdasein." So haßte Dostojewski. Aber er haßte nur dort, wo die Menschen nicht liebten. Und wir verstehen, warum er vor diese Menschen hintrat, mit denen er umgegangen war, und in ihrem Debattierklub jenen anderen Vortrag hielt, dessen Thema er sich selbst gestellt hatte: über den Egoismus. Mit ihm reinigte er sich von ihnen. Der Wortlaut des Vortrages ist in seiner Lebenskrise untergegangen. Von seinem Inhalt handelte später sein Werk, das eine neue Unio mystica der Wirklichkeit wider den Nihilismus des vom Leben gelösten Intellektes stellte. Nachdem die Menschen sich geschieden hatte, mußten auch die Geister sich scheiden.
Ganz anders waren seine Erlebnisse in Sibirien. Sie waren menschlich anders: uns sie waren sittlich anders. Nun lernte er dieses russische Volk erst kennen, um dessen Heiles willen er in Petersburg an politischen Debatten teilgenommen hatte, in denen eine veränderte Staatsform der überlieferten und eingewöhnten russischen Lebensform gefunden werden sollte. Nun fand er, daß es tiefe, starke und schöne Menschen in ihm gab, die voll von der eigenen Echtheit und schweren Ursprünglichkeit einer besonderen russischen Natur waren. Es ist richtig, daß sie Verbrechen begangen hatten. Aber Dostojewski machte die Beobachtung, daß das Verbrechen eine russische Eigenschaft ist, ein russisches Verhängnis, ein russischer Wahn — kein anderer als der, welcher, wenn man ihn auf das politische Gebiet überleitet, zum Umsturz in ihm treibt. Nur war ein Unterschied zwischen dem Revolutionär aus Doktrin , der sein Verbrechen gegen den Staat kehrt, weil er sein Ich behaupten will, und dem Revolutionär aus Instinkt, der das Verbrechen im Drange in die Natur zurückträgt, der er sein Ich opfert. Dostojewski war als Nihilist zugleich Amoralist genug, um den Verbrecher zu verstehen. Aber er war auch Ethiker, und wenn er verglich, dann fiel der Vergleich sehr zuungunsten der Doktrinäre aus. Das hatte er ja immer empfunden, das war die Scheu, das Gewissen, der geheime Grund gewesen, warum sich in ihm etwas sträubte, ein Nihilist zu bleiben und ein Revolutionär zu werden: er erkannte, daß alles Revolutionärtum aus sinnlich-tumultuarischen Bedürfnissen des Menschen kam und nur vortäuschte, Geist zu sein. Sogar diese Verbrecher, die so ganz Trieb waren, und so gar nicht Buchstabe, erschienen in ihrem Wesen geistiger als jene nihilistischen Politiker, die nur Verstand ohne Vernunft besaßen: erschienen, während sie so ganz als Leib sich gaben, mit ihrer Seele der Erde näher: erschienen animalischer, mystischer, religiöser: erschienen russischer. Und Dostojewski dachte an Rußland: was mußte aus diesen russischen Menschen seiner sibirischen Umgebung sich bilden lassen, wenn man sie nicht den Weg des Hasses wies, sondern den Weg der Liebe! Als er sie menschlich prüfte, fand er heraus, daß sie sogar gütig waren. In ihren Verbrechen noch lebte der Gott ihres Landes. Dostojewski erkannte sich selbst in ihnen wieder. Ihr Problem war sein Problem. Was bei ihnen Trieb war, das wurde bei ihm Bewußtsein. Auch als Revolutionär war er Russe gewesen, und mehr Russe als Revolutionär. Aus Sibirien schrieb er an Maikoff: "Ja, ich war immer durch und durch Russe." Als Russe konnte er nun zum Konservativen werden: "Die Ansichten wechseln, das Herz bleibt." Er blieb, der er war: "Man kann sich wohl in der Idee irren, aber man braucht nicht, wofern man sich nicht im Instinkt geirrt hat, durch diesen Irrtum ein Gewissenloser zu werden, will sagen, gegen seine Überzeugungen zu handeln."
Als Dostojewski aus Sibirien nach Petersburg zurückkehrte, zog er die politische Schlußfolge. Er fand in Rußland eine völlig veränderte politische Lage vor. Alexander II. war Nicolai I. auf dem Throne gefolgt. Die Aufhebung der Leibeigenschaft sollte nun endlich verwirklicht werden. Manche andere liberale Reform bereitete sich vor. Aber gleichzeitig hatte unter der Oberfläche des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, in den Winkeln, Mansarden und Schlupfwinkeln der Hauptstadt, in de Londoner und Züricher Emigration, jene Bewegung eingesetzt, von der die liberalen Forderungen der vierziger Jahre bereits anarchisch überboten wurden: die nihilistische. Sie kam tief aus der politischen Dämonologie des russischen Volkes und reichte über die Dekabristenbewegung zurück, in der man den Dämon in byronischer Gestalt unter jungen Enthusiasten hatte umgehen sehen, in die Zeiten des Sektierertums, in der er ein wüstes mittelalterliches Tier gewesen war. Diese Zusammenhänge hatten sich bis in die Zeit der Petraschewzen erhalten. Damals kam es vor, daß die Sektierer sich zu Zügen von Tausenden zusammenrotteten, um ihre Kirchen und Klöster vor Niederlegung zu bewahren, und daß sie das Nicolitische Militär, das mit der Exekutive betraut war, schimpflich davonjagten. Nach wie vor traten zu den Sektiererrevolten die Bauernrevolten, oder arteten in diese aus. Es war das religiöse Motiv im russischen Empörertum, das sich hernach mit dem sozialen des Kollektivismus und dem amoralischen des Nihilismus verband. Dostojewski selbst bestätigte den Nihilisten, daß sie von den Petraschewzen herstammten, obwohl diese noch keine Nihilisten gewesen waren. Aus seiner ersten Petersburger Zeit kannte Dostojewski alle die Vorformen des Nihilismus, alle die Dämonenmotive, die er dann in seiner Apokalypse des Nihilismus zusammentrug. In den Städten kam es damals zu ersten Arbeiterstreiks, und es ist gewiß kein Zufall, daß einer der Rädelsführer, eine Figur der vierziger Jahre, den Namen des "Fedjka" trug, den Dostojewski 20 Jahre später seinem nihilistischen Werkzug gab. Zwar war der Untersuchungsrichter im Petraschewzenprozeß im Unrecht gewesen, wenn er die wachsende Zahl der von ihren Bauern erschlagenen Gutsbesitzer, die der Brandstiftungen auf dem Lande und der Diebstähle und Einbrüche, auf die politische Rechnung der Angeklagten schrieb. Das waren Erscheinungen, die ohne Zutun der Petersburger Doktrinäre sich aus dem tumultuarischen Zuge der Bauernbewegung, die der Aufhebung der Leibeigenschaft voranging, freilich nicht mit ihr aufhörte, von selbst ergaben. Aber richtig ist anderseits, daß die Petraschewzen bereits im Prinzip und als Taktik eine Verbindung mit Leuten aus dem Volke suchten und in den Massen eine Aufklärung über die Unvollkommenheit der russischen Zustände verbreiteten. Eine sozialistische Auslegung der zehn Gebote, die als Werbeschrift ins Land wandern sollte, war in ihren Kreisen geplant gewesen. Die Zeit kündigte sich an, in der die Studenten "ins Volk gingen". Weibliche Literaturgesellschaften wurden gegründet, die Typ und Rolle der nihilistischen Studentin vorbereiteten. Und schon schloß sich die noch tastende Propaganda zu einem ausgesuchten System zusammen. Im Kreise der Petraschewzen war zuerst die Idee der "Fünf" ausgeheckt worden, die Dostojewski der so wüsten und doch so durchgeführten Komposition der "Dämonen" als Skelett zugrunde legte: die Idee eines großen politischen Bundes, in dem Gruppen der Tat, die einander nicht kannten, von geheimnisvoller Oberleitung abhingen. Der Bund nannte sich bei den Petraschewzen "die Gesellschaft der Propaganda", und einer von den Mitgliedern, der Gardeleutnant Montbelli, hatte gar eine "Brüderschaft der Leute von anarchischer Gesinnung zu gegenseitiger Hilfe" vorgeschlagen. Entwürfe für die Organisation solcher Verbände wurde im Ernste und mit Eifer erörtert. Und in nationalistischer, in nationalpolitischer Form sind damals zu Wilna, zu Minsk, zu Lida derartige Anschläge und Vorbereitungen auch tatsächlich aufgedeckt worden. Nicht zuletzt gehörten die geheimen Druckereien als rätselhafte Herkunftsorte massenhafter Flugschriften oder die geheimen Versammlungen der Petersburger Gesinnungsgenossen in entlegenen Städten Ingermannlands zu den Petraschewzenerscheinungen, die Dostojewski als Dämonenmotive auf den terroristischen Schauplatz einer ungenannten Gouvernementsstadt verlegte. Vor allem war der Mensch selbst zum Nihilisten geworden. Und in dem Entwurf eines "revolutionären Gesetzbuches", das jener Leutnant Palm verfaßt hatte, den Nicolai als einzigen aus dem Kreise der Petraschewzen begnadigte, steht schon der ganz nihilistische Satz: "Ich darf alles tun, was mir gefällt, weil jede meiner Handlungen das Ergebnis meiner Vernunft ist."
Dostojewski erkannte, daß ein solches Volk konservativ unterschichtet bleiben mußte. Er war kein Revolutionär, weil er den Punkt nicht suchte, von dem aus sich die Welt aus ihren Angeln heben läßt. Er suchte den Boden, auf dem sich ein Zusammenleben der Menschen ermöglichen ließ. Inzwischen war in Rußland die revolutionäre Ideologie nicht politische Phraseologie geblieben. Als Dostojewski in den fünfziger Jahren aus Sibirien und dann wieder in den sechziger Jahren aus dem Ausland zurückkehrte, ging von ersten Attentaten der rote Schrecken der nihilistischen Bewegung über das Land aus. Während Turgenjeff das Wort des Nihilismus fand, das allmählich auf die gesamte Zeitveranlagung übertragen wurde, und in ihr mit liberaler Gutgläubigkeit einen russischen Ausdruck des europäischen Positivismus sah, durchschaute Dostojewski den Dämon. Er wußte, daß der Nihilismus dem Menschen nichts zu geben hat, wie der Nihilist ein Mensch ist, der nichts zu verlieren hat. Schon die "Erinnerungen aus einem Totenhause" wurden deshalb nicht, war man von einem echten Petraschewzen hätte erwarten müssen: ein Buch der Anklage gegen den Staat, der liberalen Beschwerde oder der revolutionären Entrüstung, sondern ein slawophiles Bekenntnis mit einer menschlichen Botschaft. Man sollte dem Volke nicht sein Volkstum nehmen, weil man ihm sonst sein Menschtum nahm! Man sollte nicht Hand an das Volk legen! Und das Volk sollte nicht Hand an sich selbst legen! Beides geschah, wenn ein Ich ohne Volk über das Volk verfügte. Das hatte die Autokratie oft getan. Und dies tat jetzt der Nihilismus. Aber die Autokratie war wenigstens ein System für das Volk. Und die Orthodoxie war ein System für das Ich. Nun schrieb Dostojewski das "Tagebuch" und schuf die "Dämonen": bejahte den Geist über Rußland und trieb die Teufel des Nihilismus aus. Für das Volk nahm er den Kampf gegen die Revolution auf. Er stand in diesem Kampfe mit der Leidenschaft des Eiferers, mit den ungeheueren Kräften, die der schwächliche Mensch aus der Idee holt, von der er besessen ist. Es ist wahr, er ging in diesem Kampfe, den er selbst mit Hohn und mit jeder geistigen Überlegenheit führte, mit einfachsten Menschen zusammen: mit den echtrussischen Leuten: mit allzu russischen Leuten. Er ging freilich nicht minder überein mit den zusammengesetztesten, rätselhaftesten, unheimlichsten Russen, die ihr Volk kannten, mit dem Katholikos Tschaadajeff und dem Inquisitor Pobjedonoffeff. Auch dieses Wissen war in seiner Menschenkenntnis, daß der Mensch sogar für die Liebe zu schwach ist, die ihm gebracht wird, und daß sich mit ihr, wenn man sie nicht an den Menschen verschwenden, sondern den Menschen durch die Liebe behaupten will, Macht verbinden muß. Doch fuhr er fort, die Wahrheit zu suchen, die immer in der Einfachheit liegt, wenn sie aus dem Volke kommt. Über seine Verurteilung hatte er einst mit Ergebung in Erkenntnis gesagt: "Uns ist Recht geschehen: wenn man uns nicht verurteilt hätte, dann würde uns das Volk verurteilt haben." In den "Dämonen" ließ er Schatoff, den Russengläubigen, diesen Einzigen, dem er je die verhaltene Begeisterung eines vollsuchenden Helden gab und dessen Gestalt er wie die eines Jüngers liebte, das Wort sagen: "Wer kein Volk hat, der hat auch keinen Gott." Volk haben: das war für ihn gleichbedeutend mit Gott haben. Macht über das Volk: war Verantwortlichkeit für das Volk. Dostojewski war kein Reformator. Als Fanatiker hatte er die Massivität nicht, um das Volk durch Reformation vor der Revolution zu bewahren. Als Erscheinung blieb er in der Reihe der großen Problematiker, die in unserem Zeitalter von Rousseau bis Nietzsche geht, wenn er auch als Dichter die epische Form und als Denker das dogmatische Wort vor ihnen voraus hat. Aber als Mystiker wußte er, daß der Mensch seiner Unvollkommenheit überantwortet ist, und als Politiker, daß jede Opposition, die der Mensch aus Doktrin an den Unterbau und das Gefüge des Seienden setzt, nur die geringe Wichtigkeit einer Endlichkeit haben kann, die von einem Unendlichen umschlossen wird. Damit hob auch er sich auf die geistige Ebene, auf der alle großen Menschen gestanden haben, die ihr politisches Denken, das immer ein konservatives Denken war, in eine Übereinstimmung mit ihrem metaphysischen Bewußtsein brachten, so Augustin, wie Dante. Vor der Wahl zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit hatte auch er sich für das Ewige entschieden.
(Einführung zu: F. M. Dostojewski: Die Dämonen. Sämtliche Werke, Erste Abteilung: Fünfter Band. München und Leipzig: Piper, 1919.)
02:15 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 mai 2007
Le philologue Hans Naumann
Le philologue Hans Naumann
13 mai 1886: Naissance à Görlitz du Professeur Hans Naumann, philologue germanique, défenseur de l’identité allemande. C’est son ouvrage Deutsche Nation in Gefahr (1932) qui demeure toujours d’actualité, dans la mesure où il constitue une réponse aux thèses romanisantes de son collègue de l’Université de Bonn, Ernst Robert Curtius, que les Français de l’époque connaissaient bien, car il était à bien des égards proche de Maurras et écrivait notamment dans les colonnes de la Revue universelle. Ce débat sur l’identité allemande, sur l’esprit français, sur l’héritage de Rome demeure un corpus important pour qui veut comprendre les dynamiques historiques et ethnologiques à l’œuvre en Europe occidentale et centrale. Curtius représente le romanisme allemand, Naumann, le germanisme défensif. A lire parallèlement aux romanisants français (dont Maurras) et aux nombreux auteurs du filon germanisant en France, depuis Boulainvilliers et Gobineau (Robert Steuckers).
06:05 Publié dans Biographie, Histoire, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Reinhold Schneider: catholique impérial

Reinhold Schneider: catholique impérial
13 mai 1903: Naissance à Baden-Baden de l’historien et philosophe catholique impérial Reinhold Schneider. Armin Mohler le compte parmi les exposants catholiques et anti-nazis de la révolution conservatrice. L’importance de Schneider ne réside pas tant, à notre sens, dans ces positions politiques et religieuses, mais plutôt dans l’impact de sa découverte personnelle, à la suite de voyages, de la spiritualité politique portugaise et espagnole. Cette découverte et cette fascination s’expriment dans deux ouvrages : Das Leiden des Camoens oder Untergang und Vollendung der potugiesischen Macht (= La passion de Camoens ou le déclin et l’accomplissement de la puissance portugaise) et Philipp der Zweite oder Religion und Macht (= Philippe II ou la religion et la puissance). Reinhold Schneider a plutôt contribué à une révolution conservatrice portugaise et espagnole qu’à une révolution conservatrice allemande (Robert Steuckers).
04:35 Publié dans Biographie, Histoire, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 mai 2007
Edmund Schultz : photographe national-révolutionnaire
Edmund Schultz: photographe national-révolutionnaire
12 mai 1901: Naissance à Alexandrovo d’Edmund Schultz, Allemand de Pologne qui vécut à Berlin et à Kirchhorst, lieu de résidence des frères Jünger. Il est dans leur sillage à leur époque nationale révolutionnaire. Il est un excellent compagnon dans toutes les conversations, mais n’aime pas s’adonner à l’écriture. Sa contribution au mouvement national révolutionnaire du temps de Weimar est simple mais importante : il publie des recueils de photographies, qu’il fait préfacer par les deux frères. Edmund Schultz inaugure ainsi l’avènement d’un instrument politique : le livre de photographie, appelé à mobiliser les volontés par l’image (Robert Steuckers).
05:45 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 mai 2007
E. v. Salomon: Der tote Preusse

Der tote Preuße
Das verkörperte Abbild des 20. Jahrhunderts: Vor hundert
Jahren wurde der Schriftsteller Ernst von Salomon geboren
von Markus Klein - Fefunden auf: http://www.geocities.com/wbuecher/dertotepreusse.htm
Als "zu menschlich für Hitler" - so charakterisierte Carl Zuckmayer Ernst von Salomon in seinem Dossier über deutsche Künstler und Intellektuelle 1943/44 im Exil für den amerikanischen Geheimdienst. "Zu menschlich" ist sicher der falsche Begriff, aber wie anders hätte Zuckmayer den amerikanischen Universalisten Salomons Nominalismus verdeutlichen sollen?
Universalisten und Nominalisten sind nach Armin Mohlers Definition antagonistische Menschentypen. Der Universalist glaubt, daß der Wirklichkeit eine geistige Ordnung zugrunde liegt. Diese kann er nicht nur durchschauen, sondern auch definieren und formulieren. Er kann also auch seine Handlungen mit dieser universalen Ordnung in Übereinstimmung bringen, sie somit gar ordnungsphilosophisch und heilsgeschichtlich legitimieren. Der Nominalist hingegen zeichnet sich dadurch aus, daß für ihn die Allgemeinbegriffe dem Wirklichen durch den Menschen erst nachträglich verliehen worden sind. Hinzu kommt, daß er weder den Kampf als immer vermeidbar ansieht, noch ihn scheut, noch davor zurückschreckt, seinen Gegner - den er durchaus schätzen kann - im entscheidenden Falle zu vernichten. Keinesfalls jedoch (im Unterschied zum Universalisten) würde er einen Gegner nurdeswegen vernichten, weil dieser dem Glauben an eine andere geistige Ordnung anhängt.
Wie sehr die Amerikaner Universalisten sind, wird heute im Krieg gegen "das Böse" auf der Welt deutlicher denn je. Wer wollte, konnte es jedoch auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg erkennen. Ernst von Salomon war einer, der dies damals schon gesehen hat: "Ich schreibe jetzt, weil ich eine Zeit überbrücken will, bis wieder die Möglichkeit besteht, anständige Filme zu machen, und weil ich was gegen die Amerikaner habe, und das muß heraus, sonst platze ich."
Heimat bedeutete ihm nichts, Identität alles
Was dabei herauskam, war "Der Fragebogen" von 1951, und er war ein Fanal. Ernst von Salomon schrieb in ihm die Geschichte der ersten fünfzig Jahre des 20. Jahrhunderts, das "Wie-es-gewesen"-ist, einen - im Sinne Theodor Lessings - "Teppich, geknüpft aus Fäden aller Art". Mit bitterbösem Zynismus führte er durch seine Ausführlichkeit den Entnazifizierungsfragebogen der Amerikaner ad absurdum und setzte gleichzeitig zum Kampf um die Nation nach der zweiten deutschen Niederlage in jenem Jahrhundert an, den er schon nach der ersten so vehement begonnen hatte.
Damals schon hatte Ernst von Salomon auf sich aufmerksam gemacht, zunächst durch Taten in den Reihen der "Phantasten der Tat", wie sie Herbert Cysarz genannt hat, und seit 1930 durch eine Trilogie des deutschen Nachkrieges. Nichts anderes hatte ihn hier schon zur Niederschrift veranlaßt, als was ihn zum "Fragebogen" zwang: Die Suche nach der eigenen Identität und die der Deutschen, die sich nur durch die Erzählung finden lassen konnte - um sie hernach den universalistischen Ansprüchen der Siegermächte entgegenzusetzen.
Selbst wer zur Zeit des "Neuen Nationalismus" noch um seine literarisch verbrämten Paukenschläge herumgekommen war, den "Fragebogen" konnte keiner umgehen. Er stand als Monument souveränen deutschen Daseinsanspruches jeder ideologisch und geschichtsphilosophisch hergeleiteten Geschichtsschreibung entgegen. Er demaskierte die heilsgeschichtlich begründeten Legitimationen und die damit einhergehende und durch Begriffsumbesetzung funktionalisierte Pauschal- und Kausalgeschichtsschreibung. Ernst von Salomon reklamierte so erfolgreich bis zu seinem Lebensende für sich, "Den Deutschen" Stimme und damit Anspruch auf eigene Existenz zu verleihen: "Heute bin ich ein Vertreter der fünften Zone, der deutschen Zone, der Deutschen, die in der Zerstreuung leben wie die Juden. Wollen Sie etwas davon wissen? Der - täuschen wir uns nicht - weitaus größere Teil der Deutschen, der heute stumm ist, abwartend, mißtrauisch, angegriffen, ohne sich verteidigen zu können, wo er wirklich Verantwortung trug, kann nicht einfach als nichtexistent betrachtet werden. Ich habe das Glück, nicht zu diesen zu gehören, und von ihnen gehört zu werden."
Vor nunmehr einhundert Jahren wurde Ernst von Salomon am 25. September 1902 im damals preußischen Kiel geboren. Was ihn prägte, war die preußische Haltung, die Strenge gegen sich selbst, die preußischen Tugenden, und nicht zuletzt der "Preußische Sozialismus". Um diesen Staatsgeist Preußens drehte sich sein ganzes Leben; er war sein Ziehvater, sein Mythos, sein Ziel, und nicht zuletzt sein Surrogat für die zerstörte deutsche Identität. Heimat bedeutete ihm nichts, Identität alles. Dazu trug neben dem Elternhaus vor allem seine Erziehung im Königlich-Preußischen Kadetten-Vorkorps bei. Hier lernten die Kadetten staatliche Tugenden, bis sie durch Erlaß der alliierten Machthaber in Deutschland Ende 1918 in den tobenden Bürgerkrieg hineingeworfen wurden.
Auf Seiten der Sozialdemokraten in einem der von ihnen ins Leben gerufenen Freikorps glaubte er, unter deren Parole "Kampf dem Bolschewismus" den Staat zu schützen gegen internationalistische Bestrebungen. Die gleichfalls staatsauflösenden Tendenzen des liberalen Parteienstaates blieben den Freikorpskämpfern zunächst verborgen, und so ließen sie sich zum ersten Male in diesem Jahrhundert zu Zwecken mißbrauchen, die nicht die ihren waren, die ihrem Staatsdenken geradezu konträr waren. Sie schlugen im Auftrag der selbsternannten Regierung kommunistische Aufstände nieder, übten Polizeiaktionen aus und wurden unwissentlich zu Parteigängern einer ideologisch bestimmten Bürgerkriegspartei im Ringen um die Macht in Deutschland. In Weimar jedoch, eingesetzt zum Schutze der "Nationalversammlung", merkte von Salomon erstmals, daß er hier fehl am Platze war.
Er desertierte ins Baltikum, wo erstmals seit dem Kriege deutsche Truppen wieder auf dem Vormarsch waren. Er glaubte Deutschland an der Front zu finden, doch diese Front war keine deutsche: Die deutschen Truppen kämpften im Auftrag der Engländer gegen die Bolschewisten um die Sicherung des Nachkriegs-Status quo. Das begriffen sie indes erst, als die Engländer ihnen ob ihrer Erfolge in den Arm fielen und die deutsche Regierung sie fallen ließ und ächtete. Da eskalierte ihr Idealismus und wurde zum Exzeß. Die Anerkennung des Versailler Diktatfriedens machte sie innerlich frei. Sie glaubten sich als die letzten Deutschen überhaupt, wurden irregulär, kämpften und mordeten ohne Idee und ohne Ziel, bis sie sich geschlagen und verbittert um die Jahreswende 1919/20 ins Reich zurückziehen mußten. Hier aber erwartete sie Undank, Mißtrauen, ideologischer Haß und die Auflösung. So kam es, daß sie sich Kapp zur Verfügung stellten, der ohne Vorbereitung und völlig unzulänglich zu putschen versuchte. Als in der Folge des zwangsläufigen Scheiterns dieses Putsches die Gewerkschaften unter kommunistischer und internationalistischer Parole erneut die Macht in Deutschland zu übernehmen versuchten, ließ sich der Leutnant von Salomon als Zeitfreiwilliger in den Reihen der Wehrmacht, die das Ruhrgebiet "säuberte", erneut mißbrauchen.
Er glaubte, Deutschland an der Front zu finden
Anschließend trieb es ihn in die in dem ihr zugedichteten Rahmen nie existente "Organisation Consul" in dem Irrglauben, in dieser geheimen Widerstands- und Terrororganisation gegen die französischen Besatzer und gegen deutsche Kollaborateure die Republik zu untergraben. Unterbrochen nur durch die Kämpfe um Oberschlesien im Sommer 1921, wo die Franzosen durch die Unterstützung Kongreßpolens versuchten, Deutschland auch vom Osten her zu schwächen, verselbständigten sich diese Widerstandskämpfer immer mehr und entglitten der Reichswehr. Enttäuscht und desillusioniert über die Unzulänglichkeit des liberalen Staates verrannten sie sich in die Idee, durch politische Morde zugleich die Republik zu destabilisieren und die Grundlagen für eine "nationale Revolution" zu legen.
Ihre Aktionen gipfelten am 24. Juni 1922 im Mord an Walther Rathenau. In dem Juden Rathenau, der doch eigentlich "von vornherein auf der Seite seiner Gegner" stand (Harry Graf Kessler), hatten sie geglaubt - und wurden darin unterstützt von skrupellosen und zumeist deutsch-völkischen Parteipolitikern -, den einzig begnadeten Vertreter des Liberalismus zu erkennen, der der Republik Stabilität verleihen könnte und dies zum Schaden der Deutschen und zum Nutzen des internationalen Wirtschaftsimperialismus mißbrauchen würde. Aber eigentlich redeten sie sich nur etwas ein: "Es war die Demokratie, es war die politische Begründung, die wir suchten. Wir suchten welche - da war es, zum Beispiel - Erfüllungspolitik. Für uns war der Krieg nicht aus, für uns war die Revolution nicht beendet."
Zu der Zeit, als Ernst von Salomon erkannt hatte, daß dies nicht nur ein fataler und sträflicher Irrtum gewesen war, sondern daß er mit dem Mord auch gegen sein eigenes Gesetz, das Preußentum, verstoßen hatte, war es zu spät. Wegen Beihilfe zu Zuchthaus und Ehrverlust verurteilt, war die Zelle gleichwohl fruchtbar für ihn geworden. Hier hatte er sich gelöst von den völkischen und ideologischen Verblendungen, hatte begonnen, zu sich selbst zu finden. Weihnachten 1927 aufgrund einer Amnestie freigelassen, stieß er unmittelbar in Berlin in die Kreise des "Neuen Nationalismus" und geriet über seinen Bruder Bruno in die revolutionär-romantische Schleswig-Holsteinische Landvolkbewegung, der Hans Fallada in seinem Roman "Bauern, Bonzen und Bomben" ein Denkmal gesetzt hat.
Von September bis Dezember 1929 deshalb in Moabit inhaftiert, schrieb Ernst von Salomon unter hartnäckigem Zusetzen von Ernst Rowohlt, der in Salomon den künftigen Erfolgsautor witterte, sein erstes Buch: "Die Geächteten". Diese Autobiographie, "die zugleich so etwas wie eine Selbstbiographie der ganzen Zeit ist" (Paul Fechter), verdiente, wie Ernst Jünger in einer Besprechung schrieb, schon deshalb gelesen zu werden, "weil es das Schicksal der wertvollsten Schicht jener Jugend, die während des Krieges in Deutschland heranwuchs, erfaßte."
Der zweite Teil dieser Nachkriegstrilogie, die nahezu unlesbare und gleichwohl brisant-interessante "Stadt", entstand 1932: "Die Stadt war ein Versuch, eine Bestandsaufnahme, eine Übung literarischer Art, bei der ich es auf ganz gewisse abseitige Probleme des Schreibens absah. Der Stoff ist sicher interessant, doch ohne Verbindlichkeit für mich; er diente mir nur zu einer Verschärfung aller Fragestellungen." Und der dritte Teil, der Abschluß seines "Neuen Nationalismus", der zugleich sein literarisch schönstes Werk werden sollte, "Die Kadetten", war in der so andersartigen Wiener Atmosphäre entstanden. Hier lernte von Salomon im Winter 1932/33 auf Einladung Othmars Spanns dessen Austro-Universalismus kennen, um sich darob seiner preußischen Herkunft und seines eigenen Nominalismus' nur um so bewußter zu werden: "Alle großen Bewegungen in der Welt, das Christentum wie der Humanismus, wie der Marxismus, sie alle werden von einer Art Krankheit befallen, eine göttliche Krankheit, der erhabenen Pest des ganzheitlichen Anspruchs. Das macht die Dinge so einfach für den, der sich bekennen will, und so schwer für den, der sie betrachtet. Ich, ich bin kein Bekenner, ich bin ein leidenschaftlich beteiligter Betrachter. So wurde ich kein Nationalsozialist, und so mußte ich mich von Othmar Spann trennen."
Von Salomon repräsentiert die Wirren seiner Zeit
Zurück in Berlin, wo die NSDAP bemüht war, eine Stringenz zwischen sich und den Freikorps zu apologetisieren, war es erneut von Salomons vordringliches Anliegen, den Verfälschungen in der Geschichtsschreibung des Nachkrieges entgegenzuwirken. So entstanden seine beiden Bücher "Nahe Geschichte" und das monumentale "Buch vom deutschen Freikorpskämpfer" als Korrektive nationalsozialistischer Geschichtsklitterung. Als jedoch ernste Schwierigkeiten mit der NSDAP entstanden, zog er sich aus Rücksicht auf seine jüdische Lebensgefährtin, die er während des Dritten Reiches als seine Ehefrau ausgab, aus allen kompromittierenden Kreisen, unter anderem auch aus dem Kreis um Harro Schulze-Boysen, zurück und "emigrierte" als Drehbuchautor zur UFA.
Der Nationalsozialismus war für ihn - und Hitler voran - "der größte Verfälscher der deutschen Geschichte". Salomons und der Deutschen Dilemma aber bestand darin, daß der Krieg auch ein deutscher Daseinskampf war und nicht nur rassenideologische Züge trug. So mußten sie zwangsläufig wieder in die Phalanx der nationalsozialistisch verfälschten deutschen Schicksalsgemeinschaft einscheren. Erst 1944 sollte dieser Schulterschluß endgültig aufbrechen.
Doch daß die Sieger des Weltkrieges diese Verfälschung der deutschen Nation und ihres Daseinsanspruches nur zu gerne aufgriffen und darüber die deutsche Identität zu zerstören suchten, sollte Ernst von Salomon nach seinem "automatic arrest" von Mai 1945 bis September 1946 unverzüglich zum Kampf um deutsches Subjektbewußtsein treiben. Schon in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war ihm klar geworden, daß sich die Maßnahmen der Besatzungsmächte und ihrer deutschen Handlanger "nicht gegen einen Angeklagten richtet, sondern gegen ein Volk, dem bewiesen werden soll, daß es keine anständigen Menschen hervorzubringen vermochte, und daß ihm zu dienen in jedem Falle unanständig war." Dieses System aber empfand er als eines, "das eine fatale Ähnlichkeit mit jenem hat, das zu bekämpfen diejenigen Leute in der kleidsamen Uniform der Sieger in dieses Land gekommen sind". Gerade die Sieger nämlich überschritten das Maß der von ihnen den Deutschen auferlegten moralischen Beschränkungen weiter als jemals zuvor. Salomons Reaktion darauf war eindeutig: "... niemand mag es verargt werden, sich wohl zu hüten, mit einer Macht anzubinden, welche so groß ist, daß sie es in sich erträgt, die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki unter der Begleitung des Chorals ‚Onward, Christian Soldiers!' platzen zu lassen, ohne dabei selber zu platzen."
Ab Juni 1947 reifte in Ernst von Salomon der Plan, seine und die Geschichte der Deutschen im zwanzigsten Jahrhundert niederzuschreiben und den Deutschen als Lesern wie in einem Spiegel vorzuhalten. Über den "Fragebogen" hinaus noch bemühte er sich um Überwindung der ideologischen Weltbürgerkriegsfronten, die die Deutschen so unmittelbar spalteten. Sein Engagement, u.a. in den Reihen der aufkommenden und damals noch nicht eindeutig gesellschaftspolitisch orientierten Friedensbewegung, im Demokratischen Kulturbund Deutschland und für die Deutsche Friedens-Union brachte ihm jedoch Urteile und Verurteilungen ein, die von Unverständnis strotzten. Von "Nationalbolschewismus" über "Unverbesserlichkeit" bis hin zum "German enemy of Germany" reichte die Spannweite der Urteile, und immer wieder nahm ihn die eine oder die andere Partei in Beschlag, berief sich auf ihn als Zeugen und Mitstreiter, während die andere ihn verdammte.
Nur seine tatsächliche Identität als unideologisch bestimmter Deutscher wollte oder sollte nicht ins Bewußtsein gelangen. Die "Objektisierung" der Deutschen durch eine alle Bereiche erfassende langfristige Umerziehung war zu weitgehend, die Bereitschaft der besiegten und individualisierten Einzelnen zum Identitätswechsel zu groß gewesen, um Ernst von Salomon zu folgen. Sein Erfolg, auch der des "Fragebogens", blieb ein literarischer.
Absolute Toleranz gegen jede politische Idee
Sein Versuch, die Staatsidee Preußens in seinem posthum veröffentlichten Werk "Der tote Preuße" zu erklären und plausibel zu machen, wurde aufgrund des nur zu einem Drittel fertiggestellten Torsos ein Fehlschlag. Daß er sich als Schriftsteller und Drehbuchautor durch Trivialitäten seinen Lebensunterhalt und den seiner 1948 gegründeten Familie sichern mußte, wurde ihm zudem noch verübelt. Doch mit Veröffentlichungen im Zusammenhang mit seiner Bemühung um deutsche Selbstbehauptung war mit zunehmendem Alter der Bundesrepublik kein Geld mehr zu verdienen. Je weiter die um die Jahrhundertwende geborene Generation von der Bühne abtrat, desto geringer wurde der Bedarf und das Verständnis für solche Bemühungen. Spätestens 1968 war Ernst von Salomon zum lebenden und unverstandenen Fossil geworden - selbst für seine eigenen Nachkommen. Am 9. August 1972 starb er in Stöckte (Winsen/Luhe).
Ernst von Salomon ist das verkörperte Abbild des 20. Jahrhunderts, ist Exponent eines deutschen Geschichtsabschnitts, der - mit größerem Abstand - dereinst erneut "die deutsche Romantik" genannt werden könnte. Leidenschaftlich beteiligt an den vielschichtigen Abenteuern seiner Zeit repräsentiert er die oft fatalen Wirren und Brüche, mit denen die Deutschen in "seinem" Jahrhundert konfrontiert waren. Sein Leben stellt subjektiv wie objektiv eine stellvertretende Kontinuität dar, nämlich die der Deutschen in eben jener Zeit, die so von Ideologien überfrachtet war. An ihm ist die Geschichte und das wegen der dauernden Verfälschung zwangsläufige Scheitern der im eigentlichen Sinne - um ihrer Identität willen - unideologischen Deutschen in dieser Epoche nachzuvollziehen.
Salomons auf Schiller zurückgehender Idealismus, sein Engagement für absolute Toleranz gegen jede politische Idee macht ihn heute noch interessant. Nach dem Zusammenbruch der ideologischen Nachkriegsidentitäten, die die Deutschen so lange quer durch alle Lager getrennt haben, ist ein Wiederentdeckung von Salomons in Deutschland so begrüßenswert wie selten zuvor. Vielleicht könnten die Deutschen über ihn endlich einen unideologischen Zugang zu ihrer Geschichte und damit zu sich selbst finden.
05:05 Publié dans Biographie, Histoire, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 mai 2007
C. L. Dyrssen: prussianiste mystique

Carl Ludwig Dyrssen: prussianiste mystique
7 mai 1888: Naissance à New York de Carl Ludwig Dyrssen, exposant du “prussianisme mystique” au sein de la révolution conservatrice allemande du temps de la République de Weimar. Sa contribution à la révolution conservatrice, selon Mohler, se limite pour l’essentiel à un seul livre : Der Botschaft des Ostens (1933; = Le message de l’Est). Pour Dyrssen, la Grande Guerre de 14-18 est une lutte planétaire de l’Occident libéral et financier contre l’Est mystique, dont l’Allemagne est la pièce maîtresse.
Le fascisme serait une radicalisation de l’esprit occidental, avec un vernis catholique, tandis que le national socialisme, dont Dyrssen espère l’avènement, serait tout à la fois germanique et révolutionnaire. C’est qu’en ce sens que l’on parle de “prussianisme mystique”. La postérité n’a guère retenu cet ouvrage, jugé un peu confus. Mais dans ses Ecrits politiques, Evola l’évoque, dans une perspective critique, estimant que les positions de Dyrssen conduisent l’Allemagne à une alliance irréversible avec Moscou, désormais capitale non plus de l’Empire traditionnel des Slaves, mais de la révolution bolchevique (Robert Steuckers).
11:55 Publié dans Biographie, Histoire, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le "principe résistance" chez Niekisch

Le "principe résistance" chez Niekisch
Birgit RÄTSCH-LANGEJÜRGEN, Das Prinzip Widerstand. Leben und Wirken von Ernst Niekisch, Bouvier Verlag, Bonn, 1997, ISBN 3-416-02608-X, DM 49,80.
Dans cette étude universitaire sur la personnalité et les engagements politiques d'Ernst Niekisch, l'auteur ajoute, en fin de volume, une étude sur la réception de Niekisch dans les milieux qualifiés de "nouvelle droite" en Allemagne ("Neue Rechte"). Force est de constater qu'en Allemagne la distinction entre "nouvelle droite" et "nationalisme révolutionnaire" n'est pas aussi claire qu'en France. Ce qu'il est convenu d'appeler la "Neue Rechte", Outre-Rhin, tire une bonne part de ses origines du corpus nationaliste révolutionnaire des années 60 et du début des années 70. Ce corpus national-révolutionnaire allemand était engagé sur le plan social et fort similaire, dans ses démarches, au mouvement de 67/68, surtout dans sa lutte contre le duopole impérialiste de Yalta. Birgit Rätsch-Langejürgen retrace l'histoire de la réception de Niekisch par le groupe "Sache des Volkes" (= Cause du Peuple), par des auteurs comme Wolfgang Strauss, Wolfgang Venohr, Michael Vogt et Marcus Bauer. Elle montre également que la réception de Niekisch par les groupes NR a conduit à un glissement à "gauche", dans la mesure où, dans une structure comme le NRKA ("Commission NR de Coordination"), d'anciens militants communistes travaillent à déconstruire l'anti-égalitarisme présent dans le NR ouest-allemand, première mouture, afin de donner de la consistance au message solidariste de ces groupes: ces militants ex-communistes ont notamment analysé les positions de Niekisch dans la République des Conseils de Bavière. L'objectif final était de promouvoir une quintuple révolution, tout à la fois, nationale, socialiste, écologiste, culturelle et démocratique. Au début des années 80, en pleine contestation de l'installation de missiles américains sur le sol allemand, la critique traditionnelle des NR contre les deux superpuissances se mue en une volonté de renouer avec l'URSS, comme au temps de Niekisch, car l'URSS est la seule puissance capable de résister durablement au capitalisme globaliste. Dans la mosaïque très diversifiée des nouvelles droites allemandes, des divers partis nationalistes et des groupes NR, la réception de Niekisch a été "ambivalente", conclut Birgit Rätsch-Langejürgen.
06:20 Publié dans Hommages, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 mai 2007
E. v. Salomon: apprendre à mourir

APPRENDRE A MOURIR
Entretien avec Ernst von Salomon
 En France, ce n'est qu'au pays basque qu'on trouve également la croix gammée, tournée à l'envers d'ailleurs. Un Français nous éclaire à ce sujet : Gobineau avec sa théorie des races a joué un rôle important dans la littérature allemande et les nationaux-socialistes s'en sont inspirés tout les premiers ; on a, en littérature, évoqué la pureté de la race, quoiqu'aucun autre peuple ne soit aussi mélangé que le peuple allemand. Mais pour nous, c'était l'aspiration vers une unité, qui s'exprimait par la croix gammée. D'ailleurs cet emblème était parfois porté par la Brigade Erhardt, certains préféraient la tête de mort. C'est une très curieuse conception que de se sentir ainsi lié à la mort. Clemenceau l'avait déjà constaté, il a dit : «Les Allemands aiment la mort. Cela les différencie de tous les autres peuples.» Ceci s'applique aux Prussiens et non aux autres Allemands. Ils aiment la mort.
En France, ce n'est qu'au pays basque qu'on trouve également la croix gammée, tournée à l'envers d'ailleurs. Un Français nous éclaire à ce sujet : Gobineau avec sa théorie des races a joué un rôle important dans la littérature allemande et les nationaux-socialistes s'en sont inspirés tout les premiers ; on a, en littérature, évoqué la pureté de la race, quoiqu'aucun autre peuple ne soit aussi mélangé que le peuple allemand. Mais pour nous, c'était l'aspiration vers une unité, qui s'exprimait par la croix gammée. D'ailleurs cet emblème était parfois porté par la Brigade Erhardt, certains préféraient la tête de mort. C'est une très curieuse conception que de se sentir ainsi lié à la mort. Clemenceau l'avait déjà constaté, il a dit : «Les Allemands aiment la mort. Cela les différencie de tous les autres peuples.» Ceci s'applique aux Prussiens et non aux autres Allemands. Ils aiment la mort. Il en a toujours été ainsi, dans tous mes livres ultérieurs. Ainsi dans Le Questionnaire où je me suis servi de simples questions objectives, entremêlées, pour raconter le procès vécu, pour dérouler le fil rouge des faits avec tout ce qui s'y trouvait.
Il en a toujours été ainsi, dans tous mes livres ultérieurs. Ainsi dans Le Questionnaire où je me suis servi de simples questions objectives, entremêlées, pour raconter le procès vécu, pour dérouler le fil rouge des faits avec tout ce qui s'y trouvait.
06:15 Publié dans Entretiens, Histoire, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 mai 2007
Der doppelte Ernst (v. Salomon)
| © JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH & Co. http://www.jungefreiheit.de/ 10/98 27. Februar 1998 |  | |
Der doppelte Ernst von Hans P. Rissmann Ernst von Salomon gilt als ein Meister des ironischen Stils. Der 1902 in Kiel geborene Salomon schloß sich 1918 den Freikorps an, kämpfte im Baltikum und in Oberschlesien. Er wurde hochdekoriert und erreichte den Offiziersrang. Durch den Kontakt zur "Brigade Ehrhardt" ließ er sich in den Mordanschlag auf den Reichsaußenminister Walter Rathenau verwickeln. Salomon wurde wegen Mittäterschaft zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Begegnung mit Ernst Jünger 1929 in Berlin wird für Ernst von Salomon zu einem entscheidenden Ereignis. Durch Jünger erhält er den Anstoß, schriftstellerisch tätig zu werden. Seine Bücher "Die Geächteten", "Die Stadt", "Die Kadetten" werden in Deutschland zu Bestsellern. Vor allem aber "Der Fragebogen", in dem Salomon die Absurdität des Alliierten Frageborgens zur Entnazifizierung der 1945 Besiegten durch eine Mega-Autobiographie als Beantwortung auf die Spitze trieb, macht seinen Ruhm aus. Im "Fragebogen" schließlich beschreibt Salomon auf seine ihm typische, leicht ironische Weise die Begegnung mit dem älteren und situierteren Jünger: MEHR :http://www.geocities.com/wbuecher/derdoppelteernst.htm |
05:00 Publié dans Histoire, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 mai 2007
Passaggi al bosco - E. Jünger nell'era dei titani
Bonesio, Luisa & Resta, Catarina
Passagio al bosco. Ernst Jünger nell'era dei titani
Milano, Mimesis, 2000, pp. 223, ISBN - 88-87231-92-3
Recensione di Sandro Gorgone - 26/04/2001
Questa monografia sull'opera del poliedrico scrittore e saggista tedesco morto nel 1998 alla veneranda età di 103 anni, colma una notevole lacuna nel panorama italiano della letteratura filosofica. In una complessiva ricognizione del suo pensiero, essa tratta i temi su cui principalmente si è soffermato Ernst Jünger nei suoi innumerevoli scritti (la cui traduzione in lingua italiana è ormai in stato avanzato): la modernità, il nichilismo, la tecnica, l'osservazione della natura e i futuri assetti planetari, privilegiando soprattutto la riflessione jüngeriana posteriore alla sua opera più celebre e commentata, Der Arbeiter, che vide la luce nel 1932. Le due autrici, autorevoli studiose del pensiero del Novecento, pur accostandosi a Jünger da prospettive e con interessi differenti, si muovono comunque in un medesimo orizzonte ermeneutico. I vari saggi che compongono questo volume seguono, con uno stile piano ed un linguaggio mai per soli addetti ai lavori, lo svolgersi di una scrittura cristallina e letterariamente pregevolissima (Jünger fu insignito del premio Goethe) che "diviene specchio, depurato da ogni enfasi soggettivistica, delle innumerevoli sfaccettature della natura e della vita del singolo, attraverso lo scandaglio di figure e concetti (il Waldgänger, l'Anarca, La Natura, la Tecnica, il ritorno dell'arcaico e la fine della storia) analizzati al di là di quei pregiudiziali quanto riduttivi approcci che troppo spesso hanno finora impedito un reale confronto con uno dei pensieri più lucidi e preveggenti di questo secolo" (dalla quarta di copertina).
Nella prima parte Caterina Resta segue l'avvicendarsi delle varie figure della "soggettività" nelle opere di Jünger e il delinearsi di ordini planetari e processi di globalizzazione che egli intuì con straordinaria acutezza molti anni prima della loro piena manifestazione, scorgendo l'implicazione necessaria tra dominio totale della tecnica ed unificazione politica (teoria dello Stato mondiale) e spirituale del mondo.
Dopo aver analizzato il modo in cui l'Operaio [Der Arbeiter], il nuovo Soggetto forgiato sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, mobilita il mondo attraverso la tecnica, trasformando lo spazio della nostra civilizzazione (da intendersi in senso spengleriano) in un cantiere, in un paesaggio da officina, ed entrando così in rapporto con le forze elementari della Terra, Resta ci mostra come questa evocazione del tellurico inauguri una progressiva ed inesorabile dissoluzione degli antichi ordini morali, spirituali e politici, di quel secolare Nomos della Terra di cui Carl Schmitt, costante e decisivo interlocutore di Jünger, ci ha narrato storia e decadenza. Ma l'accelerazione della tecnica non è infinita; essa tende ad uno stadio di 'perfezione' in cui si rivela il centro immobile del movimento titanico che scuote il mondo. Alle soglie del Muro del tempo la Forma compiuta, in cui l'esistenza storica si cristallizza, raggiunge la sua immagine 'eterna' e «la storia dell'uomo incontra quella della terra, che procede per ere geologiche e lente stratificazioni, fino ad inserirsi in quella del cosmo» (p. 25). Ma ben presto Jünger si accorge che il Tipo dell'Operaio non può condurre lungo questo rischioso passaggio perché la sua "volontà di potenza", che si attua come pianificazione calcolante del reale, è incapace di realizzare l'"inclusione" cosmica dell'umanità.
È il Waldgänger [colui che passa al bosco] che, nel ritorno alle energie primarie della Madre Terra, della terra selvaggia [die Wildnis], riesce, se pure con estremo rischio, a guadagnare uno spazio di resistenza spirituale e di sovranità interiore inattaccabili dalla potenza annientante della tecnica. Figura solitaria e dis-sociata, il Waldgänger resiste in quanto si abbandona alla legge segreta della Terra e al limite che disegna il mistero del bosco, che Jünger pensa come spazio simbolico di liberazione e rigenerazione. Anche l'Anarca - figura tratteggiata soprattutto in Eumeswil - resiste, in quanto interprete di istanze naturali, al potere dello Stato e della società, ma, a differenza del Waldgänger, egli vive apparentemente integrato nel sistema sociale e politico in cui si trova, sebbene realmente sia del tutto indifferente ad esso. Dopo aver messo in luce affinità e differenze dell'Anarca jüngeriano rispetto all'anarchico di concezione stirneriana, Resta si sofferma sull'«esistenza insulare» dell'Anarca che, abbandonato ogni atteggiamento attivistico ed oppositivo, si consacra ad una pratica quasi ascetica di svuotamento da ogni residuo soggettivistico e di distacco dalla realtà.
L'incantata contemplazione della natura sentita come un tutto vivente e la passione di Jünger per l'entomologia intesa come scienza descrittiva delle forme più elementari della vita, sono l'oggetto del quarto capitolo della prima parte. Ciò che attira l'attenzione di Jünger è la strettissima connessione nell'incessante divenire della natura tra potenza generativa e apparente distruzione: ma ad uno sguardo sensibile al tralucere nel visibile dell'invisibile, ogni terreno svanire rimanda ad un regno di incorruttibile bellezza ed ogni cosa che si annienta viene restituita, come un distillato, al suo puro elemento spirituale: «Altra custodia non si dà, per chi soggiorna nel tempo ed è soggetto alla sua implacabile opera di distruzione, se non in quell'invisibile di cui ogni apparenza risplende e brucia» (p. 71). All'uomo che contempla il prodigioso spettacolo della natura è affidato il compito di testimoniare e custodire il misterioso trasfigurarsi di tutto ciò che trapassa, quella «bellezza trascendente che fiammeggia attraverso il fuggevole ordine mondano» (E. Jünger, Il contemplatore solitario).
Infine Resta analizza i modi in cui il carattere totale del lavoro consente all'Operaio di esercitare il dominio tecnico su scala planetaria e di avviare un processo irreversibile di unificazione politica (sullo Stato mondiale [Weltstaat] Jünger ha scritto pagine decisive e profetiche) e spirituale del mondo: l'uniformizzazione tecnica delle scienze, delle arti e del pensiero sembra inarrestabile. Ma, a differenza dei numerosi studi sul tema della globalizzazione, Jünger qui sottolinea non tanto l'aspetto economico e sociale di questi processi, quanto l'ineluttabile oscurarsi ed impoverirsi dei tempi che solo tramite una conversione spirituale - significativi sono a tale proposito i suoi ripetuti appelli ad una "nuova teologia" - potrebbero condurre ad una rinascita.
Nella seconda parte Luisa Bonesio scandaglia le varie forme in cui si manifesta quella pietas religiosa con cui Jünger si accosta ai misteri della natura e le diverse strategie di osservazione che gli consentono di coglierne le enigmatiche meraviglie. Fondamentale è, per Bonesio, nella scrittura di Jünger l'impegno alla descrizione esatta, impeccabile della natura, che, in un'epoca segnata dalla complessiva mancanza di stile, si carica di una decisiva valenza etica,: «salvare le forme nel linguaggio appare a Jünger come uno dei più importanti compiti epocali» (p. 142). L'incantesimo delle immagini, in cui si rivela il valore ontologico del bello, presuppone misura, distanza e occhio acuto, e soprattutto quella sensibilità "stereoscopica" che consente di percepire le valenze tattili delle forme osservate accrescendo, così, lo stupore di fronte allo spettacolo della natura. Per Jünger la percezione della bellezza è una forma di «reminiscenza e di nostalgia - pressoché del tutto precluse dalla visione materialistica del mondo - dell'appartenenza a un regno da cui l'umanità si è esclusa progressivamente [...] Portare l'uomo nella giusta posizione di fronte all'universo è dunque il compito più importante, cui le "contemplazioni" di Jünger contribuiscono in un modo ineguagliato nel Novecento» (pp. 144-145). Tale visione della natura che richiama da un lato la concezione tipica delle culture tradizionali e dall'altro rinvia al pensiero orientale, implica un ridimensionamento e quasi un rovesciamento dell'antropocentrismo: in ogni aspetto del mondo naturale l'uomo può rispecchiarsi e trarre insegnamenti: ogni cosa vivente è, come l'uomo, sembianza, simulacro di un "totalmente Altro", geroglifico dell'indicibile, immagine dell'invisibile; tutti i fenomeni sono legati da una universale analogia e l'intemporalità dei modelli regna sopra la caducità degli individui. Una profonda vena neoplatonica attraversa, dunque, la contemplazione jüngeriana della natura, insieme con una incontestabile ispirazione metafisico-religiosa: l'intera natura vivente esprime "venerazione" con la sua stessa esistenza nei confronti di quel mistero che si manifesta indisvelabile in ogni immagine di ciò che è. La dimensione sacra di avvicinamento a questa immagine accoglie le opere e i pensieri dell'uomo che, al di là dell'erosione simbolica del mondo operata dalla tecnica, si incammina sulle tracce del «grande reticolo del tutto».
Ma ciò su cui maggiormente si concentrano le riflessioni di Bonesio è la «ritrascrizione in chiave geologica e paleontologica del rapporto dell'uomo moderno con la natura» con cui Jünger riporta «l'attenzione sulla vita del regno minerale, sui suoi linguaggi, le sue leggi e le sue misure temporali al cui confronto l'enfasi moderna sulle meraviglie e i poteri della tecnica appare risibile» (p. 160). Il grande rivolgimento operato dal dominio planetario della tecnica si manifesta in uno sconvolgimento tellurico: ad emergere è la dimensione geologica dell'elementare attraverso una progressiva disanimazione ed una irreversibile metallificazione del mondo. Ma tale irresistibile estendersi del deserto, dell'uniforme e dell'indifferenziato è interpretato da Jünger come il simbolo di quel necessario "imbiancamento" che prelude ad una svolta epocale, a quel Grande Passaggio al di là del muro del tempo in cui l'accelerazione della tecnica si risolve nella quiete "perfetta" di una esitante aurora.
Ciò a cui, per Bonesio, sollecita l'intera opera di Jünger è un «pensiero della Terra nel suo insieme, nella sua sostanziale unità» (p. 164), al di là della frammentazione delle prospettive, che si rivolga verso quella connessione organica di tutti gli aspetti della vita terrestre che, paradossalmente, proprio la tecnica nei suoi effetti distruttivi, rende sempre più evidente. La Modernità è incapace di riconoscere l'esistenza di tutte le dimensioni della vita dell'uomo sulla Terra e della vita della Terra stessa: la sua razionalità non può non trascurare quella direttrice simbolica verticale che dispone l'esistenza della natura, ed in essa dell'uomo, nella polarità Cielo-Terra e fonda quella superiore armonia invisibile che, misconosciuta e violentata dall'attivismo tecnico, si impone comunque, nel modo più traumatico, attraverso il sollevamento del fondo primordiale. Solo una "geografia verticale" in uno con il recupero di una sensibilità "fisiognomica" in grado di riconoscere l'espressività delle forme, può consentire, secondo le riflessioni di Bonesio, una prognosi del futuro e l'accesso alla dimensione simbolica profonda della realtà indivisa del cosmo, cui l'uomo è destinato ad appartenere nonostante i suoi incessanti slanci faustiani.
Indice
Prefazione. Parte prima (di Caterina Resta): I) L'imboscato. II) Il Waldgänger. III) L'Anarca. IV) Tra visibile e invisibile. V) Verso assetti planetari. Parte seconda (di Luisa Bonesio): I) L'uniforme del mondo. II) Immagini e avvicinamenti. Il significato della natura. III) Una geografia verticale. IV) Il cannocchiale dell'archeologo: tempo geologico e tempo umano. V) Il rebus e il cristallo. Immagini della vita nella scrittura diaristica.
Le autrici
Luisa Bonesio insegna Estetica nell'Università di Pavia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La ragione estetica, Milano, Guerini, 1990; La terra invisibile, Milano, Marcos y Marcos, 1993; Geofilosofia del paesaggio, Milano, Mimesis, 1997. Ha curato il volume di AA.VV., L'anima del paesaggio tra estetica e geografia, Milano, Mimesis 1999 e i volumi, di cui è anche coautrice, insieme a C. Resta, Geofilosofia, Sondrio, Lyasis, 1996; Appartenenza e località: l'uomo e il territorio, Milano, SEB, 1996 e Orizzonti della geofilosofia. Terra e luoghi nell'epoca della mondializzazione, Casalecchio, Arianna, 2000.
Caterina Resta insegna Filosofia Teoretica nell'Università di Messina. Tra i suoi ultimi lavori: Pensare al limite. Tracciati di Derrida, Milano, Guerini, 1990; Il luogo e le vie. Geografie del pensiero in M. Heidegger, Milano, Angeli, 1996; La Terra del mattino. Ethos, Logos e Physis nel pensiero di M. Heidegger, Milano, Angeli, 1998 e Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso, Roma, Pellicani 1999.
06:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
C. Schmitt: la cuestion del poder
| |
 |
06:05 Publié dans Droit / Constitutions, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 mai 2007
Notes on O. Spengler (Engl.)
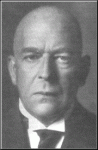
Oswald Spengler
![]() Oswald Spengler was born in Blankenburg (Harz) in central Germany in 1880, the eldest of four children, and the only boy. His mother's side of the family was quite artistically bent. His father, who had originally been a mining technician and came from a long line of mineworkers, was an official in the German postal bureaucracy, and he provided his family with a simple but comfortable middle class home.
Oswald Spengler was born in Blankenburg (Harz) in central Germany in 1880, the eldest of four children, and the only boy. His mother's side of the family was quite artistically bent. His father, who had originally been a mining technician and came from a long line of mineworkers, was an official in the German postal bureaucracy, and he provided his family with a simple but comfortable middle class home.
The young Oswald never enjoyed the best of health, and suffered from migraine headaches that were to plague him all his life. He also had an anxiety complex, though he was not without grandiose thoughts -- which because of his frail constitution had to be acted out in daydreams only.
When he was ten the family moved to the university city of Halle. Here Spengler received a classical Gymnasium education, studying Greek, Latin, mathematics and natural sciences. Here too he developed his strong affinity for the arts -- especially poetry, drama, and music. He tried his hand at some youthful artistic creations of his own, a few of which have survived -- they are indicative of a tremendous enthusiasm but not much else. At this time also he came under the influence of Goethe and Nietzsche, two figures whose importance to Spengler the youth and the man cannot be overestimated.
After his father's death in 1901, Spengler at 21 entered the University of Munich. In accordance with German student-custom of the time, after a year he proceeded to other universities, first Berlin and then Halle. His main courses of study were in the classical cultures, mathematics, and the physical sciences. His university education was financed in large part by a legacy from a deceased aunt.
His doctoral dissertation at Halle was on Heraclitus, the "dark philosopher" of ancient Greece whose most memorable line was "War is the Father of all things." He failed to pass his first examination because of "insufficient references" -- a characteristic of all his later writings that some critics took a great delight in pointing out. However, he passed a second examination in 1904, and then set to writing the secondary dissertation necessary to qualify as a high school teacher. This became The Development of the Organ of Sight in the Higher Realms of the Animal Kingdom. It was approved, and Spengler received his teaching certificate.
His first post was at a school in Saarbrücken. Then he moved to Düsseldorf and, finally, Hamburg. He taught mathematics, physical sciences, history, and German literature, and by all accounts was a good and conscientious instructor. But his heart was not really in it, and when in 1911 the opportunity presented itself for him to "go his own way" (his mother had died and left him an inheritance that guaranteed him a measure of financial independence), he took it, and left the teaching profession for good.
Historical Explanation of Current Trends
He settled in Munich, there to live the life of an independent scholar/philosopher. He began the writing of a book of observations on contemporary politics whose idea had preoccupied him for some time. Originally to be titled Conservative and Liberal, it was planned as an exposition and explanation of the current trends in Europe -- an accelerating arms race, Entente "encirclement" of Germany, a succession of international crises, increasing polarity of the nations -- and where they were leading. However in late 1911 he was suddenly struck by the notion that the events of the day could only be interpreted in "global" and "total-cultural" terms. He saw Europe as marching off to suicide, a first step toward the final demise of European culture in the world and in history.
The Great War of 1914-1918 only confirmed in his mind the validity of a thesis already developed. His planned work kept increasing in scope far, far beyond the original bounds.
Spengler had tied up most of his money in foreign investments, but the war had largely invalidated them, and he was forced to live out the war years in conditions of genuine poverty. Nevertheless he kept at his work, often writing by candle-light, and in 1917 was ready to publish. He encountered great difficulty in finding a publisher, partly because of the nature of the work, partly because of the chaotic conditions prevailing at the time. However in the summer of 1918, coincident with the German collapse, finally appeared the first volume of The Decline of the West, subtitled Form and Actuality.
Publishing Success
To no little surprise on the part of both Spengler and his publisher, the book was an immediate and unprecedented success. It offered a rational explanation for the great European disaster, explaining it as part of an inevitable world-historic process. German readers especially took it to heart, but the work soon proved popular throughout Europe and was quickly translated into other languages. Nineteen-nineteen was "Spengler's year," and his name was on many tongues.
Professional historians, however, took great umbrage at this pretentious work by an amateur (Spengler was not a trained historian), and their criticisms -- particularly of numerous errors of fact and the unique and unapologetic "non-scientific" approach of the author -- filled many pages. It is easier now than it was then to dispose of this line of rejection-criticism. Anyway, with regard to the validity of his postulate of rapid Western decline, the contemporary Spenglerian need only say to these critics: Look about you. What do you see?
In 1922 Spengler issued a revised edition of the first volume containing minor corrections and revisions, and the year after saw the appearance of the second volume, subtitled Perspectives of World History. He thereafter remained satisfied with the work, and all his later writings and pronouncements are only enlargements upon the theme he laid out Decline.
A Direct Approach
The basic idea and essential components of The Decline of the West are not difficult to understand or delineate. (In fact, it is the work's very simplicity that was too much for his professional critics.) First, though, a proper understanding requires a recognition of Spengler's special approach to history. He himself called it the "physiogmatic" approach -- looking things directly in the face or heart, intuitively, rather than strictly scientifically. Too often the real meaning of things is obscured by a mask of scientific-mechanistic "facts." Hence the blindness of the professional "scientist-type" historians, who in a grand lack of imagination see only the visible.
Utilizing his physiogmatic approach, Spengler was confident of his ability to decipher the riddle of History -- even, as he states in Decline's very first sentence, to predetermine history.
The following are his basic postulates:
1. The "linear" view of history must be rejected, in favor of the cyclical. Heretofore history, especially Western history, had been viewed as a "linear" progression from lower to higher, like rungs on a ladder -- an unlimited evolution upward. Western history is thus viewed as developing progressively: Greek ' Roman ' Medieval ' Renaissance ' Modern, or, Ancient ' Medieval ' Modern. This concept, Spengler insisted, is only a product of Western man's ego -- as if everything in the past pointed to him, existed so that he might exist as a yet-more perfected form.
This "incredibly jejune and meaningless scheme" can at last be replaced by one now discernible from the vantage-point of years and a greater and more fundamental knowledge of the past: the notion of History as moving in definite, observable, and -- except in minor ways -- unrelated cycles.
'High Cultures'
2. The cyclical movements of history are not those of mere nations, states, races, or events, but of High Cultures. Recorded history gives us eight such "high cultures": the Indian, the Babylonian, the Egyptian, the Chinese, the Mexican (Mayan-Aztec), the Arabian (or "Magian"), the Classical (Greece and Rome), and the European-Western.
Each High Culture has as a distinguishing feature a "prime symbol." The Egyptian symbol, for example, was the "Way" or "Path," which can be seen in the ancient Egyptians' preoccupation -- in religion, art, and architecture (the pyramids) -- with the sequential passages of the soul. The prime symbol of the Classical culture was the "point-present" concern, that is, the fascination with the nearby, the small, the "space" of immediate and logical visibility: note here Euclidean geometry, the two-dimensional style of Classical painting and relief-sculpture (you will never see a vanishing point in the background, that is, where there is a background at all), and especially: the lack of facial expression of Grecian busts and statues, signifying nothing behind or beyond the outward.
The prime symbol of Western culture is the "Faustian Soul" (from the tale of Doctor Faustus), symbolizing the upward reaching for nothing less than the "Infinite." This is basically a tragic symbol, for it reaches for what even the reacher knows is unreachable. It is exemplified, for instance, by Gothic architecture (especially the interiors of Gothic cathedrals, with their vertical lines and seeming "ceilinglessness").
The "prime symbol" effects everything in the Culture, manifesting itself in art, science, technics and politics. Each Culture's symbol-soul expresses itself especially in its art, and each Culture has an art form that is most representative of its own symbol. In the Classical, they were sculpture and drama. In Western culture, after architecture in the Gothic era, the great representative form was music -- actually the pluperfect expression of the Faustian soul, transcending as it does the limits of sight for the "limitless" world of sound.
'Organic' Development
3. High Cultures are "living" things -- organic in nature -- and must pass through the stages of birth-development-fulfillment-decay-death. Hence a "morphology" of history. All previous cultures have passed through these distinct stages, and Western culture can be no exception. In fact, its present stage in the organic development-process can be pinpointed.
The high-water mark of a High Culture is its phase of fulfillment -- called the "culture" phase. The beginning of decline and decay in a Culture is the transition point between its "culture" phase and the "civilization" phase that inevitably follows.
The "civilization" phase witnesses drastic social upheavals, mass movements of peoples, continual wars and constant crises. All this takes place along with the growth of the great "megalopolis" -- huge urban and suburban centers that sap the surrounding countrysides of their vitality, intellect, strength, and soul. The inhabitants of these urban conglomerations -- now the bulk of the populace -- are a rootless, soulless, godless, and materialistic mass, who love nothing more than their panem et circenses. From these come the subhuman "fellaheen" -- fitting participants in the dying-out of a culture.
With the civilization phase comes the rule of Money and its twin tools, Democracy and the Press. Money rules over the chaos, and only Money profits by it. But the true bearers of the culture -- the men whose souls are still one with the culture-soul -- are disgusted and repelled by the Money-power and its fellaheen, and act to break it, as they are compelled to do so -- and as the mass culture-soul compels finally the end of the dictatorship of money. Thus the civilization phase concludes with the Age of Caesarism, in which great power come into the hands of great men, helped in this by the chaos of late Money-rule. The advent of the Caesars marks the return of Authority and Duty, of Honor and "Blood," and the end of democracy.
With this arrives the "imperialistic" stage of civilization, in which the Caesars with their bands of followers battle each other for control of the earth. The great masses are uncomprehending and uncaring; the megalopoli slowly depopulate, and the masses gradually "return to the land," to busy themselves there with the same soil-tasks as their ancestors centuries before. The turmoil of events goes on above their heads. Now, amidst all the chaos of the times, there comes a "second religiosity"; a longing return to the old symbols of the faith of the culture. Fortified thus, the masses in a kind of resigned contentment bury their souls and their efforts into the soil from which they and their culture sprang, and against this background the dying of the Culture and the civilization it created is played out.
Predictable Life Cycles
Every Culture's life-span can be seen to last about a thousand years: The Classical existed from 900 BC to 100 AD; the Arabian (Hebraic-semitic Christian-Islamic) from 100 BC to 900 AD; the Western from 1000 AD to 2000 AD. However, this span is the ideal, in the sense that a man's ideal life-span is 70 years, though he may never reach that age, or may live well beyond it. The death of a Culture may in fact be played out over hundreds of years, or it may occur instantaneously because of outer forces -- as in the sudden end of the Mexican Culture.
Also, though every culture has its unique Soul and is in essence a special and separate entity, the development of the life cycle is paralleled in all of them: For each phase of the cycle in a given Culture, and for all great events affecting its course, there is a counterpart in the history of every other culture. Thus, Napoleon, who ushered in the civilization phase of the Western, finds his counterpart in Alexander of Macedon, who did the same for the Classical. Hence the "contemporaneousness" of all high cultures.
In barest outline these are the essential components of Spengler's theory of historical Culture-cycles. In a few sentences it might be summed up:
Human history is the cyclical record of the rise and fall of unrelated High Cultures. These Cultures are in reality super life-forms, that is, they are organic in nature, and like all organisms must pass through the phases of birth-life-death. Though separate entities in themselves, all High Cultures experience parallel development, and events and phases in any one find their corresponding events and phases in the others. It is possible from the vantage point of the twentieth century to glean from the past the meaning of cyclic history, and thus to predict the decline and fall of the West.
Needless to say, such a theory -- though somewhat heralded in the work of Giambattista Vico and the 19th-century Russian Nikolai Danilevsky, as well as in Nietzsche -- was destined to shake the foundations of the intellectual and semi-intellectual world. It did so in short order, partly owing to its felicitous timing, and partly to the brilliance (though not unflawed) with which Spengler presented it.
Polemic Style
There are easier books to read than Decline -- there are also harder -- but a big reason for its unprecedented (for such a work) popular success was the same reason for its by-and-large dismissal by the learned critics: its style. Scorning the type of "learnedness" that demanded only cautionary and judicious statements -- every one backed by a footnote -- Spengler gave freewheeling vent to his opinions and judgments. Many passages are in the style of a polemic, from which no disagreement can be brooked.
To be sure, the two volumes of Decline, no matter the opinionated style and unconventional methodology, are essentially a comprehensive justification of the ideas presented, drawn from the histories of the different High Cultures. He used the comparative method which, of course, is appropriate if indeed all the phases of a High Culture are contemporaneous with those of any other. No one man could possibly have an equally comprehensive knowledge of all the Cultures surveyed, hence Spengler's treatment is uneven, and he spends relatively little time on the Mexican, Indian, Egyptian, Babylonian, and Chinese -- concentrating on the Arabian, Classical, and Western, especially these last two. The most valuable portion of the work, as even his critics acknowledge, is his comparative delineation of the parallel developments of the Classical and Western cultures.
Spengler's vast knowledge of the arts allowed him to place learned emphasis on their importance to the symbolism and inner meaning of a Culture, and the passages on art forms are generally regarded as being among the more thought-provoking. Also eyebrow-raising is a chapter (the very first, in fact, after the Introduction) on "The Meaning of Numbers," in which he asserted that even mathematics -- supposedly the one certain "universal" field of knowledge -- has a different meaning in different cultures: numbers are relative to the people who use them.
"Truth" is likewise relative, and Spengler conceded that what was true for him might not be true for another -- even another wholly of the same culture and era. Thus Spengler's greatest breakthrough may perhaps be his postulation of the non-universality of things, the "differentness" or distinctiveness of different people and cultures (despite their fated common end) -- an idea that is beginning to take hold in the modern West, which started this century supremely confident of the wisdom and possibility of making the world over in its image.
Age of Caesars
But is was his placing of the current West into his historical scheme that aroused the most interest and the most controversy. Spengler, as the title of his work suggests, saw the West as doomed to the same eventual extinction that all the other High Cultures had faced. The West, he said, was now in the middle of its "civilization" phase, which had begun, roughly, with Napoleon. The coming of the Caesars (of which Napoleon was only a foreshadowing) was perhaps only decades away. Yet Spengler did not counsel any kind of sighing resignation to fate, or blithe acceptance of coming defeat and death. In a later essay, Pessimism? (1922), he wrote that the men of the West must still be men, and do all they could to realize the immense possibilities still open to them. Above all, they must embrace the one absolute imperative: The destruction of Money and democracy, especially in the field of politics, that grand and all-encompassing field of endeavor.
'Prussian' Socialism
After the publication of the first volume of Decline, Spengler's thoughts turned increasingly to contemporary politics in Germany. After experiencing the Bavarian revolution and its short-lived Soviet republic, he wrote a lender volume titled Prussianism and Socialism. Its theme was that a tragic misunderstanding of the concepts was at work: Conservatives and socialists, instead of being at loggerheads, should united under the banner of a true socialism. This was not the Marxist-materialist abomination, he said, but essentially the same thing as Prussianism: a socialism of the German community, based on its unique work ethic, discipline, and organic rank instead of "money." This "Prussian" socialism he sharply contrasted both to the capitalistic ethic of England and the "socialism" of Marx (!), whose theories amounted to "capitalism for the proletariat."
In his corporate state proposals Spengler anticipated the Fascists, although he never was one, and his "socialism" was essentially that of the National Socialists (but without the folkish racialism). His early appraisal of a corporation for which the State would have directional control but not ownership of or direct responsibility for the various private segments of the economy sounded much like Werner Sombart's later favorable review of National Socialist economics in his A New Social Philosophy [Princeton Univ. Press, 1937; translation of Deutscher Sozialismus (1934)].
Prussianism and Socialism did not meet with a favorable reaction from the critics or the public -- eager though the public had been, at first, to learn his views. The book's message was considered to "visionary" and eccentric -- it cut across too many party lines. The years 1920-23 saw Spengler retreat into a preoccupation with the revision of the first volume of Decline, and the completion of the second. He did occasionally give lectures, and wrote some essays, only a few of which have survived.
Political Involvement
In 1924, following the social-economic upheaval of the terrible inflation, Spengler entered the political fray in an effort to bring Reichswehr general Hans von Seekt to power as the country's leader. But the effort came to naught. Spengler proved totally ineffective in practical politics. It was the old story of the would-be "philosopher-king," who was more philosopher than king (or king-maker).
After 1925, at the start of Weimar Germany's all-too-brief period of relative stability, Spengler devoted most of his time to his research and writing. He was particularly concerned that he had left an important gap in his great work -- that of the pre-history of man. In Decline he had written that prehistoric man was basically without a history, but he revised that opinion. His work on the subject was only fragmentary, but 30 years after his death a compilation was published under the title Early Period of World History.
His main task as he saw it, however, was a grand and all-encompassing work on his metaphysics -- of which Decline had only given hints. He never did finish this, though Fundamental Questions, in the main a collection of aphorisms on the subject, was published in 1965.
In 1931 he published Man and Technics, a book that reflected his fascination with the development and usage, past and future, of the technical. The development of advanced technology is unique to the West, and he predicted where it would lead. Man and Technics is a racialist book, though not in a narrow "Germanic" sense. Rather it warns the European or white races of the pressing danger from the outer Colored races. It predicts a time when the Colored peoples of the earth will use the very technology of the West to destroy the West.
Reservations About Hitler
There is much in Spengler's thinking that permits one to characterize him as a kind of "proto-Nazi": his call for a return to Authority, his hatred of "decadent" democracy, his exaltation of the spirit of "Prussianism," his idea of war as essential to life. However, he never joined the National Socialist party, despite the repeated entreaties of such NS luminaries as Gregor Strasser and Ernst Hanfstängl. He regarded the National ocialists as immature, fascinated with marching bands and patriotic slogans, playing with the bauble of power but not realizing the philosophical significance and new imperatives of the age. Of Hitler he supposed to have said that what Germany needed was a hero, not a heroic tenor. Still, he did vote for Hitler against Hindenburg in the 1932 election. He met Hitler in person only once, in July 1933, but Spengler came away unimpressed from their lengthy discussion.
His views about the National Socialists and the direction Germany should properly be taking surfaced in late 1933, in his book The Hour of Decision [translation of Die Jahre der Entscheidung]. He began it by stating that no one could have looked forward to the National Socialist revolution with greater longing than he. In the course of the work, though, he expressed (sometimes in veiled form) his reservations about the new regime. Germanophile though he certainly was, nevertheless he viewed the National Socialists as too narrowly German in character, and not sufficiently European.
Although he continued the racialist tone of Man and Technics, Spengler belittled what he regarded as the exclusiveness of the National Socialist concept of race. In the face of the outer danger, what should be emphasized is the unity of the various European races, not their fragmentation. Beyond a matter-of-fact recognition of the "colored peril" and the superiority of white civilization, Spengler repeated his own "non-materialist" concept of race (which he had already expressed in Decline): Certain men -- of whatever ancestry -- have "race" (a kind of will-to-power), and these are the makers of history.
Predicting a second world war, Spengler warned in Hour of Decision that the National Socialists were not sufficiently watchful of the powerful hostile forces outside the country that would mobilize to destroy them, and Germany. His most direct criticism was phrased in this way: "And the National Socialists believe that they can afford to ignore the world or oppose it, and build their castles-in-the-air without creating a possibly silent, but very palpable reaction from abroad." Finally, but after it had already achieved a wide circulation, the authorities prohibited the book's further distribution.
Oswald Spengler, shortly after predicting that in a decade there would no longer be a German Reich, died of a heart attack on May 8, 1936, in his Munich apartment. He went to his death convinced that he had been right, and that events were unfolding in fulfillment of what he had written in The Decline of the West. He was certain that he lived in the twilight period of his Culture -- which, despite his foreboding and gloomy pronouncements, he loved and cared for deeply to the very end.
Keith Stimely
06:25 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 avril 2007
E. Jüngers nationalistische Publizistik

Ernst Jüngers nationalistische Publizistik liegt nun erstmals in einem noblen Sammelband vor
http://www.deutsche-stimme.de/
Nicht alle der konservativen oder liberalen Ernst Jünger-Verehrer werden es wissen oder überhaupt wissen wollen: Aber der größte deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts war in der Zeit der Weimarer Republik, also vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Machtergreifung, »Nationalrevolutionär«.
Was darf man sich nun unter einem Nationalrevolutionär vorstellen? Sicherlich nicht einen Skinhead mit Handgranate oder die europäische Variante eines Dritte-Welt-Guerilleros. Nein, nationalrevolutionäres Denken lag und liegt quer zur herkömmlichen politischen Kategorienbildung von »rechts« und »links« und ist konservativ nur im Hinblick auf seinen höchsten Wert: die Nation, die es gegen alle Gefährdungen zu verteidigen und zu erhalten gilt.
Ernst Jünger (1895 bis 1998) könnte man als den exemplarischen Typus des Nationalrevolutionärs der Zwischenkriegszeit betrachten: In einem langen Aufsatz appellierte er seinerzeit an die ständige »totale Mobilmachung« des Volkes, die Bereitschaft zur Rebellion, die Verachtung der liberalistischen Vorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft und der damals auch bei Teilen der Linken vorhandenen Sehnsucht nach Befreiung der deutschen Nation von der Plage der bürgerlichen Gesellschaft. In einer editorischen Großtat hat nun der Verlag Klett-Cotta die gesamte zwischen Ende 1919 und 1933 entstandene politische Publizistik Ernst Jüngers zu einer beinahe 900 Seiten umfassenden kommentierten Ausgabe zusammengefaßt. Die meisten der hier zusammengefaßten Aufsätze erschienen in nationalistischen Theorieorganen mit meist geringer Auflage, denen sich Jünger manchmal auch als Herausgeber zur Verfügung stellte, wie der »Standarte«, dem »Stahlhelm«, dem »Arminius«, dem »Vormarsch«, den »Kommenden« und dem »Widerstand«. Jüngers publizistisches Engagement für die letztgenannte Zeitschrift verdient besondere Beachtung, denn schließlich war der »Widerstand« das wichtigste Organ der sich um den »Über-Preußen« Ernst Niekisch formierenden »Nationalbolschewisten«. Diese Linksnationalisten forderten zur Abschüttelung des Versailler Diktates ein Bündnis mit der aus der Oktoberrevolution hervorgegangenen Sowjetunion, weil sie der Ansicht waren, »daß ihre Löffel lang genug wären, um auch noch mit dem Teufel vom selben Tisch zu essen« (Karl-Heinz Weißmann).
Ernst Jünger war als vielfach verwundeter Frontoffizier gegen Ende des Ersten Weltkriegs mit dem höchsten Tapferkeitsorden des Kaiserreichs, dem »Pour le Merite«, ausgezeichnet worden und stieg rasch zu einer nationalen Widerstandsfigur im besiegten und teilweise besetzten Deutschland auf. Gerade seine früheren Aufsätze sind noch ganz von den Erschütterungen des Fronterlebnisses durchdrungen: »Der Krieg ist unser Vater, er hat uns gezeugt im glühenden Schoße der Kampfgräben als ein neues Geschlecht, und wir erkennen mit Stolz unsere Herkunft an.«
Ablehnung der morschen bürgerlichen Ordnung
Schnell kam Jünger für sich zu dem Ergebnis, daß die Kriegsniederlage das mit innerer Notwendigkeit eingetretene Resultat der zu Friedenszeiten schon morschen bürgerlichen Ordnung des Wilhelminismus war. Dem ungeheuren Opfer der Millionen an der Front für ihr Land Gefallenen konnte nach Jünger nachträglich nur ein Sinn gegeben werden, wenn die seiner Ansicht nach bruchlose Konstanz einer sowohl vom Kaiserreich als auch der Weimarer Republik repräsentierten bürgerlichen, liberalen und rationalistischen Ordnung durch eine neue Ordnung ersetzt werde, die wieder Zugang zu den tieferen Quellen des Lebens habe: dem Nationalismus. Eine beinahe schon klassische Definition des Nationalismus lieferte Jünger in seinem Aufsatz »Das Sonderrecht des Nationalismus«:
»Wir Nationalisten glauben an keine allgemeinen Wahrheiten. Wir glauben an keine allgemeine Moral. Wir glauben an keine Menschheit als an ein Kollektivwesen mit zentralem Gewissen und einheitlichem Recht. Wir glauben vielmehr an ein schärfstes Bedingtsein von Wahrheit, Recht und Moral durch Zeit, Raum und Blut. Wir glauben an den Wert des Besonderen.«
Interessanterweise sprach Jünger später in seinen Alterstagebüchern »Siebzig verweht« davon, daß er in Deutschland die Begriffe »Nationalismus« und »Nationalisten« mehr oder weniger erfunden habe, um das Unbedingte seiner Position zum Ausdruck zu bringen. Träger der neuen Ordnung sollte nach Jünger der Frontsoldat sein, der schon in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs das höchste Maß an Opferbereitschaft gezeigt hatte und der durch das Kriegserlebnis der alten bürgerlichen Welt entrissen und zu einem neuen »Typus« gebildet worden war:
»Was dort im Lärm der Schlachten unter der Oberfläche eines scheinbar sinnlosen Geschehens an neuen Kräften geboren wurde und weiter wirkend in unsere Zeit hineingreift, jener innere Gewinn, der nicht zu leugnen ist, obwohl wir den Krieg verloren, und der für uns vielleicht wichtiger als jede äußere Ausdehnung ist, muß dem Volke auf Dauer erhalten bleiben. Dem Frontsoldaten, der das äußere Erlebnis in seiner vollen Wucht empfing, liegt es ob, auch die inneren Schlüsse zu ziehen, das große Schicksal, dem er sich gewachsen zeigte, zu einer Quelle der Kraft zu gestalten, und diese Kraft auf die ihm Folgenden zu übertragen.«. Jüngers Beobachtungen an der Front lassen sich vielleicht am besten in die Worte des sozialdemokratischen Arbeiterdichters Karl Bröger fassen, der 1914 dichtete:
»Immer schon haben wir eine Liebe zu Dir gekannt / bloß wir haben sie nie bei ihrem Namen genannt / Herrlich zeigte es aber Deine größte Gefahr / Daß Dein ärmster Sohn auch Dein Getreuester war / Denk es, O Deutschland«.
Überwindung des Klassendenkens
Der Nationalismus sollte nach Jüngers Ansicht das Klassendenken von Kaiserreich und Republik überwinden und sich die legitimen Forderungen der Arbeiterbewegung zu eigen machen: »Und, Kameraden aus der Arbeiterschaft, laßt Euch nicht verblüffen durch jene, die Euch einreden wollen, daß der Nationalismus unserer Zeit gegen Euch gerichtet sei. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der dynastische Staat wurde abgelöst und untergraben durch den Klassenstaat, aber der Klassenstaat wird vernichtet werden durch den nationalistischen Staat. Dessen Fragestellungen gehen quer hindurch durch Marxismus und Kapitalismus, durch die Revolution von 1918 und die Reaktion«.
Jünger definiert die Grundelemente des nationalistischen Staates in mehreren Aufsätzen als national, sozial, wehrhaft und autoritativ, ohne jedoch seine Staatsvorstellung weiter zu präzisieren und beispielsweise zu einem Verfassungsentwurf zusammenzufassen. Und noch etwas wird aus Jüngers politischen Aufsätzen der Weimarer Republik deutlich: Der angeblich in ihnen zum Ausdruck kommende »Antisemitismus«, der den Herausgeber des Spiegel Rudolf Augstein in einem Artikel zum hundertsten Geburtstag Jüngers 1995 noch dazu veranlaßte kundzutun, daß Jünger nie ein Klassiker der deutschen Literatur werden könne, existiert so gut wie gar nicht. Scheitern von Jüngers realpolitischen Ansätzen Jüngers Kultus der Reinheit, der vielleicht zum Scheitern seiner realpolitischen Ansätze beitrug, ließ sich mit haßdurchtränkten Feindbildern nie vereinbaren, und in mehreren Aufsätzen warnt Jünger ausdrücklich davor, in Bezug auf die Juden platten Schwarz-Weiß-Kategorisierungen aufzusitzen. Jüngers wachsende Distanz zur NSDAP kommt schon im Titel des 1927 verfaßten Aufsatzes »Nationalismus und Nationalsozialismus« zum Ausdruck, in dem er den Nationalisten die Aufgabe zuweist, die Idee »möglichst tief und rein zu erfassen«, während der »Nationalsozialismus in seiner Eigenschaft als politische Organisation auf die Gewinnnung von tatsächlichen Machtmitteln angewiesen ist«.
Ein besonderes Schmankerl stellen die vielen Buchbesprechungen Jüngers aus den zwanziger Jahren dar, die auch einen guten Eindruck der damaligen Zeitatmosphäre vermitteln. Unter den besprochenen Autoren finden sich solche Namen wie Alfred Kubin, Edwin Erich Dwinger, Arnolt Bronnen, Franz Schauwecker oder Leo Trotzki. Mit der Veröffentlichung von Jüngers Zwischenkriegspublizistik schließt sich die letzte große Lücke in der Edition seines Werkes. Jünger hatte es abgelehnt, sie in seine »Gesammelten Werke« aufzunehmen, worüber es zu einem schweren Zerwürfnis mit Armin Mohler, seinem Sekretär aus den fünfziger Jahren und selbst einer der wichtigsten Köpfe der Nachkriegsrechten, kam. In den Aufsätzen wird man alles finden, was auch das dichterische Werk Jüngers so unverwechselbar macht: Die Verbindung von analytischer Kühle und stilistischer Sicherheit mit einer immer spürbaren Leidenschaft für das von ihm behandelte Thema. Seine »Politische Publizistik« dürfte den schon von der Germanistik kanonisierten Werken wie »Auf den Marmorklippen« und »Das abenteuerliche Herz« als heimliches Hauptwerk zur Seite treten.
Arne Schimmer
Ernst Jünger: Politische Publizistik. 1919–1933. Klett-Cotta Verlag, 850 S., geb., d 50,00. Zu beziehen über: DS-Buchdienst, Postfach 100068, 01571 Riesa
06:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 avril 2007
Qui suis-je? Ernst Jünger!
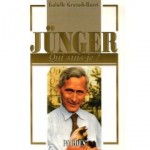
Isabelle Grazioli-Rozet:
Qui suis-je? Ernst Jünger
LA FORGE DES TITANS
Un héritier rebelle et rêveur
L'ère de la démesure
Une philosophie de la guerre
Un avenir à conquérir
Le Travailleur
LES TOURMENTS DE L'HISTOIRE
Spéculations historiques
Les leçons des Falaises de marbre
Guerre et souffrances
DE LA RÉVOLTE DES TITANS À L'ATTENTE DES DIEUX
Regards sur un passé récent
Les exilés de l'histoire
Le patriarche de la littérature
Le temps des honneurs.
Éditeur : Pardès
Date de Parution : 02/2007
Pages : 128
Collection : Qui Suis-je ?
Dimensions (cm) : 14,5 x 21,0. Broché
I.S.B.N. : 9782867143588
05:55 Publié dans Biographie, Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



