dimanche, 21 février 2010
La leçon du philosophe et sociologue Hans Freyer
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
La leçon du sociologue et philosophe Hans Freyer
Ex: http://vouloir.hautetfort.com/
 Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.
Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.
Victor Leemans, qui avant-guerre avec Raymond Aron introduisit en Belgique et en France les grands noms de la sociologie allemande, écrivait, à propos de Hans Freyer, dans son Inleiding tot de sociologie (Introduction à la sociologie, 1938) :
« Pour Freyer, toute sociologie est nécessairement "sociologie politique". Ses concepts sont toujours compénétrés d'un contenu historique et désignent des structures particulières de la réalité. Dans la mesure où la sociologie se limite à définir les principaux concepts structurels de la vie sociale, elle doit ipso facto s'obliger à prendre le pouls du temps. Elle doit d'autant plus clairement nous révéler les successions séquentielles irréversibles où se situent ces concepts et y inclure les éléments de changement, Les catégories sont dès lors telles : communauté, ville, état (Stand), État (Staat), etc., tous maillons dans une chaîne processuelle concrète et réelle. Ces concepts ne sont pas des idéaltypes abstraits mais des réalités liées au temps. (...)
Selon Freyer, aucune sociologie n'est donc pensable qui ne débouche pas dans la connaissance de la réalité contemporaine. À ce concept de réalité ne s'attache pas seulement la connaissance des structures immédiatement perceptibles mais aussi et surtout la connaissance des volontés de maintien ou de transformation qui se manifestent en leur sein. La connaissance sociologique opte nécessairement pour une direction déterminée découlant d'une connaissance de la Realdialektik (dialectique réalitaire [ou dialectique réelle, c'est-à-dire non simplement discursive])... ».
Une sociologie de l'homme total
Malgré cette définition courte de l'œuvre de Freyer, définition qui veut souligner le recours au concret postulé par le sociologue allemand, nous avons l'impression de nous trouver face à un édifice conceptuel horriblement abstrait, détaché de toute concrétude historique. Ce malaise, qui nous saisit lorsque nous sommes mis en présence de l'appareil conceptuel forgé par Freyer, doit pourtant disparaître si l'on fait l'effort de situer ce sociologue dans l'histoire des idées politiques. Avec les romantiques, les jeunes hégéliens (Junghegelianer), Feuerbach et Karl Marx, le XIXe siècle montre qu'il souhaite abandonner définitivement l'homme des humanistes, cet homme perçu comme figure universelle, comme espèce générale dépouillée de sa dimension historico-concrète. Désormais, sous l'influence et les coups de boutoir de ces philosophies concrètes, l'épaisseur historique sera rendue à l'homme : on le percevra comme seigneur féodal, comme serf, bourgeois ou prolétaire.
Une « objectivité » qui doit mobiliser l'homme d'action
Mais ces hégéliens et marxistes, qui dépassent résolument l'idéalisme fixiste de l'humanisme antérieur au XlXe, demeurent mécaniquement enfermés dans la vision de l'homo œconomicus et n'explorent que chichement les autres domaines où l'homme s'exprime. À cette négligence des matérialistes marxistes répond l'hyper-mépris des économismes d'un Wagner ou d'un Schopenhauer, d'un Nietzsche ou d'un Jakob Burckhardt. L'homme total n'est appréhendé ni chez les uns ni chez les autres. Pour Freyer, les essayistes et polémistes anglais Carlyle et John Ruskin nous ont davantage indiqué une issue pour échapper à ce rabougrissement de l'homme. Leurs préoccupations ne les entraînaient pas vers des empyrées légendaires, néo-idéalistes ou spiritualistes mais les amenaient à réfléchir sur les moyens de dépasser l'homme capitaliste, de restituer une harmonie entre le travail et la Vie, entre le travail et la création intellectuelle ou artistique.
Dans deux postfaces aux travaux de Freyer sur Machiavel (ou sur l'Anti-Machiavel de Frédéric Il de Prusse), Elfriede Üner nous explique comment fonctionne concrètement la sociologie de Freyer, qui cherche, au-delà de l'abstractionnisme matérialiste marxiste et de l'abstractionnisme humaniste pré-marxiste, à restaurer l'homme total. Pour parvenir à cette tâche, la sociologie et le sociologue ne peuvent se contenter de décrire des faits sociaux passés ou présents, mais doivent forger des images mobilisatrices tirées du passé et adaptées au présent, images qui correspondent à une volition déterminée, à une volition cherchant à construire un avenir solide pour la Cité.
La méthode de Freyer repose au départ, écrit Elfriede Üner, sur la théorie de "l'esprit objectif" (Theorie des objektiven Geistes). Cette théorie recense les faits mais, simultanément, les coagule en un programme revendicateur et prophétique, indiquant au peuple politique la voie pour sortir de sa misère actuelle. Le sociologue ne saurait donc être, à une époque où le peuple cherche de nouvelles formes politiques, un savant qui fuit la réalité concrète pour se réfugier dans le passé : « Qu'il se fasse alors historien ou qu'il se retire sur une île déserte ! », ironisera Freyer. Cette parole d'ironie et d'amertume est réellement un camouflet à la démarche "muséifiante" que bon nombre de sociologues "en chambre" ne cessent de poser.
Les écrits de sociologie politique doivent donc receler une dimension expressionniste, englobant des appels enflammés à l'action. Ces appels aident à forger le futur, comme les appels de Machiavel et de Fichte ont contribué à l'inauguration d'époques historiques nouvelles. Fichte parlait d'un « devoir d'action » (Pflicht zur Tat). Freyer ajoutera l'idée d'un « droit d'action » (Recht zur Tat). « Devoir d'action » et « droit d'action » forment l'épine dorsale d'une doctrine d'éthique politique (Sittenlehre). L'activiste, dans cette optique, doit vouloir construire le futur de sa Cité. Anticipation constructive et audace activiste immergent le sociologue et l'acteur politique dans le flot du devenir historique. L'activiste, dans ce bain de faits bruts, doit savoir utiliser à 100 % les potentialités qui s'offrent à lui. Cette audacieuse mobilisation totale d'énergie, dans les dangers et les opportunités du devenir, face aux aléas, constitue un "acte éthique".
Une immersion complète dans le flot de l'histoire
L'éthique politique ne découle pas de normes morales abstraites mais d'un agir fécond dans la mouvance du réel, d'une immersion complète dans le flot de l'histoire. L'éthique freyerienne est donc "réalitaire et acceptante". Agir et décider (entscheiden) dans le sens de cette éthique réalitaire, c'est rendre concrètes des potentialités inscrites dans le flot de l'histoire. Freyer inaugure ici un "déterminisme intelligible". Il abandonne le concept de "personnalité esthétisante", individualité constituant un petit monde fermé sur lui-même, pour lancer l'idée d'une personnalité dotée d'un devoir précis, celui de fonctionner le plus efficacement possible dans un ensemble plus grandiose : la Cité. L'éthique doit incarner dans des images matérielles concrètes, générant des actes et des prestations individuels concrets, pour qu'advienne et se déploie l'histoire.
Selon cette vision freyerienne de l'éthique politique, que doit nécessairement faire sienne le sociologue, un ordre politique n'est jamais statique. Le caractère processuel du politique dérive de l'émergence et de l'assomption continuelles de potentialités historiques. Le développement, le changement, sont les fruits d'un déplacement perpétuel d'accent au sein d'un ordre politique donné, c'est-à-dire d'une politisation subite ou progressive de tel ou tel domaine dans une communauté politique. Le développement et le changement ne sont donc pas les résultats d'un "progrès" mais d'une diversification par fulgurations successives [fractales], jaillissant toutes d'une matrice politico-historique initiale. La logique du sociologue et du politologue doit donc viser à saisir la dynamique des fulgurances successives qui remettent en question la statique éphémère et nécessairement provisoire de tout ordre politique.
Une sociologie qui tient compte des antagonismes
Cette spéculation sur les fulgurances à venir, sur le visage éventuel que prendra le futur, contient un risque majeur : celui de voir la sociologie dégénérer en prophétisme à bon marché. Le sociologue, qui devient ainsi "artiste qui cisèle le futur", poursuit, dans le cadre de l'État, l'œuvre de création que l'on avait tantôt attribué à Dieu tantôt à l'Esprit. L'homme, sous l'aspect du sociologue, devient créateur de son destin. Au Dieu des humanistes chrétiens, s'est substitué une figure moins absolue : l'homo politicus... Cette vision ne risque-t-elle pas de donner naissance aux pires des simplismes ?
Elfriede Üner répond à cette objection : la reine Rechtslehre (théorie pure du droit) du libéral Hans Kelsen, idole des juristes contemporains et ancien adversaire de Carl Schmitt, constitue, elle aussi, une "simplification" quelque peu outrancière. Elle n'est finalement que repli sur un formalisme juridique qui détache complètement le système logique, constitué par les normes du droit, des réalités sociales, des institutions objectives et des legs de l'histoire. Rudolf Smend, lui, parlera de la "domination" (Herrschaft) comme de la forme la plus générale d'intégration fonctionnelle et évoquera la participation démocratique des dominés comme une intégration continue des individus dans la forme globale que représente l'État.
Cette idée d'intégration continue, que caressent bon nombre de sociaux-démocrates, évacue tensions et antagonismes, ce que refuse Freyer. Si, pour Smend, la dialectique de l'esprit et de l'État s'opère en circuit fermé, Freyer estime qu'il faut dépasser cette situation par trop idéale et concevoir et forger un modèle de système plus dynamique, capable de saisir les fluctuations tragiques d'une ère faite de révolutions. L'idéal d'une intégration totale s'effectuant progressivement ne permet pas de projeter dans la praxis politique des "futurs imaginés" qui soient réalistes : un tel idéal s'abrite frileusement derrière la muraille protectrice d'un absolu théorique.
À droite : utopies passéistes, à gauche : utopies progressistes
La dialectique de l'esprit et du politique (de l'État), c'est-à-dire de l'imagination constructive et des impératifs de la Cité, de l'imagination qui répond aux défis de tous ordres et des forces incontournables du politique, n'a reçu, en ce siècle de turbulences incessantes, que des interprétations insatisfaisantes. Freyer estime que la sociologie organique d'Othmar Spann (1878-1950) constitue une impasse, dans le sens où elle opère un retour nostalgique vers la structuration de la société en états (Stände) avec hiérarchisation pyramidale de l'autorité. Cette autorité abolirait les antagonismes et évacuerait les conflits : ce qui indique son caractère finalement utopique. À "gauche", Franz Oppenheimer élabore une sociologie "progressiste" qui évoque une succession de modèles sociaux aboutissent à une société sans classes et sans plus aucun antagonisme : cet espoir banal des gauches s'avère évidemment utopique, comme l'ont indiqué quantité de critiques et de polémistes étrangers à ce messianisme. Freyer renvoie donc dos à dos les utopistes passéistes de droite et les utopistes progressistes de gauche.
Ces systèmes utopiques sont "fermés", signale Freyer longtemps avant Popper, et trahissent ipso facto leur insuffisance fondamentale. Les concepts scientifiques doivent demeurer "ouverts" car l'acteur politique injecte en eux, par son action concrète et par son expérience existentielle, la quintessence innovante de son époque. Freyer privilégie ici l'homo politicus agissant, le sujet de l'histoire. Les acteurs politiques, dans l'optique de Freyer, façonnent le temps.
L'idée essentielle de Freyer en matière de sociologie, c'est celle d'une construction pratique ininterrompue de la réalité [les époques sont en relation les unes aves avec les autres dans la dynamique de la continuité historique]. Aux époques politiquement instables, les normes scientifiques (surtout en sciences humaines) sont décrétées obsolètes ou doivent impérativement subir un aggiornamento, une re-formulation. L'histoire est, par suite, un chantier où œuvrent des acteurs-artistes qui, à la façon des expressionnistes, recréent des mondes à partir du chaos, de ruines. Freyer, écrit Elfriede Üner, glorifie, un peu mythiquement, l'homme d'action.
Le peuple (Volk) est le dépositaire de la virtù
Le personnage de Machiavel, analysé méthodiquement par Freyer, a projeté dans l'histoire des idées cette notion expressionniste/ créatrice de l'action politico-historique. Le concept machiavelien de virtù, estime Freyer, ne désigne nullement une "vertu morale statique" mais représente la force, la puissance de créer un ordre politique et le maintenir. Virtù recèle dès lors une qualité "processuelle", écrit Elfriede Üner. Par le biais de Machiavel, Freyer introduit, dans la science sociologique jusqu'alors "objective" et statique à la Comte, un ferment de nietzschéisme, dans le sens où Nietzsche voyait l'existence humaine comme un imperfectum qui ne pouvait jamais être "parfait" mais qu'il fallait sans cesse façonner et travailler.
Le "peuple", dans la vision freyerienne du social et du politique, est, grâce à sa mémoire historique, le dépositaire de la virtù, c'est-à-dire de la "force créatrice d'histoire". Le peuple suscite des antagonismes quand les normes juridiques et/ou institutionnelles ne correspondent plus aux défis du temps, aux impératifs de l'heure ou au ni veau atteint par la technologie. Un système "ouvert" implique de laisser au peuple historique toute latitude pour modifier ses institutions.
Le système freyerien est, en dernière instance, plus démocratique que le démocratisme normatif qui, à notre époque, prétend, sur l'ensemble de la planète, être la seule forme de démocratie possible. Quand Freyer parle de « droit à l'action » (cf. supra), corollaire d'un « devoir éthique d'action », il réserve au peuple un droit d'intervention sur la trame du devenir, un droit à façonner son destin. En ce sens, il précise la vision machiavelienne du peuple dépositaire de la virtù, oblitérée, en cas de tyrannie, par l'arbitraire du tyran individuel ou oligarchique.
Relire Freyer
Relire Freyer, contemporain de Schmitt, nous permet de déployer une critique du normativisme juridique, au nom de l'imbrication des peuples dans l'histoire et du décisionnisme. L'État de droit, c'est finalement un État qui se laisse réguler par la virtù enfouie dans l'âme collective du peuple et non un État qui voue un culte figé à quelques normes abstraites qui finissent toujours par s'avérer désuètes.
Et cette volonté freyerienne de s'imbriquer totalement dans le réel pour échapper aux mondes stérilisés des réductionnismes matérialistes, économistes et caricaturalement normatifs que nous lèguent les marxismes et libéralismes vulgaires, ne pourrait-on pas la lire parallèlement à Péguy ou aux génies de l'école espagnole : Unamuno avec sa dialectique du cœur, Eugenio d'Ors, Ortega y Gasset ?
► Robert STEUCKERS, Vouloir n°37/39, 1987.
1) Hans FREYER, Machiavelli (mit einem Nachwort von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Weinheim, IX/133 p.
2) Hans FREYER, Preussentum und Aufklärung und andere Studien zu Ethik und Politik (herausgegeben und kommentiert von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Welnheim, 222 p.
¤ Compléments bibliographiques :
- Les Fondements du monde moderne - Théorie du temps présent, H. Freyer, Payot, coll. Bibliothèque scientifique, 1965.
- « Romantisme et conservatisme. Revendication et rejet d'une tradition dans la pensée politique de Thomas Mann et Hans Freyer », C. Roques, in : Les romantismes politiques en Europe, dir. G. Raulet, MSH, avril 2009.
- « Die umstrittene Romantik. Carl Schmitt, Karl Mannheim, Hans Freyer und die "politische Romantik" », C. Roques, in : M. Gangl/ G. Raulet (dir.), Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik. Zur politischen Kultur einer Gemengelage, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt/M., Peter Lang Verlag 2007 [= Schriftenreihe zur Politischen Kultur der Weimarer Republik, Bd. 10]. [cf. sur ce thème : Les formes du romantisme politique]
- Nationalité et Modernité, D. Jacques, Boréal, Montréal, 1998, 270 p.
- The Other God that Failed : Hans Freyer and the Deradicalization of German Conservatism, J. Z. Muller, Princeton Univ. Press, 1987. Cf. [pt] Reinterpretar Hans Freyer.
- « The Sociological Theories of Hans Freyer : Sociology as a Nationalistic Program of Social Action », Ernest Manheim in : An Introduction to the History of Sociology, H. E. Barnes (éd.), Chicago Univ. Press, 1948.
¤ Citation :
- « Il faut une volonté politique pour avoir une perception sociologique ».
¤ Liens :
- « La sociologie historique en Allemagne et aux États-Unis : un transfert manqué », G. Steinmetz [ref.]
- « De Tönnies à Weber : sur l'existence d'un "courant allemand" en sociologie », S. Breuer
- Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts, H. Freyer (1921)
¤ Évocations diverses :
1) LE CARACTÈRE INHUMAIN DU CAPITALISME : Mais comment se présente plus précisément le capitalisme moderne comme système d’action? Un grand sociologue humaniste du XXe siècle, Hans Freyer, peut nous aider à répondre. Dans son livre Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (Théorie de l’époque actuelle, 1956), il parle des "systèmes secondaires" comme de produits spécifiques du monde industrialisé moderne et en analyse la structure avec précision. Les systèmes secondaires sont caractérisés par le fait qu’ils développent des processus d’action qui ne se rattachent pas à des organisations préexistantes, mais se basent sur quelques principes fonctionnels, par lesquels ils sont construits et dont ils tirent leur rationalité. Ces processus d’action intègrent l’homme non comme personne dans son intégralité, mais seulement avec les forces motrices et les fonctions requises par les principes et par leur mise en œuvre. Ce que les personnes sont ou doivent être reste en dehors. Les processus d’action de ce genre se développent et se consolident en un système répandu, caractérisé par sa rationalité fonctionnelle spécifique, qui se superpose à la réalité sociale existante en l’influençant, la changeant et la modelant. Voilà la clé qui permet d’analyser le capitalisme comme système d’action. (S. Magister)
2) En ce qui concerne la tradition sociologique allemande, qui est marquée par l'influence de nombreuses conceptions philosophiques (notamment celles du système de Hegel), elle subit en particulier l'influence néfaste de la distinction opérée par Wilhelm Dilthey (1833-1911) entre les systèmes de culture (art, science, religion, morale, droit, économie) et les formes «externes» d'organisation de la culture (communauté, pouvoir, État, Église). Cette dichotomie fut encore aggravée par Hans Freyer (1887-1969) qui distinguait les « contenus objectifs » ou « signification devenue forme », qui sont les « formes objectivisées de l'esprit » dont l'étude relève des « sciences du logos », de leurs « être et devenir réels » qui sont l'objet des « sciences de la réalité ». Le caractère insupportablement artificiel de cette opposition ne saurait être mieux démontré qu'en rappelant que dans cette conception, le langage lui-même est défini comme un « assemblage de mots et de significations, de formes mélodiques et de formations syntaxiques », comme si on pouvait appréhender le langage indépendamment de l'organisation sociale des hommes qui l'emploient. Bien entendu, les langues (Langage) présentent aussi des structures intellectuelles qu'on ne peut expliquer par la sociologie sans tomber dans l'erreur du sociologisme; mais ces structures ne constituent que la moitié du problème. En outre, les entités intellectuelles objectives ne peuvent jamais être opposées au devenir social, mais seulement former avec lui une corrélation fonctionnelle dans des complexes d'action culturelle (A. Silbermann). Dilthey lui-même adoptait à cet égard une position radicalement plus ouverte, aussi bien dans ses explications réelles, opposées à son projet, que dans beaucoup d'autres occasions, comme le prouvent ses tentatives pour établir les fondements psychologiques des sciences humaines et ses tentatives périodiques pour mettre sur pied une éthologie empirique (que l'on pourrait également définir comme une science empirique de la culture). Le danger que recèle cette distinction consiste avant tout dans ce qu'elle ouvre la voie à une sorte de distinction hiérarchique à une culture « supérieure », en quelque sorte proche de l'« esprit », et une culture « inférieure » ; celle-ci se confond facilement avec le concept de « civilisation » (matérielle), ce qui introduit dans toute cette approche du problème une évaluation patente. Il semble préférable de passer de ces conceptions fortement teintées de philosophie à une approche plus réaliste. Après la destruction totale de l'ancienne théorie des aires culturelles par l'ethnologie moderne, la dernière possibilité apparente de séparer certains contenus culturels de leurs rapports fonctionnels avec la société a définitivement disparu. (R. König)
3) La conférence « Normes éthiques et politiques » que Freyer a tenue en mai 1929 devant la Kant-Gesellschaft, souligne encore la primauté de l'État [comme fondement de la vie politique] sur le peuple. « L'État est celui qui rassemble et éveille les forces du peuple au service d'un projet culturel caractéristique ; sa politique est le fer de lance dans lequel le peuple devient historique ». Deux ans plus tard [en pleine crise de la République de Weimar], Freyer voit la signification véritable de la « révolution de droite » dans la résolution avec laquelle elle mobilise le peuple contre l'État. Et trois ans plus tard, il est avéré, pour Freyer, « qu'il existe aussi un véritable esprit du peuple en dehors des frontières politiques de l'État-Nation ». L'esprit du peuple, lit-on alors dans un sens tout à fait national-populiste, « doit être autre chose qu'un contexte fondé sur la politique. Le peuple doit être autre chose qu'un rassemblement d'hommes au sein d'un système étatique » (1934). Les singulières variations qui caractérisent la définition par Freyer du rapport de l'État et du peuple sont bien mises en valeur chez Üner (Soziologie als „geistige Bewegung“. Hans Freyers System der Soziologie und die „Leipziger Schule“, 1992). (S. Breuer)
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 30, années 40, années 50, philosophie, sociologie, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 février 2010
Les visions d'Europe à la base de la "Révolution Conservatrice"
Université d'été de la F.A.C.E. (juillet 1995) - Résumé des interventions
Vendredi 28 juillet 1995 (après-midi)
Les visions d'Europe à la base de la “Révolution Conservatrice”
(Intervention de Robert Steuckers)
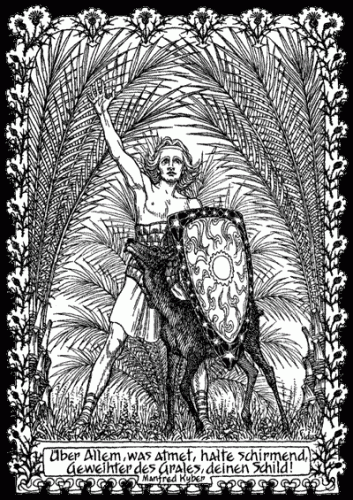 Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918.
Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918.
La RC consiste en un interprétation nouvelle de l'héritage nationaliste, protestant et hégélien (où la “nation” particulière, en l'occurrence la nation allemande) est l'instrument du Weltgeist); elle est une traduction idéologico-politique des philosophies de la Vie, mâtinée de darwinisme ou de biologisme matérialiste (Haeckel) voire d'une interprétation vitaliste du “mystère de l'incarnation” cher à beaucoup de catholiques populistes et/ou conservateurs; enfin, elle est un espace idéologique où l'on tente de concrétiser la vision nietzschéenne de la volonté de puissance ou la notion bergsonienne d'“élan vital”.
En ce qui concerne les visions d'Europe, la RC a aussi des antécédents. A l'époque des Lumières, les intellectuels européens décrivent l'Europe comme un espace de civilisation, de “bon goût”. Mais un certain pessimisme constate que cette civilisation entre en déclin, qu'elle est inadaptée aux premières manifestations d'industrialisme, que le culte de la raison, qui est son apanage, bat de l'aile et que le modèle français, qui en est le paradigme, vient à être de plus en plus souvent contesté (hostilité à la “gallomanie”, non seulement dans les pays germaniques, mais aussi dans les pays latins).
Herder propose dans ce contexte une vision, une manière de voir (Sehweise), qui met en exergue le sens de l'individualité historique des constructions collectives. Contrairement à Rousseau, qui raisonne en termes d'individus, de nations et d'universalité, et qui juge, péremptoire, que l'Europe est “moralement condamnable”, Herder voit des peuples et des cultures enracinés, dont il faut conserver et entretenir les spécificités. L'Europe qu'il appelle de ses vœux est un concert de peuples différents et enracinés. L'Europe, telle qu'elle existe, n'est pas “moralement condamnable” en soi, mais il faut veiller à ne pas exporter, en dehors d'Europe, une européisme artificiel, basé sur les canons de la gallomanie et du culte figé d'une antiquité greco-romaine ad usum delphini. L'Europe dont rêve Herder n'est pas une société d'Etats-personnes mais doit devenir une communauté de personnalités nationales.
Tel était le débat juste avant que n'éclate la révolution française. Après les tumultes révolutionnaires, Napoléon crée le bloc continental par la force des armes. Ce bloc doit devenir autarcique (Bertrand de Jouvenel écrira dans les années 30 l'ouvrage le plus précis sur la question). Napoléon a à ses côtés des partisans allemands de ce grand dessein continental (Dalberg, Krause, le poète Jean-Paul). Ce bloc doit être dirigé contre l'Angleterre. A Paris, le Comte d'Hauterive décrit ce bloc autarcique comme un “système général”, orchestrée par la France, qui organisera le continent pour qu'il puisse s'opposer efficacement à la “mer”. Dès 1795, le Prussien Theremin, dans un ouvrage écrit en français (Des intérêts des puissances continentales relativement à l'Angleterre), s'insurge contre la politique anglaise de colonisation commerciale de l'Europe et des Indes. Le système libre-échangiste anglais est dès lors un “despotisme maritime” (idée qui sera reprise par l'école des géopolitologues, rassemblée autour de la personne du Général Haushofer). Le Baron von Aretin (1733-1824), revendique une “Europe celtique”, fusion de la romanité française et de la germanité catholique de l'Allemagne du Sud, qui s'opposerait au “borussisme”, à l'“anglicisme” et au “protestantisme” particulariste. Après 1815, les “continentalistes” ne désarment pas: Welcker propose une alliance entre la France et la Prusse pour réorganiser l'Europe; Glave, lui, propose une alliance entre la France et l'Autriche, pour exclure la Russie et l'Empire ottoman du concert européen. Woltmann, dans Der neue Leviathan, propose une Gesamteuropa contre l'universalisme thalassocratique, thèses qui annoncent celles de Carl Schmitt. Bülow suggère l'avènement d'une “monarchie européenne universelle” qui procèdera à la conquête de l'Angleterre et unifiera le continent par le truchement d'un projet culturel, visant à éliminer les petits particularismes pouvant devenir autant de prétextes à des manipulations ou des pressions extérieures.
Parmi les adversaires conservateurs et légitimistes de Napoléon, nous trouvons les partisans d'un équilibre européen, où toutes les nations doivent s'auto-limiter dans la discipline (principe en vigueur dans l'Europe actuelle). Les Républicains nationalistes (Fichte, Jahn) qui se sont opposés à Napoléon parce qu'ils l'accusaient de faire du “néo-monarchisme” veulent un repli sur le cadre national ou sur de vastes confédérations de peuples apparentés par la langue ou par les mœurs. Les partisans de la restauration autour de Metternich plaident pour un bloc européen assez lâche, la Sainte-Alliance de 1815 ou la Pentarchie de 1822. La Restauration veut réorganiser rationnellement l'Europe sur base des acquis de l'Ancien Régime, remis en selle en 1815. Franz von Baader, dans ce contexte, suggère une “Union Religieuse” (qui sera refusée par les catholiques intransigeants), où les trois variantes du christianisme européen (catholicisme, protestantisme, orthodoxie) unifieraient leurs efforts contre les principes laïques de la révolution française. A cette époque, la Russie est considérée comme le bastion ultime de la religion (cf. les textes du Russe Tioutchev, puis ceux de Dostoïevski, notamment le Journal d'un écrivain). Cette russophilie conservatrice et restauratrice explique l'Ostorientierung de la future RC, initiée par Moeller van den Bruck. Le continentaliste russophile le plus cohérent est le diplomate danois Schmidt-Phiseldeck qui plaide, dans un texte largement répandu dans les milieux diplomatiques, pour un eurocentrage des forces de l'Europe, contre les entreprises colonialistes; Schmidt-Phiseldeck veut l'“intégration intérieure”. Il avertit ses contemporains du danger américain et estime que la seule expansion possible est en direction de Byzance, c'est-à-dire que la Pentarchie européenne doit lever un corps expéditionnaire qui envahira l'Empire Ottoman et l'incluera dans le concert européen. Cette volonté d'expansion concertée et paneuropéenne vers le Sud-Est sera reprise en termes pacifiques sous Guillaume II, avec le projet de chemin de fer Berlin-Bagdad qui suscitera la fameuse “question d'Orient”. Görres, ancien révolutionnaire, voit dans l'Allemagne recatholicisée l'hegemon européen pacifique, contraire diamétral du bellicisme moderne napoléonien. L'Allemagne doit joue ce rôle parce qu'elle est la voisine de presque tous les autres peuples du continent: elle en est donc l'élément fédérateur par destin géographique. L'universalité (c'est-à-dire l'“européanité”) de l'Allemagne vient de l'hétérogénéité de son voisinage, car elle peut intégrer, assimiler et synthétiser mieux et plus que les autres.
Constantin Frantz met en garde ses contemporains contre les fanatismes idéologiques: l'ultramontanisme catholique, le particularisme catholique en Bavière, le national-libéralisme prussien, le capitalisme, etc. Le Reich doit organiser la Mitteleuropa, se doter d'une constitution fédéraliste, conserver et renforcer sa place au sein de l'équilibre pentarchique européen. Mais celui-ci est en danger, à cause de l'extraversion que provoquent les aventures coloniales de l'Angleterre, qui se cherche un destin sur les mers, et de la France, qui s'est embarquée dans une aventure algérienne et africaine. Les Occidentaux provoquent la guerre de Crimée, en prenant le parti d'un Etat qui n'appartient pas à la Pentarchie (la Turquie) contre un Etat qui en est un pilier constitutif (la Russie).
Sous Guillaume II, les plans de réorganisation de la Mitteleuropa, plans tous parfaitement extensibles à l'ensemble de notre sous-continent, se succèdent. La plupart de ces projets évoquent une alliance et une fusion (d'abord économique) entre l'Allemagne forgée par Bismarck et l'Empire austro-hongrois. Dans l'optique des protagonistes, il s'agissait de parfaire une élargissement grand-allemand du Zollverein, en marche depuis le milieu du siècle. Le Français Guillaume de Molinari, “doctrinaire” du libéralisme, envisage une alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Suisse, dans un article qui connaîtra un grand retentissement dans les milieux industriels et diplomatiques: «Union douanière de l'Europe centrale» (in: Journal des économistes, V, 4, 1879, pp. 309-318). Paul de Lagarde, l'orientaliste aux origines intellectuelles du mouvement pangermaniste (Alldeutscher Verband) et, pour certains, du national-socialisme, la “Mitteleuropa” devait se limiter aux espaces germaniques et s'organiser comme un bloc contre la Russie. Paul de Lagarde est ainsi le premier homme de droite, élaborant des projets européens, qui est russophobe et non pas russophile. La russophobie étant une tradition de gauche au XIXième siècle. La tradition pangermaniste/pré-nationale-socialiste est donc russophobe et la RC, initiée par Moeller van den Bruck, reste russophile, en dépit de l'avènement du bolchevisme. Telle est la grande différence entre les deux mouvements. En 1895, l'industriel et économiste autrichien Alexander von Peez exhorte les Européens à prendre conscience des dangers du panaméricainisme, incarné par les actions de la Navy League de l'Amiral Mahan. Pour von Peez, l'Europe doit se constituer en un bloc pour s'opposer à la Panamérique, sinon tous les peuples de la Terre risquent de périr sous les effets de l'“américanisation universelle”. Plus tard, ce type d'argumentation sera repris par Adolf Hallfeld, Giselher Wirsing et Haushofer (dans sa dénonciation de la “politique de l'anaconda”).
Les libéraux de gauche Ernst Jäckh et Paul Rohrbach restent russophobes, parce que c'est la tradition dans le milieu politico-idéologique dont ils sont issus, mais suggèrent une alliance ottomane et militent en faveur du chemin de fer Berlin-Bagdad. En fait, ils reprennent l'idée d'un contrôle européen (ou simplement allemand) de l'Anatolie, de la Mésopotamie et de la Palestine que l'on trouvait jadis chez Schmidt-Phiseldeck. Mais ce contrôle s'effectuera dans la paix, par la coopération économique et l'aide au développement et non pas par une conquête violente et un peuplement de ces régions par le trop-plein démographique russe. L'alliance entre les Empires européens et la Sublime Porte sera une alliance entre égaux, sans discrimination religieuse. Paradoxalement, ce faisceau d'idées généreuses, annonciatrices du tiers-mondisme désintéressé, hérisse les Britanniques, déjà agacés par l'accroissement en puissance de la flotte allemande, créée non pas pour s'opposer à l'Angleterre mais pour faire pièce à la Navy League américaine. Ce n'est donc pas le pangermanisme, dénoncé effectivement dans les propagandes anglaise et française, qui est le véritable prétexte de la première guerre mondiale. Les discours nationalistes et racialistes des pangermanistes ne choquaient pas fondamentalement les Anglais, qui en tenaient d'aussi radicaux et d'aussi vexants pour les peuples colonisés, mais cette volonté de coopération entre Européens et Ottomans en vue de réorganiser harmonieusement les zones les plus turbulentes de la planète.
Robert Steuckers n'a pu, en deux heures et demie, que nous donner une fraction infime de ce grand travail sur l'Europe. A la suite des thématiques et des figures analysées, son texte écrit compte une analyse de la situation sous Weimar, les pourparlers entre Briand et Stresemann, la vision européenne des conservateurs catholiques et de Hugo von Hoffmannstahl, la logique paneuropéenne dans l'école de haushofer et plus particulièrement chez Karl C. von Loesch, les idées de Ludwig Reichhold, celles du Prince Karl Anton Rohan (ami d'Evola), du grand sociologue Eugen Rosenstock-Huessy, de l'esthète Rudolf Pannwitz, de Leopold Ziegler, la diplomatie classique de Staline pendant la seconde guerre mondiale (qui explique la russophilie d'une bonne part de la droite allemande, conservatrice ou nationaliste). Le texte paraîtra in extenso sous forme de livre.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, europe, affaires européennes, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 février 2010
De Arbeider: Heerschappij en gestalte
 Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010
Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010Ernst Jünger beschrijft in dit visionaire boek de toekomst en de heersende rol van de arbeider.
De kostprijs bedraagt 39,95 € verzending inbegrepen!
00:13 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, ernst jünger, années 20, années 30, allemagne, weimar, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 février 2010
Neue Formen der Weltpolitik
 Neue Formen der Weltpolitik
Neue Formen der Weltpolitik
machen.
Oswald Spengler, Aus einem Vortrage "Neue Formen der Weltpolitik", gehalten am 28. April 1924 im Überseeclub zu Hamburg.
http://www.ueberseeclub.de/vortrag/v...1924-04-28.pdf
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, années 20, weimar, oswald spengler, révolution conservatrice, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ondergang van het Avondland - Het decadentiebegrip bij Spengler en Evola
ONDERGANG VAN HET AVONDLAND
HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA
door Peter LOGGHE
Ex: http://www.peterlogghe.be/
 Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :
Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :
- Hoe ontstaat decadentie ? Wat is decadentie en waardoor ontstaat ze ?
- Zijn er wetmatigheden werkzaam ? Verloopt decadentie overal en altijd volgens een bepaald stramien en kunnen we m.a.w. het verloop, de uitkomst van de decadentie voorspellen ? Kunnen wij het proces positief beïnvloeden ?
1. OVER DE ACTUALITEIT VAN HET DENKEN OVER DECADENTIE
Niet alleen historici, cultuurfilosofen en sociologen hadden en hebben oog voor deze vragen, Evola, Spengler en Nietzsche zijn namen die in dit verband automatisch in het oog springen, maar ook natuurwetenschappers als Konrad Lorenz of prof. Eibl-Eibesfeldt laten zich in dit verband niet onbetuigd. Zo noteerde Karl Heinz Weissmann in TeKoS 113 : “Lorenz liet zich niet afschrikken en duidde de eigenlijke ondermijning van elk organisme aan als “decadentie”. Onder decadentie verstond hij als bioloog het “verstoren van de totaliteit van het systeem” (…) “ (1). Maar wij kunnen nog een stap verder zetten. Ook het fenomenale boek van J. J. Tolkien, In de Ban van de Ring – met de meesterlijke verfilming – kan zonder enig probleem in de literatuur over decadentie worden ondergebracht. Dreiging van buiten (Sauron !) wordt gecombineerd met interne zwakte (Theoden in Rohan, tot hij door Gandalf wordt geholpen, en Denethor in Gondor).
Over decadentie is eigenlijk in veel culturen nagedacht, de meeste traditionele maatschappijen hadden er zelfs mythes over – we komen er nog op terug. De eerste moderne denker over decadentie, meent althans Gerd Klaus Kaltenbrunner (2), was Niccolo Machiavelli (gestorven in 1527). Hij noemt hem zelfs een groot theoreticus van de decadentie. Machiavelli studeerde vlijtig op de antieke geschiedenisschrijvers en als diplomaat en politicus in het politiek zeer woelige en verdeelde Italië – de periode van De Medicis - deed hij ervaringen op, die hij combineerde met de conclusies die hij uit zijn studies trok. Hij ontwikkelde een theorie over de oorzaken van het politieke verval en de voorwaarden voor politieke grootheid, vernieuwing en regeneratie, heropstanding zeg maar. Hij droeg zijn Discorsi op aan die jongeren van zijn tijd die het verval afwezen en een nieuwe virtu voorbereidden. De necessità, waarover Machiavelli het heeft, staat los van elk determinisme en daarom kan Niccolo Machiavelli eigenlijk in geen enkel opzicht worden beschouwd als een pessimist. Want het is steeds mogelijk – houdt Machiavelli ons voor – met scheppingskracht het verval tegen te houden. En die kringen die het algemeen belang kunnen terugbrengen tot haar kern, houden ook het welzijn van de gemeenschap het best in stand. Die staten, die institutionele voorzorgsmaatregelen tot zelf-vernieuwing afwijzen, schrijft Machiavelli, zijn het best toegerust en hebben veruit de beste toekomstperspectieven, want het middel om zich te hernieuwen, bestaat erin terug te keren tot de eigen oorsprong. Want alle begin moet iets goeds hebben ! Het moet dus mogelijk zijn, schrijft een historicus-filosoof in de 16e eeuw, om met oorspronkelijke inzichten vanuit dit begin opnieuw te starten.
Op zich een optimistische ingesteldheid, misschien kenmerkend voor de renaissance-mens van de late Middeleeuwen. Latere cultuurfilosofen zullen opnieuw aanknopen bij de cyclische theorieën, en ipso facto het geheel eerder pessimistisch inkleuren.
Is er iets actueler te vinden dan het fenomeen decadentie ? Is er een prangender vraag dan : houdt Europa het vol ? Worden wij niet onder de voet gelopen ? Hoe een economie draaiende houden met een demografische ontwikkeling zoals in gans Europa ?
De laatste decennia toonden ons een eigenaardige revival – een eigenaardig woord in dit verband – van het nadenken over decadentie. Een nieuwe oogst aan filosofen en theorieën over ondergang. Er was niet alleen Fukuyama - het einde van de geschiedenis, u weet wel – of Samuel Huntington met Botsende beschavingen (3), wij moeten het niet eens meer zo ver zoeken om de relevantie en de toepasbaarheid van het begrip decacentie en de cultuurtheorieën vast te stellen. Concreet : het opiniestuk van filosoof Paul Cliteur in De Standaard van 14 en 15 februari 2004, met als titel Het decadentie cultuurrelativisme. Het artikel mag gekoppeld aan het recente boek van dezelfde Paul Cliteur, Tegen de decadentie (4). Zonder de stellingen van de heer Cliteur aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, wil ik er gewoon even op wijzen dat de filosoof een rechte lijn trekt tussen het antieke Griekenland en Europa. Hij legt ons de volgende redenering voor : Een beschaving, die open staat voor àlle tradities, die alle waarden de moeite waard vindt, is decadent, is een beschaving die niet meer in zichzelf gelooft, is voorbestemd om ten onder te gaan.
Wij blijven rond de centrale vraag draaien : wat is decadentie ? Is ze onvermijdelijk ? En is het stellen van de vraag of onze beschaving decadent is geworden, niet onmiddellijk het beste bewijs dat wij inderdaad decadent zijn ?
Toevallig een artikel in Junge Freiheit voor ogen, Die heroische Existenz im Geistigen (5).
Daarin stelt de reeds geciteerde Weissmann de filosoof-socioloog Arnold Gehlen (1904-1976) aan het publiek voor, de man die zich vooral bezighield met het bestuderen en het koel analyseren van “het verval”. Wanneer begint het proces van verval in een gebouw, dat mensen hebben opgetrokken en dat ze in een relatief korte tijdspanne zien ontbinden ? Gehlen is dé anti-romanticus, en wie probeert zijn conservatisme te verklaren vanuit een nostalgische blik op het Wilhelminische Duitsland bijvoorbeeld, wens ik veel geluk toe. Arnold Gehlen verwierp het streven naar voormoderne toestanden, dit leek hem totaal nutteloos en zinloos, zonder doel. De fase van de sociale ordening zijn we endgültig voorbij, schrijft de Duitse auteur kort na de Tweede Wereldoorlog, die tijden komen niet meer terug. Wij bevinden ons in het tijdperk van Mensch und Technik, culturele vormen verstenen, grote geestelijke opwellingen zijn niet meer te verwachten. Pessimisme pur sang ? Later zou Gehlen hier en daar wel correcties aanbrengen en zou hij proberen de mens weer iets centraler te zetten en opnieuw het statuut van “natuurlijk wezen” meegeven. Maar hij bleef een pessimist. Hij ziet uiteindelijk maar twee mogelijke houdingen : ofwel, wat hij omschreef als de nihilistische houding, het grote Opgeven, het meedrijven met de stroom, “het zal mijn tijd wel doen” – ofwel de heroïsche houding, bereid zijn dat oorspronkelijke, dat aparte te realiseren, maar in het besef dat de wereld waarschijnlijk toch verloren is.
Even terugkomen op Paul Cliteur, die de superioriteit van de Westerse moderne wereld dik in de verf zet. De betreurde Julien Freund, Frans socioloog, had het in zijn bijdrage voor één van de dossiers “H” van de uitgeverij L’Age d’Homme (6) over de decadentietheorie van J. Evola. En in tegenstelling tot diegenen die de superioriteit van de moderne wereld poneren, beklemtoonde de Italiaanse filosoof juist “de decadente natuur van dezelfde moderne wereld”, wat ook betekent dat ze gedoemd is om te verdwijnen.
Deze inleiding besluiten ? Het fenomeen decadentie heeft zowat iedereen beziggehouden, wetenschappers van alle slag en soort, politieke denkers, filosofen, schrijvers van alle politieke gezindten en overtuigingen. Elkeen probeerde het begrip in te passen in het eigen denk- en waardensysteem. Zelfs marxisten als Lukacs – het marxisme is toch eerder een liniair gerichte filosofie ? – vonden het thema zo interessant dat ze erover publiceerden. Maar decadentie is een thema bij uitstek van rechts, van het conservatieve kamp. Anderen leggen het conservatieve kamp graag een verkrampte houding t.o.v. decadentie in de mond. Maar : “Lorenz hield het decadentieproces echter niet voor onvermijdelijk. En rechts neigt er slechts uitzonderlijk naar om de idee van een involutie aan te houden, de idee dus van een onvermijdelijke neergang, hoe sceptisch hij voor de rest ook staat tegenover het begrip “vooruitgang”. Normaal gezien vindt men (in het conservatieve kamp) voorstanders van de idee van een wisselend spel van opgang en verval, van een alternerend proces, waarin decadentie en hergeboorte elkaar opvolgen.” (7)
Het kan wellicht nuttig zijn de twee belangrijkste epigonen van het conservatief denken over decadentie, tevens de filosofen met de meest uitgesproken – én tegelijk de meest omstreden - mening hierover, aan u voor te stellen. Het is de bedoeling van deze bijdrage om de aandacht te richten op het begrip decadentie bij de Duitse filosoof Oswald Spengler, auteur van het veel geciteerde maar minder gelezen Untergang des Abendlandes (8) verschenen in 1923, en bij Julius Evola, de Italiaanse filosoof en auteur van o.a. Rivolta contro il mondo moderno (9), verschenen in 1934.
2. OSWALD SPENGLER – met Duitse Gründlichkeit
Belangrijkste werken van Oswald Spengler :
1918 Untergang des Abenlandes, Band I
1920 Preussentum und Sozialismus
1921 Pessimismus
1922-1923 Untergang des Abendlandes, Band I + II
1924 Neubau des deutschen Reiches
1924 Politische Pflichten der deutschen Jugend
1931 Der Mensch und die Technik
1932 Politische Schriften
1933 Jahre der Entscheidung
Postume uitgave bezorgd door Hildegard Kornhardt
1937 Reden und Aufsätzen
1941 Gedanken
Postume uitgaven bezorgd door Anton Mirko Koktanek
1963 Briefe 1913-1936
1965 Urfragen
1966 Frühzeit der Weltgeschichte
.
Op het leven zelf van Oswald Spengler gaan wij niet uitgebreid in, maar geïnteresseerde lezers willen wij graag doorverwijzen naar de studie van Frits Boterman (10). Een zo uitgebreide en goed gedocumenteerde studie dat wij in de loop van deze bijdrage nog graag wat zullen verwijzen naar de bevindingen van de heer Boterman.
Oswald Spengler werd geboren in 1880 en stierf in 1936, drie jaar na de machtsovername door Hitler, en drie jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Boterman beschrijft Spengler als een man die zowel thuis hoort in de 19e eeuw – romantisch, visionair en met een zwak voor metafysici – als in de 20e eeuw – met zijn nuchterheid, diagnosticerend, futurologisch, en een groot zwak voor techniek. Hij erfde van zijn moeder de gevoelige geest, zijn sterk geworteld pessimisme en een bepaald künstlerisches aanvoelen. Spengler zelf zag zich graag als een dromer, een dichter en een visionair. Hij wilde de geschiedenis niet wetenschappelijk aanpakken, omdat de geschiedenis daarmee te kort zou worden gedaan. Neen : “Geschichte wissenschaftlich behandeln zu wollen, ist im letzten Grunde immer etwas Widerspruchvolles. Natur soll man wissenschaftlich behandeln, über Geschichte soll man dichten” (11). Maar Boterman ziet tegelijkertijd de gladschedelige beursmakelaar, met harde ogen, totaal illusieloos, vol cynisme, het gezicht van de andere Spengler, die tot politieke daden bereid was, die Mussolini vereerde, en de Weimardemocratie verafschuwde. Hij zag in de autoritaire staat de voorbode van een nieuw, imperiaal caesarisme, misschien één van de laatste overlevingsfases van de Avondlandse beschaving.
Het geschiedenisbeeld van Oswald Spengler
In wezen is Oswald Spengler dus een introvert, gevoelig persoon, een kunstenaar, een romantische estheet. En reeds zeer vroeg kwam hij tot de bevinding dat de lijnvormige of dialectische vooruitgangsidee op een leugen berustte, berustte op wishfull thinking eerder dan op de realiteit. Spengler hield het bij het bestaan van een aantal soevereine culturen, waarvan elk apart haar eigen leven, wil, voelen en lotsbestemming had. En deze culturen, die met de kracht van de oerwereld in een bepaald gebied ontstaan, zijn eigenlijk het best te vergelijken met plantaardige organismen, die opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. Dit biologisme, dat ook in andere wetenschapstakken zijn invloed liet gelden, werd tevens één van de aanvalspunten van tegenstanders van Spengler : waarom zouden culturen, die niets plantaardigs hebben, een ontwikkeling doormaken als planten ?
Spengler onderscheidde 8 culturen – organismen :
De Egyptische (met inbegrip van de Kretenzische en de Minoïsche)
De Babylonische cultuur
De Indische cultuur
De Chinese cultuur
De Grieks-Romeinse cultuur
De Arabische cultuur
De Oud-Amerikaanse, Mexicaanse cultuur
De Avondlandse cultuur
In het Rusland van Dostojevski’s figuren zal Spengler de kern zien van een nieuwe cultuur, in zoverre Rusland erin slaagt zich te ontdoen van het uit het Westen geïmporteerde marxisme.
Elke cultuur, meent Oswald Spengler, is een in zich gesloten gansheid, een vensterloze monade, waarin alle niveau’s morfologisch samenhangen. Boterman schrijft dat ze de uitdrukking is van een onvervangbare ziel, die elke cultuur belichaamt. Zelfs de meest prozaïsche uitdrukkingen, instellingen, etc., hebben ook steeds een symbolische waarde. Ze zijn de getuigen, samen met de mythes, de religies, kunst en filosofie, van een supra-individueel levensgevoel, een fundamentele houding ook t.o.v. tijd en ruimte, verleden en toekomst. Binnen de Avondlandse cultuur hebben luidsprekers, een cheque, de dubbele boekhouding geen geringere symbolische waarde dan de gotische dom, het contrapunt in de muziek.
De cultuur van Griekenland en Rome omschrijft de auteur als apollinisch : ze is gericht op het heden, is a-historisch, en valt voor het genie van de plastiek (beeldhouwwerk bvb.), ze is somatisch. De Arabische cultuur, waar Spengler ook de Perzische, de vroegchristelijke en de Byzantijnse wereld toe rekent, krijgt het etiket magisch mee : haar oersymbool is de grot, en in de centrale koepelbouw vindt het grotgevoel haar hoogste uitdrukking, net als in de apocalystiek en de alchemie, en de goudgrond van de Byzantijnse mozaïeken. De oud-Egyptische cultuur is “een incarnatie van de zorg”, en die grondhouding vindt men terug in de bewateringsaanleg, de beambtenhiërarchie en de mummiecultus, het hiëroglyfenschrift, en de keuze voor basalt en graniet voor de beeldhouwwerken. De auteur omschrijft de Avondlandse cultuur als faustisch. Ook deze cultuur, waarvan het grondsymbool de ruimte is – let op de gotische dom, in de hoogte gebouwd, fuga’s van Bach, de moderne techniek – is ondertussen aan haar verval begonnen, bevindt zich in de fase van de beschaving, de laatste fase van elke cultuurcyclus. Elke cultuurcyclus omvat ongeveer een periode van duizend jaar.
Kritiek kreeg Oswald Spengler met emmers over zich: de marxistische theoreticus George Lukàcs had het in zijn boek Die Zerstörung der Vernunft over het dilettantisme van Spengler, de cynische openheid, absurditeiten en mystiek van de auteur. Thomas Mann, de liberale rationalist Theodor Geiger (“één van de ergste boeken van onze eeuw”), iedereen had wel iets over de theorieën in Untergang des Abendlandes te zeggen (12). Gerd-Klaus Kaltenbrunner schat de situatie juister in als hij vermeldt dat zoveel schuim op de mond van critici meestal een teken is van de armoede van de tegenargumenten. En een figuur als Theodor Adorno vindt dat Oswald Spengler zijn tegenstander nog steeds niet heeft gevonden.
Frits Boterman past het geheel goed samen : Untergang des Abendlandes was het meest gelezen geschiedenisfilosofisch werk van de Republiek van Weimar, en zijn auteur heeft de 20e eeuw heel duidelijk mee bepaald (13).
Welke kenmerken zijn er Boterman nu bijgebleven als zeer belangrijk ? Wij sommen ze even op :
Spengler heeft de bedoeling met zijn Untergang de diagnose van de cultuurcrisis te stellen en tegelijkertijd een prognose over de ondergang van faustische cultuur. Aan de hand van de zgn. morfologische methode probeerde de Duitse filosoof culturen met elkaar te vergelijken en de crisis van de westerse cultuur in zijn laatste fase, die van beschaving, te beschrijven. Boterman stelt dat Spengler de bedoeling had niet louter de populaire cultuurgeschiedenis te schrijven maar hij wilde doordringen tot een diepere laag van de historische werkelijkheid, de fundamentele vragen des levens aansnijden, en de metafysische kern van het leven vatten (leven, tijd, lot). Boterman noemt dit de metafysische laag in het werk van Oswald Spengler, hij was op zoek naar de “metaphysische Struktur der historischen Menschheit” (14), hij wilde op een intuïtieve manier doordringen tot een diepere laag van de werkelijkheid en de “onzichtbare” patronen van de geschiedenis blootleggen. Spengler verweet anderen dat ze zich te weinig met metafysica bezighielden, en zal door Julius Evola hetzelfde verwijt krijgen toegespeeld !
Het cultuurcyclisch systeem. Naast de metafysische kern van het leven is er het leven zelf, de ontwikkeling ervan, het biologische leven van de cultuur als een organisme. Culturen zijn organismen die te vergelijken zijn met dieren of planten. Hiermee maakt hij ook de evolutie van cultuur naar beschaving duidelijk. Dit is de tweede laag, de cultuurmorfologisch-cultuurcyclische laag
Er is de derde laag: het geheel van de politieke consequenties die Oswald Spengler uit zijn cultuurfilosofie trok. Vooral in het tweede deel van zijn Untergang worden zijn politieke ideeën verder ontwikkeld. Ze werden ook op een later moment aangebracht dan de vorige twee niveau’s. De drie niveau’s bevatten een hoge samenhang en de uitspraak van Tracy B. Strong, aangehaald door Frits Boterman, vat het geheel goed samen : “Paradoxaal genoeg is hij zowel een onbuigzaam reactionair als ook een mysticus” (15). Wat Spengler op politiek vlak nastreefde, was Duitsland een nieuwe zonnereligie geven, en een wereldrijk. Vergeten we de tijdsomstandigheden niet : het eerste deel van Untergang des Abendlandes was grotendeels reeds in 1913 geschreven en werd gepubliceerd in 1918. Het tweede deel, met de focus op de politieke gevolgtrekkingen van een en ander, pas in 1922-1923.
Spenglers ergste vijand, Heinrich Rickert, verweet hem zijn modern biologisme. En van dat biologisme een verband leggen naar Nietzsche is heel eenvoudig, want ook de filosoof met de hamer is schatplichtig aan dit biologisme, dat leert dat zijn niet alleen betekent dat het zijnde moet worden behouden, maar zich moet vermeerderen, vergroten, aan uitbreiding doen. De Wille zur Macht. De cultuurmorfologie van Spengler wordt door Rickert op een hoopje geworpen met Nietzsche.
Nu kan de invloed van Friedrich Nietzsche op de auteur van Untergang moeilijk worden overschat, maar het zou een fout zijn niet te wijzen op de invloed van de filosoof Danilevski en van de historici E. Meyer en Friedrich Schiller.
Oswald Spengler sprak zich meermaals uit tegen absolute waarheden en eeuwige waarden, wat in zijn cultuurfilosofie regelmatig terug komt. Er is géén universele geschiedenis van de mensheid en elke moraal is cultureel bepaald. Ook Spengler is iemand die zich verzet tegen een eurocentrische benadering van de mensheid, zonder daarom ook maar even te vervallen in de in bepaalde milieus zo mondain staande “weg-met-ons”- mentaliteit. Spengler laat echter ook aan duidelijkheid niets over : het Westen gaat onvermijdelijk ten onder, de vrijheid van de mens is uiterst beperkt, en elke filosofie was en is tijdsgebonden, dus relativistisch en perspectivistisch. Hij legde als cultuurcriticus bloot wat er aan cultuurwaarde, religie, bezieling en geestelijke vitaliteit was verdwenen. In tegenstelling tot Nietzsche geloofde de auteur van Der Untergang niet meer in regeneratie van cultuur : Nietzsche heeft als geen ander – vandaar zijn invloed op zovelen, ook nu nog – de culturele symptomen van zijn tijd geanalyseerd en geïnterpreteerd als tekenen van verval en achteruitgang. Hij merkt overal de tekens van vermoeidheid, van uitputting en decadentie. En waar een figuur als Thomas Mann blijft steken in zijn Bildungsbürgertum, is Friedrich Nietzsche een stuk verder gegaan en kan men in zijn Uebermensch het Nietzscheaans genezingsproces zien. De therapie van Nietzsche is heel radicaal en superindividueel : enkelingen zullen de therapie van Nietzsche wel kunnen volgen – en genezen ? – maar daar heeft een ganse cultuur of natie niet veel aan, natuurlijk. Mann schreef over Nietzsche de volgende waarderende woorden : “..als vielmehr der unvergleichlich grösste und erfahrenste Psycholog der Dekadenz” (16). Alleen de Uebermensch kan de decadentie overwinnen. Decadentie bij Friedrich Nietzsche is veel minder een mechanisch, een automatisch proces dan bij Spengler. Decadentie ontstond – althans volgens Nietzsche – op het moment dat duidelijk werd dat God dood was en dat de mens in zichzelf de zin van het leven moest vinden. Wie kan zich met deze waarheid staande houden ? Alleen de Uebermensch, de mens die brug is geworden, en die gedreven is door de gedachte van de eeuwige wederkeer en door de wil tot macht is bezield.
Ze zijn beiden decadentie-filosofen, Nietzsche en Spengler, maar hun visie op het ontstaan en de uitrol van de decadentie is erg verschillend, dus ook de “oplossingen”. Maar ook gelijkenissen springen in het oog. Zo stelde Nietzsche vast dat de decadentie in de Griekse wereld – het ijkpunt voor Nietzsche en zovele andere 19e en 20e eeuwse denkers – dan is gestart op het moment dat de cultuur geïntellectualiseerd werd. Dit gebeurde door een figuur als Socrates die alles in vraag begon te stellen en die het weten tot grootste deugd verhief (17).
Ook Spengler zag een en ander analoog gebeuren, en zal hieraan het begrip Zivilisation verbinden. Maar waar Spengler deze versteende cultuur onvermijdelijk op haar einde zag toestappen, ontwaarde Nietzsche wel degelijk ontsnappingswegen. Lebensbejahung, Wille zur Macht, hetgeen wij hierboven reeds opsomden. Maar in de Griekse cultuur gebeurde juist het tegenovergestelde : reeds verzwakt door de socratische levenshouding wordt ze volledig vernietigd door de overwinning van de christelijke moraal.
Maar Spengler nam veel over van Nietzsche, zoveel is duidelijk : hij geloofde sterk in diens Umwertung aller Werte, de antithese cultuur-beschaving is zonder Nietzsche niet te begrijpen. Spengler voltooide de Nietzscheaanse boodschap en gaf er een metapolitieke en politieke inhoud aan. Hij heeft Nietzsche misbruikt, zullen anderen zeggen. Voor Spengler was de figuur van de Uebermensch een echt Luftgebilde, Spengler geloofde niet in de verbetering van de menselijke natuur en deelde de ondergang in bij de onvermijdelijkheden. Hij zag Nietzsche als de laatste romanticus. Politiek gezien brak de periode aan voor de nieuwe Caesars, niet voor een nieuwe Goethe. Nietzsche daarentegen was geen politiek denker, hij was op zoek naar individuele waarheden en oplossingen, terwijl Oswald Spengler geloofde in collectiviteiten, waaraan de mens is overgeleverd (18). Omdat de cultuur in de visie van de ondergangsfilosoof Spengler niet meer te regenereren was, moest zijn cultuurfilosofie in dienst staan van de harde politiek van het Duits imperialisme en zijn nieuwe Caesars – de laatste fase van de Zivilisationsperiode. De laatste doet dus het licht uit.
De levensfilosofie van Oswald Spengler
De Duitse cultuurfilosoof was duidelijk een man van de moderne wereld, hij gebruikte heel wat moderne begrippen en had heel wat te danken aan Nietzsche. Frits Boterman wees hier in zijn biografie op. Toch merkt dezelfde auteur op dat Spengler zich ook verzette tegen de rationalistische en natuurwetenschappelijke werkelijkheidsconceptie van zijn tijd. Op die manier sloot de Duitser zich aan bij de filosofische stroming van de Lebensphilosophie, een verzameling van - zowel naar methodiek als naar afbakening van interessegebied – antirationalisten (19). De heer Boterman stelt vast dat – hoewel we het ons nog moeilijk kunnen voorstellen – het Leben hét centrale thema was in de Duitse filosofie tussen 1880 en 1930. De Lebensphilosophie legde de nadruk op het intuïtieve, irrationele en gevoelsmatige van het leven, en was gericht tegen het natuurwetenschappelijk positivisme. Spengler kwam dus met zijn cultuurfilosofie niet zomaar uit de lucht vallen in Duitsland. Zijn zoektocht naar de “achterliggende” waarheid lag in dezelfde lijn als Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Freud en Sorel. De invloed van deze levensfilosofische school reikte ver, buiten Duitsland en in geheel Europa.
Frits Boterman onderneemt een meer dan verdienstelijke poging om de algemene lijnen van de Lebensphilosophie samen te vatten; wij geven de grote lijnen (20) :
De levensfilosofie gaat er in het algemeen van uit dat er geen transcendente realiteit bestaat, behalve het bestaan zelf. Het vertrekpunt is de Diesseitigkeit (het leven op aarde).
T.o.v. het primaat van het rationeel positivistisch denken stelden de levensfilosofen het primaat van het gevoel, de beleving, de intuïtie (de Tiefenerlebnis van Oswald Spengler). Belangrijk zijn dus de emotionele momenten die de mens zijn plaats in de totaliteit van het leven doen beleven.
Spengler moet worden gesitueerd in de brede stroom van deze Lebensphilosophie. Merkwaardig is wel dat hij hier niet helemaal in past : immers, Frits Boterman merkt op dat, hoewel de Duitser de natuurwetenschappelijke werkelijkheidsconceptie bestreed, hij haar bestaansrecht helemaal niet betwistte.
In bijlage, de drie vergelijkende tafels uit Der Untergang des Abendlandes, waarin Oswald Spengler steeds op een analoge manier enkele culturen naast elkaar zet.
Op het vlak van de filosofie en de geesteswetenschappen zette hij in deze vergelijking de volgende culturen naast elkaar : de Indische, de Antieke, de Arabische en tenslotte de Avondlandse cultuur.
In de 2e vergelijking – op het vlak van kunst : de Egyptische, de Antieke, de Arabische en de Avondlandse
En tenslotte op het vlak van de politiek : de Egyptische, de Antieke, de Chinese en de Avondlandse
De vergelijkende tabellen worden in de oorspronkelijke, Duitse taal gebracht, een Nederlandse vertaling heb ik immers niet gevonden.
3. JULIUS EVOLA – met Romeinse virtù
Belangrijkste werken van Julius Evola :
 1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.
1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.
1928 Imperialisme pagano. Il fascismo dinnanzi al pericolo euro-cristiano
1931 La tradizione ermetica. Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua “Arte Regia”
1932 Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Analisi critica delle principali correnti moderne verso il « sovranaturale ».
1934 Rivolta contro il mondo moderno
1937 Il mistero des Graal e la tradizione ghibellina dell’Impero
1950 Orientamenti. Undici punti
1953 Gli uomini e le rovine
1958 Metafisica del sesso
1961 Cavalcare la tigre
1963 Il cammino del Cinabro
De metafysica die Julius Evola (1898-1974) in zijn werken uiteenzet (in Rivolta, zijn hoofdwerk, maar ook in andere werken), en die hij steeds zelf heeft omschreven als “transcendent realisme”, omvat een involutionistische filosofie van de geschiedenis (van beter naar minder dus), gebaseerd op het dubbele axioma dat geschiedenis een proces van verval is, en de moderne wereld een fenomeen van decadentie. Deze geschiedenisfilosofie identificeert zich eigenlijk totaal met de wereld van de Traditie. Wat men in de moderne wereld als “politiek” omschrijft, betekent in het perspectief van de Traditie slechts een geheel van gedegradeerde vormen van een superieure vorm van politiek, gebaseerd op de ideeën van autoriteit, soevereiniteit en hiërarchie.
Involutie is de zin van de geschiedenis, zegt Julius Evola
Volgens Pierre-André Taguieff in Politica Hermetica, nr. 1, 1987 (21) is het Evoliaans denken eerder een denken over decadentie dan een denken over restauratie. Zijn radicale kritiek op de moderne wereld is even coherent als overtuigend, terwijl zijn politieke ideeën bepaald zijn door nostalgisch utopisme, irrealistisch – nog eens, volgens de auteur Taguieff. Hij (Evola) streeft een ideaal regime na, dat echter door elke historische realiteit wordt verraden, want in de realiteit omgezet. Dat is de voornaamste reden waarom wetenschapper Taguieff vindt dat Evola sterker staat in het bepalen van decadentie, dan in het neerpennen van politieke alternatieven. Maar zijn interpretatie en zijn onderzoek naar het decadentiebegrip bij Julius Evola is zo helder geschreven, dat wij hem in ons artikel
meermaals zullen moeten citeren.
Het thema van de decadentie kan elke aandachtige lezer terugvinden in alle vruchtbare periodes in Evola’s leven. Natuurlijk is er veel plaats voor het thema van zijn metafysica van de geschiedenis ingeruimd in het hoofdwerk, Rivolta, het volledige tweede deel van het werk. Het thema van de “decadentie” neemt een centrale plaats in in het werk van de Italiaanse filosoof : de fundamentele thesis is de idee van de decadente natuur van de moderne wereld, en is te vinden in de Rivolta (22). Maar ook in de andere werken, La dottrina del Risveglio. Saggio sull’ascesi buddista en Cavalcare la tigre en tenslotte Gli uomini e le rovine, zijn veel verwijzingen terug te vinden. Het voornaamste werk heeft als kern, de vraag hoe te reageren in een tijdperk van algemene, uitsluitende dissoluzione.
In tegenstelling tot heel wat moderne denkers, die vertrekken van een sociologische vaststelling van wat is en wat verkeerd loopt, vertrekt Evola in zijn studie over het begrip decadentie – en hierin is hij toch wel origineel – van de primordiale wereld van de Traditie, de oorspronkelijke Traditie, als absoluut referentiepunt. De moderne wereld wordt bestudeerd vanuit dit ijkpunt, en niet omgekeerd. Een drieledig standpunt : een axiologische visie, als een legitiem systeem van normen en als enige authentieke weg dus.
En de decadentie, aldus Evola, is een ziekte die al heel lang in deze samenleving sluimert, maar die geen mens durft uit te spreken. Ook bleven de symptomen lange tijd verborgen, door allerlei ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen aan ons oog onttrokken. “De realiteit van de decadentie is nog verborgen door de idee van vooruitgang, door idyllische perspectieven, ons door het evolutionisme aangeboden” (23), gemaskeerd dus door de idee van vooruitgang, en “gesecondeerd door de superioriteit van de moderne beschaving”. Zo zal het gevoel van de val ons maar duidelijk worden tijdens de val zelf. Om weerstand te kunnen bieden, moet de kleine minderheid, aldus Evola, het referentiepunt, de Traditie, leren kennen. En de twee modellen die Evola naar voren schuift om het involutieproces dat de geschiedenis is, te leren kennen, ontwikkelt hij uit de traditionele leerstellingen : de doctrine van de 4 tijdperken en de wet van de regressie van de kasten.
De doctrine van de 4 tijdperken
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de Kali Yuga, het IJzeren Tijdperk. Reeds Hesiodos beschreef de vier tijdperken als het Gouden Tijdperk, het Zilveren, het Bronzen en het IJzeren Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele)
Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.
De metafysica van de geschiedenis had een belangrijk gevolg : als de geschiedenis inderdaad het proces van progressieve involutie volgt, van het ene, hogere tijdperk naar het lagere tijdperk, dan kan het eerste tijdperk – althans de doctrine – niet dat zijn van de primitief, van de barbaren, maar wel dat van een superieure staat van de menselijke soort. Het gevolg was dat Evola, naast andere auteurs, onmiddellijk ook de evolutietheorie afwees.
De metafysica van de geschiedenis schrijft een onontkoombaar lot voor, een onweerlegbare koers. Evola legt er de nadruk op dat “hetgeen ons in Europa overkomt, niet arbitrair of toevallig gebeurt, maar voortkomt uit een precieze aaneenschakeling van oorzaken” (25). En “net als de mensen hebben ook beschavingen hun cyclus, hun begin, hun ontwikkeling en hun einde… Zelfs als de moderne beschaving moet verdwijnen, zal ze zeker niet de eerste zijn die verdwijnt en ook niet de laatste…. Cycli openen zich en sluiten af. De traditionele mens was bekend met de doctrine van cycli en alleen de onwetendheid van de moderne mens heeft hem en zijn tijdgenoten doen geloven dat zijn beschaving, die haar wortels heeft in het tijdelijke en het toevallige, een ander en meer geprivilegieerd lot zou kennen” (26)
Wanneer begonnen zich de eerste tekenen van decadentie te manifesteren volgens de Italiaanse cultuurfilosoof ? “De eerste tekenen van moderne decadentie zijn reeds aan te wijzen tussen de 8ste en 6e eeuw voor Christus…. Het komt er dus op aan het begin van de moderne tijden te laten samenvallen met wat men de historische tijden heeft genoemd…. Binnen de historische tijden en in de westerse ruimte duiden de val van het Romeinse Rijk en de komst van het christendom een tweede etappe aan van de vorming van de moderne wereld. Een derde etappe tenslotte doet zich voor met het ineenstorten van de feodale en Rijkswereld van het Middeleeuwse Europa, en bereikt haar hoogtepunt met het humanisme en de reformatie. Van dan af aan, en tot in onze dagen, hebben machten – al dan niet openbaar – de leiding genomen van alle Europese stromingen op het materiële en spirituele vlak” (27)
De etappes van de decadentie – de wet van het verval van de kastes
Het is in het 14e en 15e hoofdstuk van het tweede deel van zijn Rivolta dat we de belangrijke uitleg krijgen over de objectieve wet van de val van beschavingen. Ook hier is er opnieuw zwaar tol aan René Guénon betaald, zoals ook P. A. Taguieff opmerkte (28). De wet van de vier kastes beantwoordt grotendeels aan de doctrine van de vier tijdperken, want in de vier kastes vindt men de waarden terug die volgens deze doctrine opeenvolgend domineerden in één van de vier tijdperken van de regressie. Voor Evola verklaart deze wet ten volle het involutieve karakter in alle sociaalpolitieke aspecten. In alle traditionele maatschappijen zou er een gelijkaardige stratificatie hebben bestaan : aan de top staan overal de vertegenwoordigers van de spirituele autoriteit, daarna de krijgsaristocratie, erop volgend de bezittende burgerlijke stand en tenslotte de knechten. Deze vier “functionele klassen” corresponderen aan bepaalde levenswijzen, elk met zijn eigen gezicht, eigen ethiek, rechtssysteem in het globale kader van de Traditie (29). “De zin van de geschiedenis bestaat nu juist in de afdaling van de macht en van het type van beschaving van de ene naar de andere van de vier kastes, die in de traditionele maatschappijen beantwoorden aan de kwalitatieve differentiering van de belangrijkste menselijke mogelijkheden” (30). Evola vatte in zijn autobiografisch werk Le chemin du cinabre deze regressie en het belang ervan voor de geschiedenis als volgt samen : “Na de val van die systemen die berustten op de zuivere spirituele autoriteit (“sacrale maatschappijen”, “goddelijke koningen”) gaat in een tweede fase de autoriteit over in handen van de krijgsaristocratie, in de cyclus van de grote monarchieën, waar het “goddelijk recht” van de soeverein nog slechts een restecho is van de waardigheid van de eerste leiders. Met de revolutie van de Derde Stand, met de democratie, het kapitalisme en de industrialisering gaat de effectieve macht over in handen van de derde kaste, de eigenaars van de rijkdom, met een even grote transformatie van het type van beschaving en van de heersende belangen. En uiteindelijk kondigen socialisme, marxisme en communisme – en realiseren het ook ten dele - de ultieme fase aan, de komst van de laatste kaste, de antieke kaste van de slaven, die zich organiseren en de macht veroveren. Zij zet de regressie door tot in de laatste fase” (31). Op de creditzijde van de Italiaanse filosoof mag in elk geval genoteerd worden dat hij ook op momenten dat het niet “opportuun” werd geacht, want men moest zijn beschermheer niet de haren in strijken, er steeds op gewezen heeft dat Europa door Amerika werd bedreigd : niet militair, maar politiek, economisch en vooral cultureel. Amerika, dat is voor Evola een perversie van de waarden, en deze perversie leidt onvermijdelijk tot bolsjewisme. Amerika doekte in Europa de laatste restanten op van een feodale en traditionele maatschappij. De Amerikaans liberale weg leidt de beschaving naar haar laatste fase. Metafysisch plaatst de Italiaan Amerika en Sojwet-Rusland in hetzelfde kamp : het zijn twee kanten van dezelfde munt. Communisme is de laatste fase van de involutie, die wordt voorafgegaan door de derde fase, die van de liberale bezitters.
De tweedeling van de beschaving : traditionele versus moderne maatschappij
Het zal onze aandachtige lezers natuurlijk al duidelijk geworden zijn dat er tussen moderne maatschappij en traditionele maatschappij een bijna letterlijk te nemen “onmacht tot communiceren” bestaat, toch in het concept van Julius Evola. En uit de wet van de regressie van de kasten valt al evenzeer een vergankelijkheid van de moderne wereld af te leiden, wat ook heel wat “modernen” zal choqueren. Het verdwijnen van de moderne wereld heeft voor de filosoof slechts “de waarde van het puur toeval” (32) En bovenop het beschavingspluralisme, waarover Spengler het heeft, moet u in Evola’s model rekening houden met het “dualisme van de beschaving”. Er is de moderne wereld en er zijn aan de andere kant die beschavingen die haar vooraf zijn gegaan, tussen die beiden is er een volledige breuk, het zijn morfologisch gezien totaal verschillende vormen van beschaving. Twee werelden waartussen bijna geen contact mogelijk is, want zelfs de betekenis van dezelfde woorden verschilt. Een begrip van de traditionele maatschappij is derhalve voor de grote meerderheid van de modernen onmogelijk (33).
En zoals in de vertaling van een artikel, dat wij in TeKoS (34) afdrukten, vermeld, kunnen tijds- en ruimtebeschavingen terzelfdertijd en naast elkaar bestaan. Moderne wereld en traditionele maatschappijen : twee universele types, twee categorieën.
Tekens van decadentie – diagnose van het heden als geheel van regressieve processen
Als denker van de Traditie heeft Julius Evola een misprijzen voor de moderne westerse wereld, en daarin wordt hij gevolgd én voorafgegaan door nogal wat denkers van de Conservatieve Revolutie. De symptomen waren voor de meeste auteurs in dezelfde hoek te zoeken, alleen over de remedies was men het minder eens. Ook het alternatieve staatsmodel, welk mechanisme de staats- of rijksordening moest leiden, was voor de meesten verschillend.
In hetzelfde artikel over het decadentiedenken van Julius Evola somt auteur Taguieff de symptomen op (35) :
1. Het egalitarisme, pendant van het universalisme van het joods-christelijk type. En Evola benadrukt de christelijke wortels van de egalitaire wortels.
2. Het individualisme. Samen met Guénon bestrijdt Evola het individualisme, want door het bestaan ervan wordt elke transcendentie genegeerd, te beginnen met die die “de persoon” belichaamt. De moderne vergissing : persoon met individu verwarren.
3. Het economisme, de overwaardering dus van productie (productiviteit, aanbidden van de afgod van de materiële vooruitgang, het integraal economisch materialisme, vergoddelijking van geld en rijkdom. Evola is schatplichtig aan Werner Sombart.
4. Het rationalisme, de ideologische implicaties van het paradigma van de “moderne wetenschap” – de neoreligie van de Vooruitgang, het scientisme – verwerping van elke contemplatieve gedachte t.v.v. een weten, gestuurd door een technische actie.
5. De ontbinding van de staat, van de macht, en vooral van de spirituele macht, van de idee zelf van hiërarchie, in en door democratie, liberalisme en communisme. De massificatie van de volkeren, zodat gedragingen, geëgaliseerd en geïnfantiliseerd, beter controleerbaar worden.
6. Het humanisme in zijn historische vormen: het humanisme of het humanitaire cosmopolitisme, de bourgeoisie met haar fundamentele sociale, morele en sentimentele aspecten, en het valse koppel van het liberaal utilitarisme (gericht op de opperste waarde van het welzijn, gebaseerd op de norm van profijt) en het “spiritueel evasionisme”.
7. De verschillende vormen van “seksuele revolutie”, met daarin de hegemonie van de vrouwelijke waarden (broederschap, veiligheid), de groeiende gelijkmaking en uitvlakken van de seksuele verschillen, het oprukken van psychoanalyse als “de demonie van de seksualiteit”, waardering van de “derde sekse”.
8. Het verschijnen van valse elites, oligarchieën van verschillende types, plutocratie, dictators en demagogen, moderne intellectuelen. Twee signalen onderzocht Evola nauwkeurig : het verlies aan zin voor aristocratie, de kracht ervan en de originele traditie, en aan de andere kant de ontbinding van de artistieke vormen, getuige daarvan de twijfel van de moderne muziek tussen intellectualisering en primitieve hypertrofie van zijn fysieke karakter.
9. De ondergang van hetgeen Evola superieure rassen noemt, ras niet te begrijpen in een biologische opvatting.
10. Opkomst van allerlei vormen van neospiritualisme, de zgn. tweede spiritualiteit, met een term eigen aan Spengler. Het vernielen van de traditionele vormen van religie en ascese, hertaald in een “humanitaire democratische moraal”. Evola omschrijft dit neospiritualisme als de evenknie, het evenbeeld van het westers materialisme.
11. De overbevolking. Evola behoort niet tot de natalistische vleugel van de Conservatieve Revolutie: bezorgd is hij niet door ontvolking, hij zoekt menselijke kwaliteit, géén kwantiteit.
12. Het totalitarisme, mogelijk gemaakt door het organisch concept van de staat te vernietigen, en belichaamd door een nieuwe paradoxale formatie : de idôlatrie van de staat en de atomisatie van de gemeenschap. Vanaf dan reflecteert hetgeen beneden is, niet meer hetgeen boven is, want er is geen boven meer. Elke afstand is afgeschaft. De totale horizontaliteit van de geatomiseerde maatschappij – de som van perfect uitwisselbare individuen – is de voorwaarde voor het verschijnen van de pseudostaat, die de totalitaire staat in wezen is.
13. Tenslotte het naturalisme in al zijn varianten : biologisme, materialisme, collectivisme, ja, zelfs nationalisme.
Slotopmerking : wat is decadentie voor Julius Evola ?
Het moet al duidelijk geworden zijn : de negatie van de Traditie is het beginpunt van decadentie en verval. Decadentie kan in de ogen van Evola het best omschreven worden als het toaal verlies aan “oriëntatie naar het transcendente” (36). Had ook Friedrich Nietzsche het niet over “God is dood” als beginpunt van het Europees nihilisme ? In die mate is de moderne maatschappij dan ook volledig tegengesteld aan de traditionele maatschappij en is de toegang naar het transcendente voor haar afgesloten. In zijn later werk Orientamenti zal de Italiaan de lijn doortrekken en noteren dat het antropocentrisme eigenlijk het begin betekent van de decadente moderniteit. Hierin ligt trouwens de scherpste kritiek van Evola aan het adres van Oswald Spengler, iets wat we nu gaan ontdekken.
4. JULIUS EVOLA OVER OSWALD SPENGLER
De twee belangrijke cyclisten, beiden actief in wat men later de Conservatieve Revolutie is gaan noemen, moesten elkaar vroeg of laten wel ontmoeten. Evola kwam een aantal keren in Duitsland spreken voor bvb. de Herrenclub, maar tot een ontmoeting tussen de beide filosofen is het nooit gekomen. We mogen ervan uitgaan dat Spengler de Italiaan niet kende en ook zijn werken niet had gelezen. Vergeten we trouwens niet dat het magnus opum van Evola pas in 1936 verschijnt, en dat Spengler hetzelfde jaar overleed. Maar Spengler kende bvb. ook de naam van Vico niet, wat erop kan duiden dat hij weinig kennis had over de Italianen. Evola kende het werk van Spengler wel, hij las alle werken van de Duitser, niet alleen Der Untergang des Abendlandes, maar ook zijn Jahre der Entscheidung. En in een tweetal artikels ging de Italaanse filosoof dieper in op de betekenis van Spengler voor het traditioneel denken en poogde hij tevens een traditionele kritiek te formuleren op de fundamenten van het Spengleriaans denken. Evola vertaalde Der Untergang des Abendlandes in het Italiaans in 1957 en vatte in zijn inleiding enkele punten van kritiek samen. Verder schreef hij in Vita Italiana in 1936 over de Duitse ondergangsfilosoof. De beide artikels werden in 1997 in het Frans vertaald en uitgegeven (37).
Voor Julius Evola is Spengler géén moderne auteur, in die zin dat hij met zijn werk het gevoel wekt reëel te zijn, te appelleren aan iets dat groter is dan zichzelf. De beschaving, aldus Spengler, ontwikkelt zich niet volgens het ritme van een continue vooruitgang naar de “beste” beschaving. Er bestaan slechts verschillende culturen, afzonderlijk van elkaar. Tussen culturen bestaan hoogstens verbindingen van analogie, maar er is géén continuïteit.
Evola merkt op dat dit de centrale ideeën van Spengler zijn, die op geen enkele manier terug te brengen zijn tot een persoonlijke filosofische stelling. Want op een of andere manier leefden dezelfde ideeën ook reeds in de antieke wereld, onder de vorm van cyclische wetten die de culturen en de volkeren leidden. Alleen, dit maakt ook direct dé grote zwakte uit van Spengler, want op geen enkel moment wordt er ook maar gewag gemaakt van het transcendente karakter van de cyclische wetten van de culturen : “Hij ontwierp zijn wetten als nieuwe naturalistische en deterministische wetten, als een reproductie van het somber lot dat planten en dieren (…) te wachten staat: ze worden geboren, groeien en verdwijnen. Zo had Spengler geen enkel begrip van de spirituele en transcendente elementen die aan de basis liggen van elke grote cultuur. Hij is de gevangene van een laïcistische stelling die de invloed onderging van de moderne ideeën van de levensfilosofie, het Faustisch activisme en het aristocratisch elitisme van Friedrich Nietzsche” (38). En Evola komt tot de essentie : Spengler heeft niet begrepen dat er boven de pluraliteit van culturen en hun ontwikkelingsfasen een dualiteit van cultuurvormen bestaat. Hij benaderde dit concept nochtans op het moment dat hij culturen in opgang plaatste tegenover culturen in neergang, en cultuur t.o.v. beschaving. Maar, zegt Evola, hij slaagde er niet in om de essentie van de tegenstelling bloot te leggen.
 De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”.
De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”.
Toch kan Evola zich vinden in de beschrijving van de beschaving in verval : “Massacultuur, anti-kwalitatief, anorganisch, urbanistisch en nivellerend, diep anarchistisch, demagogisch en antitraditioneel”. En verder wijdt hij enkele zinnen aan de twee wereldrevoluties die het Westen in Spengleriaans opzicht zullen nekken : “Een eerste, interne, heeft zich al gerealiseerd, de sociale revolutie van de massificatie en assimilatie (…). De tweede revolutie is zich aan het voorbereiden, de invasie van de gekleurde rassen, die zich in Europa vestigen, zich europeaniseren en die de beschaving naar hun hand zullen zetten” (40). En dan opnieuw de kritiek van de Italiaanse filosoof : als antwoord op deze bedreigingen “weet Spengler slechts het ideaal van het mooie beest op te roepen, het eeuwige instinct van de krijger, latent aanwezig in periodes van ondergang, maar klaar om op te springen als de volkeren zich in hun vitale substantie bedreigd voelen (…). Dit beantwoordt volledig aan de visie van een tragische Faustische ziel, dorstend naar het eeuwige, wat voor Spengler juist model stond voor het Leitmotiv van de westerse cyclus”. Deze weg vindt Evola zeer vaag en onduidelijk, want de opkomst van de grote rijken, met hun binoom massa-Caesar, waren de emanatie van de kanker van het vernietigend cosmopolitisme, van het demonisch karakter van massa’s en dus uitingen van de decadentie zelf. Het echte alternatief zou er juist in bestaan de massa’s als massa te vernietigen en in haar nieuwe articulaties te provoceren, nieuwe klassen, nieuwe kasten (41). Niets van dit alles bij Spengler, stelt Evola bijna teleurgesteld vast, er is maar één ankerpunt, zijn Pruisen, zijn Pruisisch ideaal. Spengler zag Pruisen niet in nationale dimensies, maar eerder als een levenswijze : niet hij die in Pruisen is geboren, kan zich Pruis noemen, maar “dit type kan men overal vinden, het is een teken van ras, van gedisciplineerde toewijding, van innerlijke vrijheid in het uitvoeren van de taak, autodiscipline”. Evola besluit met te stellen dat dit Pruisen op zijn minst een solide traditioneel referentiepunt is, maar betreurt toch dat Spengler niet verder is gegaan.
5. ENKELE VERDIENSTEN VAN DE BEIDE HEREN
De betreurde Armin Mohler vatte de betekenis van Oswald Spengler in een aantal rake punten samen. Wij kunnen de voornaamste punten bij uitbreiding ook toepassen op de Italiaanse ondergangsauteur :
Spengler trekt in crisissituaties ondergrondse stromingen van het denken met een radicaliteit in het bewustzijn, wat voor hem hoogstens door een Georges Sorel werd voorgedaan. En die gedachtenstroming is een denken over de realiteit, gestart door de Stoa en Herakleitos, dat vanaf de start afzag van valse troostende gedachten of van de voorspiegeling van ordenende systemen. Dit denken – dat ook dat van Spengler is – staat boven elk optimisme of pessimisme. Geschiedenis is een in elkaar lopend proces van geboorten en ondergang en er blijft de mens niets anders over dan deze realiteit met heroïsche aanvaarding te ondergaan.
Een tweede verdienste, schrijft Mohler, is het opnieuw in baan brengen van het cyclisch denken, vanuit een stroom van Europese en buiten-Europese denkers. T.o.v. het aan invloed winnende liniair denken - zeker na de overwinning van het liberaal kapitalistische mens- en maatschappijbeeld - is het nodig en noodzakelijk dat een alternatief, ook op intellectueel vlak, geboden wordt op de vooruitgangsidee (42). De originaliteit bestaat hierin dat hij het organisch concept van de Duitse Romantiek overbracht op de cyclische gedachte en deze van toepassing verklaarde op zijn acht cultuurkringen. Hij combineerde de cyclische idee met het probleem van de decadentie en het verval van de cultuur. Een fundamentele breuk dus met de optimistische liberale vooruitgangsidee, en vooral nuttig in het doorprikken van de zeepbel, als zou er slechts één manier bestaan om naar de wereld te kijken.
Werd er van wetenschappelijke hoek vaak kritiek uitgebracht op de cyclische cultuurfilosofen – vooral het determinisme werd als onwetenschappelijk van de hand gewezen – dan is diezelfde kritiek even goed van toepassing gebleken op het liniaire beeld van de geschiedenis : ook hier speelt een determinisme mee, dat wetenschappelijke kringen al evenmin kunnen accepteren. Match nul, zullen wij maar zeggen, of is de eerste helft pas gespeeld ? Het is belangrijk te beseffen dat Spengler er samen met Toynbee, Sorokim Pitrim en anderen, voor heeft gezorgd dat de liniaire geschiedenisfilosofie – een uitvloeisel van de drie monotheïstische godsdiensten en hun wereldlijke realisaties – een cyclisch geschiedenisbeeld tegenover zich kreeg, dat eerder of opnieuw aanknoopte bij de oude, heidense, polytheïstische godsdiensten : een tijdlang hield de liniaire geschiedenisfilosofie vol, dat zij en zij alleen wetenschappelijke waarde had. Sinds het oprukken van de cyclische geschiedenisfilosofie kan zij dit niet meer volhouden.
Tenslotte heeft niemand zo duidelijk en onverbiddelijk als Spengler gewezen op de sterfelijkheid en vergankelijkheid van culturen en tot het einde toe doorgedacht. Sommige one-liners moeten toch doen denken : “De blanke heersers zijn van hun troon gestoten. Vandaag onderhandelen zij waar ze gisteren nog bevalen en morgen zullen ze moeten smeken om nog te mogen onderhandelen. Ze hebben het bewustzijn verloren van zelfstandigheid van hun macht en ze merken het niet eens”.
De verdienste van Julius Evola in dit alles : de Italiaanse filosoof verruimde de blik van Spengler en voegde er een transcendente, spirituele dimensie aan toe. Verder wees hij erop dat het proces van het sombere tijdperk, de finale fase dus, zich eerst bij ons heeft ontwikkeld. Daarom is het niet uitgesloten dat we ook de eersten zullen zijn om het nulpunt te passeren, op een moment waarop andere beschavingen zich nog in de fase van ontbinding zullen bevinden.
Voetnoten
(1) Weismann, K., Het rechtse principe, TeKoS, nr. 113, pag. 5
(2) Kaltenbrunner, G-K, Europa, Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden, regio – Glock und Lutz, Sigmaringendorf, 1987, pag. 36 e.v.
(3) Huntington, S., Botsende beschavingen, Uitgeverij Anthos, Baarn, 1997, ISBN 90 763 4115 x
(4) Cliteur, P., Tegen de decadentie, Arbeiderspers, Amsterdam, 2004, 223 blz., 16,95 euro)
(5) Weismann, K., Die heroische Existenz im Geistigen, in Junge Freiheit, nr. 6/04, 30 januari 2004, pag. 17
(6) Freund J., Evola ou le conservatisme révolutionnaire, in Guyot-Jeannin, A., Julius Evola, Les dossiers H, L’Age d’Homme, Lausanne, Suisse, 1997, pag. 187
(7) Weissmann, K., Het rechtse principe, TeKoS, nr. 113, pag. 5
(8) Spengler, O., Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Verlag C. H. Beck, München, 1973, eerste uitgave 1923,1249 pagina’s
(9) Evola, J., Rivolta contro il mondo moderno, Ulrico Hoepli, Milano, 1934, 482 pagina’s
(10) Boterman, F., Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Cultuurpessimist en politiek activist, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, ISBN 90-232-2695-X, 402 pagina’s.
(11) Kaltenbrunner, G-K, Europa, Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden, Regio – Glock und Lutz, Sigmaringendorf, 1987, pag. 396
(12) Kaltenbrunner, G-K, Europa, Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden, Regio – Glock und Lutz, Sigmaringendorf, 1987, pag. 397-398
(13) Boterman, F., Kultur versus Zivilisation: Oswald Spengler en Nietzsche, in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003, pag. 161-176
(14) Spengler, O., Untergang des Abendlandes, pag. 3
(15) Strong, T. B., Oswald Spengler – Ontologie, Kritik und Enttäuschung, in Ludz, P. C., Spengler heute, München, 1980, pag. 88
(16) Mann, T., Betrachtungen eines Unpolitischen, geciteerd in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003
(17) Evers, M., Het probleem van de decadentie : Thomas Mann en Nietzsche, in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003, pag. 130
(18) Boterman, F, Kultur versus Zivilisation: Oswald Spengler en Nietzsche in Ester, H., en Evers, M., In de ban van Nietzsche, Damon, Dudel, 2003, pag. 175 e.v.
(19) Boterman, F., Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Cultuurpessimist en politiek activist, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, pag. 67
(20) Boterman, F., Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Cultuurpessimist en politiek activist, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, pag. 68
(21) Politica Hermetica, nr. 1, Métaphysique et Politique – René Guénon, Julius Evola, L’Age d’Homme, Paris, 1987, 204 pagina’s
(22) Evola, J., Rivolta contro il mondo moderno, misschien gemakkelijkst in zijn Franse vertaling te lezen. Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, 501 pagina’s
(23) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 9
(24) Evola, J., Il cammino del Cinabro, in Franse vertaling te lezen : Le chemin du Cinabre, Archè, Milano, 1982, pagina 123-124
(25) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 487
(26) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 493
(27) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 493 e.v.
(28) Taguieff, P. A., Julius Evola, penseur de la décadence, in Politica Hermetica, nr. 1, Métaphysique et Politique – René Guénon, Julius Evola, L’Age d’Homme, Paris, 1987, p. 27
(29) Evola, J., Le chemin du cinabre, Arché-Arktos, Carmagnola, 1982, pagina 125
(30) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 449
(31) Evola, J., Le chemin du cinabre, Arché-Arktos, Carmagnola, 1982, pagina 125
(32) Evola, J., Révolte contre le monde moderne, Les Editions de l’Homme, Montréal-Brussel, 1972, pagina 12
(33) Evola, J., La tradition hermétique, Ed. Traditionelles, Paris, 1975, pagina 26
(34) Evola, J., Waarom tijdsbeschavingen en ruimtelijke beschavingen een verschillende geschiedenis hebben, in TeKoS, nr. 57, pagina 13 en volgende
(35) Taguieff, P. A., Julius Evola, penseur de la décadence, in Politica Hermetica, nr. 1, Métaphysique et Politique – René Guénon, Julius Evola, L’Age d’Homme, Paris, 1987, p. 31 en volgende
(36) Evola, J., Chevaucher le tigre, Trédaniel, Paris, 1982, pagina 269
(37) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997
(38) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pagina 7-9
(39) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pagina 10
(40) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pagina 14
(41) Ibidem
(42) Evola, J., L’Europe ou le déclin de l’occident, Perrin & Perrin, 1997, pag. 15-16
(43) Mohler, A., Oswald Spengler (1880-1936) in Criticon, nr. 60-61, pagina 160-162
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, italie, oswald spengler, julius evola, evola, spengler, philosophie, décadence, occident, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 janvier 2010
L'itinéraire d'Edgar Julius Jung
 Archives de Synergies Européennes - 1992
Archives de Synergies Européennes - 1992
L'itinéraire d'Edgar Julius Jung
par Robert Steuckers
Né le 6 mars 1894 à Ludwigshafen, fils d'un professeur de Gymnasium, Edgar Julius Jung entame, à la veille de la première guerre mondiale, des études de droit à Lausanne, où il suit les cours de Vilfredo Pareto. Quand la guerre éclate, Jung se porte volontaire dans les armées impériales et acquiert le grade de lieutenant. A sa démobilisation, il reprend ses études de droit à Heidelberg et à Würzburg mais participe néanmoins aux combats de la guerre civile allemande de 1918-19. Engagé dans le corps franc du Colonel Chevalier von Epp, il participe à la reconquête de Munich, gouvernée par les «conseils» rouges. Jung organise ensuite la résistance allemande contre la présence française dans le Palatinat. En 1923, il doit quitter précipitamment les zones occidentales occupées pour avoir trempé dans le complot qui a abouti à l'assassinat du leader séparatiste francophile Heinz Orbis. C'est de cette époque que date son aversion pour la personne de Hitler: ce dernier, sollicité par Jung envoyé par Brüning, avait refusé de rejoindre le front commun des nationaux et des conservateurs contre l'occupation française, estimant que le «danger juif» primait le «danger français». Pour Jung, ce refus donnait la preuve de l'immaturité politique de celui qui allait devenir le chef du IIIième Reich. En 1925, Jung ouvre un cabinet d'avocat à Munich. Il renonce à l'activisme politique et rejoint la DVP nationale-libérale, un parti toléré par les Français dans le Palatinat et qui rassemblait, là-bas, tous les adversaires du détachement de cette province allemande. Quand Stresemann opte pour une politique de réconciliation avec la France, dans la foulée du Pacte de Locarno (1925), Jung se distancie de ce parti, mais en reste formellement membre jusqu'en 1930. Il consacre ses énergies à toutes sortes d'entreprises «métapolitiques» et d'activités «clubistes». En effet, entre 1925 et 1933, la République de Weimar voit se constituer un véritable réseau de clubs conservateurs qui organisent des conférences, publient des revues intellectuelles, cherchent des contacts avec des personnalités importantes du monde de l'économie ou de la politique. Après avoir eu quelques contacts avec le Juniklub et le Herren-Klub de Heinrich von Gleichen et Max Hildebert Boehm (dont il retiendra la définition du Volk), Jung adhère et participe successivement aux activités du Volksdeutsches Klub (de Karl Christian von Loesch), de la Nationalpolitische Vereinigung (à Dortmund) et du Jungakademisches Klub de Munich, dont il est le fondateur. L'objectif de cette stratégie métapolitique est de créer une nouvelle conscience politique chez les étudiants, de manier l'arme de la science contre les libéraux et les gauches et de fonder une éthique pour les temps nouveaux. En 1927, paraît la première édition de son livre Die Herrschaft der Minderwertigen (= La domination des hommes de moindre valeur), véritable vade-mecum de la révolution conservatrice d'inspiration traditionaliste ou jungkonservative (que nous distinguons de ses inspirations nihiliste, nationale-révolutionnaire, soldatique comme chez les frères Jünger, nationale-bolchévique, völkische, etc.). Entre 1929 et 1932, paraissent plusieurs éditions d'une nouvelle version, comptant deux fois plus de pages, et approfondissant considérablement l'idéologie jungkonservative. Petit à petit, pense Jung, une idéologie conservatrice et traditionaliste, puisant dans les racines religieuses de l'Europe, remplacera la «domination des hommes de moindre valeur», établie depuis 1789. Mais, secouée par la crise, l'Allemagne n'emprunte pas cette voie conservatrice: le parlementarisme libéral s'effondre, plus tôt que Jung ne l'avait prévu, mais pour laisser le chemin libre aux communistes ou aux nationaux-socialistes. Jung constate avec amertume que le noyau conservateur qu'il avait formé dans ses clubs ne fait pas le poids devant les masses enrégimentées. Pour gagner du temps et barrer la route au mouvement hitlérien, Jung estime qu'il faut soutenir le gouvernement de Brüning. Ce gouvernement prolongerait la vie de la démocratie libérale pendant le temps nécessaire pour former une élite conservatrice, capable de passer aux affaires et de construire l'«Etat organique et corporatif» dont rêvaient les droites catholiques. Pour Jung, l'avènement du national-socialisme totalitaire serait la conséquence logique de 1789 et non son éradication définitive par une «éthique de plus haute valeur». En 1930-31, il rejoint les rangs de la Volkskonservative Vereinigung, qui soutient Brüning, et cherche à la rebaptiser Revolutionär-konservative Vereinigung pour séduire une partie de l'électorat national-socialiste. En mai 1932, Brüning tombe. Jung décide de soutenir son successeur Papen, qu'il juge aussi falot que lui. Jung devient toutefois son conseiller. Quand Hitler accède au pouvoir en janvier 1933, Jung prépare aussitôt les élections de mars 1933 en organisant la campagne électorale du Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, visant à soutenir l'aile conservatrice du nouveau gouvernement et à transformer la révolution nationale de Hitler, marquée par une démagogie tapageuse, en une révolution conservatrice, chrétienne, tranquille, sérieuse, décidée. Cette ultime tentative connaît l'échec. Jung continue cependant à écrire les discours de von Papen. Le 17 juin 1934, ce dernier, lors d'un rassemblement universitaire à Marbourg, prononce un discours écrit par Jung, où celui-ci dénonce le «byzantinisme du national-socialisme», ses prétentions totalitaires contre-nature, ses polémiques contre l'esprit et la raison et réclame le retour d'une «humanité véritable» qui inaugurera l'«apogée de la culture antique et chrétienne». Le régime réagit en interdisant la radiodiffusion du discours et la circulation de sa version imprimée. Papen démissionne mais cède ensuite aux pressions de la police. Jung est arrêté le 25 juin et, cinq jours plus tard, on retrouve son cadavre criblé de balles dans un petit bois près d'Oranienburg. Le destin de Jung montre l'impossiblité de mener à bien une révolution conservatrice/traditionaliste à l'âge des masses.
La domination des hommes de moindre valeur. Son effondrement et sa dissolution par un Règne nouveau (Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich), 1929
Jung a voulu faire de cet ouvrage une sorte de «bible» de la «révolution conservatrice», une révolution qu'il voulait culturelle et annonciatrice d'un grand bouleversement politique. S'adressant aux jeunes et aux étudiants, Jung veut donner à son conservatisme —son Jungkonservativismus— une dimension «révolutionnaire». Il explique que l'idéologie progressiste a eu son sens et son utilité historique; il fallait qu'elle brise l'hégémonie de formes mortes. Mais depuis que celles-ci ont disparu de la scène politique, l'attitude progressiste n'a plus raison d'être. L'idéologie du progrès n'est plus qu'une machine qui tourne à vide. Pire, quand elle reste sur sa lancée, elle peut s'avérer suicidaire. A la suite de la parenthèse progressiste, doit s'ouvrir une ère de «maintien», de conservation. Le Jungkonservativismus ne cherche donc pas à perpétuer des formes politiques dépassées. Quant aux formes sociales et politiques actuelles, pense Jung, elles ne sont plus des formes au sens propre du mot, mais des résidus évidés, balottés dans le chaos de l'histoire. Jung définit ensuite son conservatisme comme «évolutionnaire»: il vise le dépassement d'un monde vermoulu, l'inversion radicale et positive de ses fausses valeurs. Ce travail d'inversion/restauration est, aux yeux de Jung, proprement révolutionnaire.
La période qui suit la Grande Guerre est caractérisée par la crise épocale des valeurs individualistes et bourgeoises en pleine décadence. Pour les relayer, le Jungkonservativismus jungien propose un recours à Dilthey et à Bergson, à Spengler, Tönnies, Roberto Michels, Vilfredo Pareto et Nicolas Berdiaev. La crise s'explique, en langage spenglérien, par le passage au stade de «civilisation» qui est le couronnement de l'esprit libéral. Les liens sociaux sont détruits et les peuples tombent sous la coupe d'une démocratie inorganique, gérée par les «hommes de moindre valeur». Tel est le diagnostic. Pour sortir de cette impasse, il faut restaurer les vertus religieuses. Abandonnant ses positions initiales, lesquelles reposaient sur une philosophie des valeurs tirée du néo-kantisme, Jung veut désormais ancrer son «axiome de l'immuabilité de la pulsion métaphysique» dans un discours théologisé. Deux philosophes de la religion contribuent à le faire passer du néo-kantisme au néo-théologisme: Nicolas Berdiaev et Leopold Ziegler (qui deviendra son ami personnel). Jung embraye sur l'idée de Berdiaev qui évoque le fin imminente de l'époque moderne qui a vu le triomphe de l'irreligion. Pour Jung comme pour Berdiaev ou Ziegler, l'époque qui succèdera au libéralisme moderne sera un «nouveau Moyen Age» pétri de religion, réchristianisé. Eliminant les catastrophes de l'individualisme, ce nouveau «Moyen Age» restaure une holicité (Ganzheit), un universalisme dans le sens où l'entendait Othmar Spann, un «organicisme» historique et non biologique. Cette dernière position distingue Jung des nationalistes de toutes catégories. En effet, il rejette le concept de «nation» comme «occidental», c'est-à-dire «français» et révolutionnaire, libéral et atomiste. Dans ce concept de «nation», domine le rationalisme raisonneur de l'idéologie des Lumières. Les «nations», dans ce sens, sont les peuples malades ou morts. Les peuples qui n'ont pas subi l'emprise de l'idéologie nationale, qui est d'essence révolutionnaire et est donc perverse, sont vivants, conservent au fond d'eux-mêmes des énergies intactes et demeurent les «porteurs de l'histoire». Jung relativise ainsi au maximum la valeur attribuée à l'Etat national, fermé sur lui-même. Les concepts-clé sont pour lui ceux de peuple (Volk) et de Reich. Cette dernière instance, supra-nationale et incarnation politique du divin sur la Terre, est une idée d'ordre fédérative, tout à fait adaptée à l'espace centre-européen. De là, elle devra être étendue à l'ensemble du continent européen, de façon à instaurer un europäischer Staatenbund (une fédération des Etats européens). Sur le plan spirituel, l'idée de Reich est le seul barrage possible contre le processus de morcellement rationaliste et nationaliste. Les Etats-Nations reposent sur un fait figé rendu immuable par coercition, tandis que le Reich est un mouvement perpétuel dynamique qui travaille sans interruption les matières «peuples». Pour Jung, né protestant mais devenu catholique de fait, l'idée nationale est une tradition protestante en Allemagne, tandis que l'idée dynamique de Reich est une idée catholique. Sur le plan intérieur, ce Reich fédératif est organisé corporativement. A la place du Parlement et du suffrage universel, Jung suggère l'introduction d'une représentation populaire corporative et d'un droit de vote échelonné et différencié. L'organisation intérieure de son Reich idéal, Jung la calque sur les idées du sociologue et philosophe autrichien Othmar Spann. C'est le talon d'Achille de son idéologie: cette organisation corporative ne peut s'appliquer dans un Etat moderne et industriel. Son appel à l'ascèse et au sacrifice ne pouvait nullement mobiliser les Allemands de son époque, durement frappés par l'inflation, la crise de 29, la famine du blocus et les dettes de Versailles.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: Die geistige Krise des jungen Deutschland, 1926 (discours, 20 p.); Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung, 1927 (XIV + 341 pages); Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich, 1929 (2ième éd.), 1930 (3ième éd.) (692 pages); Föderalismus aus Weltanschauung, 1931; Sinndeutung der deutschen Revolution, 1933; une copie du mémoire rédigé par E.J. Jung à l'adresse de Papen en avril 1934 se trouve à l'Institut für Zeitgeschichte de Munich, archives photocopiées 98, 2375/59 et chez Edmund Forschbach, ami et biographe d'E.J. Jung (cf. infra); d'après Karlheinz Weißmann (cf. infra), Jung serait l'auteur de la plupart des textes contenus dans le recueil de discours de Franz von Papen intitulé Apell an das deutsche Gewissen. Reden zur nationalen Revolution. Schriften an die Nation, Bd. 32/33, Oldenburg i.O., 1933.
- Principaux articles de philosophie politique: 1) Dans la revue Deutsche Rundschau: «Reichsreform» (nov. 1928); «Der Volksrechtsgedanke und die Rechtsvorstellungen von Versailles» (oct. 1929); «Volkserhaltung» (mars 1930); «Aufstand der Rechten» (1931, pp.81-88); «Neubelebung von Weimar?» (juin 1932); «Revolutionäre Staatsführung» (oct. 1932); «Deutsche Unzulänglichkeit» (nov. 1932); «Verlustbilanz der Rechten» (1/1933); «Die christiliche Revolution» (sept. 1933, pp. 142-147); «Einsatz der Nation» (1933, pp. 155-160); 2) Dans les Schweizer Monatshefte: 1930/31: Heft 1, p. 37, Heft 7, p. 321; 1932/33: Heft 5/6, p. 275; 3) Dans la Rheinisch- Westfälische Zeitung, où Jung utilisait le pseudonyme de Tyll, voir les dates suivantes: 1/1/1930; 5/3/1930; 5/4/1930; 24/4/1930; 2/5/1930; 31/5/1930; 12/10/1930; 8/11/1930; 30/12/1930; 28/1/1931; 7/2/1931; 4/3/1931; 1/4/1931; 10/4/1931; 1/8/1931; été 1931; 15/3/1932; 4) Dans les Münchner Neueste Nachrichten, voir les dates suivantes: 20/3/1925; 28/1/1930; 23/11/1930; 3/1/1931; 25/7/1931; 4/7/1931; 5) Dans les Süddeutsche Monatshefte: «Die Tragik der Kriegsgeneration», mai 1930, pp. 511-534; 6) Dans Die Laterne: «Was ist liberal?», Folge 6, 6/5/1931.
- Participation à des ouvrages collectifs: «Deutschland und die konservative Revolution», in E.J. Jung, Deutsche über Deutschland. Die Stimme des unbekannten Politikers, Munich, 1932, pp. 369-383; on signale également une contribution d'E.J. Jung («Die deutsche Staatskrise als Ausdruck der abandländischen Kulturkrise») dans Karl Haushofer et Kurt Trampler (éd.), Deutschlands Weg an der Zeitenwende, Munich, 1931; le livre signé par Leopold Ziegler, Fünfundzwanzig Sätze vom Deutschen Staat (Berlin, 1931) serait en fait dû à la plume de Jung.
- Sur Edgar Julius Jung: Leopold Ziegler, Edgar Julius Jung. Denkmal und Vermächtnis, Salzbourg, 1955; «Edgar Jung und der Widerstand» in Civis 59, Bonn, Nov. 1959; Friedrich Grass, «Edgar Julius Jung (1894-1934)», in Kurt Baumann (éd.), Pfälzer Lebensbilder, Bd. 1, Spire, 1964; Karl Martin Grass, Edgar Julius Jung, Papenkreis und Röhmkrise 1933-1934, dissertation phil., Heidelberg, 1966; Bernhard Jenschke, Zur Kritik der konservativ-revolutionäre Ideologie in der Weimarer Republik. Weltanschauung und Politik bei Edgar Julius Jung, Munich, 1971 (avec une bibliographie reprenant 79 articles importants d'E.J. Jung); Karl-Martin Grass, «Edgar J. Jung», in Neue Deutsche Biographie, 10. Bd., Berlin, 1974; Joachim Kaiser, Konservative Opposition gegen Hitler 1933/34. Edgar Julius Jung und Ewald von Kleist-Schmenzin, Texte non publié d'un séminaire de l'Université d'Aix-la-Chapelle, 1984; Edmund Forschbach, Edgar J. Jung, ein konservativer Revolutionär 30. Juni 1934, Pfullingen, 1984; Gilbert Merlio, «Edgar Julius Jung ou l'illusion de la "Révolution Conservatrice"», in Revue d'Allemagne, tome XVI, n°3, 1984; Karlheinz Weißmann, «Edgar J. Jung» in Criticón, 104, 1987, pp. 245-249; Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, 3ième éd., Darmstadt, 1989.
- Pour comprendre le contexte historique: Klemens von Klemperer, Konservative Bewegungen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Munich/Vienne, 1957; Erasmus Jonas, Die Volkskonservativen 1928-1933, Düsseldorf, 1965; Theodor Eschenburg, «Hindenburg, Brüning, Groener, Schleicher», in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 9. Jg. 1961, 1; Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, Munich 1962; Franz von Papen, Vom Scheitern einer Demokratie 1930-1933, Mayence, 1968; Klaus Breuning, Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur, Munich, 1969; Volker Mauersberger, Rudolf Pechel und die «Deutsche Rundschau» 1919-1933. Eine Studie zur konservativ-revolutionären Publizistik in der Weimarer Republik, Brème, 1971; Jean-Pierre Faye, Langages totalitaires, Paris, 1972; Martin Greiffenhagen, Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland, Munich, 1977.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, philosophie, théorie politique, années 20, années 30, allemagne, sciences politiques, politologie, weimar, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 janvier 2010
Grezngänger Ernst Niekisch
 Grenzgänger Ernst Niekisch
Grenzgänger Ernst Niekisch
Ex: http://rittermabuse.wordpress.com/
In der DDR bekleidete Ernst Niekisch zahlreiche Funktionen; dennoch entzog die deutsche Teilung ihm den Boden: »Zuletzt erkannte ich, dass man in Deutschland nur noch die Wahl habe, Amerikaner oder Russe zu sein. Wer mit Entschiedenheit eine eigene deutsche Position bewahren will, verfällt über kurz oder lang hoffnungsloser Vereinsamung.« In einem unveröffentlichten Manuskript schlug er tatsächlich kurz vor seinem Tod vor, die DDR, das »Bollwerk gegen den Westen«, in »Preußen« umzubenennen.
Als Grenzgänger zwischen links und rechts blieb Niekisch auch nach seinem Tod wirkungsmächtig. Bei vielen Versuchen, die Linke mit der Nation zu versöhnen, stand er Pate. Der Historiker Sebastian Haffner forderte noch im November 1989 angesichts der sich abzeichnenden Wiedervereinigung, Niekisch wieder auf die Tagesordnung zu setzen: »So unwahrscheinlich es klingen mag: Der wahre Theoretiker der Weltrevolution, die heute im Gange ist, ist nicht Marx und nicht einmal Lenin. Es ist Niekisch.«
00:16 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, années 20, années 30, nationalisme révolutionnaire, nationalisme, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 janvier 2010
Spuren
 Spuren
Spuren
Das Wesen dieses Glaubens ist vielleicht am besten getroffen, wenn man darum besorgt ist, das Heil seiner Seele nicht zu verscherzen, damit die Selbstachtung zu verlieren und mit der eigenen Würde auch das Gewissen zu ertöten.
Josef Strzygowski, Geistige Umkehr. Indogermanische Gegenwartsstreifzüge eines Kunstforschers, Heidelberg 1938, S. 81.
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, indo-européens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 janvier 2010
Armin Mohler et la révolution conservatrice
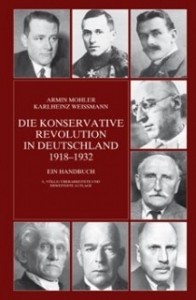 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Armin Mohler et la «Révolution Conservatrice»
(2ième partie)
par Luc PAUWELS
Dans notre numéro 59/60 de novembre-décembre 1989, Robert Steuckers avait analysé la première partie de l'introduction théorique d'Armin Mohler. Au même moment, Luc Pauwels, directeur de la revue Teksten, Kommentaren en Studies (in nr. 55, 2de trimester 1989), se penchait sur le même maître-ouvrage de Mohler et mettait l'accent sur la seconde partie théorique, notamment sur la classification des différentes écoles de ce mouvement aux strates multiples. Nous ne reproduisons pas ci-dessous l'entrée en matière de Pauwels, car ce serait répéter en d'autres mots les propos de Steuckers. En revanche, le reste de sa démonstration constitue presque une sorte de suite logique à l'analyse parue dans notre n°59/60.
Débuts et contenu
Les premiers balbutiements de la Révolution Conservatrice, écrit Mohler, ont lieu lors de la Révolution française: «Toute révolution suscite en même temps qu'elle la contre-révolution qui tente de l'annihiler. Avec la Révolution française, advient victorieusement le monde qui, pour la Révolution Conservatrice représente l'adversaire par excellence. Définissons provisoirement ce monde comme celui qui refuse de mettre l'immuable de la nature humaine au centre de tout et croit que l'essence de l'homme peut être changée. La Révolution française annonce ainsi la possibilité d'un progrès graduel et estime que toutes les choses, relations et événements sont explicables rationnellement; de ce fait, elle essaie d'isoler chaque chose de son contexte et de la comprendre ainsi pour soi».
Mohler nous rappelle ensuite un malentendu tenace, que l'on rencontre très souvent lorsque l'on évoque la Révolution Conservatrice. Un malentendu qui, outre la confusion avec le fascisme et le national-socialisme, lui a infligé beaucoup de tort: c'est l'idée erronée qui veut que tout ce qui est (ou a été) fait et dit contre la Révolution française, son idéologie et ses conséquences, relève de la Révolution Conservatrice.
La Révolution de 1789 a dû faire face, à ses débuts, à deux types d'ennemis qui ne sont en aucune manière des précurseurs de la Révolution Conservatrice. D'abord, il y avait ses adversaires intérieurs, qui estimaient que les résultats de la Révolution française et/ou de son idéologie égalitaire étaient insuffisants. Cette opposition interne a commencé avec Gracchus Babeuf (1760-1797), adepte d'«Egalité parfaite» (la majuscule est de lui), qui voulait supprimer toutes les formes de propriété privée et espérait atteindre l'«Egalité des jouissances». Sa tentative de coup d'Etat, appelée la «Conjuration des Egaux», fut tué dans l'œuf et l'aventure se termina en parfaite égalité le 27 mai 1797... sous le couperet de la guillotine.
Toutes les tendances qui puisent leur inspiration dans l'égalitarisme de Babeuf et qui, sur base de ces idées, critiquent la Révolution française, n'ont rien à voir, bien entendu, avec la Révolution Conservatrice (RC). Elles appartiennent, pour être plus précis, aux traditions du marxisme et de l'anarchisme de gauche.
Ensuite, la Révolution française, dès ses débuts, a eu affaire à des groupes qui la combattaient pour maintenir ou récupérer leurs positions sociales (matérielles ou non), que les Jacobins menaçaient de leur ôter ou avaient détruites. Les adeptes de la RC ont toujours eu le souci de faire la différence entre leur propre attitude et cette position; ils ont qualifié l'action qui en découlait, écrit Mohler, de «restauratrice», de «réactionnaire», d'«altkonservativ» («vieille-conservatrice»), etc. Mais, au cours du XIXième siècle, les tenants de la RC (qui ne porte pas encore son nom, ndt) et les «Altkonservativen» font face à un ennemi commun, ce qui les force trop souvent à forger des alliances tactiques avec les réactionnaires, à se retrouver dans le même camp politique. Ainsi, la différence essentielle qui sépare les uns des autres devient moins perceptible pour les observateurs extérieurs. Dans les rangs mêmes de la RC, on s'aperçoit des ambiguïtés et le discours s'anémie. Pour les RC de pure eau, ces alliances et ces ambiguïtés auront trop souvent des conséquences fatales. Mohler nous l'explique: «Car, à la RC, n'appartiennent —comme le couplage paradoxal des deux mots l'indique— que ceux qui s'attaquent aux fondements du siècle du progrès sans simplement vouloir une restauration de l'Ancien Régime».
Sous sa forme pure, la RC est toujours restée au stade de la formulation théorique. Rauschning, lui aussi, décrit ce caractère composite dans son ouvrage intitulé précisément Die Konservative Revolution: «Le mouvement opposé, qui se dresse contre le développement des idées révolutionnaires, a amorcé sa croissance au départ de stades initiaux embrouillés et semi-conscients, pour atteindre ce que nous nommons, avec Hugo von Hoffmannstahl, la RC. Elle représente le renversement complet de la tendance politique actuelle. Mais ce contre-mouvement n'a pas encore trouvé d'incarnation pure, adaptée à lui-même. Il participe aux tentatives d'instaurer des modèles d'ordre totalitaire et césariste ou à des essais plattement réactionnaires. C'est pour toutes ces raisons, précisément, qu'il reste confus et brouillon...».
Sur base de cette constatation, Mohler observe que toute description cohérente du processus de maturation de la RC se mue automatiquement en une véritable histoire des idées. Si on cherche à la décrire comme une partie intégrante de la réalité politique, elle déchoit en un événement subalterne ou marginal. De ce fait, il ne faut pas donner des limites trop exiguës à la RC: elle déborde en effet sur d'autres mouvements, d'autres courants de pensée. Et vu le flou de ces limites, flou dû à la très grande hétérogénéité des choses que la RC embrasse, des choses qui font irruption dans son champs, Mohler est obligé de tracer une démarcation arbitraire afin de bien circonscrire son sujet. Il s'explique: «Au sens large, le terme "Révolution Conservatrice" englobe un ensemble de transformations s'appuyant sur un fondement commun, des transformations qui se sont accomplies ou qui s'annoncent, et qui concerne tous les domaines de l'existence, la théologie comme par exemple les sciences naturelles, la musique comme l'urbanisme, les relations interfamiliales comme les soins du coprs ou la façon de construire une machine. Dans notre étude, nous nous bornerons à donner une définition exclusivement politique au terme; notre étude se limitant à l'histoire des idées, nous désignons par "Révolution Conservatrice" une certaine pensée politique».
Les pères fondateurs, les précurseurs et les parrains
Une pensée politique, une Weltanschauung, implique qu'il y ait des penseurs. Mohler les appelle les Leitfiguren, les figures de proue, que nous nommerions par commodité les «précurseurs». Mohler souligne, dans la seconde partie de son ouvrage, inédite dans les premières éditions, que l'intérêt pour les précurseurs s'est considérablement amplifié. Les figures qui ont donné à la RC sa plus haute intensité spirituelle et psychique, ses penseurs les plus convaincants et aussi ses incarnations humaines les plus irritantes ont désormais trouvé leurs biographes et leurs analystes».
Si l'on parle de «père fondateur», il faut évidemment citer Friedrich Nietzsche (1844-1900), reconnu par les amis et les ennemis comme l'initiateur véritable du phénomène intellectuel et spirituel de la RC. A côté de lui, le penseur français, moins universellement connu, Georges Sorel (1847-1922)... Nous reviendrons tout à l'heure sur ces deux personnages centraux.
Au second rang, une génération plus tard, nous trouvons le «trio» (ainsi que le nomme Mohler): Carl Schmitt (1888-1985), Ernst Jünger (°1895) et Martin Heidegger (1889-1976). Mohler cite ensuite toute une série de penseurs dont l'influence sur la RC est sans doute moins directe mais non moins intense. Les parrains non-allemands sont essentiellement des sociologues et des historiens du début de notre siècle qui, très tôt, avaient annoncé le crise du libéralisme bourgeois: les Italiens Vilfredo Pareto (1848-1923) et Gaëtano Mosca (1858-1941), l'Allemand Robert(o) Michels (1876-1936), installé en Italie, l'Américain d'origine norvégienne Thorstein Veblen (1857-1929). L'Espagne nous a donné Miguel de Unamuno (1864-1936) puis, une génération plus tard, José Ortega y Gasset (1883-1956). La France, elle, a donné le jour à Maurice Barrès (1862-1923).
Quelques-uns de ces penseurs revêtent une double signification pour notre propos: ils sont à la fois «parrains» de la RC en Allemagne et partie intégrante dans les initiatives conservatrices-révolutionnaires qui ont animé la scène politico-idéologiques dans nos propres provinces.
Parmi les «parrains» allemands de la RC, Mohler compte le compositeur Richard Wagner (1813-1883), les poètes Gerhart Hauptmann (1862-1946) et Stefan George (1868-1933), le psychologue Ludwig Klages (1872-1956) et, bien sûr, Thomas Mann (1875-1955), Gottfried Benn (1896-1956) et Freidrich-Georg Jünger (1898-1977), le frère d'Ernst.
D'autres parrains allemands sont à peine connus dans nos provinces; Mohler les cite: les poètes Konrad Weiss (1880-1940) et Alfred Schuler (1865-1923), les écrivains Rudolf Borchardt (1877-1945) et Léopold Ziegler (1881-1958), un ami d'Edgar J. Jung, connu surtout pour son livre Volk, Staat und Persönlichkeit («Peuple, Etat et personnalité»; 1917). Enfin, il y a Max Weber (1864-1920), le plus grand sociologue que l'Allemagne ait connu, célèbre dans le monde entier mais pas assez pratiqué dans nos cercles non-conformistes.
La RC dans
d'autres pays
Pour Mohler, la RC est «un phénomène politique qui embrasse toute l'Europe et qui n'est pas encore arrivé au bout de sa course». Dans la préface à la première édition de son ouvrage, nous lisons que la RC est «ce mouvement de rénovation intellectuelle qui tente de remettre de l'ordre dans le champs de ruines laissé par le XIXième siècle et cherche à créer un nouvel ordre de la vie. Mais si nous ne sélectionnons que la période qui va de 1918 à 1932, nous pouvons quand même affirmer que la RC commence déjà au temps de Goethe et qu'elle s'est déployée sans interruption depuis lors et qu'elle poursuit sa trajectoire aujourd'hui sur des voies très diverses. Et si nous ne présentons ici que la partie allemande du phénomène, nous n'oublions pas que la RC a touché la plupart des autres pays européens, voire certains pays extra-européens».
Mohler réfute la thèse qui prétend que la RC est un phénomène exclusivement allemand. Il suffit de nommer quelques auteurs pour ruiner cet opinion, explique Mohler. Quelques exemples: en Russie, Dostoievski (1821-1881), le grand écrivain, chaleureux nationaliste et populiste russe; les frères Konstantin (1917-1860) et Ivan S. Axakov (1823-1886). En France, Georges Sorel (1847-1922), le social-révolutionnaire le plus original qui soit, et Maurice Barrès (1862-1923). Ensuite, le philosophe, homme politique et écrivain espagnol Miguel de Unamuno (1864-1936), l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto (1848-1923), célèbre pour sa théorie sur l'émergence et la dissolution des élites. En Angleterre, citons David Herbert Lawrence (1885-1930) et Thomas Edward Lawrence (1888-1935), qui fut non seulement le mystérieux «Lawrence d'Arabie» mais aussi l'auteur des Seven Pillars of Wisdom, de The Mint, etc.
Cette liste pourrait être complétée ad infinitum. Bornons-nous à nommer encore T.S. Eliot et le grand Chesterton pour la Grande-Bretagne et Jabotinski pour la diaspora juive. Tous ces noms ne sont choisis qu'au hasard, dit Mohler, parmi d'autres possibles.
Dans les Bas Pays de l'actuel Bénélux, on observe un contre-mouvement contre les effets de la Révolution française dès le début du XIXième siècle. En Hollande, les conservateurs protestants se donnèrent le nom d'«antirévolutionnaires», ce qui est très significatif. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) et Abraham Kuyper (1837-1920) donnèrent au mouvement antirévolutionnaire et au parti du même nom (ARP, depuis 1879) une idéologie corporatiste et organique de facture nettement populiste-conservatrice (volkskonservatief). Conrad Busken Huet (1826-1886), prédicateur, journaliste et romancier, infléchit son mouvement, Nationale Vertoogen, contre le libéralisme, héritier de la Révolution française. Son ami Evert-Jan Potgieter (1808-1875) qui, en tant qu'auteur et co-auteur de De Gids, avait beaucoup de lecteurs, évolua, lui aussi, dans sa critique de la société, vers des positions conservatrices-révolutionnaires; il décrivait ses idées comme participant d'un «radicalisme conservateur» (konservatief radikalisme).
Après la première guerre mondiale, aux Pays-Bas, les idéaux conservateurs-révolutionnaires avaient bel et bien pignon sur rue et se distinguaient nettement du conservatisme confessionnel. Ainsi, le Dr. Emile Verviers, qui enseignait l'économie politique à l'Université de Leiden, adressa une lettre ouverte à la Reine, contenant un programme assez rudimentaire d'inspiration conservatrice-révolutionnaire. Sur base de ce programme rudimentaire, une revue vit le jour, Opbouwende Staatkunde (Politologie en marche). Le philosophe et professeur Gerard Bolland (1854-1922) prononça le 28 septembre 1921 un discours inaugural à l'Université de Leiden, tiré de son ouvrage De Tekenen des Tijds (Les signes du temps), qui lança véritablement le mouvement conservateur-révolutionnaire aux Pays-Bas et en Flandre.
Dans les lettres néerlandaises, dans la vie intellectuelle des années 20 et 30, les tonalités et influences conservatrices-révolutionnaires étaient partout présentes: citons d'abord la figure très contestée d'Erich Wichman sans oublier Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Menno ter Braak, Hendrik Marsman et bien d'autres. En Flandre, la tendance conservatrice-révolutionnaire ne se distingue pas facilement du Mouvement Flamand, du nationalisme flamand et du courant Grand-Néerlandais: la composante national(ist)e de la RC domine et refoule facilement les autres. Hugo Verriest et Cyriel Verschaeve, deux prêtres, doivent être mentionnés ici (1), de même qu'Odiel Spruytte (1891-1940), un autre prêtre peu connu mais qui fut très influent, surtout parce qu'il était un brillant connaisseur de l'œuvre de Nietzsche (2). En dehors du mouvement flamand, il convient de mentionner le leader socialiste Henri De Man (3), le Professeur Léon van der Essen (4) et Robert Poulet, récemment décédé et auteur, entre autres, de La Révolution est à droite (5). Sans oublier le Baron Pierre Nothomb (6), chef des Jeunesses Nationales et Charles Anciaux de l'Institut de l'Ordre Corporatif (7).
Les noms de Lothrop Stoddard et de Madison Grant, défenseurs soucieux de l'identité de la race blanche, de James Burnham, théoricien de The Managerial Revolution, mais aussi auteur du The Suicide of the West et de The War we are in, montrent que les Etats-Unis aussi ont contribué à la RC. Dans les grands bouleversements qui affectent depuis quelques dizaines d'années l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine, on peut, explique Mohler, trouver des phénomènes apparentés: «Notamment le mélange, caractéristique de la RC, de lutte pour la libération nationale, de révolution sociale et de rédécouverte de sa propre identité».
Le mouvement ouvrier péroniste en Argentine, avec Juan et Evita Perón, constitue, sur ce chapitre, un exemple d'école. Plus nettement marquée encore est l'œuvre du révolutionnaire chinois, le Dr. Sun Ya-Tsen (1866-1925), fondateur du Kuo-Min-Tang, qui, dans son livre Les trois principes du peuple (8), prêche explicitement pour le nationalisme, la révolution sociale et la voie chinoise vers la démocratie.
Mohler pose un constat: le fait que la Révolution française a mis en branle un contre-mouvement conservateur dont le point focal a été l'Allemagne, indique clairement que nous avons affaire à un phénomène de dimensions au moins européennes; «L'accent mis sur l'élément allemand dans la RC mondiale se justifie sur certains plans. Mêmes les expressions non allemandes de cette révolution intellectuelle contre les idées de 1789 s'enracinent dans ce chapitre de l'histoire des idées en Allemagne, qui s'étend de Herder au Romantisme. En Allemagne même, cette révolte a connu sa plus forte intensité».
L'un des facteurs qui a le plus contribué à l'européanisation générale de la RC est sans conteste la large diffusion des œuvres et des idées de Nietzsche. Armin Mohler tente de ne pas englober Nietzsche dans la RC, mais démontre de façon convaincante que sans Nietzsche, le mouvement n'aurait pas acquis ses Leitbilder («images directrices») typiques et communes. Son influence s'est faite sentir dans les Bas Pays, notamment chez le jeune August Vermeylen (9) et, d'après H.J. Elias (10), sur toute une génération d'étudiants de l'Athenée d'Anvers, parmi lesquels nous découvrons Herman van den Reeck, Max Rooses, Lode Claes et d'autres figures célèbres. La philosophie de Nietzsche a permis qu'éclosent dans toute l'Europe des courants d'inspiration conservatrice-révolutionnaire.
Le Normand Georges Sorel, le second «père fondateur» de la RC selon Mohler (11), est toutefois resté inconnu dans nos régions. Cet ingénieur et philosophe n'a pratiquement jamais été évoqué dans notre entre-deux-guerres (12). A notre connaissance, la seule publication néerlandaise qui parle de lui est l'étude de J. de Kadt sur le fascisme italien; elle date de 1937 (13). On dit qu'il aurait exercé une influence discrète sur Joris van Severen (14) mais son meilleur biographe, Arthur de Bruyne (15), dont le travail est pourtant très fouillé, ne mentionne rien.
Les groupes «völkisch»
Nous ne devons pas concevoir la RC comme un ensemble monolithique. Elle a toujours été plurielle, contradictoire, partagée en de nombreuses tendances, mouvements et mentalités souvent antagonistes. Mohler distingue cinq groupes au sein de la RC; leurs noms allemands sont: les Völkischen, les Jungkonservativen et les Nationalrevolutionäre, dont les tendances idéologiques sont précises et distinctes. Ensuite, il y a les Bündischen et la Landvolkbewegung, que Mohler décrit comme des dissidences historiques concrètes qui n'ont produit des idéologies spécifiques que par la suite. Cette classification en cinq groupes de la RC allemande n'est pas aisément transposable dans les autres pays. Partout, on trouve certes les mêmes ingrédients mais en doses et mixages chaque fois différents. Cette prolixité rend évidemment l'étude de la RC très passionnante.
Le premier groupe, celui des Völkischen, met l'idée de l'«origine» au centre de ses préoccupations. Les mots-clefs sont alors, très souvent, le peuple (Volk), la race, la souche (Stamm) ou la communauté linguistique. Et chacun de ces mots-clefs conduit à l'éclosion de tendances völkische très différentes les unes des autres. Dans la foule des auteurs allemands de tendance völkische, signalons-en quelques-uns qui ont été lus et appréciés à titres divers chez nous, de manière à ce que le lecteur puisse discerner plus aisément la nature du groupe que par l'intermédiaire d'une longue démonstration théorique: Houston Stewart Chamberlain, Adolf Bartels, Hans F.K. Günther, Ernst Bergmann, Erich et Mathilde Ludendorff, Herman Wirth et Erwin Guido Kolbenheyer.
Chez nous, quand la tendance völkische est évoquée, l'on songe tout de suite à Cyriel Verschaeve qui y a indubitablement sa place. Les mots-clefs volk (peuple) et taal (langue) peuvent toutefois nous induire en erreur car l'ensemble du mouvement flamand a pris pour axes ces deux vocables. Une fraction seulement de ce mouvement peut être considérée comme appartenant à la tendance völkische, notamment une partie de l'orientation grande-néerlandaise qui, explicitement, plaçait le «principe organique de peuple» (organische volksbeginsel), théorisé par Wies Moens (16), ou le «principe national-populaire», au-dessus de toutes autres considérations politiques et/ou philosophiques. Nous songeons à Wies Moens lui-même et à la revue Dietbrand, à Ferdinand Vercnocke, à Robrecht de Smet et sa Jong-Nederlandse Gemeenschap (Communauté Jeune-Néerlandaise), à l'aile dite Jong-Vlaanderen (Jeune-Flandre) de l'activisme (17), à l'anthropologue Dr. Gustaaf Schamelhout (18), etc.
Au sein de la tendance völkische a toujours coexisté, chez nous, une tradition basse-allemande (nederduits), à laquelle appartenaient Victor Delecourt et Lodewijk Vlesschouwer (qui participait, e.a., à la revue De Broederhand), le Aldietscher (Pan-Thiois) Constant Jacob Hansen (1833-1910) (19) et le germanisant plus radical encore Pol de Mont (1857-1931), qui déjà avant la première guerre mondiale avait développé son propre corpus völkisch.
Le groupe des Jungkonservativen
A rebours de volks (völkisch), le terme de jungkonservativ (jongkonservatief) n'a jamais, à ma connaissance, été utilisé dans nos provinces. En Allemagne, démontre Mohler, le terme jungkonservativ est le vocable classique qu'ont utilisé les fractions du mouvement conservateur qui, par l'adjonction de l'adjectif «jeune» (jung), voulaient se démarquer du conservatisme antérieur, purement «conservant» et réactionnaire, l'Altkonservativismus. Les Jungkonservativen s'opposent, en esprit et sur la scène politique, au monde légué par 1789 et tirent de cette opposition des conséquences résolument révolutionnaires. Les grandes figures du Jungkonservativismus, également connue hors d'Allemagne, sont notamment Oswald Spengler (20), Arthur Moeller van den Bruck (21), Othmar Spann, Hans Grimm et Edgar J. Jung.
Le peuple et la langue, concepts-clefs des Völkischen, ne sont certes pas niés par les Jungkonservativen, encore moins méprisés. Mais pour eux, ces concepts ne sont pas pertinents si l'on veut construire un ordre: ils conduisent à la constitution d'Etats nationaux fermés, monotone, comparables aux Etats d'inspiration jacobine. De plus, ces Etats précipitent l'Europe, continent qui n'a que peu de frontières linguistiques et ethniques précises, dans des conflits frontaliers incessants, dans des querelles d'irrédentisme, des guerres balkaniques. En pervertissant le principe völkisch, ils provoquent une extrême intolérance à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques à l'intérieur de leurs propres frontières. De tels débordements, l'histoire en a déjà assez connus.
Le mot-clef pour les Jungkonservativen est dès lors le Reich. L'idée de Reich, prisée également dans les Bas Pays, n'implique pas un Etat fermé à peuple unique ni un Etat créé par un peuple conquérant sachant manier l'épée. Le Reich est une forme de vivre-en-commun propre à l'Europe, né de son histoire, qui laisse aux souches ethniques et aux peuples, aux langues et aux régions, leurs propres identités et leurs propres rythmes de développement, mais les rassemble dans une structure hiérarchiquement supérieure. Dans ce sens, explique Mohler, l'Etat de Bismarck et celui de Hitler ne peuvent être considérés comme des avatars de l'idée de Reich. Ce sont des formes étatiques qui oscillent entre l'Etat-Nation de type jacobin et l'Etat-conquérant impérialiste à la Gengis Khan.
En langue néerlandaise, Reich peut parfaitement se traduire par rijk. Dans d'autres langues, le mot allemand est souvent traduit à la hâte par des mots qui n'ont pas le même sens: «Empire» suggère trop la présence d'un empereur; «Imperium» fait trop «impérialiste»; «Commonwealth» suggère une association de peuples beaucoup plus lâche.
Mentionnons encore trois particularités qui nous donnerons une image plus complète du groupe jungkonservativ. D'abord, l'influence chrétienne est la plus prononcée dans ce groupe. L'idée médiévale de Reich est perçue par quelques-uns de ces penseurs jungkonservativ comme essentiellement chrétienne, qualité qui demeurera telle, affirment-ils, même si l'idée doit connaître encore des avatars historiques. Les Jungkonservativen chrétiens perçoivent la catholitas comme une force fédératrice des peuples, comme une sorte de ciment historique. Pour eux, cette catholitas ne semble donc pas un but en soi mais un instrument au service de l'idée de Reich.
Ensuite, ces Jungkonservativen cutlivent une nette tendance à peaufiner leur pensée juridique, à ébaucher des structures et des ordres juridiques idéaux. C'est en tenant compte de cet arrière-plan que le deuxième concept-clef de la sphère jungkonservative, en l'occurrence l'idée d'ordre, prend tout son sens. En dehors de l'Allemagne, c'est incontestablement ce concept-là qui a été le plus typique. Mohler écrit, à ce propos: «L'unité, à laquelle songent les Jungkonservativen (...) englobe une telle prolixité d'éléments, qu'elle exige une mise en ordre juridique».
 Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Dans les Bas Pays, plusieurs figures de la vie intellectuelle étaient apparentées au courant jungkonservativ. Songeons à Odiel Spruytte qui, malgré son ancrage profond dans le Mouvement Flamand, restait un défenseur typique de l'«universalisme» d'Othmar Spann (22). Aux Pays-Bas, citons Frederik Carel Gerretsen, historien, poète (sous le pseudonyme de Geerten Gossaert) et homme politique (actif, entre autres, dans la Nationale Unie).
Lorque l'on recherche les traces de l'idéologie jungkonservative dans nos pays, il faut analyser et étudier les concepts de solidarisme et de personnalisme: les tenants de cette orientation doctrinale appartenaient très souvent à la démocratie chrétienne. Les «navetteurs» qui oscillaient entre la démocratie chrétienne et la RC, version jungkonservative, étaient légion.
Le Jungkonservativ le plus typé, le seul à peu près qui ait vraiment fait école chez nous, c'est Joris van Severen. Chez lui, les concepts-clefs d'«ordre» et d'«élite» sont omniprésents; sa pensée est juridico-structurante, ce qui le distingue nettement des nationalistes flamands aux démarches protestataires et friands de manifestations populaires. Autre affinité avec les Jungkonservativen: sa tendance à chercher des interlocuteurs dans l'aile droite de l'établissement... Mais ce qui est le plus étonnant, c'est la similitude entre sa pensée de l'ordre et l'idée de Reich des Jungkonservativen de l'ère weimarienne: Joris van Severen refuse la thèse «une langue, un peuple, un Etat» et part en quête d'un modèle historique plus qualitatif, reflet d'un ordre supérieur, mais très éloigné de l'Etat belge de type jacobin, qui, pour lui, était aussi inacceptable. Dans cette optique, ce n'est pas un hasard qu'il se soit référé aux anciens Pays-Bas, dans leur forme la plus traditionnelle, celle du «Cercle de Bourgogne» du Reich de Charles-Quint. Jacques van Artevelde (23) en avait lancé l'idée au Moyen Age et elle avait tenu jusqu'en 1795. L'argumentation qu'a développé Joris van Severen pour étayer son idéal grand-néerlandais dans le sens des Dix-Sept Provinces historiques (24), et contre toutes les tentatives de créer un Etat sur une base exclusivement linguistique, est au fond très semblable à celle qu'avait déployé Edgar J. Jung lorsqu'il polémiquait avec les Völkischen pour défendre l'idée de Reich. A la fin des années 30, van Severen parlait de plus en plus souvent du «Dietse Rijk» (de l'Etat thiois; du Regnum thiois), utilisant dans la foulée le vieux terme de Dietsland (Pays Thiois) (25) pour bien marquer la différence qui l'opposait aux «nationalistes linguistiques» (26).
Les nationaux-révolutionnaires
Le troisième groupe, celui des nationaux-révolutionnaires, est un produit typique de la «génération du front» en Allemagne. Il est plus difficile à cerner pour nous, dans les Bas Pays. De plus, la plupart des auteurs nationaux-révolutionnaires sont peu connus chez nous. Friedrich Hielscher, Karl O. Paetel, Arthur Mahraun, pour ne nommer que les plus connus d'entre eux, sont très souvent ignorés, même par les politologues les plus chevronnés. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus célèbres. Mais cette célébrité, ils l'ont acquise pendant une autre période et pour d'autres activités que leur engagement national-révolutionnaire. Ainsi, Ernst von Salomon acquit sa grande notoriété pour ses romans à succès. Otto et Gregor Strasser, à la fin de leur carrière, ont été connus du monde entier parce qu'ils ont été les compagnons de route de Hitler, avant de s'opposer violemment à lui et, pour Gregor, de devenir sa victime. Ernst Niekisch, lui, est souvent considéré à tort comme un communiste parce qu'après la guerre il a enseigné à Berlin-Est (27). Mais cette notoriété, due à des faits et gestes posés en dehors de l'engagement politique, fait que les nationaux-révolutionnaires sont en général très mal situés. On les considère comme des «nazis de gauche», ce qui est inexact dans la plupart des cas, sauf peut-être pour Gregor Strasser, assassiné sur ordre de Hitler en 1934. Ou bien on les considère comme des communistes sans carte du parti, ce qui n'est vrai que pour quelques-uns d'entre eux.
En réalité, l'attitude nationale-révolutionnaire est le fruit d'une étincelle jaillie du choc entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Les étincelles ne meurent pas si l'on parvient, grâce à elles, à allumer un foyer: ce que voulaient les nationaux-révolutionnaires. Ils considéraient plus ou moins les Völkischen comme des romantiques et des «archéologues» et les Jungkonservativen comme des individus qui voulaient construire du neuf avant que les ruines n'aient été balayées. Evacuer les ruines, mieux, contribuer énergiquement au déclin rapide du monde bourgeois, dénoncer la décadence capitaliste: voilà ce que les nationaux-révolutionnaires comprenaient comme leur tâche. Pour la mener à bien, ils présentait un curieux cocktail de passion sauvage et de froideur sans illusions, produit de leur expérience du front.
Mohler cite une phrase typique de Franz Schauwecker, figure de proue du «nationalisme soldatique»: «L'Allemand se réjouit de ses déclins parce qu'ils sont le rajeunissement». La gauche comme la droite sont dépassées pour les nationaux-révolutionnaires. Ils voulaient dépasser la gauche sur sa gauche et la droite sur sa droite. Pour eux, Staline était un conservateur et Hitler un libéral. Ce que les temps nouveaux apporteront, ils ne le savent pas trop: «mouvement», tel est le premier mot-clef. Le deuxième, c'est la «nation», celle qui est née dans les tranchées. Schauwecker décrit comment la réalité et la foi, comment l'instinct et la profondeur de la pensée, la nature et l'esprit ont fusionné. «Dans cette unité, la nation était soudainement présente». C'est cela pour eux, le nationalisme: la société allemande sans classes.
Au Pays-Bas, il y a eu une figure nationale-révolutionnaire bien typée: Erich Wichman (1890-1929), surnommé souvent avec mépris le «premier fasciste néerlandais», alors qu'il est très difficile de coller l'étiquette de fasciste (si l'on entend par fasciste, cette sorte de militaires d'opérette chaussés de belles bottes bien cirées) sur ce représentant impétueux de la bohème hollandaise, au visage déformé par un oeil de verre. Les noms des groupuscules qu'il a fondé De Rebelse Patriotten (Les Patriotes Rebelles), De Anderen (Les Autres), De Rapaljepartij (Le Parti de la Racaille) trahissent tous l'élan oppositionnel et le défi adressé à «tout ce qui est d'hier», assortis d'un résidu de foi nationale. A son ami, le Dr. Hans Bruch, il écrivit ces phrases révélatrices: «Je n'ai pas besoin de vous dire que, moi comme vous, nous souhaitons que les Pays-Bas et Orange soient au-dessus de tout! Mais... ce cri de guerre ne peut plus être un cri de guerre parce qu'il a été répété a satiété, éculé, galvaudé et usé par les nationalistes de vieille mouture; par de gros bonshommes tout gras affublés de moustaches tombantes, qui remplissent des salles de réunion pour se plaindre, se lamenter et se consumer en jérémiades parce que notre nation, hélas, n'a jamais eu assez de sentiment national. (...) Et nous, les combatifs, nous ne pouvons rien avoir en commun avec eux! Car, nous, nous ne voulons pas nous plaindre, mais agir. Mais nous ne voulons pas non plus pousser des cris de joie, car nous savons qu'en tant que peuple nous n'avons encore rien - nous avons la ferme volonté de mettre un terme définitif à notre misère!» (28).
La prose de Wichman, en violence et en radicalisme, ne cède en rien devant les phrases de Franz Schauwecker ou d'autres nationaux-révolutionnaires: «Tout, aujourd'hui, est cérébralisé et calculé. Il n'y a plus place en ce monde pour l'aventure, l'imprévu, l'élasticité, la fantaisie et la «démonie». La raison raisonnante la plus bête garde seule droit au chapitre. Dieu s'est mis à vivre peinard. Cette époque est morte, sans âme, sans foi, sans art, sans amour. (...) Ce n'est plus une époque, c'est une phase de transition mais qui peut nous dire vers où elle nous mène? Si tout devient autrement que nous le voulons — et pourquoi cela ne deviendrait-il pas autrement? On pourra une fois de plus nous appeler "les fous". Tout acte peut être folie, est en un certain sens une folie. Et celui qui craint d'être appelé un "fou", d'être un "fou", celui qui craint d'être une part vivante d'un tout vivant, celui qui ne veut pas "servir", celui qui ne veut pas être "facteur" en invoquant sa précieuse "personnalité" et ainsi faire en sorte qu'advienne un monde contraire à ses pensées, celui qui a peur d'être un «lépreux de l'esprit», qui ne veut être "particule", qui ne veut être ni une feuille dans le vent ni un animal soumis à la nécessité ni un soldat dans une tranchée ni un homme armé d'un gourdin et d'un revolver sur la Piazza del Duomo (ou sur le Dam); celui qui ne commence rien sans apercevoir déjà la fin, qui ne fait rien pour ne pas commettre de sottise: voilà le véritable âne! On ne possède rien que l'on ne puisse jeter, y compris soi-même et sa propre vie. C'est pourquoi, il serait peut-être bon de nous débarrasser maintenant de cette "République des Camarades", de cette étable de "mauvais bergers". Oui, avec violence, oui, avec des "moyens illégaux"! C'est par des phrases que le peuple a été perverti, ce n'est pas par des phrases qu'il guérira (Multatuli) (29). Donc, répétons-le: aux armes!».
Le type du national-révolutionnaire a également fait irruption sur la scène politique flamande, surtout dans les tumultueuses années 20. Notamment dans le groupe Clarté et dans sa nébuleuse, qui voulaient forger un front unitaire révolutionnaire regroupant les frontistes flamands (30), les communistes, les anarchistes et les socialistes minoritaires. On hésite toutefois à ranger des individus dans cette catégorie car l'engagement proprement national-révolutionnaire n'a quasi jamais été qu'une phase de transition: quelques flamingants radicaux ont tenté de trouver une synthèse personnelle entre, d'une part, un engagement nationaliste flamand et, d'autre part, une volonté de lutte sociale-révolutionnaire. Après une hésitation, longue ou courte selon les individualités, cette synthèse a débouché sur un national-socialisme plus proche du sens étymologique du mot que de la NSDAP, encore peu connue à l'époque. Chez d'autres, la synthèse conduisit à un engagement résolument à gauche, à un socialisme voire un communisme teinté de nationalisme flamand.
Boudewijn Maes (1873-1946) est sans doute l'une des figures les plus hautes en couleurs du microcosme «national-révolutionnaire» flamand. Ce nationaliste flamand libre-penseur (vrijzinnig) avait lutté contre les activistes pendant la première guerre mondiale parce qu'ils étaient trop bourgeois à son goût. Après 1918, il les défendit parce qu'il était animé d'un sens aigu de la justice et parce qu'il s'estimait solidaire du combat national flamand. Aussi parce qu'il voyait en eux des victimes de l'«Etat bourgeois» belge et donc des révolutionnaires potentiels. En 1919, il est élu au Parlement belge sur les listes du Frontpartij. Il y restera seulement deux ans. Dans des groupuscules toujours plus petits, notamment au sein d'un Vlaams-nationaal Volksfront, il illustra un radicalisme pur, dont il ne faut pas exagérer la portée, et par lequel il voulait dépasser les socialistes et les communistes sur leur gauche. Plus tard, il passa au socialisme et mourut communiste flamand.
A propos des deux derniers groupes de la RC allemande, nous pouvons être brefs. Les Bündischen, héritiers des célèbres Wandervögel, constituent un phénomène typique dans l'histoire du mouvement de jeunesse allemand, lequel a véritablement alimenté tous les cénacles de la RC. Notre mouvement de jeunesse flamand, depuis Rodenbach (31), en passant par l'Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) (32), jusqu'au Diets Jeugdverbond, n'est pas comparable aux Bündischen sur le plan idéologique: la majeure partie des affiliés à l'AKVS, à ses successeurs et à ses émules, est restée, des années durant, fidèle à une sorte de tradition völkische catholisante. D'autres noyauteront l'aile droite de la démocratie chrétienne flamande. Cette communauté de tradition forme aujourd'hui encore le lien entre les groupes nationalistes flamands et certains cénacles du parti catholique. C'est l'idéologie de base que partagent notamment un journal comme De Standaard et les animateurs du pélérinage annuel à la Tour de l'Yser (IJzerbedevaart).
La Landvolkbewegung fut une révolte paysanne, brève mais violente, qui secoua le Slesvig-Holstein entre 1928 et 1932. On peut tracer des parallèles entre des événements analogues qui se sont produits au Danemark et en France mais, dans nos régions, nous n'apercevons aucun phénomène de même nature. Mohler lui-même, dans son Ergänzungsband (cf. références infra) de 1989, revient sur sa classification antérieure des strates de la RC en cinq groupes: la Landvolkbewegung a été de trop courte durée, trop peu chargée d'idéologie et trop dépendante d'orateurs issus d'autres groupes de la RC (surtout des nationaux-révolutionnaires) pour constituer à égalité un cinquième groupe.
Le fascisme défini
par les Staliniens
Mohler note que la littérature secondaire concernant la RC parue depuis 1972 (année de parution de la seconde édition de son maître-ouvrage) est devenue de plus en plus abondante et imprécise. La raison de cet état de choses: la propagation de la conception stalinienne du fascisme, y compris dans les milieux universitaires. «Cette conception, qui a l'élasticité du caoutchouc, est en fait un concept de combat, contenant tout ce que le stalinisme perçoit comme ennemi de ses desseins, jusque et y compris les sociaux-démocrates. Lorsque l'on parlait jadis du national-socialisme de Hitler ou du fascisme de Mussolini, on savait de quoi il était question. Mais le «fascisme allemand» peut tout désigner: la NSDAP, les Deutsch-Nationalen, la CDU, le capitalisme, Strauß comme Helmut Schmidt - et c'est précisément cette confusion qui est le but. Et bien sûr, la RC, elle aussi, aboutit dans cette énorme marmite».
Cette confusion a débouché d'abord sur une littérature tertiaire traitant du fascisme et dépourvue de toute valeur historique, ensuite sur des petits opuscules apologétiques qui «désinforment» en toute conscience. Prenons un exemple pour montrer comment le concept illimité de fascisme, propre au vocabulaire stalinien, s'est répandu dans le langage courant au cours des années 70 et 80: l'écrivain néerlandais Wim Zaal écrit un livre qui connaitra deux éditions, avec un titre chaque fois différent pour un contenu grosso modo identique. Ce changement de titre est révélateur. En 1966, l'ouvrage est titré De Herstellers (Les Restaurateurs). Il traite de plusieurs aspects de l'idéologie conservatrice-révolutionnaire aux Pays-Bas. La définition qu'il donne de cette idéologie n'est pas tout à fait juste mais elle a le mérite de ne pas être ambiguë et parfaitement concise; nous lui reprocherions de réduire l'univers conservateur-révolutionnaire à celui des adeptes de l'«ordre naturel», ce qui n'est pas le cas car d'autres traditions intellectuelles l'ont alimenté. Ecoutons sa définition: «Ce que visait le mouvement restaurateur, c'était précisément de restaurer l'ordre naturel du vivre-en-commun et de le débarrasser des maux que lui avait infligés les forces révolutionnaires à partir de 1780. Toutes les conséquences de ces révolutions n'étaient pas perverses mais leurs principes l'étaient». La seconde édition (remaniée) du livre paraît en 1973: elle traite du même sujet mais change de titre: De Nederlandse fascisten (Les fascistes néerlandais).
De Gorbatchev au Pape Jean-Paul II, de Reagan à Khomeiny, y a-t-il une figure de proue du monde politique ou de l'innovation idéologique qui n'ait jamais été traité de «fasciste» par l'un ou l'autre de ses adversaires? Dans de telles conditions, ne doit-on pas considérer que le mot est désormais vide de toute signification, du moins pour ce qui concerne le récepteur. En revanche, dans le chef de l'émetteur, le message est très clair; celui qui traite un autre de «fasciste», veut dire: «J'entends vous discriminer sur le plan intellectuel»; en d'autres mots: «Je refuse tout dialogue».
Ni dans cet article ni dans le travail de Mohler, le fait de dénoncer cet usage élastique du terme «fascisme» ne constitue pas une tentative d'évacuer du débat les rapports historiques réels qui ont existé entre, d'une part, la RC et, d'autre part, le fascisme ou le national-socialisme. La pensée révolutionnaire-conservatrice ne peut être purement et simplement réduite au rôle de «précurseur» de l'idéologie fasciste. ce serait trop facile et grotesque. A ce propos, Mohler écrit: «Tous ceux qui critiquent les idées de 1789 courent le risque de se voir étiquettés par les protagonistes de ces idées révolutionnaires de "pères fondateurs du fascisme" (ou du "nazisme") (...) D'Héraclite à Maître Eckehart, en passant par Paracelse et Luther, Frédéric le Grand, Hamann et Zinzendorf, pour aboutir à Schopenhauer et Kierkegaard, on peut, dans la foulée, construire les arbres généalogiques du fascisme les plus fantasmagoriques».
En réalité, parmi les protagonistes des idées conservatrices-révolutionnaires, on trouvera les appréciations et les attitudes les plus diverses vis-à-vis du fascisme, tant en Allemagne que dans nos pays. La prudence et la précision s'imposent. Quelques figures de la RC se sont en effet converties très vite et avec beaucoup d'enthousiasme au nazisme, comme, par exemple, un Alfred Bäumler ou un Ernst Kriek, ou, chez nous, un Herman van Puymbroeck (33), futur rédacteur-en-chef de Volk en Staat. D'autres ont vu leur enthousiasme s'évanouir rapidement, mais trop tard pour échapper à la mort: l'exemple de Gregor Strasser, assassiné le 30 juin 1934, un jour avant Edgar J. Jung, qui avait, lui, combattu le national-socialisme dès le début et avec la plus grande énergie. Thomas Mann et Karl Otto Paetel choisirent d'émigrer, tout comme Otto Strasser et Hermann Rauschning. Le national-révolutionnaire dur et pur, ennemi de Hitler, Hartmut Plaas, mourra en 1944 dans un camp de concentration tout comme l'avocat liégeois Paul Hoornaert, grand admirateur de Mussolini et chef de la Légion Nationale.
Pour d'autres encore, la collaboration mena à un ultime engagement dans la Waffen-SS, dont ils ne revinrent jamais; pour citer deux exemples, l'un flamand, l'autre néerlandais: Reimond Tollenaere (1909-1942) et Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942). Au cours de cette même année 1942, la collaboration était déjà un passé bien révolu pour un Henri De Man ou un Arnold Meijer, ex-chef du Zwart Front néerlandais. Quant à Tony Herbert, jadis figure symbolique de tout ce qui comptait à droite en Flandre dans les années 30, il était déjà entré de plein pied dans la résistance. Dans la véritable résistance à Hitler, derrière l'attentat du 20 juillet 1944, se profile une quantité de figures issues de la RC, notamment de la Brigade Ehrhardt, comme l'Amiral Wilhelm Canaris, le Général Hans Oster voire l'écrivain Ernst Jünger. Quant à l'homme qui, en 1945, dans le tout dernier numéro de Signal, la revue de propagande allemande qui paraissait dans la plupart des langues européennes pendant la guerre, publia un article pathétique pour marquer la fin du IIIième Reich, était une figure de la RC: Giselher Wirsing, issu du Tat-Kreis (34). En 1948, il participera à la fondation du journal Christ und Welt, dont il deviendra le rédacteur en chef en 1954 et le restera jusqu'à sa mort en 1975 (35).
Les noms que nous venons de citer ne constituent pas des exceptions. Loin de là. Tous répondent en quelque sorte à la règle. Mais comment expliquer à quelqu'un qui a été élevé sous l'égide du concept stalinien de fascisme, ou a reçu un enseignement universitaire marqué par ce concept, que c'est un fait historiquement attesté que dès le début de l'année 1933, le citoyen néerlandais Jan Baars (36), chef de l'Algemene Nederlandse Fascistenbond (ANFB; = Ligue Générale des Fascistes Néerlandais), envoie un télégramme à Hitler pour protester contre la persécution des Juifs (37). Le 30 janvier 1933, le jour où Hitler arriva au pouvoir, un autre télégramme partit de Hollande. Non pas envoyé par Jan Baars mais par l'association des étudiants catholiques d'Amsterdam, le cercle Thomas Aquinas. C'était un télégramme de félicitations. Précisons-le. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné.
Luc PAUWELS.
(texte paru dans la revue anversoise Teksten, Kommentaren en Studies, nr. 55, 2de Trimester 1989; adresse: DELTAPERS v.z.w., Postbus 4, B-2110 Wijnegem).
(1) cfr. Arthur De Bruyne, Cyriel Verschaeve - Hendrik De Man, West-Pocket, 4-5, De Panne, 1969.
Jos Vinks, Cyriel Verschaeve, de Vlaming, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1977.
Hugo Verriest (1840-1922) fut l'élève de Guido Gezelle au couvent théologique de Roeselare (Roulers). Nommé prêtre en 1864. Enseigne à Bruges, Roeselare, Ypres, Heule. Curé à Wakken, commune de la famille de Joris van Severen en 1888. Exerça une influence prépondérante sur le mouvement étudiant nationaliste d'Albrecht Rodenbach (la fameuse Blauwvoeterij).
A son sujet, lire: Luc Delafortrie, Reinoud D'Haese, Noël Dobbelaere, Antoon Van Severen, Rudy Pauwels, Dr. R. Bekaert, Hugo Verriest - Joris Van Severen, Komitee Wakken, Wakken, 1984.
(2) Frank Goovaerts, «Odiel Spruytte. Een vergeten konservatief-revolutionnair denker in Vlaanderen», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 55/1989.
(3) Sur De Man en français: André Philip, Henri De Man et la crise doctrinale du socialisme, Librairie universitaire J. Gambier, Paris, 1928.
Revue européenne des sciences sociales, Cahiers Vilfredo Pareto, Tome XII, 1974, n°31 («Sur l'œuvre de Henri De Man»).
Michel Brelaz, Henri De Man. Une autre idée du socialisme, Ed. des Antipodes, Genève, 1985.
En guise d'introduction générale: Robert Steuckers, «Henri De Man», in Etudes et Recherches, GRECE, Paris, n°3, 1984.
En anglais: Peter Dodge, Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik De Man, M. Nijhoff, The Hague (NL), 1966.
(4) Léon van der Essen, Pages d'histoire nationale et européenne, Les Œuvres/Goemare, Bruxelles, 1942.
Léon van der Essen, Alexandre Farnèse et les origines de la Belgique moderne, 1545-1592, Office de publicité, Bruxelles, 1943.
Léon van der Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, Charles Dessart éd., s.d.
(5) Robert Poulet, La Révolution est à droite. Pamphlet, Denoël et Steele, Paris, 1934.
(6) Frederic Kiesel, Pierre Nothomb, Pierre de Meyere éd., Paris/Bruxelles, 1965.
(7) Charles Anciaux, L'Etat corporatif. Lois et conditions d'un régime corporatif en Belgique, ESPES, Bruxelles, 1942.
(8) Dr. Sun Ya-Tsen, The Three Principles of the People, China Publishing Company, Taipei R.O.C., 1981.
(9) August Vermeylen, écrivain flamand, né à Bruxelles en 1872 et mort à Uccle en 1945. Etudie à Bruxelles, Berlin et Vienne. Il enseignera à Bruxelles et à Gand. Sera démis de ses fonctions par les autorités allemandes en 1940. Influence de Baudelaire et du mouvement décadent français mais défenseur de la langue néerlandaise. Co-fondateur de la revue littéraire Van Nu en Straks. Individualiste anarchisant à ses débuts, il évoluera vers un socialisme communautaire, justifié par un panthéisme dynamique. Son œuvre la plus célèbre est De wandelende Jood (Le Juif errant), illustrant la quête de la vérité en trois phases: la jouissance sensuelle, l'ascèse et le travail.
(10) Hendrik J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, 4 delen, Uitg. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1971. Ces quatre volumes retracent l'histoire intellectuelle du mouvement flamand et recense minutieusement les influences diverses qu'il a subies, notamment celles venues des Pays-Bas, d'Allemagne et de Scandinavie. Ces ouvrages sont indispensables pour comprendre les lames de fond non seulement de l'histoire flamande mais aussi de l'histoire belge.
(11) Mohler se réfère surtout au livre de Michael Freund, Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus (V. Klostermann, Frankfurt a.M., 1972). De même qu'aux passage que consacre Carl Schmitt à Sorel dans Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1926), aujourd'hui disponible en français sous le titre de Démocratie et Parlementarisme (Seuil, 1988).
(12) Sorel a exercé une incontestable influence sur le philosophe martyr José Streel (1910-1946), idéologue du rexisme et auteur, entre autres, de La Révolution du XXième siècle (Nouvelle Société d'Edition, Bruxelles, 1942). Dans cet ouvrage concis, on repère aussi l'influence prépondérante de Péguy, Maurras et De Man. Sur José Streel, lire ce qu'en écrit Bernard Delcord, «A propos de quelques "chapelles" politico-littéraires en Belgique (1919-1945)», in Cahiers du Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale/Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, Ministère de l'Education nationale/Ministerie van Onderwijs, Archives Générales du Royaume - Algemeen Rijksarchief, Place de Louvain 4 (b.19), Bruxelles, 1986. On lira de même toutes les remarques que formule à son sujet le Prof. Jacques Willequet dans La Belgique sous la botte, résistances et collaborations, 1940-1945, Ed. Universitaires, Paris, 1986. Signalons aussi que José Streel fut l'un des artisans de l'accord Rex-VNV, règlant, dans le cadre de la collaboration, le problème linguistique belge.
(13) J. De Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid, N.V. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, 1939.
(14) Sur Joris Van Severen, lire: L. Delafortrie, Joris Van Severen en de Nederlanden, Oranje-Uitgaven, Zulte, 1963.
Jan Creve, Recht en Trouw. De Geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Soethoudt, Antwerpen, 1987.
(15) Arthur De Bruyne, Joris Van Severen, droom en daad, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1961-63.
(16) Le poète Wies Moens (1898-1982) fut un activiste (un «collaborateur») pendant la première guerre mondiale. Il étudia à l'Université de Gand de 1916 à 1918. Il purgera quatre ans de prison pour ses sympathies nationalistes. Il fondera les revues Pogen (1923-25) et Dietbrand (1933-40). En 1945, il est condamné à mort mais trouve refuge aux Pays-Bas pour échapper à ses bourreaux. Il fut le principal représentant de l'expressionnisme flamand et entretint des liens avec Joris Van Severen, avant de rompre avec lui.
Cfr. Erik Verstraete, Wies Moens, Orion, Brugge, 1973.
(17) L'activisme est la collaboration germano-flamande pendant la première guerre mondiale. A ce propos, lire: Maurits van Haegendoren, Het aktivisme op de kentering der tijden, Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen, 1984.
(18) Frank Goovarts, «Dr. G. Schamelhout, antropologie en Vlaamse Beweging», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 42, 1985. Le Dr. G. Schamelhout peut être considéré comme un élève de Georges Vacher de Lapouge. Il s'est intéressé également aux ethnies européennes.
(19) Le mouvement pan-thiois (Alldietscher Beweging) visait à unir toutes les «tribus» basses-allemandes, soit néerlandaises et allemandes du nord, en forgeant un Etat qui aurait rassemblé les Pays-Bas, la Belgique (avec les départements français du Nord et du Pas-de-Calais), la Prusse, le Hanovre, le Oldenbourg, etc. La langue de cet Etat aurait été une synthèse entre le néerlandais actuel et les dialectes bas-allemands. A ce sujet, lire: Ludo Simons, Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Alldietsche Beweging, Orion, Brugge, 1980.
(20) Sur Spengler, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Gilbert Merlio, Oswald Spengler, témoin de son temps, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, Stuttgart, 1982 (deux volumes).
(21) Sur Arthur Moeller van den Bruck, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Denis Goeldel, Moeller van den Bruck (1876-1925), un nationaliste contre la révolution, Peter Lang, Frankfurt a.M./Bern, 1984.
(22) Deux livres récents sur Spann: Walter Becher, Der Blick aufs Ganze. Das Weltbild Othmar Spanns, Universitas, München, 1985.
J. Hanns Pichler (Hg.), Othmar Spann oder die Welt als Ganzes, Böhlau, Wien, 1988.
(23) Pour comprendre le mouvement d'unité dans les Bas Pays au Moyen Age, lire Léon Vanderkinderen, Le siècle des Artevelde. Etudes sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant, J. Lebègue & Cie, Bruxelles, 1907.
(24) Les dix-sept provinces regroupent les pays suivants dans l'optique de Joris Van Severen et de ses adeptes de jadis et d'aujourd'hui: la Frise, le Groningue, la Drenthe, l'Overijssel, le Pays de Gueldre, le Pays d'Utrecht, la Hollande, la Zélande, le Brabant, le Limbourg (Limbourg historique, Limbourg belge, soit l'ex-Comté de Looz, Limbourg néerlandais contemporain), le Pays de Liège, le Pays de Namur, le Luxembourg (Grand-Duché, Luxembourg belge et Pays de Thionville/Diedenhofen), le Hainaut, la Flandre, l'Artois et la Picardie.
(25) Le terme néerlandais de «Dietsland» se traduit en français par «Pays Thiois». Le long de la frontière linguistique, en Pays de Liège, on trouve également la forme «tixhe», typique de l'ancienne graphie liégeoise. On parle également de «Lorraine thioise» pour désigner la partie allemande de la Lorraine.
(26) Van Severen semble être le seule représentant de la RC dans nos pays à avoir utiliser et revendiquer le terme de «conservateur-révolutionnaire». C'était dans un article du 23 juillet 1932, paru dans De West-Vlaming. Cité par Arthur De Bruyne, op. cit., p. 140.
Rappelons qu'une querelle demeure sous-jacente entre, d'une part, le nationalisme à base exclusivement linguistique, rêvant d'un Etat néerlandais unissant la Flandre et les Pays-Bas, et, d'autre part, les adeptes des Dix-Sept Provinces Unies, regroupant les régions néerlandophones, wallonophones, picardophones et germanophones de l'ancien «Cercle de Bourgogne».
(27) Pour comprendre l'itinéraire d'Ernst Niekisch, lire Uwe Sauermann, Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus, Bibliothekdienst Angerer, München, 1985.
(28) Cité par Wim Zaal dans De Nederlandse Fascisten, Wetenschapelijke Uigeverij, Amsterdam, 1973.
(29) Multatuli est le pseudonyme d'Eduard Douwes Dekker (1820-1887), écrivain néerlandais, pionnier de la colonisation de l'Indonésie. Lecteur de Nietzsche, il se posera en partisan d'une monarchie éclairée et d'un système d'éducation non étouffant. Son roman le plus célèbre est Max Havelaer, une chronique assez satirique de la colonie néerlandaise en Indonésie.
(30) Le frontisme est le mouvement politique des années 20 en Flandre, porté par les soldats revenus du front. Sur la scène électorale, il se présentait sous la dénomination de Frontpartij. Ce mouvement d'anciens soldats du contingent était pacifiste et soucieux de ne plus verser une seule goutte de sang flamand pour la France, considérée comme ennemie mortelle des peuples germaniques et du catholicisme populaire.
(31) Albrecht Rodenbach (1856-1880), jeune poète flamand, formé au séminaire de Roeselare (Roulers), élève de Hugo Verriest (cf. supra), fonde, en entrant à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, le mouvement étudiant flamand, la Blauwvoeterij. Ses poèmes mêlent un catholicisme charnel et sensuel, typiquement flamand, à un paganisme wagnérien, nourri de l'épopée des Nibelungen: un contraste étonnant et explosif...
A son sujet, lire: Cyriel Verschaeve, Albrecht Rodenbach. De Dichter, Zeemeeuw, Brugge, 1937.
(32) L'AKVS publie toujours une revue, AKVS-Schriften. Adresse: AKVS-Schriften, c/o Paul Meulemans, Kruisdagenlaan 75, B-1040 Brussel. Tél.: 02/734.25.52.
(33) La radicalité des positions de H. Van Puymbrouck transparaît dans le texte d'une brochure publiée à Berlin en 1941 et intitulée Flandern in der neuen Weltordnung (Verlag Grenze und Ausland, Berlin, 1941) et rééditée en 1985 par Hagal-Boeken, Speelhof 10, B-3840 Borgloon.
(34) Sur le Tat-Kreis, cfr.: Klaus Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution, Fluchtwege in der Krise der bürgerlichen Gesellschaft: Das Beispiel des «Tat-Kreises», edition Suhrkamp, es 778, Frankfurt a.M., 1976. Ouvrage très critique mais qui révèle les grandes lignes de l'idéologie du Tat-Kreis.
(35) A propos de Giselher Wirsing, on lira avec profit le texte que lui a consacré Armin Mohler au moment de sa mort en 1975 («Der Fall Giselher Wirsing») et repris dans son recueil intitulé Tendenzwende für Fortgeschrittene, Criticón Verlag, München, 1978.
(36) Jan Baars, né le 30 juin 1903, fit partie de la résistance néerlandaise pendant la guerre. Il est décédé le 24 avril 1989.
(37) Wim Zaal, op. cit., p.119.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, années 20, années 30, révolution conservatrice, droite, conservatisme, nouvelle droite, idéologie, sciences politiques, politologie, philosophie, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 janvier 2010
La excepcion en Carl Schmitt - Una exposicion introductoria
La excepción en Carl Schmitt
Una exposición introductoria
Christian Reátegui / Ex: http://la-coalicion.blogspot.com/

La previsión de una dictadura comisarial en los dos últimos textos constitucionales peruanos ha pasado inadvertida. Para comenzar, la positivización del concepto jurídico de medida en dichos textos constitucionales ha pasado sin mayores comentarios. Tanto en la Constitución peruana de 1979 como en la de 1993 podemos leer textos similares:
Constitución de 1979“Artículo 211º.- Son obligaciones y atribuciones del Presidente de la República:
...
18.- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y la soberanía en caso de agresión.”
Constitución de 1993
"Artículo 118º.- Corresponde al Presidente de la República:
...
15.- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado".
Se ha dicho que los constituyentes peruanos de 1979 adoptaron la fórmula de la empleada en el artículo 16 de la Constitución francesa de 1958, que fue a su vez recogida del texto del famoso artículo 48 de la Constitución de Weimar (1919). Lo que es menos conocido es que este artículo 48 fue el centro de un debate jurídico rico e intenso en la Alemania de esos años acerca de sus alcances y, en última instancia, acerca del concepto de Constitución, debate en el que el concepto de medida (maßnahme) desempeñó un papel central. Para el jurista alemán Carl Schmitt dicho artículo sustentaba la posibilidad de una Dictadura del Presidente del Reich. Es más, dicho artículo devenía en el referente interpretativo de toda la Constitución:
“Artículo 48. Si un Land no cumpliese con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en la Constitución o en una Ley del Reich, el Presidente del Reich podrá hacérselas cumplir con ayuda de las Fuerzas Armadas.
Si la seguridad y el orden públicos se viesen gravemente alterados o amenazados, el Presidente del Reich podrá adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de la seguridad y orden públicos, utilizando incluso las Fuerzas Armadas si fuera necesario. A tal fin puede suspender temporalmente el disfrute total o parcial de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.
El Presidente del Reich está obligado a informar inmediatamente al Reichstag de la adopción de todas las medidas tomadas conforme a los párrafos 1º y 2º de este artículo. Las medidas deberán ser derogadas a petición del Reichstag.
En caso de peligro por demora, el Gobierno de cualquier Land podrá aplicar provisionalmente medidas de carácter similar a las referidas en el párrafo 2º de este artículo. Las medidas deberán ser derogadas a petición del Reichstag o del Presidente del Reich.
Una ley del Reich desarrollará el resto"
Para Schmitt el párrafo 2º, primera parte, de este artículo contiene el fundamento constitucional de un apoderamiento para una comisión de acción ilimitada, en términos precisos, una dictadura comisarial. Sobre la verificación o no del presupuesto (alteración o amenaza de la seguridad y del orden públicos) para dicho apoderamiento, decide de por sí el Presidente. De acuerdo a Schmitt, el párrafo 2º, en su parte primera, constituía derecho vigente y no requería la ley que desarrollara el estado de excepción que preveía el 5º párrafo. Ante el acaecimiento de alteración o amenaza de la seguridad y del orden públicos, el Presidente podía adoptar todas las medidas necesarias (nötigen Maßnahmen), cuya necesidad era evaluada de acuerdo a las circunstancias y al solo arbitrio del propio Presidente. En consecuencia la dictadura Presidencial cuya posibilidad preveía la Constitución de Weimar, se concretizaba en la adopción de medidas.
Para Schmitt una medida era una acción individualizada o una disposición general, adoptada frente a una situación concreta que se considera anormal, y que es, por lo tanto, superable, con una pretensión de vigencia por tiempo no indefinido. Una medida se caracteriza por su dependencia de la situación objetiva concreta. Ello supone que la magnitud de la medida, su procedimiento y su eficacia jurídica dependen de la naturaleza de las circunstancias. El aforismo latino rebus sic stantibus preside su adopción y ejecución. Ahora bien, la dictadura comisarial desarrollada por Schmitt no significaba la disolución del orden jurídico existente ni que el Presidente deviniese en soberano, ya que las medidas era sólo de naturaleza fáctica y no podían ser equiparadas con actos de legislación ni de administración de justicia, sin que ello significase que no se pudiesen tomar medidas que se aproximaran por sus resultados y consecuencias prácticas a fallos judiciales, decisiones administrativas conseguidas tras un procedimiento previamente establecido o a normas generales (leyes y/o reglamentos), pero que jurídicamente no serían equiparables en significado ni en eficacia jurídicas. Esto porque una medida no podía reformar, derogar o suspender preceptos constitucionales, pero sí podía desconocerlos, separándose de ellos para un caso concreto o una generalidad de casos concretos, en lo que Schmitt llamaba “quebrantamiento” (durchbrechung) de la Constitución. Hay que apuntar que, de acuerdo a Schmitt, hay que distinguir entre Constitución y leyes constitucionales. La Constitución sería la decisión de conjunto de un pueblo acerca de la forma y modo de su unidad política, mientras que las leyes constitucionales serían los preceptos o normas que, por una razón u otra, han sido recogidas en el texto constitucional. Entonces para nuestro autor la Constitución es intangible, mientras que las leyes constitucionales (preceptos o normas) no, por lo que pueden ser “quebrantadas” por las medidas para un caso determinado o casos determinados, y ello sólo en defensa de la propia Constitución en estados de excepción. Hay que precisar que cualquier ley constitucional podría ser desconocida puntualmente por las medidas (o “quebrantada”) y no sólo las que contienen derechos fundamentales, como sucede con lo permitido por la norma de la segunda parte del párrafo 2º como más adelante veremos.
Un ejemplo para clarificar la diferencia entre medida y decisión administrativa, sería la que da el propio Schmitt a propósito de lo establecido en el artículo 129º de la Constitución de Weimar. Este artículo preveía una serie de garantías a favor de los funcionarios, así, sólo podrían ser privados de su cargo mediante un procedimiento conforme a Derecho, tenían la posibilidad de interponer recursos impugnatorios, el respeto a sus derechos adquiridos, etc. A pesar de ello, a través de una medida se podría suspender a determinados funcionarios y confiar su cargo a otras personas. Tales medidas tendrían efectos o resultados jurídicos, pero no la eficacia de una decisión adoptada tras un proceso disciplinario que concluyese con la separación definitiva del cargo del funcionario. Esto significa que el funcionario suspendido continuaría disfrutando (jurídicamente) de su status de funcionario, situación que no se daría con el separado jurídicamente del servicio. Asimismo, la persona encargada, mediante una medida, del cargo y de sus tareas públicas no conseguiría, por ello, alcanzar la situación jurídica de funcionario.
Para Schmitt no escapó que esta comisión para una dictadura presidencial, entraba en contradicción con lo establecido en la segunda parte de ese mismo 2º párrafo, que para él contenía otra norma que, junto al apoderamiento general de su primera parte, determinaba que para conseguir el restablecimiento de la seguridad y el orden públicos, el Presidente del Reich también podía suspender (suspension), es decir, poner temporalmente fuera de vigencia, en todo o en parte, a los derechos fundamentales contenidos en las leyes constitucionales de los artículos 114º (libertad personal), 115º (inviolabilidad del domicilio), 117º (secreto de la correspondencia y de correo), 118º (libertad de prensa), 123º (libertad de reunión), 124º (libertad de asociación) y 153º (propiedad privada). Esta contradicción, que, por un lado, permitía suspender toda el ordenamiento jurídico existente y, por otro, sólo permitía suspender una serie de derechos enumerados taxativamente, se debía, según Schmitt, a la confusión entre dictadura soberana y comisarial, que supone el considerar que el Presidente del Reich podía emitir ordenanzas con fuerza de ley sin considerar la distinción entre ley y medida y la asignación de competencias que conformaba la Constitución del Reich, y a la creencia ingenua que, en el Estado de Derecho burgués, la seguridad sólo podría ser puesto en peligro por individuos o grupos de individuos en tumultos y motines, no por organizaciones políticas, colectivos o agrupaciones solidarias, ya que los grupos intermedios y gremios de este tipo habían desaparecido.
Esta misma contradicción, entre la existencia del establecimiento de una dictadura presidencial (artículos 211 numeral 18 de la Constitución de 1979, y 118 numeral 15 de la Constitución de 1993) con la de un régimen de excepción limitado (artículos 231 de la Constitución de 1979, y 137 de la Constitución de 1993) se ha dado, a nuestro entender, tanto en la Constitución peruana anterior como en la actual. Basta con leer el artículo 231º de la Constitución de 1979 y el 137º de la que nos rige actualmente:
Constitución de 1979
"Artículo 231.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decreta, por plazo determinado, en todo o parte del territorio y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
a.- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede suspender las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7, 9 y 10 del artículo 2º y en el inciso 20-g del mismo artículo 2º. En ninguna circunstancia se puede imponer la pena de destierro. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. La prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando lo dispone el Presidente de la República.
b.- Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, o guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con especificación de las garantías personales que continúan en vigor. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso”
Constitución de 1993
“Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
1.- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
El plazo de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2.- Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso".
El que el artículo 55 de la Constitución actual, que prescribe que los tratados celebrados por el Estado, y que se encuentren en vigor, forman parte del derecho nacional, y la 4º Disposición Final y Transitoria que dispone que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre dichas materias ratificadas por el Perú, pueden dar la impresión que el problema jurídico se ha zanjado. Ello puede ser considerado efectivamente así, pero pasa por alto que toda disciplina jurídica que pretende tener vigencia en el tiempo, es decir, eficacia social, no puede responder a autoengaños a partir de visiones ideologizadas de experiencias pasadas. Sobre ello queda mucho por abundar aún.
00:16 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, révolution conservatrice, sciences politiques, philosophie, politologie, droit, décisionnisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 décembre 2009
Annotation sur le "Travailleur"
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Annotation sur le «Travailleur»
Dr. Karlheinz WEISSMANN
Ernst Jünger a toujours voulu que l'on inclue son Travailleur dans l'édition de ses œuvres complètes, surtout contre les “bien-pensants” qui l'exhortaient à prendre distance à l'endroit de ce “faux-pas” littéraire. Déjà dans une “Troisième lettres aux amis”, datée du 1er septembre 1946, Jünger insistait: il ne reniait rien de son œuvre, celle-ci devait être considérée comme un tout; il ne prenait ses distances d'aucun fragment de ce travail. Le rapport qui existe entre des écrits tels La mobilisation totale ou Le Travailleur, d'une part, et d'autres tels Jardins et Routes, est comparable à celui qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Plus tard, il a répété cette formule de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais cela ne nous dit rien de clair, finalement, sur la valeur qu'il faut attribuer actuellement aux premiers écrits de Jünger. La seconde version du Cœur aventureux déjà, la décision de publier en 1934 une édition des œuvres complètes mais sans les textes nationalistes du début des années 20 ensuite, signale la volonté de Jünger de marquer une césure entre la partie purement politique de ses premiers écrits et ses livres ultérieurs. Mais il fit tout de même une exception de taille: les deux ouvrages que nous venons de mentionner, La Mobilisation totale et Le Travailleur. Mais au prix d'une interprétation qui rend presque méconnaissable l'intention initiale. Voilà pourquoi il m'apparaît opportun de poser une nouvelle fois la question: quelle est l'“assise dans la vie” que possèdent ces textes? Ce qui doit nous permettre de tourner notre regard vers un fragment de l'histoire des impacts obtenus par ses livres-clefs, histoire au demeurant peu connue, mais ô combien instructive et éclairante.
La Mobilisation totale et Le Travailleur étaient tous deux des livres apocalyptiques. Depuis le début des années 30 la crise s'accentuait considérablement en Allemagne; simultanément augmentait le besoin de “grandes solutions”. Les modèles technocratiques, les “Plans” de réorganisation de l'Etat et de la société bénéficiait d'une incontestable conjoncture, puisque le jeu libre des libéraux, en politique comme en économie, avait incontestablement failli. Pour les extrémistes de gauche, le modèle était les plans quinquennaux soviétiques, tandis qu'une fraction des économistes professionnels autour de John M. Keynes imaginait une politique interventionniste du plein-emploi. Enfin, des cercles de non-conformistes, où se rencontraient, pour échanger des idées, hommes de gauche et de droite, libéraux, sociaux-démocrates, des banquiers, des conservateurs et des nationaux-socialistes. Ces idées ont trouvé une écho dans le fameux “Plan WTB” (d'après les noms de ses inventeurs: Wladimir Woytinski, Karl Baade et Fritz Tarnow), édité par la fédération des syndicats (Gewerkschaftsbund), de même que dans le Wirtschaftliches Sofortprogramm der NSDAP (= “Programme économique tout-de-suite de la NSDAP”) de Gregor Strasser ou dans le Sofortprogramm de Günther Gereke qui devint par la suite Commissaire du Reich pour la politique de l'emploi dans le Cabinet von Schleicher. En lançant son appel à la “nostalgie anti-capitaliste”, Strasser a pu transformer en triomphe pour la NSDAP les élections de juillet 1932; ailleurs, le Président de l'ADGB, Theodor Leipart, tentait de rassembler tous les partisans de l'autarcie nationale, qui voulaient délivrer les syndicats libres du carcan de la SPD. Dans son célèbre discours de Bernau, le 14 octobre 1932, Leipart expliquait que la tâche du travailleur était de se mettre au service de son peuple; il évoquait l'«esprit soldatique de l'imbrication dans le Tout et du don de soi au Tout», qui devait animer le prolétariat dans l'avenir.
On peut avancer la thèse que Leipart a été inspiré par Le Travailleur de Jünger. A une époque aussi chaotique, les ennemis d'hier se rassemblent dans de nouveaux groupements: Le Travailleur avait incontestablement touché une corde sensible dans l'air du temps. Mais ce livre mythique et apocalyptique a également suscité une série d'incompréhensions. Les uns considéraient Le Travailleur comme un ouvrage “bolchévique”, d'autres y voyaient le résultat d'un culte impolitique de la technique, d'autres encore en interprétaient le contenu comme l'expression d'une philosophie nihiliste, née sous la pression des faits. Ce sont précisément les admirateurs de Jünger dans les ligues de jeunesse nationales-révolutionnaires et le mouvement Widerstand d'Ernst Niekisch qui se sont sentis interpellés et irrités. Une irritation qui s'est encore accrue quand Jünger, sans ambages, accepte la modernité et insiste sur le rapport unissant la “mobilisation allemande” et la “domination planétaire du Travailleur”. Si Jünger a voulu faire du Travailleur un écrit programmatique du “nouveau nationalisme”, alors il n'a pas été compris de son public ou n'a été accepté qu'avec réserve. En 1933, les dernières possibilités d'organiser des discussions fructueuses disparaissent.
 Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Tout ce que je viens d'écrire sur le groupe rassemblé autour de Traugott et Sild permet de comprendre le Jünger “politique”. L'engagement de Jünger dans les années 20 n'a pas été une marotte: sans aucun doute, il a appartenu aux têtes pensantes de la droite révolutionnaire allemande. Mais sa participation au débat politique n'autorise aucune simplification extrême, comme celles de l'historiographie boîteuse qui se pare du label d'“antifascisme”, en répétant ses arguments à satiété. Jünger était un nationaliste à l'époque mais il a toujours été plus que cela. Mais, après avoir écrit Le Travailleur, il tire une conclusion: la politique n'est qu'un phénomène superficiel qui n'influe en rien sur les processus titaniques à l'œuvre dans notre monde; Jünger n'a pas voulu s'exposer aux coups de cette “titanisation”, parce qu'il la croyait inévitable. Cette attitude est sans doute le résultat d'un moment de faiblesse, mais elle est aussi empreinte de sagesse. Car l'un des messages les plus forts de Jünger demeure le suivant: il est bon “de deviner que derrière les excès de dynamisme de notre temps se trouve caché un centre immobile”.
Dr. Karlheinz WEISSMANN.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, ernst jünger, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 décembre 2009
Jünger Wandervogel

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Jünger Wandervogel
Patrick NEUHAUS
Dans bon nombre de publications, Ernst Jünger témoigne de ses ancrages personnels dans le monde d'avant la première guerre mondiale.
Ceux qui connaissent la biographie de Jünger savent que l'adolescent détestait la rationalité, se sentait étranger à elle, tout comme à la quotidienneté du monde de son époque. Il était un rêveur qui ne connaissait rien du monde des autres et n'y cherchait pas son chemin. Cette attitude d'“anarque”, nous ne cessons de la découvrir dans toute l'œuvre d'Ernst Jünger. A la même époque, Franz Kafka ou Thomas Mann affichaient une même distance par rapport au monde de la majorité. Les intérêts du jeune Jünger résident tout entiers dans son monde onirique individuel. Le monde dans lequel évolue l'adolescent Jünger est marqué par tous ces facteurs sociaux qui orientaient la vie de la plupart des fils de la société bourgeoise: une maison parentale reposant sur des fondements solides, une vie quotidienne à l'école obnubilée par les bonnes notes, l'idéal d'une profession stable. C'est dans ce type de monde que le jeune homme de la Belle Epoque devait trouver sa voie. L'écrivain Ernst Jünger sera le contraire de son père, Ernst Jünger sen. (1868-1943). En 1901, le père quitte, avec sa famille, la pittoresque cité de Heidelberg pour émigrer à Hannovre, ensuite à Schwarzenberg dans l'Erzgebirge, enfin à Rehberg: au fil de ces transplantations, le fils Ernst Jünger jun., se détache de plus en plus nettement de la vision du monde positiviste du 19ième siècle. Son père ne réussit qu'à lui communiquer sa passion pour l'entomologie. Mais au-delà de cela, s'est rapidement évanouie l'influence intellectuelle que le père, chimiste et pharmacien doué, exerçait sur son fils épris d'indépendance. Dès l'âge de 13 ans, nait dans le cœur de Jünger un enthousiasme et un émerveillement pour l'agencement des choses dans la nature, pour le sens qu'elles nous communiquent.
Les séjours en pleine nature, la collection de ces petites pierres, de ces petites mosaïques, aux formes diverses, leur agencement en images aux couleurs châtoyantes, les voyages imaginaires du jeune Jünger féru de lectures dans des mondes lointains, aventureux, ont fait en sorte que les journées d'école sont vite apparues fort mornes. Dans Le cœur aventureux, Jünger dépeint ses aspirations avec une indéniable volupté: «Mes parents possédaient une serre... et, souvent, lorsque l'air brûlant frémissait sur le toit de verre, je songeais, avec un plaisir étrange, qu'il ne devait pas faire plus chaud en Afrique. Mais il devait sans doute y faire un peu plus chaud, car c'est ce qui était quasi insupportable, ce qui n'avait jamais encore été vécu, qui était le plus attirant».
Comme des milliers d'autres garçons, Jünger, à seize ans, en 1911, rejoint le Wandervogel. Une des raisons qui l'ont poussé dans les rangs de ce mouvement de jeunesse: le recul de ses résultats scolaires. Comme l'avait déjà constaté Gerhard Ille dans son livre Es begann in Steglitz (Berlin, 1987), le développement du mouvement de jeunesse est étroitement lié à l'augmentation rapide du nombre d'élèves dans les grandes écoles. Le nombre des adhérents du Wandervogel s'est multiplié. Les temps d'apprentissage étaient devenus plus long, le corps des enseignants tendait à s'enfler démesurément et à se bureaucratiser; tout cela contribuait à diminuer sensiblement la qualité de l'enseignement dans les Gymnasia. Pour beaucoup d'élèves, l'école devenait aliénante; elle les préparait à des professions qui n'étaient plus, en dernière instance, que des “fonctions” dans les structures de la société allemande, de plus en plus technologisée et bureaucratisée.
Jünger ne se sentait pas exposé à la pression sociale, qui poussait les jeunes gens à terminer la seconde moitié de leurs humanités afin d'obtenir le droit d'effectuer un service militaire volontaire d'un an seulement (en 1912, Jünger décrochera finalement ce diplôme). Ce type de service militaire prévoyait un temps réduit à une seule année, permettait aux jeunes de gagner du temps et de l'argent et autorisait le volontaire à postuler le statut d'officier de réserve. Mais si le jeune homme ne réussissait pas à atteindre cette position sociale tant briguée, il restait tenaillé par la crainte des examens; s'il ne les passait pas ou s'il n'obtenait pas l'affectation désirée, cela pouvait se terminer en tragédie. Les statistiques de 1883-1888 nous signalent le suicide de 289 élèves, dont 110 dans les grandes écoles. Chez les Wandervögel, qui cultivaient un ressentiment certain à l'égard de la société qu'ils détestaient, ces considérations n'avaient pas leur place. L'officier de réserve issu du Wandervogel envisageait toujours une réforme “par le haut”, et, plus tard, pendant la guerre, il cherchait à promouvoir une réforme globale de la vie dans le corps même des officiers. Ce fut un échec. Mais le scepticisme de ces jeunes officiers à l'égard de l'armée en tant que forme d'organisation, à l'égard de sa technicisation et de sa rationalisation, est demeuré: c'était un scepticisme pour une part plus “progressiste” que celui qui règnait dans d'autres secteurs de la société.
Ernst Jünger, lui, n'a jamais songé au suicide, car il ne prenait pas l'école au sérieux. «Je rêvais sans tenir compte de rien, avec passion... et je me cherchais chaque nouvelle année un nouveau chef droit aux épaules larges, derrière lesquelles je pouvais opportunément me réfugier» (Das abenteuerliche Herz, 1ière version).
La fantaisie juvénile influencée par la lecture de livres d'aventures, comme ceux de Karl May, ou de récits coloniaux ou d'ouvrages de géographie, l'a conduit à rêver à de longs voyages dans des contrées inexplorées. La notion de “communauté” qui, pour d'autres, est la clef de l'aventure, ne constitue pas l'essentiel pour Jünger. A ce moment-là de son existence, comme plus tard, pendant la guerre, elle n'est qu'un moyen pour compléter son univers d'ivresse et de rêves. L'énergie pour l'aventure, Jünger la porte en lui, il n'a pas besoin d'une dynamisation complémentaire, qui lui serait transmise par d'autres. Jünger ne s'est jamais entièrement soumis à un groupe ni n'a adhéré exclusivement à un mouvement précis. C'est ce qui ressort des quelques rares descriptions que nous livre Jünger sur le temps où il était Wandervogel: beuveries vespérales à la manière des étudiants des corporations. Sur les visites hebdomadaires aux brasseries de Hameln, où Jünger était lycéen en 1912, nous avons un récit, publié seulement en 1970 dans Approches, drogues et ivresse: «Les chansons et toute sorte de cérémonies telles que la “salamandre” (1) étaient ordonnées après un silentium préparatoire; un moment de détente, la fidelitas, suivait l'exécution du rituel. On buvait dans des pots à couvercle; parfois aussi un hanap circulait à la ronde. Il avait la forme d'une botte qu'on ne cessait de remplir à nouveau, aux frais de celui qui avait été l'avant-dernier à la tenir. Quand la bière tirait à sa fin, il fallait, ou bien en boire de toutes petites gorgées, ou bien faire “cul sec” d'un trait (...) Il existait toute une série de délits qu'on expiait en vidant une petite ou grande quantité de liquide — ce qu'on appelait “descendre dans le pot”. Souvent des étudiants, ex-membres du club, étaient nos hôtes; ils louaient notre zèle gambrinesque». (note (1): Salamandre: rite qui consiste à frotter trois fois la table en rond du fond de son pot avant de faire “cul sec”).
 Par la suite, Jünger a essayé de traduire en actes ce que d'autre n'évoquaient qu'en paroles. A la recherche de la vie dans sa pureté la plus limpide, avec la volonté de se plonger dans l'ivresse extrême de l'aventure et dans l'émerveillement intense de nouvelles découvertes, de nouvelles couleurs, odeurs et plantes, de nouveaux animaux, Jünger décide de franchir le pas, un pas extraordinairement courageux pour un adolescent, un pas dangereux: à Verdun, en Lorraine, sans avoir averti son père, il s'engage dans la Légion Etrangère française. Un an seulement avant la Grande Guerre, avant même d'avoir passé son “examen de maturité” (ndt: qui correspond plus ou moins au bacchalauréat français), le jeune Jünger amorce une aventure audacieuse, mais qui sera de très courte durée. La même année, au moment où Ernst Jünger part, un revolver dans la poche, pour rejoindre la prestigieuse phalange des professionnels de l'armée française, le mouvement Wandervogel réunit ses adeptes allemands sur une montagne d'Allemagne centrale, le Hoher Meißner. Un Wandervogel autrichien avait appelé les Germains au “Combat contre les Slaves”; les Allemands veulent prendre position et répondent, par la voix de leur porte-parole: «La guerre? Cette manifestation de la folie des hommes, cette destruction de la vie, ce massacre en masse des hommes, faut-il la réactiver de nos jours? Qu'un destin bienveillant, que notre œuvre quotidienne, exécutée en toute fidélité à nos idéaux, nous en préservent!».
Par la suite, Jünger a essayé de traduire en actes ce que d'autre n'évoquaient qu'en paroles. A la recherche de la vie dans sa pureté la plus limpide, avec la volonté de se plonger dans l'ivresse extrême de l'aventure et dans l'émerveillement intense de nouvelles découvertes, de nouvelles couleurs, odeurs et plantes, de nouveaux animaux, Jünger décide de franchir le pas, un pas extraordinairement courageux pour un adolescent, un pas dangereux: à Verdun, en Lorraine, sans avoir averti son père, il s'engage dans la Légion Etrangère française. Un an seulement avant la Grande Guerre, avant même d'avoir passé son “examen de maturité” (ndt: qui correspond plus ou moins au bacchalauréat français), le jeune Jünger amorce une aventure audacieuse, mais qui sera de très courte durée. La même année, au moment où Ernst Jünger part, un revolver dans la poche, pour rejoindre la prestigieuse phalange des professionnels de l'armée française, le mouvement Wandervogel réunit ses adeptes allemands sur une montagne d'Allemagne centrale, le Hoher Meißner. Un Wandervogel autrichien avait appelé les Germains au “Combat contre les Slaves”; les Allemands veulent prendre position et répondent, par la voix de leur porte-parole: «La guerre? Cette manifestation de la folie des hommes, cette destruction de la vie, ce massacre en masse des hommes, faut-il la réactiver de nos jours? Qu'un destin bienveillant, que notre œuvre quotidienne, exécutée en toute fidélité à nos idéaux, nous en préservent!».
Cette attitude pacifiste a été celle de la majorité dans le mouvement de jeunesse bourgeois avant le déclenchement de la Grande Guerre. La volonté d'action de Jünger, d'une parfaite cohérence, ne pouvait pas se concrétiser dans sa patrie. Son départ pour la Légion fit la une dans les quotidiens de sa région. Par voies diplomatiques, le père de Jünger obtient assez rapidement le rapatriement de son fils fugueur, qui se trouvait déjà en Afrique. Détail intéressant: le père lui ordonne par télégramme de ne pas revenir sans s'être laissé photographier en uniforme de légionnaire.
Jünger eut en Afrique des expériences plutôt dégrisantes. Il nous décrit par exemple comment il a été cueilli par des policiers militaires français, peu après son arrivée au Maroc, et exposé à la risée des indigènes. Les chambres sont pareilles à celles des détenus. Dès ce moment, l'aventure africaine laissait à désirer. Mais son livre Jeux africains demeure un récit légendaire, qui ne cesse de captiver ses lecteurs. En 1939, le Meyers Lexikon, pourtant fidèle à la ligne imposée par le régime, fait tout de même l'éloge de ce texte: Jünger, écrit le rédacteur, prouve avec ce livre «qu'il est doué d'une grande capacité poétique à décrire et à contempler», surtout «après avoir approché dangereusement un retournement, celui qui mène du réalisme héroïque au nihilisme sans espoir».
Après avoir passé un Abitur accéléré, Jünger se porte volontaire dès le début de la guerre. Sa jeunesse était définitivement passée. Le monde obsolète de sa ville natale, endormi et médiéval, moisi et vermoulu, il l'abandonnait définitivement. Il appartiendra désormais au petit nombre de ceux qui abandonnent le romantisme sans une plainte, pour adopter le pas cadencé, pour troquer le béret de velour des Wandervögel pour le casque d'acier de l'armée impériale. Numquam retrorsum, semper prorsum!
Patrick NEUHAUS.
(article extrait de Junge Freiheit, n°12/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
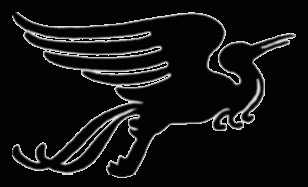
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, ernst jünger, mouvements de jeunesse, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 décembre 2009
Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
 Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Werner BRÄUNINGER
«Nous souhaitons du fond de notre cœur la victoire du national-socialisme, nous connaissons le meilleur de ses forces, l'enthousiasme qui le porte, nous connaissons le sublime des sacrifices qui lui sont consentis au-delà de toute forme de doute. Mais nous savons aussi, qu'il ne pourra se frayer un chemin en combattant... que s'il renonce à tout apport résiduaire issu d'un passé révolu» (1).
Ces phrases, Ernst Jünger les a écrites pendant l'été 1930. Pourquoi, se demande-t-on aujourd'hui, Jünger n'a-t-il pas trouvé la voie en adhérant au mouvement de cet homme, apparamment capable de transposer et d'imposer les idées de Jünger et du «nouveau nationalisme» dans la réalité du pouvoir et de la politique? Mon propos, ci-après, n'a pas la prétension d'être une analyse méticuleuse, profonde, systématique de l'histoire des idées. Il ne vise qu'à montrer comment une personnalité individuelle et charismastique de la trempe d'Ernst Jünger, qui a fêté ses 100 ans en mars dernier, a pu maintenir son originalité à l'ère du Kampfzeit de la NSDAP.
1. Ernst Jünger et Adolf Hitler
Le jugement posé par Jünger sur Hitler a varié au cours des années: «Cet homme a raison», puis «Cet homme est ridicule» ou «Cet homme est inquiétant» ou «sinistre» (2). En 1925, Jünger pensait encore que la figure de Hitler éveillait indubitablement, tout comme celle de Mussolini, «le pressentiment d'un nouveau type de chef» (3). La description par Jünger d'un discours du jeune Hitler nous communique très nettement ce “fluide”: «Je connaissais à peine son nom, lorsque je l'ai vu dans un cirque de Munich où il prononçait l'un de ses premiers discours... A cette époque, j'ai été saisi par quelque chose de différent, comme si je subissais une purification. Nos efforts incommensurables, pendant quatre années de guerre, n'avaient pas seulement conduit à la défaite, mais à l'humiliation. Le pays désarmé était encerclé par des voisins dangereux et armés jusqu'aux dents, il était morcelé, traversé par des corridors, pillé, pompé. C'était une vision sinistre, une vision d'horreur. Et voilà qu'un inconnu se dressait et nous disait ce qu'il fallait dire, et tous sentaient qu'il avait raison. Il disait ce que le gouvernement aurait dû dire, non pas littéralement, mais en esprit, dans l'attitude, ou aurait dû faire tacitement. Il voyait le gouffre qui se creusait entre le gouvernement et le peuple. Il voulait combler ce fossé. Et ce n'était pas un discours qu'il prononçait. Il incarnait une manifestation de l'élémentaire, et je venais d'être emporté par elle» (4).
Après que Jünger ait reçu de Hitler un exemplaire de son livre autobiographique et programmatique, le fameux Mein Kampf, Jünger lui a expédié tous ses livres de guerre. L'un de ces exemplaires d'hommage, plus précisément Feuer und Blut, contient une dédicace datée du 9 janvier 1926: «A Adolf Hitler, Führer de la Nation! - Ernst Jünger». Plus tard, la même année, Hitler annonce sa visite chez Jünger à Leipzig; celle-ci n'a toutefois pas eu lieu, à cause d'une modification d'itinéraire. Plus tard, Jünger écrit, à propos de cet événement: «Cette visite se serait sans doute déroulée sans résultat, tout comme ma rencontre avec Ludendorff. Mais elle aurait certainement apporté le malheur» (5). En 1927, Hitler lui aurait offert un mandat de député NSDAP au Reichstag. Jünger a refusé. Il considérait que l'écriture d'un seul vers avait davantage d'intérêt que la représentation de 60.000 imbéciles au Parlement.
Les relations entre les deux hommes se sont nettement rafraîchies par la suite, surtout après que Hitler ait prêté le “serment de légalité” en octobre 1930 devant la Cour du Reich à Leipzig: «Je prête ici le serment devant Dieu Tout-Puissant. Je vous dis que lorsque je serai arrivé légalement au pouvoir, je créerai des tribunaux d'Etat sous le houlette d'un gouvernement légal, afin que soient jugés selon les lois les responsables du malheur de notre peuple». A cela s'ajoute que Jünger et Hitler ne jugeaient pas de la même façon la question des attentats à la bombe perpétrés par le mouvement paysan du Landvolk dans le Schleswig-Holstein.
Jünger critiquait Hitler et son mouvement parce qu'ils étaient trop peu radicaux; au bout de quelques années, l'écrivain jugeait finalement le condottiere politique comme un «Napoléon du suffrage universel» (6). Pourtant, ils restaient tous deux d'accord sur l'objectif final: le combat inconditionnel contre le Diktat de Versailles et aussi contre la décadence libérale, ce qui impliquait la destruction du système de Weimar.
Jünger: «Nous nous sommes mobilisés de la façon la plus extrême dans cette grande et glorieuse guerre pour défendre les droits de la Nation, nous nous sentons aujourd'hui aussi appelés à combattre pour elle. Tout camarade de combat est le bienvenu. Nous constituons une unité de sang, d'esprit et de mémoire, nous sommes “l'Etat dans l'Etat”, la phalange d'assaut, autour de laquelle la masse devra serrer les rangs. Nous n'aimons pas les longs discours, une nouvelle centurie qui se forge nous apparait plus importante qu'une victoire au Parlement. De temps à autre, nous organisons des fêtes, afin de laisser le pouvoir parader en rangs serrés, et pour ne pas oublier comment on fait se mouvoir les masses. Des centaines de milliers de personnes viennent d'ores et déjà participer à ses fêtes. Le jour où l'Etat parlementaire s'écroulera sous notre pression et où nous proclamerons la dictature nationale, sera notre plus beau jour de fête» (7). Mais quand un parti national a réellement pris le pouvoir et renverser le système de Weimar, Jünger s'est arrogé le droit de dire oui ou non au cas par cas, face à ce qui se déroulait en face de lui.
En 1982, Jünger répond à une question qui lui demandait ce qu'il reprochait réellement à Hitler: «Son attitude résolument contraire au droit après 1938. Je suis encore pleinement d'accord avec Hitler pour sa politique dans les Sudètes et pour son Anschluß de l'Autriche. Mais j'ai reconnu bien vite le caractère de Hitler...» (8). Le souci de Jünger était le salut du Reich et non pas le sort d'une personne. Un an après l'effondrement du national-socialisme, il écrit: «... Peu d'hommes dans les temps modernes n'ont suscité autant d'enthousiasme auprès des masses, mais aussi autant de haine que lui. Quand j'ai entendu la nouvelle de son suicide, un poids m'est tombé du cœur; parfois j'ai craint qu'il ne soit exposé dans une cage dans une grande ville étrangère. Cela, au moins, il nous l'a épargné» (9).
2. Le «nouveau nationalisme»
Favorisé par ses hautes décorations militaires, gagnées lors de la première guerre mondiale, ainsi que par la notoriété de ses livres de guerre, Jünger est devenu la figure sympbolique du «nouveau nationalisme». Autour de ce concept, se sont rassemblés entre 1926 et 1931 quelques revues, dans lesquelles Jünger non seulement écrit de nombreux articles, mais dont il est le co-éditeur. Ces revues s'appellent Standarte, Arminius, Der Vormarsch et Die Kommenden. Les autres éditeurs étaient Franz Schauwecker, Helmut Franke, Wilhelm Weiss, Werner Lass, Karl O. Paetel, etc. Parmi les autres auteurs de ces publications, citons, par exemple, Ernst von Salomon, Friedrich Hielscher, Friedrich Wilhelm Heinz, Hanns Johst, Joseph Goebbels, Konstantin Hierl, Ernst von Reventlow, Alfred Rosenberg et Werner Best. Au cours de ces dernières années de la République de Weimar, il est typique de noter que ces “Rebelles”, situés entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche, se sont rencontrés en permanence avec des “Communards” officiels ou oppositionnels, ou avec des nationaux-socialistes fidèles ou hostiles au parti. Parmi ces cercles obscurs de débats, il y avait la «Gesellschaft zum Studium der russischen Planwirtschaft» (= Société pour l'étude de l'économie planifiée russe). On espérait là surtout apprendre l'opinion d'Ernst Jünger.
 Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. On s'étonne aujourd'hui de constater comme étaient variés et différents les caractères et les types humains de ces idéologues du «nouveau nationalisme». Tous étaient unis par un sentiment existentiel, celui du “réalisme héroïque”, terme qu'a utilisé maintes fois Ernst Jünger pour définir l'attitude fondamentale de sa vision du monde (10). De fait, une telle attitude se retrouve chez la plupart des théoriciens de cette époque, y compris, par exemple, chez un Oswald Spengler (Preußentum und Sozialismus, Der Neubau des Deutschen Reiches), Arthur Moeller van den Bruck (Das Dritte Reich) et Edgar Julius Jung (Die Herrschaft der Minderwertigen).
Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. On s'étonne aujourd'hui de constater comme étaient variés et différents les caractères et les types humains de ces idéologues du «nouveau nationalisme». Tous étaient unis par un sentiment existentiel, celui du “réalisme héroïque”, terme qu'a utilisé maintes fois Ernst Jünger pour définir l'attitude fondamentale de sa vision du monde (10). De fait, une telle attitude se retrouve chez la plupart des théoriciens de cette époque, y compris, par exemple, chez un Oswald Spengler (Preußentum und Sozialismus, Der Neubau des Deutschen Reiches), Arthur Moeller van den Bruck (Das Dritte Reich) et Edgar Julius Jung (Die Herrschaft der Minderwertigen).
Jünger voulait se joindre à cette phalange olympienne en publiant à son tour une sorte d'“ouvrage standard”. Dans la publicité d'un éditeur, on découvre l'annonce d'un livre de Jünger qui se serait intitulé Die Grundlage des Nationalismus, mais qui n'est jamais paru. Si le livre avait été imprimé, il serait aujourd'hui sans nul doute la source par excellence. L'ouvrage aurait aussi dû comporter un essai intitulé «Nationalismus und Nationalsozialismus», qui n'est paru qu'en 1927 dans la revue Arminius. Le comble dans cet essai, c'est la proposition de faire du national-socialisme un instrument de l'action politique pratique («dans le mouvement de Hitler se trouve plus de feu et de sang que la soi-disant révolution a été capable de susciter au cours de toutes ses années»), et de faire du nationalisme, que Jünger réclamait pour lui, le laboratoire idéologique. Dès 1925, Jünger exhortait dans son appel «Schließt euch zusammen!» (Resserrez les rangs!), les groupes rivaux à former un «Front nationaliste final» (11). Mais ce front n'a jamais vu le jour, «l'appel est resté sans écho, s'est évanoui dans les discours mesquins des secrétaires d'association qui voulaient absolument avoir le dernier mot» (Karl O. Paetel).
Au fur et à mesure que son aversion contre la démocratie grandissait, son refus de Hitler augmentait aussi. Tandis que ces hérétiques développaient entre eux un grand nombre de «thèses spéciales sur le nationalisme», tant et si bien qu'aucune unité réelle ne pouvait émerger, la NSDAP de Hitler courait de victoire électorale en victoire électorale. En formulant et en fignolant leurs spéculations, beaucoup d'intellectuels du «nouveau nationalisme» avaient vraiment perdu le contact avec les réalités. Ernst von Salomon décrit les faiblesses du nationalisme théorique de façon fort colorée dans son Questionnaire: «... On n'insistera jamais assez pour dire que les émotions intellectuelles de ces hommes combattifs appartenant au “nouveau nationalisme” se sont évanouies en silence. Outre le nombre ridiculement faible d'abonnés à ces quelques revues, personne ne les remarquait, et nous atteignions un degré élevé d'excitation, quand, par hasard, un grand quotidien de la capitale, évoquait en quelques lignes l'une ou l'autre production de l'un d'entre nous» (12).
3. Le Dr. Goebbels
Les rapports entre Jünger et le Dr. Joseph Goebbels méritent un chapitre particulier. Les deux hommes se rencontraient à l'occasion dans les sociétés berlinoises patronnées par Arnolt Bronnen ou dans des soirées privées entre nationaux-révolutionnaires. Dans la plupart des cas, ils s'échangeaient des coups de bec ou des boutades cyniques. Jünger fit comprendre à Goebbels qu'il préférait de loin le type du «soldat-travailleur prusso-allemand» que celui du «petit bourgeois en chemise brune» qui proliférait dans les rangs de la NSDAP et des SA. Plusieurs décennies plus tard, Jünger se souvient: «... Goebbels m'invita. Notamment en 1932 à assister à l'un de ses discours, devant des travailleurs à Spandau. Je n'ai pas attendu la fin de son discours, je suis sorti avant, et j'ai appris plus tard qu'il y avait eu une formidable bagarre dans la salle. Goebbels était déçu: nous avons donné à cet Ernst Jünger une place d'honneur, mais quand ça a commencé à chauffer et que les chaises ont volé, il n'était plus là. Goebbels oubliait intentionnellement de dire que j'avais vécu de toutes autres batailles que cette bagarre de salle» (13).
Dans ces journaux, Goebbels fait souvent part de sa déception à l'égard de Jünger, qu'il aurait bien voulu voir adhérer à la NSDAP. Le 20 janvier 1926, le futur ministre de la propagande écrivait: «... Je viens de terminer hier la lecture des Orages d'acier d'Ernst Jünger. C'est un grand livre, brillant. La puissance de son réalisme suscite en nous de l'épouvante. De l'allant. De la passion nationale. De l'élan. C'est le livre allemand de la guerre. C'est un homme de la jeune génération qui prend la parole pour nous parler de la guerre, événement profond pour l'âme, et qui réalise un miracle en nous décrivant ce qui se passe dans son intériorité. Un grand livre. Derrière lui, un gaillard entier». Cinq mois plus tard, on perçoit déjà une déception: «... me suis préoccupé du “nouveau nationalisme” des Jünger, Schauwecker, Franke, etc. On parle et on passe à côté des vrais problèmes. Et il y manque la chose la plus importante, en dernière instance: la reconnaissance de la mission du prolétariat» (Goebbels, Journaux, 30 juin 1926).
Trois ans plus tard, Goebbels rejette définitivement Jünger: «... Mes lectures: Das abenteuerliche Herz de Jünger. Ce n'est plus que de la littérature. Dommage pour ce Jünger, dont je viens de relire les Orages d'acier. Ce livre était vraiment une grand livre, un livre héroïque. Parce que derrière lui, il y avait un vécu de sang, un vécu total. Aujourd'hui, Jünger s'enferme et se refuse à la vie, et ses écrits ne sont plus qu'encre, que littérature» (Goebbels, Journaux, 7 octobre 1929). Ce règlement de compte durera jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich, quand, en dernière instance, Goebbels interdit à la presse allemande, de faire mention du cinquantième anniversaire de Jünger.
4. Le retrait
Hans-Peter Schwarz écrit dans son livre consacré à Jünger, Der Konservative Anarchist: «... Un phénomène qui mérite réflexion: dans les années 1925-1929, quand aucun observateur objectif n'aurait donné la moindre chance au nationalisme révolutionnaire en Allemagne, Jünger a joué le héraut de cette idée, mais quand, coup de sort fatidique, un Etat nationaliste, socialiste, autoritaire et capable de se défendre, a commencé à s'imposer, avec une évidence effrayante, ses intérêts pour les activités concrètes diminuent à vue d'oeil. En effet, après les élections de septembre 1930, il n'y avait plus qu'un seul mouvement politique qui pouvait revendiquer le succès et prétendre réaliser cette vision de l'Etat: la NSDAP d'Adolf Hitler» (14).
Le retrait de Jünger hors de la politique n'était pas dû immédiatement à la montée en puissance de la NSDAP. Plusieurs facteurs ont joué leur rôle. Parmi eux, le résultat de ses études sur le fascisme italien. Le fascisme n'aurait, à ses yeux, plus rien été d'autre «qu'une phase tardive du libéralisme, un procédé simplifié et raccourci, simultanément une sténographie brutale de la conception de l'Etat des libéraux, qui, pour le goût moderne, est devenue trop hypocrite, trop verbeuse et surtout trop compliquée. Le fascisme tout comme le bolchévisme ne sont pas faits pour l'Allemagne: ils nous attirent, nous séduisent, sans pourtant pouvoir nous satisfaire, et on doit espérer pour notre pays qu'il soit capable de générer une solution plus rigoureuse» (15). Jünger a-t-il deviné cette évolution pour le Reich?
Avec l'installation de Jünger à Berlin, commence son retrait. Depuis lors, il n'a plus cessé de se donner le rôle d'un observateur à distance. Dès le déclin des revues Vormarsch et Die Kommenden dans les années 1929 et 1930, il abandonne très ostensiblement la rédaction d'articles politiques. En se rémémorant cette tranche de sa vie, il a commenté le travail éditorial comme suit: «Les revues sont comme des autobus, on les utilise, tant qu'on en a besoin, et puis on en sort». Et: «On ne peut plus se soucier de l'Allemagne en société aujourd'hui; il faut le faire dans la solitude, comme un homme qui ouvrirait des brèches à l'aide d'un couteau dans la forêt vierge et qui n'est plus porté que par un espoir: que d'autres, quelque part sous les frondaisons, procèdent au même travail» (16). Jünger avait perçu que ses activités de politique quotidienne n'avaient plus de sens; il se consacrait de plus en plus à ses livres. Des ouvrages tels Das abenteuerliche Herz, Der Arbeiter et Die totale Mobilmachung (dont on n'a malheureusement retenu qu'un slogan) l'ont rendu célèbre en dehors des cercles étroits qui s'intéressaient à la politique.
Autre motif justifiant sans doute le retrait de Jünger: son amitié avec le national-bolchévique Ernst Niekisch, dont la revue, Widerstand, avait publié quelques articles de Jünger. Niekisch était un solitaire de la politique, fantasque et excentrique, mis sur la touche par l'Etat national-socialiste, pour des raisons de sécurité intérieure (sans avec raison, du point de vue des nouvelles autorités). Dans un article intitulé «Entscheidung» (= Décision), Niekisch plaide très sérieusement pour «l'injection de sang slave dans les veines allemandes, afin de guérir la germanité des influences romanes venues d'Europe du Sud et de l'Ouest». Ou: «... Celui qui vit conscient de sa responsabilité pour le millénaire d'histoire et de destin allemands à venir, ne s'effondre pas, effrayé, devant les remous d'une migration des peuples, s'il n'y a pas d'autre voie pour nous conduire à une nouvelle grandeur allemande» (17). Cette idée bizarre ne nécessite pas de commentaires de ma part. Mais Jünger n'était sans doute pas attiré par l'orientation à l'Est, prônée par Niekisch, ou par son anti-capitalisme lapidaire; ce qui l'attirait secrètement chez cet homme inclassable, c'est l'opiniâtreté avec laquelle il défendait la «pureté de l'idée».
Comme s'il voulait clarifier les choses pour lui-même, Jünger, dans Les Falaises de marbre (qui contiennent des traits auto-biographiques incontestables), nous expliquer pourquoi il a été travaillé par un désir de participer à la politique active: «Il y a des époques de déclin, pendant lesquelles la forme s'estompe, la forme qui est un indice très profond, très intériorisé, de la vie. Lorsque nous nous enfonçons dans ses phases de déclin, nous errons dans tous les sens, titubants, comme des êtres à qui manque l'équilibre... Nous voguons en imagination dans des temps reculés ou dans des utopies lointaines, où l'instant s'estompe... C'est comme si nous sentions la nostalgie d'une présence, d'une réalité et comme si nous avions pénétré dans la glace, le feu et l'éther, pour échapper à l'ennui».
5. La «zone des balles dans la nuque»
La rupture définitive entre les nationaux-socialistes et Jünger a eu lieu après la parution de Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (1932). Dans bon nombre d'écrits nationaux-socialistes, ce livre a été critiqué avec une sévérité inouïe; il se serait agi d'un «bolchévisme crasse». Thilo von Trotha écrivit dans le Völkischer Beobachter: «... Eh oui! Les voilà, les interminables parlottes de la dialectique! On joue pendant trois cents pages avec tous les concepts possibles et imaginables, on les répète indéfiniment, on accumule autant de contradictions et, à la fin, il ne reste, surtout pour notre jeune génération, qu'une énigme insaisissable: comment un soldat du front comme Ernst Jünger a-t-il pu devenir cet homme qui, sirotant son thé et fumant ses cigarettes, acquiert une ressemblance désespérante avec ces intellectuels russes de Dostoïevski qui, pendant des nuits entières, discutent et ressassent les problèmes fondamentaux de notre monde». Thilo von Trotha ajoute, que Jünger ne voit pas «la question fondamentale de toute existence, ..., le problème du sang et du sol». En Jünger, pense von Trotha, s'accomplit la tragédie d'une homme «qui a perdu la voie vers les fondements promordiaux de tout Etre». Conclusion de von Trotha: ce n'est pas l'ère du Travailleur qui est en train d'émerger, mais l'ère de la race et des peuples.
Pourtant, malgré cette critique sévère et violente, von Trotha affirme que Jünger reste «un des meilleurs guerriers de sa génération», mais c'est pour ne pas lui pardonner son attitude fondamentalement individualiste: «... [les littérateurs nationaux-révolutionnaire, note de W.B.] passent leur existence à côté du grand courant de la vie allemande, marqué par le sang; ils cherchent toujours des adeptes mais restent condamnés à la solitude, à demeurer face à eux-mêmes et à leurs constructions, dans leur tour d'ivoire... et on observera sans cesse et avec étonnement qu'ils continuent à vouloir représenter la jeunesse allemande, en méconnaissant les faits réels, de façon tout-à-fait incompréhensible. L'“élite spirituelle” de la jeunesse allemande n'est pas littéraire, elle suit fidèlement le véritable Travailleur et le véritable Paysan: Adolf Hitler» (18). La critique atteint son sommet dans une formulation pleine de fantaisie: Jünger se rapprocherait, avec son ouvrage, de la «zone des balles dans la nuque». Dans la conclusion d'un article d'Angriff, un journal animé par Goebbels, on trouve une phrase plus concrète et plus mesurée, mais néanmoins exterminatrice: «Monsieur Jünger, avec cet ouvrage, est fini pour nous».
Ces critiques émanent pourtant des nationaux-socialistes les plus intelligents; mais elles ne tombaient du ciel, par hasard. Elles reflètent un constat politique posé dorénavant pas les autorités du parti: les nationaux-révolutionnaires sont rétifs à toute discipline de parti et veulent mener une vie privée opposée aux critères édictés par les nationaux-socialistes. Friedrich Hielscher dans son livre autobiographique Fünfzig Jahre unter Deutschen (= «Cinquante ans parmi les Allemands») évoque quelques anecdotes de l'époque. Nous y apprenons que la vie privée de nombreux “nationaux-révolutionnaires” ne respectait aucun dogme ni aucune rigueur comportementale. Ainsi, au cœur de l'hiver très froid de 1929, cette joyeuse bande s'était réunie dans l'appartement de Jünger à Berlin. Aux petites heures, ils buvaient tous du rhum dans des tasses de thé et voilà que le poêle vient à s'éteindre faute de bois. Jünger, sans hésiter, casse à coups de pied une vieille commode de son propre mobilier, la démonte et en empile les morceaux près du feu, permettant ainsi à la compagnie de gagner encore un peu de chaleur et de confort» (19).
6. Dans le Royaume de Léviathan
A cette époque, les critiques des nationaux-socialistes ne touchaient plus Jünger. Il s'était bien trop éloigné de la politique quotidienne. La “révolution nationale” de janvier 1933 ne lui avait fait aucun effet. La réalité du IIIième Reich n'était pour lui que les ultimes soubresauts du monde bourgeois, n'était qu'une “démocratie plébiscitaire», dernière conséquence néfaste des «ordres nés de 1789» (20). Pour pouvoir poursuivre son travail dans l'isolement, il quitte Berlin et s'installe à Goslar. Avant ce départ, le nouvel Etat ne put s'empêcher de commettre quelques perquisitions chez la famille Jünger.
Sur l'une de ces perquisitions, un écho est passé dans la presse de l'époque; dans les Danziger Neuesten Nachrichten du 12 avril 1933, on peut lire: «Comme on l'a appris par la suite, sur base d'une dénonciation, il a été procédé à une perquisition au domicile de l'écrivain nationaliste Ernst Jünger, qui a gagné au feu, en tant qu'officier, l'Ordre Pour le Mérite pendant la guerre mondiale, qui a écrit plusieurs livres sur cette guerre, parmi lesquels un ouvrage de grand succès, Orages d'acier, et qui, dans son dernier livre de sociologie et de philosophie, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, se réclame d'idées collectivistes. La perquisition n'a pas permis de découvrir objets ou papiers compromettants». La dernière livraison de la revue Sozialistische Nation n'épargnait pas ses sarcasmes: «... On n'a rien trouvé, si ce n'est l'Ordre Pour le Mérite». Jünger ne laissa planer aucun doute: il fit savoir clairement qu'il n'entendait participer d'aucune façon aux activités culturelles du Troisième Reich, comme auparavant à celles de la République de Weimar. Ses lettres de refus à l'Académie des Ecrivains de Prusse sont devenues célèbres, de même que sa réponse brève et sèche à la Radio publique de Leipzig, qui l'avait invité pour une émission. Il souhaitait tout simplement «ne pas participer à tout cela». Le 14 juin 1934, il écrit à la rédaction du Völkischer Beobachter: «Dans le supplément “Junge Mannschaft” du Völkischer Beobachter des 6 et 7 mai 1934, j'ai constaté que vous aviez reproduit un extrait de mon livre Das abenteuerliche Herz. Comme cette reproduction ne comporte aucune mention des sources, on acquiert l'impression que j'appartiens à votre rédaction en tant que collaborateur. Ce n'est pas le cas: depuis des années je n'utilise plus la presse comme moyen [d'expression]. Dans ce cas particulier, il convient encore de souligner que nous sommes face à une incongruité: d'une part, la presse officielle m'accorde le rôle d'un collaborateur attitré, tandis que, d'autre part, on interdit par communiqué de presse officiel la reproduction de ma lettre à l'Académie des Ecrivains du 18 novembre 1933. Je ne vise nullement à être cité le plus souvent possible dans la presse, mais je tiens plutôt à ce qu'il ne subsiste pas la moindre ambigüité quant à la nature de mes convictions politiques. Avec l'expression de mes sentiments choisis, Ernst Jünger».
Fait significatif: de 1933 à 1945, Ernst Jünger n'a pas reçu la moindre distinction honorifique ou bénéficié du moindre hommage officiel. «... Ne trouvez-vous pas curieux que je n'ai pas obtenu le moindre prix sous le IIIième Reich, alors qu'on prétend que j'aurais été si précieux pour les nazis. Si tel avait été le cas, j'aurais été couvert de prix et de distinctions», remarque Jünger près de soixante ans après les événements.
La vie de Jünger fut relativement paisible de 1934 à la guerre. Nous lui devons plusieurs livres immortels, datant de cette période, pendant laquelle il a consolidé son constat: le national-socialisme a sa phase héroïque derrière lui. Sans retour. Qu'en restait-il? Sa prédilection pour les structures hiérarchiques, clairement délimitées. En 1982, Jünger reconnaissait: «Certes, j'ai un faible pour les systèmes d'ordre, pour l'Ordre des Jésuites, pour l'armée prussienne, pour la Cour de Louis XIV... De tels ordres m'en imposent» (22).
Ernst Jünger est resté fidèle à lui-même pendant toute son existence. C'est ainsi que Karl O. Paetel, jadis militant “nationaliste social-révolutionnaire”, dans une excellent biographie consacrée à son ami immédiatement après la dernière guerre, répond aux critiques de façon définitive, pour les siècles des siècles: «Le guerrier est-il devenu pacifiste? L'admirateur de la technique, un ennemi du progrès technique? Le nihiliste, un chrétien? Le nationaliste, un bourgeois cosmopolite? Oui et non: Ernst Jünger est devenu dans une certaine mesure le deuxième homme sans jamais cesser d'être le premier. A aucune étape dans le cheminement de son existence, Ernst Jünger ne s'est converti, jamais il n'a brûlé ce qu'il adorait hier. Les transformations ne sont pas rejets chez lui, mais fruits d'acquisitions, d'élargissements d'horizons, de complètements; il ne s'agit jamais de se retourner, mais de poursuivre le même chemin en mûrissant, sans se fixer dans les aires de repos. C'est ainsi que Ernst Jünger a trouvé son identité, est devenu le diagnostiqueur de notre temps, éloigné de tout dogme dans son questionnement comme dans les réponses qu'il suggère».
Werner BRÄUNINGER.
Notes:
(1) Ernst JÜNGER, «Reinheit der Mittel», in Die Kommenden, 27 déc. 1929.
(2) Ernst JÜNGER, Strahlungen. Die Hütte im Weinberg. Jahre der Okkupation, p. 615 (éd. DTV, 1985).
(3) Ernst JÜNGER, «Abgrenzung und Verbindung», in Standarte, 13 sept. 1925.
(4) (5) (6) Voir remarque 2, p. 612, 617 et 444 (Jünger cite ici un mot de Valeriu Marcu).
(7) Ernst JÜNGER, «Der Frontsoldat und die innere Politik», in Standarte, 29 nov. 1925.
(8) Ernst JÜNGER, Interview accordé à Der Spiegel, n°33/1982.
(9) Voir rem. 2, p. 616.
(10) La formule «réalisme héroïque» provient de l'article «Der Krieg und das Recht» du Dr. Werner Best (publié dans le volume collectif Krieg und Krieger, édité par Ernst Jünger à Berlin en 1930). Quant à savoir si cette formule, utilisée par Jünger, provient originellement de Best, rien n'est sûr à 100%.
(11) Ernst JÜNGER, «Schließt Euch zusammen», in Die Standarte, 3 juin 1926.
(12) Ernst von SALOMON, Der Fragebogen, p. 244 (7), 1952.
(13) voir rem. 8.
(14) Hans-Peter SCHWARZ, Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers, Verlag Rombach, 1982, p. 107.
(15) Ernst JÜNGER, «Über Nationalismus und Judenfrage», Süddeutsche Monatshefte, 27, n°12, 1930.
(16) Ernst JÜNGER, Das abenteuerliche Herz.
(17) Ernst NIEKISCH, Entscheidung, p. 180 ss.
(18) Ex Völkischer Beobachter (édition bavaroise), 22 oct. 1932.
(19) Description de mémoire de Werner Bräuninger, ex: Friedrich HIELSCHER, Fünfzig Jahre unter Deutsche, Rowohlt Verlag, 1950.
(20) Ernst JÜNGER, Strahlungen. Kirchhorster Blätter, p. 298 (DTV n°10.985).
(21) (22) Voir rem. 8.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, années 20, années 30, histoire, nationalisme révolutionnaire, national-socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 décembre 2009
Oswald Spengler - Der optimistische Pessimist
| Oswald Spengler – Der optimistische Pessimist |
| Geschrieben von: Daniel Bigalke | |
| Ex: http://www.blauenarzisse.de/
| |
|
Spengler war mehr als der pessimistische Prophet des Untergangs: Er war Dichterphilosoph, Visionär, Tatsachenmensch und Außenseiter. Als dieser ergriff er Partei gegen die Nationalsozialisten, um nach Hitlers Vorgehen z.B. gegen Edgar J. Jung und gegen die konservative Opposition am 30. Juni 1934 Ekel gegenüber der Geistlosigkeit des „braunen Haufens“ zu empfinden. Spenglers Werk ordnet sich charakteristisch in die deutsche Geistesgeschichte überhaupt ein. Man erkennt dies an den darin vorkommenden Dualitäten: Ambivalenz zwischen Politischem und Unpolitischem, Kultur und Zivilisation, Pessimismus und Aktivismus, dogmatischer Religiosität und tieferer Spiritualität. Spengler, geboren im anhaltinischen Blankenburg, verstand sich als Überwinder des eurozentrischen Weltbildes. Die abendländische Kultur habe ihren Höhepunkt erreicht. Als Zivilisation, der Ära des entgrenzten und mit mächtigen exekutiven Befugnissen ausgestatteten Cäsarismus, gerate ihr Demokratismus zur Farce bloßer Parolen, die vom Pfad freiheitlicher Ansprüchen abgekommen ist. Damit personifiziert Spengler eine geistige und politische Zeitenwende, wie wir sie heute nach dem 11. September 2001 ähnlich erleben. Der Parteienstaat erhält sich durch trockene Parolen, die Staatsexekutive überwacht wesentliche Lebensbereiche. Ihre demokratistische Ideologie gerät zum zivilreligiösen Dogma und ruft zugleich die politische Fundamentalopposition auf den Plan.Spengler selbst ging es um einen oppositionellen Genius, der urteilsfähig und mit ganzheitlichem Bewußtsein ausgestattet den profanen Parteihader überwindet. Ob Spengler damit heute Parteigänger eines politischen „Extremismus“ wäre, muß dahingestellt bleiben. Allein formale Begriffe und diskriminierende Kategorien können das Wesen der Welt nicht umfassend erschließen. Spengler stand an der Wegegabelung von ideellem Überbau und kreativem Ekel an der Realität. Womöglich war es jener Zwiespalt, der seine reifen Urteile ermöglichte, die in seinem Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“ artikuliert werden. Konservative Revolution und aktive Metapolitik Edgar Julius Jung (1894-1934), Verfasser der am 17. Juni 1934 von Franz von Papen gehaltenen Marburger Rede vor Studenten, welche für Jung zum tödlichen Verhängnis werden sollte, schrieb noch kurz vor seiner Ermordung über den zurückgezogenen Spengler: „Persönlich Stolzeres und menschlich doch Weheres, aber auch sachlich Gerechteres und geschichtlich Gültigeres dürfte in den letzten 15 Jahren kaum von einem zweiten Zeitgenossen deutscher Zunge geschrieben worden sein.“ Der „Untergang des Abendlandes“ ist mehr als nur eine Kulturphilosophie, er ist in hohem Maße Träger einer politischen Botschaft, im Kern ein geschichtsspekulatives System, welches deutsche Denker nach Hegel wohl kaum wieder derartig in Angriff nahmen. Spengler war ein unpolitischer Intellektueller, der sich abseits der Politik hielt und sein Heil in höheren Sphären suchte.
In intellektueller und sozialer Hinsicht kann man ihn vor 1918, vor Erscheinen dieses Buches, als einen „declassé“ betrachten, bis er schließlich nach Erscheinen desselben in ein verzweigtes Netzwerk industrieller, politischer und paramilitärischer Kreise aufgenommen wurde, das sich in drei Machtzentren des Deutschen Reiches konzentrierte: Berlin, Ruhrgebiet, München. In ihm weitete Spengler seine „konservativ-revolutionäre“ Geisteshaltung aus und praktizierte gleichsam aktive Metapolitik. Metapolitik möchte mit dem Schaffen eines geistig-kulturellen Überbaus auf das politische Geschehen einwirken, ohne sich in tagesaktuellen Debatten zu verlieren. So gilt die Einkehr ins eigene Innere als Notwendigkeit für ein Wirken in der Welt. Wissen und gar Weisheit ist nicht von denen zu erwarten, die nicht auch ernsthaft an sich selbst gearbeitet, eigene Motivationen und Leidenschaften erkannt und in ihren Konsequenzen reflektiert und optimiert haben. Metapolitik artikuliert neue politische Methoden und Inhalte. Sie reflektiert, was hinter der Politik steht. Wenn Metapolitik auf existentielle Erfahrungen und Beobachtungen, wie die Furcht vor einem neuerlichen Zusammenbruch einer haltgebenden Ordnung, zurückgreift, dann kann dies ganz neue, tiefgründige Zusammenhänge erschließen und kann das Krisenbewußtsein schärfen. Der Schlüssel zum Verständnis des „Untergangs des Abendlandes“ Spengler war sensibel für soziale und kulturelle Entwicklungen in Deutschland. Sein Kulturpessimismus umschließt die Dekadenz und das Spätzeitbewußtsein, die gespannte Beziehung zwischen Geist, Macht und Modernitätskrise. Seine persönlichen Enttäuschungen und Ressentiments kehrten sich gegen die Kultur und deren offizielle Repräsentanten. Spenglers eigene Tragödie als Mensch trug alle Farben seiner Zeit: “...den Kult des einsamen, des Fremdlings (...), die Begierde zu leiden, den Narzismus der Schwarzen Romantik. (...) Er versteht: es gibt keine Erkenntnis, kein Glück (...), es gibt nur Werden und Wollen.” So schrieb Koktanek in seiner Biographie von 1968. Spengler entzog sich aber auch im „Untergang“ nicht den direkt politischen Inhalten. Er kompensierte seine innere Zerrissenheit und sein Unvermögen tatsächlicher Teilhabe am Leben durch seine Mystik, durch sein allumfassendes Lebensprinzip, schlichtweg durch seine Lebensphilosophie. Er bezweckte damit die Verschiebung deutscher Mentalitäten nach seinen Ambitionen, um der Gefährdung der tradierten Kultur durch Massenhaftigkeit, Mechanisierung und durch Ökonomismus entgegenzuwirken. Wissenschaft konnte Gesetze erweisen, aber nicht die ersehnte Gewißheit erzeugen. Der „Untergang“ ist ein Werk, welches diese Gewißheit zu schaffen in Angriff nahm. Die Zeitenwende Spengler spürte darin die Polaritäten des Lebens: Ich und Welt, Mikrokosmos und Makrokosmos, das Eigene und das Fremde, Geburt und Weltangst. So betrachtet er das Leben aus der Perspektive des Geworfenseins: „Ein Denker ist ein Mensch, dem es bestimmt war, durch das eigene Schauen und Verstehen die Zeit symbolisch darzustellen. Er hat keine Wahl. Er denkt, wie er denken muß, und wahr ist für ihn, was als Bild seiner Welt mit ihm geboren wurde.“ Seine konservative Weltanschauung trug die Konturen einer politischen Haltung, die weniger durch einen streng wissenschaftlichen sondern vielmehr durch einen poetisch-intuitiven Zugriff gegen die verhaßte Entseelung seiner Zeit ankämpfte. Die Konzentration auf mythische Phänomene, die Wahrnehmung des künftig Notwendigen und der Drang, all jenes politisch mitzuteilen, führten zu einer spezifischen Motivation und zu einer einmaligen Ausdrucksweise, wie sie sich nur bei Spengler findet. Konservative Weltanschauung durch einen poetisch-intuitiven Zugriff Die „Konservativen Revolutionäre“, darunter Spengler, können als die geistige Vorhut auf der Suche nach neuen Sicherheiten verstanden werden. Spengler entwickelte darunter eine antiintellektuelle und vitalistische Lebensphilosophie. Er wurde konfrontiert mit der Entstehung eines neuen Mittelstandes, der sich zusehends über Massenpolitik und Interessenverbände zu artikulieren wußte. Dadurch entstand der Druck auf die konservative Elite, die – zu recht – einstige Kulturideale wie Harmonie zwischen Innerlichkeit und Welt, Formkraft und Beseelung sowie Metaphysik verloren gehen sah oder, um mit Spengler zu reden, diese zur „Zivilisation“ erstarren sah. Daraus resultiert kompensatorisch eine überspannt subjektive Weltdeutung, die der eigenen Intuition mehr vertraut als wissenschaftlichen Methoden. Die Denker der „Konservativen Revolution“ hatten ein solches Bewußtsein, welches in Anlehnung an Kants transzendentale Wende und Fichtes Subjektphilosophie als jenes Bewußtsein gekennzeichnet werden kann, das mehr denn je das „Spezifisch Deutsche“ im Denken war und ist. Eine fortschreitende Entzweiung des Lebens wurde befürchtet. Dabei ging es den Deutschen, wie aus heutiger Sicht leichtfertig behauptet, nicht um eine konservative Verlängerung der linken Gesellschaftskritik, sondern vielmehr um die praktische Handhabung gesellschaftlicher und sozialer Umbrüche in Deutschland, welchen man eine deutsche Geistes- und Politikalternative entgegenstellte. In Deutschland eben leisteten sich damals wie heute die Gebildeten fern der politischen Praxis die Radikalität des reinen Gedankens. Das macht die deutsche Besonderheit aus. Georg Quabbe, auch „Konservativer Revolutionär“, hätte dazu gesagt: So sind wir! Und deshalb handeln wir danach! Wir können Spengler einen optimistischen Pessimisten nennen, der wenig von der „demokratischen“ Litanei oberflächlicher Unverbindlichkeit hielt, sondern seine Hände unter emotionaler Wahrnehmung des existenziellen Fundamentalcharakters des Lebens strapazierte und beschmutzte, um eine demgemäße politische Ordnung zu schaffen. Es bleibt zu hoffen, daß innovative Menschengruppen zu dieser Kategorie Mensch aufsteigen. |
00:14 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : spengler, weimar, allemagne, philosophie, pessimisme, optimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 décembre 2009
Armin Mohler: discipulo de Sorel e teorico da vida concreta
 Armin Mohler: discípulo de Sorel e teórico da vida concreta
Armin Mohler: discípulo de Sorel e teórico da vida concreta
Ex: http://europapatrianostra.wordpress.com/
O “mito”, como a “representação de uma batalha”, surge espontaneamente e exerce um efeito mobilizador sobre as massas, incute-lhes uma “fé” e torna-as capazes de actos heróicos, funda uma nova ética: essas são as pedras angulares do pensamento de Georges Sorel (1847-1922). Este teórico político, pelos seus artigos e pelos seus livros, publicados antes da primeira guerra mundial, exerceu uma influência perturbante tanto sobre os socialistas como sobre os nacionalistas.
Contudo, o seu interesse pelo mito e a sua fé numa moral ascética foram sempre – e continuam a sê-lo apesar do tempo que passa – um embaraço para a esquerda, da qual ele se declarava. Podemos ainda observar esta reticência nas obras publicadas sobre Sorel no fim dos anos 60. Enquanto algumas correntes da nova esquerda assumiram expressamente Sorel e consideravam que a sua apologia da acção directa e as suas concepções anarquizantes, que reclamavam o surgimento de pequenas comunidades de “produtores livres”, eram antecipações das suas próprias visões, a maioria dos grupos de esquerda não via em Sorel mais que um louco que se afirmava influenciado por Marx inconscientemente e que trazia à esquerda, no seu conjunto, mais dissabores que vantagens. Jean-Paul Sartre contava-se assim, evidentemente, entre os adversários de Sorel, trazendo-lhes a caução da sua notoriedade e dando, ipso facto, peso aos seus argumentos.
Quando Armin Mohler, inteiramente fora dos debates que agitavam as esquerdas, afirmou o seu grande interesse pela obra de Sorel, não foi porque via nele o “profeta dos bombistas” (Ernst Wilhelm Eschmann) nem porque acreditava, como Sorel esperara no contexto da sua época, que o proletariado detivesse uma força de regeneração, nem porque estimava que esta visão messiânica do proletariado tivesse ainda qualquer função. Para Mohler, Sorel era um exemplo sobre o qual meditar na luta contra os efeitos e os vectores da decadência. Mohler queria utilizar o “pessimismo potente” de Sorel contra um “pessimismo debilitante” disseminado nas fileiras da burguesia.
Rapidamente Mohler criticou a “concepção idílica do conservantismo”. Ao reler Sorel percebeu que é perfeitamente absurdo querer tudo “conservar” quando as situações mudaram por todo o lado. A direita intelectual não deve contentar-se em pregar simplesmente o bom-senso contra os excessos de uma certa esquerda, nem em pregar a luz aos partidários da ideologia das Luzes; não, ela deve mostrar-se capaz de forjar a sua própria ideologia, de compreender os processos de decadência que se desenvolvem no seu seio e de se desembaraçar deles, antes de abrir verdadeiramente a via a uma tradução concreta das suas posições.
Uma aversão comum aos excessos da ética da convicção
Quando Mohler esboça o seu primeiro retrato de Sorel, nas colunas da revista Criticón, em 1973, escreve sem ambiguidades que os conservadores alemães deveriam tomar esse francês fora do comum como modelo para organizar a resistência contra a “desorganização pelo idealismo”. Mohler partilhava a aversão de Sorel contra os excessos da ética da convicção. Vimo-la exercer a sua devastação na França de 1890 a 1910, com o triunfo dos dreyfusards e a incompreensão dos Radicais pelos verdadeiros fundamentos da Cidade e do Bem Comum, vimo-la também no final dos anos 60 na República Federal, depois da grande febre “emancipadora”, combinada com a vontade de jogar abaixo todo o continuum histórico, criminalizando sistematicamente o passado alemão, tudo taras que tocaram igualmente o “centro” do tabuleiro político.
Para além destas necessidades do momento, Mohler tinha outras razões, mais essenciais, para redescobrir Sorel. O anti-liberalismo e o decisionismo de Sorel haviam impressionado Mohler, mais ainda do que a ausência de clareza que recriminamos no pensamento soreliano. Mohler pensava, ao contrário, que esta ausência de clareza era o reflexo exacto das próprias coisas, reflexo que nunca é conseguido quando usamos uma linguagem demasiado descritiva e demasiado analítica. Sobretudo “quando se trata de entender elementos ou acontecimentos muito divergentes uns dos outros ou de captar correntes contrárias, subterrâneas e depositárias”. Sorel formulou pela primeira vez uma ideia que muito dificilmente se deixa conceptualizar: as pulsões do homem, sobretudo as mais nobres, dificilmente se explicam, porque as soluções conceptuais, todas feitas e todas apropriadas, que propomos geralmente, falham na sua aplicação, os modelos explicativos do mundo, que têm a pretensão de ser absolutamente completos, não impulsionam os homens em frente mas, pelo contrário, têm um efeito paralisante.
Ernst Jünger, discípulo alemão de Georges Sorel
Mohler sentiu-se igualmente atraído pelo estilo do pensamento de Sorel devido à potencialidade associativa das suas explicações. Também estava convencido que este estilo era inseparável da “coisa” mencionada. Tentou definir este pensamento soreliano com mais precisão com a ajuda de conceitos como “construção orgânica” ou “realismo heróico”. Estes dois novos conceitos revelam a influência de Ernst Jünger, que Mohler conta entre os discípulos alemães de Sorel. Em Sorel, Mohler reencontra o que havia anteriormente descoberto no Jünger dos manifestos nacionalistas e da primeira versão do Coração Aventureiro (1929): a determinação em superar as perdas sofridas e, ao mesmo tempo, a ousar qualquer coisa de novo, a confiar na força da decisão criadora e da vontade de dar forma ao informal, contrariamente às utopias das esquerdas. Num tal estado de espírito, apesar do entusiasmo transbordante dos actores, estes permanecem conscientes das condições espacio-temporais concretas e opõem ao informal aquilo que a sua criatividade formou.
O “afecto nominalista”
O que actuava em filigrana, tanto em Sorel como em Jünger, Mohler denominou “afecto nominalista”, isto é, a hostilidade a todas as “generalidades”, a todo esse universalismo bacoco que quer sempre ser recompensado pelas suas boas intenções, a hostilidade a todas as retóricas enfáticas e burlescas que nada têm a ver com a realidade concreta. É portanto o “afecto nominalista” que despertou o interesse de Mohler por Sorel. Mohler não mais parou de se interessar pelas teorias e ideias de Sorel.
Em 1975 Mohler faz aparecer uma pequena obra sucinta, considerada como uma “bio-bibliografia” de Sorel, mas contendo também um curto ensaio sobre o teórico socialista francês. Mohler utilizou a edição de um fino volume numa colecção privada da Fundação Siemens, consagrado a Sorel e devida à pluma de Julien Freund, para fazer aparecer essas trinta páginas (imprimidas de maneira tão cerrada que são difíceis de ler!) apresentando pela primeira vez ao público alemão uma lista quase completa dos escritos de Sorel e da literatura secundária que lhe é consagrada. A esta lista juntava-se um esboço da sua vida e do seu pensamento.
Nesse texto, Mohler quis em primeiro lugar apresentar uma sinopse das fases sucessivas da evolução intelectual e política de Sorel, para poder destacar bem a posição ideológica diversificada deste autor. Esse texto havia sido concebido originalmente para uma monografia de Sorel, onde Mohler poria em ordem a enorme documentação que havia reunido e trabalhado. Infelizmente nunca a pôde terminar. Finalmente, Mohler decidiu formalizar o resultado das suas investigações num trabalho bastante completo que apareceu em três partes nas colunas da Criticón em 1997. Os resultados da análise mohleriana podem resumir-se em 5 pontos:
Uma nova cultura que não é nem de direita nem de esquerda
1. Quando falamos de Sorel como um dos pais fundadores da Revolução Conservadora reconhecemos o seu papel de primeiro plano na génese deste movimento intelectual que, como indica claramente o seu nome, não é “nem de direita nem de esquerda” mas tenta forjar uma “nova cultura” que tomará o lugar das ideologias usadas e estragadas do século XIX. Pelas suas origens este movimento revolucionário-conservador é essencialmente intelectual: não pode ser compreendido como simples rejeição do liberalismo e da ideologia das Luzes.
2. Em princípio, consideramos que os fascismos românicos ou o nacional-socialismo alemão tentaram realizar este conceito, mas estas ideologias são heresias que se esquecem de levar em consideração um dos aspectos mais fundamentais da Revolução Conservadora: a desconfiança em relação às ideias que evocam a bondade natural do homem ou crêem na “viabilidade” do mundo. Esta desconfiança da RC é uma herança proveniente do velho fundo da direita clássica.
3. A função de Sorel era em primeiro lugar uma função catalítica, mas no seu pensamento encontramos tudo o que foi trabalhado posteriormente nas distintas famílias da Revolução Conservadora: o desprezo pela “pequena ciência” e a extrema valorização das pulsões irracionais do homem, o cepticismo em relação a todas as abstracções e o entusiasmo pelo concreto, a consciência de que não existe nada de idílico, o gosto pela decisão, a concepção de que a vida tranquila nada vale e a necessidade de “monumentalidade”.
Não há “sentido” que exista por si mesmo.
4. Nesta mesma ordem de ideias encontramos também esta convicção de que a existência é desprovida de sentido (sinnlos), ou melhor: a convicção de que é impossível reconhecer com certeza o sentido da existência. Desta convicção deriva a ideia de que nunca fazemos mais que “encontrar” o sentido da existência forjando-o gradualmente nós próprios, sob a pressão das circunstâncias e dos acasos da vida ou da História, e que não o “descobrimos” como se ele sempre tivesse estado ali, escondido por detrás do ecrã dos fenómenos ou epifenómenos. Depois, o sentido não existe por si mesmo porque só algumas raras e fortes personalidades são capazes de o fundar, e somente em raras épocas de transição da História. O “mito”, esse, constitui sempre o núcleo central de uma cultura e compenetra-a inteiramente.
5. Tudo depende, por fim, da concepção que Sorel faz da decadência – e todas as correntes da direita, por diferentes que sejam umas das outras, têm disso unanimemente consciência – concepção que difere dos modelos habituais; nele é a ideia de entropia ou a do tempo cíclico, a doutrina clássica da sucessão constitucional ou a afirmação do declínio orgânico de toda a cultura. Em «Les Illusions du progrès» Sorel afirma: “É charlatanice ou ingenuidade falar de um determinismo histórico”. A decadência equivale sempre à perda da estruturação interior, ao abandono de toda a vontade de regeneração. Sem qualquer dúvida, a apresentação de Sorel que nos deu Mohler foi tornada mais mordaz pelo seu espírito crítico.
Uma teoria da vida concreta imediata
Contudo, algumas partes do pensamento soreliano nunca interessaram Mohler. Nomeadamente as lacunas do pensamento soreliano, todavia patentes, sobretudo quando se tratou de definir os processos que deveriam ter animado a nova sociedade proletária trazida pelo “mito”. Mohler absteve-se igualmente de investigar a ambiguidade de bom número de conceitos utilizados por Sorel. Mas Mohler descobriu em Sorel ideias que o haviam preocupado a ele também: não se pode, pois, negar o paralelo entre os dois autores. As afinidades intelectuais existem entre os dois homens, porque Mohler como Sorel, buscaram uma “teoria da vida concreta imediata” (recuperando as palavras de Carl Schmitt).
Karlheinz Weissmann traduzido por Rodrigo Nunes
causanacional.net
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, révolution conservatrice, philosophie, histoire, conservatisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 novembre 2009
Arthur Moeller van den Bruck: Nationalistisch
 Arthur MOELLER VAN DEN BRUCK:
Arthur MOELLER VAN DEN BRUCK:
Nationalistisch
http://rezistant.blogspot.com/
Man kann das Wort nicht in Verruf tun, wenn die Sache ihr Recht hat.
Deutsche hofften nach unserem Zusammenbruche, sich in dem Leben, das man uns immerhin liess, ohne Nationalismus einrichten zu können. Aber in einem Schicksale richtet man sich nicht ein. In einem Schicksale unterliegt man, oder obsiegt man.
Wir wollten dies nicht wahrhaben. Deutsche gedachten ein Geschäft mit dem Schicksale zu machen. Sie wollten sich die Gegenwart erkaugen, indem sie eine Schuld einräumten, die wir nich thatten. Und was an Zukunft bevorstand, das suchten sie durch eine Erfüllungspolitik hinauszuschieben, die wir zunächst einmal auf uns nahmen und an die wir doch nicht recht glaubte. Man konnte nicht oberflächlicher sein, wenn man auf diese Weise den Folgen eines verlorenen Krieges zu entgegen suchte. Und wir konnten nicht undeutscher sein, weil wir wider allen angeborenen Ernst der Nation handelten.
Der elfte Januar musste kommen, um uns zur Besinnung zu bringen. Von den Ereignissen, die dieser Tag heraufführte, hatte man uns immer versichert, dass es niemals zu ihnen kommen werde. An diesem Tage zerriss die geflissentliche Täuschung. und eine Änderung ging in der Nation vor sich, deren Menschen zum ersten Male das Schicksal eines besiegte, eines darniedergeschlagenen, eines in Ketten gelegten Volkes begriffen.
Von diesem elften Januar an gibt es ein Recht auf Nationalismus in Deutschland. Jetzt kann man uns nicht mehr mit der Ausflucht kommen, es gebe auch andere und internationale Wege, um an das eine und einzige Ziel einer wiedererrungenen deutschen Selbständigkeit zu gelangen, über das sich alle Parteien, wie sie versichern, einig sind.
Nationalist ist, wer sich nicht in das Schicksal der Nation ergibt, sondern ihm widerspricht.
Nationalismus ist heute in Deutschland: Widerstand.
II.
Wenn der Nationalismus die Nation will, dann müsste es, sollte man meinen, das Natürliche sein, dass auch die Nation den Nationalismus will.
Aber in Deutschland ist, so scheint es, das Natürliche nicht das Politische, sondern das Unpolitische. Franzosen, Italiener, Engländer sind von einer anderen politischen Rasse. Es sijnd ältere Völker, die den Sinn ihrer Geschichte verstanden haben. Ihre Erfahrungen auf dieser Erde sitzen ihnen im Blute. Ihre Menschen werden mit ihnen geboren. Und Generation gibt sie an Generation als politischen Instinkt und als diplomatische Disziplin weiter.
Nur in Deutschland ist möglich, dass es Frankophile in einem Augenblicke gibt, in dem Frankreich die Nation weissbluten lässt. Es hat bei uns immer eine Franzosenpartei gegeben. Sie hat in Überläufergewalt schon mit den Römern paktiert. Sie hat später in Fürstengestalt mit dem Hofe von Versailles paktiert. Sie möchte heute mit der französischen Wirtschaft paktieren. Sie ist seit dem elften Januar einigermassen kleinlaut geworden. Sie gibt sich sogar den patriotischen Anschein, als missbillige sie die französischen Methoden. Aber sie treibt ihre Minierung weiter und wartet nur auf die Stunde, in der sie ihr Werk in der Öffentlichkeit fortsetzen kann.
Die Frankophilen wissen, was sie politisch wollen. Das Proletariat weiss dies nicht. Es nimmt bereits seinen Drang zur Wirklichkeit. In den westlichen Ländern war der Sozialismus immer nur ein Sprungbrett für den Politiker. Wenn er aus der Opposition, in der er seine Grünlingsjahre zubrachte, in den Staat mit dessen Ämtern übertrat, dann vollzog er diesen Stellungswechsel ohne Wimperzucken als ein Nationalist. Der deutsche Arbeiter hat die sozialistische Botschaft mit dem so schweren, so gründlichen, so versessenen Ernste aufgenommen, mit dem Deutsche sich einer Idee hinzugeben pflegen. Auch das Erlebnis des Völkerkampfes hat seinen Glauben an den Klassenkampf nicht zu erschüttern vermocht. Er hofft nach wie vor auf eine der drei Internationalen. Der Nationalist muss sich mit der Tatsache nicht abfinden, nein, sondern auseinandersetzen, dass es Millionen von Deutschen gibt, die von der Idee der Nation marxistisch wegerzogen worden sind. Er erfährt in jeder innenpolitischen und in jeder aussenpolitischen Beziehung, wie diese Idee der Nation über die ganze Erde hin, aber nirgendwo mit einem solche Erfolge wie im sozialistischen Deutschland, ständig von der Idee der vereinigten Proletariate aller Länder gekreuzt wird. Diese Idee eines grossen proletarischen Klassenkampfes trennt den deutschen Arbeiter von seiner heute so gefährdeten und umdrohten Nation. Der deutsche Nationalist müsste nicht Nationalist sein, wenn er den Gedanken der deutschen Nation nicht auf as ganze Volk bezöge, nicht auf alle Shcichten des Volkes, in denen es sich gliedert, und hier nicht auf diejenige Klasse, aus der es als Industreivolk nachwächst und aufsteigt. Er weiss, dass es keinen Befreiungskamof für eine Nation geben kann, wenn sie Bürgerkrieg im Rücken hat. Er stellt auch den Klassenkampf in seine politische Rechnung ein, aber er versteht ihn nicht so sehr sozial, als national, als einen Kampf der unterdrückten Völker, der östlichen gegen die westlichen, der jungen gegen die alten. Er merkt wohl auf, wenn der deutsche Kommunist von einem Vaterlande spricht, das er sich erst erobern müsse. Er fühlt, dass dies die Keimzelle des Nationalismus auch im deutschen Proletariate ist. Aber er gibt sich eine politische Rechenschaft über das Unzureichende der proletarischen Politik. Ist es nicht auch nur eine deutscheste Selbsttäuschung, wenn der deutsche Arbeiter von seinem Willen zur nRettung der Nation aus der weltkapitalistischen Klaue spricht und diese Rettung auf die eigene proletarische Faust nehmen will? Noch ist nicht ausgemacht, dass das Zeitalter des Weltkapitalismus ein Ende fnden wird, wie der Marxist es sich vorstellt. Und eher ist möglich, dass ein stürzender Weltkapitalismus den deutschen Sozialismus mitbegraben wird!
Die Demokratie, die durch die Revolution zur Macht im Staate aufrückte, fürchtet das Proletariat ebenso sehr, wie sie den Nationalismus scheut. Sie spielt das eine gegen den anderen aus. Sie spricht von dem Feinde, der rechts, und von dem Feinde, der links steht. Und in einer Zeit, in welcher der einzige Feind, den wir haben sollten, vom Rheine an die Ruhr vorrückte, bereitet sie den deutschen des entschlossensten Widerstandes ihre parteipolitischen Hemmungen. Auch dies ist nur zu deutsch. Die Demokratie hat ein schlechtes Gewissen vor der Nation. Sie hat sich auf die Weltdemokratie berufen und muss nun erleben, das sie von eben dieser Weltdemokratie um der Nation willen misshandelt wird. Sie ist nicht so empfindungslos, dass sie die Schläge icht spürte, die das Deutschtum treffen, indem sie die Demokratie treffen. Ihr ist jetzt die Vertretung der Nation überkommen, und es gibt Demokraten, die, ohne Nationalisten zu sein, Nationalismus für sich in Anspruch nehmen. Sie versichern zum mindesten, dass auch sie "gute Deutsche" sind, was freilich ein wenig sagender Mittelbegriff ist, der nicht verpflichtet. Sie geraten damit in für sie fremde Bereiche, in denen sie sich nur schwer zurechtfinden. Es fehlt ihnen das Überwältigende des Erlebnisses, von dem der Nationalist ausgeht. Die Vaterlandsliebe ist hier keine Leidenschaft für Deutschland, aus der die Vorausschau eines Schicksales folgt. Sie ist im besten Falle ein Wohlmeinen mit seiner betrogenen duldenden stummen Bevölkerung, und im schlechteren Falle eine Befürchtung für deren parteipolitische Zuverlässigkeit. Nur so ist die Stellung der Demokratie zum Sozialismus zu erklären. Es ist darin Eifersucht. Und es folgt daraus Misstrauen. Die Demokraten verstehen die Geistesverfassung des Nationalismus nicht. Sie verstehen die Beweggründe der Nationalisten nicht. Sie unterstellen Ihnen innenpolitische Hintergedanken und Endabsichten. Der Nationalismus sieht nur einen Weg: es ist der, welcher uns dahin bringt, dass wir die Politik aller Parteipolitik entrücken. Und Nationalisten haben nur das eine Ziel: das Schicksal der Nation an die Problemfront der Aussenpolitik zu bringen. Aber Probleme verlangen Entscheidungen. Und die Demokratie entzieht sich Entscheidungen.
Sie wird ihnen nicht immer ausweichen können. Wir sind, so scheint es, ein Volk, das sich alle Jahrhunderte in die Notwendigkeit bringt, einen Freiheitskampf führen zu müssen. Die Deutschen, so scheint es, wollen immer wieder von Vorne anfangen! Einst stand das Bürgertum an seinem Anfange. Heute steht, vielleicht, das Proletariat an dem seinen. Wann wird die Nation an ihrem stehen?
III.
Die Geschichte unpolitischer Völker ist diejenige ihrer Selbsttäuschungen. Die Geschichte politischer Völker ist diejenige ihrer Bewusstwerdung.
Wir sind jetzt in Deutschland noch ein Mal vor die Wahl gestellt, zu welchen Völkern wir gehören wollen. Es ist möglich, dass alle Leiden dieser Zeit nur Umwege sind, um aus uns endlich ein Volk zu machen, das sich seiner Nationalität politisch bewusst wurde. Dies ist die Zuversicht des Nationalismus. Es ist nicht minder möglich, dass dieselben Leiden nur Zuckungen sind, in denen sich unser Untergang bereits vollzieht, über den wir uns mit Menschheitsforderungen hinwegtäuschen, denen wir, wie dies deutsch ist, vor unserem Ende noch nachzukommen suchen. Dies ist die Gefahr der Demokratie. Sie hat, wie dies demokratisch ist, nur innenpolitische Sorgen. Von jenen Leiden ist nicht abzusehen, wie sie ohne das Zutun je enden könnten, das der Nationalismus fordert. Und um unserer Bewusstwerdung willen müssen wir uns mit unseren Selbsttäuschungen beschäftigen.
Die Welt der Politik ist nicht diejenige der Wünsche, sondern der Wirklichkeiten. Es hilft uns nicht, dass wir, wie dies unsere Art ist, Vorstellungen von einer gerechteren und vernünftigeren Welt nachhängen, als derjenigen, in der wir leben, und die uns politisch umgibt. Das Recht eines Volkes ist das Unrecht eines anderen. Und seine Vernunft ist dienige des Eigennutzes. Änder die Welt - aber ändert vorher den Deutschen! Macht einen Menschen aus ihm, der endlich die Schwachheit von sich abtut, die Dinge immer nur auf seine Wünsche hin anzusehen! Macht einen Deutschen aus ihm, der sich mit der Leidenschaft zur Wirklichkeit durchdringt und der sich nicht mit der Verherrlichung eines Unwirklichen lächerlich macht, das niemals ist und niemals sein kann! Ihr werdet mit diesem Menschen und Deutschen auf der Erde gar Manches erreichen: auch Manches, was gerecht ist, auch Manches, was vernünftig ist - aber immer nur über einen Nationalismus, und durch ihn, der die Politik der Naton zu sichern vermag.
Moeller van den Bruck, in: Das Gewissen, 5. Jahrgang, Nummer 25, 25. Juni 1923.
00:12 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : weimar, allemagne, nationalisme, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 novembre 2009
La resurrezione europea
La resurrezione europea
Quando, nei primi anni Trenta, Ernst Jünger vedeva la crisi della borghesia superata dall’avvento di una nuova civiltà, guidata dall’Arbeiter, era decisamente ottimista. Oggi siamo costretti a registrare che il borghesismo è la classe universale che organizza in prima persona il processo di sgretolamento dell’Europa. Quando invece vaticinò «la fine di contesti millenari», volendo dire che era giunta la fine della tradizione europea, vide giusto. Solo che, in luogo del nuovo dominatore metallico dei tempi di rivolgimento, abbiamo più modestamente il protagonismo di un materiale umano di infimissima specie, un “tipo” antropologicamente di lega povera. Le note “caste” oggi al potere rappresentano il contrario di quella razza della nuova “età del ferro” preconizzata dall’intellettuale tedesco, essendo il frutto dell’inopinata affermazione di un’epoca plastificata. Gestita da elementi eticamente e culturalmente inferiori e in base a ideali non eroici, ma da termite.
 E dire, però, che quando Jünger faceva le sue ipotesi tutto un mondo ribolliva per davvero di volontà di rovesciamento degli idoli borghesi. La stagione jüngeriana, tuttavia, se misurata in tempi spengleriani, durò un attimo. Il 1932 – anno in cui fu scritto L’operaio – è passato da un pezzo, morti e sepolti sono i tentativi storici di rianimare l’Europa con cure radicali attinte da quello stesso bacino eroicizzante, e tutto ormai riposa sulla quiete di un dominio mondiale di energie corrosive ben paludate da ideali positivi. Lo stesso Jünger, col passare dei decenni, abbandonò le sue immagini faustiane e i suoi affondo nichilistici e si mise ad argomentare in termini di “fine della storia”, di difesa ecologica della Terra, acconciando il suo genio letterario a belle riproduzioni fantasy del romanzo metastorico. Disse di non comprendere i catastrofismi che erano stati di Spengler. Però scrisse che si aspettava una prossima epoca “dei Titani”, «molto propizia alla tecnica ma sfavorevole allo spirito e alla cultura». Titani magari no, ma questo pare proprio il mondo in cui viviamo, in cui il tecnocrate, il politicante e l’uomo-massa di annunci come quelli di Jünger e di Spengler non sanno che farsene.
E dire, però, che quando Jünger faceva le sue ipotesi tutto un mondo ribolliva per davvero di volontà di rovesciamento degli idoli borghesi. La stagione jüngeriana, tuttavia, se misurata in tempi spengleriani, durò un attimo. Il 1932 – anno in cui fu scritto L’operaio – è passato da un pezzo, morti e sepolti sono i tentativi storici di rianimare l’Europa con cure radicali attinte da quello stesso bacino eroicizzante, e tutto ormai riposa sulla quiete di un dominio mondiale di energie corrosive ben paludate da ideali positivi. Lo stesso Jünger, col passare dei decenni, abbandonò le sue immagini faustiane e i suoi affondo nichilistici e si mise ad argomentare in termini di “fine della storia”, di difesa ecologica della Terra, acconciando il suo genio letterario a belle riproduzioni fantasy del romanzo metastorico. Disse di non comprendere i catastrofismi che erano stati di Spengler. Però scrisse che si aspettava una prossima epoca “dei Titani”, «molto propizia alla tecnica ma sfavorevole allo spirito e alla cultura». Titani magari no, ma questo pare proprio il mondo in cui viviamo, in cui il tecnocrate, il politicante e l’uomo-massa di annunci come quelli di Jünger e di Spengler non sanno che farsene.
Ma è a personaggi come i due dioscuri tedeschi che l’Europa deve il fatto di avere ancora un’anima. Sfaldata e minacciata da vicino, ma viva. Non è possibile immaginare una ripresa europea sul ciglio dell’abisso, se non tornando a imbracciare quell’ideologia – poiché proprio di idee armate si trattava – che accomunò Jünger e Spengler come in un sogno europeo di rinascita a tutti i costi. Persino dietro al “tramonto” preconizzato da Spengler, difatti, c’era una promessa di nuovo inizio. E ovunque in Jünger si coglie la volontà di indicare la forma che si imporrà, una volta gestito e fatto placare il caos nichilista.
Dinanzi alla crisi provocata – oggi come allora – da uno scomposto e distruttivo procedere della modernità, l’anelito dell’uomo in ordine con le leggi della vita non può che essere verso «l’esigenza di una vita nuovamente ordinata e strutturata all’interno di una dimensione di compattezza e stabilità». Ha scritto queste parole Domenico Conte, autore di Albe e tramonti d’Europa. Ernst Jünger e Oswald Spengler, appena pubblicato dalle Edizioni di Storia e Letteratura di Roma.
È una frase chiave. Solo apparentemente innocua. Essa infatti mostra come il pensiero del realismo eroico, della mobilitazione totale e del cesarismo militante non fosse espressione anch’esso dell’epoca del nichilismo e dell’aggressione delle masse, ma, al contrario, intendesse utilizzare gli strumenti della modernità per abbatterla e costruire in sua vece un nuovo ordine gerarchico. «Questo mondo della mobilitazione e del movimento non è che un interludio», scrive Conte, e con questo ci fa capire che la fase della lotta è necessaria non in sé, ma per raggiungere ciò che egli definisce la «utopia della stabilità». Insomma: la Rivoluzione Conservatrice – e con loro i regimi nazionalpopolari che bene o male ne misero in pratica i presupposti – è una macchina moderna, d’accordo, ma antimodernista. Oltrepassati i confini della storia e della politica, Jünger e Spengler, ognuno per suo conto, ma con idee sovente intrecciantesi, guardarono al di là, immaginando forme ulteriori, stili post-moderni, accadimenti di primordiale potenza rifondatrice. Osservato fino in fondo l’incubo della tecnica e della società moderne, questi due artigiani dell’idea europea di dominio non hanno fatto filosofia reazionaria, non hanno espresso conservatorismi inetti, ma hanno dato strumenti di rivolta: «con l’impazienza e il radicalismo – soggiunge Conte – di chi non credeva più nella storia o vi credeva solo nel senso del vedervi l’imperare e l’agitarsi di più alte potenze, votarsi alle quali parve cosa necessaria e bella».
In effetti, se Jünger fu il collaboratore dei fogli di punta del nazionalismo politico post-bellico e vicino agli ambienti dell’oltranzismo nazionalrivoluzionario, Spengler non gli fu da meno: in rapporti con personaggi come Franz Seldte, futuro ministro nazionalsocialista, era ammiratore del mondo dei Männerbünde, le milizie armate al seguito di un capo tipiche dell’epoca, dagli squadristi italiani alle SA e allo Stahlhelm, nelle quali vedeva l’affermarsi di un prosssimo cesarismo carismatico. Contestualmente, Jünger osservò ne L’operaio che «la massa comincia a secernere dal proprio corpo organi di autodifesa». Questo considerare le cose dal punto di vista dell’organico, del vitale, dell’ancestrale biologico è forse la dimensione che meglio accomuna Jünger e Spengler e che meglio ne spiega il terribile, seducente, incantatorio talento da affrescatori. Entrambi analisti dell’uomo e della società, entrambi evocatori di scenari cosmologici, di rivolgimenti apocalittici, di ipotesi di riaffermazione di “tipi” elementari e originari, di razze mutanti, di arcaismi giacenti nell’inconscio e riattivati dall’uso della tecnica e dalla volontà impersonale, il tutto da indirizzare – con forte senso politico – contro l’affastellamento informe del Moderno. Profetizzarono uomini nuovi, secondo «cambiamenti fisiognomici intercorrenti nel passaggio dal mondo borghese dell’individuo al mondo tipico dell’Operaio». L’uno e l’altro giudicarono – sbagliando profezia, ma non importa – che presto al borghese, «sfornito di qualsiasi rapporto con forze elementari» sarebbero succeduti esemplari. Quasi campionature di un’inedita stirpe lavorata dai fatti, dal carattere, da un destino epocale.
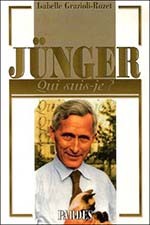 Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del Novecento rappresentata da Jünger e da Spengler come in fondo un unico strumentario di lotta filosofica, metafisica e politica, bene in grado di raddrizzare il piano inclinato su cui corre la modernità. E si tratta di strumenti da estrarre dai più reconditi giacimenti della natura occulta, veri archetipi in riposo che attendono soltanto di essere risvegliati: l’energia formatrice, ad esempio, la Gestaltungskraft, che a giusto titolo Conte indica come termine essenziale dell’Arbeiter, e che è la stessa forza che, ne L’uomo e la tecnica, Spengler vede agire per catastrofi immediate, risolutive: le mutazioni che aprono vie impensate ai progetti della storia.
Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del Novecento rappresentata da Jünger e da Spengler come in fondo un unico strumentario di lotta filosofica, metafisica e politica, bene in grado di raddrizzare il piano inclinato su cui corre la modernità. E si tratta di strumenti da estrarre dai più reconditi giacimenti della natura occulta, veri archetipi in riposo che attendono soltanto di essere risvegliati: l’energia formatrice, ad esempio, la Gestaltungskraft, che a giusto titolo Conte indica come termine essenziale dell’Arbeiter, e che è la stessa forza che, ne L’uomo e la tecnica, Spengler vede agire per catastrofi immediate, risolutive: le mutazioni che aprono vie impensate ai progetti della storia.
Conte batte sul tasto delle naturali differenziazioni tra i due pensatori, ma ribatte pure su quello delle organiche similitudini. E ci rende noto un esemplare dettaglio, di gran valore filologico e immaginale. Una lettera scrittagli da Ernst Jünger nel 1995, a un mese dal compimento del suo centesimo anno, in cui conveniva con lo studioso napoletano che Spengler aveva svolto in qualche modo su di lui il ruolo di maestro: «Lei ha ragione a supporre che Oswald Spengler abbia esercitato un’influenza significativa sulla mia evoluzione spirituale…». Assodato che Spengler era senza mezzi termini considerato da Jünger «decisivo per la sua concezione della storia», Conte indica come elemento tra i più visibili di questa fratellanza ideale il «collegamento fra Operaio e prussianità», quello fra Operaio e Germania, e soprattutto la visuale copernicana della storia, nel senso di una storia e di una politica mondiali, ma «in un’ottica in realtà germanocentrica». Un sano relativismo di prospettiva che non sviliva, ma al contrario rafforzava sia in Jünger sia in Spengler l’ostilità verso l’individualismo cosmopolita borghese e quella «contro i partiti politici, i parlamenti, la stampa liberale e l’economia di libero mercato».
Un altro dei numerosi spunti offerti da Conte è il commento a un libro dell’americano John Farrenkopf, recentemente dedicato a Spengler come “profeta del declino”. Un caso singolare di “spenglerismo” negli USA? Un momento… vediamoci chiaro… Farrenkopf condivide le prognosi infauste di Spengler circa il futuro dell’Occidente, formula un suo pessimismo circa la decadenza del mondo occidentale (pacifismo, crisi demografica e culturale, ottusa pratica di esportare tecnologia ai nemici dell’Occidente, etc.), ma alla fine non manca di sostituire l’America alla Germania come quella struttura imperiale auspicata da Spengler per contenere gli sviluppi verso il basso della civilizzazione. E, da buon americano, non manca neppure di indicare in qualche scritto giovanile del filosofo del tramonto accenni di apprezzamento per la democrazia. Non sono tanto questi aspetti che importano. Conte demolisce alla svelta il tentativo di americanizzare Spengler e di confondere l’impero con l’imperialismo di bottega. Da parte nostra, noi segnaliamo il valore irrinunciabile della duplice lezione di Jünger e di Spengler: la presenza pesante di due autori dal messaggio forte, attualissimo, il cui pensiero di contrasto radicale va strappato di mano ai depotenziatori – certi salotti della new age jüngeriana, amanti del romanziere criptostorico, ma muti sull’ideologo nazionalrivoluzionario… adesso lo Spengler democratico e americanomorfo… – per rimetterlo al centro di un possibile recupero del tradizionalismo rivoluzionario europeo…
Domenico Conte, ben noto al pubblico italiano per essere uno dei pochi esegeti non prevenuti della Rivoluzione Conservatrice – e autore tra molti altri di quell’eccellente libro-monstre che è Catene di civiltà. Studi su Spengler, pubblicato dalle Edizioni Scientifiche Italiane nel 1994 – parla non a caso di albe e tramonti d’Europa. Il pensiero tragico e le prospettive catastrofiste di Jünger e di Spengler nascondono allo stesso modo tutto un tracciato di proiezioni futuribili, assegnando alla nostra civiltà spazi di insorgenza e di contro-storia ancora percorribili. Spengler, fortemente interessato ai momenti aurorali e dinamici della Kultur, era in realtà un agitatore di destini. E Jünger, nel suo Arbeiter, scrisse la frase rivelatrice: «ogni tramonto è preparazione». Entrambi, e insieme ad esempio a un Heidegger, e in maniera tra l’altro non dissimile dal nostro vecchio Oriani, videro il futuro dell’Europa nel suo saper riconoscere una nuova alba, fatta di istinto, volontà e mobilitazione.
* * *
Tratto da Linea del 11 ottobre 2009.
00:08 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, jünger, spengler, weimar, allemagne, europe, littérature, lettres; lettres allemandes, littérature allemande, philosophie, déclin, décadence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 novembre 2009
Innerlichkeit und Staatskunst - Zum Wirken Friedrich Hielschers
 Innerlichkeit und Staatskunst -
Innerlichkeit und Staatskunst -
Zum Wirken Friedrich Hielschers
"Zwei Tyrannen tun dem Deutschen not: ein äußerer, der ihn zwingt, sich der Welt gegenüber als Deutscher zu fühlen, und ein innerer, der ihn zwingt, sich selbst zu verwirklichen."
- Ernst Jünger
Verfasser: Richard Schapke
Der am 7. März 1990 auf dem Rimprechtshof im Schwarzwald verstorbene Friedrich Hielscher gehörte mit Sicherheit zu den originellsten Ideologen der Konservativen Revolution. Da er sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch weniger als ohnehin schon um öffentliche Breitenwirkung scherte, gerieten seine Arbeiten in fast vollständige Vergessenheit, auch wenn Hielschers Name des öfteren in Jüngers "Strahlungen" auftaucht. In jüngster Zeit ist eine regelrechte Wiederentdeckung des unkonventionellen Nietzscheaners zu bemerken - Grund genug für einen Versuch, sich Friedrich Hielschers Leben und Werk zu nähern. Wir greifen hierbei oftmals auf Originalzitate zurück, um den Gegenstand unserer Betrachtung in seinen eigenen Worten sprechen zu lassen. Mitunter sind Zitate und Analysen aus der nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichten Autobiographie "Fünfzig Jahre unter Deutschen" eingeflochten. Aus inhaltlichen Gründen gehen wir hierbei von der Chronologie der Veröffentlichung ab.
1. Herkunft
Friedrich Hielscher wurde am 31. Mai 1902 in Guben (nach anderen Angaben in Plauen/Vogtland) in eine nationalliberale Kaufmannsfamilie hineingeboren. Gerade 17 Jahre alt geworden, absolvierte er sein Kriegsabitur am Humanistischen Gymnasium, um sich fast unmittelbar darauf einem der gegen Spartakisten und Separatisten oder in den Grenzkämpfen im Osten fechtenden Freikorps anzuschließen. Dieses Freikorps Hasse ging im Juni 1919 aus der MG-Kompanie des ehemaligen Infanterieregiments 99 hervor und kam in Oberschlesien gegen polnische Insurgenten zum Einsatz. Zu den Freikorpskameraden Hielschers gehörte Arvid von Harnack, der später durch seine Mitarbeit in Harro Schulze-Boysens Roter Kapelle zu Berühmtheit gelangen sollte. Die Einheit bewährte sich und wurde in die Reichswehr übernommen, aber Hielscher quittierte den Dienst im März 1920, da er eine Beteiligung am überstürzten Kapp-Putsch gegen die Republik ablehnte.
Es folgte ein Jurastudium in Berlin, das von regelmäßigen Besuchen an der Hochschule für Politik begleitet wurde. Dem Brauch entsprechend schloß Hielscher sich einer Studentenverbindung an und wählte die Normannia Berlin. Nach einer vorübergehenden Mitgliedschaft im Reichsclub der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) traten in Gestalt des aus der SPD hervorgegangenen nationalen Sozialisten August Winnig und des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler prägendere politische Einflüsse an ihn heran. Von Winnig übernahm Hielscher die Überzeugtheit von einer weltgeschichtlichen Mission Deutschlands, vom Spengler das zyklische Geschichtsbild. Hinzu kam das in den Werken Ernst Jüngers herausgearbeitete Kriegertum.
Im Jahr 1924 erfolgte der Wechsel nach Jena, wo Hielscher das Referendarexamen bestand und im Dezember 1926 mit Auszeichnung zum Doktor beider Rechte promovierte. Die ungeliebte Beschäftigung als Verwaltungsjurist im preußischen Staatsdienst wurde nach nicht einmal einem Jahr im November 1927 aufgegeben. Die Anforderungen des Studiums behinderten nicht den häufigen Besuch des Weimarer Nietzsche-Archivs. Friedrich Nietzsche sollte dann auch über seine Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche der letzte wirklich prägende Bestandteil des sich allmählich herauskristallisierenden Weltbildes sein. Von Dauer war die weitere Beteiligung als Alter Herr am Verbandsleben der Normannia Berlin, wo Hielscher die Bekanntschaft von Persönlichkeiten wie Horst Wessel, Hanns Heinz Ewers und Kurt Eggers machte.
2. Innerlichkeit
Am 26. Dezember 1926 betrat Friedrich Hielscher mit dem Aufsatz "Innerlichkeit und Staatskunst" die Bühne der politischen Publizistik. Der junge Jurist hatte sich auf Rat Winnigs dem nationalrevolutionären Kreis um die Wochenzeitung "Arminius" angeschlossen, dem nicht zuletzt Ernst Jünger das Gepräge gab. Aus der Begegnung mit Jünger entstand eine lebenslange Freundschaft. "Innerlichkeit und Staatskunst" enthält bereits alle wesentlichen Aspekte des Hielscherschen Weltbildes und soll daher ausführlicher dokumentiert werden.
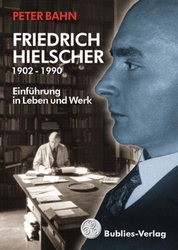 "Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.
"Seien wir ehrlich: wir stehen nicht am Beginn eines neuen Aufstieges, sondern vor dem Ende des alten Zusammenbruches. Dieses Ende liegt noch vor uns. Wir müssen erst noch durch das Schlimmste hindurch, ehe wir ans neue Werk gehen können. Jeder, der jetzt schon mit irgendeinem Aufbau beginnt, tut sinnlose Arbeit. Das will folgendes heißen. Jede kriegerische Vorbereitung, die auf einen Befreiungskrieg in der Gegenwart oder der nahen Zukunft abzielt, ist wertlose Spielerei und grob fahrlässige Dummheit. Jeder geistige Versuch, einigende Bünde, Verbände, kulturelle Vereinigungen, Weisheitsschulen, oder wie man das Zeug sonst nennen mag, in der Gegenwart zu gründen, ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit der inneren Haltung.
(...) Beweise haben in der Welt der Tatsachen keinen Sinn.. Es ist noch nie vorgekommen, daß man politische Gegner durch Beweise bekehrt oder in ihrer Stellung erschüttert hätte. Aber es ist nötig, daß die sich einig werden, die im Grunde ihres Wesens Träger ein und desselben Zieles sind: des heiligen Deutschen Reiches. Zu dieser Einigung bedarf es des gegenseitigen Verständnisses. Dieses Verständnis fehlt. Ihm dient die folgende Begründung. Sie bildet sich nicht ein, daß an dem kommenden deutschen Zerfall irgend etwas zu ändern sei. Aber sie ist der Überzeugung, daß es jetzt schon an der Zeit ist, an der geistigen Haltung zu arbeiten, von der aus der spätere Aufbau allein beginnen kann.
Seit die Germanen in Berührung mit der kraftlos gewordenen und überreifen römisch-byzantinisch-christlichen Kulturenvielfalt gekommen sind, die den Ausgang des sogenannten Altertums bildet, ist ihre innere Haltung unfrei. Seit sie das Denken dieser fremden Welten übernommen haben, unfähig, die kaum zum Ausdruck gekommene eigene Art gegen das jeder Unmittelbarkeit längst entwachsene, zu Ende gedachte fremde Wesen zu schützen, seit dieser Zeit ist die deutsche Haltung zweispältig (sic!). Der Deutsche bejaht den Kampf als solchen; aber die müde Sittlichkeit der Fremden sucht den Frieden. Seit also der deutsche Geist überfremdet ist, wird jede deutsche Kampfhandlung mit schlechtem Gewissen getan, wird halb, kommt nicht zum endgültigen Erfolge und sinkt nach oft prachtvollem Aufschwung immer wieder in sich zusammen. Staatskunst ist die Fähigkeit, die eigenen Kampfhandlungen mit dauerndem Erfolg nach außen zu verwirklichen. Seit der Deutsche überfremdet ist, steht die deutsche Staatskunst allein und hat die deutsche Innerlichkeit nicht geschlossen hinter sich. (...)
Mit Bismarcks Entlassung verwandelte sich das Bismärckische Reich in den Wilhelminischen Staat, in ein Verfassgebilde, dessen Untergang unvermeidbar war. Diese Unvermeidbarkeit zeigte sich im Weltkriege. Wenn kriegerisches Heldentum ein Schicksal wenden kann, dann mußten wir siegen. Aber wir mußten die Fahnen senken, weil hinter dem deutschen Krieger nicht die deutsche Heimat stand als eine Einheit innerlichsten Glaubens, Wollens, Denkens, als eine Welt der ungetrübten reinen und abgrundtiefen Zuversicht. So kam die Niederlage. Der Staat der Weimarer Verfassung ist nicht ein neues Gebilde, das von seinem Vorgänger irgendwie wesentlich verschieden wäre, sondern nur die letzte Gestalt des Wilhelminischen Staates, die dessen alberne, wertlose, erbärmliche Seiten in vorbildlicher Deutlichkeit und - freilich unbewußter - Ehrlichkeit zeigt.
So ist hier nichts mehr zu halten und zu retten. Je eher dieser Staat zugrunde geht, um so besser ist es für die deutsche Sache. Sein weiteres Schicksal ist uns vollendet gleichgültig. Soll ich noch deutlicher werden? Also ist hier nichts mehr zu verbessern. Wenn das noch möglich wäre, dann würde zudem nicht das kindische Hurraschreien scheinkriegerischer Aufzüge von Wert sein, sondern einzig und allein ein verbissenes, unterirdisches, schweigendes und selbstverleugnendes Arbeiten, das vom Kleinsten anfängt, wie Friedrich Wilhelm der Erste angefangen hat. Aber weil es nicht möglich ist, an diesem Staat noch Hand anzulegen, bleibt nur eins übrig: in sich zu gehen, und aus der Tiefe des eigenen Herzens die Zuversicht, den Glauben heraufzuholen, der die deutsche Zukunft tragen und ohne den das neue Werk nicht begonnen werden wird. (...)"
Wir fassen zusammen: Der Zusammenbruch der liberalkapitalistischen Ordnung ist nicht in vollem Gange, sondern er steht erst noch bevor. Vor diesem Kollaps sind jede Aufbauarbeit und jede politische Partizipation zwecklos. Das deutsche Wesen wurde vom westlich-christlichen Materialismus überfremdet, und daher war die Niederlage des verwestlichten Kaiserreiches im Weltkrieg unvermeidbar. Die Republik ist die Fortsetzung des wilhelminischen Staates in anderem Gewande und ebenso wie er dem Untergang geweiht.
Am 30. Januar 1927 legte Hielscher den Aufsatz "Der andere Weg" nach: "Will ein unterworfenes Volk frei werden, so muß es dazu zweierlei tun: es muß erstens innerlich einig werden und zweitens seine staatskünstlerische Begabung betätigen...Für die Betätigung unserer staatskünstlerischen Begabung fehlen uns die Mittel." Der Hauptfeind waren nicht die unterdrückten asiatischen Völker, sondern die "Träger der europäischen Zivilisation...Aber wir bestreiten, daß wir zur Freiheit, d.h. zum selbstherrlichen Gebrauch unserer eigenen Kräfte gelangen können, ohne in entscheidenden Gegensatz zu Europa zu treten...Daher ist es geboten, unsere ganzen Fähigkeiten auf den anderen Weg zu richten, dessen Begehung ebenfalls unumgänglich notwendig ist, auf die endliche Einigung des deutschen Geistes." Angezeigt ist die "mephistophelische Schlangenhaftigkeit und Gewandtheit in der Verschleierung der tiefsten Gründe und Hintergründe". In diesem Kampf sind alle Mittel erlaubt, solange man die eigene Treue nicht verletzt. "Ersichtlich setzt eine solche Handlungsweise eine Sicherheit der inneren Haltung voraus, die kaum überbietbar ist." Der geistige Kampf gilt nicht etwa der etwaigen Undurchsichtigkeit des Handelns, sondern der Vielfältigkeit der fremden Einflüsse. Einzig auf eigenen Willen gegründet ist die Welt eines neuen Geistes, einer machtwilligen Seele zu errichten. "Das ist das Ziel. Der Weg zu ihm führt über eine rücksichtslose strenge Selbsterziehung eines jeden Einzelnen. Er führt über das eindeutige Bekenntnis zu dem Glauben, an den sich die Dichter der alten Sagen, an den sich Eckehart, Luther, Goethe und Nietzsche hingegeben haben. Er führt über die Gestaltung jener Erziehung aus diesem Glauben heraus zur Züchtung eines Geschlechts, das im Opferdienst am deutschen Glauben einig und deshalb, und nur deshalb, berufen ist, das staatskünstlerische Werk zu vollbringen, zu dem die Gegenwart ebensowohl aus einem Mangel an äußerem Willen wie aus innerer Glaubenslosigkeit nicht geeignet ist."
Am 13. Februar 1927 folgte "Die faustische Seele": "Die seelische Zugehörigkeit zum Deutschtum ist das Grunderlebnis der deutschen Menschen. Der letzte große Versuch, sich mit diesem Grunderlebnis im Bewußtsein auseinanderzusetzen, ist Spenglers Lehre von der faustischen Kultur. Der deutsche ist der faustische Mensch. Die faustische Kultur ist das deutsche Seelentum. Spengler sieht es aus dem unendlichkeitsverlorenen Walhall mit seinen tiefen Mitternächten herabsteigen in die Tiefen der Mystik, sieht es zu endlosen Kämpfen, gleichgültig gegen den Tod, das Schwert ziehen, die gotischen Dome wollen den Himmel stürmen, der lutherische Bauerntrotz schlägt drein, ins Grenzenlose schreitet die wälderhafte nordische Musik, unter den zartesten und weltseligsten Melodien ihre gewaltige Einsamkeit verbergend oder sie hinausschreiend in Sturm und Gewitter, aus Not und Elend und Blut steigt das Preußentum empor, und als dem Faust der Zarathustra folgt, erschüttern Wagners Posaunen die Welt und der Preuße Bismarck holt die Krone aus dem Rhein. Dann folgt der Zusammenbruch, und von neuem beginnt der alte Kampf (...)
Ich sehe einen langen Weg. Im Urdämmer der Sage stehen der deutsche Machtwille und die deutsche Innerlichkeit zueinander und sind untrennbar verbunden....Friedrich Nietzsche, der letzte große Träger der deutschen Innerlichkeit, hat den Willen zur Macht gelehrt und so die alte Weisheit wieder geweckt, die von den Tagen der Götter, von den Tagen Sigfrids und Hagens her die deutsche Sittlichkeit verkündet. Wenn unsere Innerlichkeit wieder gelernt haben wird, ihr zu folgen, wenn der deutsche Machtwille nicht mehr alleinstehen wird, erst dann, aber dann sicher, wird die deutsche Zwietracht aufhören, wird sich das deutsche Menschentum vollenden und in seiner Vollendung heimfinden zu dem ewigen Brunnen, aus dem es entstiegen ist."
Verdeutlicht wird diese Darstellung der faustischen Seele durch den Aufsatz "Die Alten Götter". Sagen, Märchen und die germanisch-keltische Mythologie bilden die Heimat der deutschen Seele. Hielscher betont den Kampf als Daseinsprinzip: "Das versteht nur ein Deutscher, daß man sich gegenseitig die tiefsten Wunden schlagen und dennoch die beste Freundschaft halten kann. Denn der Deutsche ist in seinem Innern selber so: hundert- und tausendfältig zerrissen, ein Schlachtgebiet aller holden und unholden Geister, und aus dieser Zerrissenheit seinen Stolz herausholend und eine höhere Einheit, die über allem Ernste sich ein Lächeln bewahrt hat, und über allen Abgründen eine einsame und lichte Höhe, die ihren Glanz in alle Tiefen schickt....Der Kampf ist das Nein, und die Vollendung ist das Ja. Die Geburt des Ja aus dem Nein, die Vollendung im Kampfe, das ist das Lied von den alten Göttern. Es ist das Lied, das alle großen Träger der deutschen Innerlichkeit verkündet haben. Wenn Eckehart die brennende Seele lehrte, in der doch eine ungetrübte schweigende Stille herrscht, wenn Luther im Wirken und durch das Wirken Satans die Allmacht Gottes geschehen sah, wenn Goethe alles Drängen und Ringen als ewige Ruhe in Gott erlebte, wenn endlich Nietzsches Welt des Willens zur Macht, diese Welt des Ewig-sich-selber-Schaffens und Ewig-sich-selber-Zerstörens als endloser Kreislauf zu sich selber guten Willen hatte, so war das immer nur das alte Lied" (der nordischen Mythologie). "So wird der Kampf zum Selbstsinn, und die Treue in diesem Kampfe ist das Höchste. Es gibt nichts anderes. Um des Kampfes willen ist die Innerlichkeit da, weil sie die Kraft zu diesem Kampfe gibt...Das ist eine ganz andere Treue, als die Gegenwart sie kennt. Das ist die Treue, die alles opfert, den Schwur, die Ehre, das eigene Blut; die Treue, die nur das eigene Werk und seine Vollendung im Kampfe kennt."
Das Leben der Völker bemißt sich nach Völkerjahren mit den vier Jahreszeiten. Hielscher zieht zahlreiche Allegorien mit dem Vegetationszyklus eines Baumes. Die Deutschen befinden sich derzeit im Stadium des Winters, ausgelöst durch die "Verstofflichung", den Materialismus der westlichen Zivilisation. Die Entstehung des Materialismus verortet Hielscher bereits zu Zeiten der Renaissance, aus der sich der Frühkapitalismus entwickelte. Der Mensch will nicht mehr gebunden sein, sondern wider seine Natur nur noch von sich selbst abhängen. Religion, Volk, Tradition und Kultur weichen dem Individualismus. Die Menschen haben die Wahl, ob der Winter "die Umkehr oder den Tod bringen (wird), nach unserer Wahl und nach der zukommenden Gnade der Götter".
"Wer die Kälte der Oberfläche ändern wollte, würde als Schwarmgeist scheitern. Desgleichen steht nicht in der Hand der Wurzeln und der Wintersaat und nicht in der Hand des Menschen. Vielmehr ist uns diese Kälte vorgegeben." Jeder Winter birgt den Keim des Frühlings, nicht zuletzt symbolisiert durch die Sonnenwende.
"An der Quelle muß der Strom versiegen, an der Wurzel muß das Unheil absterben. Und in Quelle und Wurzelgrund muß das Heil von neuem gewonnen werden." Das Reich ist noch nicht stark genug, um oberirdisch gedeihen zu können. Es ist verborgen im Inneren seiner Glieder, eines neuen Menschentypus, keine sichtbare Gestalt. Innerlichkeit und Wille zur Macht verknüpfen sich miteinander.
So geht es heute nicht mehr um das Retten des alten abendländischen Leibes, sondern um das Bilden des neuen." Soziale Herkunft und Interessen der Unterirdischen sind gleichgültig. "Und jeder mag unter den Vorbildern sich seinen Helden wählen."
3. Staatskunst
Nachdem Hielscher dergestalt die Notwendigkeit unterstrichen hatte, ein neues Bewußtsein als Grundvoraussetzung erfolgreichen Handelns zu schaffen, wandte er sich außenpolitischen Fragen zu. Im März 1927 veröffentlichte der "Arminius" seinen vielbeachteten Aufsatz "Für die unterdrückten Völker!", der Hielscher gewissermaßen zum Erfinder des Befreiungsnationalismus machen sollte. Wir merken an, daß derartige Gedankengänge auch schon im Werk Moeller van den Brucks auftauchen.
Der Erste Weltkrieg hatte die Völker aller Kontinente aufgerüttelt, so daß jede politische Maßnahme ihre Wirkung verhundertfachte. Auf dem Brüsseler Kongreß der unterdrückten Völker hatten die Farbigen erstmals einmütig ihre Stimme gegen den Westen, gegen Imperialismus und Kolonialismus und für den Nationalismus erhoben. Unter den Bestimmungen des Versailler Diktats war Deutschland mit seiner dem Westen hörigen Demokratie kein souveräner Staat, sondern ebenfalls eine Kolonie. Kein Kontinent stand mehr für sich alleine, sondern neue Aufgaben, Freundschaften und Ziele entwickelten sich. Im Zentrum der Hoffnung Hielschers stand das Erwachen des Giganten China, Indiens oder der arabischen Welt, weniger die Sowjetunion, die ihre "russische" Ideologie allen anderen Völkern aufzwingen wollte und damit kein echter Partner der nach Freiheit strebenden Völker war.
Deutschland ist kein Teil des westlichen Europa, sondern ein Teil des asiatischen Ostens. In der Verehrung des Ostens verbeugt sich der Deutsche "vor einer weiten unendlichen, durchaus uneuropäischen und geheimnisvollen Welt einer sehnsüchtigen und zutiefst ruhigen Weisheit und Selbstsicherheit, aus der er seine Kraft strömen fühle". Die deutsche Innerlichkeit ist ein Widerspruch gegen den Westen und dessen Zivilisationsdenken. "Die Völker des Ostens glauben an unverrückbare Kräfte, denen sie sich verdienstet wissen, aus denen ihre Art entspringt, und zu der sie zurückkehrt, wenn ihre Stunde geschlagen hat. Der Deutsche gehört zum Osten und nicht zum Westen. Der Westen ist Zivilisation, der Osten ist Kultur. Die Zivilisation ist auf dem Gelde und der Berechnung aufgebaut und kennt keine Innerlichkeit. Die Kultur errichtet auf dem Grunde einer unerschütterlichen Gewißheit die Werke einer hohen Kunst, eines demütigen Denkens, einer hingebenden Weisheit. Die Völker des Westens sind Zivilisationsvölker, die Völker des Ostens tragen ihre großen Kulturen."

Im Gegensatz zum kapitalistischen Westen ist der Osten sozialistisch, wobei Sozialismus hier als eine innere Haltung und nicht als theoretisches System zu verstehen ist. Während der Kapitalismus den Menschen seinen Taten entfremdet und dem Nutzen unterwirft, will der Sozialismus die Leistung und das Werk. Die Menschen sind keine Einzelwesen, sondern Glieder von Gemeinschaften. "Der Westen kennt nicht Ideen, sondern Konzerne; er kennt keine Gemeinschaften, sondern wirtschaftliche Verbundenheit."
"Der Westen ist Imperialismus, der Osten ist Nationalismus. Der Nationalismus ist die Folge des Glaubens an die eigene Kultur, der Wille zur Durchsetzung ihrer eigenen Art, der Wille zum Dienst an der Gemeinschaft, die auf der eigenen Kultur beruht. Der Imperialismus ist die Benutzung der nationalen Mittel zur Erlangung wirtschaftlichen Profites, die Umfälschung nationaler Ziele in Wirtschaftsinteressen."
"Wir deutschen Nationalisten werden mit den Nationalisten des Ostens zusammengehen; wir fordern den gemeinsamen Kampf gegen den westeuropäisch-amerikanischen Imperialismus und Siegerkapitalismus, wir fordern die Abkehr der deutschen Wirtschaft von den westlichen Verbundenheiten, die Abkehr der deutschen Geistigkeit vom Westen. Im Osten kämpfen die unterdrückten Völker den gleichen Kampf, den Kampf der Kulturnationen gegen die Zivilisationsvölker, den Kampf der Tiefe gegen die Oberfläche. Verbünden wir uns ihnen. Scheuen wir kein Opfer. Der Osten wartet auf uns. Enttäuschen wir ihn nicht. Wir sind der Vorposten des Ostens gegen den Westen. Der Westen wankt, und der Sturm aus dem Osten hat begonnen. Die deutsche Stunde schlägt."
Hielschers Ausführungen, die sich im übrigen jeder Rassist und Xenophobe einmal etwas intensiver durch den Kopf gehen lassen sollte, trafen auf ein gemischtes Echo. Der Kampfverlag der NS-Parteilinken unterstützte Hielschers internationalistisch-nationalistische Thesen ebenso wie Franz Schauweckers "Standarte". Bezeichnenderweise kam vom hitleristischen "Völkischen Beobachter" und von den Vereinigten Vaterländischen Verbänden schroffe Ablehnung.
Mit seinem philosophisch-politischen Programm stürzte Hielscher sich in die Politik, zunächst eine Reihe geopolitischer Analysen nach obigem Muster im "Arminius" veröffentlichend und jegliche Mitarbeit am Weimarer System heftig kritisierend. Im Juli 1927 beteiligte er sich an der von August Winnig gegründeten Berliner Sektion der Alten Sozialdemokratischen Partei, einer "rechten" Abspaltung der SPD. Als Gruppenorgan fungierte die Zeitschrift "Der Morgen", zu deren Autoren neben Hielscher die Nationalrevolutionäre Eugen Mossakowsky und Karl Otto Paetel gehörten. Anhang aus der Arbeiterschaft konnte kaum gewonnen werden, dafür kamen die bürgerlichen Rebellen.
4. "Das Reich"
Spätestens das ASP-Experiment überzeugte Hielscher von der Sinnlosigkeit tagespolitischer Aktivitäten. In seinen Memoiren "Fünfzig Jahre unter Deutschen" analysiert er die Situation im Nachhinein so: "Will man sich den Ort der Einzelgänger vor Augen führen, so stelle man sich die Parteien als ein Hufeisen vor, an dessen einem Flügel die Nationalsozialisten, an dessen anderem die Kommunisten standen.
Dann finden wir neben den Nationalsozialisten die Deutschnationalen Hugenbergs, neben ihnen die Deutsche Volkspartei Stresemanns und neben ihr das katholische Zentrum, das die Mitte tatsächlich bildete. Links davon sehen wir die Demokraten, hernach die Sozialdemokraten und schließlich die Kommunistische Partei.
Aber mit ihnen schloß sich der Kreis nicht, sondern zwischen ihnen und den Nationalsozialisten klaffte eine Lücke, die sich um so weniger schließen konnte, als die Nationalsozialisten und die Kommunisten bereits nur noch dem Namen nach Parteien waren, in Wirklichkeit aber Horden, und zwar Horden in Bundesgestalt und mit parlamentarischer Maske. Sie wollten Massenbewegungen sein, gaben sich vor ihren gutwilligen Anhängern das Gesicht eines Bundes und spielten nach außen die Partei, um nicht verboten zu werden.
Den Bund kennzeichnet im Aufbau die gegenseitige Verpflichtung zwischen Haupt und Gliedern, im Wesen der Geist, der sie verbindet, sei es nun ein Glaube oder auch nur eine besondere Menschlichkeit, im Sinne der freiwilligen Dienste an diesem Geiste und im Zwecke das Ziel, das er dem Haupte und den Gliedern aufgibt.
Der Horde mangelt im Aufbau die Gegenseitigkeit, im Wesen der Geist, im Sinne der freie Wille und im Zwecke das Ziel. An die Stelle der Gegenseitigkeit tritt der einseitige Gehorsam, an die Stelle des Geistes das Programm, an die Stelle des freien Willens der Zwang und an die Stelle des Zieles der erstrebte Vorteil und Nutzen, sei es des Hordenführers allein, sei es zugleich seiner Garde oder der ganzen Horde.
Die Gestalt des Bundes anzunehmen empfiehlt sich der Horde, wenn das Volk sich wieder nach Bund und Verbundenheit sehnt, weil die Lüge am besten in Gestalt der Wahrheit zu wirken vermag und von ihren abgesplitterten und selbständig genommenen Teilen allein lebt. Mit der Wahrheit zu schwindeln, ist nicht nur die beste, sondern es ist auch die einzige Art der Lüge, die Erfolg haben kann.
Und die Maske der Partei schließlich bietet sich von selber an, weil in Verfallszeiten nicht das Volk, sondern der Bürger herrscht, welcher in den Zweckverbänden der unverbindlichen Parteien sich am besten darzustellen und zu entfalten vermag. (...)
So sehen wir nicht nur an den äußeren Flügeln des Parteienhufeisens zwei offenkundige Horden in Bundesgestalt und mit scheinbündischen Gliederungen wie hier der SA oder der SS und dort dem Rotfrontkämpferbunde, sondern auch bis fast in die Mitte heran jede Partei bemüht, sich eine Horde heranzubändigen oder sich eines Bundes zu versichern. (...)
Zwischen den beiden Hordenflügeln aber kochten die Einzelgänger ihren Trank und bildete sich Bund. Hier schlugen die Flammen von rechts nach links herüber, um der Feuerzange die nötige Glut zu geben."
Auf den Zerfall der "Arminius"-Gruppe folgte ab Oktober 1927 die Zeitschrift "Der Vormarsch", ursprünglich ein Blatt von Kapitän Ehrhardts Wikingbund. Die Schriftleitung lag bei Ernst Jünger und Werner Lass, dem Führer der Schill-Jugend, einem ehemaligen Gefolgsmann des Freikorpsführers Roßbach mit starkem Einfluß in der HJ. Hielscher variierte hier weiterhin seine bekannten Thesen. Der "Vormarsch" wurde zum Zentrum einer bewußt provokativen Militanz. Es kam zur Bildung kleiner revolutionärer Zirkel, die über die Grenzen der Bünde und Parteien zusammenarbeiten. Engere Verbindungen unterhielt der "Vormarsch"-Kreis zur NSDAP, die sich durch ihren sozialrevolutionären Charakter zusehends von den anderen Rechtsverbänden absonderte. Unterhalb der agitatorischen Ebene verkehrte Hielscher in diversen Zirkeln, von denen vor allem der Salon Salinger zu nennen ist. Der jüdischstämmige Hans Dieter Salinger, Beamter im Reichswirtschaftsministerium und Redakteur der "Industrie- und Handelszeitung", versammelte hier einen bunt zusammengewürfelten Kreis um sich. Neben Hielscher sind hier Ernst von Salomon, Hans Zehrer, Albrecht Haushofer, Ernst Samhaber oder Franz Josef Furtwängler, die rechte Hand des Gewerkschaftsführers Leipart, zu nennen.
Im Frühjahr 1928 bildete Friedrich Hielscher, wohl inspiriert durch Salingers Kontaktpool und durch den Schülerkreis des Dichters Stefan George (vor allem in Aufbau und Methode), einen eigenen Zirkel um seine Person. Diesem Kreis fiel beispielsweise indirekt das Verdienst zu, den Brecht-Weggefährten Arnolt Bronnen für die revolutionäre Rechte zu gewinnen. Nach dem Rückzug Jüngers übernahm Hielscher im Juli 1928 gemeinsam mit Ernst von Salomon die Leitung des "Vormarsches", dessen Auflage auf 5000 Exemplare gesteigert werden konnte. Der NS-Studentenbund warb um den unter Studenten und Bündischer Jugend zugkräftigen Intellektuellen, um ihn als Veranstaltungsredner für sich zu gewinnen. Das Verbandsorgan der Ehrhardt-Anhänger und rechten Paramilitärs entwickelte sich zu einer übernational-antiimperialistischen Monatszeitung, die jedoch durch die wirtschaftliche Inkompetenz von Verlagsleiter Scherberning behindert wurde.
Dem Zeugnis Ernst von Salomons zufolge war der Hielscher-Kreis in seiner Anfangsphase jedoch ein Tummelplatz menschlicher Intrigen und Eitelkeiten. Im Herbst 1928 reagierte Hielscher auf die sich abzeichnende Bauernrevolte in Norddeutschland mit der schwächlichen Forderung nach Verminderung der Steuern und einer Agrarreform - offensichtlich hatte er das revolutionär-anarchistische Potential der entstehenden Landvolkbewegung nicht erkannt. Der verärgerte Salomon urteilte im Februar 1929: "Hielscher hat sich für mein Empfinden völlig ausgeschöpft, was er betreibt, ist Leerlauf, schade um ihn. Aber er erkennt das selber nicht, will die Dinge forcieren und erreicht dadurch erst recht nichts. Außerdem führt er einen absonderlichen Lebenswandel, der an seinen Nerven zehrt. Dabei haben die ganzen Leutchen...dickste Illusionen im Kopp..." Hielscher bilde sich ein, "man könne Politik ohne Macht, allein durch Geist und gute Verbindungen machen". Zugleich hielten die heftigen internen Auseinandersetzungen im Hielscher-Kreis mit Intrigen, Verleumdungen und Verdächtigungen an. Salomon kehrte dem "Vormarsch" daraufhin mit der Bemerkung, hier müsse noch einmal "bannig femegemordet" werden, den Rücken und schloß sich den Landvolkterroristen an.
Trotz eines Hitler-Verdikts gegen den "Vormarsch", der angeblich mit dem "asiatischen Bolschewismus" liebäugele, stellte sich der mächtige Gregor Strasser am 25. Oktober 1929 hinter die Gruppe. Ernst Jünger, Franz Schauwecker oder Friedrich Hielscher seien Beispiele für die steigende Tendenz, "daß der Nationalsozialismus beginnt, magnetgleich andere Kreise, andere bisher in ihrer Sphäre festgefügte, gleichwertige Geister an sich zu ziehen." Am gleichen Tag schrieb Hielscher in den "Kommenden": "Stoßen wir also bei unserer nationalistischen Arbeit auf politische Handlungen der russischen Außenpolitik, die gegen den Westen gerichtet sind, so werden wir diese Handlungen begrüßen und nach Möglichkeit fördern. Stoßen wir auf die kommunistische Ideologie selbst, die auf dem dialektischen Materialismus beruht, so werden wir ihr das idealistische Bekenntnis zur Deutschheit entgegenzustellen haben; und wir werden nicht zu vergessen haben, daß der Sozialismus, den wir wünschen, die Unterordnung der Menschen unter den nationalistischen Staat auf wirtschaftlichem Gebiet bedeutet, während der Sozialismus, den Marx anstrebt, das staatenlose, größtmögliche Wohlergehen der größtmöglichen Zahl will."
Im Sommer 1929 legte Hielscher die Chefredaktion des "Vormarsch" nieder, um sich einem eigenen Zeitschriftenprojekt und einem weltanschaulichen Grundlagenwerk zu widmen. Die Monatsschrift "Das Reich" sollte sich zu einem der maßgeblichen Blätter der nationalrevolutionären Szene entwickeln, in der die brillantesten Köpfe aus der Grauzone zwischen NSDAP und KPD zu Wort kamen. In der Rubrik "Vormarsch der Völker" gewährte man den antikolonialen Befreiungsbewegungen und ihren Vertretern breiten Raum, folgerichtig spielten auch vulgärgeopolitische Betrachtungen eine Rolle. Um die Jahreswende 1930/31 beteiligte Hielscher sich gemeinsam mit Jünger und Paetels Sozialrevolutionären Nationalisten an der Deutsch-Orientalischen Mittelstelle zur Förderung des antiimperialistischen Befreiungsnationalismus. Gelder beschaffte Franz Schauwecker vom Stahlhelm-nahen Frundsberg-Verlag, und neben dem altgedienten Putschisten F.W. Heinz sollte Schauwecker sich zu einem der enthusiastischsten Hielscher-Gefolgsleute entwickeln. Weitere Finanzmittel kamen vom unvermeidlichen Kapitän Ehrhardt. Die Debütausgabe des "Reiches" erschien am 1. Oktober 1930, und kein Geringerer als Ernst Jünger steuerte zur Eröffnung einen Beitrag bei.
Hielscher selbst schrieb in "Die letzten Jahre", Weimar und mit ihm die Wilhelminische Ordnung seien im Zerfall begriffen, es gehe wie seine Parteien bis hin zu NSDAP an Selbstzersetzung infolge von Unfähigkeit der Führer zugrunde. Die Weltwirtschaft kranke an der Weimarer Republik wie an einer unheilbaren Wunde. Asien blicke gärend auf Deutschland, von wo der Funke kommen sollte, der den letzten Sprengstoff entzündet: "Die Versuche des Westens, von der Wirtschaft her die kommende Gefahr zu bannen, verfangen nicht mehr. Die Mächte des Ostens tasten eine jegliche nach einem neuen Halt; aber keine hat die Lösung. Niemand weiß weiter. Und in dem deutschen Raum inmitten dieser tausendfältigen Verwirrung brodelt es unaufhörlich.
Hier ist der Ort und hier liegt die Aufgabe für die Menschen des Reiches, die durch den Weltkrieg hindurchgegangen sind; des heimlichen Reiches, das inmitten der Völker sichtbare Gestalt annehmen will. Wer dem Weltkriege seine Haltung und seine Zuversicht verdankt, weiß, daß er ein Sieg des Reiches gewesen ist, den Osten erweckend, den Westen zersetzend, den Zusammenbruch des wilhelminischen Fremdkörpers vorbereitend...
Die Wissenden erkennen sich auf den ersten Blick. Sie haben einander gefunden und finden sich weiter, seitdem die Verwandlung des Weltkrieges ihr Bewußtsein erfüllt hat. Seit dieser Zeit ist die Unruhe zur Arbeit geworden und die Suche zum Entdecken...Die Menschen des unsichtbaren Kerns haben einander entdeckt. Sie rühren keinen Finger gegen den Westen, der sich imn Staat der Weimarer Verrfassung so guit wie jenseits des Atlantischen Ozeans von selbst zerstört. Was heute Erfolg heißt, ist ihnen gleichgültig. Sie haben die große Geduld.
Denn die Entscheidung, die sich heute vorbereitet, liegt tiefer als irgend eine Entscheidung der bisherigen Geschichte. An ihr sind alle Mächte beteiligt. Der Weg zu ihr ist Bekenntnis und Staatskunst zugleich. Nur wo beides ineinanderwirkt, geschieht d a s R e i c h."
Neben dem "Reich" widmete Hielscher sich weiteren publizistischen Projekten, beispielsweise beteiligte er sich am 1931 von Goetz Otto Stoffregen herausgebenenen Sammelband "Aufstand - Querschnitt durch den revolutionären Nationalismus". Im Beitrag "Zweitausend Jahre" hieß es: "Das Kennzeichen, durch welches sich unsere Geschichte von der jedes anderen Volkstums unterscheidet, ist die wechselseitige Verschlungenheit von Innerlichkeit und Macht. Unsere Innerlichkeit enthält den Willen zur Macht; und unsere Macht enthält den Willen zur Innerlichkeit." Innerlichkeit und Machtwille wurden durch den Einbruch des Christentums getrennt. Der Weg der Innerlichkeit führt von der Ursage über Mystik, Reformation und Idealismus bis hin zu Nietzsche. Der Weg der Macht wiederum verlief von Theoderich den Großen über Heinrich VI von Hohenstaufen, Gustav Adolf und Friedrich den Großen bis zu Bismarck. Die wechselseitige Bezogenheit von Innerlichkeit und Macht hatte niemals aufgehört. Immer wieder erfolgten Anläufe, die Einheit beider Begriffe herzustellen, und unter der Macht des Reiches alle germanischen Stämme zu einen. "So ist nun in dreifachem Anlauf vor aller Augen das Ziel errichtet worden, das die Macht des Reiches zu verwirklichen bestimmt ist; und es bedarf der Waffe, mit der die Deutschen das ihnen jetzt sichtbare Ziel erreichen können. Diese Waffe heißt Preußen. Preußen ist kein Stamm, sondern eine Ordnung. Es gibt nur Wahlpreußen. Aus allen Stämmen des Reiches strömen die wagemutigsten, abenteuerlichsten, kriegerischsten Herzen zusammen; es entsteht der Staat Friedrich Wilhelms I und Friedrichs des Großen." Ziel war der Kampf gegen den westlichen Materialismus, "und gerade gegenüber diesem bereits in Deutschland eingedrungenen Gift."
"Ob Luther gegen Rom kämpft, oder ob Goethe den Beginn des Johannesevangeliums neu übersetzt: ‚Im Anfang war die Tat' - immer drängt die Innerlichkeit zum Tun; sie enthält den Willen zur Macht, die Sehnsucht, die das Amt herbeiglaubt und die Menschen zum Werke drängt.
In Nietzsche vollends wird dieser Drang zum bewußten Wollen: die Innerlichkeit erkennt ihr Getriebenwerden als Willen zur Macht." Nietzsche forderte den "ins Geistige gesteigerten Fridericianismus", bindet dieses neue Menschentum an Gestalten wie Friedrich II von Hohenstaufen und Friedrich II. den Großen. Auf Nietzsche und Bismarck folgte der Weltkrieg, der "trotz der scheinbaren Niederlage den größten Sieg bedeutet, den Deutschland jemals errungen hat". "Zum ersten Mal, seit die Erde steht, gibt es keine voneinander abgetrennten Kampffelder mehr, so wie es z.B. den ostasiatischen, den vorderasiatischen oder den Kulturkreis des Mittelmeeres gegeben hat, sondern die Erde ist ein einziges Schlachtfeld geworden, ein Chaos, in welchem alle Kräfte zugleich um den Sieg streiten, ein Chaos, das alle Kräfte durch diesen Streit verwandelt und von Grund auf umschöpft."
 Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.
Im gleichen Jahr legte Friedrich Hielscher sein mit Hilfe des Frundsberg-Verlages herausgebenes Grundlagenwerk "Das Reich" nach. Ein Volk entsteht Hielscher zufolge aus der Gemeinschaft von Schicksal und Bekenntnis. Das Blut erhält seinen Rang durch eine Entscheidung und nicht durch die Biologie. Deutschtum/Deutschheit leiten sich nicht durch Abstammung und staatliche Definition, ab, sondern aus Gesinnung und Glauben. Der Reichsbegriff wird vom politischen zum religiös-metaphysischen, in der Geschichte wirkenden Prinzip einer föderativen Ordnung Europas - unter Führung des preußischen Geistes. Die Nationalstaaten sollten sich in Stämme und Landschaften auflösen, und aus diesen verkleinerten Einheiten war etwas Größeres zu schaffen, das über die Nationalstaaten hinausging.
Ergänzend heißt es in "50 Jahre unter Deutschen": "In Wahrheit muß...im Innern des Menschen angefangen werden, im eigenen zuerst und dann im Bunde mit denen, die des gleichen Willens sind. Aber das ist mit keiner noch so reinen Sittlichkeit zu schaffen, schon gar mit keiner Moral und vollends nicht mit Anordnungen und Vorschrift." Sondern nur der Glaube "gibt uns das Gesetz als das Gebot der Götter"
"Das Reich": "Die schöpferische Kraft kann nicht auf dem einen Gebiet wirken und auf dem anderen nicht. Sie kann nicht vor dem Alltag halt machen oder vor den Umständen oder der Not. Sie erfüllt den ganzen Menschen. Er mag anpacken, was er will, er mag versuchen, sich in nichtige Dinge zu flüchten: Die schöpferische Kraft folgt ihm, sie treibt ihn weiter, und am Ende erkennt er, daß alles, was er angefaßt hat und was ihm begegnet ist, notwendig und gut gewesen ist um seines Werkes willen, für das er lebt, für das er gelebt wird, das durch ihn hindurch wirkt. Darum bilden alle Menschen, hinter denen ein und dasselbe Wesen steht, nicht auf irgendwelchen einzelnen Gebieten, sondern ihr ganzes Leben hindurch, in jeder Hinsicht unabdingbar eine Einheit des Wirkens. Es müssen ein und dieselben Ereignisse sein, die sie fördern oder hemmen: ein und dieselben Begegnungen müssen für sie Tiefe oder Licht bedeuten: sie haben dasselbe Schicksal, das heißt aber: sie sind ein Volk. Kein Ding in Raum und Zeit bindet endgültig: nicht die Abstammung, nicht die Sprache, nicht die Umgebung. Dem alleine steht der einzelne frei gegenüber. Allein seine schöpferische Kraft, die seinen Willen überhaupt erst bildet, aus dem sein Wille in jedem Augenblick gebildet wird, bindet ihn notwendig, sie ist der Kern seines Wesens. Damit unterscheidet sich ein Volk von einem bloßen Abstammungsverband und von jeder Verbindung, die nur durch äußere Umstände zusammengehalten wird...Nur die seelische Besessenheit durch dieselbe schöpferische Kraft gestaltet aus einer Vielheit vertretbarer Menschen ein Volk, indem ein und dieselbe Wirklichkeit durch die Tat bezeugt wird. Das Volk ist Einheit des Bekenntnisses und des Schicksals. (...) Geduld ist die oberste Tugend dessen, der verwandeln will. Wer keine Geduld hat, erreicht nichts.
Die Entscheidung, die sich hier vorbereitet, bedeutet die vollkommene Vernichtung der heutigen Ordnungen und Güter; und es ist an der Zeit, mit jenen hoffnungslosen Gedanken aufzuräumen, die noch retten wollen, was zu retten ist. Es ist nichts mehr zu retten. Alle äußeren Gestaltungen der Gegenwart brauchen und unterstützen die westliche Verfassung des öffentlichen und des Einzellebens. Sie setzen die Heiligkeit des uneingeschränkten Eigentums voraus, den Verdienst als treibenden Anreiz des Handelns und die Wohlfahrt aller als Ziel der Gemeinschaften. Hier darf nichts gerettet werden. Die inneren Güter aber, die nicht des Westens, sondern des Reiches sind, sind unzerstörbar. Wer sie für gefährdet hält, kommt für die deutsche Zukunft nicht in Frage. Denn er glaubt nicht an sie. Wer glaubt, zweifelt nicht.
Die Vernichtung dessen, was heute besteht, ist sogar notwendig. Denn daß der Westen die Entscheidung gerade in dem Raume zwischen Rhein und Weichsel sucht, liegt an dem Rang, den dieses Gebiet innerhalb der - westlichen - Weltwirtschaft besitzt. Weil China, Indien und Rußland bereits zum größten Teile aus ihr heraus gefallen sind, darf sie Deutschland nicht auch noch verlieren, um keinen Preis. Sonst ist sie selbst verloren. Darum setzt der Untergang des Westens die Vernichtung dessenh voraus, was heute Deutschland heißt, was mit dem Wesen des Reiches nur mehr den Namen gemeinsam hat.
Die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges werden gering vor dieser Zukunft. Er hat die Erde noch nicht aufgerufen. Aber der Erste Weltkrieg hat es getan; und dadurch wird die Wucht der nächsten Jahre, der nächsten Jahrzehnte, der nächsten Jahrhunderte größer, als die der fünftausend Jahre bewußter Erdgeschichte, auf die wir zurückblicken können. Wer von dem Werke, das ihm obliegt, die Erhaöltung und Bewahrung überkommender Dinge erwartet, zeigt nur, daß er die Größe der Verwandlung nicht erkannt hat, in der die Völker seit 1914 leben.
Es gibt heute keine sichtbaren Werte des Reiches. Es lebt inwendig in den Herzen; oder es würde nicht leben.Zerschlagen muß das Eigentum werden, das dem Westen gehört, das den westlichen Menschen gehört. Der Westen würde längst besiegt sein, wenn er nicht die Geister der Menschen gefangen hätte, wenn nicht wirklich jeder, der um seines Vorteiles willen lebt, damit zum Werkzeuge, zum Untertan und Helfer des Westens würde. Zerschlagen muß die ständische Haltung werden, weil die hierarchische Befriedung der Stände, die - gutgläubig oder nicht gutgläubig - vom Süden her verkündet wird, nur der pax Romana, der friedevollen Herrschaft Roms sich einfügt, welche die Völker dem Heiligen Stuhle unterwirft, und weil die Ziele Roms mit denen des Westens gemeinsam auf die Erhaltung des Staates der Weimarer Verfassung gerichtet sind. Zerschlagen muß die Möglichkeit der kolonialen Ausdehnung werden, weil der Herrschaftsanspruch des Reiches nichts mit dem kolonialen Märktekampf zu tun hat, weil, nicht nur der Begriff der ‚Kolonie', sondern auch jedes koloniale Streben dem Willen zur prosperity und nicht dem Willen zur Macht dient.
Man darf gewiß sein, daß die allernächsten Jahre diese Vernichtung vorbereiten und fördern werden. Jener Gleichlauf der Selbstzersetzung des Westens und des Aufbaus der Reichszellen, jene langsame und zögernde Annäherung zweier Bahnen, die sich erst im Augenblick der Entscheidung überschneiden, deren Überschneidung der entscheidende Augenblick ist, prägt sich bereits heute - und von Tag zu Tag mehr - in der Verelendung des Volkes aus. Es wird nicht fünf Millionen, sondern fünfundzwanzig Millionen Arbeitslose geben. Es wird nicht mehr Haß und Hoffnung geben, sondern nur noch Verzweiflung und Zuversicht.
Diese Zuversicht, welche die kommende Vernichtung bejaht, glaubt an das unvernichtbare ewige Wesen des Reiches. Sie weiß, daß im Wandel der sichtbaren Geschichte immer nur die unsichtbare Wirklichkeit lebt. Sie weiß, daß eine jede Kraft des Ewigen selber unwandelbar und ewig ist, und daß kein Werk, kein schöpferisches Tun um des zeitlichen Seins willen geschieht, sondern immer und nur um der Macht des Reiches willen, welches sein zeitliches Reden und Schweigen, Tun und Stillesein, sichtbares oder verborgenes Bildnis heraufführt, wie es ihm beliebt. Das kriegerische Herz verwechselt die zeitliche Erhaltung nicht mit der göttlichen Unsterblichkeit. Es ist unsterblich und freut sich der zeitlichen Vernichtung als der Bürgschaft seiner unüberwindlichen Gewalt. Der Untergang, dem sich die Deutschen, und das heißt immer und immer wieder: die Menschen des Reiches, heute aussetzen, führt die Freiheit herauf, um die seit der ersten Schlacht des Ersten Weltkrieges gekämpft wird, die Freiheit, welcher als erwünschtes Werkzeug der Westen selber dient, dessen Griff über die Erde das Zeitalter der großen Kriege des Reiches ermöglicht."
5. Unterirdisch im Dritten Reich
Die Nationalisten alten Schlages und die KPD konnten hier begreiflicherweise nicht folgen. Ernst Niekisch urteilte: "Das ist ja nicht mehr Nationalismus". Alfred Kantorowicz erkannte in der Vossischen Zeitung am 14. September 1931 als einer der wenigen, wohin die Reise ging: Das sei weder Politik noch Philosophie, sondern Theologie. Otto-Ernst Schüddekopf bemerkt sehr treffend, die Disproportion zwischen dem engen deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts und den heraufnahenden globalen Machtkämpfen suchte man im radikalen Nationalismus Weimars zu überwinden. Der Sprung in die Freiheit durch die Idee des "Reiches" der Deutschheit, die mit den Voraussetzungen des deutschen Nationalstaates nichts mehr zu tun hat - der Nationalsozialismus bedeutete demgegenüber einfach Reaktion. Kollektivistisches Denken und bolschewistische Lebensform wurden als typenbildende Kraft akzeptiert. So konnte man die alten Massenparteien aus den Angeln heben und sich selbst als die die Zukunft des Reiches bestimmende Kraft definieren.
Nach der NS-Machtergreifung stellte Friedrich Hielscher die Herausgabe des "Reiches" ein, um sich der unterirdischen Arbeit gegen den Hitlerismus zu widmen. Ziemlich zutreffend rechnete er mit einer Dauer des Tausendjährigen Reiches von ca. 12 Jahren, während der Großteil der nationalrevolutionären Parteigänger Hitler zu diesem Zeitpunkt nicht ernst nahm. Während Persönlichkeiten wie Schauwecker sich der neuen Ordnung anpaßten, blieben Friedrich Hielscher, die Gebrüder Jünger und Ernst Niekisch als intellektuelle Kristallisationspunkte des nationalrevolutionären Untergrundes. Der Hielscher-Zirkel entwickelte sich zu einer kleinen Untergrundzelle, zu der auch der ehemalige Ehrhardt-Adjutant Franz Liedig gehörte. Über Liedig und August Winnig hielt die Gruppe lockeren Kontakt zu oppositionellen Militärs. Verbindungen bestanden zur sozialdemokratischen Gruppe um Mierendorff, Leuschner, Haubach und Reichwein.
Von größerer spiritueller Bedeutung war die 1933 nach dem Umzug nach Potsdam erfolgte Gründung der Unabhängigen Freikirche UFK als heidnisch-pantheistischer Glaubensbewegung auf indogermanischer Grundlage: "Ich glaube an Gott den Alleinwirklichen. Ich glaube an die ewigen Götter. Ich glaube an das Reich." Heidnische Elemente aus der deutschen Klassik und Romantik wurden mit dem ketzerischen Pantheismus eines Johannes Scotus Eriugenas, Nietzsche und dem überlieferten keltisch-germanischen Volksglauben verknüpft zu einer sehr bald für Außenstehende äußerst schwer zu erfassenden theologischen Einheit. Die Theologie der UFK war kein statisches Gebilde, sondern wie das Reich eine dynamisch weiterzuentwickelnde Aufgabe.
1934 beteiligte Hielscher sich am von Curt Horzel herausgegebenen Sammelband "Deutscher Aufstand" und veröffentlichte wahrhaft prophetische Sätze: "Erster Satz: Der wilhelminische Staat hat den Krieg verloren, aber Deutschland hat ihn gewonnen.
Zweiter Satz: Deutschland hat den Krieg nicht nur dadurch gewonnen, daß es neue innere Kraftquellen erschlossen hat, sondern auch durch die Erschütterung der ganzen Erde, durch die alle Voraussetzungen aller Völker ins Wanken geraten sind.
Dritter Satz: durch die von Deutschland ausgehende Erschütterung ist es zum entscheidenden Lande auch des vor uns stehendem Zweiten Erdkrieges geworden." Diesen hatten schon Nietzsche, Trotzki und Ludendorff prophezeit. "Es leuchtet ein, daß dort, wo alle Kräfte sich überschneiden, die Entscheidung fallen muß." Der Kampf zwischen Imperialismus und Revolution wird hier ausgefochten, zwischen Bolschewismus und Hochkapitalismus, zwischen Asien und West. Deutschland als Land der Mitte sucht nach einer Synthese zwischen den Gegensätzen. Als Ausweg forderte Hielscher den Kontinentalblock Deutschland-Sowjetunion-China.
Eine beinahe antik anmutende Tragödie nahm ihren Anfang, als Hielschers Freund und Schüler Wolfram Sievers 1935 zum Geschäftsführer der SS-nahen Kulturstiftung Ahnenerbe avancierte. Die völkisch-indogermanischen Elitevorstellungen der Hielscher-Gruppe trafen sich durchaus mit denjenigen der SS. Hatte Hielscher sich in den Elfenbeinturm zurückgezogen, so versuchte der aktivistische Praktiker Sievers nun, das Konzept in die Tat umzusetzen und geriet außer Kontrolle. Zunächst beteiligte der Geschäftsführer sich daran, das bäuerlich-defensive Element des Reichsnährstandes aus dem Ahnenerbe hinauszudrängen und stattdessen dem soldatischen Charakter der SS-Ideologie mehr Platz zu verschaffen. Von Bedeutung war neben frühgeschichtlichen, volkskundlichen und indogermanologischen Forschungen z.B. der Versuch, die deutschen Hochschulen zwecks Schaffung eines neuen wissenschaftlichen Geistes von der Schutzstaffel infiltrieren zu lassen. Im Januar 1941 legte Sievers in einem internen Memorandum die Ziele der Erforschung von Raum, Geist und Tat des nordischen Indogermanentums dar: "Hauptziel ist es, vom Kulturellen her in Deutschland selbst das Reichsbewußtsein neu zu wecken, bezw. zu vertiefen, von dessen einstiger Größe beispielsweise ein Straßburger Münster, die Prager Burg, das Fuggerhaus auf dem Warschauer Altmarkt, die flandrischen Tuchhallen noch heute Zeugnis ablegen über Jahrhunderte hinweg, in denen das Reich schwach und im böhmisch-mährischen Raum, in den Niederlanden, im Flamentum, in der Schweiz das Gefühl der Zugehörigkeit zum Reich verloren gegangen war. Es wird notwendig sein, die Verbindungen bloß zu legen, die dennoch niemals abgerissen sind, die Überfremdung durch Kirche, Liberalismus, Freimaurerei und Judentum hinwegzuräumen und die Wiedervereinigung der Menschen germanischen Blutes im Reich zu erleichtern, das - lange seiner selbst durch internationale Ideologien entfremdet - trotz allem germanische Art am stärksten gewahrt hat."
Mit Kriegsausbruch verstrickte das Ahnenerbe sich in kulturelle Beutezüge im besetzten Europa und in verbrecherische Menschenversuche, die Sievers nach dem Zusammenbruch die Hinrichtung einbringen sollten. Immerhin gestattete die Tätigkeit für das Ahnenerbe ab 1937 auch Hielscher, unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Aufträge umherzureisen und Verbindungen zu Oppositionellen zu halten. Am 2. September 1944 wurde er in Marburg wegen seiner Beziehungen zu Mitverschwörern des 20. Juli verhaftet und ins Berliner Männergefängnis an der Lehrterstraße verbracht. Die Gestapo übersah die Beziehungen zu Franz Liedig oder Hartmut Plaas und interessierte sich vor allem für die Kontakte zu Haubach, Reichwein und dem Grafen von der Schulenburg. Der alarmierte Sievers erwirkte am 19. Dezember 1944 die Haftentlassung. Hielscher mußte sich zur Frontbewährung melden, die er bei einer Ersatz-Nachrichtenabteilung verbrachte, ohne auch nur einen Schuß abzugeben. Nach dem Zusammenbruch konzentrierte Friedrich Hielscher seine wissenschaftliche und weltanschauliche Arbeit auf das studentische Verbandsleben und die Unabhängige Freikirche.
"Der Blick auf die Vergangenheit lehrt uns die Notwendigkeit, der Blick in die Zukunft lehrt uns die Freiheit. Die Vergangenheit zeigt, was vorgegeben, die Zukunft, was uns aufgegeben ist. Die Zeit ist weder unser Herr, noch unser Feind oder Freund, sondern die Zeit sind wir selber als die Wandelnden und sich Verwandelnden, und jeder ist es zu seinem Teile. Wer also der Zeit absagt, sagt damit entweder anderen ab oder sich selbst und seiner eigenen Aufgabe. Und zwar Anderen, die heute so herrschen, wie man nicht herrschen sollte, oder sich, indem er jenen gehorcht.
Das Zweite liegt uns fern. Und damit sind wir gebunden, der unrechten Herrschaft die Wurzel abzugraben. Also doch gebunden? Jawohl; und wir haben nur die Wahl, entweder gebunden im Gewissen und damit frei vor der Welt, oder unverbindlichen Gewissens und damit der Welt untertan zu leben.
Auch ist festzuhalten, daß die Freiheit oder Untertänigkeit vor der Welt von anderer Art ist als die Gebundenheit oder Ungebundenheit des Gewissens. Dort geht es um unsere Bewegungsfreiheit, die wir zu verteidigen oder preiszugeben uns entschließen müssen, hier um unsere Willensfreiheit, mit der wir uns an das binden oder nicht binden, was uns im Gewissen geboten ist.
Und verknüpft sind beide, die Willens- und die Handlungsfreiheit, nur insoferne, als sich über kurz oder lang der zweiten begibt, wer die erste mißbraucht." (Fünfzig Jahre unter Deutschen)
Literaturhinweise:
Peter Bahn: Glaube - Reich - Widerstand. Zum 10. Todestag Friedrich Hielschers, in: wir selbst 1-2/2000
Louis Dupeux: "Nationalbolschewismus" in Deutschland 1919-1933, München 1985
Friedrich Hielscher: Innerlichkeit und Staatskunst, Arminius 26.12.1926
Friedrich Hielscher: Der andere Weg, Arminius 30.01.1927
Friedrich Hielscher: Die Faustische Seele, Arrminius 13.02.1927
Friedrich Hielscher: Die Alten Götter, Arminius 20.02.1927
Friedrich Hielscher: Für die unterdrückten Völker! Arminius 20.03.1927
Friedrich Hielscher: Fünfzig Jahre unter Deutschen, Hamburg 1954
Friedrich Hielscher: Das Reich, Berlin 1931
Curt Hotzel: Deutscher Aufstand, Stuttgart 1934
Michael H. Kater: Das "Ahnenerbe" der SS 1935-1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart 1974
Markus Josef Klein: Ernst von Salomon. Eine politische Biographie, 1994 Limburg an der Lahn
Susanne Meinl: Nationalsozialisten gegen Hitler. Die nationalrevolutionäre Opposition um Friedrich Wilhelm Heinz, Berlin 2000
N.N.: Das Innere Reich, in Sturmgeweiht, Ausgabe Sommer 1995
Karl O. Paetel: Versuchung oder Chance? Zur Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus, Göttingen 1965
Otto Ernst Schüddekopf: Linke Leute von Rechts. Nationalbolschewismus in Deutschland von 1918-1933, Stuttgart 1960
Sonnenwacht. Briefe für Heiden und Ketzer, Ausgabe 12, 2000
Goetz Otto Stoffregen (Hrsg.): Aufstand. Querschnitt durch den revolutionären Nationalismus, Berlin 1931
ZIRKULAR, Ausgaben 1 bis 3, 2001
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, allemagne, années 20, années 30, années 40, philosophie, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 31 octobre 2009
Hommage de Günter Rohrmoser à Ernst Jünger

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Hommage de Günter Rohrmoser, philosophe et sociologue conservateur
Mon rapport à Ernst Jünger a plutôt été celui de la distance. Je ne suis pas, me semble-t-il, la personne appropriée pour lui rendre hommage à l'occasion de son décès, ni pour prendre position à l'endroit de l'ensemble de son œuvre. Dieu merci, Ernst Jünger n'est pas resté toujours le même homme. L'Ernst Jünger de la première guerre mondiale, l'Ernst Jünger du temps de la République de Weimar, l'Ernst Jünger du temps du Troisième Reich et l'Ernst Jünger d'après la seconde guerre mondiale sont autant de facettes très différentes d'une œuvre qui embrasse l'ensemble du siècle. C'est incontestable: il appartient à l'aréopage des plus grands écrivains de ce siècle. Et si le socialiste Mitterrand ne s'était pas affirmé comme un très bon connaisseur et un admirateur de l'œuvre de Jünger, la querelle stérile entre la gauche et la droite à propos de sa personne aurait continué bon train. Pour moi, aujourd'hui comme hier, l'œuvre principale de Jünger reste Der Arbeiter. Ce livre a été interprété comme une contribution de l'auteur au national-socialisme, ce qui est complètement faux. Der Arbeiter est l'une des plus grandes descriptions physiognomiques de notre siècle; les paysages terrifiants du “cœur aventureux” en sont le complément. Certes, le Travailleur est un mythe: il n'a pas grand' chose à voir avec la réalité ouvrière du 20ième siècle. Mais, depuis, le monde s'est transformé et ressemble désormais à un paysage d'ateliers et de fabriques; tout est devenu travail et, comme auparavant, nous luttons pour faire advenir ce que Jünger nommait une “construction organique”, c'est-à-dire une nouvelle fusion entre l'homme et la technique. Avec ces paroles, il a touché notre siècle en plein cœur. Ensuite, ce n'est nullement un hasard si, avec cet ouvrage, il a plus profondément influencé Heidegger que celui-ci n'a bien voulu l'admettre. Personnellement, je ne trouve guère d'inspiration dans le Jünger d'après la seconde guerre mondiale. Je me souviens que Carl Schmitt annonçait, tout étonné, mais aussi à moitié amusé, qu'Ernst Jünger pensait que l'éon chrétien s'achevait. La spéculation qui calcule l'âge de la Terre et qui, dans une certaine mesure, dérive des travaux d'Oswald Spengler, ne sont pas du goût de tout le monde. Jünger a certes été un homme pie(ux), mais il était très éloigné du christianisme, plus éloigné sans doute que d'un païen de l'antiquité.
Günter ROHRMOSER.
(texte paru dans Junge Freiheit, n°9/98).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, conservatisme, ernst jünger, allemagne, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, hommages |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 29 octobre 2009
Hommage de Günter Maschke à Ernst Jünger
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
 L'hommage de Günter Maschke
L'hommage de Günter Maschke
«L'intelligence se soumet dès qu'elle accepte une question, indépendamment du fait qu'on y répondra oui ou non», notait Ernst Jünger après la première guerre mondiale. A cette époque, après 1918, il y avait encore assez d'intellectuels dans l'Allemagne vaincue qui avaient la force de rejeter l'impudence des puissances victorieuses et de leurs valets allemands qui voulaient imposer au pays leurs recettes libérales-démocratiques. Aujourd'hui, la situation est devenue beaucoup plus difficile, et c'est la raison pour laquelle il nous faut apprendre le désinvolture jüngerienne. Tel est notre devoir supérieur.
Günter MASCHKE.
(hommage publié par Junge Freiheit, n°9/98).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, philosophie, hommages, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 octobre 2009
Spengler, Jahre der Entscheidung
Spengler, Jahre der Entscheidung |
 Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“ Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“"www.webcritics.de vom 08.11.2007" BUCHBESTELLUNG |
| Ohne Zweifel sind die Schriften des Geschichtsphilosophen, Kulturhistorikers und politischen Schriftstellers Oswald Spengler (1880–1936), des „Philosophen des Schicksals“ (Frank Lisson) wieder aktuell. Mit der vorliegenden Schrift hat Frank Lisson die letzte Schrift Spenglers neu herausgebracht und mit einem interessanten Vorwort versehen. Bei der Lektüre meint man, daß dies das stimmungsmäßig resignierendste und verzweifeltste Buch ist, welches in Deutschland je unter der Rubrik „politische Schrift“ erschienen ist. |
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, philosophie, révolution conservatrice, conservatisme, droite, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 octobre 2009
La Guerre comme expérience intérieure
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
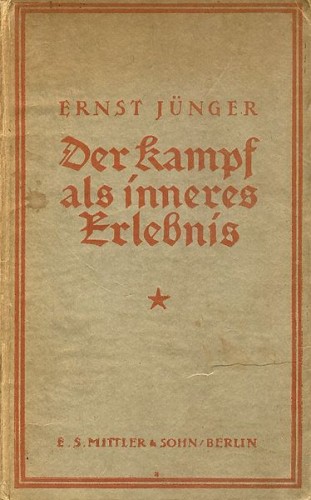 La Guerre comme Expérience Intérieure
La Guerre comme Expérience Intérieure
Analyse d'une fausse polémique
«Pour le soldat, le véritable combattant, la guerre s'identifie à d'étranges associations, un mélange de fascination et d'horreur, d'humour et de tristesse, de tendresse et de cruauté. Au combat, l'homme peut manifester de la lâcheté ou une folie sanguinaire. Il se trouve alors écartelé entre l'instinct de vie et l'instinct de mort, pulsions qui peuvent le conduire au meurtre le plus abject ou à l'esprit de sacrifice» (Philippe Masson, L'Homme en Guerre 1901-2001, Editions du Rocher, 1997).
Voici quelques mois paraissait, dernière publication française du vivant de Ernst Jünger, La Guerre comme Expérience Intérieure, préfacée par le philosophe André Glucksmann, chez Christian Bourgois éditeur, maison qui depuis des années s'est fait une spécialité des traductions jüngeriennes. Un texte d'importance, qui vient utilement compléter les écrits de guerre déjà parus de l'écrivain allemand, Orages d'Acier, Boqueteau 125, et Lieutenant Sturm, ouvrages de jeunesse que les spécialistes de son oeuvre polymorphe considèrent à la fois comme les plus vindicatifs, initiateurs de ses prises de position politique ultérieures, et parallèlement déjà annonciateurs du Jünger métaphysique, explorateur de l'Etre, confident de l'intimité cosmique.
Engagé volontaire au premier jour des hostilités en 1914, quatorze fois blessé, titulaire de la Croix de Fer Première Classe, Chevalier de la Maison des Hohenzollern, de l'Ordre «Pour le Mérite», distinction suprême et rarissime pour un homme du rang, Ernst Jünger publie dès 1920, à compte d'auteur et, comme il se plaira à dire par la suite, «sans aucune intention littéraire», In Stahlgewittern (Les Orages d'Acier), qui le révèlent d'emblée au milieu des souvenirs tous larmoyants des Barbusse, Remarque, von Unruh ou Dorgelès, comme un rescapé inclassable, un collectionneur tant de révélations ontologiques que de blessures physiques et morales. André Gide et Georges Bataille crieront au génie.
Une théorie du guerrier émancipé
Estimant ne pas avoir épuisé son sujet, il surenchérit en 1922 par la publication de Der Kampf als inneres Erlebnis (La Guerre comme Expérience intérieure), qu'il dédie à son jeune frère Friedrich Georg Jünger, lui aussi combattant émérite de la guerre mondiale et talentueux publiciste: «A mon cher frère Fritz en souvenir de notre rencontre sur le champ de bataille de Langemarck». Il découpe son manuscrit en treize courts tableaux, autant de souvenirs marquants de SA guerre, qu'il intitule sans fard Sang, Honneur, Bravoure, Lansquenets, Feu ou encore Veillée d'armes. Nulle trace d'atermoiement dans la plume de Jünger, nul regret non plus: «Il y a davantage. Pour toute une partie de la population et plus encore de la jeunesse, la guerre apparaît comme une nécessité intérieure, comme une recherche de l'authenticité, de la vérité, de l'accomplissement de soi (...) une lutte contre les tares de la bourgeoisie, le matérialisme, la banalité, l'hypocrisie, la tyrannie». Dans ces quelques mots tirés de W. Deist, extraits de son article Le moral des troupes allemandes sur le front occidental à la fin de 1916 (in Guerre et Cultures, Armand Colin, 1994), transparaît l'essentiel du Jünger de l'immédiat après-guerre.

Préambule au récit, la lecture de la préface d'André Glucksmann laisse bien sceptique quant à sa légitimité. «Le manifeste, ici réédité, est un texte fou, mais nullement le texte d'un fou. Une histoire pleine de bruit, de fureur et de sang, la nôtre». En s'enferrant dans les classiques poncifs du genre, le philosophe relègue la pensée de Jünger à une simple préfiguration du national-socialisme, fait l'amalgame douteux entre Der Kampf... et Mein Kampf. Et s'il note avec justesse que le Lansquenet du présent ouvrage annonce le Travailleur de 1932, il n'en restreint pas moins l'œuvre de Jünger à la seule exaltation de la radicalité, du nihilisme révolutionnaire (citant pêle-mêle Malraux, Breton et Lénine), à l'union du prolétariat et de la race sans distinguer la distance jüngerienne de la soif de sang et de haine qui nourriront fascisme, national-socialisme et bolchévisme. A vouloir moraliser un essai par essence situé au-delà de toute morale, Glucksmann dénature Jünger et passe à coté de son message profond.
L'ennemi, miroir de sa propre misère
Là où Malraux voit le «fondamental», Jünger perçoit «l'élémentaire». L'adversaire, l'ennemi n'est pas le combattant qui se recroqueville dans le trou d'en face mais l'Homme lui-même, sans drapeau, l'Homme seul face à ses instincts, à l'irrationnel, dépouillé de tout intellect, de tout référent religieux. Jünger prend acte de cette cruelle réalité et la fait sienne, s'y conforme et retranscrit dans ces pages quelles purent être les valeurs nouvelles qui en émergèrent, terribles et salvatrices, dans un esprit proche de celui de Teilhard de Chardin écrivant: «L'expérience inoubliable du front, à mon avis, c'est celle d'une immense liberté». Homo metaphysicus, Jünger chante la tragédie du front et poétise l'empire de la bestialité, champ-clos où des siècles de civilisation vacillent et succombent sous le poids des assauts répétés et du fracas des bombardements. «Et les étoiles alentour se noient en son brasier de feu, les statues des faux dieux éclatent en tessons d'argile, et de nouveau toute forme forgée se fond en mille fourneaux ardents, pour être refondue en des valeurs nouvelles». Et dans cet univers de fureur planifiée, le plus faible doit «s'effacer», sous les applaudissements d'un Jünger darwiniste appliqué qui voit l'homme renouer avec sa condition originelle de guerrier errant. «C'est ainsi, et depuis toujours». Dans la lutte paroxystique que se livrent les peuples sous l'emprise hypnotique des lois éternelles, le jeune lieutenant des Stoßtruppen discerne l'apparition d'une nouvelle humanité dont il commence à mesurer la force, terrible: «une race nouvelle, l'énergie incarnée, chargée jusqu'à la gueule de force».
Jünger lègue au lecteur quelques-uns des plus beaux passages sur ces hommes qui, comme lui, se savent en sursis, et rient de se constater encore vivants une aube après l'autre: «Tout cela imprimait au combattant des tranchées le sceau du bestial, l'incertitude, une fatalité toute élémentaire, un environnement où pesait, comme dans les temps primitifs, une menace incessante (...) Dans chaque entonnoir du no man's land, un groupe de chuchoteurs aux fins de brusques carnages, de brève orgie de feu et de sang (...) La santé dans tout cela? Elle comptait pour ceux qui s'espéraient longue vieillesse (...) Chaque jour où je respire encore est un don, divin, immérité, dont il faut jouir à longs traits enivrés, comme d'un vin de prix». Ainsi entraîné dans le tourbillon d'une guerre sans précédent, totale, de masse, où l'ennemi ne l'est plus en tant que défenseur d'une patrie adverse mais qu'obstacle à la réalisation de soi —miroir de sa propre misère, de sa propre grandeur— le jeune Jünger en vient de facto à remettre en cause l'héritage idéologique de l'Aufklärung, son sens de l'Histoire, son mythe du progrès pour entrevoir un après-guerre bâti sur l'idéal de ces quelques-uns, reîtres nietzschéens fils des hoplites de Salamines, des légions de Rome et des Ligues médiévales appliquant l'éthique de la chevalerie moderne, «le marteau qui forge les grands empires, l'écu sans quoi nulle civilisation ne tient».
Un sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation
L'horreur au quotidien, Jünger la connaît, qui la côtoie sans répit et la couche sans concession aucune sur le papier —«On reconnaît entre toutes l'odeur de l'homme en putréfaction, lourde, douceâtre, ignoblement tenace comme une bouillie qui colle (...) au point que les plus affamés en perdaient l'appétit»— mais, à la grande différence des bataillons qui composeront les avant-gardes fascistes des années vingt et trente, il n'en retire ni haine ni nationalisme exacerbé, et rêve bien plutôt d'un pont tendu au-dessus des nations entre des hommes forgés sur le même moule implacable des quatre années de feu et de sang, répondant aux mêmes amours viriles: «Le pays n'est pas un slogan: ce n'est qu'un petit mot modeste, mais c'est aussi la poignée de terre où leur âme s'enracine. L'Etat, la nation sont des concepts flous, mais ils savent ce que pays veut dire. Le pays, c'est un sentiment que la plante est capable d'éprouver». Loin de toute xénophobie, vomissant la propagande qui attise des haines factices, le «gladiateur» Jünger, amoureux de la France et que touche plus qu'un éclat d'obus de s'entendre qualifié de “boche”, se déclare ainsi proche des pacifistes, «soldats de l'idée» qu'il estime pour leur hauteur d'esprit, leur courage pour ceux qui ne craignent pas seulement de mourir au feu, et leur sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation. Aussi peut-il songer lors des accalmies, tapi dans son repli de tranchée, à l'union nouvelle des lansquenets et des pacifistes, de D'Annunzio et Romain Rolland. Effet des bombes ou prophétisme illuminé, toujours est-il que La Guerre comme Expérience intérieure prend ici une dimension et une résonance largement supérieures à celles des autres témoignages publiés après-guerre, et que se dessine déjà en filigrane le Jünger de l'autre conflit mondial, celui de La Paix.
Ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire
«La guerre m'a profondément changé, comme elle l'a fait, je le crois, de toute ma génération» et si elle n'est plus «son esprit est entré en nous, les serfs de sa corvée, et jamais plus ne les tiendra quittes de sa corvée». L'oeuvre intégrale d'Ernst Jünger sera imprégnée de la sélection dérisoire et arbitraire du feu qui taillera dans le vif des peuples européens et laissera des séquelles irréparables sur la génération des tranchées. On ne peut comprendre Le Travailleur, Héliopolis, Le Traité du Rebelle sans se pénétrer du formidable (au sens originel du terme) nettoyage culturel, intellectuel et philosophique que fut la «guerre de 14», coupure radicale d'avec tous les espoirs portés par le XXème siècle naissant.
Ce qui fait la force de Jünger, son étrangeté au milieu de ce chaos est que jamais il ne se résigne et persiste à penser en homme libre de son corps et de son esprit, supérieur à la fatalité —«qui dans cette guerre n'éprouva que la négation, que la souffrance propre, et non l'affirmation, le mouvement supérieur, l'aura vécue en esclave. Il l'aura vécue en dehors et non de l'intérieur». Tandis qu'André Glucksmann se noie dans un humanisme béat et dilue sa pensée dans un moralisme déplacé, Jünger nous enseigne ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire.
«De toute évidence, Jünger n'avait jamais été fasciné par la guerre, mais bien au contraire, par la paix (...) Sous le nom de Jünger, je ne vois qu'une devise: «Sans haine et sans reproche» (...) On y chercherait en vain une apologie de la guerre, l'ombre d'une forfanterie, le moindre lieu commun sur la révélation des peuples au feu, et —plus sûr indice— la recherche des responsabilités dans les trois nombreux conflits qui de 1870 à 1945, ont opposé la France à l'Allemagne». (Michel Déon, de l'Académie Française)
Laurent SCHANG.
Ernst JÜNGER, La Guerre comme Expérience Intérieure, préface d'André Glucksmann, Christian Bourgois éditeur, 1997.
00:19 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, première guerre mondiale, révolution conservatrice, allemagne, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, weimar, années 20, années 30, militaria, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 octobre 2009
L'instant brûlant
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
L'instant brûlant
Quand meurt un homme, le chant de sa vie est joué dans l'éther. Il a le droit d'écouter jusqu'à ce qu'il passe au silence. Il prête alors une oreille si attentive au milieu des souffrances, de l'inquiétude. En tout cas, celui qui imagina le chant était un grand maître. Cependant, le chant ne peut être perçu dans la pureté du son que là où disparaît la volonté, là où elle cède à l'abnégation (1).
Ernst Jünger s'est avancé, ce 17 février 1998, vers des régions où les ciseaux de la Parque ne tranchent pas.
Les réactions lorsque fut annoncé ce deuil dans le monde des Lettres et de la pensée furent tristement coutumières. En ces temps où prévaut le “politiquement conforme”, certains critiques se sont distingués par des analyses sinon élogieuses (comme l'excellent article de Dominique Venner paru dans Enquête sur l'Histoire) du moins pertinentes (dans un magazine allemand inattendu, Focus). D'autres, zélés contempteurs inféodés à une idéologie qu'ils servent dans les organes de la presse française et allemande, se sont empressés de diffamer une œuvre qu'ils ne se sont jamais donnés la peine de lire et l'avouent parfois. Diable! Le personnage est agaçant: doté tout à la fois d'un esprit d'une rare fécondité et d'une vigueur physique non moins surprenante qui lui a permis de traverser la presque totalité du XX° siècle, ce plus que centenaire n'a eu de cesse d'aimer son pays, de ne se rétracter en rien: écrits bellicistes à l'issue de la Première Guerre mondiale, vision élitiste, contemplation douloureuse lors de l'entre-deux guerres... Il n'a rien renié; seul parfois l'angle de la perspective devait changer, mais faut-il forcer un homme à n'être qu'un bloc monolithique? Toutefois, est-il décent, en cette période, de s'irriter des réactions coutumières quand on prononce le nom de Jünger, de dresser dès à présent le bilan de l'œuvre? Les lecteurs fidèles préféreront encore se tourner vers cet Eveilleur qui a su nous offrir une élégante méditation philosophique et poétique sur les maux qui rongent notre civilisation.
Les ciseaux de la Parque... Par respect pour ce “passage” qui intriguait tant Ernst Jünger, nous évoquerons dans ces colonnes sa métaphysique de la mort, qui apparaît dès 1928 dans la première version du Cœur aventureux. Car à force d'avoir voulu préciser les choix politiques souvent au sens large de Jünger, on a souvent oublié que cet auteur, s'il avait voulu agir sur l'histoire, ne s'intéressait pas moins aux questions d'ordre spirituel. Or, parler de la mort consiste justement à se plonger dans les eaux régénératrices de la spiritualité. Reportons-nous à un texte révélateur de 1928
La vie est un nœud qui se noue et se dénoue dans l'obscurité. Peut-être la mort sera-t-elle notre plus grande et plus dangereuse aventure, car ce n'est pas sans raison que l'aventurier recherche ses bords enflammés (2).
Le symbole de l'entortillement
Procréation et mort marquent la fin du lacet, de ce noeud coulant qui, relié à son principe du domaine éternel, pénètre dans le règne terrestre. Pour Jünger, vie et mort sont intimement liées. Dans sa seconde version du Cœur aventureux qui paraît en 1938, Jünger recourt une nouvelle fois au symbole de l'entortillement. La théorie du lacet fait alors partie intégrante de l'initiation de Nigromontanus, maître mystérieux et charismatique. Le principe qu'il explique suppose une manière supérieure de se soustraire aux circonstances empiriques.
Il [Nigromontanus] nommait la mort le plus étrange voyage que l'homme puisse faire, un véritable tour de passe, la capuche de camouflage par excellence, aussi la plus ironique réplique dans l'éternelle controverse, l'ultime et l'imprenable citadelle de tous les êtres libres et vaillants (3).
Cet aspect nous ramène aux liens qu'entretiennent la mort et la liberté pour Jünger. Qui craint la mort doit renoncer à sa liberté. Le renforcement puissant de cette dernière n'est possible que si l'on part de la certitude que l'homme, en mourant, ne disparaît pas dans le néant, mais se voit élevé dans un être éternel. Aussi la pensée de Jünger tourne-t-elle sans cesse autour de la mort, parce qu'il veut infiniment fortifier la position de la liberté et assurer l'essence éternelle de l'homme. Ces idées acquises sur les champs de bataille, il les émet encore dans Heliopolis en 1949 et dans l'essai Le Mur du Temps, paru en 1959.
Celui qui ne connaît pas la crainte de la mort est l'égal des dieux (4).
Une conception grecque et platonicienne de la mort
La conception jüngerienne de la mort, en rien chrétienne, est influencée par la pensée grecque, notamment platonicienne. Les lectures attentives des dialogues Phédon, Gorgias, La République (notamment le X° chapitre) ont laissé leur trace dans l'œuvre jüngerienne. L'anamnèse platonicienne, nous la retrouvons formulée dans la deuxième version du Cœur aventureux et plus précisément dans “La mouche phosphorescente”. Jünger rapporte de la conversation de deux enfants qu'il surprit un jour cette phrase qui fusa, telle une illumination intellectuelle:
Et sais-tu ce que je crois? Que ce que nous vivons ici, nous le rêvons seulement; mais quand nous serons morts, nous vivrons la même chose en réalité (5).
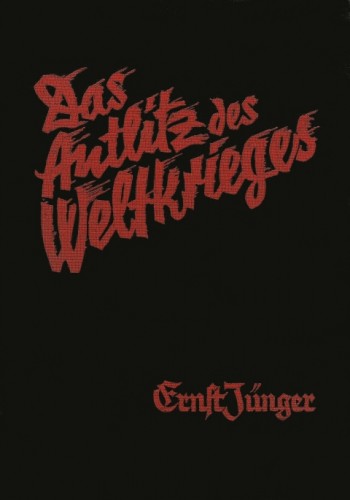 La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!
La vie semble se réduire à n'être que le reflet de cette vie véritable, impérissable, qui ne jaillit qu'au-delà de la mort. Voyons-y une fois encore le triomphe de l'être intemporel sur l'existence terrestre, qui est déterminée par le temps qui s'écoule perpétuellement!
Nous trouvons chez Jünger une inversion de la mort, comme si cette dernière signifiait en fait le réveil d'un rêve étrange, peut-être même mauvais. Cela n'est pas sans évoquer la métaphysique de la mort, telle que l'avait formulée le romantique Novalis dans les Hymnes à la Nuit et le roman Heinrich von Ofterdingen.
Le monde devient rêve, le rêve devient monde [...]
Mélancolie et volupté, mort et vie
Sont ici en intime sympathie (6)
Idéalisation de la nuit et goût de l'outre-tombe
L'idéalisation de la nuit qui apparaît au cours du XIX° siècle dans le culte lamartinien de l'automne, le goût de l'outre-tombe, l'attraction de la mort sur Goethe, sur Novalis et sur Nodier, la nécrophilie de Baudelaire, jette encore des feux de vie dans la pensée de Jünger. Le procès intenté à la raison comme nous l'avons perçu au XIX° siècle se poursuit au XX° siècle contre l'idéologie positiviste; cette véritable offensive vient des horizons les plus variés: citons R. von Hartmann et sa Métaphysique de l'Inconscient, Barrès et le Culte du Moi, Bergson et l'Evolution créatrice ou l'Essai sur les données immédiates de la conscience. La redécouverte de l'inconscient des psychanalystes est aussi certainement liée à cette révolte.
La mort apparaît comme l'ultime libération de l'esprit du monde de la matière. A cet égard, la nouvelle “Liebe und Wiederkunft” —“amour et retour”—, très révélatrice, traduit une philosophie de l'histoire où des événements similaires se produisent sans cesse dans le même ordre, un retour de l'identique sous des formes différentes. L'histoire déjà parue dans la première version du Cœur aventureux localise à Leisnig le passage à l'écriture et se voit dotée d'un titre une décennie plus tard. Jünger s'est alors contenté de préciser ici une image, d'affiner une idée ou de changer là l'emploi d'un temps verbal; il n'a en rien touché le contenu de l'histoire.
La trame est simple. Le narrateur, un officier, est tout d'abord naufragé sur une île de l'Océan Atlantique. Recueilli par une vertueuse femme qui prit le voile, il se rend peu à peu à l'évidence qu'une relation séculaire les lie l'un à l'autre. La fonction de cette femme consiste à soigner et à veiller les hommes qui, pour avoir goûté une belle plante narcotique, dorment le lourd sommeil du coma. Malgré les injonctions de la religieuse, le narrateur n'y résiste pas non plus et devient lui-même la proie du sommeil et du rêve. Pourtant, le voilà de nouveau sur l'île, menacée cette fois par l'inimitié d'une flotte espagnole! Hôte d'une généreuse famille pirate, amoureux de la fille de la maison, le narrateur se prépare, chevaleresque, à livrer combat. Or, n'aperçoit-il pas soudain une fleur merveilleuse, ne succombe-t-il pas encore à l'impérieux désir de la goûter?
Dans la dernière lueur du crépuscule, j'eus le temps encore de pressentir que je vivrais d'innombrables fois pour rencontrer cette même jeune fille, pour manger cette même fleur, pour m'abîmer de cette même manière, tout comme d'innombrables fois déjà ces choses avaient été mon lot (7).
Une fleur aux couleurs du danger: le rouge, le jaune
Cette singulière histoire nous permet de mieux cerner la double nature de l'homme, ce qui fonde son originalité et son drame: son âme est immortelle et son corps périssable. Il est certain que la présence de cette fleur ne peut qu'évoquer le symbole le plus connu de toute l'œuvre de Novalis, la fleur bleue qui enchante le roman Heinrich von Ofterdingen et qui marque, de par ses racines et la couleur céleste de ses pétales, l'union de la terre et du ciel. La fleur jüngerienne n'est pas parée du bleu spirituel et bienfaisant. Ses pétales arborent les teintes de la vie et du danger, le jaune et le rouge (8); tout comme Goethe, rappelons-le, Jünger devait conférer une signification particulière aux couleurs. La fleur, belle et menaçante, figure l'instabilité essentielle de l'être , qui est voué à une évolution perpétuelle. Ernst Jünger semble admettre que la mort n'est pas un fait définitif, mais une simple étape de la série des transformations auxquelles tout être est soumis. La réminiscence d'un état antérieur, telle qu'elle semble affecter l'imagination nocturne de Jünger et que nous venons d'évoquer, soulève le délicat problème de l'incarnation successive des âmes et dramatise ainsi la notion d'un éternel retour. Ne soyons donc pas surpris de trouver dans Le Cœur aventureux les très célèbres vers de Goethe:
Ah, tu étais ma sœur ou ma femme, en des temps révolus (9).
Ces vers impliquent la reconnaissance des choses entre elles, de leurs liens, une conscience de leur parenté qui peut dépasser le cadre restreint de l'espèce humaine; d'ailleurs Jünger, dans le même passage, se fait écho de Byron:
Les monts, les vagues, le ciel ne font-ils partie de moi et de mon âme, et moi-même d'eux? (10).
La mort est le “souvenir le plus fort”
Finalement, la mort est pour Jünger un souvenir enfoui au plus profond de la mémoire, “le souvenir le plus fort” “der Tod ist unsere stärkste Erinnerung” (aHl, 75). L'homme qui, pour Jünger, représente infiniment plus que le corps physique, est doté d'une mémoire qui semble survivre à la destruction de la matière. Le dualisme de la vision anthropologique que nous décelons ici évoque celui de Platon, qui stipula la primauté de l'âme sur le corps. Fidèle à ses influences pythagoriciennes, Platon reprit à son compte l'idée de l'immortalité de l'âme; dans sa préexistence ou postexistence, l'âme voit les idées, mais en s'incarnant dans sa prison de chair, elle les oublie. Rappelons-nous que celui qui, chez Hadès, conserve la mémoire transcende la condition mortelle, échappe au cycle des générations. D'après Platon, les âmes assoiffées doivent éviter de boire l'eau du Léthé car l'oubli, qui constitue pour l'âme sa maladie propre, est tout simplement l'ignorance. Voilà peut-être la raison pour laquelle les Grecs prêtaient à Mnémosyne “mémoire”, la mère des Muses, de grandes vertus! L'histoire que chante la Titanide est déchiffrement de l'Invisible; la mémoire est fontaine d'immortalité. Nous pensons trouver ici un lointain écho de cette sagesse antique chez Jünger car, dans son œuvre, le contact avec l'autre monde est permis grâce à la mémoire. Celle-ci joue donc un rôle fondamental dans l'affirmation de l'identité personnelle et nous ne pouvons que souligner cette faveur qu'elle trouve auprès de Jünger, si l'on se réfère à ses journaux intimes, ces voyages entrepris dans les profondeurs du moi et d'où surgissent à la conscience des aspects nouveaux de l'être, mêlé parfois à toute une tonalité poétique.
L'aspect orphique de Jünger
Le roman philosophique Eumeswil (1977), à cet égard très révélateur, montre l'aspect orphique de Jünger. La mémoire, par l'intermédiaire du Luminar, fait tomber la barrière qui sépare le présent du passé. Que ce soit par le biais du Luminar ou par l'évocation des morts dans le jardin de Vigo, un pont est jeté entre le monde des vivants, au-delà duquel retourne tout ce qui a quitté la lumière du soleil. Cette évocation des morts n'est pas sans éveiller à notre mémoire le rituel homérique, qui connaît deux temps forts: d'une part, l'appel chez les vivants et, d'autre part, la venue au jour, pour un bref moment, d'un défunt remonté du monde infernal. Le voyage d'un vivant au pays des morts semble également possible, ainsi le chamane Attila qui s'aventura dans les forêts.
La place centrale que les mythes de type eschatologique accordèrent à la mémoire indique l'attitude de refus à l'existence temporelle. Si Jünger exalte autant la mémoire, nous pouvons nous demander s'il n'est pas mû par la tentation d'en faire une puissance qui lui permette de réaliser la sortie du Temps et le retour du divin.
Qu'en est-il du vieil homme? Dans l'attente de l'ultime rendez-vous, habitué à la mort pour l'avoir côtoyée sur les fronts, dans les deuils et les déchirements qu'elle causa, il ne peut abandonner une inquiétude, qu'il exprime Deux fois Halley:
Au contraire, ce qui me préoccupe depuis longtemps, c'est la question du franchissement; une coupe en terre est transformée en or, puis en lumière. A cela une seule chose m'inquiète: c'est de savoir si l'on prend encore connaissance de cette élévation, si l'on s'en rend encore compte (11).
Parques, Moires, Nornes
Quelques années plus tard paraît le journal Les Ciseaux, que Jünger écrivit de 1987 à 1989. L'outil bien anodin dont il est ici question appartient aux sœurs filandières des Enfers qui filent et tranchent le fil de nos destinées. Etrangères au monde olympien, ces Parques ou Moires du monde hellénique sont les déesses de la Loi. Lachésis tourne le fuseau et enroule le fil de l'existence, Clotho, la fileuse, tient la quenouille et file la destinée au moment de la naissance. La fatale Atropos coupe le fil et détermine la mort. La représentation ternaire des fileuses, également présente dans le religieux germanique où les Nornes filent la destinée des dieux et celle des hommes, évoque la trinité passé, présent et futur et nous permet d'entrer dans la temporalité. Ce fil est le lien qui nous attache à notre destinée humaine, nous lie à notre mort. Ce qui importe ici, c'est que, d'une part, l'outil retenu par Jünger ne soit ni le fuseau ni la quenouille mais bien les ciseaux de la divinité morticole et que, d'autre part, Jünger valorise non le fil ou le tissage mais la coupure par les ciseaux.
Le titre de l'essai et les discrètes allusions aux Moires, à ces divinités du destin, intègrent l'écrit dans l'ensemble de la réflexion jüngerienne sur le temps et la temporalité. Quoi d'étonnant à ce qu'il établisse des correspondances secrètes avec ses écrits antérieurs et jongle avec des idées abondamment traitées dans le passé! Les allusions au Travailleur, au Mur du temps sont nombreuses; sans grande peine, nous retrouvons Le Traité du Sablier, Le Problème d'Aladin, Eumeswil et même la théorie du “lacet” propre au Cœur aventureux. Cette œuvre de continuité qui n'est certes pas l'écrit le plus original de Jünger, prend l'aspect d'une récapitulation. Dans cet écrit tout en nuances, à défaut d'avoir énoncé des théories véritablement nouvelles, Jünger a composé une série d'accords d'accompagnements, s'attaquant à des problèmes essentiels de notre temps. Les Ciseaux sont en cela une méditation sur les aventures de notre siècle qu'ils posent, sur un fond de dualisme entre races divines, le problème crucial de l'éthique dans un monde où la science et le progrès technique repoussent les frontières d'une science morale désormais dépassée. Nous reconnaissons cette volonté d'ordonner le monde à d'autres fins que matérialistes.
Jünger considère le Temps sous la loi de deux règnes, d'une part celle du temporel où les ciseaux d'Atropos ne coupent pas et annoncent cet infini comme nous pouvons déjà le percevoir dans les rêves et l'extase. L'essai parle donc de la conscience jüngerienne de la mort et de cette douloureuse et inquiétante question du passage, de l'ultime franchissement.
Du comportement psychologique des agonisants
Cette curiosité incite l'auteur à s'interroger sur l'état de mort temporelle et sur les souvenirs des rares patients qui, rappelés à la vie, reprochent à leur médecin de les avoir empêchés de passer le tunnel de la mort (Schere, 73 sq). Sensible peut-être à cette vague déferlante de littérature occultiste qui aborde depuis quelques années la vie postmortelle, (est-là un présage de l'ère du Verseau?) ne va-t-il pas jusqu'à citer Elisabeth Kübler-Ross (12), cette femme d'origine suisse alémanique, installée aux Etats-Unis d'Amérique? En sa qualité de médecin, elle édita de nombreux ouvrages portant sur le comportement psychologique des agonisants; elle examina les récits des patients qu'avaient ressuscités les nouvelles techniques médicales de la réanimation, c'est-à-dire des injections d'adrénaline dans le cœur ou des électrochocs. Certains “revenants” que la médecine avait considérés cliniquement morts après avoir préalablement constaté un arrêt cardiaque, une absence de respiration et d'activité cérébrale, confièrent les expériences étranges qui leur étaient alors advenues pendant ces instants.
Or, la similitude des descriptions, l'exactitude des récits excluaient tout rêve ou toute hallucination. C'est ce qui incita le médecin à voir là une preuve d'existence post-mortelle. Voilà un sujet épineux où l'on se heurte tant aux théologiens horrifiés à l'idée d'un éventuel blasphème qu'aux doctes gardiens de la Science! Le raisonnement scientifique ne saurait rien admettre qui ne soit entièrement évident et ne forme un tout cohérent; la pensée qui en résulte, disciplinée par la rigoureuse volonté d'ordonner selon une méthode la plupart du temps linéaire et déductive, va par étapes successives de la simplicité à la complexité dans un ordre logique et chronologique. Or, dans le présent cas, la finalité du témoignage peut être sujette au même doute que son contenu. Il est donc bien évident que les thèses alléguées par E. Kübler-Ross ne peuvent, dans le meilleur des cas, remporter l'unanimité du monde scientifique et, dans le pire, ne peuvent qu'être rejetées car la science accueille avec méfiance des assertions qu'elle juge a priori insanes.
Toutefois, comme si Jünger voulait imposer le silence aux contempteurs de théories qu'il semble lui partager, comme s'il doutait aussi de cette méthode scientifique dont on aperçoit les limites, il cite des autorités médicales, aussi ambiguës soient-elles, ou nous livre les réflexions d'un ami, Hartmut Blersch, médecin lui aussi de son état. Ce dernier, traitant des personnes âgées, a écrit une étude non éditée: “Die Verwandlung des Sterbens durch den Descensus ad infernos” [La transformation de l'agonie par la Descente aux Enfers] (13) et a permis à Jünger d'en inclure quelques extraits dans Les Ciseaux. Jünger a tourné le dos à l'intelligence rationnelle du discours et à certaines acquisitions du savoir scientifique il y a longtemps déjà. De nos jours, une telle approche, qualifiée d'irrationnelle invite ses représentants à douter de la validité, du sérieux que l'on pourrait accorder à une telle pensée, à voir dans cette réaction antimatérialiste une régression vers un nouvel obscurantisme. Il n'en est pas moins vrai que Jünger, s'inscrivant déjà dans toute une tradition, reflète les angoisses qui oppressent son temps. Car cette mythologie d'une vie post-mortelle exerce sur nos contemporains une fascination qui dépasse le simple divertissement.
Placidité et sagesse où la mort devient conquête
Les conceptions irrationnelles de Jünger ont toujours damé le pion à la divine raison. Ainsi avait-il conclu son ouvrage Approches, drogues et ivresse:
L'approche est confirmée par ce qui survient, ce qui est présent est complété par ce qui est absent. Ils se rencontrent dans le miroir qui efface temps et malaise. Jamais le miroir ne fut aussi vide, dépourvu ainsi de poussière et d'image —deux siècles se sont chargé de cela. En plus, le cognement dans l'atelier —le rideau devient transparent; la scène est libre (14).
C'est peut-être justement dans cette irrationalité que Jünger puise cette placidité et cette sagesse où la mort elle-même devient conquête. Esprit téméraire, Jünger s'est avancé, vigilant, vers ces régions où les ciseaux de la Parque ne tranchent pas.
Tout comme jadis où, jeune héros incontesté, il glorifiait l'instant dangereux, le vieil homme avait renoncé à l'histoire, à percevoir le temps de manière continue; il est demeuré fasciné par cette seconde brûlante où tout se joue, ce duel sans merci où la vie et la mort s'affrontent:
L'histoire n'a pas de but; elle est. La voie est plus importante que le but dans la mesure où elle peut, à tout instant, en particulier à celui de la mort devenir le but (15).
Isabelle FOURNIER.
Notes:
(1) Sgraffitti, [première parution, Antaios, 1960, Stuttgart] in Jüngers Werke, Bd. VII, Essays III, p. 354: «Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Lebenslied im Äther gespielt. Er darf es mithören, bis er ins Schweigen übergeht. Er lauscht dann so aufmerksam inmitten der Qualen, der Unruhe. In jedem Fall war es ein großer Meister, der das Lied ersann. Doch kann es in seinem reinen Klange nur vernommen werden, wo der Wille erlischt, wo er der Hingabe weicht».
(2) Das abenteurliche Herz 1, Berlin, 1928 [1929], p. 76: «Das Leben ist eine Schleife, die sich im Dunkeln schürzt und löst. Vielleicht wird der Tod unser größtes und gefährlichstes Abenteuer sein, denn nicht ohne Grund sucht der Abenteurer immer wieder seine flammenden Ränder auf».
(3) Das abenteurliche Herz 2, Berlin, 1938 [1942], p. 38: «Er nannte den Tod die wundersamste Reise, die der Mensch vermöchte, ein wahres Zauberstück, die Tarnkappe aller Tarnkappen, auch die ironische Replik im ewigen Streit, die letzte und ungreifbare Burg aller Freien und Tapferen».
(4) An der Zeitmauer, [première parution Antaios, 1, 209-226], Stuttgart, 1959, p. 159: «Wer keine Todesfurcht kennt, steht mit Göttern auf vertrautem Fuß».
(5) Das abenteureliche Herz 2, ibid., p. 102: «[...] und weißt du, was ich glaube? Was wir hier leben, ist nur geträumt; wir erleben aber nach dem Tode dasselbe in Wirklichkeit».
(6) Novalis, Hymnen an die Nacht, Heinrich von Ofterdingen. Goldmann Verlag, Stuttgart, 1979, p. 161-162: «Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt[...]/Wehmuth und Wollust, Tod und Leben/ Sind hier in innigster Sympathie».
(7) Das abenteureliche Herz 2, ibid. p. 83: «Im letzten Schimmer des Lichtes ahnte ich noch: Ich würde unzählige Male leben, demselben Mädchen begegnen, dieselbe Blume essen und daran zugrunde gehen, ebenso wie dies bereits unzählige Male geschehen war».
(8) voir à ce propos le symbolisme des couleurs dans le Cœur aventureux.
(9) Das abenteurliche Herz 1, ibid., p. 74: «Ach, du warst in abgebten Zeiten/ Meine Schwester oder meine Frau».
(10) Das abenteurliche Herz 1, ibid., p. 74: «Sind Berge, Wellen, Himmel nicht ein Teil von mir und meiner Seele, ich von ihnen?».
(11) Zwei Mal Halley, Stuttgart, 1987, p. 33: «Mich beschäftigt vielmehr seit langem die Frage des Überganges; ein irdener Becher wird in Gold verwandelt und dann in Licht. Daran beunruhigt nur eines: ob diese Erhöhung noch zur Kenntnis genommen wird, noch ins Bewußtsein fällt».
(12) Die Schere, Stuttgart, 1989, p. 173 sq.
(13)Schere, p. 173.
(14) Annäherungen, Drogen und Rausch, Stuttgart, 1970, [Ullstein, 1980], p. 348: «Annäherung wird durch Eintretendes bestätigt, Anwesendes durch Abwesendes ergänzt. Sie trefen sich im Spiegel, der Zeit und Unbehagen löscht. Nie war der Spiegel so leer, so ohne Staub und bildlos —dafür haben zwei Jahrhunderte gesorgt. Dazu das Klopfen in der Werkstatt— der Vorhang wird durchsichtig; die Bühne ist frei».
(15) Die Schere, ibid., p. 120: «Die Geschichte hat kein Ziel; sie existiert. Der Weg ist wichtiger als das Ziel, insofern, als er in jedem Augenblick vor allem in dem des Todes Ziel werden kann».
00:06 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, première guerre mondiale, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, weimar, années 20, années 30, hommages |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 octobre 2009
Revoluçao Conservadora, forma catolica e "ordo aeternus" romano
 Revolução Conservadora, forma católica e “ordo aeternus” romano
Revolução Conservadora, forma católica e “ordo aeternus” romano
A Revolução Conservadora não é somente uma continuação da «Deutsche Ideologie» romântica ou uma reactualização das tomadas de posição anti-cristãs e helenistas de Hegel (anos 1790-99) ou uma extensão do prussianismo laico e militar, mas tem também o seu lado católico romano. Nos círculos católicos, num Carl Schmitt por exemplo, como nos seus discípulos flamengos, liderados pela personalidade de Victor Leemans, uma variante da Revolução Conservadora incrusta-se no pensamento católico, como sublinha justamente um católico de esquerda, original e verdadeiramente inconformista, o Prof. Richard Faber de Berlim. Para Faber, as variantes católicas da RC renovam não com um Hegel helenista ou um prussianismo militar, mas com o ideal de Novalis, exprimido em Europa oder die Christenheit: este ideal é aquele do organon medieval, onde, pensam os católicos, se estabeleceu uma verdadeira ecúmena europeia, formando uma comunidade orgânica, solidificada pela religião.Der Glanz, die Macht ist dahin» [«Estamos no fim, a Áustria está morta. O Esplendor e o Poder desapareceram»].
Depois do retrocesso e da desaparição progressiva deste organon vivemos um apocalipse, que se vai acelerando, depois da Reforma, a Revolução francesa e a catástrofe europeia de 1914. Desde a revolução bolchevique de 1917, a Europa, dizem estes católicos conservadores alemães, austríacos e flamengos, vive uma Dauerkatastrophe. A vitória francesa é uma vitória da franco-maçonaria, repetem. 1917 significa a destruição do último reduto conservador eslavo, no qual haviam apostado todos os conservadores europeus desde Donoso Cortés (que era por vezes muito pessimista, sobretudo quando lia Bakunine). Os prussianos haviam sempre confiado na aliança russa. Os católicos alemães e austríacos também, mas com a esperança de converter os russos à fé romana. Enfim, o abatimento definitivo dos “estados” sociais, inspirados na época medieval e na idade barroca (instalados ou reinstalados pela Contra-Reforma) mergulha os conservadores católicos no desespero. Helena von Nostitz, amiga de Hugo von Hoffmannstahl, escreve «Wir sind am Ende, Österreich ist tot.
Num tal contexto, o fascismo italiano, contudo saído da extrema-esquerda intervencionista italiana, dos meios socialistas hostis à Áustria conservadora e católica, figura como uma reacção musculada da romanidade católica contra o desafio que lança o comunismo a leste. O fascismo de Mussolini, sobretudo depois dos acordos de Latrão, recapitula, aos olhos destes católicos austríacos, os valores latinos, virgilianos, católicos e romanos, mas adaptando-os aos imperativos da modernidade.
É aqui que as referências católicas ao discurso de Donoso Cortés aparecem em toda a sua ambiguidade: para o polemista espanhol a Rússia arriscava converter-se ao socialismo para varrer pela violência o liberalismo decadente, como teria conseguido se tivesse mantido a sua opção conservadora. Esta evocação da socialização da Rússia por Donoso Cortés permite a certos conservadores prussianos, como Moeller van den Bruck, simpatizar com o exército vermelho, para parar a Oeste os exércitos ao serviço do liberalismo maçónico ou da finança anglo-saxónica, ainda mais porque depois do tratado de Rapallo (1922), a Reichswehr e o novo exército vermelho cooperam. O reduto russo permanece intacto, mesmo se mudou de etiqueta ideológica.
Hugo von Hoffmannstahl, em Das Schriftum als geistiger Raum der Nation [As cartas como espaço espiritual da Nação] utiliza pela primeira vez na Alemanha o termo “Revolução Conservadora”, tomando assim o legado dos russos que o haviam precedido, Dostoievski e Yuri Samarine.
Para ele a RC é um contra-movimento que se opõe a todas as convulsões espirituais desde o século XVI. Para Othmar Spann, a RC é uma Contra-Renascença. Quanto a Eugen Rosenstock( que é protestante), escreve: «Um vorwärts zu leben, müssen wir hinter die Glaubensspaltung zurückgreifen» [Para continuar a viver, seguindo em frente, devemos recorrer ao que havia antes da ruptura religiosa]. Para Leopold Ziegler (igualmente protestante) e Edgard Julius Jung (protestante), era preciso uma restitutio in integrum, um regresso à integralidade ecuménica europeia, Julius Evola teria dito: à Tradição. Eles queriam dizer por aquilo que os Estados não deviam mais opor-se uns aos outros mas ser reconduzidos num “conjunto potencializador”.
Se Moeller van den Bruck e Eugen Rosenstock actuam em clubes, como o Juni-Klub, o Herren-Klub ou em círculos que gravitam em torno da revista de sociologia, economia e politologia Die Tat, os que desejam manter uma ética católica e cuja fé religiosa subjuga todo o comportamento, reagrupam-se em “círculos” mais meditativos ou em ordens de conotação monástica. Richard Feber calcula que estas criações católicas, neo-católicas ou para-católicas, de “ordens”, se efectuaram a 4 níveis:
1) No círculo literário e poético agrupado em torno da personalidade de Stefan George, aspirando a um “novo Reich”, isto é, um “novo reino” ou um “novo éon”, mais do que a uma estrutura política comparável ao império dos Habsbourg ou ao dos Hohenzollern.
2) No “Eranos-Kreis” (Círculo Eranos) do filósofo místico Derleth, cujo pensamento se inscreve na tradição de Virgílio ou Hölderlin, colocando-se sob a insígnia de uma “Ordem do Christus- Imperator”.
3) Nos círculos de reflexão instalados em Maria Laach, na Renânia-Palatinado, onde se elaborava uma espécie de neo-catolicismo alemão sob a direcção do teólogo Peter Wust, comparável, em muitos aspectos, ao “Renouveau Catholique” de Maritain na França (que foi próximo, a dado momento, da Acção Francesa) e onde a fé se transmitia aos aprendizes particularmente por uma poesia derivada dos cânones e das temáticas estabelecidas pelo “Circulo” de Stefan George em Munique-Schwabing desde os anos 20.
4) Nos movimentos de juventude, mais ou menos confessionais ou religiosos, particularmente nas suas variantes “Bündisch”, bom número de responsáveis desejavam introduzir, por via das suas ligas ou das suas tropas, uma “teologia dos mistérios”.
As variantes católicas ou catolizantes, ou pós-católicas, preconizaram então um regresso à metafísica política, no sentido em que queriam uma restauração do “Ordo romanus”, “Ordem romana”, definida por Virgílio como “Ordo aeternus”, “ordem eterna”. Este catolicismo apelava à renovação com esse “Ordo aeternus” romano que, na sua essência, não era cristão mas a expressão duma paganização do catolicismo, explica-nos o cristão católico de esquerda Richard Faber, no sentido em que, neste apelo à restauração do “Ordo romanus/aeternus”, a continuidade católica não é já fundamentalmente uma continuidade cristã mas uma continuidade arcaica. Assim, a “forma católica” veicula, cristianizando-a (na superfície?), a forma imperial antiga de Roma, como assinalou igualmente Carl Schmitt em Römischer Katholizismus und politische Form (1923). Nessa obra, o politólogo e jurista alemão lança de alguma maneira um duplo apelo: à forma (que é essencialmente, na Europa, romana e católica, ou seja, universal enquanto imperial e não imediatamente enquanto cristã) e à Terra (esteio incontornável de toda a acção política), contra o economicismo volúvel e hiper-móvel, contra a ideologia sem esteio que é o bolchevismo, aliado objectivo do economicismo anglo-saxónico.
Para os proponentes deste catolicismo mais romano que cristão, para um jurista e constitucionalista como Schmitt, o anti-catolicismo saído da filosofia das Luzes e do positivismo cienticista( referências do liberalismo) rejeita de facto esta matriz imperial e romana, este primitivismo antigo e fecundo, e não o eudemonismo implícito do cristianismo. O objectivo desta romanidade e desta “imperialidade” virgiliana consiste no fundo, queixa-se Faber, que é um anti-fascista por vezes demasiado militante, em meter o catolicismo cristão entre parênteses para mergulhar directamente, sem mais nenhum derivativo, sem mais nenhuma pseudo-morfose (para utilizar um vocábulo spengleriano), no “Ordo aeternus”.
Na nossa óptica este discurso acaba ambíguo, porque há confusão permanente entre Europa e Ocidente. Com efeito, depois de 1945, o Ocidente, vasto receptáculo territorial oceânico-centrado, onde é sensato recompor o “Ordo romanus” para estes pensadores conservadores e católicos, torna-se a Euroamérica, o Atlantis: paradoxo difícil de resolver, porque como ligar os princípios “térreos” (Schmitt) e os da fluidez liberal, hiper-moderna e economicista da civilização “estado-unidense”?
Para outros, entre o Oriente bolchevizado e pós-ortodoxo e o Hiper-Ocidente fluido e ultra-materialista, deve erguer-se uma potência “térrea”, justamente instalada sobre o território matricial da “imperialidade” virgiliana e carolíngia, e esta potência é a Europa em gestação. Mas com a Alemanha vencida, impedida de exercer as suas funções imperiais pós-romanas uma translatio imperii (translação do império) deve operar-se em beneficio da França de De Gaulle, uma translação imperii ad Gallos, temática em voga no momento da reaproximação entre De Gaulle e Adenauer e mais pertinente ainda no momento em que Charles De Gaulle tenta, no curso dos anos 60, posicionar a França “contra os impérios”, ou seja, contra os “imperialismos”, veículos da fluidez mórbida da modernidade anti-política e antídotos para toda a forma de fixação estabilizante (NdT. Daqui presume-se uma distinção entre imperialismo e imperialidade, daí o uso dos dois conceitos).
Se Eric Voegelin tinha teorizado um conservantismo em que a ideologia derivava da noção de “Ordo romanus”, ele colocava o seu discurso filosófico-político ao serviço da NATO, esperando deste modo uma fusão entre os princípios “fluidos” e “térreos” (NdT. naturalmente esta dicotomia que o autor usa recorrentemente no texto é uma referência à tradicional oposição entre ordenamentos marítimos e terrestres), o que é uma impossibilidade metafísica e prática. Se o tandem De Gaulle-Adenauer se referia também, sem dúvida, no topo, a um projecto derivado da noção de “Ordo aeternus”, colocava o seu discurso e as suas práticas, num primeiro momento (antes da viagem de De Gaulle a Moscovo, à América Latina e antes da venda dos Mirage à Índia e do famosos discursos de Pnom-Penh e do Quebeque), ao serviço de uma Europa mutilada, hemiplégica, reduzida a um “rimland” atlântico vagamente alargado e sem profundidade estratégica. Com os últimos escritos de Thomas Molnar e de Franco Cardini, com a reconstituição geopolítica da Europa, este discurso sobre o “Ordo romanus et aeternus” pode por fim ser posto ao serviço de um grande espaço europeu, viável, capaz de se impor sob a cena internacional. E com as proposições de um russo como Vladimir Wiedemann-Guzman, que percepciona a reorganização do conjunto euro-asiático numa “imperialidade” bicéfala, germânica e russa, a expansão grande-continental está em curso, pelo menos no plano teórico. E para terminar, parafraseando De Gaulle: A estrutura administrativa acompanhá-la-á?
Robert Steuckers
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, rome, rome antique, catholicisme, religion, carl schmitt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 16 octobre 2009
50. Todestag Arnolt Bronnen
 50. Todestag Arnolt Bronnen
50. Todestag Arnolt Bronnen
Widersprüchlich, faszinierend, abstoßend: Arnolt Bronnen, der 64jährig am 12. Oktober 1959 in Ost-Berlin starb und seine Laufbahn als Kaufhausangestellter begann, war Anarchist, katholischer Konvertit, Nationalsozialist, Kommunist, ein Mitstreiter Brechts, Goebbels‘ Günstling beim Rundfunk, Widerstandskämpfer in Österreich, Nachkriegsbürgermeister.
So ist Bronnen mehr als nur die Personifizierung der Wirrnisse der Intellektuellen im 20. Jahrhundert. Seine jüdische Herkunft ließ er gerichtlich widerlegen. Den Haß auf den jüdischen Zieh- oder Zeugevater brachte er 1920/22 auf Papier und Bühne. Er war Renegat, Opportunist und Provokateur, der „faschistische Piccolo“ und die „Hyäne im Kinderzoo“. Er schockierte mit expressionistischen Theaterstücken und sexualneurotischen Exzessen, störte mit SA-Männern Thomas Manns Deutsche Ansprache in Berlin, ließ weiße Mäuse während der Kino-Premiere von Im Westen nichts Neues auf das Publikum los und fand in der DDR sein Gnadenbrot als Theaterkritiker.
Er veröffentlichte 1929 den wohl wichtigsten rechten Agitprop-Roman Deutschlands, O.S. (zuletzt Klagenfurt 1995), über die Kämpfe der Freikorps in Oberschlesien. Tucholsky schrieb einen berühmten Verriß. Und noch heute läßt sich über dieses Buch trefflich streiten. Und seine Kinder – Tochter Barbara ist Schriftstellerin, Franziska Schauspielerin (Schwarzwaldklinik), Sohn Andreas Unternehmer – sind sich bis heute uneins über ihren Vater, den Chaoten und Grenzgänger (B. Bronnen: Das Monokel, München 2000) .
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



 Die Auseinandersetzung mit Oswald Spengler (1880–1936), dem begeisterten und zugleich leidenden Philosophen des Schicksals und dem Vertreter der „Konservativen Revolution“, hat wieder Hochkonjunktur. Was vor über 80 Jahren eindrucksvoll im „Untergang des Abendlandes“ (1918) begann, in „Preußentum und Sozialismus“ (1919) die Abrechnung mit dem Marxismus praktizierte und ihm einen deutschen ethischen Sozialismus entgegensetzte, endete mit Spenglers letztem Werk „Jahre der Entscheidung“ (1933). Dieses prophezeite die heutigen politischen und ökologischen Krisen der globalisierten Welt und ihrer Wirtschaft.
Die Auseinandersetzung mit Oswald Spengler (1880–1936), dem begeisterten und zugleich leidenden Philosophen des Schicksals und dem Vertreter der „Konservativen Revolution“, hat wieder Hochkonjunktur. Was vor über 80 Jahren eindrucksvoll im „Untergang des Abendlandes“ (1918) begann, in „Preußentum und Sozialismus“ (1919) die Abrechnung mit dem Marxismus praktizierte und ihm einen deutschen ethischen Sozialismus entgegensetzte, endete mit Spenglers letztem Werk „Jahre der Entscheidung“ (1933). Dieses prophezeite die heutigen politischen und ökologischen Krisen der globalisierten Welt und ihrer Wirtschaft.