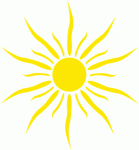Le mécanisme de l'illusion
Sorel, Jünger et le mythe
Source : Nicolô Zanon, revue Trasgressioni n°2 (1986), tr. fr. A. Coletti in Orientations n°11 (juil. 1989).
Dans son ouvrage Réflexions sur la violence, Georges Sorel écrivait : "Nous savons très bien que les historiens du futur ne manqueront pas de trouver que notre pensée a été pleine d'illusions puisque ils observeront derrière eux un monde déjà révolu. Au contraire, nous devons œuvrer, et personne ne saurait nous dire aujourd'hui ce que les historiens connaîtront ; personne ne pourrait nous fournir le moyen de modifier nos images motrices afin d'éviter leurs critiques".
Aujourd'hui nous pourrions donner de ces quelques lignes une interprétation triomphaliste et nous limiter à admirer la foi profonde et la passion politique qui anime leur auteur. Pourtant il n'y a rien là dedans de cet aveugle fanatisme qui anime les sectaires et rien de cette irritante imperméabilité au doute qui rend médiocres les prophètes. Par contre, on pourrait peut-être percevoir dans ces propos un peu de "cette trempe d'âme qui pourrait supporter même l'effondrement de tout espoir" et qui constitue, pour Max Weber, la caractéristique principale d'un individu très singulier : l'homme qui a la vocation pour la politique.
Les "images motrices" forcent les hommes à l'action
Seul un homme de ce genre, face à une réalité qui refuse tenacement de s'adapter à ses espoirs, face à un mystérieux mécanisme qui fait que chaque action provoque dans le monde des conséquences que celui qui a agi ne voulait (1) et ne prévoyait pas, pourra s'exclamer : "Aucune importance, on continue !". De la même façon, dans le passage cité, Sorel est parfaitement conscient que ces "images motrices", ces mythes, seront, dans l'avenir, considérés comme illusion. Mais malgré cela, il s'approprie la devise "aucune importance, on continue !" et il dit : "aucune importance, même s'il ne s'agit que d'illusions, nous devons œuvrer !
"Nous devons œuvrer politiquement" : les Réflexions sur la violence contribuèrent sûrement et de façon concrète à donner une nouvelle forme et une nouvelle vigueur aux espoirs révolutionnaires du prolétariat. En recevant l'héritage de Bakounine et de Proudhon, et surtout en adhérant avec conviction aux thèses de la philosophie bergsonienne, Sorel s'éloigne du rationalisme de Marx et construit une théorie du mythe qui est en même temps une philosophie de la vie concrète. Pour lui, ce que la vie exprime de plus valable et de plus noble ne dérive pas de la froide dictature de la raison mais se révèle dans les situations exceptionnelles, quand les hommes, possédés par les grandes images mythiques, participent à une lutte. Seuls les peuples ou les groupes sociaux prêts à embrasser vigoureusement la foi par le biais d'un mythe peuvent avoir une mission historique.
C'est dans la disponibilité au mythe que se trouve le secret de l'action, des héroïsmes et de l'enthousiasme. Les exemples de la grandiose efficacité du mythe sont, pour Sorel, l'idée de l'honneur et d'une glorieuse réputation pour le peuple grec, l'attente du Jugement Dernier dans le christianisme primitif, la foi dans la "vertu" et dans la liberté révolutionnaire pendant la révolution française et l'enthousiasme nationaliste dans la lutte des Allemands pour l'indépendance en 1813. Pour ce que Sorel peut observer de son époque, la disponibilité au mythe ne se prête certes pas à une bourgeoisie hantée par l'argent et par la propriété, bâtisseuse d'une société dominée par le scepticisme et le relativisme, à une bourgeoisie qui place une confiance ingénue dans les infinies discussions du parlementarisme.
La "clase discutidora" ne porte pas de mythe en elle
Ce n'est pas la clase discutidora (= la classe parlementaire), comme Donoso Cortès l'avait dénommée, qui peut être porteuse d'un mythe : seules les masses du prolétariat industriel révèlent un pouvoir de mobilisation autour d'un mythe politique. Le mythe ne peut pas être théorisé sur le papier par des intellectuels ou par des hommes de lettres mais est immanent à la vie concrète, à la foi instinctive des masses qui embrassent la cause du socialisme : c'est le mythe de la grève générale. D'après Sorel, ce que la grève générale signifie réellement et objectivement dans la situation politique n'a aucune importance : ce qui compte, c’est la foi que le prolétariat lui accorde, et les effets, provoqués par une telle foi, dans la dynamique de la lutte politique.
Le mythe n'est pas l'utopie
Sorel distingue très clairement le mythe de l'utopie. L'utopie, pour lui, n'est que le produit usé d'une pensée rationaliste et comme telle peut, tout au plus, souhaiter des "réformes" dans un futur plus ou moins proche. L'utopie se laisse décomposer et reconstituer dans ses diverses parties, en démontrant ainsi sa nature de construction mécanique et artificielle. Au contraire, chaque mythe, et par conséquent le mythe de la grève générale, doit être accepté ou refusé dans sa totalité. Il n'alimente pas l'espoir d'une lente et graduelle transformation de "l'instant" ; il ne trace pas non plus, avec une admirable perfection, les caractères d'une société future : le mythe de la grève générale agit au présent et maintient vive chez le prolétariat la tension palpitante pour le combat décisif avec la bourgeoisie, pour l'immense catastrophe finale.
Dans l'interprétation de Carl Schmitt (2), l'affirmation par Sorel de la théorie du mythe démontre que, aux alentours des années vingt, la confiance rationaliste dans le système parlementaire avait perdu de sa force et de son évidence. Dans l'organisation relativiste/libérale, chaque opinion doit avoir le même espace et la même légitimité, et puisqu'il n'existe pas de critère pour décider de manière absolue ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, il s'avère nécessaire de discuter chaque problème et, après la discussion, de se soumettre à un compromis.
La faiblesse du relativisme libéral
Comme l'exposait Donoso Cortès vers le milieu du siècle dernier, le "principal intérêt du libéralisme est de ne jamais arriver au jour des négations radicales ou des affirmations souveraines. Et pour que cela n'arrive point, en se servant de la discussion, le libéralisme confond les principes et répand le scepticisme, puisqu'il sait fort bien qu'un peuple, qui écoute continuellement la voix des sophistes, est confronté sans cesse au pour et au contre de toute chose, finit par ne plus savoir en quoi croire et par se demander si la vérité et l'erreur, le juste et l'injuste, l'honnêteté et l'infamie sont des contraires ou bien sont une même chose observée à partir de points de vue différents. Mais une période aussi angoissante, continue Donoso Cortès, est toujours de brève durée. L'homme est né pour agir et la discussion éternelle est contraire à la nature humaine, puisqu'elle est "ennemie des œuvres". Le jour viendra où les peuples, poussés par leur penchant le plus violent, envahiront les rues et les places pour demander résolument Barabbas ou Jésus en précipitant dans la poussière les chaires des sophistes" (in Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, 1851).
À un siècle de distance, malgré ces paroles, substantiellement prophétiques et dûment confirmées par les faits, Hans Kelsen, dans son essai Absolutisme et relativisme dans la philosophie et dans la politique (1948), répétait que les promesses théorétiques de la démocratie moderne sont inclues dans le relativisme philosophique, tandis que les conceptions antidémocratiques trouvent leur pendant, en philosophie, dans la foi en une valeur absolue ! (3)
Mettons à part la nature problématique et le caractère superficiel d'un tel parallèle entre philosophie et politique, parallèle qui néglige d'emblée toute vraie réflexion sur les caractéristiques qu'une "forme politique bien fondée" doit présenter... Parce que même si l'on en parle à un niveau seulement abstrait, l'idée d'une forme politique qui se vante de son propre relativisme est un peu singulière... Il faut dire, en revanche, que la confiance dans le relativisme, que montre ce grand juriste, ne rend pas un bon service aux conceptions démocratiques qui, à l'ère des sociétés de masse ou des sociétés complexes, se trouvent en difficulté précisément pour concilier, d'une part, le maintien d'une définition minimale de procédure (qui est donc relativiste) de la démocratie, avec, d'autre part, l'exigence désespérée de préserver un minimum d'homogénéité sociale, politique et culturelle qui permette la survie et la stabilité à cette même démocratie (4).
Sorel, le nationalisme russe et le bolchévisme
Selon Sorel, des profondeurs de l'instinct vital authentique d'un groupe animé par la foi dans le mythe, peut surgir une impulsion. Impulsion, qu'à la façon de Carl Schmitt, on peut définir "d'orgueilleuse décision morale", laquelle efface les préoccupations relativistes. Une bonne partie des mouvements politiques qui, pendant les années 20 et 30, déchaînèrent une lutte à outrance contre les démocraties libérales, comptaient sur l'adhésion de masses possédées par des mythes, dont la charge, simultanément destructrice et dévastatrice, fut, sans aucun doute, déterminante.
Il est encore intéressant d'observer cette théorie sorélienne du mythe, analysée par un penseur se proclamant, à l'époque, socialiste et internationaliste tout en désignant le mythe de la grève générale comme multiplicateur des énergies du prolétariat. Cette théorie du mythe peut, en réalité, servir à comprendre les succès de toutes les luttes pour l'affirmation nationale et de tous les mouvements qui ont combattu animés par un sentiment nationaliste ou, du moins, leur extraordinaire énergie.
D'ailleurs, les autres exemples de mythe que Sorel cite, outre celui de la grève générale, paraissent indiquer que le mythe de la nation en particulier possède une extraordinaire efficacité politique. Et, dans l'Appendice, ajouté en 1919 aux Réflexions, Sorel, en faisant l'apologie de Lénine, dit que l'emploi de la violence a porté les Bolchéviques au pouvoir ou, du moins, à redonner à la Russie sa conscience nationale.
Un voyageur français, que Sorel cite, écrivait en 1839 : "Ou la Russie n'accomplira pas ce qui nous paraît sa destinée, ou Moscou redeviendra un jour la capitale de l'empire. Si je voyais jamais le trône de Russie majestueusement replacé sur sa véritable base, je dirais : la nation slave, triomphant, par un juste orgueil, de la vanité de ses guides, vit enfin de sa propre vie". Et voilà que, sous la direction de Lénine, qui réunit en lui les capacités d'homme d'État de Pierre le Grand et le sentiment national de Nicolas I, les Bolchéviques ont redonné à Moscou le titre de capitale de la Russie, conclut Sorel, et leur bolchévisme est russe et moscovite. Avec un certain bien-fondé, Schmitt pouvait souligner que "dans la bouche d'un marxiste internationaliste, ceci est un éloge surprenant puisqu'il démontre que l'énergie du mythe national est plus grande que l'énergie du mythe de la lutte des classes" (in Die geistesgeschichtliche Lage…).
Il est presque superflu de rappeler le fameux discours que Mussolini prononça à Naples en octobre 1922, un peu avant la marche sur Rome, dans lequel le mythe de la nation était exalté et opposé au socialisme, défini comme une mythologie inférieure. Pour les écrivains anarchistes tels que Bakounine ou Proudhon, les péroraisons contre l'uniformité centralisatrice de l'État moderne, contre la bureaucratie, l'armée, contre toute forme d'autorité, tant politique que métaphysique, allaient de pair avec l'exaltation d'une sorte de vitalisme libertaire, dont la plénitude instinctive ne pouvait être sacrifiée à l'autel d'aucun pouvoir.
De l'anarchisme à "l'autorité nouvelle"
Même chez Sorel survivent des influences anarchiques de ce genre. Mais cela ne fait pas de doute que l'adhésion au mythe politique fait surgir, dans cette "plénitude instinctive de la vie concrète", une nouvelle sensibilité à l'ordre, la discipline et la hiérarchie. La prétendue liberté de l'anarchiste, dans l'adhésion fidéiste au mythe, peut se muer en un nouveau lien solide, encore plus fort que les liens anciens de l'Autorité contre laquelle lutte l'anarchiste. L'obéissance aux chefs de celui qui se bat, possédé par un mythe, est à peu près inconditionnelle.
Et la nouvelle forme politique, la nouvelle grande "Autorité", que la lutte installe, obtient d'autant plus de consensus que sont puissantes ses capacités mythopoïétiques (= formation du mythe) ; le recours aux mythes est d'autant plus continu, plus obsessionnel, qu'il faut tenir les masses en état de mobilisation permanente. Voilà un résultat quelque peu paradoxal qui confirme cependant que l'on peut en réalité faire abstraction de certaines lois de la coercition politique.
Georges Sorel participa activement aux luttes politiques de son temps mais il n’œuvra pas seulement en tant qu'agitateur. En analysant la théorie du mythe, en fait, il accomplissait un travail scientifique et décrivait une loi de l'action politique. "Faire de la science veut dire, avant tout, savoir quelles sont les forces existantes dans le monde, écrit-il, et se mettre en condition de les utiliser en raisonnant d'après expérience. C'est pour cette raison que je dis qu'en acceptant l'idée de la grève générale, en sachant parfaitement qu'il s'agit d'un mythe, nous œuvrons exactement à la façon d'un physicien moderne, qui a pleine confiance dans sa science tout en sachant que dans l'avenir elle sera considérée comme dépassée". Il ne s'agit pas ici d'une déclaration de meeting, ni des propos d'un agitateur de foules : Sorel sait que la capacité de mobilisation, due au mythe, est indépendante de tout jugement "objectif" qui porte sur sa valeur heuristique, parce que, en fait, une telle réflexion entraînerait la mort du mythe.
Observateur lucide et fervent participant
Il y a ici une étrange et surprenante synthèse de 2 attitudes qu'il est difficile, en vérité, de concilier : on sait parfaitement que l'idée de grève générale est un mythe, une idée que la postérité jugera "illusoire", mais on n'hésite pas à le faire lourdement valoir dans le déroulement pratique de la lutte politique. "Nous devons opérer", dit Sorel, comme nous l'avons vu au début du présent exposé. Il est un observateur lucide des faits et des théories et sait les décrire avec réalisme. Mais, en même temps, il reste un fervent participant à ces mêmes dynamiques politiques dont il a révélé une des plus importantes arcanes.
Il serait injuste de le considérer comme cynique : Sorel a cru à ses propres mythes en les considérant comme tels. Ce n'est certainement pas chose courante. Ayant désormais dépassé l'âge de 70 ans, il est en mesure de lancer une puissante invocation qui prouve que sa foi est intacte : "maudites soient les démocraties ploutocratiques qui affament la Russie ! Je ne suis qu'un vieillard dont l'existence est à la merci de minimes accidents mais puissé-je, avant de descendre dans la tombe, voir humilier les orgueilleuses démocraties bourgeoises, aujourd'hui cyniquement triomphantes". Il n'y a pas de doute : Sorel avait la "vocation" politique.
L'expérience de Sorel nous paraît en effet singulière, non seulement pour la richesse globale de sa pensée qui constitue une intéressante convergence de tendances et de courants apparemment éloignés les uns des autres et contradictoires, mais aussi pour cette capacité qu'il possède de concilier la connaissance lucide de la réalité politique avec la disponibilité à l'action fidéiste, au cœur de cette même réalité. Presque jamais, si l'on analyse les penseurs décisifs dans l'histoire de la pensée politique, il n'est donné d'observer chez eux une telle absence de problématisation des rapports entre connaissance et action.
Dans le cadre de la politique active, quel individu, ni saint ni héros, peut afficher à la fois une sagesse profonde et une foi profonde ? Une connaissance approfondie des arcanes de la politique, en fait, produit souvent le scepticisme. Ce scepticisme n'arrêtera peut-être pas l'action mais il enlèvera à l'action même son caractère fidéiste, la privera de son élan idéal : parce que, à ce stade, il s'agira seulement de mettre en fonction un mécanisme dont l'efficacité est prouvée déjà par l'expérience. Même le mythe politique peut se révéler comme un mécanisme aux effets suffisamment sûrs. Celui qui en connaît le mode de fonctionnement pourra l'activer et, dans les coulisses de ce beau spectacle, son visage se contractera en un rictus : la grimace douloureuse du cynisme.
Deux routes se tracent, en effet, pour celui qui connaît ou croit connaître les arcanes de la politique : la 1ère route est celle de l'abstention, de la non-action et de la simple observation des faits, désenchantée comme celle d'un entomologiste ou souffrante comme celle du poète qui admire la primitivité instinctive de la vie qui se déroule devant ses yeux, mais qui est conscient d’être trop "savant" pour pouvoir y participer de façon innocente. La 2nde route est celle de la pure politique de puissance, de l'usage sans discrimination de la force et de la ruse pour se maintenir au pouvoir ou pour le conquérir,
Le cynique et le pouvoir
Chez le démagogue et chez l'agitateur de masses, qui luttent pour arriver au pouvoir, on peut observer une disponibilité d'âme cynique et sans scrupules, sinon parfois une bonne dose de cruauté. Celui qui est déjà au pouvoir pourra aussi faire preuve d’une certaine cruauté mais aux degrés les plus hauts de la conscience. Le cynisme du souverain aura ainsi des effets moins sanguinaires, il sera, pour ainsi dire, un cynisme "décadent". La conscience de la relativité et de l'inanité de tout effort est ici trop importante. Au moment de la relève de la garde, le cynique, s'il a sauvé sa vie, s'éloignera du pouvoir avec une certaine tranquillité d'esprit. S'il le pouvait, il dirait à son successeur triomphant que le monde n'est rien d'autre que le lieu où toutes les espérances nés du cœur font naufrage.
Ce profond désespoir intérieur, cette image d'un monde sans lumière, est typique de tous les penseurs qui ont d'abord fréquenté intensément le monde de l'activisme politique puis qui ont analysé froidement et enfin compris sa rude logique. Que l'on pense au Prince de Machiavel et aux durs conseils qu'il contient : des légions de moralistes ont, pendant des siècles, poussé de hauts cris à propos de son "scandaleux cynisme". Mais, comme on peut le noter, Machiavel analyse ici l'individu singulier dans sa situation d'absolue solitude :
"Dans la brève densité du Prince, tout s'échappe, oscille et tremble, écrit G. Capograssi, dans l'absence absolue de tout point à partir duquel l'esprit pratique puisse apaiser ses exigences et se débarrasser de son erreur empirique et utilitaire. C'est une humanité en proie aux diktats épouvantables d'une bataille, avec ses phases offensives et défensives, une humanité qui n'a pas d'autre alternative que de changer sans répit de position et de transformer toute chose en arme. Tous les moyens sont permis : les valeurs humaines et éthiques n'existent pas encore dans le monde de Machiavel, dont la réalité est un ensemble de choses décousues que chacun manie et utilise pour atteindre ses propres buts" (5).
Les passions mènent le monde
Voilà, en apparence, les résultats d'une observation désenchantée du monde de la politique et de la connaissance de ses mystères. Machiavel fut un excellent conseiller : mais serait-il possible de l'imaginer dans le rôle du souverain ou du démagogue ? Vraisemblablement pas, puisque dans cette descente dans l'Abgrund, aux abîmes du nihilisme politique, l'esprit humain paraît encore garder une dernière possibilité de défense : sortir de l'action, comme nous venons de le dire, et se contenter de la simple observation.
"Redoutable paradoxe du diplomatique, écrit Régis Debray dans La puissance et les rêves (Gal., p. 261), comment à la fois se tenir à distance des névroses ambiantes et des passions du jour sans jamais oublier que ‘les passions mènent le monde’ et que les temps forts de l'histoire sont ceux où des hommes meurent pour une idée ?" Dès que l'incrédulité professionnelle du spécialiste le conduit à négliger chez les autres la force motrice des croyances (c-à-d. des appartenances collectives dont elles sont l'empreinte individuelle), le stratège, affirme Debray, déchoit en conférencier et l'agnosticisme des forts se replie vers ce scepticisme mondain, ce relativisme fatigué et frivole qui conduit tant de diplomates et de politiciens à subir comme des aveugles l'histoire se faisant par d'autres aveugles, mais qui ont la foi.
Debray - cela lui arrive souvent - a mis le doigt sur la plaie. Son œuvre est, en France, un excellent exemple de transgression des lieux commun et des schémas idéologiques qu'il repousse pour essayer de nouvelles synthèses et emprunter des chemins inexplorés. Pourtant, sa tentative de concilier la puissance et les rêves va se révéler problématique. La politique de puissance assume la "force motrice des croyances", dans leur signification proprement littérale, à la façon d'un mécanisme que l'on active et dont on peut se servir. Les croyances ne sont plus des "valeurs", leur signification et leur importance résident simplement dans le fait d'être des "moyens" pour atteindre un but. L'usage du mythe reconnu comme arcanum dans la politique, permettra, peut-être, de rejoindre la puissance mais, alors, où sont restés les rêves ?
Les mystères des grandes politiques
Il est bien vrai qu'à chaque grande politique appartient un mystère. Ce n'est guère consolant, parce que l'idée que nous pouvons nous faire aujourd'hui des mystères politiques n'a rien de mystique et encore moins de mythique ou d'irrationnel. La conscience des arcana peut sûrement fonder une hiérarchie puisque toute secte d'initiés aux ésotérismes politiques pourra regarder de haut les "hommes communs", ceux qui "ne savent pas". Mais il s'agira d'une hiérarchie purement matérielle, presque d'un despotisme secret, où il ne survit rien du charisme ni rien de la capacité à se faire une "représentation visuelle" d'une quelconque transcendance (6). Et ceci parce que, depuis le début de l'époque moderne, l'arcanum politique a montré, avec une obscène évidence, son caractère artificiel, sa nature de moyen technique, pratique, pour la conservation ou la conquête du pouvoir. Comme le fait remarquer Schmitt, à l'origine même de l'État moderne, il y une orientation vers le rationalisme et la technicité (in La dictature, Seuil, 2000).
 C'est d'une technique pratique que l'État moderne est né historiquement. Par réflexe théorétique, la doctrine de la "raison d'État" est née. Elle est une maxime sociologique et politique, tirée des nécessités imposées par le maintien et par l'extension du pouvoir politique et elle se situe donc au-dessus de toute considération sur le "juste" et "l'injuste". Dans l'interprétation historique de Meinecke, la "raison d'État" apparaissait encore dans son aspect rassurant de conciliation entre cratos et ethos, entre, d'une part, un agir déterminé par l'instant du pouvoir et, d'autre part, un agir déterminé par une responsabilité morale (in L'idée de raison d'Etat dans l'histoire des temps modernes [1924], Droz, 1973).
C'est d'une technique pratique que l'État moderne est né historiquement. Par réflexe théorétique, la doctrine de la "raison d'État" est née. Elle est une maxime sociologique et politique, tirée des nécessités imposées par le maintien et par l'extension du pouvoir politique et elle se situe donc au-dessus de toute considération sur le "juste" et "l'injuste". Dans l'interprétation historique de Meinecke, la "raison d'État" apparaissait encore dans son aspect rassurant de conciliation entre cratos et ethos, entre, d'une part, un agir déterminé par l'instant du pouvoir et, d'autre part, un agir déterminé par une responsabilité morale (in L'idée de raison d'Etat dans l'histoire des temps modernes [1924], Droz, 1973).
Une analyse moins fourvoyante nous dit qu'à un niveau encore plus élevé, au-dessus des conceptions de "raison d'État" et de "salut public", lesquelles se prêtent, à cause de leur obscurité, à des interprétations moralisantes, on trouve dans la littérature politique contemporaine, lorsqu'elle évoque la naissance de l'État moderne, une autre conception : celle de l'arcanum politique. Au départ de cette conception, le politique se développe en tant que science sous l'aspect d'une doctrine secrète. "Mais le concept d'arcanum en politique et en diplomatie, même quand il se rapporte aux secrets d'État, n'est pas plus ou moins mystique que la conception moderne de secret d'entreprise ou d'affaires" (Schmitt, La dictature). L'usage qu'on faisait de ce concept à l'époque, révèle la signification purement technique de l'arcanum : ce n'est qu'un secret de fabrication.
 Il va de soi que l'usage des métaphores mécaniques et techniques, qui renvoient à une artificialité générale et immanente de tout l'univers politique, n'est ni innocent ni fortuit. Il révèle, au contraire, aux origines de l'ère de l'État moderne et de l'État moderne lui-même, un problème philosophique de fond, qui nous apparaît considérable, puisqu'il implique et explique bon nombre de situations que l'on a abordées plus haut. Des études récentes - et on peut rappeler ici les noms de Roman Schnur et, en Italie, d'Emmanuele Castrucci - ont interrogé la situation intellectuelle des XVIe et XVIIe siècles en Europe, en mettant en évidence des filons de pensée, constamment laissés dans l'ombre par l'enquête idéaliste des XIXe et XXe siècles, ancrée dans les dilemmes du jusnaturalisme et de l'historicisme. L'image qui jaillit de ces recherches est celle de l'intellectuel libertin, vu dans une ambiance culturelle et politique que l'on qualifie du mot de "maniérisme".
Il va de soi que l'usage des métaphores mécaniques et techniques, qui renvoient à une artificialité générale et immanente de tout l'univers politique, n'est ni innocent ni fortuit. Il révèle, au contraire, aux origines de l'ère de l'État moderne et de l'État moderne lui-même, un problème philosophique de fond, qui nous apparaît considérable, puisqu'il implique et explique bon nombre de situations que l'on a abordées plus haut. Des études récentes - et on peut rappeler ici les noms de Roman Schnur et, en Italie, d'Emmanuele Castrucci - ont interrogé la situation intellectuelle des XVIe et XVIIe siècles en Europe, en mettant en évidence des filons de pensée, constamment laissés dans l'ombre par l'enquête idéaliste des XIXe et XXe siècles, ancrée dans les dilemmes du jusnaturalisme et de l'historicisme. L'image qui jaillit de ces recherches est celle de l'intellectuel libertin, vu dans une ambiance culturelle et politique que l'on qualifie du mot de "maniérisme".
Le maniérisme
Pourquoi tout ceci nous intéresse-t-il ? Avant tout parce que dans la sensibilité maniériste et baroque prédomine une allégorie désespérée du "vide", de la précarité du monde historicopolitique. Dans cette précarité, l'homme est lié à l'existence terrestre et il est son prisonnier, sans voie de sortie : "la sensibilité européenne du maniérisme et du baroque ne permet aucun signe d'espoir au-delà du profane et ramène constamment à la condition de départ, écrit Castrucci, à la réalité, c'est-à-dire, à un monde réglé par les seuls rapports de force et par la capacité résolutive des décisions politiques du souverain" (7).
L'affirmation de la pensée décisionniste dans la théorie politique des XVIe et XVIIe siècles signale l'avènement de la théorisation nihiliste-libertine : le décisionnisme, en fait, survient seulement là où le "principe espérance" a disparu, où toute tension révolutionnaire généreuse et agitée a manqué et où aucune valeur suprasensible ne donne plus d'illusions à l'homme historique en agitant devant lui l'espoir de la libération.
Mais qui est donc l'intellectuel libertin ? Il fait partie d'une élite qui a pu réfléchir sur l'épouvantable déchaînement des guerres de religion et qui a dû être saisie d'horreur face aux abîmes de chaos et de violence dans lesquels la foi en des valeurs a conduit les hommes. Il a donc mûri un "scepticisme relativiste" qui théorise jusqu'au bout la désillusion vis-à-vis des valeurs mais en même temps se rend compte que les valeurs, même si elles sont rendues indémontrables et sont épurées de toute aura traditionaliste, continuent toujours à faciliter l'intégration sociale, comme autant de mythes politiques. Mais l'ordre qui en découle est un ordre purement conventionnel - c'est exactement la "tentative d'un ordre maniériste", d'après l'expression de Schnur - qui essaie de concilier la suspension subjectiviste des valeurs et la nécessité d'un ordre institutionnel. L'intellectuel libertin s'oriente vers une explication mécaniciste des lois qui président aux catégories du politique.
L'utilisation de l’arcanum
Les élites politiques - auteurs et utilisateurs du savoir/pouvoir qui permet le gouvernement des masses – "devinent la présence, au fond de l’existence de l’existence de l'homme, de forces occultes et très puissantes qui constituent les véritables principes d'origine d’une anthropologie politique. La soif de plaisir, la volonté de puissance, dans l'ensemble de leurs articulations ambiguës et multiples, apparaissent comme un noyau irrationnel, irréductible à toute forme conceptuelle, mais, par contre, riche en renvois vers le territoire inexploré du mythe politique. Cet esprit irrationnel doit être contrôlé et dirigé par des hommes armés de critères d'action rationnels par rapport au but. L'usage du mythe à des fins politiques est d'ailleurs exclusivement instrumental, émancipé par la valeur et dirigé vers la satisfaction de la volonté qui veut la puissance" (7). L'usage de l'arcanum politique est donc un moyen technique/pratique pour essayer d'assurer un ordre conventionnel et artificiel, et le mythe politique est l'instrument le plus efficace pour atteindre ce but. Dans son for intérieur, le maniériste politique vit pourtant de la valeur qu'il a déjà largement dépassée : mais "son sourire est sans joie, car Behemoth peut l'emporter aussi" (7).
Il ne peut en effet ressentir de la joie, celui qui a enlevé sa signification au monde. Beaucoup des "apprentis sorciers" qui se sont dévoués pour atteindre ce but risquent de devoir verser par la suite des larmes amères parce que, au-dessus de cet univers politique artificiel, au-dessus de cette pure mécanique mise en marche uniquement pour des fonctions de contrôle, est suspendue la possibilité - voire la probabilité - de l'auto-dissolution. Et il ne peut y avoir aucune complaisance de la part de celui qui doit prendre acte de cette situation, caractérisée par l'absence radicale de fondement et par l'artificialité inscrite dans les origines mêmes de l'histoire de la modernité politique. Mais aucune connaissance éthique ingénue, aucune "nostalgie humaniste résiduelle", ne sont des refuges possibles, d'autant plus pour l'activiste ou l'homme politique qui projette et espère retrouver un sens dans le monde.
"Nous devons œuvrer", disait Sorel. Si l'on veut répéter ces paroles, et sans être ni des saints ni des héros, en essayant même d'oublier les vociférations et les malhonnêtetés propres à un certain type de "vocation" pour la politique, on doit assumer jusqu'au bout les noyaux cruciaux de "cette" modernité (8).
On vient d'évoquer le maniériste politique. Cette figure vivait dans le contexte historique et politique de l'absolutisme, c-à-d. dans un ordre qui nous paraît profondément lié aux métaphores mécanicistes, qui trouveront par après leur expression accomplie dans la construction hobbesienne du Léviathan. C’est là une donnée intéressante parce qu’un mécanisme ne peut jamais être totalitaire : "C’est quelque chose d’extérieur, que l’on peut utiliser pour obtenir des citoyens une obéissance extérieure, sans que leur intériorité ne soit touchée, sans que leur conscience ne soit éprouvée" (9).
À ce stade de notre exposé apparaît une lecture possible, qui distingue, tant sur le plan historique que sur le plan théorique, l'absolutisme du totalitarisme, puisque ce denier "isme" paraît mû, en général, par une instance unanimisante, qui ne tient pas compte de la libre manifestation de la conscience dans la sphère intérieure. Comme on le devine déjà dans Sorel, le mythe politique, dans sa capacité de mobilisation, imprègne une collectivité de façon globale : avec lui s'évaporent les individualités ; une issue différente ne serait pas possible. Possédant un degré maximal de conscience, le maniériste politique, malgré son désespoir, dispose d'un avantage : une grande liberté intérieure par rapport à ce qu'il a créé lui-même. Il se soumet extérieurement mais sa conscience possède une autonomie totale.
L'Anarque de Jünger
Même sans vouloir forcer de manière excessive le parallèle, il se rapproche sensiblement d'une autre figure, celle de l'Anarque de Jünger. En effet, nous avons jusqu'ici parlé de normes et des tristes impasses auxquelles conduisent les persistances pernicieuses de la norme. Et si l'on cherche maintenant une possibilité de transgression face à toutes les lourdes régularités, face aux lois dont on observe l'immuable répétition dans l'univers politique, l'Anarque présente, peut-être, un formidable exemple de liberté et d'autonomie. Presque sous l'influence d'une conjonction astrale favorable, l'Anarque paraît en mesure de ré-amorcer le jeu, de se projeter vers d'autres solutions, jusqu'alors inconcevables, solutions qui seraient aussi des issues : elles permettraient de sortir des blocages paralysants et désespérants nés du rapport entre conscience et action politique.
"Neutralité intérieure. On y participe quand et si on en a envie. Si dans l'omnibus, il n'y a plus de confort, on descend" (10). L'Anarque connait en profondeur le pouvoir et la politique. Dans la ville imaginaire d'Eumeswil, il dispose même de l'extraordinaire Luminar, pour étudier chaque manifestation de l'histoire, même la plus cachée. L'Anarque, en tant qu'historien, peut analyser le pouvoir et la politique en direct, puisqu'il dépend directement du Condor, le tyran qui a renversé les tribuns et qui règne sur Eumeswil. En tant qu'Anarque, il n'est pas contre l'autorité, même s'il croit ne pas en avoir besoin, puisqu'il a une idée bien précise de la grandeur. Historien, tout l'intéresse, même s'il sait que peu de choses changent. Les drapeaux sont importants pour lui, mais sans signification. "Je les ai déjà vus tantôt hissés, tantôt baissés, dit Martin Venator, comme les feuilles de mai et de novembre (...) On continuera : fêter le 1er Mai, mais avec une interprétation différente. D'autres portraits seront affichés en tête des cortèges".
L'Anarque n'est pas l'adversaire du monarque, il est son pendant
Pour l'Anarque, peu de choses changent. Il porte un uniforme, en partie comme une veste, en partie comme une cape mimétique. Et cet uniforme couvre sa liberté intérieure qu'il saura objectiver dans chaque transition. Tout ceci le différencie de l'anarchiste qui, objectivement privé de liberté, sera l'objet de crises furieuses tant qu'on ne l’enfermera pas dans une camisole de force encore plus rigide. L'anarchiste est l'antagoniste du monarque dont il médite l'anéantissement. Il frappera la personne mais il renforcera la succession. Dans le mot "anarchisme", le suffixe "-isme" a donc une signification restrictive, puisqu'il accroît la volonté mais réduit la substance. L'Anarque, par contre, n'est pas l'antagoniste du monarque mais la personne la plus éloignée de lui. Il n'est pas son adversaire mais son pendant.
"Le monarque veut dominer beaucoup de monde. En fait, il veut dominer tout le monde. L'Anarque ne veut dominer que lui-même. Cela lui permet d'entretenir un rapport objectif, tout empreint de scepticisme, avec le pouvoir, dont il laisse défiler devant lui les images et figures, avec, bien sûr, de l'indifférence dans le cœur. Dans son for intérieur, néanmoins, il n'est ni impassible ni dépourvu de passion stoïque". Martin (ou Manuel) Venator est le serviteur du Condor qui est le tyran : le Condor a sa fonction, comme l'Anarque a la sienne : "Nous avons tous les deux la possibilité de nous retirer à l'intérieur de notre substance qui est l'élément humain dans sa singularité spécifique". L'Anarque se considère comme l'égal du tyran parce qu'il peut le tuer quand il le veut et ceci est la seule et unique forme d'égalité qu'il admet. Le pouvoir de le gracier est naturellement sien aussi.
L'Anarque et le maniériste
La liberté de l'Anarque dépasse aussi celle du maniériste politique. Avant tout, parce que l'Anarque est serein même si sa sérénité est songeuse. Par contre, le maniériste politique est prisonnier de sa conscience désespérée même quand, loin de la malhonnêteté du pouvoir, il pourra se livrer à des méditations où la liberté sera confite dans la mélancolie. Ce qui fait toute la différence, c'est que le scepticisme du maniériste est fatigué et résigné, même s'il n'est pas dépourvu de grandeur tragique. Le scepticisme de l'Anarque, lui, est relié, en fait, à une "disponibilité toujours intacte", ce qui n'est pas simplement une jolie formule mais aussi le signe d'un destin.
"Je suis Anarque dans l'espace ; dans le temps, je suis méta-historien, dit Martin. Donc je ne suis engagé ni avec le présent politique ni avec la tradition, je suis comme une page blanche, je suis puissance et ouvert en toute direction". Comme historien, il est sceptique, mais comme Anarque, il est sur ses gardes. "Ma liberté personnelle est un avantage secondaire, dit-il. Au-delà du temps, je suis prêt à la Grande Rencontre, à l'irruption de l'Absolu dans le temps. C'est là que l'histoire et la science trouvent leur fin".
Le maniériste politique n'est, en toute vraisemblance, concerné que par "son" seul Pouvoir, même si, en certaines circonstances, il peut s'en éloigner. Il disparaîtra avec lui. Pas l'Anarque : chaque lieu n'est, pour lui, qu'un lieu de passage, sa liberté est totale, même face à l'obligation de se donner une limite. Pour le temps d'intervalle, pour les "en attendant", c-à-d. dans les intermèdes entre 2 dominations, il possède un refuge qui n'est pas uniquement intérieur. À la façon du muscadin, l'Anarque a bâti son repaire loin de la ville. Là-bas, il pourra disparaître pendant qu’il faudra.
L'Anarque et le pouvoir
Son rapport avec le pouvoir n'est pas seulement de nature sceptique, mais est aussi ouvert aux suggestions de la magie. Au "bar de nuit", il écoute les dialogues des puissants et, quand l’heure est tardive et que la fatigue s'installe, leurs figures, leurs silhouettes se découpent, hiératiques, plus nettes, dans un maintien presque sacré. "Je voyais leurs visages se durcir comme dans le rite sacrificateur. Il se formait ensuite une aura de mystère". Très certainement, il s'agit ici, comme parfois chez Jünger, d'une pure fascination esthétique. Mais il est vraiment très symptomatique que, dans le calme et l'indifférence absolue de l'Anarque, survient quelquefois une sorte d'impatience nerveuse, une inquiétude fébrile. Tout compte fait, c'est là le contrepoids à sa disponibilité toujours intacte, c'est une sorte de péage qui est dû, mais l'Anarque semble penser que cela en vaut la peine.
L'entrée en scène de l'anarchiste/nihiliste conforte la société et renforce son unité. L'Anarque, lui, reconnaît au fond de son intimité l'imperfection fondamentale de l'État et de la société. C'est pour cela que cette position peut s'avérer plus dangereuse pour lui. L'État et la société suscitent sa répulsion mais il sait toutefois que "des temps et des lieux peuvent se présenter où l'harmonie invisible transparaît dans l'harmonie visible. Cela se constate surtout dans l'œuvre d'art. Dans ce cas, dit l'Anarque, il est encore possible de servir dans la joie". Mais, en général, l'Anarque fait preuve de circonspection et d'une prudence hors pair dans ses rapports avec le pouvoir. Il cultive un penchant instinctif pour les normes, parce qu'elles lui évitent de trop réfléchir, du moins aux choses superflues. Il se fera difficilement apprécier et les puissants seront toujours contents de ses services, mais de façon discrète, modérée.
L'Anarque, les dieux, la religion
L'Anarque peut aussi devenir "excessif" : cela arrive quand l'inquiétude survient à nouveau. Ses prétentions deviennent alors exorbitantes. Par ex. en matière de religion. Certes, pour lui, le terme est usé et corrompu. Religio, comme on le sait, se rattache à "lien" et c'est justement cela que refuse l'Anarque. Il ne veut rien savoir des divinités et des rumeurs qui les concernent, sinon en tant qu'historien. En tant qu'Anarque, il demande davantage. "Le fait que les dieux se soient montrés, non seulement dans la préhistoire, mais aussi à la fin de l'époque historique, explique-t-il, n'est pas à mettre en doute. Ils ont participé à nos banquets et à nos luttes". Mais voilà la requête totale : "Qu'apporte à l'affamé la splendeur des festins d'antan ? Que rapporte au pauvre le tintement des pièces d'or qu'il perçoit à travers le mur du temps ? C'est la présence qu'il faut exiger".
Ce jeu de relance, que joue l'Anarque, nous apparaît parfois surprenant. La cité imaginaire d'Eumeswil advient dans un temps, où toute chose semble être définitivement passée. Passée, l'ère chrétienne. Passé, l'État mondial. Passée, l'époque des "grands incendies". Chaque temps réel et chaque temps possible sont révolus. Historien, Martin le sait bien : "... je suis convaincu de l'inadéquation, ou, mieux, de l'inutilité de tout effort ; j'admets qu'y contribue aussi l'hypersatiété des temps les plus récents. Le catalogue des possibles paraît épuisé. Les grandes idées sont consommées par la répétition : on ne peut plus rien en tirer". C'est là un problème qui renforce la douleur de l'historien : la faillite des idéaux se fracassant contre l'esprit du temps, qui les dégradent en illusions.
De ce point de vue, il faudrait renoncer alors aux exigences excessives, apaiser cette disponibilité faite d'inquiétude. "Dans une telle situation, la tentation d'invoquer les dieux est très forte et il y a alors grand mérite à y résister", reconnaît l'Anarque. Parce qu'Eumeswil semble se poser comme un lieu d'observation privilégiée pour attendre une récapitulation définitive et concluante et ainsi préparer l'opération "fin du temps". L'Anarque suivra les puissants dans le "recours aux forêts". Cette métaphore indique sans doute que la fin est nécessaire ou bien elle suggère la voie des révélations occultes, permettant de rêver à un monde au visage autre, d’y rêver à la façon des dieux. Le "recours à la forêt" indique peut-être aussi ce passage qui est la mort, ou le retour au chaos, ou un simple passage sans limitation. Il est probablement inutile de chercher un "message". Et même, s’il parvenait à le cerner, ce message, l’Anarque l’aurait déjà dépassé. Tandis que nous resterions ici, à chercher comment diable il serait possible d’œuvrer, et sur quel mode.
Notes :
-
Cf. Jules Monnerot, Les lois du tragique, PUF, 1969. Monnerot écrit, en rappelant Jaspers : "Le type d'action qui ainsi échappe à l'agent alors qu'il importerait qu'elle ne lui échappât point, c'est l'action tragique. L'hétérotélie, lorsque les conséquences des décisions voulues entraînent une catastrophe pour l'agent, et non la plupart du temps pour lui seul, c'est le tragique", p. 10. -
C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus : "La théorie du mythe est la manifestation la plus forte qui prouve que le rationalisme relatif de la pensée parlementaire a perdu son évidence". [tr. fr. in Parlementarisme et démocratie, Seuil, 1988]
-
Pour Kelsen, Ponce Pilate eut la figure pouvant le mieux symboliser l'attitude relativiste qui est à la base de la démocratie. Face au Christ qui se présente "pour rendre témoignage à la vérité", Ponce Pilate demande "Qu’est-ce que la vérité ?". Et parce que lui, Pilate, le sceptique relativiste, ne sait ce qu'est la vérité, l'absolue vérité en laquelle croit l'homme qui est devant lui, il s'en remet, en toute bonne conscience, à la procédure démocratique et laisse la décision au vote populaire. Cf. aussi La polémique entre H. Kelsen et C. Schmitt sur la justice constitutionnelle, N. Zanon, in Annuaire international de justice constitutionnelle n°V, 1989, p. 177 sq. -
Il m'apparaît assez imprudent de résumer en quelques lignes une question aussi décisive et fondamentale. Récemment est parue une défense de la "démocratie sans valeurs" : c'est l'ouvrage de Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Einaudi, Torino, 1984. La démocratie est perçue ici comme modalité structurelle et réglementation procédurière : elle trouve sa justification en un relativisme politique radical qui ne connaît aucun absolu mais seulement des formes entre lesquelles les diverses valeurs admises peuvent louvoyer. On peut ajouter que la "démocratie sans valeurs" est conceptuellement liée au développement du Rechtsstaat, c-à-d. d'un État qui vit dans le droit mais ne reconnaît aucun droit ou, mieux, d'un État qui ne peut lui donner aucune définition matérielle ni aucun contenu et ne peut que lui attribuer des connotations en termes de mécanisme juridique. Ainsi, la "démocratie sans valeurs" et l'État de droit acceptent le principe de n'être que le cadre juridique qui cherche à déterminer et à circonscrire un champ de rencontre, un terrain de contradiction et de contraste. La "démocratie sans valeurs" et l'État de droit se posent, en d'autres mots, comme les règles du jeu. Aux antipodes de cette conception, se trouve le Carl Schmitt qui écrit la Verfassungslehre : pour lui, la démocratie signifie essentiellement l'homogénéité politique du peuple, dont la cohésion fonde un organisme politique basé sur l'exclusion de l'autre, de tout ce qui, politiquement, ne relève pas de tel peuple. L'antithèse formel/substantiel qui se trouve sous-jacente dans le rapport entre, d'une part, la démocratie comprise comme ensemble de règles de jeu et, d'autre part, la démocratie comprise comme homogénéité politique, peut être parfaitement considérée comme un problème encore actuel.
-
Cité par E. Castrucci, Ordine convenzionale e pensiero decisionista, Giuffrè, Milano, 1981, p. 37.
-
Sur le concept de Repräsentation, voir C. Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form, Theatiner Verlag, München, 1925. Dans cet essai, [réédité chez Klett Cotta, Stuttgart, 1984], l’A. soutient la thèse que l'Eglise est forma politica au sens le plus éminent, c-à-d. est un ordre dans lequel la souveraineté apparaît visible, "représentée", comme complexio oppositorum, comme institution (aussi au sens juridique) qui donne forme aux contraires et conserve inaltéré la racine théologique de la transcendance.
-
in Storia delle idee e dottrina decisionistica, essai d’introduction à : R. Schnur, Individualismo e assolutismo, Giuffrè, 1979, p. IV.
-
-
R. Schnur, Individualismo e assolutismo, p. 87. Tr. it. de Individualismus und Absolutismus. Zur politischen Theorie vor Thomas Hobbes, Berlin 1963.
-
E. Jünger, Eumeswil. Toutes les citations qui suivent sont tirées de ce livre. Les pages n’ont pas été mentionnées non seulement pour ne pas alourdir la lecture mais surtout parce que c’est inopportun. Certaines phrases de cet auteur n’appartiennent en effet pas à telle ou telle page mais bien plutôt à des états particuliers de la conscience, accessibles uniquement à ceux s’en montrant disponibles.

 Così è anche il caso della Russia odierna (intendendo con questa formula l’intero Impero Zarista, estendendosi fino ai Balcani e alla Turchia, con Bisanzio come nuova Gerusalemme), che ha subìto due tentativi di occidentalizzazione, dapprima con Pietro il Grande (petrinismo) e poi con Lenin (bolscevismo). Questi tentativi però toccano solo la superficie dell’anima russa, e, anzi, aumentano l’odio dei Russi nei confronti dell’Occidente, un odio simile a quello degli zeloti per Roma. Il suo destino sarebbe quello di collidere con l’Occidente, come era già successo con le guerre tra la Russia e la Francia (Guerre Napoleoniche), l’Austria-Ungheria (Prima Guerra Mondiale), e avverrà contro la Germania (Seconda Guerra Mondiale).
Così è anche il caso della Russia odierna (intendendo con questa formula l’intero Impero Zarista, estendendosi fino ai Balcani e alla Turchia, con Bisanzio come nuova Gerusalemme), che ha subìto due tentativi di occidentalizzazione, dapprima con Pietro il Grande (petrinismo) e poi con Lenin (bolscevismo). Questi tentativi però toccano solo la superficie dell’anima russa, e, anzi, aumentano l’odio dei Russi nei confronti dell’Occidente, un odio simile a quello degli zeloti per Roma. Il suo destino sarebbe quello di collidere con l’Occidente, come era già successo con le guerre tra la Russia e la Francia (Guerre Napoleoniche), l’Austria-Ungheria (Prima Guerra Mondiale), e avverrà contro la Germania (Seconda Guerra Mondiale). Questo fu scritto 80 anni prima del crollo dell’Unione Sovietica (e del bolscevismo). Adesso le previsioni di Spengler si sono avverate: la Russia riemerge dal caos della caduta dell’URSS, con una sua nuova forza e un più forte carattere nazionale, autenticamente slavo, riscoprendo la fede ortodossa, riaffermandosi come potenza e muovendo i primi passi verso un impero eurasiatico, guarda a caso proprio nei Balcani (verso la Serbia e il Kosovo) e nel Caucaso (verso l’Abcasia e l’Ossezia), scontrandosi con la potenza occidentale egemone (gli Stati Uniti). Per questo motivo, non siano frettolosi gli esegeti di Spengler nel riconoscere Putin (in foto) come uno dei Cesari dell’Occidente al tramonto: potrebbe essere un Barbarossa o un Giustiniano della nuova Russia che avanza.
Questo fu scritto 80 anni prima del crollo dell’Unione Sovietica (e del bolscevismo). Adesso le previsioni di Spengler si sono avverate: la Russia riemerge dal caos della caduta dell’URSS, con una sua nuova forza e un più forte carattere nazionale, autenticamente slavo, riscoprendo la fede ortodossa, riaffermandosi come potenza e muovendo i primi passi verso un impero eurasiatico, guarda a caso proprio nei Balcani (verso la Serbia e il Kosovo) e nel Caucaso (verso l’Abcasia e l’Ossezia), scontrandosi con la potenza occidentale egemone (gli Stati Uniti). Per questo motivo, non siano frettolosi gli esegeti di Spengler nel riconoscere Putin (in foto) come uno dei Cesari dell’Occidente al tramonto: potrebbe essere un Barbarossa o un Giustiniano della nuova Russia che avanza.



 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg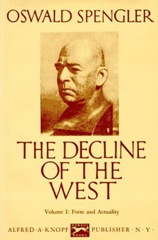




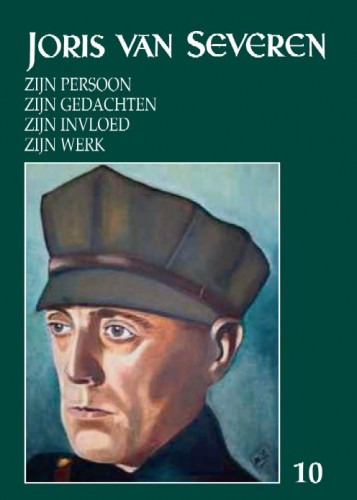

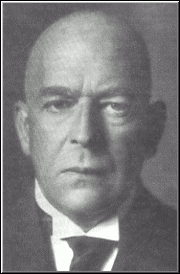










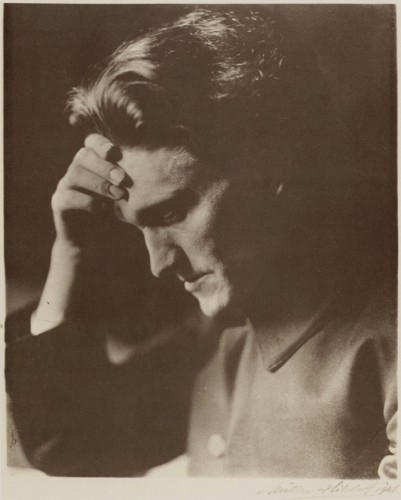


 C'est d'une technique pratique que l'
C'est d'une technique pratique que l' Il va de soi que l'usage des métaphores mécaniques et techniques, qui renvoient à une artificialité générale et immanente de tout l'univers politique, n'est ni innocent ni fortuit. Il révèle, au contraire, aux origines de l'ère de l'État moderne et de l'État moderne lui-même, un problème philosophique de fond, qui nous apparaît considérable, puisqu'il implique et explique bon nombre de situations que l'on a abordées plus haut. Des études récentes - et on peut rappeler ici les noms de
Il va de soi que l'usage des métaphores mécaniques et techniques, qui renvoient à une artificialité générale et immanente de tout l'univers politique, n'est ni innocent ni fortuit. Il révèle, au contraire, aux origines de l'ère de l'État moderne et de l'État moderne lui-même, un problème philosophique de fond, qui nous apparaît considérable, puisqu'il implique et explique bon nombre de situations que l'on a abordées plus haut. Des études récentes - et on peut rappeler ici les noms de  Het interbellum zorgde voor een enorme toevloed van ideeën op zowat alle vlakken. De humanist Lord Boyd Orr noemde de naoorlogse periode niet zonder reden ‘de grootste en snelste overgangsfase in de menselijke beschaving’ (1). Vooral Duitsland was een bijzonder vruchtbare regio op vlak van politieke ideeën, hoewel we dichterbij uiteraard ook genoeg interessante figuren kunnen vinden. Het interbellum bewees op politiek-filosofisch vlak vooral dat de grenzen tussen socialisme, marxisme en nationalisme helemaal niet zo abstract zijn als men zou denken. ‘Les extrèmes se touchent’. Een open geest is dus noodzakelijk.
Het interbellum zorgde voor een enorme toevloed van ideeën op zowat alle vlakken. De humanist Lord Boyd Orr noemde de naoorlogse periode niet zonder reden ‘de grootste en snelste overgangsfase in de menselijke beschaving’ (1). Vooral Duitsland was een bijzonder vruchtbare regio op vlak van politieke ideeën, hoewel we dichterbij uiteraard ook genoeg interessante figuren kunnen vinden. Het interbellum bewees op politiek-filosofisch vlak vooral dat de grenzen tussen socialisme, marxisme en nationalisme helemaal niet zo abstract zijn als men zou denken. ‘Les extrèmes se touchent’. Een open geest is dus noodzakelijk.