mardi, 14 septembre 2021
Age of Entitlement : Caldwell met en pièces la révolution des "droits civils".

Age of Entitlement : Caldwell met en pièces la révolution des "droits civils"
par Daniele Scalea
Ex: https://www.centromachiavelli.com/2021/09/09/caldwell-age-of-entitlement-recensione/
Le journaliste américain Christopher Caldwell, rédacteur en chef de la Claremont Review of Books, est un homme qui, à bien des égards, va à contre-courant de la tendance dominante : un conservateur qui parvient à se faire publier régulièrement par le New York Times, mais, à l'ère de l'hyper-simplification sociale boulimique, on ne le trouve pas sur Facebook ou Twitter, et il publie un livre tous les dix ans. Mais ce sont des livres qui laissent des traces.
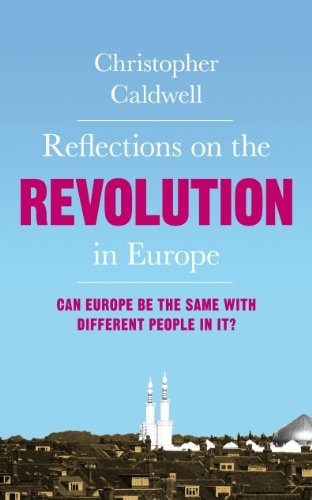
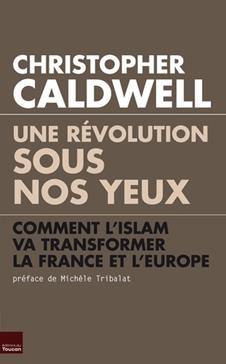
En 2009, deux ans avant la grande crise migratoire qui lancera le thème, il publie Réfllexions sur la révolution en Europe: une analyse fine de la manière dont l'immigration, notamment musulmane, révolutionne déjà l'Europe. Ceux qui ont lu le livre beaucoup plus modeste de l'auteur de cette critique, Immigration : the Reasons of Populists, se souviendront de l'ouvrage de Caldwell comme l'un des textes fondamentaux sur le sujet.
L'année dernière, un nouvel ouvrage du journaliste américain est arrivé sur les étagères des librairies : The Age of Entitlement. America since the Sixties. Le titre, qui se traduit approximativement par "l'âge des droits" (mais le terme "entitlement" a une connotation qui renvoie au privilège et à la revendication), fait référence à l'ère de l'histoire américaine qui a débuté avec la loi sur les droits civils de 1964.
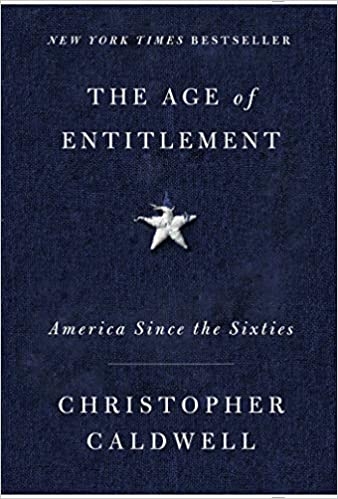
Le livre analyse ces cinquante dernières années, en essayant de lire entre les lignes des événements et d'expliquer comment et pourquoi la société a changé. Il s'agit sans aucun doute d'un ouvrage essentiel pour le chercheur américain, mais il est également intéressant et précieux pour d'autres : parce que l'on sait combien le Nouveau Monde a eu d'influence sur l'Ancien, et parce que, comme l'écrit Caldwell lui-même, "la politique des droits civils s'est avérée être l'exportation américaine la plus réussie de la fin du vingtième siècle". L'Amérique décrite par Caldwell est aussi, dans les grandes lignes, notre Europe : en comprenant la première, on peut comprendre la seconde.
Age of Entitlement est un livre iconoclaste, qui met en pièces l'un des totems du progressisme (la déségrégation raciale) ainsi que celui du conservatisme (Reagan). Bien entendu, Caldwell n'est pas nostalgique du racisme et de la ségrégation, mais il regarde au-delà de la surface pour pénétrer dans les profondeurs de la révolution que le président Lyndon Johnson, exploitant la vague d'émotions suscitée par l'assassinat de son prédécesseur Kennedy, a lancée avec le Civil Rights Act, la loi fédérale qui a mis fin à la discrimination raciale dans le Sud. Comme l'explique en détail l'auteur, cette révolution a été lancée par une Amérique encore conservatrice, dominée à tous les niveaux (politique, médias et académie) par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui ne souhaitaient que mettre fin à la honte de la ségrégation.
Le résultat n'a pas répondu aux attentes du public. La réforme des droits civils est devenue l'une des entreprises les plus difficiles et les plus durables de l'histoire des États-Unis : elle a débuté dans les années 1960, a duré (jusqu'à présent) un demi-siècle, a coûté des billions de dollars et a conduit à une relecture de l'ensemble de l'histoire américaine à la lumière du problème racial. La race a pris une signification religieuse et le mouvement des droits civiques est devenu son église. La réforme des droits civils était censée mettre fin à l'obsession de la race dans le Sud : elle a fini par la nationaliser par le biais de l'action positive, ou discrimination "positive". Avec elle, un système explicite de préférence raciale a été introduit au niveau fédéral.
En outre, la loi sur les droits civils a également offert un modèle de pouvoir transformateur fondé sur la coercition, les dépenses et le mépris des prescriptions constitutionnelles. L'imposition bureaucratique, les décrets, la surveillance militante, les poursuites judiciaires et les décisions de justice ont été les outils utilisés, au cours des décennies suivantes, par chaque minorité pour affirmer ses privilèges contre la tradition et la volonté de la majorité. Les tribunaux et la bureaucratie ont remplacé la politique démocratique. Par exemple, le Bureau des droits civils a été créé, dont les directives ont depuis été traitées comme des lois par les tribunaux, bien qu'elles aient été rédigées par des bureaucrates en dehors de toute représentation et de tout contrôle démocratiques. La loi sur les droits civils est devenue une deuxième constitution "non officielle" qui, en cas de conflit avec la première et "officielle", prévaut toujours. D'où l'annulation de certains "anciens" droits constitutionnels tels que la liberté d'association (pour interdire la ségrégation) et la liberté d'expression. En 1978, la Cour suprême a statué qu'il était légitime d'attribuer des notes sur une base raciale en tant que handicap ; en d'autres termes, la discrimination positive ne visait plus à compenser le racisme passé, mais à corriger le racisme (supposé) présent. Les différences de résultats entre les groupes doivent désormais nécessairement être attribuées au racisme. Prétendre le contraire (par exemple en remettant en question le mérite individuel) revient à délégitimer la révolution des droits civils, la nouvelle "Constitution" de facto des États-Unis. Voici la censure des opinions divergentes, qui prendra la forme du "politiquement correct". Le système créé par les droits civils fait qu'il est intenable pour toute entreprise de supporter des cas de discrimination. Les employeurs sont donc toujours prêts à licencier les employés qui sont attaqués par les "progressistes". C'est la privatisation de la censure. Tout le monde a peur de dire un mot déplacé qui pourrait lui coûter sa carrière. Le politiquement correct est une réforme imposée d'en haut à l'opinion publique par le biais de la punition des dissidents. Il s'agit - écrit Caldwell - de "la conquête idéologique du pouvoir institutionnel la plus complète de l'histoire des États-Unis".

Toutes les impulsions des minorités ont, depuis 1964, toujours prévalu sur la démocratie. Un exemple évident est celui des gays. Caldwell retrace dans un chapitre le processus d'émancipation/affirmation jusqu'au mariage homosexuel, en soulignant comment il a eu lieu à chaque étape contre l'opinion dominante (qui ne se conformera qu'a posteriori aux décisions affirmées par la minorité) et toujours par le biais de décisions de justice dans des cas étudiés à la table par des fondations et des cabinets d'avocats, dans lesquels les plaignants eux-mêmes sont soigneusement sélectionnés pour plaire aux juges (voir Edith Windsor). Le résultat a été la redéfinition juridique du mariage, qui n'est plus une réalité préexistante à l'État et reconnue par lui, mais une institution sociale créée par l'État lui-même (et qui, en tant que telle, ne peut accepter aucune forme de discrimination).
Les premières épigones noires à exploiter le nouveau modèle dans les années 1970 ont toutefois été les féministes, mais pas toujours avec des résultats heureux pour les femmes elles-mêmes. Le modèle du New Deal de la famille à revenu unique, dans lequel le salaire du mari devait compenser les tâches ménagères de sa femme, a été renversé. Depuis les années 1970, les femmes aussi doivent travailler sur le marché pour gagner leur part, mais cela ne s'ajoute pas à ce qu'elles avaient déjà par l'intermédiaire de leur mari. Le revenu familial reste le même, mais deux personnes doivent désormais travailler pour le gagner. Caldwell cite une pensée intéressante de Bertrand Russell, selon laquelle l'État-providence remplacerait l'État dans le rôle du père et, ce faisant, saperait la moralité traditionnelle. La mère n'a plus besoin d'un père fiable pour ses enfants. Les hommes, privés du rôle paternel, perdent tout intérêt pour la postérité, l'histoire, la continuité et la procréation. Nous ne savons pas si le diagnostic de Russell est correct, mais les symptômes sont sans aucun doute ceux décrits et Lyndon Johnson a créé un État-providence aux États-Unis.
Les années 1970 ont également marqué un changement important au sein de la classe dirigeante américaine. La défaite au Vietnam a miné le prestige de l'armée : ce ne sont plus les anciens combattants qui donnent le ton, mais la génération des baby-boomers et, en particulier, ceux qui s'étaient opposés à la guerre et ne l'avaient pas combattue (essentiellement l'élite universitaire). Il est essentiel de comprendre le rôle des baby-boomers : comme leur nom l'indique, les personnes nées entre 1946 et 1964 constituent une génération numériquement énorme. Pour être précis, note Caldwell, la plus grande génération de l'histoire américaine. Pendant trois quarts de siècle, toutes les autres générations, qu'elles aient précédé ou suivi, ont dû se conformer aux préoccupations exprimées par les baby-boomers, plus nombreux, qui, bien entendu, ont évolué au fur et à mesure de leur maturation : dans les années 1960 et 1970, ils sont jeunes et la sexualité domine ; dans les années 1980 et 1990, ils sont en pleine maturité et l'accent est mis sur la famille et les possibilités d'enrichissement ; après 2000, il s'agit de protéger le patrimoine constitué au cours des décennies précédentes. Caldwell ne peut pas le faire pour des raisons de temps, ayant écrit la majeure partie du livre avant 2020 : mais on pourrait ajouter ce qui s'est passé ces deux dernières années, lorsque les Boomers, maintenant âgés de 60-70 ans, face à une vague épidémique, ont soumis l'ensemble de la société aux exigences de la santé préventive.
Caldwell donne une interprétation originale de la contre-culture des années 1970 : selon lui, elle est essentiellement réactionnaire, un mouvement mystique qui regrette la pureté perdue de l'Amérique du passé ; tout est marqué par un sentiment de décadence. Ce n'est pas un hasard si les citoyens de cette décennie, confrontés à une criminalité galopante et à la propagation de la toxicomanie, sont arrivés à la conclusion que les brillants projets sociaux des années 1960 avaient échoué : c'est pour mettre fin à ces expériences qu'ils ont, à leur grande surprise, porté Ronald Reagan à la Maison Blanche en 1981. Contrairement aux attentes, Reagan n'a pas coulé mais sauvé le système progressiste, qui reviendra d'ailleurs avec encore plus de force après lui.

L'accusation de Caldwell contre Reagan était qu'il n'était conservateur qu'en paroles. Il était plutôt un libertaire, influencé (comme beaucoup de droitiers de sa génération) par Ayn Rand et le culte anti-traditionnel et anti-moraliste du capitalisme débridé. Le slogan Reagan du "rêve américain" est celui d'une génération qui n'accepte pas les limites de la nature ou du bon sens, qui veut tout maintenant. Avec les Reaganomics, les Boomers ne font qu'exploiter le futur travail de leurs enfants, par l'endettement, et celui des étrangers, par les délocalisations et les portes ouvertes à l'immigration.
La voie choisie par Reagan n'était en aucun cas obligatoire : au cours de ces années, la société américaine a atteint le taux de dépendance le plus bas (c'est-à-dire le rapport le plus élevé entre la population productive et la population non productive) et n'était pas confrontée à une urgence particulière. Et pourtant, la dette a encore augmenté pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon Caldwell, les baby-boomers ont acheté (avec l'argent de leurs enfants) la paix sociale avec les secteurs de la société qui dépendaient désormais de l'État-providence Johnsonien, dont le coût explosait et qui, sous Reagan, atteignait des trillions. Reagan a financé (et augmenté) les coûts de la déségrégation mais a compensé la classe moyenne blanche (affectée par la discrimination positive : chaque emploi donné à un homme noir par préférence raciale est un emploi enlevé à un homme blanc qui l'aurait eu par mérite) en réduisant les impôts. Il a donc été le sauveur de la Grande Société (c'est ainsi qu'on appelle en Amérique le programme des démocrates, à partir de Johnson, visant à éliminer la pauvreté et les inégalités raciales), mais au prix de l'endettement de la postérité, de la désindustrialisation du pays et de l'ouverture des portes à l'immigration sauvage.
C'est en 1986, sous la présidence de Reagan, qu'une loi bipartisane a accordé l'amnistie et la citoyenneté aux nombreux immigrants illégaux et, par le biais d'une législation anti-discrimination, a de facto forcé les employeurs (qui ne pouvaient pas "discriminer" sur la base de l'origine nationale) à embaucher des illégaux. Les immigrés ont moins de droits sur le lieu de travail, bien sûr, mais ils en auront davantage devant les tribunaux, en tant que victimes éventuelles de discrimination. De nouveaux groupes ethniques rejoignent les Noirs en tant que "minorités" à protéger dans le cadre du nouveau culte de la "diversité".
Les années 1990 ont été la décennie de l'essor de la nouvelle économie, à propos de laquelle Caldwell est également critique. Avant elle, le pays était "un tout économique"; avec elle, il est devenu une simple partie économique de la division internationale du travail. Des concepts tels que la "souveraineté" et l'"indépendance" ont perdu leur sens; la capacité (donnée par la technologie) d'assembler des composants individuels à distance a permis même aux pays pauvres et non industrialisés de concurrencer les États-Unis. Surtout, les nouvelles chaînes de valeur mondiales n'avaient plus une finalité industrielle (c'est-à-dire la recherche d'une valeur ajoutée dans le monde) mais une finalité politique: elles servaient à passer outre les droits des travailleurs. Le favoritisme fiscal accordé aux entreprises de haute technologie devait porter le coup de grâce à l'économie traditionnelle: des géants comme "Amazon" devaient être aidés par la politique pour remplacer les petits détaillants.

Les années 1990 ont également vu une accélération de la spirale de l'endettement. Le Républicain George H.W. Bush et le Démocrate Bill Clinton ont tous deux procédé au Bush et Bill Clinton ont poursuivi sur la voie de Reagan (financement de l'État-providence par la dette plutôt que par les impôts). Les prêts ont été complètement politisés : suivant le mantra selon lequel toute inégalité serait une discrimination, l'État a favorisé et garanti les prêts aux minorités (la facture sera payée la décennie suivante avec la crise des prêts hypothécaires à risque et les sociétés soutenues par l'État - "Fannie Mae" et "Freddie Mac" - qui les ont accordés). En outre, les banques ont été incitées (pour éviter les accusations de racisme) à accorder des prêts libéraux et à faire contrôler leurs prêts par des "groupes communautaires" liés au mouvement des droits civiques : des milliards de dollars entre les mains d'organisations politiques hautement idéologisées.
La "société civile" a gagné en importance au cours de cette période, complétant les juristes et les bureaucrates dans l'exercice du pouvoir réel. Dans les années 1980, les super-riches augmentaient leur richesse à un rythme sans précédent, alors que dans le même temps, un culte idolâtre des managers et de l'élite en général se répandait. Le concept de "philanthropie" a subi un changement majeur : alors qu'il ne s'agissait auparavant que de charité et d'aide aux pauvres et aux nécessiteux, il a été établi que la propagande idéologique pouvait également être incluse. Ce qui n'a pas changé, c'est la large déductibilité fiscale des sommes consacrées à la "philanthropie". Les super riches peuvent désormais utiliser des fondations pour influencer la politique en fonction de leurs intérêts pratiques ou de leurs idéaux, l'ensemble de la population devant payer la facture et compenser la perte de recettes fiscales. Il va sans dire que la grande majorité de ces super-riches sont du côté des "progressistes" et des "droits civils". Selon M. Caldwell, parmi les nombreuses motivations, une seule prévaut : l'élite est une minorité et, en tant que telle, bénéficie de lois et de pratiques qui réduisent le pouvoir de la majorité. Elle ne se soucie peut-être pas du sort des Noirs, des immigrés et des homosexuels, mais elle se soucie que la minorité ait les moyens de l'emporter sur la majorité.
Il existe un autre événement peu connu des années 1990 que Caldwell désigne comme très important dans l'histoire américaine : la légalisation et la commercialisation massive de l'OxyContin et d'autres opioïdes à base d'oxycodone en 1996. Puissants analgésiques à fort effet de dépendance, ils ont été à la base d'un nouveau cycle épidémique de toxicomanie dans la population américaine, après l'héroïne dans les années 1970 et le crack dans les années 1980. M. Caldwell se demande comment, dans le débat public et la culture populaire, ces deux autres épidémies d'opioïdes ont eu une profonde influence, alors que l'épidémie actuelle passe plutôt inaperçue. Pourtant, son taux de mortalité est 10 fois supérieur à celui des années 1980 et 20 fois supérieur à celui des années 1970. Qu'est-ce qui a changé ? La réponse de Caldwell est la suivante : à la différence des deux précédentes, l'épidémie d'oxycodone touche principalement les Blancs (au point de provoquer un déclin anormal et rapide de leur population qui n'est compensé que par l'immigration) et ne peut donc pas s'inscrire dans le récit moral "officiel". Le politiquement correct a créé une hiérarchie "morale" entre les races, dans laquelle les Blancs constituent la base méprisée et ne sont destinés qu'à se tordre de culpabilité. L'autorité morale appartient aux Noirs (à tel point que de nombreux Blancs se font passer pour des Noirs : le livre en offre quelques exemples illustres, mais nous avons également abordé ce phénomène dans ce blog) ; la blancheur, en revanche, est considérée comme un état spirituel inférieur - et héréditaire. En somme, la révolution des droits civiques n'a pas créé un monde nouveau, mais seulement effectué une transvalorisation : c'est le même vieux monde mais à l'envers. La pyramide raciale et raciste est toujours là, mais elle a été renversée. La situation s'est peut-être même aggravée, selon M. Caldwell. L'ancienne Constitution américaine garantissait la neutralité et la liberté raciales. La "nouvelle constitution" officieuse des droits civils, en revanche, favorise la conscience raciale et le dirigisme gouvernemental.
Dans ce cadre, les démocrates sont devenus le parti de ceux qui bénéficient des droits civils : les minorités (y compris les super-riches), les immigrants, les femmes (et plus particulièrement les féministes), les bureaucrates, les juges et les avocats. Le parti républicain a donc changé : il englobe désormais l'ensemble du spectre politique d'avant 1960, qui était à l'époque divisé entre les partisans et les opposants du New Deal. Les démocrates, qui contrôlent l'économie et la culture grâce à leur hégémonie dans les universités et les organisations à but non lucratif, dirigent le système même lorsqu'ils ne sont pas au gouvernement. Les républicains, isolés de la classe instruite, sont incapables d'influencer le système (même lorsqu'ils gouvernent) et même de comprendre sa logique.
C'est le dernier et précieux avertissement du livre de Caldwell, qui rend également justice à l'activité de ces associations ou fondations qui, comme le Centro Studi Machiavelli, tentent de reconnecter la droite avec la connaissance afin de la rendre capable de dominer le système, au lieu de s'illusionner en pensant qu'elle peut gouverner - sans le faire - après chaque élection qu'elle gagne.
Daniele Scalea
Fondateur et président du Centre d'études Machiavelli. Diplômé en sciences historiques (Université de Milan) et docteur en études politiques (Université Sapienza), il enseigne "Histoire et doctrine du djihadisme" et "Géopolitique du Moyen-Orient" à l'Université Cusano. De 2018 à 2019, il a été conseiller spécial sur l'immigration et le terrorisme auprès du sous-secrétaire aux affaires étrangères Guglielmo Picchi. Son dernier livre (écrit avec Stefano Graziosi) s'intitule Trump contre tous. L'Amérique (et l'Occident) à la croisée des chemins.
13:27 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, livre, christopher caldwell, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 décembre 2011
Une grande transformation

Une grande transformation
par Georges FELTIN-TRACOL
En 2009, le journaliste Christopher Caldwell faisait paraître Reflections on the revolution in Europe, clin d’œil appuyé à l’ouvrage contre-révolutionnaire du Whig Edmund Burke publié en 1790. Les Éditions du Toucan viennent de sortir sa traduction française sous le titre d’Une révolution sous nos yeux. Alors que les maisons d’éditions institutionnelles se gardent bien maintenant de traduire le moindre ouvrage qui irait à l’encontre de la pesante pensée dominante, saluons cette initiative qui permet au public francophone de découvrir un point de vue divergent bien éloigné de l’agencement ouaté des studios de radio et des plateaux de télévision.
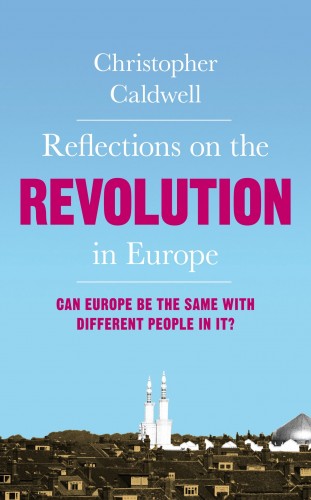 Éditorialiste au Financial Times (le journal officiel de la City) et rédacteur au Weekly Standard et au New York Times Magazine, Christopher Caldwell relève du courant néo-conservateur anglo-saxon. Il en remercie même William Kristol, qui en est l’une des têtes pensantes. L’édition française est préfacée par la démographe Michèle Tribalat qui, avec son compère Pierre-André Taguieff, semble ébaucher une sensibilité néo-conservatrice dans l’Hexagone plus charpentée que les guignols de la triste revue Le meilleur des mondes.
Éditorialiste au Financial Times (le journal officiel de la City) et rédacteur au Weekly Standard et au New York Times Magazine, Christopher Caldwell relève du courant néo-conservateur anglo-saxon. Il en remercie même William Kristol, qui en est l’une des têtes pensantes. L’édition française est préfacée par la démographe Michèle Tribalat qui, avec son compère Pierre-André Taguieff, semble ébaucher une sensibilité néo-conservatrice dans l’Hexagone plus charpentée que les guignols de la triste revue Le meilleur des mondes.
On pourrait supposer qu’Une révolution sous nos yeux est un lourd pensum ennuyeux à lire composé de douze chapitres réunis en trois parties respectivement intitulées « Immigration », « L’islam » et « L’Occident ». Nullement ! Comme la plupart des enquêtes journalistiques anglo-saxonnes, les faits précis et détaillés sont étayés et argumentés. Il faut avouer que le sujet abordé est risqué, surtout en France…
« Ce livre, avertit l’auteur, évitera l’alarmisme et la provocation vaine, mais il évitera aussi l’euphémisme et cette façon de se coucher (à titre préventif) qui caractérise tant d’écrits sur les questions relatives à l’ethnicité (p. 53). » Qu’aborde-t-il donc ? « Ce livre, répond Caldwell, traite de l’Europe, de comment et pourquoi l’immigration et les sociétés multi-ethniques qui en résultent marquent une rupture dans son histoire. Il est écrit avec un œil rivé sur les difficultés que l’immigration pose à la société européenne (p. 52).
Partant des déclarations prophétiques en avril 1968 du député conservateur Enoch Powell au Midland Hotel de Birmingham consacrées aux tensions raciales à venir, l’auteur estime que « l’immigration n’améliore pas, ne valorise pas la culture européenne; elle la supplante. L’Europe ne fait pas bon accueil à ses tout nouveaux habitants, elle leur cède la place (p. 47) ». Pourquoi ?
Les racines du mal
Avant de répondre, Christopher Caldwell rappelle que « l’immigration de masse a débuté dans la décennie postérieure à la Seconde Guerre mondiale. […] En Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Scandinavie, l’industrie et le gouvernement ont mis en place des politiques de recrutement de main-d’œuvre étrangère pour leurs économies en plein boom (p. 25) ». Par conséquent, « l’Europe devint une destination d’immigration, suite à un consensus de ses élites politiques et commerciales (p. 25) ». Il insiste sur le jeu du patronat qui préfère employer une main-d’œuvre étrangère plutôt que locale afin de faire baisser les salaires… Il y a longtemps que l’immigration constitue l’arme favorite du capital (1). Or « les effets sociaux, spirituels et politiques de l’immigration sont considérables et durables, alors que ses effets économiques sont faibles et transitoires (pp. 69 – 70) ».
Il importe d’abandonner l’image du pauvre hère qui délaisse les siens pour survivre chez les nantis du Nord… « Pour Enoch Powell comme pour Jean Raspail, l’immigration de masse vers l’Europe n’était pas l’affaire d’individus “ à la recherche d’une vie meilleure ”, selon la formule consacrée. C’était l’affaire de masses organisées exigeant une vie meilleure, désir gros de conséquences politiques radicalement différentes (p. 31, souligné par l’auteur). » Dans cette « grande transformation » en cours, en raison du nombre élevé de pratiquants parmi les nouveaux venus, l’islam devient une question européenne ou, plus exactement, le redevient comme au temps du péril ottoman et des actes de piraterie maritime en Méditerranée jusqu’en 1830… Dorénavant, « l’immigration jou[e] un rôle aussi perturbateur que le nationalisme (p. 402) ».
Très informé de l’actualité des deux côtes de l’Atlantique, Christopher Caldwell n’hésite pas à comparer la situation de l’Europe occidentale à celle des États-Unis. Ainsi, les remarques politiques ne manquent pas. L’auteur estime par exemple que, pour gagner les électeurs, Nicolas Sarközy s’inspire nettement des méthodes de Richard Nixon en 1968 et en 1972.
À la différence de Qui sommes-nous ? de Samuel P. Huntington qui s’inquiétait de l’émergence d’une éventuelle Mexamérique, Caldwell pense que les Latinos, souvent catholiques et occidentalisés, peuvent renforcer et améliorer le modèle social étatsunien. L’auteur remarque même, assez justement, que « les Américains croient que l’Amérique, c’est la culture européenne plus l’entropie (p. 447) ». En revanche, l’Europe est confrontée à une immigration pour l’essentiel musulmane. L’Europe ne serait-elle pas dans le même état si l’immigration extra-européenne était principalement non-musulmane ? L’auteur n’y répond pas, mais gageons que les effets seraient semblables. Le problème majeur de l’Europe n’est pas son islamisation qui n’est qu’une conséquence, mais l’immigration de masse. Il serait temps que les Européens comprennent qu’ils deviennent la colonie de leurs anciennes colonies…
L’injonction morale multiculturaliste
Si cette prise de conscience tarde, c’est parce que « le multiculturalisme, qui demeure le principal outil de gestion de l’immigration de masse en Europe, impose le sacrifice des libertés que les autochtones européens tenaient naguère pour acquises (p. 38) ». L’imposture multiculturaliste (ou multiculturelle) – qui est en fait un monothéisme du marché et de la consommation – forme le soubassement fondamental de l’Union européenne et des « pays occidentaux [qui] sont censés être des démocraties (p. 435) ». Néanmoins, sans la moindre consultation électorale, sans aucun débat public véritable, « sans que personne ne l’ait vraiment décidé, l’Europe occidentale s’est changée en société multi-ethnique (p. 25) ».
À la suite d’Alexandre Zinoviev, d’Éric Werner et d’autres dissidents de l’Ouest, Christopher Caldwell observe la démocratie régresser en Occident avec l’adoption fulgurante de lois liberticides contre les hétérodoxies contemporaines. En effet, « l’Europe de l’après-guerre s’est bâtie sur l’intolérance de l’intolérance – un état d’esprit vanté pour son anti-racisme et son antifascisme, ou brocardé par son aspect politiquement correct (p. 128) ». Après la lutte contre l’antisémitisme, l’idéologie multiculturaliste de la tolérance obligatoire s’élargit aux autres minorités raciales et sexuelles et renforce la répression. Il devient désormais tout aussi grave, voire plus, de dénigrer un Noir, un musulman, un homo ou de nier des faits historiques récents que de violer une fillette ou d’assassiner un retraité ! « Peu à peu, les autochtones européens sont […] devenus moins francs ou plus craintifs dans l’expression publique de leur opposition à l’immigration (p. 38). » Rôdent autour d’eux de véritables hyènes, les ligues de petite vertu subventionnées grassement par le racket organisé sur les contribuables. Et garde aux « contrevenants » ! Dernièrement, une Londonienne, Emma West, excédée par l’immigration et qui l’exprima haut et fort dans un compartiment de transport public, a été arrêtée, accusée de trouble à l’ordre public et mise en détention préventive. « Le journal Metro puis un journaliste de la chaîne américaine C.N.N. ont lancé un appel à la délation sur Twitter (2) ». La police des transports a même appelé à la délation sur Internet pour connaître l’identité de cette terrible « délinquante » ! Sans cesse soumis à une propagande « anti-raciste » incessante, « les Européens ont commencé à se sentir méprisables, petits, vilains et asexués (p. 151) ». Citant Jules Monnerot et Renaud Camus, Caldwell voit à son tour l’antiracisme comme « le communisme du XXIe siècle » et considère que « le multiculturalisme est presque devenu une xénophobie envers soi-même (p. 154) », de l’ethno-masochisme ! Regrettons cependant que l’auteur juge le Front national de Jean-Marie Le Pen comme un parti « fasciste », doctrine disparue depuis 1945…
La mésaventure d’Emma West n’est pas surprenante, car « l’État-nation multiculturel est caractérisé par un monopole sur l’ordre moral (p. 413) ». Les racines de ce nouveau moralisme, de ce néo-puritanisme abject, proviennent du traumatisme de la dernière guerre mondiale et de l’antienne du « Plus jamais ça ! ». « Ces dernières années, l’Holocauste a été la pierre angulaire de l’ordre moral européen (p. 356) ». Il était alors inévitable que « le repentir post-Holocauste devient le modèle de régulation des affaires de toute minorité pouvant exiger de façon plausible d’un grave motif de contrariété (p. 357) ». Être victime est tendance, sauf quand celle-ci est blanche.
Dans cette perspective utopique d’harmonie interraciale, il paraît certain qu’aux yeux des tenants du politiquement correct et du multiculturalisme, « l’Islam serait tout simplement la dernière catégorie, après le sexe, les préférences sexuelles, l’âge et ainsi de suite, venue s’ajouter au langage très convenu qu’ont inventé les Américains pour évoquer leur problème racial au temps du mouvement des droits civiques (pp. 234 – 235) ». Pour Christopher Caldwell, c’est une grossière erreur, lui qui définit l’islam comme une « hyper-identité ».
Le défi musulman
Le choc entre l’islam et l’Occident est indéniable : le premier joue de son dynamisme démographique, de son nombre et de sa vigueur spirituel alors que le second se complaît dans la marchandise la plus indécente et la théocratie absconse des droits de l’homme, de la femme, du travelo et de l’inter… Les frictions sont inévitables entre la conception traditionnelle phallocratique musulmane et l’égalitarisme occidental moderne. Allemands et Scandinaves sont horrifiés par les « crimes d’honneur » contre des filles turques et kurdes « dévergondées » par le Système occidental. Les pratiques coutumières de l’excision, du mariage arrangé et de la polygamie choquent les belles âmes occidentales qui exigent leur interdiction pénale. Mais le musulman immigré n’est-il pas lui même outré par l’exposition de la nudité féminine sur les panneaux publicitaires ou de l’homoconjugalité (terme plus souhaitable que « mariage homosexuel ») ?
Caldwell rappelle que le Néerlandais Pim Fortuyn combattait l’islam au nom des valeurs multiculturalistes parce qu’il trouvait la religion de Mahomet trop monoculturelle et donc totalitaire. Des mouvements populistes européens (English Defence League, Vlaams Belang, Parti du Peuple danois, Parti de la Liberté de Geert Wilders, etc.) commettent l’erreur stratégique majeur de se rallier au désordre multiculturel ambiant et d’adopter un discours conservateur moderne (défense de l’égalité homme – femme, des gays, etc.) afin d’être bien vus de la mafia médiatique. Par cet alignement à la doxa dominante, ils deviennent les supplétifs d’un système pourri qui reste l’ennemi prioritaire à abattre.
Pour l’auteur d’Une révolution sous nos yeux, l’islam est dorénavant la première religion pratiquée en Europe qui connaît l’immense désaffection des églises. L’homme étant aussi un être en quête de sacré, il est logique que la foi mahométane remplit un vide résultant de décennies de politique laïciste démente. Et ce ne seront pas les tentatives désespérées de Benoît XVI pour réévangéliser le Vieux Continent qui éviteront cette incrustation exogène parce que Caldwell démontre – sans le vouloir – le caractère profondément moderniste du titulaire putatif du siège romain : l’ancien cardinal Ratzinger est depuis longtemps un rallié à la Modernité !
Dans ce paysage européen de l’Ouest en jachère spirituelle, « les musulmans se distinguent par leur refus de se soumettre à ce désarmement spirituel. Ils se détachent comme la seule source de résistance au multiculturalisme dans la sphère publique. Si l’ordre multiculturel devait s’écrouler, l’Islam serait le seul système de valeur à patienter en coulisse (p. 423) ». Doit-on par conséquent se résigner que notre avenir d’Européen soit de finir en dhimmi d’un quelconque califat universel ou bien en bouffeur de pop corn dans l’Amérique-monde ?
Puisque Caldwell souligne que « l’immigration, c’est l’américanisation (p. 446) », que « l’égalité des femmes constitu[e] un principe ferme et non négociable des sociétés européennes modernes (p. 317) » et que « vous pouvez être un Européen officiel (juridique) même si vous n’êtes pas un “ vrai ” Européen (culturel) (p. 408) », il est temps que, hors de l’impasse néo-conservatrice, le rebelle européen au Diktat multiculturel occidental promeuve une Alter-Europe fondée sur l’Orthodoxie traditionnelle ragaillardie, un archéo-catholicisme antétridentin redécouvert et des paganismes réactivés, une volonté de puissance restaurée et des identités fortes réenracinées. « L’adaptation des minorités non-européennes dépendra de la perception qu’auront de l’Europe les autochtones et les nouveaux arrivants – civilisation florissante ou civilisation décadente ? (p. 45) » Ni l’une ni l’autre; c’est la civilisation européenne qu’il faut dans l’urgence refonder !
Georges Feltin-Tracol
Notes
1 : Pour preuve supplémentaire, lire la chronique délirante d’Ariel Wizman, « Pourquoi les immigrés sont les meilleurs alliés du libéralisme », dans L’Express, 7 décembre 2011.
2 : Louise Couvelaire, dans M (le magazine du Monde), 10 décembre 2011. Pour soutenir au moins moralement Emma West, on peut lui envoyer une carte postale à :
Mrs Emma West
co HMP Bronzfield
Woodthorpe Road
Ashford
Middlesex TW15 3J2
England
• Christopher Caldwell, Une révolution sous nos yeux. Comment l’islam va transformer la France et l’Europe, préface de Michèle Tribalat, Éditions du Toucan (25, rue du général Foy, F – 75008 Paris), coll. « Enquête & Histoire », 2011, 539 p., 23 €.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2342
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, christopher caldwell, europe, affaires européennes, immigration, islam |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 novembre 2011
Une révolution sous nos yeux
Une révolution sous nos yeux
Ex: http://aristidebis.blogspot.com/
Comme le rappelle Christopher Caldwell, la décision de recourir à une immigration extra-européenne massive se fondait essentiellement, à ses débuts, sur des considérations économiques. Les pays européens, ravagés et décimés par la seconde guerre mondiale, avaient un important déficit de main d’œuvre qui paraissait justifier le recours à des travailleurs étrangers. Des programmes furent donc mis en place, un peu partout en Europe, pour les attirer. L’immigration semblait alors une bonne affaire pour les pays d’accueil. En réalité ce calcul apparemment rationnel reposait sur deux hypothèses qui furent insuffisamment examinées. La première était que les besoins couverts par la main d’œuvre étrangère étaient des besoins durables, la seconde était que ces immigrants rentreraient chez eux une fois que ces besoins auraient cessé. A la fin des années 1960, la plupart des emplois industriels occupés par la main d’œuvre immigrée avaient disparu ou étaient en voie de disparition mais la main d’œuvre, elle, était toujours là. Non seulement les « travailleurs invités » (gastarbeiter) ne rentraient pas chez eux, mais leur simple présence sur le sol européen suscitait un flot continu de nouvelles arrivées : « Le premier facteur de l’immigration, c’est l’immigration. Il faut du courage pour se lancer le premier et pour se soumettre aux lois, aux coutumes et aux caprices d’une société qui ne se soucie pas de vous. Mais une fois que vos compatriotes ont établi une tête de pont, l’immigration devient simple et routinière. » (p31). Autrement dit, et sans en avoir bien conscience, en recourant à l’immigration les décideurs européens avaient choisis de résoudre des problèmes économiques transitoires par un changement démographique permanent (p35).
00:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : europe, affaires européennes, christopher caldwell, livre, immigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


