Sous un masque de « vieux boulevardier », Jean Anouilh ne cessa, en réalité, d’être un jeune insoumis, un « indécrottable » insurgé contre les idéologies modernes. Interprété, de son vivant, par les plus grands acteurs français et étrangers, il fut un des auteurs majeurs du XXe siècle. Le centenaire de sa naissance est célébré fort discrètement.
Le théâtre d’Anouilh, s’il traverse aujourd’hui, spécialement en France, un certain purgatoire tant sur scène que dans la critique, s’impose néanmoins comme l’un de plus représentatifs du XXe siècle. » Ainsi s’exprimait, en 2007, Bernard Beugnot dans son introduction aux Oeuvres complètes d’Anouilh, publiées dans la collection de la Pléiade à l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort. Trois ans plus tard, à l’occasion, cette fois, du centenaire de sa naissance, ce constat reste, hélas, vrai. Seuls quelques spectacles – dont une remarquable reprise (qui s’est achevée le 30 mai) de Colombe (1951), à la Comédie des Champs- Elysées, mise en scène par Michel Fagadau, avec Anny Duperey et sa fille Sara Giraudeau, retransmise en direct, le 15 mai, sur France 2 – et un hommage prononcé par Michel Galabru, aux molières, le 25 avril, sont venus raviver sa mémoire.
N’était son Antigone, succès de librairie et fortune des éditions de la Table Ronde grâce aux professeurs de français, qui s’attarderait encore aujourd’hui à faire découvrir Anouilh à nos jeunes étudiants ? Ce désormais classique du théâtre attend toujours au « purgatoire » des scènes françaises. Pourtant, de son vivant, Anouilh a été interprété par les plus grands acteurs français et étrangers : Jean-Louis Barrault, Bernard Blier, Michel Bouquet, Pierre Brasseur, Suzanne Flon, Paul Meurisse, les Pitoëff, Madeleine Renaud, Jean Vilar, Michel Simon, Jean-Pierre Marielle, Michel Galabru, Richard Burton ou Laurence Olivier. Faut-il y voir là, comme pour Montherlant, mutatis mutandis, l’effet d’une certaine critique lui ayant taillé un costume de vulgaire boulevardier ? Aurait-il également pâti des mutations du théâtre contemporain opposant le théâtre dit littéraire au théâtre des metteurs en scène ? Certainement. Alors qu’on joue encore Ionesco ou Beckett, Anouilh reste peu joué malgré une oeuvre imposante : une cinquantaine de pièces écrites en un demi-siècle.
Son « tort » aura peut-être été d’arriver trop tard ou trop tôt. Né quatre ans avant la Première Guerre mondiale (il vit le jour à Bordeaux le 23 juin 1910), parvenu au faîte de sa carrière dès l’âge de trente ans, il appartient à une génération occultée par l’avant-garde qui s’emparera des scènes de l’après-guerre. Homme de tradition plutôt que de rupture, Anouilh est entré au théâtre dans l’ombre des maîtres d’avant-guerre et par la petite porte.
Fils d’un tailleur et d’une pianiste d’orchestre d’Arcachon, les premiers spectacles auxquels assiste le jeune homme sont des opérettes du casino de la ville. « Je crois (c’est assez sot), expliquera- t-il plus tard, que c’est ce qui m’a donné envie de faire du théâtre. » A dix ans, il écrit déjà des pièces en vers dans le style d’Edmond Rostand, et avoue avoir eu sa « première impression d’auteur dramatique » à seize ans, lorsqu’il réussit à écrire une pièce aussi longue qu’une vraie, intitulée la Femme sur la cheminée. Provincial « monté à Paris », il fait la connaissance de Jean-Louis Barrault au lycée Chaptal. Après avoir assez vite abandonné ses études de droit et fait une courte carrière de rédacteur en publicité, c’est grâce à Louis Jouvet qu’il pénètre dans le monde du théâtre. Engagé à la Comédie des Champs-Elysées pour lire les manuscrits et composer les salles des générales, il découvre le milieu théâtral parisien. « De vivre tous les jours dans un théâtre a failli me dégoûter de faire du théâtre », écrira-t-il à Pierre Fresnay. En effet, Jouvet se montre très dur avec lui. Il profitera, cependant, de cette expérience pour affiner son goût et son écriture.
C’est à cette même époque qu’il découvre l’auteur qui va transformer sa conception de l’écriture dramatique : Jean Giraudoux. Avec lui, il comprend enfin qu’il existe une langue poétique au théâtre, une langue artificielle, certes, mais plus authentique, plus précise aussi qu’une simple conversation écrite. Héritier du baroque, Anouilh considère que le théâtre n’a pas, en effet, à « faire bêtement vrai », à tendre au « réalisme », voire à ce voyeurisme de « l’œil collé au trou de la serrure », mais, au contraire, à saisir l’essentiel à travers le factice et le faux (dans la forme) afin de mettre en valeur un « vrai éternel ». « Siegfried [de Giraudoux] m’a révélé que le style, les idées peuvent avoir leur place dans une œuvre scénique. J’entends par style : le mot juste mis à sa place. » Cela restera un des modèles et une des règles d’écriture de celui qui affirmait que « le spectacle, fête des yeux, doit être aussi fête de l’esprit ». Le jeune dramaturge se situera donc dans cette tradition théâtrale française, ce théâtre du texte dit « littéraire » où l’expression compte beaucoup. A l’instar de Molière, Marivaux ou, plus tard, Musset puis, bien sûr, Giraudoux, Anouilh affectionne « la phrase courte, serrée, musclée […], la phrase construite, la phrase française complète, avec le mot, l’adjectif et le verbe ». Ce n’est pas pour rien que, selon ses dires, il aurait aimé vivre au XVIIIe siècle, le grand siècle de la conversation. Pour autant, il n’ignore pas les auteurs modernes, tels Pirandello ou, plus récents encore, Ionesco, Beckett, ou encore Adamov, partageant avec eux certaines préoccupations métaphysiques.
De fait, ses premières œuvres apparaissent marquées par l’existentialisme et une vision très pessimiste de la nature humaine. Ainsi en va-t-il, notamment, de l’Hermine, sa première œuvre sérieuse écrite alors qu’il travaillait encore chez Jouvet, et qui inaugure le cycle des « Pièces noires ». Séduit, Pierre Fresnay la montera au théâtre de l’œuvre en 1932. C’est un premier succès d’estime (37 représentations) mais, surtout, la révélation d’un nouvel auteur dramatique. Conquis par le romantisme encore juvénile qui se dégage de l’œuvre, Robert Brasillach parlera à son sujet de « mythe du baptême ». Déjà, en effet, cette pièce qui met en scène la soif de pureté absolue habitant les deux personnages – Frantz, un jeune homme pauvre tombé amoureux de Monime, une belle aristocrate –, donne le ton d’une œuvre qui sera marquée par une quête quasi mystique et impossible de l’absolu. Une quête notamment incarnée par des personnages féminins animés d’une grande force morale en même temps que d’une touchante fragilité : Thérèse dans la Sauvage (1938), Nathalie dans Ardèle ou la Marguerite (1948), Jeanne dans l’Alouette (1953) et, bien sûr, Eurydice et Antigone dans les pièces éponymes (1942 et 1944). 
Mais le vrai premier succès de Jean Anouilh viendra quelques années plus tard, en 1937, avec le Voyageur sans bagage, une pièce mise en scène par Georges Pitoëff, qui le confirme comme un auteur dramatique à part entière. Inspirée de Siegfried, de Giraudoux, cette œuvre constitue un tournant dans la carrière d’Anouilh, qui prend alors conscience « d’avoir franchi une frontière, celle du réalisme ». Dans cette histoire d’un homme devenu amnésique qui refuse le poids de son passé et de sa famille, il réaffirme une thématique qui deviendra récurrente dans son théâtre.
L’année suivant cette réussite inattendue – près de 200 représentations ! –, le jeune auteur fait la connaissance d’André Barsacq, qui deviendra pendant une décennie son metteur en scène attitré. Leur collaboration commence avec le Rendez-Vous de Senlis, « pièce rose » mais teintée de noir qui représente une sorte de double inversé du Voyageur sans bagage. Cette fois, c’est Georges, le personnage principal, qui se construit un passé de rêve en engageant des comédiens afin de conquérir la belle Isabelle. Monté en 1941, c’est encore un succès critique et public qui consacre l’auteur comme un des meilleurs dramaturges contemporains.
C’est alors, en pleine Occupation, que lui vient le projet d’écrire une adaptation moderne de l’Antigone de Sophocle. La première de cette nouvelle Antigone aura lieu au théâtre de l’Atelier, en février 1944. C’est immédiatement un succès dû, en partie sans doute, au fait que la pièce a été – et reste encore – analysée en fonction du contexte politico-social du moment. Elle suscite des réactions contradictoires, mais l’ambiguïté du texte laisse toute liberté d’interprétation : Créon incarne-t-il Vichy et Antigone la Résistance ? Peut-être. Mais Breton ira jusqu’à écrire qu’elle était l’œuvre… d’un Waffen SS ! Longtemps – jusqu’à aujourd’hui ? –, certains feront peser sur Anouilh le soupçon de « collaboration » pour avoir fait représenter cette pièce à cette époque, mais aussi pour avoir livré des textes (uniquement littéraires) à Je suis partout et pour avoir signé, à la Libération, la pétition en faveur de la grâce de Brasillach. Les mêmes oublieront, évidemment, que, aux pires moments des persécutions antisémites, Anouilh cacha chez lui la femme d’André Barsacq, juive d’origine russe, et qu’il donna des nouvelles à la revue antinazie Marianne. Et les mêmes, en revanche, ne s’offusqueraient pas que, ayant fait représenter les Mouches, en 1943, puis Huis clos, en mai 1944, qu’ayant donné plusieurs articles à la revue Comoedia, contrôlée par la Propaganda-Staffel, Jean-Paul Sartre se fût métamorphosé en « héros » de la Résistance, allant jusqu’à siéger au Comité d’épuration des écrivains. Ces procès d’intention, l’exécution de Brasillach et, plus largement, les horreurs de l’Epuration venant après les horreurs de l’Occupation, laisseront en Anouilh des traces indélébiles et une amertume qui allait rehausser d’ironie une écriture déjà très noire. « J’ouvre les yeux, je vois partout la lâcheté, la délation, les règlements de comptes. Je suis d’un coup devenu vieux en 1944, voyant la France ignoble », confessera-t-il trente ans plus tard. De ce temps-là, les allusions sarcastiques aux représailles de 1944-1945 deviendront fréquentes, depuis Ornifle (1955) jusqu’à Tu étais si gentil quand tu étais petit (1972).
Avec Ardèle ou la Marguerite (1948), Anouilh inaugure la série des pièces dites « grinçantes », celles où éclateront avec le plus de brio ses réparties incorrectes, et qui culmineront avec Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes. Lors de sa création, en 1956, cette satire des tribunaux révolutionnaires de 1793 visant, en réalité, les cours de justice de l’Epuration, scandalise la critique, mais triomphe auprès du public : la pièce sera représentée un an et demi à guichets fermés. La comparaison qu’il dresse entre la Libération et la Terreur allait contribuer à asseoir la – mauvaise – réputation d’Anouilh, et faire de lui un véritable empêcheur de penser en rond sur scène.
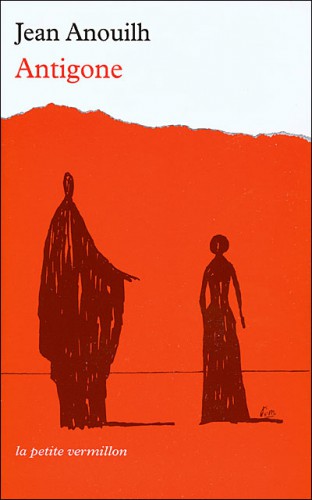 Deux ans plus tard, en 1959, il inaugure la série des « Nouvelles Pièces grinçantes » avec l’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux, dont le titre constitue en soi une forme de provocation. Cycle qui devait se clore en 1970, avec les Poissons rouges ou Mon père ce héros, réquisitoire sévère et d’apparence cocasse contre une certaine forme de société, faisant allusion à Mai-68, mais aussi à la grande rupture de 1940- 45. Entre-temps, dans ses « Pièces costumées », il aura abordé des sujets historiques qui prouvent une belle maîtrise en la matière : l’Alouette (1953) – sur Jeanne d’Arc –, Becket ou l’Honneur de Dieu (1959) – sur le meurtre, en 1170, de l’archevêque de Cantorbéry –, la Foire d’empoigne (1962) – sur les Cent-Jours. Comédie-ballet, de moeurs ou d’intrigue, farce, drame, comédie ou tragédie, jusqu’à sa mort, en 1987, Anouilh aura touché à tous les genres de théâtre, ce qui ne facilitera pas la tâche des taxinomistes en chaire. S’il revendiquait pour lui-même le qualificatif de « vieux boulevardier indécrottable », c’était en pensant à la tradition italienne de la commedia dell’arte issue des atellanes latines dans le sillage de Molière, son maître. Mais, sous le masque du « vieux boulevardier », Anouilh révèle également une figure de jeune insoumis. Sensibilité inquiète et libertaire, révolté de l’intérieur à l’image de ses personnages féminins, Anouilh prône une insurrection des âmes contre la médiocrité, la banalité et la duplicité. Une insurrection tout aristocratique qui prend pour cible les lieux communs du progressisme sous toutes ses formes (égalitarisme, démocratisme, relativisme, etc.) et le range définitivement du côté des réactionnaires invétérés.
Deux ans plus tard, en 1959, il inaugure la série des « Nouvelles Pièces grinçantes » avec l’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux, dont le titre constitue en soi une forme de provocation. Cycle qui devait se clore en 1970, avec les Poissons rouges ou Mon père ce héros, réquisitoire sévère et d’apparence cocasse contre une certaine forme de société, faisant allusion à Mai-68, mais aussi à la grande rupture de 1940- 45. Entre-temps, dans ses « Pièces costumées », il aura abordé des sujets historiques qui prouvent une belle maîtrise en la matière : l’Alouette (1953) – sur Jeanne d’Arc –, Becket ou l’Honneur de Dieu (1959) – sur le meurtre, en 1170, de l’archevêque de Cantorbéry –, la Foire d’empoigne (1962) – sur les Cent-Jours. Comédie-ballet, de moeurs ou d’intrigue, farce, drame, comédie ou tragédie, jusqu’à sa mort, en 1987, Anouilh aura touché à tous les genres de théâtre, ce qui ne facilitera pas la tâche des taxinomistes en chaire. S’il revendiquait pour lui-même le qualificatif de « vieux boulevardier indécrottable », c’était en pensant à la tradition italienne de la commedia dell’arte issue des atellanes latines dans le sillage de Molière, son maître. Mais, sous le masque du « vieux boulevardier », Anouilh révèle également une figure de jeune insoumis. Sensibilité inquiète et libertaire, révolté de l’intérieur à l’image de ses personnages féminins, Anouilh prône une insurrection des âmes contre la médiocrité, la banalité et la duplicité. Une insurrection tout aristocratique qui prend pour cible les lieux communs du progressisme sous toutes ses formes (égalitarisme, démocratisme, relativisme, etc.) et le range définitivement du côté des réactionnaires invétérés.
Pourtant, comme l’a noté Laurent Dandrieu dans l’hebdomadaire Valeurs actuelles (« Anouilh ou la pureté impossible »), « sa description sans aménité du carcan de la famille et sa haine des valeurs bourgeoises auraient dû lui valoir des circonstances atténuantes » de la part de ses coreligionnaires de gauche. Mais non. Loin de l’avant-garde d’aprèsguerre, hors des modes et à l’écart des idéologies modernes, Anouilh reste un auteur singulier dans le théâtre français du XXe siècle, préservé des avanies du temps et des commentateurs. Son œuvre en conserve d’autant plus de fraîcheur et de profondeur, malgré certains aspects délicieusement désuets, et, à la relecture, aujourd’hui comme Jean Dutourd hier, on peut encore s’exclamer : « Que c’est délicieux et inattendu, un auteur qui défend la noblesse de caractère, l’insouciance, la légèreté, l’esprit contre la bassesse d’âme et la cuistrerie ! »



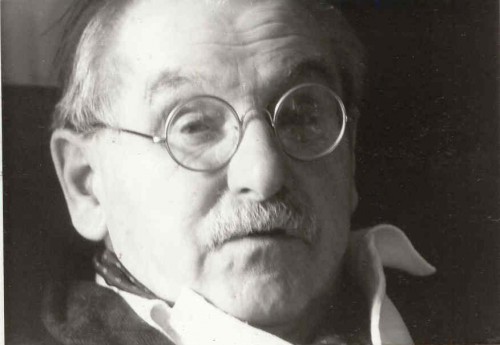

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg