
Parution du numéro 492 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Jean Bastier
Céline vu par Marc Fumaroli
Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève
Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du numéro 492 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Jean Bastier
Céline vu par Marc Fumaroli
Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève
Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)
C’est sans doute une infirmité de ma part ; les livres de Philippe Sollers m’ont toujours laissé indifférent, exception faite de Femmes (1983), qui doit d’ailleurs beaucoup à Céline, et La Guerre du goût (1994), recueil de ses meilleures critiques. En raison de son art d’esquiver les questions embarrassantes, celui que Pierre Assouline nommait (devant lui) “le roi des pirouettes” a pourtant de fervents admirateurs, notamment dans la nouvelle génération. En témoigne l’essai enthousiaste de Yannick Gomez qui analyse les liens entre son œuvre et la musique, domaine qu’il maîtrise ô combien. Mais le chapitre qui intéressera davantage ceux qui me lisent, c’est évidemment celui intitulé “Céline – Sollers”. Une anecdote à ce sujet : on sait que celui-ci s’est toujours targué d’avoir été l’un des grands artisans de la réhabilitation littéraire de l’auteur de Nord. Il l’écrit d’ailleurs noir sur blanc dans ses Mémoires.

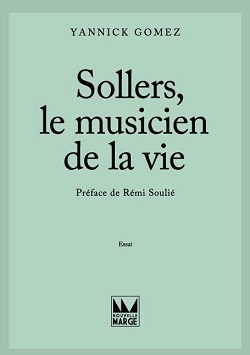
Avec malice, Jérôme Dupuis releva qu’après avoir écrit en 1963 un bref article sur Céline dans les Cahiers de l’Herne, il fallut attendre… 1991 pour lire un nouveau texte de lui sur le sujet¹. Et de préciser que la grande période de traversée du désert, ce furent les années 60, 70 et 80, où Sollers jugeait plus urgent de célébrer Lacan, Mao ou Casanova. Dans le BC, je me gardai de réfuter ces propos, factuellement exacts, mais précisai que, chaque fois qu’il en eut l’occasion, Sollers défendit Céline dans les médias. Ce fut notamment le cas en 1976 dans une émission télévisée à lui consacrée². Mon papier se concluait ainsi : « Céline reconnaîtra les siens ! » Manifestement touché par cette défense, Sollers m’envoya la dernière livraison de sa revue L’Infini avec un mot courtois. Il a tous les défauts du monde, relevait un critique, sauf ceux des esclaves qui obéissent aux ordres des prescripteurs. Et c’est vrai qu’il m’est toujours apparu comme un homme libre, allant jusqu’à faire sien le précepte baudelairien revendiquant le droit de se contredire.

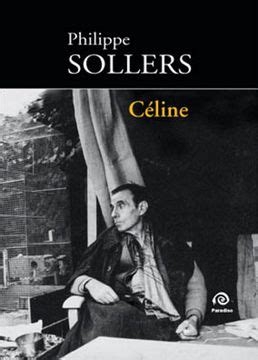
Un admirateur de Céline est assurément mal placé pour reprocher à Sollers d’avoir succombé aux sirènes de la politique totalitaire. Passé du communisme au maoïsme, il ne renia jamais vraiment son passé gauchiste et demeurait nostalgique de la comédie débridée du printemps 68 dont la France ne se remit jamais, comme en atteste l’état de son école et de son université. Dans son fameux article La France moisie ³, Sollers raillait un ministre de l’Intérieur (de gauche) qui avait eu l’audace de fustiger ceux qu’il appelait, doux euphémisme, les “sauvageons”. Et il prenait bien entendu la défense du “héros” libertaire de mai 68 qui termina sa carrière parlementaire en se faisant l’apologiste du capitalisme et de l’économie de marché. Mais, comme le disait Céline (citant la sœur de Marat), ces volte-face sont là turpitudes humaines qu’un peu de sable efface. Ce qu’on retiendra de Sollers, c’est sa vaste érudition à la fois musicale et littéraire ainsi que ce goût de la conversation qui le fait davantage appartenir au XVIIIe siècle qu’à notre période déclinante dont il déplorait à juste titre l’inculture et la frivolité.
• Yannick GOMEZ : Sollers, le musicien de la vie (préface de Rémi Soulié), Éditions Nouvelle Marge, 2025, 141 p. (18 €). Voir aussi Hommages à Philippe Sollers, Gallimard, 2023, 142 p. (12 €)
Notes:
15:22 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, philippe sollers, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
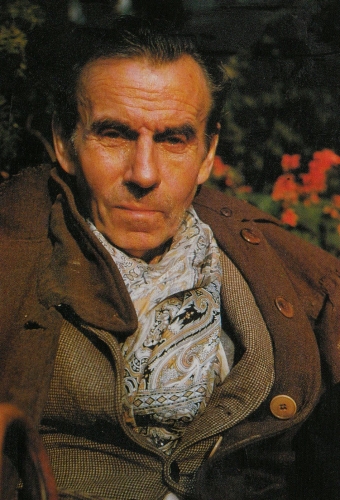
Parution du n°491 du Bulletin célinien
 Sommaire:
Sommaire:
Céline’s London. Le mystère de La Belle Sauvage
Céline au programme du baccalauréat ? Histoire d’un mythe
Dans la bibliothèque de Céline : Ibsen, L’Impérialisme germaniste dans l’œuvre de Renan, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche
Londres de Céline et Londres (Albert). La prostitution et la honte.
N’en déplaise à certain célinien acrimonieux¹, le BC poursuit son bonhomme de chemin et s’achemine vers le 500e numéro. Et ce en dépit de l’âpre anticélinisme qui prospère d’année en année. Tout est fait pour donner de Céline l’image la plus univoque possible. C’est ce qui a encore été fait récemment en adaptant à l’écran le podcast (à charge) , “Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour”, diffusé l’année passée sur France Inter. « J’ai été tellement recouvert de toutes les ordures et les merdes que cent mille tonnes de parfums d’Arabie ne me feraient pas encore sentir bon ! » écrivait-il en exil.
Que dirait-il aujourd’hui ?… Rendant compte de ce documentaire, la presse emboîte le pas, dénonçant “un homme monstrueux habité par une noirceur inouïe”. Quant à l’objectif de cette initiative, il n’est guère dissimulé par certains : extirper Céline du “panthéon des lettres françaises” et pour cela “déboulonner” la statue. Certes, on peut critiquer l’homme. Céline souhaitait la victoire de l’Axe et, pendant l’Occupation, n’a pas mis une sourdine à son antisémitisme obsessionnel.
Mais pourquoi énoncer des contrevérités dans ce qu’il faut bien appeler un réquisitoire ? Les plus flagrantes ont trait aux deux guerres mondiales : Destouches embusqué à Londres car réformé en 1915 par piston² (ceci pour la première) et Céline nazi intégral appelant de ses vœux le génocide (pour la seconde). Une volonté à peine dissimulée de réduire son rayonnement littéraire est ici à l’œuvre.
Dans un courriel adressé à un téléspectateur qui s’était plaint de ce parti-pris, la personne en charge de la médiation des programmes de France Télévisons a répondu que « s’intéresser à un sujet nécessite de choisir un angle ». Et d’ajouter cette précision chafouine : « Retenir certains aspects d’un sujet ne signifie pas occulter tous les autres dans l’absolu, potentiellement abordés lors de prochains programmes sur le thème, abordé sous un angle différent »³. Le hic, c’est que lorsqu’il est question de Céline, c’est toujours le même angle.
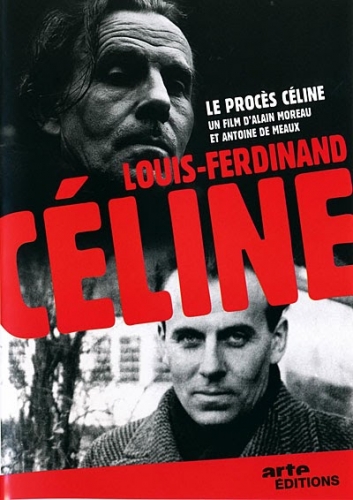
Pour rappel : Antoine de Meaux (“Le procès Céline”, Arte, 2011), Jean-Baptiste Pérétié (“Voyage au bout de Céline”, France 5, 2011), Christine Lecerf (“Louis-Ferdinand Céline au fond de la nuit”, France Culture, 2019), Élise Le Bivic (“Céline : les derniers secrets”, France 5, 2021), pour ne citer que les plus récentes émissions. Toutes font le procès de Céline et méconnaissent ce qui fait la grandeur de l’écrivain. C’est un choix délibéré. Et cela s’aperçoit jusque dans les détails. Ainsi, évoquant la réception critique de Voyage au bout de la nuit, il est précisé que la presse fut partagée. Non pas en raison du langage et du style novateurs de ce premier roman mais parce qu’« on ne sait pas encore où situer politiquement Céline » (!) Il suffit d’analyser le dossier de presse pour se rendre compte que la ligne de partage ne se situe pas sur ce plan. On se plaît à rêver d’une émission où serait mis en relief ce qui fait l’originalité et la valeur de l’œuvre. Un angle pour une fois différent…
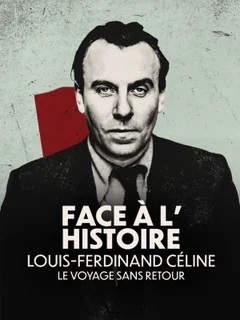
• Philippe COLLIN et Florence PLATARETS : « Face à l’histoire. Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour », Production Agat Films. Diffusé le 14 décembre 2025 sur France 5.
16:41 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
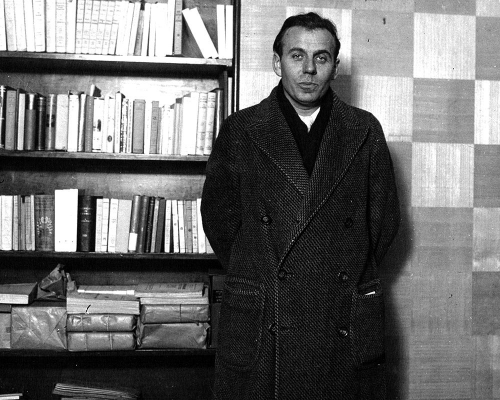
Parution du numéro 490 du Bulletin célinien
Sommaire :
 Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)
Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)
Une fausse citation d’Erasme chez Céline
Dans la bibliothèque de Céline : Hamlet
James Salter lecteur de Waugh et de Céline.
Céline fut un “collaborateur” pour le moins atypique. Henri Godard a indiqué qu’il s’est tenu à l’écart de toute collaboration officielle. C’est le moins que l’on puisse dire. Pendant l’Occupation, cet électron libre n’a pas arrêté de morigéner les uns et les autres (politiques et journalistes) estimant qu’ils n’étaient pas à la hauteur de la situation. Histoire de doper les ventes, les historiens ne rechignent pas à le mettre en couverture de leur livre. Ce fut le cas d’un spécialiste de l’Épuration en France¹ ; c’est aujourd’hui celui d’un jeune historien qui publie sa thèse de doctorat sur les écrivains collaborateurs. Il y analyse ce que sont devenus les deux cents (!) écrivains frappés à la Libération. Et de s’interroger sur la postérité littéraire d’écrivains mineurs mais aussi de Rebatet, Morand, Maurras,… et Céline auquel il consacre tout un chapitre.
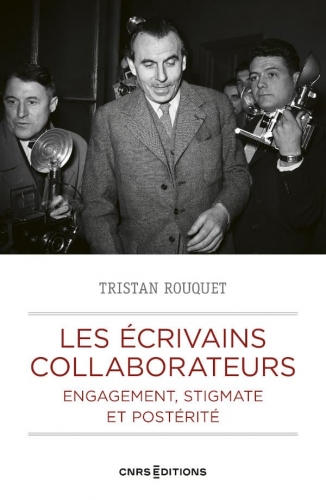
D’entrée de jeu, il passe en revue les éléments de nature, on le conçoit aisément, à exaspérer ceux qui honorent la mémoire des intrépides ayant combattu l’envahisseur. C’est le cas de l’auteur, attaché scientifique à un musée de la Résistance. Quels sont ces éléments qui datent tous du début de ce siècle ? Dans l’ordre : l’inscription (suivi du retrait) de Céline au recueil des Célébrations nationales du ministère de la Culture (2011) ; l’entrée de Drieu la Rochelle dans la “Bibliothèque de la Pléiade” (2012) ; l’édition de la correspondance de Morand et Chardonne (2013) ; la réédition des Décombres de Rebatet (2015) ; l’initiative (avortée) de la réédition des pamphlets par Gallimard (2018) ; la présence de Maurras et Chardonne dans Le Livre des Commémorations nationales (2018) ; la réapparition de manuscrits inédits (2021) suivie de leur publication avec succès. Cela fait beaucoup. Et montre que, pour ce qui le concerne, Céline est tout sauf un écrivain maudit².

L’auteur affirme pourtant que celui-ci est auréolé de ce statut par ses biographes. Et, selon lui, Céline, seul, sut convertir sa déchéance en littérature. Là où il serait magistral, c’est que, devenu un “auteur canonique” (Voyage au bout de la nuit fut inscrit au programme de l’agrégation des lettres modernes en 1993 et en 2003), il n’en devient pas pour autant un écrivain figé. L’intérêt suscité est entretenu par sa légende sulfureuse qu’il a contribué à bâtir par ses romans d’après-guerre dans lesquels il raconte son exil ignominieux aux yeux de ceux qui n’accepteront jamais de le lire. Céline renverse en outre le stigmate en imposant l’image qu’il a de lui-même, évitant dans ses romans d’expliquer son engagement en faveur de l’Axe. C’est la conclusion de l’auteur, un tantinet jargonnante: «Il s’agit d’élaborer et de diffuser une narration qui s’empare de la marque infamante pour la réajuster à une illusion biographique acceptable. Cependant, si le renversement du stigmate est unanimement reconnu, alors la provocation qu’il porte disparaît. Afin d’éviter cette routinisation du charisme, tout l’enjeu revient alors à entretenir la tension entre la canonisation et l’impiété.» Pari réussi pour Céline au grand dam de ses contempteurs qui auraient préféré que son œuvre ne lui survive pas.
• Tristan ROUQUET, Les écrivains collaborateurs (Engagement, stigmate et postérité), CNRS Éditions, coll. “Nationalisme et guerres mondiales”, 2025, 448 p. (26 €)
18:39 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, louis-ferdinand céline, collaboration, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Julien Gracq et la tentation élitiste
Claude Bourrinet
Contrairement à André Breton ou à Sartre, Gracq s'est toujours bien gardé d'être entouré, a fortiori de prendre la tête d'un mouvement, ou de s'intégrer à l'une de ces « avant-gardes », ou à l'un de ces courants littéraires, qui ont caractérisé le XXe siècle, surtout français, du moins jusqu'à ce que ces rivières – ou ces ruisseaux – se perdent dans les sables du marais stérile de la fin du millénaire. Il a semblé se retrancher dans une tour solitaire, idée qui ne lui aurait du reste pas répugné. "Je peux me plaire (ô combien!), dit-il, dans un pays vide. Non dans un pays peuplé de figurants." Ces comédiens, qui servent de décor, pullulent dans le milieu intellectuel, où les effets valent plus que le fond, où les combinaisons remplacent la voie étroite, ou règne la formule hugolienne ; « Ad augusta per angusta ». Il l'affronte d'ailleurs ouvertement au début des années 50, mais se retire rapidement. Jeu de mains (à plume), jeu de vilains. Ses années seront ponctuées, dorénavant, entre deux années scolaires, par le retour studieux et estival dans la maison familiale, à Saint-Florent, et, imperturbablement, chaque mois de septembre, par une expédition en Deux-chevaux sur les « Grands chemins », souvent de France.

L'explication de cette tentation semi-érémétique était, aux yeux des professionnels du livre et de ses consommateurs, une affaire d'orgueil, ou de tactique. Peut-être les deux. Comme on répliqua, selon Sainte-Beuve, à quelqu'un qui annonçait le vœu de Chateaubriand de se retirer dans un ermitage: «M. de Chateaubriand veut une cellule, mais c'est une cellule sur un théâtre», on voyait dans le snobisme de Gracq une posture, dont le silence pouvait faire du bruit et intéresser ses ventes. Cette accusation eut cours surtout au moment de son refus du prix Goncourt. Mais au fond, on lui en voulut toujours de ne pas être de la maison.
Certes, sa promotion à l'Ecole Normale Supérieure avait été l'aboutissement royal d'un cursus qui était celui de l'élite «des enfances bourgeoises, et même petites-bourgeoises», solution de continuité sociale et culturelle, qui fut, jusque dans les années soixante, moment où l'Ecole de masse tendit à s'imposer, une situation «normale» et acceptée. En Hypokhâgne, durant l'année 1928, au lycée Henri IV, il porte monocle et cravate blanche. Rue d'Ulm, ils étaient «vingt-huit à trente pour la section Lettres, et nous nous connaissions exactement». Les meilleurs élèves de France, le gratin. «Une – ou deux – ou trois figures de proue que distinguaient la singularité de l'esprit, le brio intellectuel parfois presque inquiétant, l'évidence des aptitudes extra-universitaires. […] Une demi-douzaine d'hommes spéciaux, comme on aurait dit au temps de Robespierre, qui avaient repéré et choisi de bonne heure leur créneau, étroit et peu fréquenté, et qui, larguant tout autre souci, marchaient déjà d'un pas assuré vers une direction des Hautes Etudes ou une chaire au Collège de France. Un ou deux égarés, étrangers au moule universitaire, qui semblaient être entrés là par distraction: souvent les plus amusants de tous. […]. Le reste destiné à peupler, sans nouveauté, les khâgnes et les universités de province. Mais aucune bille n'avait encore été capturée par sa case ; les jeux roulaient toujours ; le champ des possibles, pour les carrières, débordait de beaucoup celui des probabilités – pour quatre ans encore chacun portait dans sa giberne le bâton de maréchal de Jaurès ou de Péguy, de Bergson ou de Giraudoux, et guettait du coin de l'oeil, dans l'oeil du camarade, l'étincelle naissante de hautes aptitudes ou de la haute ambition. »
Passons sur l'idée fugace, qu'il se vît tenir rang dans la dernière brigade. Somme toute, son métier de professeur de géographie et d'histoire n'était qu'un gagne-pain, fort agréable, et pourvoyeur de temps libre appréciable. L'enseignement n'était pas, pour lui, une vocation, même si ses élèves le jugèrent comme excellent pédagogue.

Durant toute sa vie d'écrivain, il regretta son isolement, dans un monde littéraire de plus en plus agité par les sollicitations médiatiques. Au début du mois de février 2000, Le Monde titrait, à son sujet, une de ses déclarations désabusée, qu'on jugea provocatrice: «En littérature, je n'ai plus de confrères». On vit, dans cette déclaration, de la superbe. Le dernier à avoir été du niveau exigeant où il tentait de se tenir avait été André Breton (photo). Après 1966, il n'y a plus rien. Or, un écrivain veut toujours savoir ce que ses écrits valent. Il y a les lecteurs, certes: il rassembla des amoureux – peu nombreux en regard des admirateurs de l'émission de Bernard Pivot, Apostrophes - de son œuvre, et qui n'étaient pas loin de se considérer comme des initiés. Mais le véritable jugement ne peut venir que d'un égal. Non dans un sens hiérarchique, déplacé à ce propos, mais qui ait la même vision de l'écriture, qui appartienne au même monde que lui.
 En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »
En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »
 Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.
Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.
La référence au Graal n'est pas loin. Gracq conte qu'à 18 ans, il cessa, sans drame, de se rendre à la messe. Ce qui ne signifie pas qu'il n'ait gardé, au plus profond de lui, un sens mystique tendu. Il rappelle les sensations tenaces de son enfance, qui allaient dans cette direction: «J'ai été élevé dans le catholicisme, dans un pays qui est très croyant, Saint-Florent, et une chose me frappait: une colline, avec, au sommet une église abbatiale, une abbaye très importante, une espèce de bulle sacramentelle. Plus que le sacré, me frappait et me séduisait la confrérie des gardiens du sacré. Cela apparaît avec les chevaliers.»
Cette tonalité religieuse, mystique, rejaillit aussi quand, dans son essai sur Breton, il interprète le surgissement et le destin du surréalisme. Là aussi transparaît la tentation élitiste. Et bien qu'il n'acceptât jamais de se couler dans le groupe surréaliste, il reprend à son compte, en 1948, la destinée manifeste d'un cercle semi-clandestin, de « vrais fidèles » d'un medium, Breton, « traversé » par les esprits de Sade, de Nerval, de Baudelaire,de Rimbaud, de Lautréamont, de Nouveau, de Jarry, de Vaché, de Rigaut, de Desnos, de Dali, «phénomène de transsubstantation» étonnant, qui l'investit d'un pouvoir charismatique. Il est traversé littéralement par le meilleur de leur esprit, il est le conducteur élu du fluide. «Aucune opération intellectuelle précise n’élucide ce contact miraculeux.» On a l'impression d'être «report[é]" à l’époque où l’«Esprit» visitait familièrement les hommes et à travers eux prophétisait en liberté».


Gracq s'est beaucoup inspiré de son ami Monnerot, condisciple à l'Ecole Normale, sociologue du socialisme et ayant médité sur les rapports entre la poésie et le sacré, notamment dans les cercles surréalistes. Il ne s'agit pas de trop porter attention, aux «germes de socialisation» qui ponctuent la trajectoire du cercle, que Monnerot appelle le «set», groupé autour de Breton entre les deux guerres, «café qu’on hante, habitude des réunions périodiques, promenades en commun, fréquentation de lieux «électifs», jeux d’esprit pratiqués, rites sommaires». Autre chose était la «puissance d’éveil» que le surréalisme recelait, «l’attente galvanisante d’une espèce d’an mil qui littéralement jetait les esprits en avant d’eux-mêmes, les exorbitait», «l’«esprit» qui aiguillonnait le groupe[...] avec la vigueur hallucinatoire d’une terre promise».
Monnerot parle d'«aristocratie du miracle» «ordonné autour d’une «révélation générale» et par là ne se différenciant pas par essence de telle ou telle communauté d’ «élus» à ses débuts».
Le groupe suggère « l’idée d’un ordre clos et séparé, d’un compagnonnage exclusif, d’un phalanstère que tendent à enclore on ne sait trop quelles murailles magiques (l’idée significative de « château » rôde aux alentours) qui paraît s’imposer dès le début à Breton », « beaucoup plus proche, par ses contours surtout exclusifs, de la Table ronde ou de la chevalerie en quête du Graal que de la communauté chrétienne initiale ». On a là une « appartenance, qui nous renvoie à la source même du sentiment religieux et qu’on ne peut se refuser plus longtemps – que cela plaise ou non – à qualifier de mystique ». On sait que cette « mystique » s'est nourrie en partie de doctrines satanistes, sadienne, par provocation, dans un désir de blasphémer, de profaner un christianisme abhorré. Mais une mystique tout de même, qui ne demandait, selon Gracq, qu'à être retournée positivement.
 Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».
Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».
Bien qu'en situation d'échec en 1948 (et comme le faisait remarquer Breton, entre le surréalisme d'avant-guerre et ce qu'il en reste à la Libération, il y a Buchenwald et la Bombe), Gracq voit dans l'émergence de petits groupes, de happy few portés par une flamme mystique authentique, se traduisant par ce qu'il appelle le Grand Oui (au monde), à l'opposé du projet existentialiste qui mise sur le collectif, et songe à subvertir le réel par la volonté sociale et politique, une alternative à la sclérose civilisationnelle de l'Occident – selon un schéma que lui a légué Oswald Spengler. Ces fraternités chevaleresques, il ne les trouvera jamais.
18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, surréalisme, élitisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
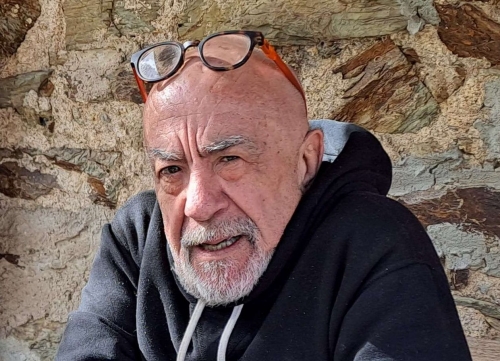
Hommage à Didier Carette
par Luc-Olivier d'Algange
Grande tristesse d'apprendre la mort de Didier Carette. Avec lui s'en vont encore la liberté, la générosité et l'audace, - autant de rares vertus qui feront que les médias n'en parleront guère. Directeur du théâtre Sorano à Toulouse qu'il revivifia durant une décennie, il en fut éloigné pour des raisons « politiques ».

Que dire, sinon citer l'une des Feuilles orphiques ou pythagoriciennes qu'il aimait, et citer ses œuvres, dont la diversité et l'amplitude dépassèrent, de très loin et de très haut, tous les engagements partisans. Sa devise, populaire et aristocratique: «faire du théâtre non pour tous, mais pour chacun».
"Ceci est consacré à Mnémosyne,
Quand tu seras sur le point de mourir, tu t'en iras vers les demeures bien construites d'Hadès.
A droite, il y a une source près de laquelle se tient un cyprès blanc.
C'est là que les âmes des morts descendent et qu'elles s'y rafraîchissent.
De cette source surtout ne t'approche pas car tu en trouveras une autre, en face, d'où s'écoule l' eau fraîche qui vient du lac de Mnémosyne.
Au-dessus d'elle se trouvent les gardiens, ils te demanderont du plus profond de leur coeur,""ce que tu fais, et où tu vas, cherchant, dans les ténèbres du sombre Hadès.
Dis : je suis fils de Terre et de Ciel étoilé, mais je suis desséché par la soif et je meurs.
Donnez-moi vite l'eau fraîche qui s'écoule du lac de Mnémosyne.
Alors par le vouloir du roi des enfers, ils te traiteront avec bienveillance et te laisseront boire à la source de Mémoire.
Alors tu chemineras sur la voie sacrée, parmi les autres Mystes, dans la gloire de Dionysos."

En rappel de ses oeuvres:
Metteur en scène :
2010
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…
2009
Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…
2008
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…
Le Frigo de Copi mise en scène Didier Carette
2007
Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams mise en scène Didier Carette
Banquet mise en scène Didier Carette
2006
Rimbaud l'enragé – Une saison en enfer mise en scène Didier Carette
Le Bourgeois gentilhomme de Molière mise en scène Didier Carette…
2005
Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette
Homme pour homme de Bertolt Brecht mise en scène Didier Carette…
2003
Folies Courteline de Georges Courteline mise en scène Didier Carette
Peer Gynt de Henrik Ibsen mise en scène Didier Carette

2002
Satyricon de Pétrone mise en scène Didier Carette
La Nonna de Roberto Cossa mise en scène Didier Carette
1999
Karamazov d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette
Nuit blanche d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette
1998
Le Cas Woyzeck d'après Georg Büchner mise en scène Didier Carette
1997
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette
1989
Les Grandes Journées du père Duchesne de Jean-Pierre Faye mise en scène Didier Carette
1987
La Mère la joie... de Marie de Sévigné mise en scène Didier Carette
1986
Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…
Il n'y a plus d'aventuriers d'après André Malraux mise en scène Didier Carette
1983
Pntgrl-Rabelais de François Rabelais mise en scène Didier Carette
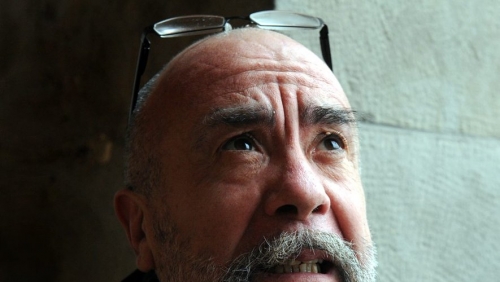
Comédien :
2010
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…
2009
Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…
2008
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…
1997
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette
1994
Le Voyage à Bâle de Pierre Laville mise en scène Simone Amouyal
1992
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Jacques Rosner
1986
Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…
1982
Le Labyrinthe d’Armand Gatti mise en scène Armand Gatti
1980
Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…
1968
Le Chien du général de Heinar Kipphardt mise en scène Maurice Sarrazin…
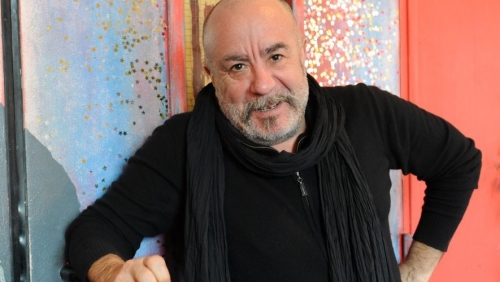
Auteur :
2005
Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette
2003
Armada de Didier Carette
1994
Le Torero de salon d'après Camilo José Cela… mise en scène Henri Bornstein
1992
Armada de Didier Carette mise en scène Simone Amouyal
Traducteur:
2008
La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…
Scénographe:
1997
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette
Collaborateur artistique:
2013
Nana d'après Émile Zola mise en scène Céline Cohen…
1980
Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…
Voir aussi: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2018/12/05/d...
18:28 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : didier carette, hommage, théâtre, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Je n’ai vraiment compris Dominique de Roux — cet esprit décapant, aristocratique dans son goût de déplaire — qu’en lisant Pasolini. L’un est devenu le miroir de l’autre. Ils ont vécu deux vies brèves, à la même époque, dans un même refus instinctif des appartenances bourgeoises. Je n’ose imaginer ce que leur rencontre aurait pu créer. Sans doute un explosif plus puissant que la bombe à hydrogène.
Par Frédéric Andreu
Dominique de Roux et Pier Paolo Pasolini partagent une posture rare : celle des dissidents de l’intérieur. Ils semblent appartenir à un camp — De Roux au paysage littéraire français, Pasolini à la gauche italienne — tout en le contredisant radicalement de l’intérieur. De Roux l’affirme sans détour : « Je n’ai jamais appartenu à aucun camp. » Il cultive ce qu’il nomme « une liberté contre la meute », une intransigeance qui le pousse à attaquer le cléricalisme, les orthodoxies morales et le confort intellectuel de son époque.
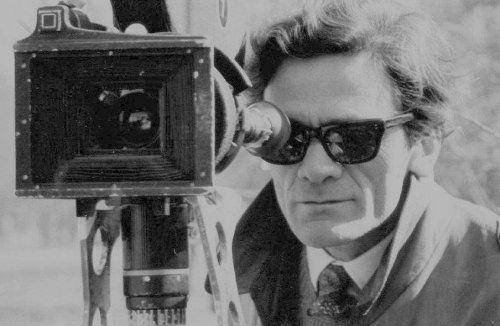
Pasolini, lui, est un hérétique déclaré au sein de la gauche italienne. Il écrit dans les Écrits corsaires :« La gauche m’a toujours considéré comme un hérétique. » Hérétique, il l’est en effet : farouchement contre l’avortement, qu’il voit comme une capitulation devant la logique utilitariste ; contre le théâtre de Mai 68, qu’il accuse d’être une gesticulation bourgeoise plus qu’une révolution ; contre la consommation, qu’il juge « obscène », un acte « grossier » qui uniformise les consciences et détruit toute authenticité populaire. Il ira jusqu’à dire que la société de consommation est « plus fasciste que le fascisme ».
Son amour va à la tradition, à l’homme cosmique, humilié par la machine, effacé par le consumérisme.
« TOUT mon amour va à la tradition
Je viens des ruines, des églises,
des retables d’autel, des villages oubliés des Apennins et des Préalpes
où ont vécu mes frères ». (Poésie en forme de rose, 1964)
Ce dissident politique est aussi un dissident esthétique : son cinéma est un anti-Hollywood radical. Pasolini refuse les corps lisses, les récits consolants, les couleurs de studio. Il filme à contre-jour de l’Occident cinématographique : théâtre filmé, visages non-professionnels, dialectes, rites archaïques, ascèse de la lumière. À l’usine à rêves, il oppose une fabrique du réel — une vérité nue, biblique, parfois cruelle, mais jamais trompeuse.

Chez De Roux comme chez Pasolini, la dissidence s’accompagne d’un burlesque féroce. De Roux n’hésite pas à tourner en dérision certaines figures religieuses — le cardinal Daniélou « la calotte sur le tête », l’abbé Bruckberger notamment — avec une ironie d’une précision chirurgicale. Il critique les masques, les formes.
Pasolini, à son tour, met en scène dans Uccellacci e uccellini un corbeau marxiste, pédant et bavard, caricature hilarante de l’intellectuel de gauche. Il disait de ce personnage : « Le corbeau parle comme un intellectuel, mais il reste un oiseau : il critique tout, mais ne change rien. » (L’image même du politicien macronoïde parvenu aujourd’hui au pouvoir).
Ce burlesque n’est pas un divertissement : c’est une arme critique. Le rire démasque plus sûrement qu’un discours doctrinal.
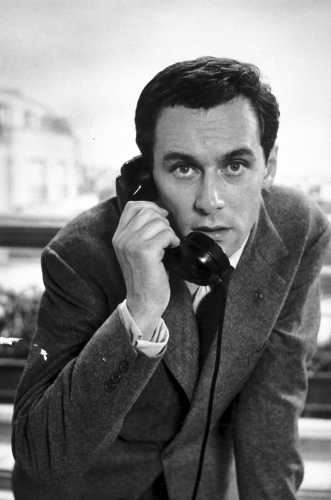
Dans la vie, pourtant, une rencontre a eu lieu : celle de Dominique de Roux avec Maurice Ronet, acteur intense, silencieux, qui partageait avec lui une même mélancolie active et une même exigence artistique. Leur dialogue, bien réel, laisse entrevoir ce que De Roux pouvait susciter chez des artistes à la sensibilité aiguë, et ce qu’il était capable de reconnaître chez eux.
Et c’est là que naît une forme de nostalgie imaginaire : il est profondément regrettable que De Roux n’ait jamais rencontré Pasolini. Tout laissait pourtant croire que leurs routes, parallèles, auraient pu un jour se croiser : mêmes années, mêmes combats, même détestation des conformismes. L’un apportant son feu littéraire, l’autre son feu cinématographique. Leur face-à-face aurait sans doute été incandescent — trop incandescent peut-être pour une époque qui ne savait pas accueillir ce genre de fulgurance. En un sens, Gombrowich a été, pour de Roux, une sorte de Pasolini, mais sans la même radicalité.
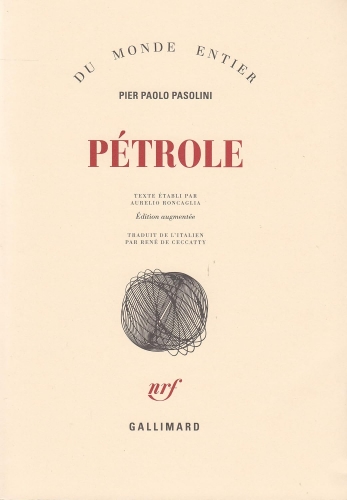
Les deux (h)auteurs quittent la scène, en nous laissant orphelins : De Roux est parti trop tôt, sans avoir tourner toutes les pages de la vie ; Pasolini, assassiné de la pire des manière, n’a pu achever son livre le plus incendiaire, Pétrole, resté comme une voix interrompue. (On n’a pas idée en France du vide laissé par cette disparition).
De Roux et Pasolini : deux dissidents, vraiment. Et, à leur manière, une paire parfaite, même sans s’être connus.
19:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, dominique de roux, lettres, littérature, lettres italiennes, lettres françaises, littérature italienne, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
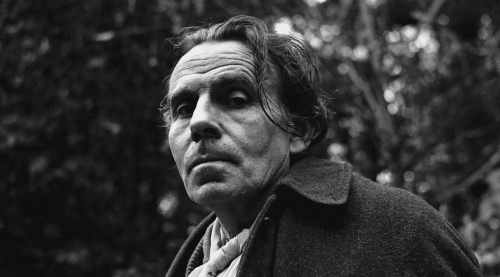
Parution du numéro 489 du Bulletin célinien
 Sommaire:
Sommaire:
Entretien avec Marie Vergneault-Gourdon
Emmanuel Carrère et Céline
Dans la bibliothèque de Céline: G (Galtier-Boissière, La Garçonne, La Gaule…)
Céline sur la Butte (1941)
Actualité célinienne
Point de vue : Céline l’inatteignable.
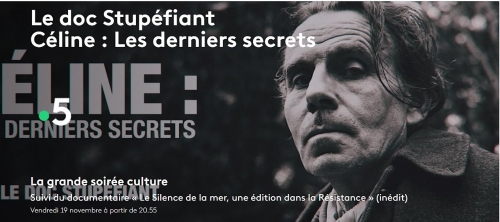
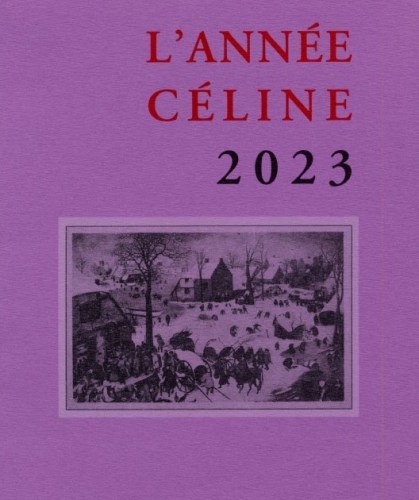
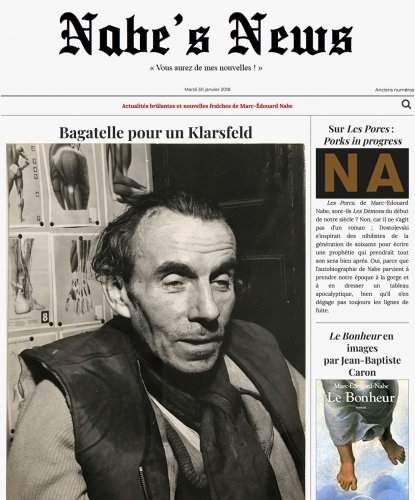
20:23 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, marc-édouard nabe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
Claude Bourrinet
Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.
Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
La révolution romantique
L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.
Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).
Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.
Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.
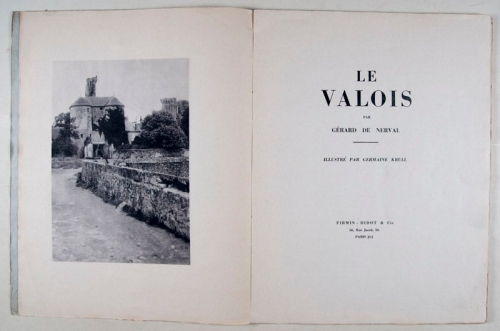
Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …
Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

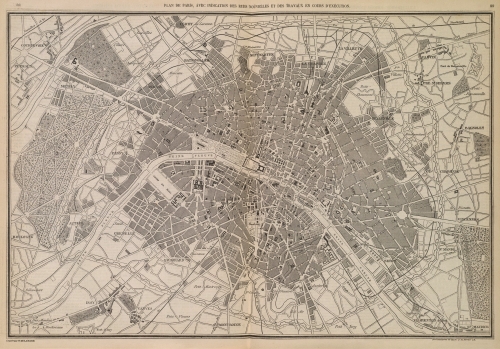

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.
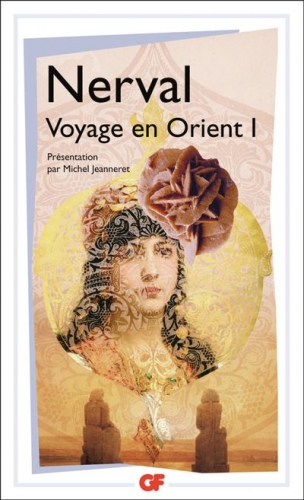
Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve
Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).
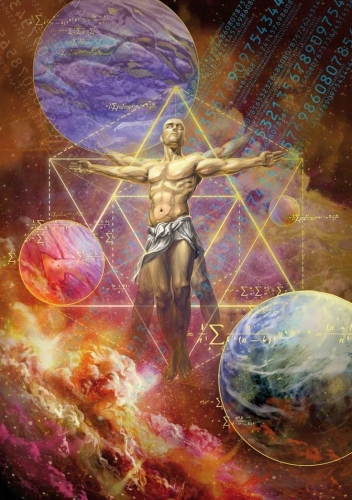
La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.
Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...
Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.
On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...
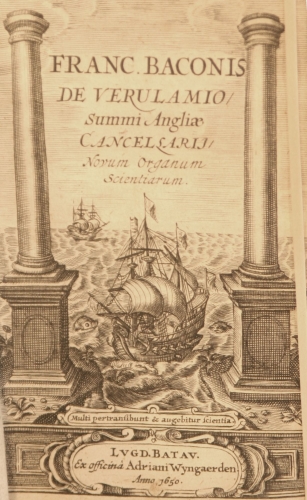
Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.
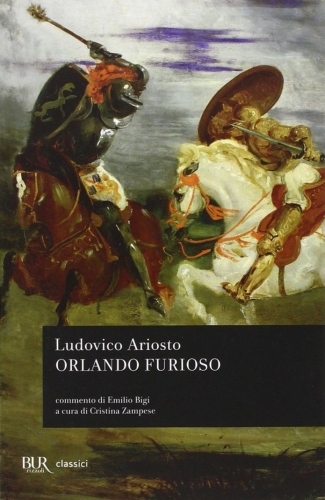
Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.
Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.
La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».
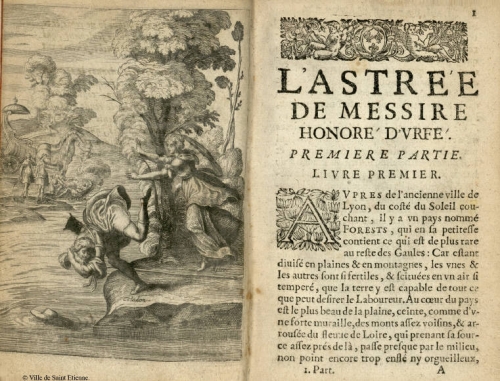
Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.
Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.
Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.
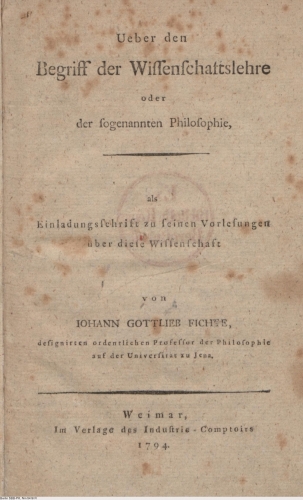
La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).
Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.
Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).
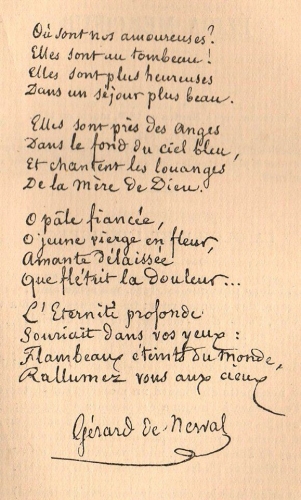
Nerval et l’écriture
Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.
Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.
La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.
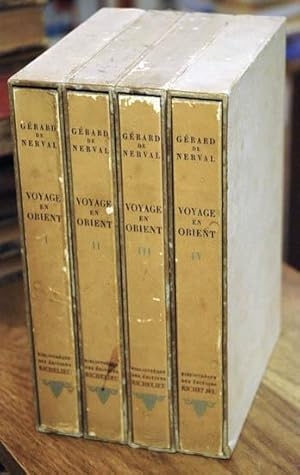
Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.
Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».
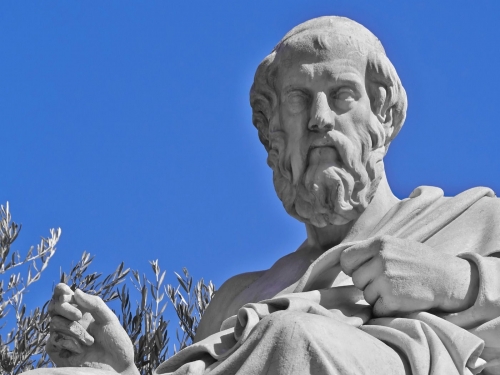
La quête intérieure
Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....
Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.
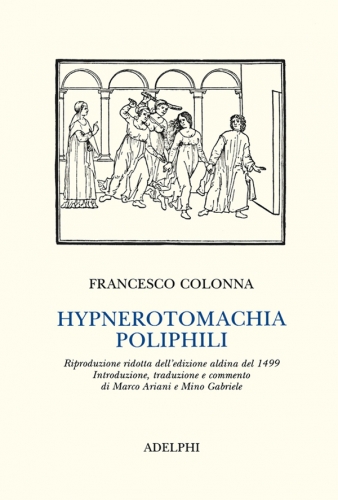
C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.
Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .
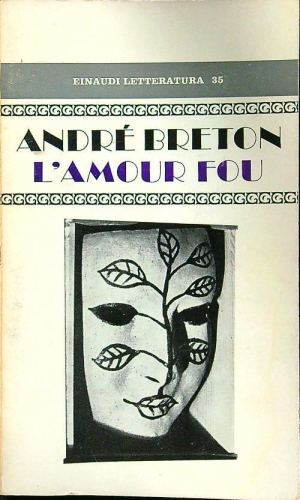
Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.
Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.
La « folie », une voie initiatique
Toutefois, l'œuvre de Nerval n'est pas, à la manière romantique, un épanchement, une confession lyrique, un abri pour le moi, mais le théâtre tragique de son élaboration, de son accomplissement, de son exaucement, dans l'angoisse et la joie. Le verbe est créateur de sens. Il réalise son sens, il est performatif, et c'est pourquoi il est dangereux. Il suit intimement, sans écart, les sinuosités du labyrinthe de la vie, et les éclairs de rêves. Il est lui-même lueur révélante, apocalyptique, illuminante, si l’on ose cette tautologie, et dédale où se dissimule le minotaure, ou bien grotte où s'ébattent les nymphes. Il est la clé qui force le sens, l'Absolu, l’Éternité, le Salut. Mais il est incomplet : il faut trouver la lettre qui manque ; chercher, toujours, sans fin, au-dessus de l'abîme.
Et l'on voit ce qui, soudain, change avec Nerval, et annonce un nouveau continent de la connaissance. Au lieu de se laisser happer par le monde des images, par les visions, de se perdre dans le gouffre de la folie, il tente de maîtriser cet « épanchement », avec une volonté remarquable et poignante, et non seulement d'en considérer les terribles merveilles comme un univers réel, au même titre que celui d'ici, de la terre lourde et laborieuse, mais d'en tirer toutes les leçons, d'en explorer les arcanes pour trouver la lumière. Rappelons l'émouvant et fameux aveu de Baudelaire, pourtant guère prolixe au sujet d'un poète si proche de lui dans le temps et dans l’inspiration, dans la tonalité, répondant au calembour injurieux de Veuillot, qui, dans L'Univers du 3 juin 1855, avait écrit que Nerval avait non pas spiritualisé, mais alcoolisé sa vie : « Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement ? — Et plus récemment encore, — il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, — quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, — si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, — délier son âme dans la rue la plus noire qu’il put trouver, — quelles dégoûtantes homélies !... »
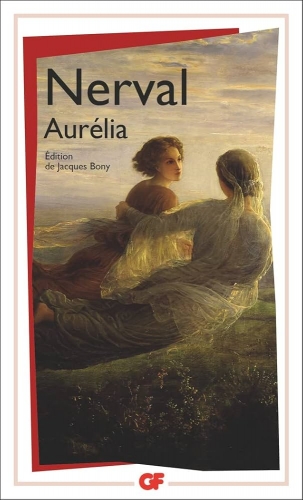
Nerval est peut-être l'être le plus pieux que le XIXe siècle eut sécrété. Dans Aurélia, il indique « les causes d'une certaine irrésolution [les principes de la Révolution, le rationalisme, le scepticisme voltairien] qui s'est souvent unie chez [lui] à l'esprit religieux le plus prononcé ». Il est passé à côté de son temps, et pourtant, il est l'âme d'un âge où la divinité a définitivement quitté la terre désormais désertifiée des hommes, comme l'est la Cythère de 1843, la Cérigo occupée par les Anglais, que surplombe, sur une colline desséchée battue par le clapotis de la Mer de Crète, cette Crète où Ariane dévide son fil, un pendu qui se voit de loin. Il clame dans le désert, en affrontant, dans son propre esprit, le nihilisme qui le ronge comme un monstre chimérique sorti du chaos.
L'expérience du rêve, liée à celle de la nostalgie des origines, transmute sa trajectoire en initiation, en « glissement vers le mythe », comme dit Albert Béguin. C'est retrouver l'aube de l'humanité, l'épanchement du rêve dans la vie réelle, et les déesses, les dieux rendus à la visibilité, à la vénération qui leur est due ; c'est l'expansion du moi, au-delà de la faute originelle, de la mort, de la souffrance, de la solitude, vers une dimension universelle qui concerne l'humanité entière et son destin. Se sauver est retrouver l'harmonie, lui redonner vie, peut-être même rappeler les dieux sur terre, et reconstituer l'Arcadie, l'âge d'or, une nouvelle Cythère, parée d'un amour printanier.

Non sans péril, celui de haute mer. Albert Béguin le rappelle : « Ceux qui se risquent à ces explorations intérieures en ramènent des œuvres singulières et durables, qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et périssable, mais son essence et sa figure mythique. Ils cherchent à rejoindre le plan profond où se déroule, non plus leur propre histoire terrestre, mais leur destinée éternelle. Comme le mystique, ils paient de l'anéantissement de leur personne la plongée dans la nuit. » Heidegger le dit de même : « La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut é-voque le sacré. Le sacré relie le divin. Le divin approche de Dieu. / Ceux qui risquent plus appréhendent, dans l’absence de salut, l’être sans abri. Ils apportent aux mortels la trace des dieux enfuis dans l’opacité de la nuit du monde. »
Nerval dit de lui-même, dans Promenades et Souvenirs : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. » En vérité, Wege – nicht Werke : « Des chemins, non des œuvres », comme écrivait Heidegger quelques jours avant sa mort. Nerval reprocha à Alexandre Dumas de ne produire que des articles de consommation, des objets de divertissement. Lui, expérimentait. Ses livres étaient des quêtes risquées, des jeux d’arène dangereux où danse la corne du taureau. Lorsqu’avec lui, on évoque la « littérature », il est capital de s’enlever de l’esprit l’acception courante, triviale, de ce mot.
Être tout « littéraire », c’est-à-dire rêve, est une autre façon d’affirmer sa folie. Dans une Lettre à Mme Dumas, il s’indigne: "...Mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique [ Nerval évoque la sempiternelle dénonciation de la littérature – vaine, inutile, nuisible – de la part des êtres positifs, ayant pieds sur terre, qui œuvrent pour le Bien commun, et mettent l’utilité pratique, celle des économistes et des banquiers, au-dessus de toute la beauté du monde – qui, le rappelle Gautier, ne sert à rien ], on ne m’a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à ma véracité. Avoue ! avoue ! me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le Dictionnaire médical. À l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un ! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »).
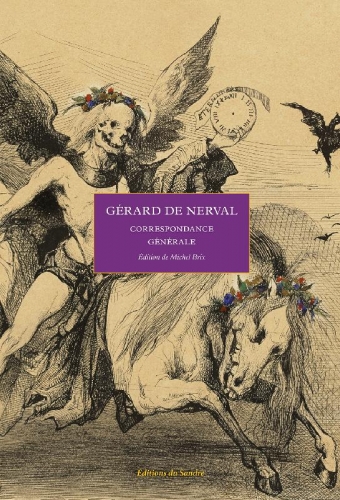
Nerval proteste contre la version clinique, et met l'accent sur la dimension "poétique" (existentielle, en vérité), sur la "voyance", à la suite des romantiques allemands comme Novalis. La "folie" (liée au rêve) est un autre nom pour désigner la création "poétique" (ces deux mots sont des pléonasmes), mais aussi le véritable royaume de la vie humaine, qui ne correspond pas au domaine restreint et restrictif de la conscience "diurne", trop mesquine et trompeuse. La vérité se trouve à l'intérieur de l'être humain, et le monde extérieur est le résultat de la projection de ce contenant trop inexploré. Évidemment, pour un scientifique comme le docteur Blanche (portant très ouvert, adepte de méthodes douces et intelligentes), c'est là une perception entachée de suspicion. Dans les faits, nous ne nous en apercevons pas, mais nous sommes des fous, nous vivons comme des fous. Certes, des fous qui se parent d'un costume "raisonnable", pour donner le change. A moins que nous ne soyons des rêveurs qui croient, parfois, ne pas rêver.
La littérature rend visible, lisible, réelle, cette « folie ». L’île de Calypso, l’antre du Cyclope, dans l’Odyssée, la Terre du Milieu, du Seigneur des anneaux, l’Enfer, de Dante, sont lestés de plus de réalité, de présence (parousia) que le décor urbain évanescent, exsangue et fantomatique de nos besoins erratiques, qui, de la maison au supermarché, de la voiture au bureau, ornent notre vacuité existentielle ; et Julien Sorel, Hamlet, Rastignac, le Grand Meaulnes, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Erec et Enide, Don Quichotte (ce proto-Nerval), Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, sans parler du pharmacien Homais, et même, dans les Évangiles, Pierre, Paul, ou Jean, existent davantage, que mon voisin, ou que le ministre de l’économie du moment, et me sont peut-être comme des étoiles à suivre, ou à ne pas suivre. Ils sont la réalité, en vérité. Peut-être la plus authentique, celle qui possède un sens. Ne dit-on pas que les femmes du peuple montraient Dante du doigt, considérant le teint cuivré de son visage comme le témoignage irréfutable de son séjour en Enfer ? Elles avaient la foi du charbonnier. Combien ont cru que Malraux avait participé à la guerre civile de 1927, à Shanghai, et qu’il avait même été l’un des chefs de l’insurrection ? Ernst Jünger, quant à lui, entre deux coups de feu, lisait avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. » Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année.
Les paysages mentaux et le théâtre de nos songes, tout « imaginaires » qu’ils soient, peuplent davantage, même le jour, la salle obscure de notre existence, que ce que l’on appelle la « réalité », mais qui ne se résout qu’à une cascade de données sans signification véritable. Et nous ne sommes essentiellement cette « folie » : grande ou petite.
Note:
(1) « Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d’employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d’un livre unique : la lecture suivie de ces pages est ce qu’on nomme la vie réelle ; mais quand le temps accoutumé de la lecture (le jour) est passé et qu’est venue l’heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l’ouvrant au hasard à tel ou tel endroit et tombant tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissions pas ; mais c’est toujours dans le même livre que nous lisons. »
[…]
« Si l’on se place, pour juger des choses, à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder aux poètes que la vie n’est qu’un long rêve. »
Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819 (mais la publication n'en a été faite, en France, qu'en 1886.
15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, poésie, 19ème siècle, romantisme, romantisme français |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
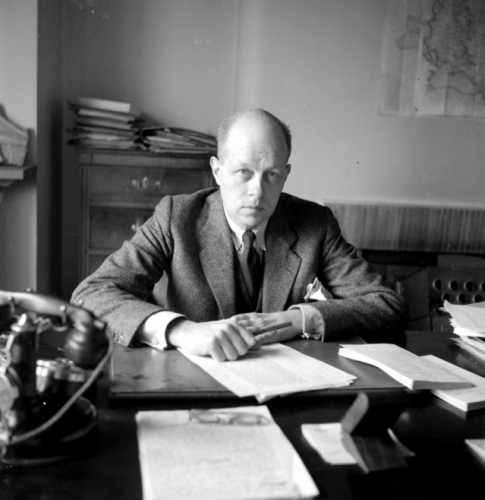
Drieu: Histoire d’une adolescence
par Andrea Scarabelli (2016)
Source: https://legio-victrix.blogspot.com/2025/11/andrea-scarabe...
Yukio Mishima écrit ses Confessions d’un masque entre vingt et trente ans. C’est en 1949. Bien qu’il ne l’admette pas, il s’agit d’une autobiographie, et c’est précisément pour cette raison qu’elle n’a pas manqué de susciter des polémiques, pour des motifs que nous laissons aux professionnels du scandale. Le livre parle des premières incursions dans la vie d’un adolescent qui vit en lui-même le déséquilibre de son temps. Car c’est là que résident la grandeur ou la misère d’une vie : soit elle parcourt les étapes d’une civilisation entière, incarnant ses fractures, exhibant ses lacérations, soit elle est tout simplement peu intéressante.
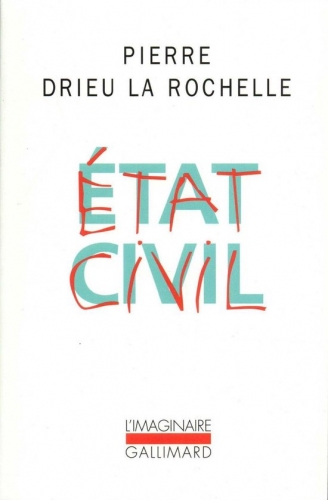 Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…
Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…
Nous sommes en 1921, comme on le disait. Le jeune Drieu n’avait publié que deux livres : Interrogation, en 1917 (récemment traduit en italien par La Finestra), et Fond de Cantine, trois ans plus tard. Ce sont deux recueils de poèmes. Il ne s’était pas encore lancé dans l’écriture des Chiens de paille, ni dénoncé les Comédies de Charleroi, ni mesuré sa France. Il n’était pas encore un « socialiste fasciste », ni n’avait tenté de marquer le siècle, et le lyrisme crépusculaire de ses magnifiques Journaux était encore bien loin, tout comme Gilles et Feu Follet. Avant de plonger dans ces œuvres qui feront de lui un auteur de sa génération, le jeune Drieu avait une petite affaire à régler: son adolescence.
À quel âge écrit-on une autobiographie ? On pourrait répondre : cela dépend de la vie que l’on a vécue. Mais aussi de combien, comme on l’a dit plus tôt, cette autobiographie reproduit le Zeitgeist, l’esprit du temps, devenant un diorama du siècle. Or, État Civil n’est pas seulement un récit d’années fugitives, des premières expériences à l’école, de la découverte d’un monde, des premières fautes et expiations… C’est la narration de la jeunesse d’un siècle qui se serait divisé en deux guerres mondiales, arrivant en retard à sa rencontre avec le destin. Un siècle éternellement en retard sur lui-même: d’où l’importance de livres comme celui-ci, avant-gardes d’une Europe qui aurait pu être, mais ne fut pas, et que le geste suicidaire de Drieu l’a empêché de voir. Un acte d’une extrême compassion, peut-être, commis par l’auteur envers lui-même.
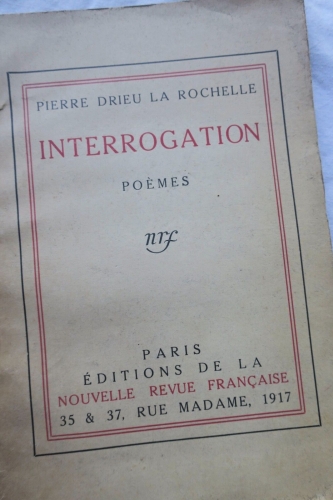
«Tout crépuscule est une aube», écrivait Ernst Jünger. Si Drieu évoque ses expériences juvéniles, ce n’est pas pour fermer la porte à l’enfance, mais pour en préserver intacte toute la fraîcheur. Il suffit de lire quelques pages d’État Civil, autobiographie en l’absence de biographie, pour comprendre: «Les enfants n’appartiennent pas à la même époque, à la même race, au même continent que les hommes. Ils vivent dans des Ères passées ou encore à venir… Armés de tous leurs sens, dotés d’une capacité extraordinaire d’intuition, ils parlent avec tout l’univers une langue mystique qu’ils oublient aussitôt, et habitent des terres vierges». Ils ressemblent aux sauvages: «Comme eux, ils se laissent domestiqués, et comme eux, ils meurent si leur liberté se perd».
 Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».
Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».
Il portera cette enfance avec lui dans les années à venir, dans ses rencontres et ses relations, dans les soirées de gala et les tempêtes d’acier, y infusant ses œuvres et ses articles pour ces revues qui lui coûteront l’excommunication par la culture officielle et l’accès au Panthéon de la Pléiade seulement en 2012, dans une édition d’ailleurs très expurgée et hygiénisée par ceux qui ne se lassent pas de réécrire notre passé. Mais cela n’enlève rien à la valeur de livres comme celui-ci. Le «maudit» Drieu nous connaissait très bien...
13:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre drieu la rochelle, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Deux textes sur Julien Gracq:
Gracq et le groupe des Hussards
Claude Bourrinet
Les Hussards ont l’air de revenir à la mode, actuellement. Je me suis demandé ce que Julien Gracq en avait pensé, et j’ai mené ma petite enquête.
Néanmoins, je dis tout de suite que Les Poney sauvages me sont tombés des mains: trop anglo-saxon, non seulement par le thème (je n’y suis pas opposé en principe, admirant maints auteurs britanniques, mais les membres des services secrets de sa Gracieuse majesté, non !), et, surtout, un style à l’américaine, efficace, qui roule des mécaniques, grande gueule et sentant le whisky, donnant l'impression qu'on va assister à un pugilat de saloon … très peu pour moi. A l’opposé (à propos du style), le style laborieux, qui s’entend écrire, qui veut faire du … style (puisque c’est la marque de la droite), présumé « aristocratique » (c’est-à-dire supposé égotiste, au-dessus du vulgum pecus de la littérature vernaculaire, bien qu’on vise quand même à vendre abondamment), ostensiblement « réactionnaire » (id est attaché aux « valeurs » si galvaudées actuellement, comme du parfum Dior de contrefaçon), en somme l’écriture (si on ose dire) d’un Tillinac, m’irrite à tel point, que ça me donne envie de lire du Marc Lévy.
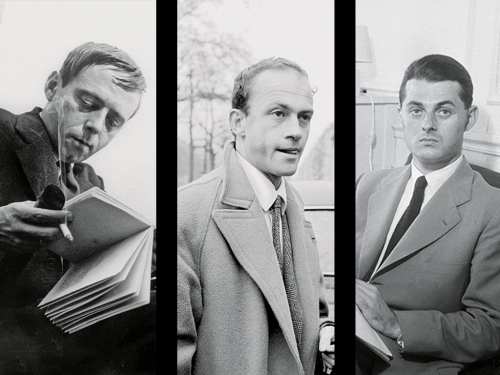
Toujours est-il que le contraire du mensonge n’est pas toujours la vérité. Je veux dire par là qu’en se hérissant contre l’engagement politique inquisitorial, et désastreux pour la littérature, des ivrognes de gauche, on risque de verser dans la même ornière, en état d’ébriété, mais du côté droit du chemin des certitudes. Ils sont socialo-communistes ? qu’à cela ne tienne ! on sera de droite, de droite dure, et même traînant des souvenirs glauques, de quoi faire pâlir le vendeur de rue de l’Humanité !
C’est bien, ce que leur reprochait le discret et apolitique Gracq : outre qu’il a toujours méprisé les « écoles littéraires » (et les Hussards en sont une), il voyait en eux une bande de jeunes tapageurs (c’était le temps des blousons noirs, des yéyés, de la génération « jeune » en train de naître, et tout cela avait une senteur chewing-gumée d’Amérique, nation roulant à 100 à l’heure, au point d’exporter ses accidents tragiques de bagnole, cette μηχανή moderne à apothéoses pour journaux à sensations), et qui épataient le bourgeois conformiste, comme les sartriens existentialistes l’avaient fait à Saint-Germain-des-Prés. Et cette pétarade langagière se voyait dans la forme. Il disait : « Ils écrivent comme on conduit une décapotable : vite, pour le vent. Moi, j’écris comme on marche dans une forêt la nuit : lentement, pour entendre. » Ces hussards galopent beaucoup, mais on ne sait trop où.
Là, Gracq touche un point essentiel. Ecrire n’est pas jongler. On peut bien aimer le champagne, mais allez trouver du sens aux noces éclaboussantes de lumière ! Certes, ce qui est digne d’intérêt, dans ces orgies crâneuses, ce sont les petits matins blêmes, où l’on traîne sa mélancolie. Il est bon, parfois, de s’inspirer de Nerval. Il est vrai que les Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent, Michel Déon (qui s'acheva en devenant Immortel, en 1979) etc. se réclamaient de Stendhal, lequel s’imposait la gaieté, par devoir beyliste, mais qui passa son existence à se ronger les sangs.
Du reste, et je vais faire une digression: on confond, dans certains milieux, égotisme et égoïsme. Rien n’est plus erroné. L’égoïste prend, l’égotisme donne. L’égoïste se réjouit de son individualisme, l’égotiste est sociable, et même plein de compassion pour le faible, le prisonnier, la victime (il n’est qu’à lire, pour s’en rendre compte, Le Rouge et le Noir, Lucien Leuwen – où le héros éponyme, qui est pourtant officier, est pris de pitié pour les ouvriers, que l’armée s’apprête à charcuter, ou bien La Chartreuse de Parme). L’égoïste est rapace, cherche à accumuler, l’égotiste se dépouille des passions superfétatoires (presque toutes les passions, du reste), pour s’en tenir à l’essentiel : la beauté et l’amour, parfois la pensée. L’égotiste éprouve même un penchant à l’ascétisme, au jansénisme (on trouve cette tentation chez Stendhal, et surtout chez Baudelaire le "dandy", dont le perfectionnisme vestimentaire n'était pas une ostentation de cabotin, mais le SIGNE d'une moralité supérieure). L’égoïste se moque du malheur des autres, pourvu qu’il ait sa pâture, l’égotiste ne se sacrifiera pas a priori pour le bien de l’humanité (imitant ainsi le sage que nous présente La Fontaine dans la dernière fable de son recueil), mais, bien qu’il sache que les happy few ne sont, par définition, pas nombreux, il pensera que son bonheur est susceptible de s’accroître du bonheur d’autrui. L’égoïste ne croit, lui, en rien, il est cynique, et se réjouit d’être supérieur, ce que ne fera jamais l’égotiste, qui fuit le mauvais goût.

L'égotisme se manifeste par ce que Stendhal appelle la chasse au bonheur. Pour Stendhal, c'était l'amour, pour Gracq, c'est l'osmose avec la terre, avec le monde, le "Grand oui". Evidemment, dans les deux cas, il ne saurait être question que de singularité, de recherche individuelle, et de retrait, voire de discrétion. L'égotisme, comme le radical le suppose, concerne le moi. Mais un moi qui n'est pas égoïste, même s'il n'a de compte à régler avec personne. Son apparente hauteur n'est qu'une humilité qui se connaît, et le degré suprême de la modestie.
Pour en revenir à Gracq, sa clarification : « Moi, j’écris comme on marche dans une forêt la nuit : lentement, pour entendre » laisse entendre bien plus que ce qui ne concerne que la forme et le style. Pour lui, l’écriture est une recherche à tâtons dans l’opacité d’un monde parcouru d’énigmes, un méthodique décryptage, comme lorsqu’on lit une carte, des arcanes de la nature, de la vie, de l’existant ; d’où une phrase complexe, emmêlée, distordue, qui procède de surprises en trouvailles, de sensations fines en intuitions subtiles. Tout le contraire des Hussards, dont il appréciait tout de même Blondin et Nimier, tout en leur reprochant, à l’un, d’être trop « alcoolique », et à l’autre, de trop faire claquer la phrase.
* * *

Gracq, Les Eaux étroites et le Sortilège
«Pourquoi le sentiment s'est-il ancré en moi de bonne heure que, si le voyage seul – le voyage sans idée de retour – ouvre pour nous les portes et peut changer vraiment notre vie, un sortilège plus caché, qui s'apparente au maniement de la baguette du sourcier, se lie à la promenade entre toutes préférée, à l'excursion sans aventure et sans imprévu qui nous ramène en quelques heures à notre point d'attache, à la clôture de la maison familière?».
Ces quelques lignes, qu'il faudrait lire et relire, apprendre par cœur comme le verset de la Bible de l'existence, initient ce merveilleux petit récit que Gracq publia en 1976: Les eaux étroites.
Il s'agit avant tout de porter une attention sérieuse à l'épithète « étroite ». Nous ne sommes plus ici à la Pointe du Raz où Gracq, en compagnie de Henri Queffélec (surpris par le regard lointain de son ami), reçut comme un coup de fouet au cœur le sentiment saisissant de la gravité massive du Continent eurasiatique, et l'aspiration « sans idée de retour » du grand large, qui le propulsait vers un infini d'aventure et de joie, ouvrant ainsi « les portes » de l'amor fati (et de la littérature). Il ne s'agit pas non plus que cette osmose qui procède de l'immobilité consécutive à un abandon sur la Terre enchanté, extase mystique (ce sont ses mots) qu'il éprouva dans les Flandres, durant la guerre, en 1940, ou en 1925, quand il était collégien au lycée Clemenceau, à Nantes, et qu'il se « récréait », avec ses camarades, comme chaque semaine, dans la prairie de Mauves : «... une après-midi, allongé dans l'herbe haute et regardant couler la Loire au ras des prés, j'eus tout à coup l'esprit ensoleillé par une bizarre illumination quiétiste: le sentiment, au moins approximatif, qu'il était parfaitement indifférent, et en même temps parfaitement suffisant et délectable, de me tenir ici ou d'être ailleurs, qu'une circulation instantanée s'établissait entre tous les lieux et tous les moments, et que l'étendue et le temps n'étaient, l'un et l'autre, qu'un mode universel de confluence. Si je compare à un ensoleillement cette sensation de passivité à la fois enivrée et comblée, c'est qu'elle se montra relativement durable, et ne disparut, en s'affaiblissant peu à peu, qu'au bout de deux ou trois heures. »

Assurément, si la première expérience s'apparente à une tension nietzschéenne, dont Gracq, comme le vates de Sils-Maria (1881, révélation de l'Eternel Retour), pressentait l'épuisement (« Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer ! - Ainsi parlait Zarathoustra), celle de la « promenade » sur un « bachot centenaire – bancal, délabré, vermoulu, cloqué de goudron, et parfois dépourvu de gouvernail – sur l'Èvre (photo), « petit affluent inconnu de la Loire » « enclôt dans le paysage de mes années lointaines », qui n'avait « ni source ni embouchure qu'on pût visiter », jure avec l'errance sans limite qu'offre le vaste Océan, dont Baudelaire disait qu'il était une analogie de Dieu (d'un Dieu que Gracq évacue de sa Weltanschauung). Car cette « balade » tranquille est loin de prendre cette teinte tragique qu'induit la pensée de Nietsche. On penserait plutôt à Heidegger commentant Hölderlin, pour qui le voyage du poète à Bordeaux n'avait de sens que dans le retour, « plein d'usage et raison », au pays natal (Heimat), qui n'a certes pas un sens patriotique, mais qui relève de la quête de l'être (terme trop abstrait, au demeurant, dont se méfiait Gracq), de cette « clairière » qui, pour l'auteur des Carnets de grand chemin, s'attache à l'imaginaire, aux souvenirs, aux glissements littéraires de la poésie occidentale, aux sensations, aux rêveries... qui sont autant de retour à soi. Jamais Gracq, alors, ne fut plus près du Nerval de Sylvie, dont Proust a dit qu'il inaugurait une autre manière de voir le monde.
Gracq était géographe de formation et de profession, et, tout comme l'oeil de Jünger avait été formé par la pratique quasi constante de l'entomologie (même en pleins combats, il avait un regard aux aguets pour les insectes, comme pour les shrapnels), il gardait cette précision acribique qui caractérise l'homme de science. Jünger parlait d'approche kaléidoscopique, et Gracq use aussi de cette conciliation entre l'observation froide et la chaleur de l'abandon au courant sensoriel et psychique.


On ne manquera pas de remarquer que, comme pour les mystiques qui empruntent la « voie étroite » (et le titre de ce récit: Les Eaux étroites, nous fait signe) chemin de l'humilité (terme qu'il faut prendre au sens littéral d'intimité simple avec la terre - Gracq emploie par ailleurs le titre d'un ouvrage du géographe allemand Suess ; « La Face de la terre », Das Antlitz der Erde ) – humus – proche d'humiliation – mais chez Gracq, cette idée est à rejeter -, en tout cas de dépouillement, de « pauvreté », de joyeux « délaissement » - comme ces oiseaux du ciel qui ne se soucient pas du repas du lendemain et se satisfont de ce que le bon Dieu leur abandonne dans l'instant -, l'auteur insiste sur la modestie d'une aventure sans aventure, d'une découverte sans « imprévu », comme si l'on retrouvait – expérience onirique bien connue où l'on croit redécouvrir une expérience vécue jadis – un lieu intimement familier (peut-être le cœur du monde) qu'il appelle « notre point d'attache, à la clôture de la maison familière ». Anamnèse platonicienne, mais non de « Là-bas », mais bien d'Ici, dans le monde charnel de la Présence. Pour Gracq, la Parousie est à portée de main. "Habiter, être mis en sûreté, veut dire : rester enclos (eingefriedet) dans ce qui nous est parent (in das Frye), c’est-à-dire dans ce qui nous est libre (in das Freie) et qui ménage toute chose dans son être. Le trait fondamental de l’habitation est ce ménagement. Il pénètre l’habitation dans toute son étendue. Cette étendue nous apparaît, dès lors que nous pensons à ceci, que la condition humaine réside dans l’habitation, au sens du séjour sur terre des mortels." 'Heidegger)
Aussi faut-il, derrière ces derniers mots, voir une acception beaucoup plus large que le simple endroit où l'enfance s'est déployée (l'Èvre se jette dans la Loire, à 1500 mètres de Saint-Florent-Le-Vieil), dont il porte souvenir, mais sans nostalgie ni regret (Gracq est tout d'acceptation jubilatoire du présent, il est l'homme du « Grand oui » au monde). S'il emploie aussi le vocable de « sortilège », en ajoutant que s'attache à lui l'idée de la « baguette du sourcier », c'est qu'il songe à une source souterraine qu'il s'agit de repérer et peut-être de capter (ce qui ne signifie pas capturer, mais se laisser porter par elle). Nous sommes ici en plein conte de fée. Cette source pressentie, à laquelle on aurait accès grâce à un sortilège, c'est peut-être cette « clé », obsession qui revient maintes fois dans ses écrits, et qui était aussi la hantise de Nerval cherchant, à la manière des kabbalistes, la lettre qui manquait pour lire le secret du monde. Et l'on aura garde de ne pas oublier que s'il est un « motif » récurrent de la vie de Gracq, c'est bien celui de la Queste du Graal.

Et l'idée sans doute la plus la plus déroutante pour un Occidental (quoiqu'on la retrouve parmi tous les mysticismes, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident) – et Gracq n'aura jamais été aussi proche du bouddhisme zen - c'est le sens de la gratuité, de la grâce, donc, de ce qui est donné comme ça, sans gain ni profit, sans idée derrière la tête, sans utilité convoitée, comme pur et absolu abandon à ce qui est, à ce qui est offert par l'instant, sans aucune volonté de maîtriser par la pensée le flux des sensations, quiétisme extatique si proche, au fond, de la démarche surréaliste, dont le projet, à la suite de Rimbaud, était de « changer la vie » : « Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. » (André Breton)
14:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : julien gracq, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Frédéric Andreu
« Je ne puis me défendre de l’idée que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière ». En écrivant, nous sommes des Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu ». — Luc-Olivier d’Algange, Entretien avec André Murcie.
Porteur de la lampe poétique, Luc-Olivier d’Algange connaît l’art d’éclairer les blasons d’attente de nos âmes. On lit un texte de lui en se surprenant, parfois, à voir le monde par ses yeux. Et lorsque l’ouvrage se referme et que sa trace narrative s’estompe dans les brumes de l’oubli, il demeure en nous comme un bruissement de feuilles : trace d’une forêt enchantée qu’il a su éveiller en nous.
Les fieffés rêveurs que nous sommes savent que nos images oniriques dérivent parfois jusqu’aux rivages les plus secrets de Mnémosyne, mère des Muses. Peu savent, en revanche, que ces rivages, infrarouges et ultraviolets du monde suprasensible, sont aussi ceux où scintillent les récits de nos légendes. Car le monde légendaire prolonge la lumière naturelle : il fait rayonner, au-delà du visible, ces couleurs interdites au regard, mais familières à l’âme.

Laissant entrer ces fréquences suprasensibles, la prose dalgangienne évoque, par certains côtés, les vitraux d’église traversés par la clarté du sacré. J’ajouterais quelques rares estampes, celles d’Aude de Kerros, dont le magnétisme sourd des mêmes rêveries cheminantes : https://audedekerros.fr
Textes ajourés, estampes magnétiques ou vitraux d’église nous met en contact cette vie dans la vie qui nous attend avant la mort, celle qui pleut en rosée mystique sur les pétales de nos âmes — et non celle qui nous serait promise après la mort.
En contrepoint à l’approche héraldique de Luc-Olivier se tient l’approche étymologique de Philippe Barthelet. J’ai longtemps cherché à comprendre pourquoi deux factures aussi différentes semblaient participer d’une même tradition. Tout récemment, une réponse à cette question s’est imposée à moi: quand Luc-Olivier « remonte » la tradition vers les pistils, bourgeons et fleurs du langage — où butinent tant d’abeilles poétiques ! —, l’auteur du Voyage d’Allemagne descend, lui, vers le sol de cette langue où racines et bulbes des mots forment leurs rhizomes. D’où ces étymons qui émaillent presque chacune de ses phrases.
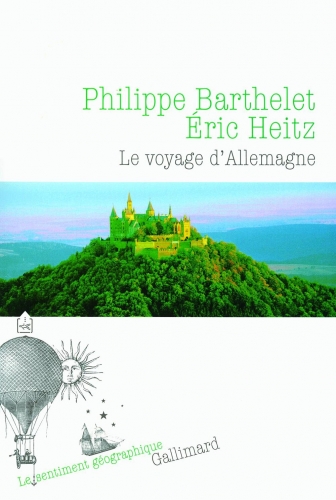
Ces deux explorations, aussi riches de découvertes soient-elles, ne sont pas sans risque : la première peut perdre le Petit Poucet lecteur non averti dans les Holzwege des brumes ésotériques ; la seconde risque de prendre les mots pour les choses. Cependant, mises bout à bout, ces deux œuvres forment un axe lumineux et vertical, absolument nécessaire en ces temps d’avachissement généralisé et de nivellement par le bas.
En elles-mêmes, les œuvres font et sont signes — car tout ce qui est n’est-il pas signe d’autre chose. Elles nous intiment dans l’idée que l’existence n’est que sous l’horizon de notre propre transfiguration, que du point de vue d’elle et d’elle seule. Au coeur de cette attente, les œuvres sont témoins, rappels, voire appels. À la fois balises et boussoles magnétiques, elles ont vocation à nous faire entendre - dans ce monde-ci - les échos de l’autre monde qui veille dans les marges du visible. On peut dire avec Ernst Jünger que l’art agit comme puissance d’orientation. Observons-le dans nos vies intimes : parfois, la montre de l’art se met à sonner quand nous sommes égarés dans les doublures factices de ce monde.Dans ces moments de tourmente, tout se passe comme si quelque chose de nous, en nous, mystérieux et nostalgique, se mettait soudain à résonner avec l’art. Cette résonance rend alors possible d’autres raisonnements plus affûtés que ceux issus de notre logique primaire. Plus encore, l’art nous intime dans l’idée que notre vie entière est, un jour ou l’autre, appelée à changer d’octave, à ôter ses vieux habits de l’âme. D’ailleurs, un des contes recueillis par les frères Grimm, Die Sterntaler, ne dit pas autre chose. Ôtant son unique chemise pour la donner à une enfant plus pauvre qu’elle, la jeune fille du conte voit tomber les étoiles du ciel qui se transforment en ducats d’or. Son vieil habit n’est autre ce qui nous voile la « légende éveillée », l’« imagination vraie » pourtant face à nos yeux de toute éternité. Non seulement l’or tombe dans la nouvelle robe miraculeuse de la jeune fille, mais encore les animaux de la forêt se mettent à lui parler, et elle à les comprendre ! Les fleurs deviennent des sceptres, les êtres apparaissent revêtus de leur manteau de sacre...
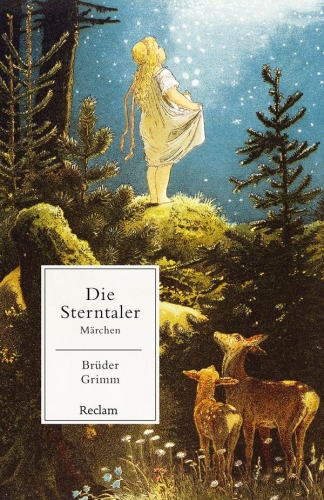
Cet écho « transfigurique » — dont le conte de fée conserve l’octave — est sans doute le plus haut et souverain qui dans une vie d’homme, il nous soit donné d’entendre. Mais il contient aussi sa part de risque : l’oubli de lui-même. Une fois sa conscience altérée, il est fatalement remplacé qui, par une théologie créationniste, puis un moralisme fossilisé et enfin une croyance athéiste. Autant de vérités chrétiennes dont Chesterton nous enseigne qu’elles seraient « devenues folles ». Bref, autant de château en ruine, de parodies du plan initial... On peut dire que lorsque le son initial disparaît, il est remplacé par un bruit, lui-même par un autre, et ainsi de suite, jusqu’au règne assourdissant du monde-machine.
« Le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées » écrit si justement Luc-Olivier. La catena aurea où scintillent tant d’oeuvres et de poèmes, agit alors comme un rappel du son primordial, un tocsin ; un antidote et un acte de résistance. S’il déplore, certes, ce paysage de chantier que devient notre monde, cet imaginaire en ruine que la technologie laisse derrière elle, Luc-Oliver d’Algange n’ignore pas non plus que la providence est inscrutable. C’est à travers les murs fissurés des ruines qu’il guette l’aurore. L’oeuvre de Luc-Olivier n’est ni progressiste, ni réactionnaire ; c’est à ce signe que l’on peut dire qu’elle est l’un des maillons de la catena aurea, chaîne d’or de la tradition.
« L’ennemi, c’est la planification du monde : l’homme-machine, le monde sans imprévu, sans feu », écrit Dominique de Roux dans Mémoires de l’inassouvissement. Disciple du faucon royal Dominique de Roux, Luc-Olivier n’ignore pas que des mains visqueuses, toujours à louvoyer et à comploter dans l’ombre, agissent aujourd’hui à ciel ouvert. Leur technologie noire, planificatrice et ensorcelante, brouille le message divin, le détourne de sa finalité libératrice. Ce dispositif vise un but : empêcher notre éveil individuel et collectif. Les grands planificateurs visent en effet moins notre mort physique que notre consentement au déclin et à la zombification. Pour ce faire, ils remplacent nos royaumes, nos récits fondateurs, nos arts et nos dieux par autant de doublures parodiques et subliminales. Leur stratégie a une force, mais aussi une faiblesse, elle est reconnaissable entre toutes. Celle-ci consiste toujours à présenter la copie à la place de l’original, avant de l’imposer comme la norme. Le règne contemporain de l’« art conceptuel » est emblématique de ce processus. Heureusement, Aude de Kerros s’est employée à démasquer le dispositif. Mais sans aller jusqu’à s’interroger sur l’essence de cet art. Pourtant, rien de nouveau sous le soleil. Ce dispositif, à l’œuvre dans la laideur contemporaine, n’est-il pas inscrit dans l’essence même de la technique ? Aussi bien actif dans l’asphalte qui recouvre la terre, l’écran de l’ordinateur qui s’érige en fenêtre, le dispositif ainsi à imposer le faux art pour le vrai.
L’art qui contient un secret, un magnétisme, une orientation, doit être remplacé par un autre, bidulaire, qui n’en contient pas. La finalité du dispositif est d’obombrer notre potentiel transfigurique, d’opacifier la conscience collective. Mais, aussi, à mesure que la vie se parodise en palais de miroir technique et administratif, augmente la nostalgie du fil d’Ariane. C’est donc en ces temps de règne sans partage des Titans et des Cyclopes, que poèmes, estampes et vitraux redeviennent autant d’aiguilles magnétiques de notre horloge intérieure.
Oui, Luc-Olivier d’Algange : la Tradition n’est pas derrière nous, mais devant nous.
Et les œuvres d’art en sont les balises secrètes.
Contacts :
dalgangelucolivier@gmail.com
audedekerros@yahoo.fr
phiiippe.barthelet@orange.fr (s’écrit avec trois « i »)
13:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Gracq, le goût, le jugement, la littérature
par Claude Bourrinet
J'ai tenu à reproduire le texte de Gracq qui suit, et qui appartient aux entretiens accordés à Jean Carrière. Il y est question de "goût", point d'ancrage, s'il en est, de la critique littéraire depuis Montesquieu, depuis le début du XVIIIe siècle. Ce critère de valeur appartient particulièrement au monde du classicisme, ou du néoclassicisme, qui s'inscrit dans la longue tradition romaine d'une culture livresque nécessaire à la sélection des oeuvres. Certaines demeurent "classiques", illustres, donc, et destinées à être étudiées en classe.
Gracq est plus ou moins embrigadé par une certaine droite, il est vrai de moins en moins substantielle, soit qu'elle tende à s'amenuiser avec le nombre de ceux qui lisent encore, ou qu'elle tende même à constituer une minorité parmi ceux qui se contentent d'une consommation d'ouvrages produits industriellement. Gracq a la réputation d'être provincial, terne, grisâtre, sans scandales, sans cette ostentation provocatrice que prisent volontiers les entrepreneurs d'idées de notre pays, de gauche, certes, mais pas toujours. Partant, on a cru l'incorporer dans la cohorte des réactionnaires. A vrai dire, si la droite s'en est réjouie, la gauche littéraire l'a dénoncé comme tel.
C'est évidemment mal le connaître. Les exemples sont extrêmement nombreux de sa dilection à privilégier, parmi les livres qu'il a croisés, ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont sécrété assez de poudre pour faire exploser une ville, comme certaines oeuvres de Stendhal, de Rimbaud, de Lautréamont, des surréalistes, de Claudel et d'autres, ou qui (et ce sont du reste les mêmes) ont ouvert grand les portes sur le vent du large.
Sa conception de la littérature, du moins du roman, appartient de plain pied à la modernité. Pour lui, un roman est tout fiction : le monde supposé "extérieur", les personnages, les indices de réalité, rien n'est lié au "réel". Même la mort, qui termine invariablement ses romans, n'a de valeur qu'imaginaire. C'est-à-dire que ce qui donne consistance à un récit, c'est le verbe, le mot, la phrase. En ce qui concerne son "style", il trace un sillon d'existence avec une entière liberté d'invention, tordant, ses longues phrases, les disloquant, les nouant et les dénouant dans un jeu qui, parfois, semble nous faire perdre la piste, mais nous y ramène par des chemins de traverse. Le "sens" qui se dégage de ses romans trahit aussi une position singulièrement "rebelle", puisque, dans un premier temps, après avoir braisé l'atmosphère où se noient ses personnages dans de noires lumières, il dérive vers les lisières de l'Histoire, entre rêverie et abandon à l'instant, pour finir par choisir, avec joie et gratitude, l'appel de la Terre, non celle des paysans, comme invitait à le faire un Barrès, mais à la façon du poète, qui unifie le monde sur le point concret où s'inscrivent les pas du promeneur.

Gracq n'est pas du tout "classique", ni passéiste, dans tous les domaines. Il se réclame ardemment du romantisme, surtout du romantisme allemand, Novalis, Hölderlin, Arnim, Kleist et d'autres, et surtout des poètes qui ont marqué les différentes ruptures de la poésie française, depuis Nerval et Baudelaire, jusqu'à Breton, en passant par Rimbaud, Lautréamont. Rappelons aussi qu'il était un fervent admirateur de Jünger. La littérature de fauteuil douillet, et la peur d'effaroucher le bourgeois (sans qu'il eût le désir de l'épater, ou de le déranger) n'étaient pas de son monde.
"L'idée de "goût" est difficilement dissociable de celle de « culture », et celle-ci de la digestion et de la longue rumination de la littérature passée. C'est avec le développement de cette culture que le goût est censé se former : plus ou moins conservateur par sa nature, il tient à une tradition, et cherche inconsciemment, peu ou prou, à la prolonger dans le tri qu'il opère de la littérature qui se fait. Pour cette raison, et pour d'autres, c'est une notion peu franche, qui ne s'avoue pas tout à fait pour ce qu'elle est, plutôt hostile à la nouveauté, et qu'il y a intérêt à utiliser le moins possible : l'idée de jugement, par exemple, paraît en matière de littérature, plus claire et plus saine que celle de goût. Le surréalisme, à mon avis, comme le romantisme autrefois, comme tous les mouvements révolutionnaires, a été parfaitement fondé à le suspecter (« Je me fais du goût l'idée d'une grande tache », a écrit à peu près Breton). C'est une idée qui tend à se rasseoir, comme s'est rassise déjà l'idée équivoque de « Beauté ».
13:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 488 du Bulletin célinien, consacré à Roger Nimier
Sommaire :
 Nimier, un an avant
Nimier, un an avant
Hussard un jour… hussard toujours
Prince de la chronique
Entretien avec Marc Dambre et Alain Cresciucci
Esthète et solitaire. Les thébaïdes de Monsieur Nimier
Le Saint-Brieuc de Roger Nimier.
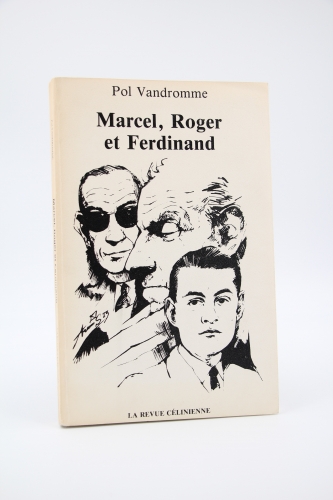
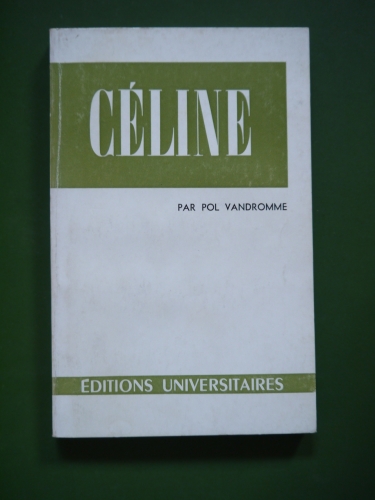
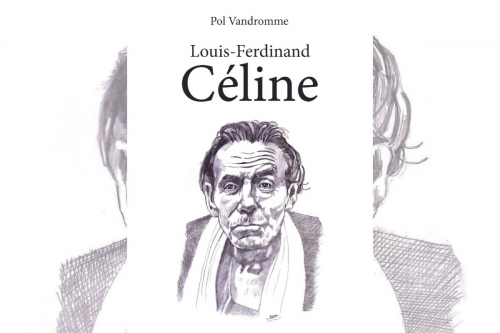
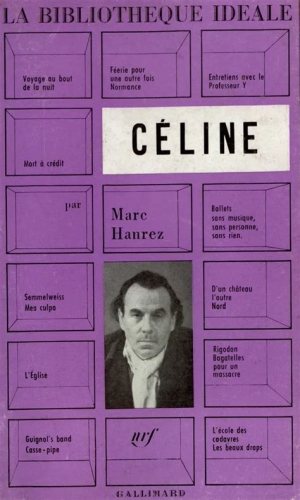
11:53 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, louis-ferdinand céline, littérature française, lettres françaises, revue, roger nimier |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
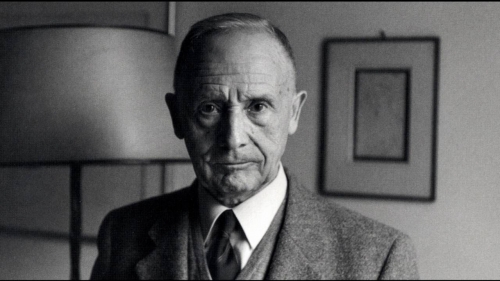
Gracq dans les marges de l'Histoire
Claude Bourrinet
Source: Page Facebook de Claude Bourrinet
L'idée (une des idées), ou plutôt l'image, la chiquenaude qui met en branle l'imagination, ou, si l'on veut, le cerf-volant que l'on envoie dans les airs pour capter la foudre, le déclencheur, donc, qui pré-valut à la rédaction du Rivage des Syrtes, fut la tentation forte de décrire une bataille navale. L'enfant Gracq suivait avec passion, sur les cartes reproduites par L'Illustration, les affrontements des flottes de guerre allemande et anglaise, notamment ce choc des Titans que fut la bataille du Jutland, le 1er juin 1916. Cependant, celle qui aurait dû avoir lieu, entre la flotte d'Orsenna et celle du Farghestan, non seulement ne fut pas écrite, mais elle n'eut pas lieu. « Les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent » envahirent le territoire d'Orsenna sur terre, par le Sud, par le désert.
D'aucuns pourraient s'avouer déçus: une sorte de bataille de Lépante aurait fait bel effet, dans un roman plus ou moins historique (entre l'Antiquité et la Renaissance, entre Mithridate et Venise, il est vrai) ; mais voilà, une sorte de logique romanesque a empêché Gracq de la peindre. Ses « marines », ce sont les vagues qui giflent les côtes bretonnes. Mais, plus que la dimension réaliste (ou romantique), plus que l'anecdote pittoresque, qui manqueraient à l’œuvre, c'est plutôt une certaine conception de la littérature qui est affirmée par l'ellipse. L'écriture romanesque ne vise pas à montrer les choses, mais à en saisir, par les sens et l'intuition, la logique de leur survenue. Ce qui compte, ce n'est pas l' « événement » (il n'y en a guère, chez Gracq), mais ce qui le rend possible, comme l'étreinte pesante et lourde du ciel orageux présage l'éclair et le tonnerre. Tout est dans l'attente intense de cela même qui doit donner sens. Tout le récit du Rivage des Syrtes est la narration d'un crescendo fatal d'une énergie tellurique (symbolisée par le volcan Tângri, qui se profile à l'horizon de la terre farghestane), à travers les expériences sensorielles et passionnelles du héros Aldo. L'orage, qui est le destin de l'Histoire, ne nous est pas donné. On sait seulement, au détour d'une phrase, qu'Orsenna a été détruite par les « barbares ».
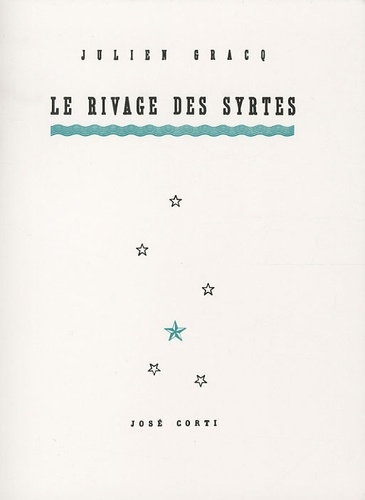
Cette charge électrique saturant l'atmosphère prête à crever en cataractes de sang, nous l'avons connu avant les coups de feu du 28 juin 1914, à Sarajevo, où Nedeljko Čabrinović fut une sorte d'Aldo. Mais le héros de Gracq n'est pas nationaliste, et ne médiatise, dans son geste provocateur, aucune idéologie. Les trois coups de canon provenant des batteries côtières faghestanes, sonnent comme un lever de rideau théâtralisé. L'Histoire est une scène où les morts sont vraiment morts, certes, mais Gracq se présente comme le spectateur, et directeur de cet « opéra fabuleux » porté par une trajectoire imaginaire, qui peut, au demeurant, s'apparier à celle d'un individu.
Pourtant, beaucoup de commentateurs n'ont pas manqué d'établir un parallèle entre le désastre annoncé, et la montée du nazisme, vecteur de guerre et de destructions massives. A ce compte, Aldo fut un « collabo », puisqu'il fut appelé à désirer l'offensive désastreuse de l'ennemi, poussé par le désir ardent de transgresser la loi, de franchir la ligne maritime interdite depuis des siècles, déclenchant ainsi sciemment l'apocalypse. Il semble évident que le roman recèle une portion non négligeable de nietzschéisme. En outre, Gracq était alors un grand lecteur d'Oswald Spengler et de Ferdinand Lot. Mais il a pris des distances par rapport aux thèses « dangereuses » de l'auteur du Déclin de l'Occident, ainsi que de Toynbee, qui expliquait, comme Ibn Khaldoun avant lui, l'effondrement des Empires par la conjonction entre les invasion barbares, et la défection insurrectionnelle du « prolétariat » intérieur (ou, dans le roman, par la rébellion d'une famille de rebelles, les Aldobandi, à laquelle Vanessa, qui tient un rôle capital, appartient).

Il considérait surtout ces deux historiens (ou philosophes de l'Histoire) comme des « poètes de l'Histoire », des pourvoyeurs d'archétypes. Les légendes, les mythes, sont des générateurs de motifs imaginaires. L'épopée des Nibelungen (étymologiquement « Ceux du brouillard), par exemple, si chère au wagnérien Gracq, pourrait entretenir maints liens avec Le Rivage des Syrtes ; Aldo, alors, ne serait pas Siegfried, mais le « traître » Hagen, celui qui déclenche tout. A moins, plus justement, qu'il ne soit Kriemhild, qui épouse le roi des Huns, pour se venger, et provoquer le massacre du roi Gunther, et de ses frères. Mais il n'est pas mu par le ressentiment, bien que le résultat soit de même portée. Toutefois, la "liberté" provocatrice, quoique pourvoyeuse de jouissance et d'ivresse, s'avère être une illusion. Une fois le branle donné, le dynamiteur n'aura été qu'un rouage d'une machine qui le dépasse infiniment, et qui poursuit une marche froide et inexorable.
C'est en poète, en visionnaire, que Gracq s'enquiert de la décadence. Qu'importe du reste si elle est occidentale ou non. Il acquiesce au concept d'entropie. Ses images sont, comme chez Spengler, ou Michelet, biologiques. « Tout ce qui existe mérite de périr ». Et il ajoute volontiers, à cette assertion de Hegel, « surtout si le corps est usé, miné par l'âge et la sclérose, vermoulu, et qu'un coup de botte suffit à ébranler jusqu'au fracas de la chute ». Orsenna est bâtie sur des couches superposées d'ossements, de cadavres. Elle est une ancienne puissance qui se survit, juchée sur une mémoire sénile de ressassement d'une gloire évanouie. Sa pulvérisation est donc logique. Le fonctionnaire Marino, fidèle capitaine et gardien de la forteresse maritime des terres du Sud, incarne l'enracinement dans le culte de la Terre et des Morts, et son barrésisme est condamné par le narrateur, lorsqu'il se noie dans la vase puant le cadavre et le bois pourri qui clapote au pied du quai de l'arsenal.
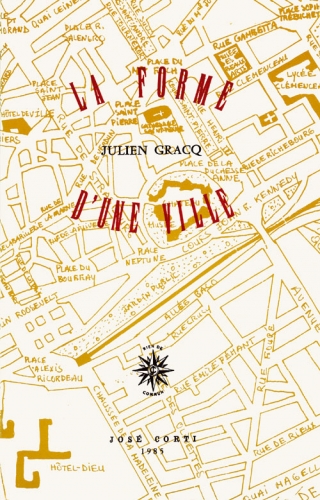
Gracq a rarement évoqué les événements historiques, ni ne s'est engagé après 1938, date à laquelle il a rompu avec le Parti communiste, dix ans après avoir perdu l'habitude de se rendre à la messe. Son sens de l'Histoire doit beaucoup à Chateaubriand, non par une posture « réactionnaire », voire royaliste, qu'il n'eut jamais (bien que né à Saint-Florent-le-Vieil, haut lien des exploits de l'armée de Vendée, et tombeau de Bonchamps), et, si l'on excepte quelques références historiques parsemées, à titre d'exempla, dans ses fragments critiques, il n'évoqua la guerre qu'à travers ses souvenirs de la bataille de Dunkerque – au sens large -, à laquelle il participa en tant que lieutenant. Jamais il ne s'engagea pour un parti ou un autre, quoiqu'il partageât un certain conservatisme « provincial » avec une certaine droite. Il accepta plusieurs invitations de Pompidou, mais uniquement parce que ce dernier avait été l'un de ses condisciples à l’École Normale supérieure. Son refus de dédicacer Les eaux étroites, dans une édition d'art offerte par l'illustrateur à Mitterrand, tenait probablement à la répugnance que lui inspirait le personnage. Sa «ligne», pour autant qu'on le sache par son silence massif à ce sujet, tient en un apolitisme inflexible. Cela ne l'empêchait pas, néanmoins, de jeter des lueurs de compréhension avertie sur des tendances majeurs de l'actualité mondiale (par exemple, son refus de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne). Il ne rejetait pas non plus toute nouveauté. L'abattage des haies du bocage vendéen et breton le réjouit, car il lui permettait de jouir de larges échancrures par lesquelles s'offraient des perspectives et des panoramas que l'amateur de paysages – comme « presbyte » - recherchait.
La question de la rédemption historique est loin d'être résolue dans l’œuvre gracquienne, qui baigne cependant en partie, du moins dans sa composante romanesque, dans l'Histoire (Le Rivage des Syrtes, Un balcon en forêt), tandis que sa seule pièce de théâtre, Le Roi pêcheur, évoque la possibilité du salut, d'un salut qui n'est pas chrétien (Gracq a rejeté toute interprétation chrétienne du mythe du Graal). Le Roi pêcheur finit dans l'incertitude, et l'attente a tout lieu de persister. Le personnage féminin de Kundry est, selon l'auteur, son « porte-parole » : elle est déchirée, comme Baudelaire, entre deux postulations, entre la caducité de la nature humaine, qu'on peut appeler le « péché », et l'espoir, la quête de la grâce. Mais ce n'est pas de ce côté-là que Gracq trouve une issue à l'enfermement, au nihilisme contemporain.
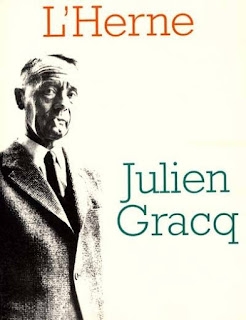 Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).
Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).
Gracq passe, en littérature, pour un « passéiste », voire un réactionnaire. Il a déclaré, avec son ironie mordante que, par moment, il déployait (songeons à son pamphlet, « La Littérature à l'estomac », où il pourfend les « Aristarque » de la critique littéraire), qu'en France, la littérature, du moins la production de grands écrivains, avaient cessé après le XIXe siècle. Son style, très maîtrisé, aristocratique quelque peu, hautain disait certains, et exigeant un lecteur lent et scrupuleux, désignait en lui un adversaire du laisser-aller, de la « libération » de la libido créatrice (ce qui était un contresens : rien de plus érotique, sensuelle, que la prose poétique de Gracq, qui, paradoxalement, est bien plus proche d'une hypothétique « avant-garde » - bien qu'il réprouvât et le terme, et l'idée – pour peu qu'on fasse l'effort de reconnaître en lui la « liberté grande » sans cesse en exercice, qui préside à son travail d'écriture, bien éloignée du conformisme salonnard et universitaire des Écoles littéraires en -isme de l'après-guerre).
Gracq était attaché à une certaine authenticité de vie, et de relation avec le monde. Il la trouvait dans ses liens avec la nature. Ce n'est pas un hasard s'il prisait par-dessus tout la rudesse dépouillée et franche des reliefs hercyniens, de la Bretagne, des Ardennes, des plateaux de l'Aubrac et du Cézallier. Il était l'homme des marges, de l'entre-deux, des zones insolites, à la manière dont les surréalistes désignaient les hasards objectifs pourvoyeurs de « merveilles », qui, parfois, lui octroyaient des « extases » ressemblant étrangement à des expériences mystiques orientales, ou à ce que recherchait Heidegger, quand il parlait des « Clairières de l'être ». Mais s'il s'inspire beaucoup du romantisme allemand, il n'en demeure pas moins un géographe. Comme Jünger, il observe la nature, les paysages, au moyen d'un double regard, de la conjugaison « kaléidoscopique », dit Jünger dans Le Cœur aventureux, d'une interprétation analytique claire et distincte, et d'une plongée « magique » dans le flux de sensations que le monde offre. Un œil scrutateur au cœur du maelström, en quelque sorte. A cette connaissance de lieux remarquables se mêlent également intimement des fragments vivants de souvenirs mythiques, culturels, historique, etc., aboutissant parfois à un état proche du rêve. Mais un rêve conscient.
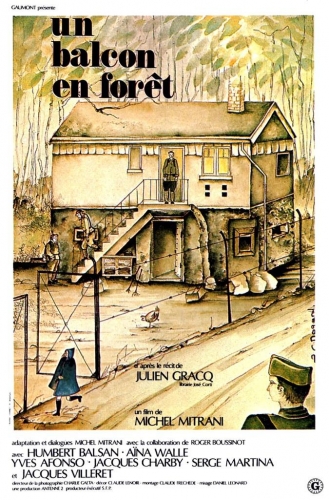
Gracq écrit à un moment où l'Occident est en crise, et le sait. Toute la production littéraire, philosophique, artistique du XXe siècle tente de répondre à ce malaise (et Freud, dans son Malaise dans la civilisation (1929), a réagi peu de temps après Spengler (1918 et 1922)). Gracq refuse de jouer. Il ne « s'engage » pas, il est, non « antipolitique », comme Baudelaire, qui s'essouffle à vilipender la démocratie, les bourgeois, l'égalitarisme, le progrès etc., mais apolitique. Non qu'il n'aille voter, mais il ne se laisse pas ferrer. Son royaume n'est pas de ce monde-là. Son « utopie », son locus amoenus, est de celui qui existe vraiment, qui est tel ou tel lieu, bien concret, bien sentant, bien jouissant, aussi prenant que des élans du cœur et de la chair, et qui ouvre sur le cosmos, dont l'ouverture délimite un périmètre aussi signifiant qu'une fenêtre découpant un paysage éblouissant de beauté convulsive ou gorgée de paix. Avec Gracq, comme avec d'autres (et comment ne pas penser à Kenneth White?), des contrées inconnues s'ouvrent à notre curiosité et à notre sensibilité : ce sont celles qui échappent aux labours de l'Histoire, et qui sont là, devant nos yeux, pourvu qu'on les ait « bien ouverts ».
18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : julien gracq, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Anatole France: Populaire des deux côtés des barricades
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/anatole-france-popul...
Croyez-le ou non, il y a eu des moments où l’extrême gauche et l’extrême droite se sont exprimées d’une seule voix, et un tel exemple concerne l’attaque dirigée contre Anatole France (1844–1924) par le mouvement surréaliste nouvellement formé. France, considéré par ses concitoyens comme le plus grand homme de lettres de l’histoire du pays et lauréat du prix Nobel de littérature en 1921, gisait impuissant sur son lit de mort tandis qu’un groupe de conspirateurs s’employait à rédiger une diatribe virulente dans laquelle leur cible déclinante serait décriée comme un conformiste complaisant, impardonnablement encensé par les deux camps politiques.
Imaginé par André Robert Breton (1896–1966), Paul Éluard (1895–1952) et Louis Aragon (1897–1982), l’article incriminé était un pamphlet de quatre pages intitulé Un Cadavre et visait à noircir le nom du poète, romancier et dramaturge socialiste en réaction au fait que ses œuvres littéraires étaient dévorées en si grand nombre. Bien que France ait été universellement vénéré, Breton expliqua que lui et ses compagnons conspirateurs
« considéraient son attitude comme la plus équivoque et la plus méprisable de toutes : il avait tout fait pour s’attirer l’approbation de la droite comme de la gauche. Il était gonflé d’honneurs et d’autosatisfaction. »
Des phrases acerbes telles que « c’est un vieil homme comme les autres », « un peu de servilité humaine quitte le monde » et « l’homme n’a plus besoin de soulever de poussière » paraissaient bien anodines à côté de la contribution d’Aragon. Intitulé « Avez-vous déjà giflé un mort ? », le poète et romancier décrivait sa cible mourante comme un homme « acclamé simultanément par l’imbécile [Charles] Maurras et le Moscou chancelant » tout en apparaissant comme « l’incarnation de l’ignominie française ».
Alors que la presse parisienne regorgeait de détails croustillants sur l’état de santé déclinant d’Anatole France, les surréalistes étaient désireux de provoquer une réaction et d’attirer l’attention sur eux-mêmes. Le pamphlet devait être distribué le jour même de la mort de France, mais les préoccupations juridiques et morales de leur imprimeur sur la nature du document furent telles qu’il ne fut publié qu’une semaine après son décès.
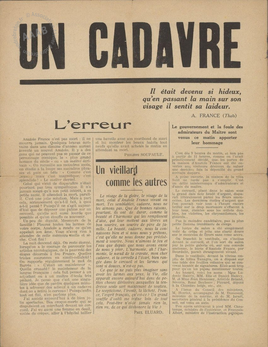
Comme il fallait s'y attendre, Un Cadavre déclencha un énorme scandale et le journaliste de droite Camille Mauclair (1872–1945) — qui deviendra plus tard collaborateur du régime de Vichy et travaillera pour Revivre : Grand Magazine illustré de la Race — décrivit Aragon et ses acolytes comme des « fous furieux » qui avaient les manières non seulement de « voyous mais de chacals ». Le journal pro-communiste Clarté accusa les surréalistes d’« irréflexion » pour leur attaque contre l’épicentre mondial du marxisme-léninisme, et Breton répondit en qualifiant la Révolution russe de « vague crise ministérielle » pleine « d’une misérable activité révolutionnaire » qui, ironiquement, ne méritait même pas ce nom.
Même France lui-même avait salué la fondation du Parti communiste français (PCF) et fut défendu plus tard par l’écrivain anglais George Orwell (1903–1950) en raison des déclarations humanitaires que l’on trouve dans ses romans. À une occasion, France avait parlé de la folie de vivre dans un pays qui « interdit aussi bien aux riches qu’aux pauvres de dormir sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. » Compte tenu de sa dénonciation de la démocratie libérale, il est donc facile de comprendre pourquoi il pouvait être défendu à la fois par des communistes et des proto-fascistes.
18:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anatole france, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, surréalistes, surréalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
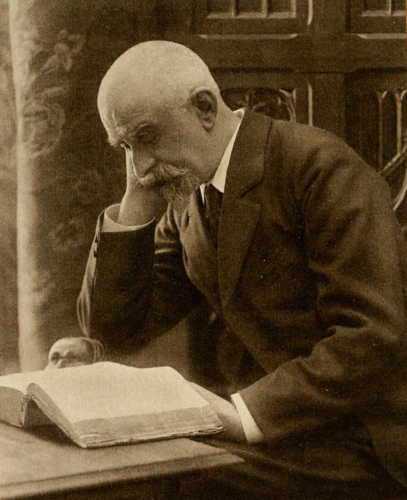
Les Foules de Lourdes, le testament antimoderne de Huysmans
Claude Bourrinet
Je veux qu’on y vienne en procession.
La Vierge
L’homme est un animal adorateur. Adorer, c’est se sacrifier et se prostituer.
Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.
De la vaporisation et de la centralisation du moi. Tout est là.
Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.
Une mystique naturaliste
Il restera toujours un fond naturaliste, chez Huysmans, qui, jusqu'à sa dernière heure où, vêtu de la robe noire et du capuchon des moines de Saint Benoît, il rendit l'âme, éprouvera, comme la présence lancinante d'une basse continue, le souci angoissé de trouver les signes tangible, matériels, du surnaturel, dans un monde livré à la banalité de la décadence, et encore davantage de sa propre existence d'homme souffrant en quête de salut (1).
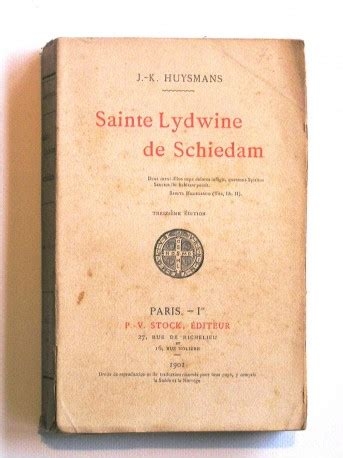 Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.
Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.
Une comparaison avec Les Confessions de Saint-Augustin suffit à mesurer l'écart qui sépare ces deux convertis sur le tard. Chez l'évêque d'Hippone, on se laisse emporter par des élans lyriques de mysticité, par des considérations théologiques et philosophiques de grande portée, qui irrigueront la pensée médiévale, et au-delà. En revanche, chez Huysmans, on suit pas à pas un itinéraire quasi clinique, déroulant les méandres, les avancées et les retours en arrière d'une âme qui est loin de déboucher rapidement sur la voie royale, si tant est qu'elle y soit un jour parvenue, la foi n'étant jamais vraiment acquise. Huysmans était trop écrivain pour s'abandonner, trop écrivain moderne, c'est-à-dire héritier de la littérature qui débuta avec le romantisme, et transféra le souci du monde, la sociabilité innée des écrivains dits « classiques », oublieux de soi et refoulant l' « amour-propre », dans l'univers narcissique et obscur du poète créant sa propre centralité de prophète et Prêtre du moi, sinon du monde, et toujours en quête de vérité.
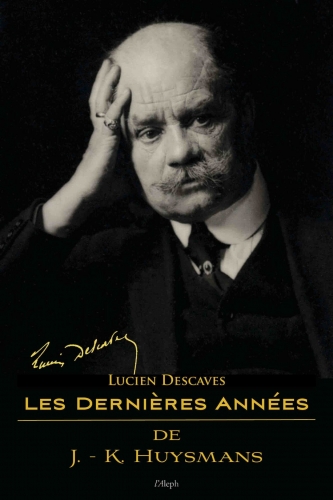 « Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »
« Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »
Il est vrai néanmoins que son écriture, sa création littéraire, passent nécessairement par la révolution existentielle, violente et profonde, qu'il a vécue. (3) Les deux dimensions sont liées, et, contrairement à beaucoup de symbolistes, qui contrecarrent le pessimisme et la décadence par le culte de l'esthétisme, de l'art, du rêve, il unit intimement la douleur angoissée de la recherche religieuse à sa traduction sur la page blanche. La lecture de ses œuvres, à partir de Là-bas, pour ne pas parler d'En Route, impose à n'importe quel lecteur le sentiment d'être confronté à une expérience vécue.
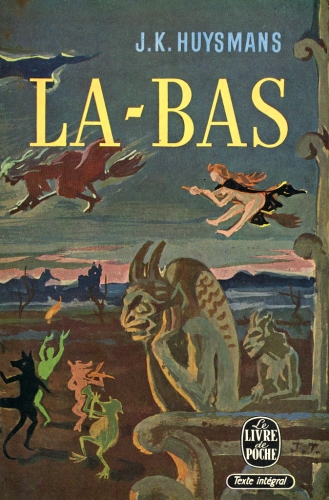
Les étapes douloureuses (doloristes?) de sa conversion, il les a annotées, comme un carnet de route, dans son œuvre: partant du satanisme dans son « Livre noir », Là-Bas (1891) (qui montre, somme toute, un monde surnaturel, un christianisme à rebours, opposé au naturalisme avec lequel il vient de rompre avec fracas avec A rebours (1884)), il saute le pas métaphysique, se convertit.
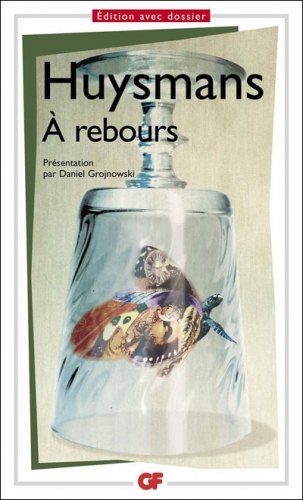
Barbey d'Aurevilly avait eu, dès la parution d'A rebours, la prémonition de ce plongeon religieux: il avait prédit, dans un article du Constitutionnel du 28 juillet 1884, que Huysmans aurait un jour à choisir entre « la bouche d’un pistolet ou les pieds de la croix ». Ce chemin de croix (le Cycle de Durtal) est jalonné d’œuvres comme En route (1895) – il mit quand même trois ans avant de traduire littérairement sa conversion de 1892, à la Trappe d’Igny, où il reçoit les sacrements -, La Cathédrale (1898), L'Oblat (1903).
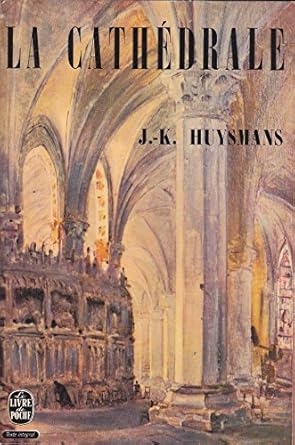

Le dernier livre est la relation de sa tentative de se lier, en 1901, à l'abbaye de Ligugé (photo), dans le Poitou, aventure spirituelle interrompue par l'expulsion de la communauté monastique de Saint Martin, à la suite des lois anti-religieuses de la République franc-maçonne du Petit Père Combe, déclinaison locale – avec le Portugal, en 1911, d'une persécution plus vaste (ou de tentatives, comme en Belgique et en Allemagne), dont font l'objet, sous les pontificats de Léon XIII (1878 – 1903), et Pie X (1903 – 1914), les catholiques européens, y compris en Italie ou en Espagne.
Paradoxalement, cette époque fut aussi, contre un nihilisme de plus en plus rongeur et dissolvant, celle du grand mouvement de conversions littéraires que vont connaître les Lettres françaises au début du XXe siècle avec des auteurs comme Paul Bourget, Péguy, Brunetière, Claudel, Maritain, Jacques Rivière, Psichari, Massignon, Massis, Léon Bloy – qui fut très proche de Huysmans, et se brouilla violemment avec lui -, et d'autres, notamment à la faveur de l'influence d'un abbé très intégré dans les cercles mondains et artistique, l'abbé Mugnier (protrait, ci-dessous), lequel apparaît dans En route, sous les traits de l'abbé Gévresin, mais surtout de celle de l’abbé Gabriel Ferret, mort en 1897, à quarante-cinq ans, à qui Huysmans dédia La Cathédrale (1898).

Le fil conducteur des livres de Huysmans, y compris les premiers, qui étaient naturalistes, sont marqués par une hostilité constante à la modernité, à l'américanisme, à la médiocrité contemporaine, à la bêtise triomphante et à la laideur qui l'accompagne, et fortement imprégnés de pessimisme schopenhauerien, considéré en cette fin de siècle décadente comme si « français » (« Nietzsche déclarait préférer lire Schopenhauer dans sa traduction française plutôt que dans sa version originale », rappelle Clément Rosset). Cette philosophie, à tonalité antimoderne, si tardivement connue, était assez répandue et partagée, explicitement ou implicitement, dans les milieux intellectuels d'alors, et le fut encore davantage au XXe siècle, par exemple par Proust, Céline, Beckett etc., pour n'évoquer que des écrivains français – ou de langue française. Tendance intellectuelle, voire existentielle, violemment contraire à la Weltanschauung chrétienne, mue par l'espérance. Encore faudrait-il tempérer cette opposition, si l'on prend en compte le dogme du péché originel, et un jansénisme qui a beaucoup imprégné la mentalité française, sans oublier un Baudelaire, l'un des maîtres à penser de Huysmans, qui se réclamait de Joseph de Maistre.
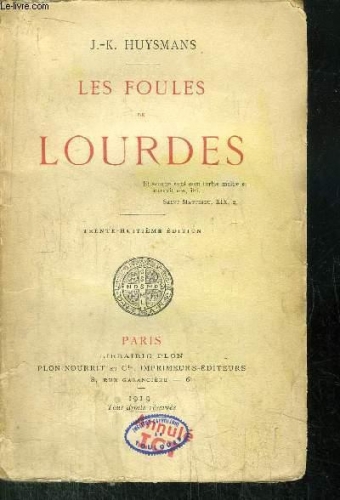
Les foules de Lourdes
Les Foules de Lourdes est le dernier ouvrage de Huysmans, une sorte d'enquête à portée autobiographique, parue un an avant sa mort, le 1er octobre 1906, et relatant un pèlerinage dans la cité mariale, qui dura cinq jours, durant l'été 1904, dont l'écriture est si dense qu'on a l'impression d'un mois de séjour. Il y fut hébergé à la Villa Saint-Antoine par un couple, les Leclaire, qu'il connaissait bien, puisqu'il avait fait construire avec eux une grande demeure, la villa Notre-dame, destinée à accueillir un cercle chrétien d'artistes, non loin de l'abbaye de Ligugé, avant qu'il ne fît profession d'oblat, et quittât les lieux, désertés à la suite de l'expulsion de France des ordres religieux.
Voilà comment Lucien Descaves présente la naissance du projet d'écrire cet opera ultimate: « Vers la fin du mois d’août [1900], il avait été voir passer, en gare de Poitiers, les trains remplis de malheureux qui allaient chercher à Lourdes une guérison miraculeuse. Songeait-il déjà, ayant terminé enfin Sainte-Lydwine, qu’il était en train de raboter, songeait-il à une vision plus directe des souffrances humaines? Je le crois; mais il était sans doute momentanément refroidi par la lecture du roman de Zola. Il revint allégé de cette appréhension. Certes, les descriptions de Zola étaient « justes et admirables »; mais cette revue affreuse des suppliciés conduits vers une guérison hasardeuse par des gens du monde en gants frais et culottes de cyclistes, cela laissait tout de même à l’observateur quelque chose à dire. »
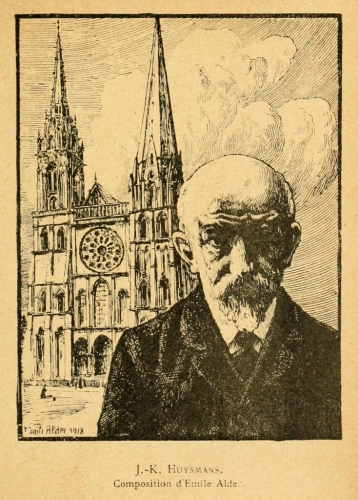
Ce fut du reste à Poitiers que le mal, qui devait l'emporter, commença à être virulent. Lors de son séjour à Lourdes, le cancer à la mâchoire était bien avancé, mais il n'en touche pas un mot. La fin de l’année 1903 et le début de 1904 n’apportèrent à ses maux aucun soulagement.
J'espère montrer que ce récit, qui pourrait tout aussi bien être un roman qu'un reportage, est, selon moi, le chef-d’œuvre de Huysmans. Il mêle en effet, à la manière du romancier, une « intrigue », qui n'est pas rectiligne, mais circulaire, puisqu'il déambule sinueusement entre des points « stratégiques », comme la grotte, le cabinet des médecins qui constatent les miracles, la basilique, oscille de manière itérative, entre la foule et des réduits plus ou moins protégés, entre des personnes bien caractérisées, et l'anonymat des fidèles...
Dans le même temps, il se livre, s'insérant entre des descriptions d'une intensité pathétique et parfois grotesque, à de profondes réflexions religieuses, théologiques, tout en ressassant des griefs (la laideur de l'architecture, la médiocrité des spécimens d'humanité qui arrivent par wagons, les comportements grégaires). Il confronte son écœurement à des justifications, des objections spirituels, toujours hanté par la crainte d'être enferré dans le rets perfides du Malin à l'affût, dont on sent la présence pérenne, même en ces lieux inspirés par la Vierge, et surtout en ces montagnes mélancoliques des Pyrénées, si chargées de mémoire païenne.

Nous verrons que ce que vit alors Huysmans ne concerne pas uniquement le chrétien, le catholique, mais aussi tout homme libre à l'ère des foules. De même, la filiation du monde lourdesque que Huysmans nous livre avec tout le talent de prosateur poétique qui est le sien n'est pas sans une parenté évidente avec l'univers dantesque. La filiation s'incarne par exemple au fil des cercles de souffrances, qui semblent s'aggraver à mesure que le regard aigu du narrateur inscrit dans notre imagination les symptômes monstrueux, à peine supportables, des maux qui tordent ou abattent, transforment en chair palpitante de douleur, en matière souffrante, des âmes qui ont parcouru des centaines de kilomètres dans des wagons cahotants.
Cette tératologie que Huysmans dévide comme une fresque infernale avec des mots puissants, des vocables parfois recherchés dont les sonorités et les couleurs nous font voir et sentir, au point que, tout en étant fascinés, nous sommes terrifiés, saisis de répugnance, sont, comme chez le poète florentin évoluant de bolgia en bolgia, évidemment des symboles: manifestation du péché, même parmi les innocents, les enfants – mais pour l'auteur de Là-bas, il n'y a pas d’innocence, nous sommes tous coupables, et la purulence de la chair est l'image, en vérité, d'une condition frappée par un mal profond, indéracinable. En même temps, comme dans la Divine comédie, nous sommes souvent émus, pris de compassion, d'une pitié irrépressible pour ces êtres touchés par la maladie, non seulement parce que ce sont des humains, comme nous, mais aussi, comme dit Homère, et toute l'Antiquité avec lui, parce que ce sont des mortels. Huysmans nous renvoie à ce que nous sommes, des créatures pathétiques, vaines, chétives, faites pour peiner, et c'est le sceau d'Adam et d'Eve.
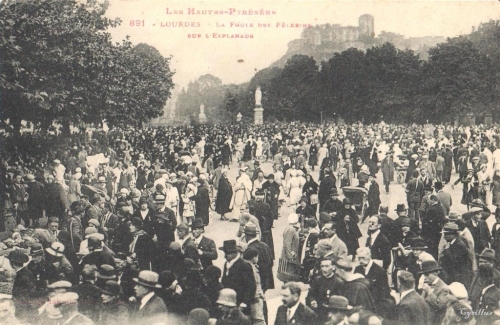

Il ne se livre d'ailleurs pas à une taxinomie des pèlerins en fonction de leurs talents. Le savoir, le génie même, n'apparaissent pas dans les critères qui président à ses descriptions. Malgré tout, il établit une hiérarchie: plus on est riche, plus on se livre à la représentation, à la commedia, au théâtre narcissique, et plus on cache sa misère dans les plis compliqués de sa vêture sociale, qui doit se voir; en revanche, quelques êtres simples, naïfs, aussi primitifs que la peinture médiévale qu'il prise tant, qu'ils soient âgés ou enfants, accompagnateurs ou patients, nonnes ou prêtres, trouvent grâce à ses yeux. Mais ils sont peu nombreux. Ils se singularisent par une présence sans arrière-pensée d'amour-propre, comme la rose qui est parce qu'elle est, ou par un sens du devoir plein, total, par cette noblesse de l'action qui, lorsqu'elle est orientée vers le bien, l'amour du prochain, élève jusqu'à la sérénité, et parfois l'extase. Combien d'infirmières, de soignantes, de brancardiers admirables se donnent ainsi à corps perdu ? Ils sont la prémonition du Paradis, que l'on n'entrevoit guère, et auquel on n'a pas accès, hormis dans ces espèces de songes ritualisés et concentrés que sont les prières vécues (toutefois, la majeure partie des malades les débitent à la chaîne, comme des formules magiques).
Et il y a l'espoir. Il fait vivre, en tout cas survivre, et, du moins le croit-on, guérit. Peu. Car à Lourdes, on s'arrête surtout à l'Enfer. Le purgatoire, la santé, qui est le salut sécularisé, pour ainsi dire, ne touche qu'une minorité. Des élus, en somme. Et gratuitement. Pourquoi celle-ci, et pas celui-là, qui aurait mérité autant qu'elle d'être sauvé ?
Il est, dans cette immense circonférence où le centre est dans chaque souffrance incommensurable, un petit cercle avec lequel Huysmans sympathise, dont les membres sont tacitement des complices, ou des happy few maîtrisant les afflux brutaux de vagues sensorielles qui renverseraient celui qui n'a aucun intérêt vital à se retrouver en ces lieux. Le petit groupe avec lequel il lui est possible d'entretenir sereinement des propos abstraits, en tout cas d'ordre rationnel, ou anecdotique, qui comprend, comme on l'a vu, des âmes simples, d'élite, si l'on veut, authentiques, proches sans doute de l’Évangile de Jésus, est constitué de quelques personnages importants dont la tâche à Lourdes implique une mise à distance. Ce retrait se traduit par une capacité à examiner, à penser la situation. Il y a quelques prêtres cultivés, mais qui ont leurs limites (notamment dans leur rapport avec la beauté), et des scientifiques, des hommes de métier, des médecins, dont le réflexe premier, professionnel, est de se montrer sceptique face aux présupposés « miracles ».
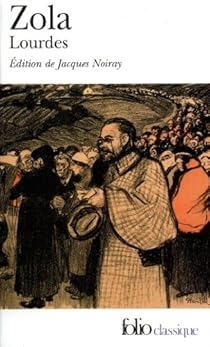 L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.
L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.
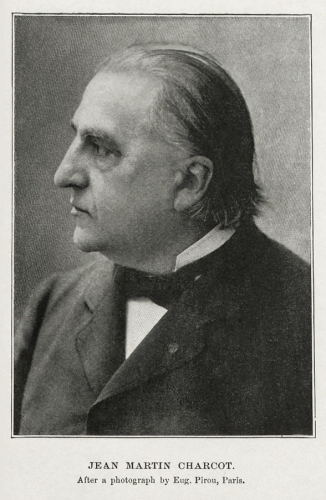 Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.
Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.
Il n'est pas sûr non plus que de nombreux prêtres d'aujourd'hui ne partagent les analyses du neurologue. Nonobstant, l'impression que ce petit cercle échappe à la pression environnante demeure, et le cabinet où les « miraculés » viennent se faire estampiller, ressemble à une redoute au milieu d'un champ de bataille. Pour autant que Huysmans soit un homme sanguin, violent, emporté, submergé par la répulsion (souvent) ou soulevé par l'admiration (rarement), il demeure un être de raison. La meilleure des morales est de savoir penser, dit Pascal.
L'une des questions vitales pour lui, à tel point qu'on se demande si ce n'est pas là le cœur même de sa conversion, est celle de la beauté, de l'esthétique. Il constate amèrement le vandalisme auquel a été soumis la petite cité de Lourdes, la destruction de l'ancienne petite église romane, et l'incroyable vulgarité, grossièreté, des ouvrages édifiés, qu'ils fussent des bâtiments religieux, ou des statues. Huysmans s'attarde beaucoup à ce sujet, et a toujours à l'esprit le phénomène saint sulpicien et son esthétique pompière, inauthentique, plébéienne et démagogique, réplique fidèle, dans le contexte artistique du XIXe siècle, d'un siècle industriel de parvenus, siècle bourgeois, béotien, où les créateurs véritables, écrivains, peintres, sculpteurs, ont eu toutes les peines à se faire entendre, voire à survivre.
L'architecture fut sans doute l’un des point névralgiques de cette maladie de la laideur. Huysmans aurait pu utiliser le vocable kitsch, s'il n'était entré dans la langue française qu'en 1962. La basilique du sacré-cœur de Montmartre en est exemple parfait, un beau furoncle sur une colline, triomphant, qui se voit de loin, et qui domine de sa superbe un Paris livré au diable. Huysmans est sans doute l'écrivain de fin de siècle le plus baudelairien qui fût. Rimbaud le fut aussi à sa manière, mais contrairement à son idole, il aimait la nature, transfigurée, il est vrai. Baudelaire comme Huysmans la détestent. Ils s'y ennuient. En revanche, l'esprit, l'âme, se lisent fidèlement dans la création humaine, dans l'artifice, au sens littéral du terme, c'est-à-dire produit de l'artifex.

Pour Huysmans, une petite église romane, une statue gracile, gothique, par exemple (et non néogothique!) de la Vierge, sont des signes de la présence divine (il s'en est expliqué dans son beau livre, qui a achevé de le rendre célèbre, et lui a octroyé une coquette somme, La Cathédrale). Or, l’Église de son temps partage les goûts de la bourgeoisie décadente de l'époque. Elle s'est empressée de détruire, de vendre, ou d'achever de ruiner des héritages sublimes d'un moyen âge qui, malgré le romantisme, n'était pas encore reconnu comme l'un des sommets de la civilisation européenne (et ce déni durera).
Huysmans est stupéfait de s'apercevoir que le clergé, celui d'en bas comme celui d'en haut, est complètement indifférent à ces questions. L'essentiel, pour la hiérarchie sacerdotale, relève de la mission. Il s'agit de répandre la Bonne parole, d'amener à soi le troupeau, et de l'encadrer. En cela, il est fidèle à ce que l’Église a toujours fait depuis les temps premiers de sa naissance, et surtout de sa prise de pouvoir, au IVe siècle. Que ses œuvres matérielles aient été, de surcroît, souvent belles, appartient à un autre ordre que celui de la simple propagation de la foi.
Or, dès la Contre-Réforme, on entre dans l'ère de l'efficacité et des foules urbanisées. Il est nécessaire de promouvoir une esthétique qui relève du fonctionnement social, et qui touche affectivement. Les prêtres rétorquent à Huysmans qu'il s'agit de se mettre à portée du peuple. A cela, il répond que, de tout temps, les choix artistiques et esthétiques ont été imposés, et la foule des fidèles s'est pliée volontiers à ce geste impératif, d'assigner à des cerveaux souvent incultes l'éclat transcendant d'une beauté, qui est le signe du divin. C'est cela, cette ambition que l'on veut bien croire démesurée, qui est rompue, avec la modernité. En revanche, parallèlement au sentimentalisme de loge du concierge, on mise sur le gigantesque, l'Hénaurme, comme aurait écrit Flaubert. Ce qui est grand, gros, puissant et écrasant, impressionne immanquablement le béotien, avec, il est vrai, un autre patron: il faut que ce soit comme dans la réalité.

Tout est cyclopéen, éléphantesque, à Lourdes, et on peut y voir une prémonition de l'esthétique totalitaire, communiste, mussolinienne, nazie, américaine, sous sa forme new-yorkaise, ou disneyienne. Lourdes, c'est le prototype, dans le style néogothique ou néobyzantin, de Disneyland, et les mêmes questions d'encadrement du « tourisme » se pose.
La procession, allégorie de la modernité en marche
On peut s'interroger sur les raisons véritables de la « conversion » de Huysmans. Il ne s'est rendu à Lourdes qu'en traînant avec réticence son carnet de notes dans ses bagages. Du reste, il nous prévient : « […] je n’aime pas les foules qui processionnent, en bramant des cantiques. »
Pourtant, le récit qu'il fait de son pèlerinage, même si le champ dans lequel il évolue paraît clos, et sent l'enfermé, suit tout de même une ligne, du moins jusqu'à l'approche de la fin, la queue s'éteignant peu à peu, comme un cierge mélancolique et fatigué à bout de flamme. Se dessine en effet, au fil de la narration, un crescendo, dont l'achèvement paroxystique est une « formidable procession » composée de « tout un corps d’armée, trente mille hommes », « un cierge à la main, de la grotte au Rosaire, en passant par les lacets en forme d’M couché qui grimpent sur la colline, derrière la basilique, et, après avoir descendu et remonté les rampes, […] sur l’esplanade pour finalement se fondre, en un seul groupe, dans le cirque immense du Rosaire».

Pour jouir de ce spectacle exceptionnel, Huysmans s'assied « auprès de quelques prêtres, sur les marches de la chapelle. De là, [il] domine, au-dessus du Gave, la basilique, la rampe, l’esplanade, le Rosaire, vus de profil; c’est l’endroit le mieux situé pour assister au gala de la féerie du feu».
Cette procession est en effet placé sous le signe de la lumière. Or, la lumière est le symbole du Divin, son éclat, le signe de sa présence, et c'est pourquoi les églises dites « gothiques », avec leurs vitraux, ont, à partir de l’Évêque de Saint-Denis Suger, pris le pas sur les sombres églises dites « romanes ». Mais la lumière est aussi très présente, en enfer, par la vertu des flammes.
Le choix de l'incendie comme métaphore filée s'est imposé pour décrire cette coulée humaine où tout semble se fondre. « Dans la nuit, la grotte, creusée sous la basilique, flamboie comme une fournaise; c’est de là que part l’incendie propagé par les cierges des pèlerins que l’on ne voit pas ; il semble que des étincelles sautées du fond d’un four ouvert et portées par le vent voltigent dans les lacets de la colline, qui, lentement, s’embrasent ; et les bluettes gagnent du terrain, pétillent déjà dans les arbres derrière l’abside de la basilique et atteignent, peu à peu, en tournant, le parvis, avant de descendre sur la rampe de droite, dans une indescriptible cacophonie de Laudate Mariam, de «Au ciel, au ciel! », mêlés à des cantiques de langues étrangères, tous écrasés, pourtant, par la masse pesante des Ave.
Et voici la basilique qui s’illumine du haut en bas, qui se découpe en des lignes tricolores dans l’ombre et elle paraît plus étriquée, plus chétive encore, sur le fond de ces montagnes que les ténèbres, déchirées par les coups de lumière, agrandissent. La chaufferette ronde, à couvercle, le gueux posé sous ses pieds, le toit du Rosaire, brasille avec la ferblanterie de son dôme et ses oculi rouges. Maintenant, les deux rampes sont en pleine combustion; l’on monte sur l’une et l’on descend sur l’autre; l’on dirait d’une roue de feu, couchée sur le flanc, à demi soulevée du sol, qui tourne, en crépitant, lançant, dans son mouvement giratoire, des gerbes d’étincelles. Les cierges qui grimpent se hâtent, semblent marcher, en poussant des cris de victoire, à l’assaut de la basilique ; et subitement, dans le sillage scintillant, de grands trous se font; le vent a éteint des cierges et des mouches de feu volent pour les rallumer et les trous noirs disparaissent, bouchés par des paquets de flammes !
Et cela tourne, tourne, sans arrêt, dans un vacarme d’Ave soutenu par les cuivres de la fanfare ; au loin, l’esplanade qui déborde, fait songer à une plaine dont la récolte se carbonise, à des champs d’épis en ignition; et les tiges de cette moisson qui brûle projettent un éclairage de théâtre sur les arbres des alentours dont le vert s’albumine et se décolore. »

La description se poursuit, magnifiquement, superbement, et le lecteur est aussi fasciné que le spectateur.
Le XXe siècle en a vu, des processions aux flambeaux ! Ce n'est pas ce qui a manqué dans cet âge de fer et de feu !
Au demeurant, les manifestations collectives de foi ardente, où l'individu se perd et communie avec ses proches par la famille, la résidence, ou la religion, sont très communes dans l'Histoire humaine. C'était, et c'est encore le cas dans les rites chamaniques, ou chez les aborigènes. Jünger, dans un récit de voyage au Japon dédié à Julien Gracq, a décrit ce qu'il a vu à Kiyo-Také, une ville de province, dans les environs de Nikko : « Cette danse, à laquelle n'importe qui pouvait prendre part, se mouvait dans un vaste rond-point, autour d'une chapelle en forme de tour, haute et étroite. Les musiciens qui y jouaient répétaient, des heures et des heures durant, sur des tambours voilés et un instrument au son clair, une cloche, je suppose, un simple motif de quatre notes:
ti-tin...ta-tàm.
Les danseurs et danseuses portaient des kimonos d'été à dessins en damiers et tenaient dans la main de larges chapeaux de paille tressés. Ils tournaient lentement, en mesure, chacun pour soi, brandissant parfois leur chapeau, l'ouverture tournée vers le ciel. Il pleuvait: nous nous trouvions parmi les rangs serrés des spectateurs, sous des parapluies plats de papier.
Ici, les visages, et surtout ceux des jeunes filles, se simplifiaient encore, à mesure qu'ils se rapprochaient de l'extase... »


Songeons aussi au Tatbir (photo), rituel chiite, où, dans une procession fiévreuse, à grands geste, certains exaltés se font saigner le crâne en commémoration de la mort du jeune petit-fils de Mahomet, l'imam Hussein ibn Ali, qui a été tué à la bataille de Kerbala. Les exemples sont légions. Mais ces cas supposent une divinité, ou plusieurs, des croyances, la certitude qu'un monde supra-humain existe vraiment.
Or, la fin du XIXe siècle est cette époque où Nietzsche a annoncé la mort de Dieu. C'est l'âge du nihilisme.
On peut aborder le phénomène de transe collective d'usage à Lourdes, lors des pèlerinage, de deux façons: ou l'on survalorise l'état de fusion «mystique» qui absorbe les fidèles, parfois pour leur bien (Huysmans note que certains paraissent transfigurés, et portent à leur prochain une considération qu'ils ne manifestaient sans doute pas avant de venir en ces lieux saints, et qu'ils abandonneront peut-être, sans doute, en s'en éloignant); ou l'on se concentre sur les réactions individuelles d'un personnage tel que J-K. Huysmans, d'un caractère de chien, jaloux de sa liberté comme un ermite, soucieux jusqu'à la folie de l'authenticité de l'existence, et des relations avec le monde et la vérité.
Huysmans n'a pas reçu la grâce, comme un Pascal. Il n'y a pas vraiment eu, chez lui, de nuit mystique, de Mémorial. Sa « conversion » est un long cheminement, ouvrage de sa volonté. Je ne prétends pas qu'il n'était pas «croyant»: il pensait, manifestement, que Jésus existait vraiment, comme la sainte Vierge, et que les saints, comme Sainte Lydwine de Schiedam, étaient des créatures élues de Dieu, dotées de vertus charismatiques. Mais il n'est pas un mystique, comme Saint Jean de la Croix.
Il semble plutôt avoir réagi comme un être sur la défensive, qui entend préserver une intégrité toujours mise en péril par l'action ubiquiste et dissolvante d'une modernité agressive, stupide, et obscène. De là son retranchement dans l'art (il est poète, c'est-à-dire, au sens où l'entend Roman Jakobson, soucieux au plus au point de la chair et de la peau des mots, de la phrase, du rythme, de la préciosité de la langue), dans la hantise de la beauté, dans les souvenirs éblouis du moyen-âge, de siècles où il était naturel d'être chrétien, de porter en soi un sens, qui est aussi celui, partagé, par la société, par les pouvoirs religieux et politiques. Ce sens, au moment où science et républicanisme communient dans le même culte de l'homme vernaculaire, commun, dans le dernier homme nietzschéen, il faut se le donner, le conquérir, l'arracher à un grand corps, celui de l’Église, qui vit encore quelque peu, mais dont l'on sent bien qu'il est près de l'agonie. Seule l'écriture permet de garder la tête hors de l'eau, et de pouvoir respirer. Tant bien que mal, et souvent mal.
L'un des contemporains de Huysmans, Gustave Le Bon, a écrit, en 1895, un ouvrage célèbre, La psychologie des foules, où il revient, au détour de la description du phénomène holiste de la communauté soudée en acte, sur le sujet de la préservation de l'être singulier dans un milieu oppressant où le collectif l'emporte. Il serait trop long de suivre toutes les étapes de son argumentation. Mais on peut retenir cette phrase, qui s'applique bien à Huysmans : « Les individualités qui, dans la foule, posséderaient une personnalité assez forte pour résister à la suggestion, sont en nombre trop faible pour lutter contre le courant. » Cette vérité s'applique autant à celui qui se fond dans une collectivité fusionnelle ayant pour centre une croyance forte, et comme manifestation des gestes et des sons ritualisés, que pour ce que Jünger nomme Le Rebelle, tentant d'échapper à l'effacement de son existence par l'empire du vide.
Notes:
(1) « Il faudrait, se disait-il [Durtal], garder la véracité du document, la précision du détail, la langue étoffée et nerveuse du réalisme, mais il faudrait se faire aussi puisatier d’âme et ne pas vouloir expliquer le mystère par les maladies des sens ; le roman, si cela se pouvait, devrait se diviser de lui-même en deux parts, néanmoins soudées ou plutôt confondues, comme elles le sont dans la vie, celle de l’âme, celle du corps, et s’occuper de leurs réactifs, de leurs conflits, de leur entente. Il faudrait, en un mot, suivre la grande voie si profondément creusée par Zola, mais il serait nécessaire aussi de tracer en l’air un chemin parallèle, une autre route, d’atteindre les en deçà et les après, de faire en un mot, un naturalisme spiritualiste : ce serait autrement fier, autrement complet, autrement fort ! » (ex: Là-bas. Gallimard. Folio classique, p. 30-81).

(2) « Bienheureuse Lydwine, elle obtient du Ciel la permission de souffrir pour les autres, d’alléger les malades en prenant leurs maux. »
(3) « Que de pressentiments et de signes envoyés déjà par Dieu, qu’il est grandement temps d’agir, de considérer la minute présente comme la plus importante des minutes, et de faire ma perpétuelle volupté de mon tourment ordinaire, c’est-à-dire du Travail ! » Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.
16:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, joris-karl huysmans, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, catholicisme, lourdes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 487 du Bulletin célinien
Sommaire :

Entretien avec Jean-Charles Huchet
Deux façons de citer Céline
Le Pont de Londres vu par Jules Van Erck (1964)
Roland Barthes et Céline
Dans la bibliothèque de Céline (Fables de La Fontaine René Fauchois)
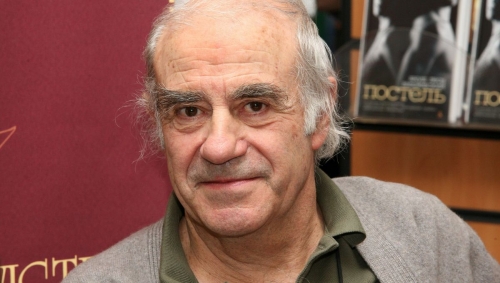
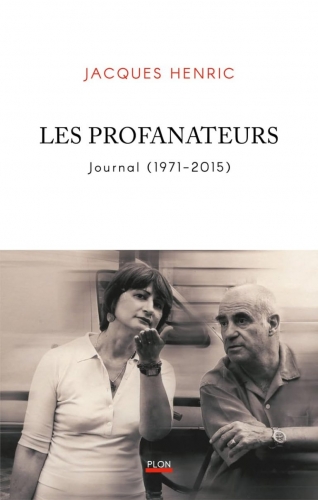
• Jacques HENRIC, Les Profanateurs. Journal (1971-2015), Plon, 2025 (30 €)
19:43 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, revue, lettres, lettres françaises, littérature française, louis-ferdinand céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
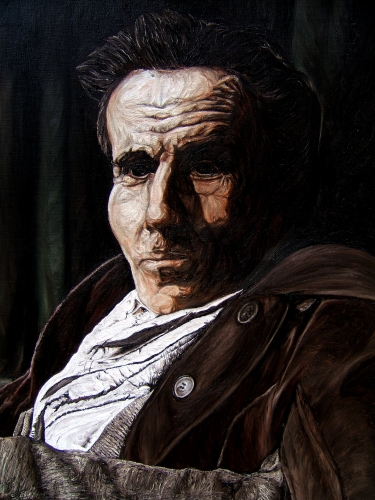
Parution du numéro 486 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Céline à Londres. Asile et évasion
Céline et Malaparte. Deux écrivains maudits dans la tourmente de la guerre
Actualité célinienne
L’abricot de Céline
À la fin de sa vie, Angelo Rinaldi (1939-2025) confiait à l’un de ses proches : « Céline, je l’ai adoré mais je ne le relis pas. Proust, c’est une autre affaire. »¹ Il est vrai que son écriture (il était aussi romancier) le rapproche du second et non du premier. Fidèle à ses origines, cet académicien proche de la gauche radicale, défendait l’écrivain Céline tout en réprouvant avec force le pamphlétaire. Au point d’écrire certaines contrevérités ou approximations le concernant. Ainsi lorsqu’il affirme que Céline fit publier une photo de Desnos afin de le dénoncer à la police allemande² Mais c’est le même qui énonçait cette profession de foi auquel tout amoureux des lettres peut souscrire : « La classification entre littérature de droite ou littérature de gauche, le célinien que je suis la récuse ».

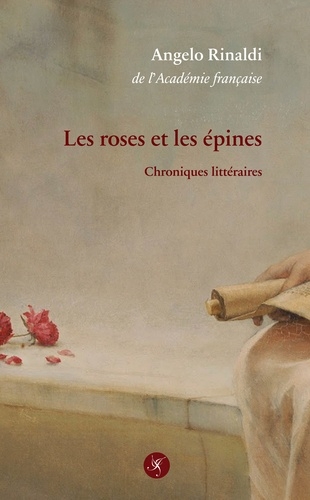
En 1992, avec Philippe Sollers et Julien Gracq, il pria le Ministre de la Culture de classer la maison de Céline comme “lieu de mémoire”³. Il se rendit également à Meudon pour y converser avec Lucette et, à la même époque, prit la défense de son mari sur un plateau de télévision en affirmant qu’il ne fallait tout de même pas le confondre avec René Bousquet. Évolua-t-il par la suite, influencé par la lecture de certains anticéliniens rabiques ? Toujours est-il que ses articles le concernant ne manquèrent pas d’irriter un célinien sourcilleux – j’ai nommé Jean-Paul Louis – qui réagit dans un article caustique4. Lequel montre, soit dit en passant, qu’il n’est pas du genre à se laisser amollir par des propos enveloppants ; lors de la première édition des Lettres à Marie Canavaggia, Rinaldi n’écrivit-il pas le plus bel éloge que ce célinien de haut vol ne récoltera jamais : « M. Jean-Paul Louis sait tout de son sujet, et presque autant de l’histoire du siècle, en général. Son admiration pour le romancier qui a changé les règles du genre n’a d’égale que sa probité. Loin de jeter sur Céline le manteau qui cachait les divagations de Noé à des fils trop respectueux, il dénude, fouille, éclaire, explique, annote avec une implacable érudition.5 »
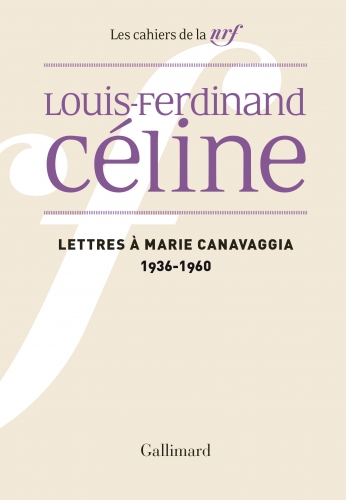
Le compliment se poursuit sur une dizaine de lignes qui saluent l’artisan-imprimeur d’excellence. Peu de temps avant la mort du critique (qui passa de L’Express au Figaro en passant par Le Point et Le Nouvel Observateur), un jeune éditeur a eu la bonne idée de republier un recueil de ses articles. Ils sont regroupés en cinq catégories : un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. On ne s’étonnera pas de voir figurer Céline dans l’avant-dernière avec Saint-Simon, Borges, Gombrowicz et Vialatte, pour ne citer qu’eux. Écoutons le à propos de la trilogie allemande : « Un trésor de sensations et de “choses vues” qui va entrer, accommodé à la sauce Dante pimentée de gouaille parigote, dans la composition d’une chronique dont D’un château l’autre, Nord et Rigodon sont les chapitres. Elle lui assurera la seule réhabilitation qu’il puisse espérer ; celle de l’écrivain. »6 L’essentiel est dit.
• Angelo RINALDI, Les roses et les épines (Chroniques littéraires), Éditions des Instants, 2025, 270 p. (21 €)
19:36 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue, angelo rinaldi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Sommaire :
 Entretien avec Alain de Benosit
Entretien avec Alain de Benosit
Retour sur l’histoire d’une enquête
Dans la bibliothèque de Céline [E1]
Céline rend-il fous ces « psys » ? La polémique enfle…
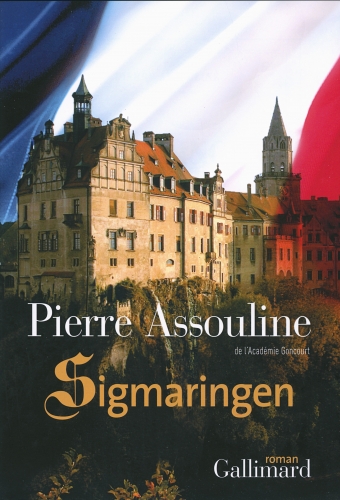
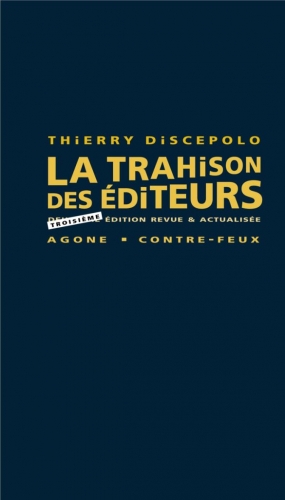
18:29 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, littérature française, letttres, lettres françaises, louis-ferdinand céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Julien Gracq et l'Occident
Claude Bourrinet
Le terme « Occident » (la majuscule confère à sa situation géographique – d'abord, pointe de l'Eurasie – et à son acception d'orientation de type astronomique, saturée de multiples sens, un espace sémantique très large, englobant la notion de « civilisation ») est rarement employé par Gracq, sinon par allusion, par exemple en citant l’ouvrage de Spengler, Le Déclin de l’Occident, qu’il juge suggestif, mais dont il ne partage pas tout à fait les thèses. Toutefois, qui lit l’intégralité de ses œuvres décèle, comme une basse continue, la question itérative du destin de l’homme occidental – sous réserve de délimiter exactement son identité, qui est multiple.
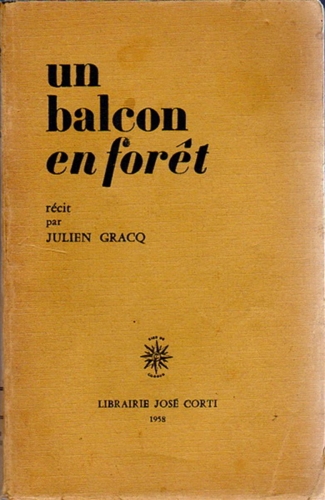
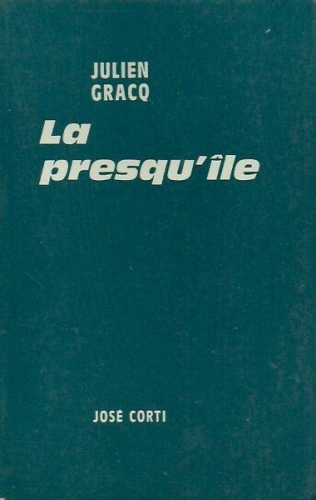
Empressons-nous de souligner que l’on ne trouvera pas, dans de longs développements charpentés, structurés, et agencés avec des concepts « clairs et distincts », une analyse de cet objet historique qu’est l’Occident. Gracq, d’ailleurs, ne se réfère à aucune doctrine, à aucune « grille de lecture » idéologique ou philosophique (bien qu’on ait « lu » Le Château d’Argol comme une application romancée de la dialectique hégélienne!). Dans ses romans se devine, mais en sourdine, et le lecteur doit interpréter la signification, une conception de l’Occident, de son déclin, et les essais, qui remplacent progressivement, puis définitivement, dans les années 60 (1958, Un Balcon en forêt, 1970, La Presqu’île), les œuvres fictionnelles, se présentent sous forme fragmentée – et il faudra expliquer ce choix, comme indice de crise - de sorte que sa vision est éclatée. Maintes fois, Gracq a répudié avec véhémence le corset étouffant de la théorie, tant dans le choix de l’écriture, que dans le champ de la littérature, ou dans la sphère politique et idéologique de la « gestion » humaine (Gracq ne raffole pas de l’État). L’inflation rationaliste et théorique est un signe clinique de civilisation en fin de vie, une sclérose hostile au souffle, à l’énergie (élément dynamique très présent dans sa conception de la littérature). Il partage cette idée avec Spengler. Notons qu’une interrogation lancinante porte sur les raisons de l’étouffement de la littérature, et l’impossibilité, dans le monde présent, de la poésie, ou plutôt du poète (car il ne peut exister de poésie si manque ce type humain qui se nomme « poète »).
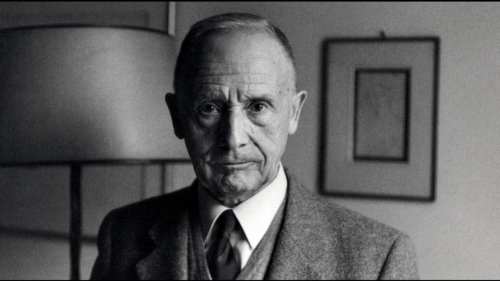
De fait, pour expliciter ce que Gracq entend par « Occident », et quelle est, selon lui, sa destinée, en regard de ce qu’il est actuellement, et ce qu’il a été, il faut opter pour une approche pragmatique, qui n’est du reste pas incompatible avec le mode opératoire, ou plutôt exploratoire, qui est le sien, quand il recourt à une errance savamment provoquée pour tirer des territoires arpentés une essence (sa « méthode » - comme on parle de méthode à propos de Descartes – étant significativement apparentée à celle d’un Kenneth White, à sa « géopoétique »). Gracq, géographe de formation, c’est-à-dire homme de cartes et de terrain, est « créateur » (selon l’étymologie de « poésie ») d’un sens qui surgit au fil de ses pas, et qui sollicite tous les territoires « culturels » occidentaux, littéraires, mythiques, plastiques, musicaux, historiques etc. A partir de cette expérience – de cette expérimentation ? – confrontation sensorielle avant tout, quasi phénoménologique, s’amorçant par une épochê faisant fi de tout pré-jugé, se dessine un portrait contrasté de l’Occident, ou plutôt de la situation d’un « Occidental » (fatalement : on vient de quelque part) en terre d’Occident (en crise). Cette « lecture » ne concerne pas seulement les essais, mais aussi les œuvres fictionnelles, ces dernières, néanmoins, étant diffractées par leur portée allégorique.
L’approche pas à pas, qui essaie de ne pas trop catégoriser les intuitions gracquiennes, respecte de surcroît le goût de Gracq pour les lectures patientes et mûries au fil des pages. Méthode herméneutique prônée par Jauss. Gracq nous y invite. Il a toujours plus ou moins blâmé les exégèses trop assurées, qui plaçaient dans des cases ses écrits.
Ce n’est pas malmener l’analyse que de dévoiler d’entrée de jeu la vision qu’a Gracq de l’Occident. Ce dernier, comme on le sait, n’est ni un révolutionnaire, ni un trancheur abstrait découpant la réalité en membres absolument circonscrits. La vie est complexe. Gracq, provincial essentiel, a ce regard circonspect des hommes du terroir. Lucide quant aux effets destructeurs, voire nihilistes, de l’Occident (et son périple assez bref, en 1970, dans le Nouveau Monde apporte matière à réflexion), il ne condamne pas brutalement la modernité, même éradicatrice (par exemple le bocage de son pays), et y voit même des avantages particuliers (l’abattage des haies, parfois, découvre de larges horizons où le regard tend – le thème de l’attente, très occidentale – Gracq était hanté par le mythe du Graal – est récurrent dans son œuvre).
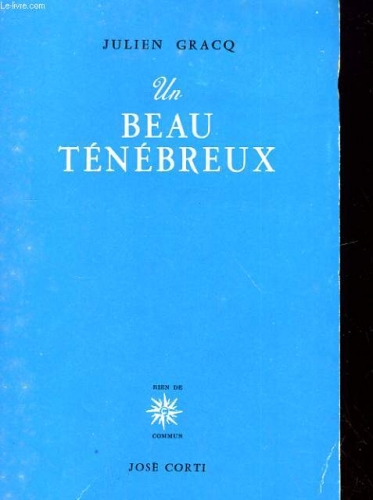
L’auteur du Beau Ténébreux – roman qui se termine par un suicide logique - est un homme sans apparente tragédie : comme l’anarque jüngérien, il trouve sa place dans un système avec lequel il n’entretient pas des affinités particulièrement chaleureuses (et il en est ainsi, par exemple, de sa « vocation » de professeur, et des distances qu’il a ménagées durant l’Occupation allemande, ne s’engageant ni dans la Collaboration, ni dans la Résistance, découvrant avec délice le roman d’un lieutenant (promu capitaine) ennemi, Jünger, et pourtant, ayant parfaitement rempli son devoir d’officier de brigade durant l’épisode de la « poche de Dunkerque », son idéal de société étant, du reste, la Venise de Tiepolo). Il n’est pourtant pas d’un autre temps (il n’éprouve aucun regret poignant de son enfance, même si ses descriptions laissent passer une certaine tendresse), mais il n’est pas pour autant du nôtre, il est, comme Nietzsche, intempestif. Il est un observateur attentif, essayant de comprendre à sa manière (qui est celle d’un poète), et de jouir de l’existence, surtout en contemplatif (ce qui suffit à le mettre en retrait d’un monde qui privilégie l’action et l’asservissement aux faits). C’est un écrivain « désengagé », mais il trouve dans une autre dimension, supérieure, un télos, une issue à une civilisation occidentale, qu’il juge, dans le fond, dévitalisée, décadente, en crise.
En effet, à mesure qu’on le lit et qu’on le relit, on s’aperçoit (et c’est ce qu’il faudra démontrer) qu’il s’efforce, plutôt que de juger, de trouver une autre voie d’assomption de l’Occident. On a déjà évoqué celle de l’errance raisonnée (comme Rimbaud cultivait le dérèglement raisonné de tous les sens), exploration qui est plus sensorielle qu’intellectuelle - more geometrico. A l’occasion de ces parcours initiatiques (l’initiation étant un concept capital, qui renoue avec les vieilles traditions européennes, d’Ulysse à Dante), il se place en situation de corps à corps avec le grain du monde, avec la roche, la terre, l’ombre et le soleil, mais aussi avec le tissu des villes et des villages. Il semble revenir, pour ainsi dire, aux expériences des « théologiens » présocratiques, qui cherchaient le logos du monde dans les transformations de la physis. Gracq est un géographe, un « scientifique », mais, comme Jünger prisait l’entomologie « esthétique » et initiatique, non celle des champions de l’éprouvette et des équations, lui est ce ces géographes qui auscultent les os et les chairs de notre pays, ou plutôt des pays, surtout ceux de France, des Causses, du Cézallier, des Landes, de Bretagne etc., en alchimiste du verbe. Il transforme le matériaux opaque, qu’il a vu à l’occasion d’une exposition sur l’Or des Incas, en or étincelant. Et, à cette aune, il sort de l’Histoire (assez pipée, selon ses critiques quasi voltairiennes) pour entrer dans un mode d’existence qui ressemble étrangement à ce que Heidegger nomme l’éclaircie de l’être, la clairière.
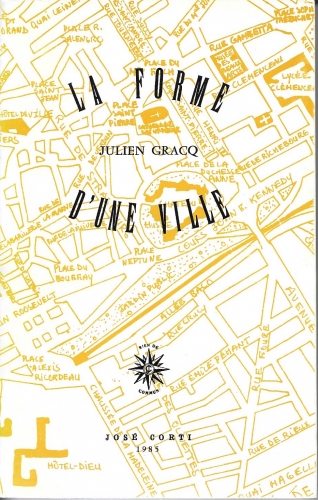
Aussi s’agit-il de distinguer deux « Occidents » (sans parler de l’Europe, dont la signification est différente, mais, encore une fois, Gracq se garde bien d’élargir ses réflexions à de larges concepts assez enivrants, pour rester dans la sphère de son expérience). Un Occident qui semble peu pourvoyeur de sens, et un autre, qu’il tente de « créer », de susciter, à la suite ou en concomitance d’autres chercheurs (ou « travailleurs », pour reprendre encore une fois une expression rimbaldienne). Ce n’est certes pas une connaissance intérieure (et l’intériorité de l’homme se doit, dorénavant, après la mise en péril de la notion même de personne, d’être justifiée – à vrai dire, cette dimension n’existait guère avant Socrate), à la manière d’un Nerval, dont il emprunte l’approche erratique, mais avec lequel il ne partage pas – ou rarement - le sentier vital du rêve (et pourtant, Gracq n’a jamais renié le surréalisme, dont il essaie de retrouver le souffle), mais une confrontation extérieure, susceptible de modeler un autre homme, contemplatif, attiré par la beauté et l’éclair du monde, pour ainsi dire une nouvelle gnose. Le parallèle avec Jünger, paraît séduisant, auquel il faut cependant retirer toute la portée mystique et divine (Gracq n’éprouvant aucune dilection pour les mystères sacrés).
Pour autant, Gracq, comme Jünger (et c’est un trait qui contredit la logique « démocratique » - au sens littéral – de l’Occident moderne, y compris dans les régime « totalitaires », fascistes ou communistes), ne placent leur foi que dans l’existence d’une élite, ou, tel un Stendhal scrutant un avenir prochain (soit 1880, ou 1930), dans l’émersion de la masse liquéfiée, ou de l’oubli mémoriel, d’ un cercle de happy few capable de retrouver la Lettre.
12:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, claude bourrinet, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
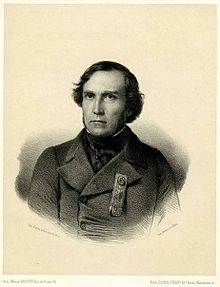
Gustave de Beaumont et le féminisme américain
Nicolas Bonnal
Le féminisme américain est le mieux équipé et le plus dangereux du monde. La victoire de Trump l'a empêché de mettre fin à la question sexuelle (dixit Philippe Muray) qui est son obsession depuis des lustres. Abolir l’homme et la femme au passage est son rêve. Après il faut mener une croisade d’extermination à travers le monde. Comme disait la candidate démocrate: abortion ! Ce serait comique si l’industrie éducative et tous les médias occidentaux n’étaient obsessionnellement aussi AUX ORDRES.
Tant pis, on y passera.
Rappelons Todd encore :
« Le conflit entre le monde anglo-saxon et le monde arabo-musulman est profond. Et il y a pire que les prises de position féministes de Mmes Bush et Blair concernant les femmes afghanes. L'anthropologie sociale ou culturelle anglo-saxonne laisse apparaître quelques signes de dégénérescence (…). Si une science se met à distribuer des bons et des mauvais points, comment attendre de la sérénité de la part des gouvernements et des armées ? ».
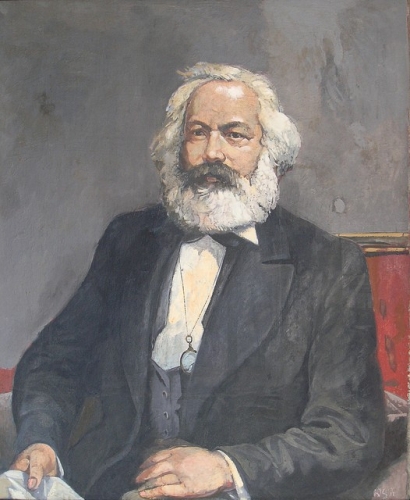 J’ai déjà cité le compagnon de voyage de Tocqueville qui passionne plus Karl Marx que Tocqueville ! Dans sa célèbre étude sur la question juive le grand Karl cite le passage suivant (c’est comme ça que j’ai découvert Beaumont) :
J’ai déjà cité le compagnon de voyage de Tocqueville qui passionne plus Karl Marx que Tocqueville ! Dans sa célèbre étude sur la question juive le grand Karl cite le passage suivant (c’est comme ça que j’ai découvert Beaumont) :
« …tout individu peut, sans aucune préparation ni étude préalable, se faire homme d'église. Le ministère religieux devient une carrière dans laquelle on entre à tout âge, dans toute position et selon les circonstances.
Tel que vous voyez à la tête d'une congrégation respectable a commencé par être marchand ; son commerce étant tombé, il s'est fait ministre ; cet autre a débuté par le sacerdoce, mais dès qu'il a eu quelque somme d'argent à sa disposition, il a laissé la chaire pour le négoce. Aux yeux d'un grand nombre, le ministère religieux est une véritable carrière industrielle. »
Mais Beaumont est un humaniste progressiste et il voit la vérole partout dans la vieille civilisation ; voici ce qu’il raconte (au sens propre) à propos du mariage à l’européenne, à la française notamment, qui débouche sur le cocuage (on le savait depuis Molière…) :
« En Europe, dit le voyageur, tout est souillure et corruption !... Les femmes y sont assez viles pour se vendre, et les hommes assez stupides pour les acheter. Quand une jeune fille prend un mari, ce n'est pas une âme tendre qu'elle cherche pour unir à la sienne, ce n'est pas un appui qu'elle invoque pour soutenir sa faiblesse ; elle épouse des diamants, un rang, la liberté : non qu'elle soit sans cœur ; une fois elle aima, mais celui qu'elle préférait n'était pas assez riche. On l'a marchandée ; on ne tenait plus qu'à une voiture, et le marché a manqué.
Alors on a dit à la jeune fille que l'amour était folie ; elle l'a cru, et s'est corrigée ; elle épouse un riche idiot... Quand elle a quelque peu d'âme, elle se consume et meurt. Communément elle vit heureuse. Telle n'est point la vie d'une femme en Amérique. Ici le mariage n'est point un trafic, ni l'amour une marchandise ; deux êtres ne sont point condamnés à s'aimer ou à se haïr parce qu'ils sont unis, ils s'unissent parce qu'ils s'aiment. »
Mais venons-en à la femme américaine :
« Le trait le plus frappant dans les femmes d'Amérique, c'est leur supériorité sur les hommes du même pays. »
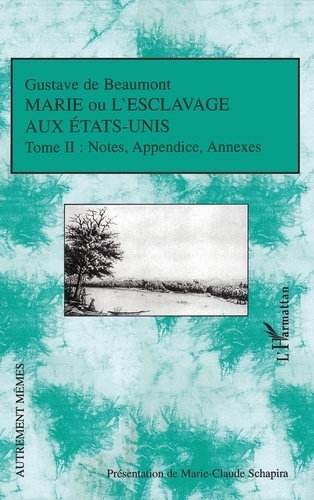 Beaumont va opposer le matérialisme masculin à l’idéalisme féminin (qui va déboucher sur un féminisme éradicateur) :
Beaumont va opposer le matérialisme masculin à l’idéalisme féminin (qui va déboucher sur un féminisme éradicateur) :
« L'Américain, dès l'âge le plus tendre, est livré aux affaires: à peine sait-il lire et écrire qu'il devient commerçant ; le premier son qui frappe son oreille est celui de l'argent ; la première voix qu'il entend, c'est celle de l'intérêt ; il respire en naissant une atmosphère industrielle, et toutes ses premières impressions lui persuadent que la vie des affaires est la seule qui convienne à l'homme.
Le sort de la jeune fille n'est point le même ; son éducation morale dure jusqu'au jour où elle se marie. Elle acquiert des connaissances en histoire, en littérature ; elle apprend, en général, une langue étrangère (ordinairement le français) ; elle sait un peu de musique. Sa vie est intellectuelle ».
Le mariage US n’est pas un rêve du tout :
« Ce jeune homme et cette jeune fille si dissemblables s'unissent un jour par le mariage. Le premier, suivant le cours de ses habitudes, passe son temps à la banque ou dans son magasin; la seconde, qui tombe dans l'isolement le jour où elle prend un époux, compare la vie réelle qui lui est échue à l'existence qu'elle avait rêvée. Comme rien dans ce monde nouveau qui s'offre à elle ne parle à son cœur, elle se nourrit de chimères, et lit des romans. Ayant peu de bonheur, elle est très religieuse, et lit des sermons. Quand elle a des enfants, elle vit près d'eux, les soigne et les caresse ».
Sans télé et sans frigo, on en est déjà au couple QUI NE SE PARLE PAS (vive Ionesco finalement…) :
« Ainsi se passent ses jours. Le soir, l'Américain rentre chez lui, soucieux, inquiet, accablé de fatigue; il apporte à sa femme le fruit de son travail, et rêve déjà aux spéculations du lendemain. Il demande le dîner, et ne profère plus une seule parole; sa femme ne sait rien des affaires qui le préoccupent; en présence de son mari, elle ne cesse pas d'être isolée. L'aspect de sa femme et de ses enfants n'arrache point l'Américain au monde positif, et il est si rare qu'il leur donne une marque de tendresse et d'affection, qu'on donne un sobriquet aux ménages dans lesquels le mari, après une absence, embrasse sa femme et ses enfants; on les appelle the kissing families… ».
L’Américaine est plus philosophe et aussi plus manipulatrice et éveillée que la Française. Victorien Sardou, idole et modèle oublié de Hitchcock (voyez mon livre sur la femme chez Hitchcock) l’a génialement montré dans son théâtre. Gare aux belles Américaines !
Beaumont sur ces différences (la Française va rattraper son retard, revoyez la scène d’A bout de souffle avec Melville-Parvulesco…) :
« En France, une jeune fille demeure, jusqu'à ce qu'elle se marie, à l'ombre de ses parents: elle repose paisible et sans défiance, parce qu'elle a près d'elle une tendre sollicitude qui veille et ne s'endort jamais; dispensée de réfléchir, tandis que quelqu'un pense pour elle; faisant ce que fait sa mère; joyeuse ou triste comme celle-ci, elle n'est jamais en avant de la vie, elle en suit le courant: telle la faible liane, attachée au rameau qui la protège, en reçoit les violentes secousses ou les doux balancements. »
L’Américaine est libre donc éveillée :
« En Amérique, elle est libre avant d'être adolescente ; n'ayant d'autre guide qu'elle-même, elle marche comme à l'aventure dans des voies inconnues. Ses premiers pas sont les moins dangereux ; l'enfance traverse la vie comme une barque fragile se joue sans périls sur une mer sans écueils. »
La raison devient une arme féminine :
« Mais quand arrive la vague orageuse des passions du jeune âge, que va devenir ce frêle esquif avec ses voiles qui se gonflent, et son pilote sans expérience ?
L'éducation américaine pare à ce danger: la jeune fille reçoit de bonne heure la révélation des embûches qu'elle trouvera sur ses pas. Ses instincts la défendraient mal: on la place sous la sauvegarde de sa raison; ainsi éclairée sur les pièges qui l'environnent, elle n'a qu'elle seule pour les éviter. La prudence ne lui manque jamais. »
Ceci dit après le grand amour la condition féminine est à désespérer (revoyez les Oiseaux en ce sens, l’extraordinaire personnage de Susan Pleshette):
« Aux yeux de l'Américain, la femme n'est pas une compagne, c'est une associée qui l'aide à dépenser, pour son bien-être et son confort, l'argent gagné par lui dans le commerce.
La vie sédentaire et retirée des femmes, aux États-Unis, explique, avec les rigueurs du climat, la faiblesse de leur complexion ; elles ne sortent point du logis, ne prennent aucun exercice, vivent d'une nourriture légère ; presque toutes ont un grand nombre d'enfants ; il ne faut pas s'étonner si elles vieillissent si vite et meurent si jeunes.
Telle est cette vie de contraste, agitée, aventureuse, presque fébrile pour l'homme, triste et monotone pour la femme ; elle s'écoule ainsi uniforme jusqu'au jour où le mari annonce à sa femme qu'ils ont fait banqueroute ; alors il faut partir, et l'on va recommencer ailleurs la même existence. »
Cela produit des caractères d’airain et républicains :
« Cette liberté précoce donne à ses réflexions un tour sérieux, et imprime quelque chose de mâle à son caractère. Je me rappelle avoir entendu une jeune fille de douze ans traiter dans une conversation et résoudre cette grande question : « Quel est de tous les gouvernements celui qui de sa nature est le meilleur ? » -- Elle plaçait la république au-dessus de tous les autres…. ».

Voyez la fillette des Oiseaux toujours, jouée par la géniale Veronica Cartwright (Alien, les Sorcières d’Eastwick…) : elle défie les codes et attaque le modèle démocratique !
Le mariage est plus une prison en Amérique qu’en France:
« En Amérique, cette liberté, sitôt donnée à la femme, lui est tout-à-coup ravie. Chez nous, la jeune fille passe des langes de l'enfance dans les liens du mariage; mais ces nouvelles chaînes lui sont légères. En prenant un mari, elle gagne le droit de se donner au monde; elle devient libre en s'engageant. Alors commencent pour elle les fêtes, les plaisirs, les succès. En Amérique, au contraire, la vie brillante est à la jeune fille; en se mariant, elle meurt aux joies mondaines pour vivre dans les devoirs austères du foyer domestique. »
Beaumont souligne la vertu de la femme américaine, moins entraînée à la bagatelle que la française pour des raisons diverses qui n’ont rien à voir avec le puritanisme dénoncé par tous nos ilotes :
« En Amérique, tout le monde travaille, parce que nul n'apporte en naissant de grandes richesses, et l'on n'y connaît point la funeste oisiveté des garnisons, parce que ce pays n'a point d'armée.
Les femmes échappent ainsi aux périls de la séduction: si elles sont pures, on ne saurait dire qu'elles sont vertueuses; car elles ne sont point attaquées.
Il est d'ailleurs un élément de corruption, puissant dans les sociétés d'Europe, et qui ne se rencontre point aux États-Unis: ce sont les oisifs nés avec une grande fortune, et les militaires en garnison. Ces riches sans profession et ces soldats sans gloire n'ont rien à faire: leur seul passe-temps est de corrompre les femmes… ».
Prude, cultivée, pessimiste, la femme US est une dangereuse machine de guerre humanitaire qui va se déchaîner lors de la guerre de Sécession (et avant bien sûr).
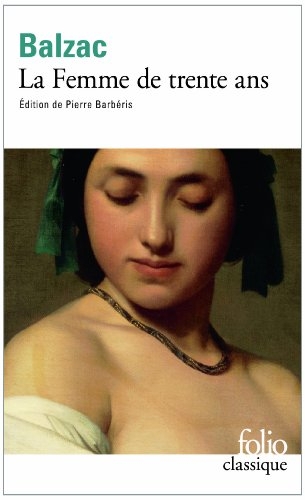 On se consolera avec notre Balzac qui écrit dans la Femme de trente ans :
On se consolera avec notre Balzac qui écrit dans la Femme de trente ans :
« Vous honnissez de pauvres créatures qui se vendent pour quelques écus à un homme qui passe, la faim et le besoin absolvent ces unions éphémères; tandis que la société tolère, encourage l’union immédiate bien autrement horrible d’une jeune fille candide et d’un homme qu’elle n’a pas vu trois mois durant; elle est vendue pour toute sa vie. Il est vrai que le prix est élevé ! «.
Le mâle blanc était mal parti…
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victorien_Sardou
https://classiques.uqam.ca/classiques/beaumont_gustave_de...
https://www.amazon.fr/Hitchcock-femmes-Nicolas-Bonnal/dp/...
https://www.dedefensa.org/article/le-feminisme-us-par-del...
https://www.dedefensa.org/article/balzac-et-la-rebellion-...
11:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave de beaumont, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, féminisme, féminisme américain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
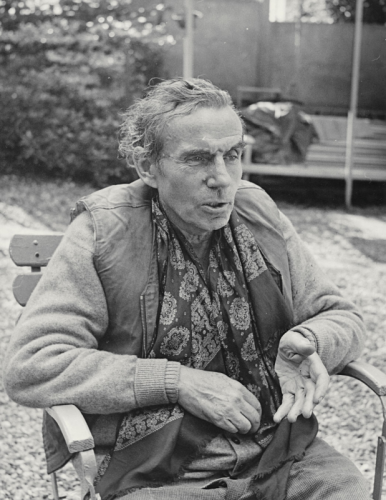
Parution du numéro 484 du Bulletin célinien
Sommaire :
 De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)
De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)
Dans la bibliothèque de Céline (D / 1)

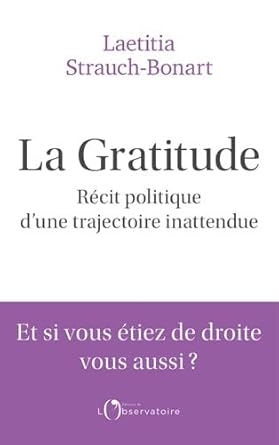
• Laetitia STAUCH-BONART, La Gratitude (Récit d’une trajectoire politique inattendue), Éditions L’Observatoire, 240 p. (21 €). Voir aussi son entretien avec Jean Birnbaum dans le dossier du Monde des livres, “D’une tendance à l’égarement chez les intellectuels” (n° 24975, 18 avril 2025). Chez le même éditeur : Samuel FITOUSSI, Pourquoi les intellectuels se trompent, 272 p. (22 €).
11:12 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Brasillach et les souvenirs de la vie transfigurée
par Frédéric Andreu
La magie de l'œuvre de Brasillach tient sans doute au fait qu'elle vient éclairer en nous le matin profond de notre mémoire. Tout se passe comme si les personnages des romans de Brasillach restent assez flou, assez peu précis pour que nous puissions les faire nôtres. Les intégrer à notre étymologie intime.
L'œuvre de Brasillach agit par "attouchements", non par argumentations ; elle ne prouve rien, mais fait éprouver. C'est pourquoi le ressort intime de Brasillach est la nostalgie, notamment de l'enfance.
L'existence d'un "monde auroral" relève aussi de cette beauté à partir de laquelle le sentiment du beau nous apparaît. Martin Heidegger dit que si une chose est belle, elle l'est encore plus à sa naissance. Sans doute que cette proposition philosophique nous aide un peu à mieux apercevoir, sans trop être ébloui par lui, ce mystère auroral qui rode, telle une aura, autour de l'œuvre de Robert Brasillach.
Mais il est encore une autre manière de situer les choses. Un autre octave.

Nous connaissons tous la nostalgie qui nait en nous devant un beau coucher de soleil. Je pense que celle-ci ne pourrait pas naître en nous sans l'existence d'"un soleil qui ne se couche jamais", un astre qui éclaire un monde radicalement différent du nôtre et qui se tient en marge du nôtre tel que l'infra-rouge et l'ultraviolet se tiennent en marge du spectre des couleurs.
L'aurore et le crépuscule, expressions de la dialectique du monde, seraient le reflet brisé d'un autre soleil littéraire, unitaire et merveilleux, qui, lui, ne se couche jamais.
Ce soleil éclairerait un univers où le drame de la vie et de la mort, du soi et des autres, du laid et du beau n'auraient pas lieu. En d'autres termes, une réalité non-dialectique.
Pour être d'essence métaphysique, ce monde n'est pour autant pas posé sur un nuage. Il n'a rien à voir avec une de ses promesses de libération sous "bonne conduite" telle qu'on en trouve dans le catéchisme des religions cléricales. Ce salut là est en l'Homme. Inscrit dans le secret du coeur, dans l'"Immédiatement" (pour reprendre le titre d'un ouvrage de Dominique de Roux) de la vie intime. C'est à dire sans médiation (mécanique, cléricale ou encore conceptuelle). Il est fait pour les vivants, pas pour les morts. Pour les émerveillés et pas forcement pour les ascètes et les fous de Dieu. "Le surnaturel n'est rien d'autre que le naturel dévoilé" nous rappelle Émilie Dickinson. Tel est exactement le sens de mon propos.

Dans les conceptions anciennes du monde dont les mythologies sont les vestiges, l'univers était perçue comme épiphanie d'un monde parfait. Le monde était perçu comme un "reflet" d'un autre monde. Il semble que le Dieu unique "cause première" des philosophes nous maintienne à distance de ce dévoilement suprême. Qu'il a ouvert dans notre culture comme une sorte de "fausse fenêtre" qui nous empêche de voir le monde comme le projet même de sa propre transfiguration en nous enfermant dans un théâtre neuronal. D'éminents penseurs considèrent même que la théologie chrétienne contiendrait le germe de ce processus de désenchantement du monde.
Je ne sais que penser de cette affirmation peut être un peu péremptoire. Comme peut être péremptoire aussi l'idée que cette fausse fenêtre sert en définitive les intérêts de pouvoirs oligarchiques.
Tout cela relève de l'excès. Qu'une religion contienne un dispositif est certes une chose démontrée depuis Agamben, mais affirmer que la série des religions, doctrines et universalismes philosophiques d'essence biblique serviraient in fini un dispositif oligarchique tient sans doute du complotisme.
Mais il y a plus que cela. Le monde transfigurique dont le légendaire brasillachien contiendrait une sorte de "reliquat", nous est devenu étranger car nous ne le pensons plus par rapport à une société de type organique. L'organique peut encore avoir l'intuition du trans-organique, source de nos religions natives et du matin profond de notre âme européenne.

La société de type mécanique qui est la nôtre, de plus en plus réduite à une société d' "individus" atomisés où l'individualisme est la règle, est incapable de penser autre chose que l'individu et l'économie. Elle ne peut donc comprendre qu'elle fut d'abord transorganique avant de devenir organique, puis enfin mécanique. Elle n'a aucune intuition de sa chute. Il n'y en que dans les lisières dorées de notre compréhension ordinaire que l'on peut comprendre que le souvenir d'un beau moment de notre enfance est un reflet d'une nostalgie d'un niveau plus fondamentale de l'être, la nostalgie d'un monde non déchu, ce "royaume qui n'est pas de ce monde" annoncé par Jésus-Christ à Ponce Pilate.
La société de type mécanique, globalisée, métissée de force, entame aujourd'hui sa phase de décomposition cadavérique. Elle est trop absente à elle-même, trop individuo-centrée pour parvenir à produire autre chose que des expériences du grand laboratoire économique.
Pays où ces sciences exactes sont reines, la France m'apparaît en outre celui où le système de gouvernement est le plus mécanique du monde. La république centralisatrice est pour moi celui qui est parvenu le plus à éradiquer les nappes phréatiques de la vie réelle. Ce système importé des Etats-Unis a érigé une fausse fenêtre, les droits de l'homme abstrait, en dogme. Deux cents ans après son arraisonnement du continent européen par sa face ouest (la France) le laïcisme, le droitdelhommisme révèlent aujourd'hui ce pourquoi il a été fondé : promouvoir ouvertement le mélange des races, le melting-pot au profit d'un petite caste de nantis, qui elle, ne se métisse pas.
La société mécanique et conflictuelle qu'elle est en voie de créer rend la société sourde et aveugle au monde trans-organique. Elle a été crée pour cela. Pour nous transformer en anesthésistes-anesthésiés. En consommateurs-producteurs incapables de nostalgie. Ce n'est pas un hasard si les "contes merveilleux" tel que Cendrillon ou Blanche Neige et les Sept Nains sont des récits aujourd'hui réservés à la prime enfance.

Lorsque les frères Grimm parcouraient les campagnes de la Thuringe entre 1800 et 1815, ces contes étaient encore, dans certaines vallées transmis à toute la communauté et non aux enfants. Ils étaient transmis comme des contes initiatiques et non de vulgaires superstitions. A noter qu'en 1945, les forces d'occupation alliées interdirent la publication des contes de Grimm invoquant la violence qu'ils contiendraient. Il est sûr que les forces qui écrasèrent des millions de citoyens sans défense sous des tapis de bombes, avaient eut le culot de désigner quelques légendes comme responsables de violence.
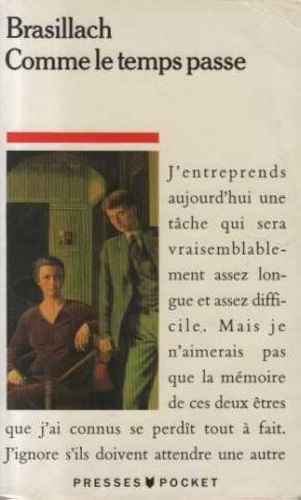
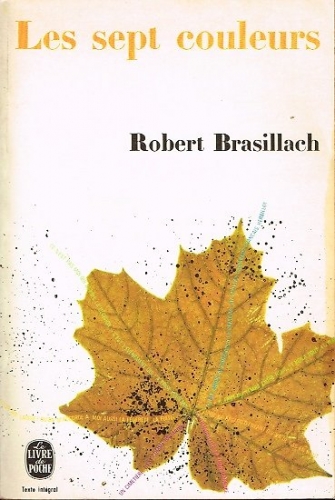
Dans le roman Comme le temps passe, Brasillach n'est pas loin de ce "matin profond" de notre conscience quand il intuitionne qu'"il y eut un temps les animaux parlaient aux hommes". Il évoque ce merveilleux des contes où les grenouilles parlent aux princesses.
De tels passages, étrangers à toute emprise théorique, ne sont pas rares chez Brasillach. Dans les Sept Couleurs (autre roman de Brasillach), la rencontre entre le réel et le suréel éclate au grand jour. Au début du récit, Catherine et son compagnon visitent un cimetière situé dans un ville parisienne, Charonne. Lorsqu'ils rencontrent de manière totalement inopinée, leur "double légendaire"... Ceux ci les surprend en train de lire l'épitaphe d'une tombe. Il n'est peut être pas un hasard si cette tombe est celle du secrétaire de Robespierre.
Les deux protagonistes essayent de déchiffrer les inscriptions de cette tombe lorsqu'un petit garçon les accoste.
Lecteurs ! comment mieux faire résonner ensemble l'histoire et le légendaire ? Sinon en organisant la rencontre de la froideur de l'historique la plus guillotinante qui soit (une tombe, en lien avec Robespierre) avec le "petit garçon de la légende".
Évidement, tant que nous croyons que le monde des fées et des princesses est issu de l'imaginaire comme si l'imagination était la folle du logis, nous n'avons aucune chance de comprendre l'importance crucial de l'œuvre de Brasillach.
C'est à peine si l'auteur de cette oeuvre peut à la rigueur servir de bannière de ralliement afin se s'opposer symboliquement à des groupuscules qui s'en servent, eux, généralement sans l'avoir lu, à un épouvantail idéologique. Il vaut mieux faire parti des premiers que des seconds, mais il faut mieux encore garder à l'esprit que ce bas-monde des oppositions contradictoires n'existent que par rapport à leur "transfiguration".
Le monde merveilleux des légendes que Brasillach fait miroiter dans nos yeux de lecteurs n'est pas qu'un simple carré de sable pour enfant. Il pourrait bien contenir les balises vivantes conduisant à un autre monde. Cette promesse que l'univers physique n'existe qu'en vue de sa transfiguration. Cette révolution là est la moins sanglante du monde.
Frédéric Andreu.
16:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : robert brasillach, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
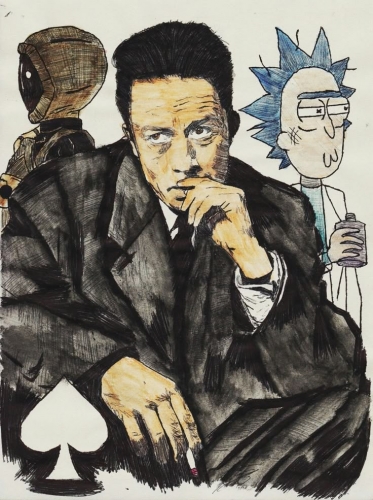
Albert Camus et la prostration du Français
Nicolas Bonnal
On sait que Camus aura beaucoup souffert du carcan scolaire. Le redécouvrir c’est le lire en oubliant le fatras idéologique (Résistance, Vichy, décolonisation, communisme, absurde…) qui l’accompagne, certes en le remettant aussi à sa modeste – modeste mais indispensable - place. Car il ne faut pas oublier que sa mort accidentelle aura arrangé tout le monde, surtout à gauche. Certains le voyaient mal tourner alors.
J’ai eu comme ça un besoin de relecture étant resté sur des souvenirs lumineux et surpris (on se doute qu’il n’était pas a priori ma tasse de thé). Mais en le triangulant avec le roman noir américain (même froideur glaciale, même prison de fer que chez Chandler), avec Céline et avec les réflexions du maître communiste Henri Lefebvre, inspirateur de Debord et découvreur de la vie ordinaire qui allait décapiter tous les mouvements politiques (car quel mouvement politique voudrait nous en arracher à cette vie ordinaire ?) ; en relisant d’une manière behaviouriste L’Etranger par exemple, en le considérant comme un documentaire social et non comme une « allégorie » (les pages de Wikipédia sont ridicules, abjectes même) et en se rappelant que notre bon esprit fut surtout un découvreur de Dostoïevski, on arrive à de curieuses observations.

Rappelons au passage que si Visconti a raté l’adaptation cinéma de L’Etranger, il a très bien réussi celle de D’Annunzio (L’Innocent est son chef-d’œuvre), ou celle des Nuits blanches de Dostoïevski, ce qui montre que n’importe quel maître du dix-neuvième siècle est plus présent, moderne et contemporain que toutes les babioles du vingtième siècle.
Je n’ai pas trop envie de reprendre le lien entre La Peste et le Covid. Il est déjà trop éculé et trop évident, même si La Peste annonce et décrit le pouvoir moderne et la banalité de son mal et de ses méthodes qui ont été vues par Jouvenel à la même époque (que L’Etranger) dans ses analyses sur la démocratie totalitaire.
Mais prenons le début tout de même; c’est ce Camus célinien qui me surprend:
« Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat, tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. »
Comparons ici :
« Au lit ils enlevaient leurs lunettes d’abord et leurs râteliers ensuite dans un verre et plaçaient le tout en évidence. Ils n’avaient pas l’air de se parler entre eux, entre sexes, tout à fait comme dans la rue. On aurait dit des grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s’ennuyer… »
Le style de Céline reste incomparable mais l’effet est le même.
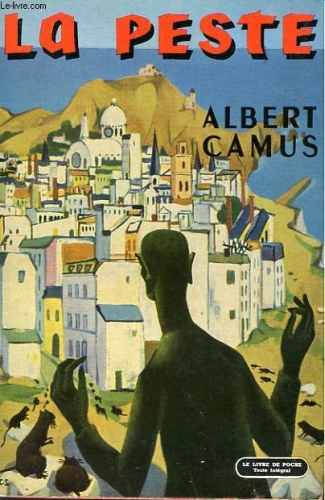
Impitoyable, Camus observe aussi – toujours au début de La Peste donc :
« Mais, très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leurs bureaux, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leurs balcons. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard des cartes. »
La suite résonne comme du Henri de Man :
« On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme tous nos contemporains sont ainsi. »
La banalité du mal moderne se manifeste partout :
« Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficultés aussitôt qu'on a des habitudes. »

La presse, l’information ? On lit ceci plus loin :
« Les journaux, naturellement, obéissaient à la consigne d'optimisme à tout prix qu'ils avaient reçues. À les lire, ce qui caractérisait la situation, c'était « l'exemple émouvant de calme et de sang-froid » que donnait la population. »
La presse n’est là que pour programmer sur ordre. Dont acte.
Les crétins font donc de La Peste un produit allégorique sur Vichy et la Shoah. En réalité on est plus proche d’Ionesco-Beckett, de ce désespoir, devant la vie et les hommes modernes, qui a saisi les écrivains au lendemain de la seconde guerre mondiale: et Camus finit par douter de la réalité des hommes qui l’entourent. On est ici au début – début épouvantable – de L’Etranger, quand il veille notre héros (meurt et sot comme racines) le cadavre de sa mère (il n’est donc pas si abominable que cela, il est prostré et fatigué de réagir, comme le froncé sous Macron) :
« Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne et pas un détail de leurs visages ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. »
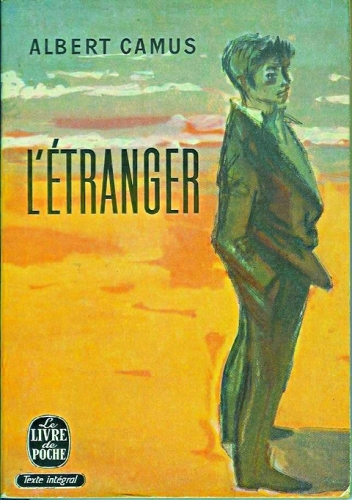
En fait avant la télé déjà l’homme moderne ou pour parler comme l’extraordinaire Roderick Seidinger l’homme post-historique doute de la réalité de son prochain, avant même qu’il ne lui parvienne plus que par écran interposé (voyez mon texte sur Nizan et le bourgeois) !
Il fait des observations prosaïques mais objectives notre "étranger":
« Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leurs visages, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. »
Retour au boulot avec l’impeccable patron:
« En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes deux jours de congé: c'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi quatre jours de vacances avec mon dimanche et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. »
Atmosphère de gendarmerie… Courteline est passé par là il est vrai… O bureaucratie, ô républiques !
Puis L’Etranger retrouve sa jolie fille, d’ailleurs espagnole, comme tant de gens à Oran et ailleurs. Au lieu de venir râler toute leur vie en République, certains pieds noirs auraient mieux fait de s’y rendre et d’y vivre en Espagne, même « franquiste » ! Bazar politique à part c’était le pays le plus libre et le plus heureux du monde, le moins taxé aussi (il y a des restes…). Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur dans un pays où les partis politiques sont interdits. Pas de parti socialiste, communiste, conservateur, républicain, catho, crétin-démocrate, euro-féministe écologiste, national-sioniste ou populiste…

Et ici on découvre une évidence rappelée par Revel dans ses très bonnes Mémoires (le Voleur dans la maison vide) : chaque génération croit avoir inventé la révolution sexuelle. En réalité on se croirait dans les années soixante-dix (les présumées libératoires qui imposèrent surtout avortement, féminisme, implosion familiale) et comment :
« J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque.
Elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après et nous n'avons pas eu le temps. Je l'ai aidée à monter sur une bouée et, dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et, comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. »
Après on est plus vie ordinaire que jamais (et alors, René Guénon ? C’est un crime ?), et on parle bronzette et cinoche :
« Sur le quai, pendant que nous nous séchions, elle m'a dit : « Je suis plus brune que vous. » Je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma, le soir. Elle a encore ri et m'a dit qu'elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l'air très surprise de me voir avec une cravate noire et elle m'a demandé si j'étais en deuil. »
Atterrissage en douceur mais atterrissage quand même :
« Je lui ai dit que maman était morte. Comme elle voulait savoir depuis quand, j'ai répondu : « Depuis hier. » Elle a eu un petit recul, mais n'a fait aucune remarque. »
Rappelons comme ça en passant les faux scandales liés à la canicule de 2004. Survient la fameuse après-midi sans télé passée à ne rien foutre donc et à mater la rue du balcon puisqu’il n’y a pas de télé :
« J'ai pensé qu'ils allaient aux cinémas du centre. C'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. »
Là on est dans Guy Debord !
Paragraphe premier du légendaire opus :
« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans la représentation. »
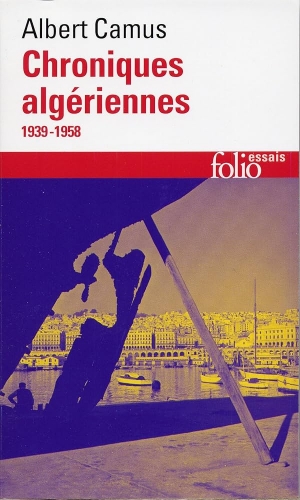
Et comme dit le cinéphile Céline (Le Voyage, toujours), étranger à New York :
« Nous sommes, par nature, si futiles, que seules les distractions peuvent nous empêcher vraiment de mourir. Je m’accrochais pour mon compte au cinéma avec une ferveur désespérée. »
Ensuite il y a le sport et ses supporters :
« À cinq heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et, les rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j'ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à pleins poumons que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes. L'un m'a même crié : « On les a eus. » Et j'ai fait : « Oui », en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer. »
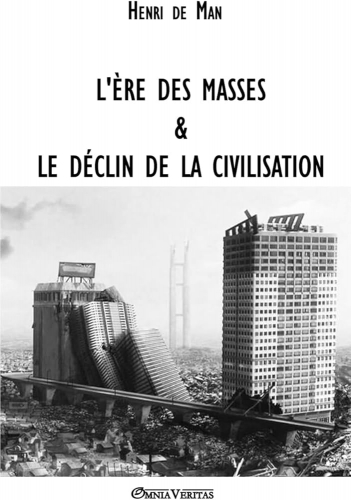
Petite piqure de rappel avec Henri de Man :
« De Man voit aussi l’homogénéisation frapper les esprits grâce aux médias de masse et à l’adoration du sport ou du people. Il parle de sa vision de pavillons de banlieue et leur audition, à ces habitants qu’il croyait bien logés, d’une seule émission :
Tous les habitants de ces maisons particulières écoutaient en même temps la même retransmission. Je fus pris de cette angoisse… Aujourd’hui ce sont les informations qui jouent ce rôle par la manière dont elles sont choisies et présentées, par la répétition constante des mêmes formules et surtout par la force suggestive concentrée dans les titres et les manchettes. »
Retour à Camus. Le troupeau rentre de la promenade et du spectacle :
« La journée a tourné encore un peu. Au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre et, avec le soir naissant, les rues se sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventures. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus graves. »
Après le sport, un peu de cul comme on disait jadis :
« Quand nous nous sommes rhabillés sur la plage, Marie me regardait avec des yeux brillants. Je l'ai embrassée. À partir de ce moment, nous n'avons plus parlé. Je l'ai tenue contre moi et nous avons été pressés de trouver un autobus, de rentrer, d'aller chez moi et de nous jeter sur mon lit. J'avais laissé ma fenêtre ouverte et c'était bon de sentir la nuit d'été couler sur nos corps bruns. »
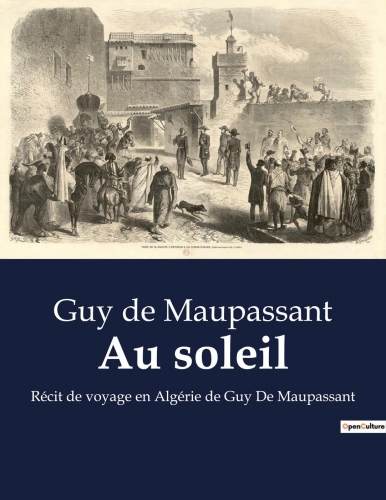
Maupassant parlait déjà de cette libération sexuelle en Algérie. Et de ce peu de futur aussi qui nous y attendait :
« Et je pensais à ce peuple vaincu au milieu duquel nous campons ou plutôt qui campe au milieu de nous, dont nous commençons à parler la langue, que nous voyons vivre chaque jour sous la toile transparente de ses tentes, à qui nous imposons nos lois, nos règlements et nos coutumes, et dont nous ignorons tout, mais tout, entendez-vous, comme si nous n’étions pas là, uniquement occupés à le regarder depuis bientôt soixante ans…. »
L’Etranger comme métaphore du froncé qui campe ?
Camus a parlé de ces vieux sans réalité, et Maupassant de ces colonisateurs qui ne sont pas là, « comme si nous n’étions pas là… ». J’ai eu cette sensation partout où j’ai vu la « présence française » en voyageant… Ne polémiquons pas.
Mais continuons, comme dirait Sartre :
« Quand elle a ri, j'ai eu encore envie d'elle. Un moment après, elle m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non. Elle a eu l'air triste. Mais en préparant le déjeuner, et à propos de rien, elle a encore ri de telle façon que je l'ai embrassée. C'est à ce moment que les bruits d'une dispute ont éclaté chez Raymond. »
Comme on sait le Raymond en question est encore plus obsédé sexuel que notre meurt-sot et c’est son obsession pour les filles arabes battues qui va amener le drame.
« Mais Raymond m'a demandé d'attendre et il m'a dit qu'il aurait pu me transmettre cette invitation le soir, mais qu'il voulait m'avertir d'autre chose. Il avait été suivi toute la journée par un groupe d'Arabes parmi lesquels se trouvait le frère de son ancienne maîtresse. « Si tu le vois près de la maison ce soir en rentrant, avertis-moi. » J'ai dit que c'était entendu. »
Sur cet incident se rappeler l’essentiel: on va guillotiner un Français de souche qui a tué un arabe. C’est aussi ça L’Etranger, même si tout le monde oublie... Pour le reste Maupassant avait sans doute raison: le froncé se comporte en touriste et en campeur partout où il passe, et il n’a donc rien colonisé sérieusement. Voyez et revoyez Rue cases-nègres, un des derniers chefs d’œuvre de notre cinéma. On voudrait polémiquer mais je n’en ai aucune envie.
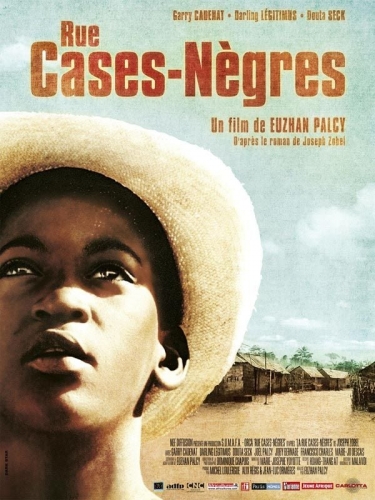
Trop espagnole, la pauvre et romantique Marie se fait encore rembarrer :
« Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien mais que sans doute je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors ? » a-t-elle dit. »
Pour divorcer. Comme dit Yockey dans son opus monumental, le divorce remplace le mariage.
Rappel : Maupassant évoque aussi dans son conte comique Marroca des souvenirs sexuels hispaniques. L’autre conte à relire est Allouma.
Marie s’enfonce, elle est obligée de s’enfoncer vu l’énergumène postmoderne, post-historique et post-tout qui l’a séduite :
« Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela mais que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. »
Meurt-sot annonce Jean Yanne en fait, celui de Nous ne vieillirons pas ensemble; et c’est Pialat, pas Visconti (le pauvre, car une fois qu’on a enlevé les costumes…) qui aurait du « adapter » comme on dit en novlangue L’Etranger.
Puis on parle de Paris et c’est pittoresque :
« Je lui ai parlé alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait connaître Paris. Je lui ai, appris que j'y avais vécu dans un temps et elle m'a demandé comment c'était. Je lui ai dit : « C'est sale. Il y a des pigeons et des cours noires. Les gens ont la peau blanche. »
C’était avant Hidalgo…
Rare allusion heureuse à la belle race méditerranéenne de la rue algérienne :
« Puis nous avons marché et traversé la ville par ses grandes rues. Les femmes étaient belles et j'ai demandé à Marie si elle le remarquait. Elle m'a dit que oui et qu'elle me comprenait. Pendant un moment, nous n'avons plus parlé. »
Céline dit la même chose sur les newyorkaises. Il est plus lyrique naturellement :
« Quelles gracieuses souplesses cependant ! Quelles délicatesses incroyables ! Quelles trouvailles d’harmonie ! Périlleuses nuances ! Réussites de tous les dangers ! De toutes les promesses possibles de la figure et du corps parmi tant de blondes ! Ces brunes ! Et ces Titiennes ! Et qu’il y en avait plus qu’il en venait encore ! C’est peut-être, pensais-je, la Grèce qui recommence ? J’arrive au bon moment ! »
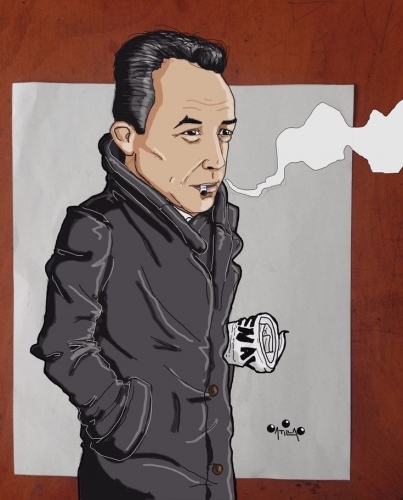
Ces races créoles étaient belles. Mais revenons sur terre :
« Nous allions partir quand Raymond, tout d'un coup, m'a fait signe de regarder en face. J'ai vu un groupe d'Arabes adossés à la devanture du bureau de tabac. Ils nous regardaient en silence, mais à leur manière, ni plus ni moins que si nous étions des pierres ou des arbres morts. »
Le Français qui aime tant moraliser les Américains ferait bien de méditer ces lignes – et celles de Maupassant (inspiré non par Dostoïevski mais comme on sait par Schopenhauer). Métaphore de la pression qui monte L’Etranger?
Après il faut passer à table. Et là on est affamés. J’ai un ami restaurateur à Vézelay qui me dit que son restau est plein à midi dix des fois. Ma sœur confirme pour Monaco. Elle sait aussi que dans plein de bleds en France on ne peut plus dîner. Passées huit heures c’est le couvre-feu annoncé par mon Philippe Muray (avec la fin du sexe) il y a trente ans déjà.
On va voir :
« Quand nous sommes revenus, Masson nous appelait déjà. J'ai dit que j'avais très faim et il a déclaré tout de suite à sa femme que je lui plaisais. Le pain était bon, j'ai dévoré ma part de poisson. Il y avait ensuite de la viande et des pommes de terre frites. Nous mangions tous sans parler. Masson buvait souvent du vin et il me servait sans arrêt. Au café, j'avais la tête un peu lourde et j'ai fumé beaucoup. »
J’ai sympathisé une fois avec un jeune serveur équatorien (un des pays sinistres où j’ai séjourné le moins longtemps en Amérique du Sud) à Côme ; il était impressionné par cette clientèle de retraités qui venait dîner à dix-neuf heures pour se planter ensuite devant Tik Tok ou la télé. Tutti quadrati, m’a-t-il dit en italien dans cette ville alors submergée de migrants et de son et lumière écolo-Bergoglio…
Résultat des courses, on a mangé un peu tôt. Il annonce la France à Macron notre "étranger":
« Masson, Raymond et moi, nous avons envisagé de passer ensemble le mois d'août à la plage, à frais communs. Marie nous a dit tout d'un coup : « Vous savez quelle heure il est ? Il est onze heures et demie. » Nous étions tous étonnés, mais Masson a dit qu'on avait mangé très tôt, et que c'était naturel parce que l'heure du déjeuner, c'était l'heure où l'on avait faim. »
Pas de doute, ils se seraient fait vacciner trente fois pour aller au restau à dix heures…
A l’heure où j’écris je vois une épidémie d’obésité irréelle se produire en Espagne. Mes amis me garantissent que ça se produit aussi en France. Bouffer est un but en soi, pas un moyen, rappelait Shamir à propos des Israéliens.
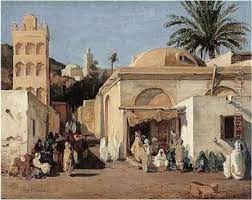
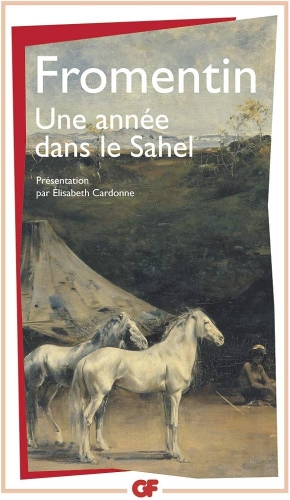
On a beaucoup parlé des grands auteurs du dix-neuvième siècle. Un peu de Dominique de Fromentin (peintre d’Algérie aussi) :
« Quoiqu'il ne fût pas le premier venu autant qu'il le prétendait, et qu'avant de rentrer dans les effacements de sa province il en fût sorti par un commencement de célébrité, il aimait à se confondre avec la multitude des inconnus, qu'il appelait les quantités négatives. »
Allez, encore une répétition de ce rare plaisir littéraire :
« Pourtant je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. »
Ma conclusion ? C’est facile d’accuser l’informatique et la télé. Mon mal vient de plus loin, comme dit Jean Racine.
Sources principales :
http://www.maupassantiana.fr/Oeuvre/Les%20Contes%20de%20M...
https://dissibooks.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/...
http://datablock.free.fr/GUY%20DEBORD%20La%20societe%20du...
https://www.ebooksgratuits.com/blackmask/fromentin_domini...
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/09/19/lecons-liber...
https://www.amazon.fr/Dosto%C3%AFevski-modernit%C3%A9-occ...
https://www.amazon.fr/Louis-Ferdinand-C%C3%A9line-pacifis...
https://www.dedefensa.org/article/nizan-et-les-caracteres...
17:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
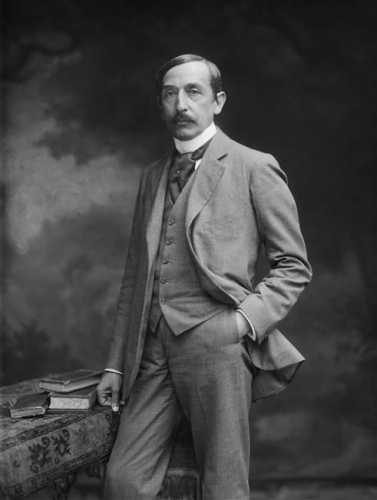
Barrès et l'arbre de Taine, entre contemplation et action
Claude Bourrinet
Un roman à thèse
Quand Barrès publie Les Déracinés, roman à forte teneur naturaliste, dont la dimension satirique rappelle aussi le Balzac des Illusions perdues, ou, plus proche de lui, le Bel-Ami de Maupassant, paru en 1885, il le conçoit comme un coup de semonce, la sonnerie alerte du tocsin. Premier tome d’une trilogie qu’il groupera sous le titre, qui vaut programme, de Roman de l’énergie nationale, ce récit de la « montée » à Paris de jeunes bacheliers lorrains encouragés par leur professeur de philosophie, M. Bouteiller, illustre jusqu’à ses ultimes conséquences, sordides et démoralisantes, l’état de « décérébration » et de « dissociation » d’une France qui a rompu ses liens charnels avec la terre des ancêtres.
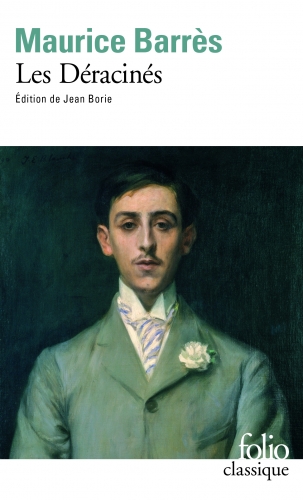
Bouteiller est de ces intellectuels dont Nietzsche parle dans ses Considérations inactuelles. Kantien incantatoire et sermonnant, il symbolise l’homme moderne (dont Kant est le suprême instituteur), cette « araignée au nœud du filet universel », qui détisse (zerspinnt), déchiquète (zerspillert), effiloche (zerfassert), et vaporise le corps social.
Le thème de la Décadence se déploie ainsi, impérieux, en arrière-plan des vicissitudes de personnages symbolisant toutes les hypothèses de vie – ou de survie – de cette fin de siècle fuligineuse, balayant un large spectre social et psychologique, du politicien corrompu, à la prostituée occasionnelle, ou à l’assassin. Comme dans tout roman réaliste, des spécimens humains plongés dans un certain bain précipitent leur destin, le vice, la mort ou, pour les plus favorisés par le sort social, la collusion avec le régime en place. La fin mêle, par une coïncidence temporelle significative, un meurtre sordide dans les fossés de Billancourt, à l’apothéose de Victor Hugo, « la plus haute magistrature nationale », « cadavre héroïque », gisant forcément sublime du Parthénon, et, partant, l’idole des Hussards noirs pour au moins un siècle.
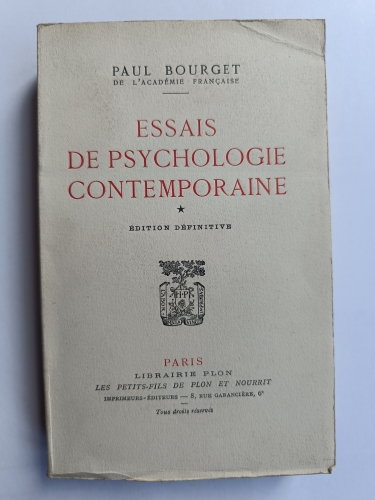
Bourget avait mis peu d’années auparavant la « décadence » à la mode, dont il avait fait la théorie : « […] l’étude de l’histoire et l’expérience de la vie nous apprennent qu’il y a une action réciproque de la société sur l’individu et qu’en isolant notre énergie nous nous privons du bienfait de cette action ». La décadence résulte de la valorisation de l’intérêt individuel aux dépens de l’intérêt collectif. Phénomène de dégénérescence, il s’agit d’une loi aussi bien naturelle qu’humaine.
Dès lors, le rôle du romancier est celui du botaniste « qui observ[e] sept à huit plantes transplantées et leurs efforts pour reprendre racine ». La narration alterne en effet entre récit proprement dit, diégésis, comme disent les savants, et commentaire, ou plutôt analyse. Roman inspiré de la vie réelle de l’auteur, Les Déracinés est une expérimentation, un laboratoire, et tient aussi de l’essai.
L’Axis mundi
L’épisode central du roman est la rencontre de Rœmerspacher, jeune Lorrain solide, étudiant en médecine et en histoire, et de son « père spirituel », Hippolyte Taine, dont il vient d’analyser l’œuvre dans un article profond. Au fil de la conversation, leurs pas les mènent aux Invalides, devant un platane, un « arbre assez vigoureux », « bel être luisant de pluie, inondé de lumière ». Ce monument de la nature est le but habituel des promenades parisiennes de l’auteur des Origines de la France contemporaine. Sa localisation concrète : « exactement celui qui se trouve dans la pelouse à la hauteur du trentième barreau de la grille compté depuis l’esplanade », jure avec l’abstraction universaliste d’un kantisme, qui a certes avec lui la raison, mais pas de corps, donc pas de lieu. Cette précision scrupuleuse a la valeur d’un théorème : n’existe que ce qui occupe un espace circonscrit.
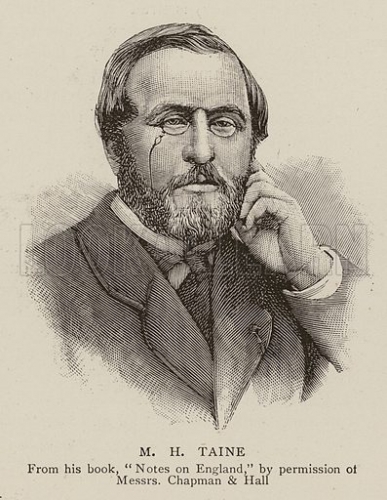
D’ailleurs, certains détails : « grain serré de son tronc », « nœuds vigoureux », évoquent pour Taine des endroits du monde dont la symbolique est attachée à un style de vie : « les roches pyrénéennes », donc la montagne, les situations élevées, d’où l’on a une vaste vue du monde ; « les chênes d’Italie », l’Italie étant, selon Stendhal, un fragment de ciel bleu chu sur la terre, pays des citrons d’or et du bonheur ; de surcroît, puisque l’on se trouve, en imagination, dans la patrie de l’art, cette école de la Renaissance qui incarne le plus la volupté d’exister, la variété chromatique de la beauté, c’est-à-dire « les peintres vénitiens ». Tout permet de suggérer que « cet arbre est l’image expressive d’une belle existence. »
Aux antipodes de cette exaltation vitale, La Nausée, de Sartre offre une vision mélancolique de l’Arbre – bien qu’il soit aussi question, pour lui, d’« exister ». En 1938, celui qui n’est pas encore l’existentialiste que l’on connaît, réplique aussi bien à Barrès qu’à Taine. Il se trouve devant un marronnier (qui paraît bien être un érable). « Assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui [lui] fai[]t peur », il éprouve une sensation qui est en-deçà du langage, le plongeant dans un maelström de déréliction : « Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface ». Et, paradoxalement, il ajoute : « J'étais. » Tout se dissout : « La racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui : la diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre - nues, d'une effrayante et obscène nudité. [...] » « Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter. »
Sartre, pour Julien Gracq, est l’un des chefs de file de ce qu’il appelle la « littérature du Non », le Non à la vie, comme il y a une littérature qui parie sur le monde, sur ses merveilles, ses surprises, ses bonheurs, ses plaisirs, une littérature du Oui. Le marronnier du jardin public s’oppose au platane de l’esplanade des Invalides, comme le nihilisme au vitalisme, ainsi que le trou noir avalant tout, ouvrant sa gueule de néant au milieu de la sarabande scintillante des galaxies.
Une autre réaction, défi que releva Maurras, en 1903, dans la Gazette de France, fut celle d’André Gide qui, dans un recueil d’articles paru au Mercure de France peu de temps avant sous le titre « Prétextes », s’en prenait avec véhémence aux Déracinés ainsi qu’à l’auteur de l’Enquête sur la monarchie. Ce débat virulent est connu sous le nom de Querelle du peuplier.
Maurras, avait côtoyé Barrès en collaborant à La Cocarde, en 1894, et, bien que le premier fût royaliste, tandis que le second persistât dans son républicanisme, ils menaient le même combat pour le « sursaut national ».
Maurras avait posé la question : « A quel moment un peuplier, si haut qu'il s'élève, peut être contraint au déracinement ? » Gide avait fait remarquer bizarrement que le déracinement était au contraire utile à la bonne croissance du peuplier (bien que replanter un peuplier adulte fût peu recommandé, ces essences d’arbres ayant un système racinaire étendu et profond, et les racines risquant d’être endommagée. En outre - et cette conséquence convient très bien aux conclusions de Barrès-, la transplantation peut occasionner un traumatisme violent, et la mort de l’arbre. Gide ajoutait, avec plus de réalisme : « Né à Paris d'un père Uzétien et d'une mère Normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine ? »
Arbre de Vie
Revenons à Taine. Dans la présentation qu’il fait de son totem vivant, il reprend implicitement des catégories aristotéliciennes. Le platane est de ces êtres dont la « force créatrice » tire la graine vers la lumière du jour. Sa perfection provient de la puissance devenue « acte », qu’il ait été « accomplissement » (energia), ou réalisation (entelechia). Être en « acte », c’est exister. Il est, à ce titre, modèle pour l’homme. En effet, « lui-même il est sa loi, et il l’épanouit…guide pour penser ! »

Lors du retour, Rœmerspacher « remarqu[e] la forte cheville du vieillard, puis observ[e) son mollet assez développé ; il pens[e] qu’il devait être de constitution vigoureuse, d’une solide race des Ardennes, affaibli seulement par le travail, et, pour la première fois, il lui vint à l’esprit de considérer M. Taine comme un animal ».
Le terme « animal » n’est pas péjoratif. D’une part, il s’oppose à la désincarnation kantienne, par la masse d’énergie vitale qu’il enferme. D’autre part, il connote la réalité du lieu que suppose la présence charnelle dans le monde. On rencontre là, bien entendu, le leitmotiv barrésien de la terre, celle des ancêtres, les Ardennes, pour Taine, la Lorraine, pour Barrès. L’homme enté sur son sol natal est similaire à un animal, qui renouvelle sa force vitale au contact du biotope dont il est originaire, et dont il tire toute sa richesse.
Et, comme un animal, l’homme enraciné est au service de l’espèce, du groupe, de la « nation » (au sens que ce vocable prenait au moyen-âge, mais aussi selon une acception moderne, Barrès étant aussi « régionaliste » que nationaliste). Chaque individu n’étant qu’une « feuille » frissonnante, « il serait agréable et noble, d’une noblesse et d’un agrément divins, que les feuilles comprissent leur dépendance du platane et comment sa destinée favorise et limite, produit et englobe leurs destinées particulières ».
Ainsi, comme dans le kantisme, l’individu doit se transcender, mais, contrairement à lui, ce ne sera pas en faveur d’idées universelles, mais plutôt d’une collectivité dont la légitimité tient du temps, de la longue mémoire, et du lieu où sont enterrés ses morts.
Arbre de la connaissance
Toutefois, Maurice Rœmerspacher et son ami, François Sturel, tentant nerveusement de tirer une leçon de cette rencontre, en arrivent-ils à un constat, qui les déconcerte. Taine, géant de la pensée, champion de l’étude austère, qui tient du bénédictin et du rat de bibliothèque, interprète autrement qu’eux le symbole de l’arbre vigoureux. Il présente un « tableau de la vie tout spinoziste ». Certes, la règle du devoir, selon l’Éthique, est claire : « Plus quelqu’un s’efforce pour conserver son être, plus il a de vertu; plus une chose agit, plus elle est parfaite... ». Mais toute la question vient de la définition de l’« agir ».
Le platane, selon l’interprétation qu’on lui accorde si on le considère comme mythème, peut symboliser tout aussi bien l’arbre de la connaissance, que celui de la vie. On sait que les deux arbres coexistent, dans l’Eden. Et si l’on partage l’avis des deux jeunes hommes, qui voient dans Taine un spinoziste, il faut supposer que pour le savant, il s’agit bien du premier.

Rappelons quelle est la fin de l’existence, pour Spinoza. Tout être, quel qu’il soit, n’éprouve de bonheur qu’en accédant à la perfection. Celle-ci consiste dans la conservation de soi suivant sa puissance et sa nature (essence). Plus nous agissons suivant les lois de notre puissance, plus nous sommes parfaits. De sorte que nous éprouvons de la joie.
Or, la perfection dont nous sommes capables correspond à la « réalité» de notre nature, et le « modèle de la nature humaine » est l’homme qui vit sous la conduite de la raison ou le sage. La connaissance est le propre de l’homme.
Pour Spinoza existent trois grands « genres de connaissance » : 1) la connaissance par imagination, qui est inadéquate ; 2) la connaissance par raison, qui est adéquate ; 3) la science intuitive, qui est adéquate aussi et représente le moment le plus parfait du développement cognitif de l’âme.
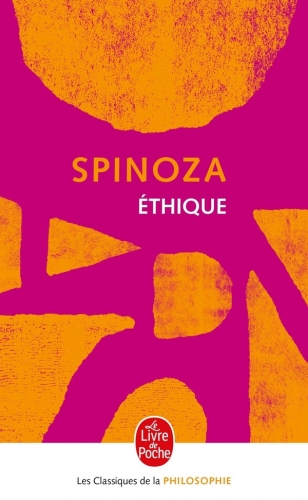
On trouve dans l’Ethique ces affirmations : « Qui connaît les choses par ce genre de connaissance (le troisième), il passe à la plus haute perfection humaine » (E, V, Prop. 27, Démonstration); « Plus chacun a le pouvoir de ce genre de connaissance, mieux il est conscient de lui-même, c’est-à-dire plus il est parfait et possède la béatitude » ; « Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu » (E, V, Prop. 32, Corollaire).
L’Amour intellectuel de Dieu apporte la béatitude, qui est la transitio la plus intense de notre puissance, la perfection adéquate à notre nature humaine.
Ainsi, par intuition, par connaissance des essences, la nature humaine se reflète-t-elle dans son « modèle » : « Plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande la perfection à laquelle nous passons et plus, en conséquence, nous participons de la nature divine »
Nous ne savons pas si Taine a joui de la deuxième connaissance (ce qui est fort probable), ou de la troisième (il n’est pas interdit de le penser). Il a lu Spinoza, il n’est pas ignorant de sa pensée profonde.
L’action vitale
Ce qu’il faut retenir, en l’occurrence, est que, pour le philosophe juif des Pays-Bas, c’est que toute connaissance prend ses racines dans la nature même, en puissance, de notre être.
Peut-être faudrait-il rappeler ce qu’a été la source du rejet nietzschéen du spinozisme, car cette réaction hostile est fort proche de la vision de la perfection que propose Sturel.
Nietzsche découvre Spinoza à Sils Maria, en juillet 1881. D’abord, pour lui, il s’agit d’une révélation lumineuse. Il en est enthousiaste. Il a l’impression de rencontrer un autre lui-même. Il écrit à Overbeck : « Sa tendance générale est la même que la mienne : faire de la connaissance le plus puissant affect».
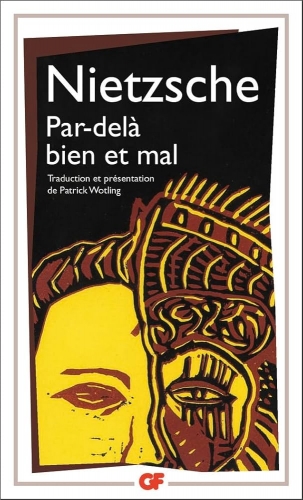
Mais, dans Par-delà le Bien et le Mal, paru en 1886, il l’attaque violemment. Selon lui, il est de ces penseurs qui ont empoisonné la vie. Dans le deuxième livre du Zarathoustra, il compare les érudits à des araignées préparant le poison, « ils sont habiles, ils ont les doigts experts. Leurs doigts s’entendent à toutes les façons d’enfiler, de nouer et de tisser les fils, ils tricotent les bas de l’esprit. » Le but de Spinoza est de disséquer les passions, pour les éliminer. « L’amour intellectuel de Dieu« est une ruse pour détruire les instincts vitaux.
Et il lui reproche, in fine, ce qui dévalorise le kantisme aux yeux d’un Barrès: ses subtiles spéculations abstraites soumettent l’homme à l’impératif de la morale.
Sturel, qui fait remarquer que le platane pousse « contre les Invalides où repose la gloire de Napoléon », rétorque à Rœmerspacher, qui semble partager la vision de son maître à penser : « « Vivre pour penser », que s’est fixé M. Taine, suppose l’abandon de parties considérables du devoir intégral: « Être le plus possible. » » Et il ajoutera, dans le Tombeau de Napoléon : « C’est bien, […], M. Taine t’a fait panthéiste. Tu regardes la nature comme une unité vivante ayant en elle-même son principe d’action. Moi, j’y vois un ensemble d’énergies indépendantes dont le concours produit l’harmonie universelle. »
Racardot, dans une conférence provocatrice, devant un auditoire goguenard et scandalisé, appellera l’épanchement de ces « énergies indépendantes », d’un nom qui évoque Napoléon : « césariser ». Notion qui peut aller loin. Car, commente le narrateur en suivant les pensées de Sturel : « si l’on coupe la tête à Racadot, à Mouchefrin, on anéantira des cellules très nombreuses qui ont été excitées à la vie par des idées de Sturel. Ce mot de « césariser » de qui Racadot le tient-il ? »
Ce même Racadot avait en effet poussé la logique de François Sturel jusqu’à ses limites. Le Platane de Taine, avait-il souligné ironiquement, avait tué, dans son harmonieux déploiement racinaire, deux de ses congénères, qu’on avait dû abattre. La volonté de puissance, associée à l’inévitable individualisme généré par une société « dissociée », « déracinée », aboutit au darwinisme, à cette loi qui règle les relations vitales des animaux et des végétaux, mais aussi les hommes entre eux. Le mot n’est pas employé, mais l’idée s’impose. En l’absence d’harmonie supérieure subsumant les éléments dont la nature peut s’épanouir et se réaliser dans la télos singulier de chacun, le seul équilibre concevable, mais branlant et temporaire, toujours en voie de dislocation, est la lutte de tous contre tous, le struggle for life, ou la volonté de puissance s’essayant sur la résistance qui l’accroît, ou la diminue, voire la détruit.
Dans cet ordre des choses, la volonté de puissance la plus efficace est celle qui s’impose au vide.
Barrès, pour nous
Tentons, en récapitulant les notions agitées par Barrès, de prendre quelque distance – celle de l’histoire du siècle dernier – pour les jauger.
Sans conteste, les deux seuls personnages qui « réussissent » sont Bouteiller et son acolyte, l’un de ses anciens élèves, Suret-Lefort. Le nouveau député de la République conclue le roman par une boutade, faisant remarquer au second qu’il est manifestement « affranchi » de son accent, « de toute intonation, et, plus généralement, de toute particularité lorraine ». Ces parvenus ont, par des combinaisons nauséabondes et des trafics d’influence, dont le futur scandale de Panama se devine en arrière-plan, conquis une circonscription électorale. Ce n’est pas un hasard si le vainqueur final est un kantien, qui, selon Péguy, aurait les mains propres, sans avoir de mains. Toutefois, les deux compères ont bien des mains, les leurs, qui ne sont pas propres, et celles des électeurs en leurs poches. Dans le royaume des idées creuses et des corps exsangues, ce sont les vampires de la pensée qui l’emportent. Barrès, qui s’est frotté, parfois avec succès, aux élections, sait de quoi il est question : «La vie est une brutale. Nul n’est contraint de se donner à la politique active, mais celui qui s’en mêle ne crée pas les circonstances ; on n’atteint un but qu’en subissant les conditions du terrain à parcourir. » Même si ce « terrain s’avère marécageux, ou ressemble à un cloaque.
Toujours est-il que nos sept héros, sept Rastignac lorrains à l’assaut de la capitale, comme les Sept contre Thèbes, ont lamentablement échoué. Même Sturel a perdu sa « promise » ! Lui-même, si avide d’action, n’a, par snobisme bourgeois, pas su, ou pu, sauver son ancienne maîtresse des griffes de ses assassins. Pire : il va pousser le sophisme jusqu’à les excuser. Car la force des choses veut que l’énergie (et il en faut pour commettre un crime, même contre une belle femme sans défense) déployée, agissante, soit viciée, dévoyée par le déracinement. Ragadot et Mouchefrin, en quittant la terre de leurs ancêtres, sont tombés dans l’erreur, qui est le vice. Et alors, la société, dans sa marche, expulse les tarés, les êtres inadéquats. Quant à Mme Astiné Aravian, cette exquise, intelligente, raffinée et voluptueuse Orientale, ce n’est qu’une malheureuse victime de l’histoire, dont le destin, nous suggère le narrateur, une espèce de hérisson écrasé par la roue d’une voiture, fatalement destinée, de toute façon, à se faire assassiner, puisque c’est un sort tout à fait naturel là-bas, dans le Caucase.

Il est assuré que, hormis Ragadot, guillotiné, Mouchefrin, écrasé de misère, tous deux issus de la plèbe, des Lorrains, certes, mais presque des gueux, sont les deux seuls, au fond, à avoir « agi » (d’autant plus que Ragadot a sacrifié ses économies pour créer un journal au titre grotesque, La vraie République, dans lequel se sont exprimés ses amis, qui n’ont mis en jeu que leur plume). Ses « amis » vont en effet s’insérer dans une société fin de siècle, dont l’image est étonnamment moderne, comme si c’était la nôtre qui était contée, avec ses médiocrités, ses vilenies, ses laideurs.
Pour autant, Barrès, l’un de nos auteurs les plus intelligents, a vu clair, souvent, et on se demande comment il a pu se livrer à certains emballements illusoires. Son patriotisme lui donnera un rôle de chantre du carnage durant la Grande Boucherie patriotique de 14-18. L’ »action » virera au cauchemar collectif. La nation ne s’en est jamais vraiment relevée. Il y a un Juin 40 à l’envers, dans le massacre de Verdun, mais l’un ne peu pas se concevoir sans l’autre. Sa lucidité, puisqu’elle existe, s’exerce, du moins, à l’échelle du roman, au sujet des possibilités d’action telles que de jeunes gens échauffés peuvent en rêver après avoir lu les pages glorieuses de la France : « Quelque chose d’imaginaire, comme la figure de Napoléon en 1884, ne peut pas fournir à des unités juxtaposées la faculté d’agir ensemble. Bonne pour donner du ressort à certains individus, cette grande légende ne peut donner de la consistance à leur groupe, ni leur inspirer des résolutions. Où les sept bacheliers peuvent-ils se diriger, pour quels objets se dépenser, à quelle union s’agréger ? »
Pour nous, qui avons connu un siècle de bouleversements atroces, de grands remuements de peuples, des monceaux de cadavres, et le manège tournant des idées qui s’enfuyaient aussi vite qu’elle s’étaient imposées, nous prenons les grandes aspirations héroïques avec circonspection.

La situation de la France, de l’Occident, s’est aggravée depuis la « Belle époque ». C’est le même vertige, devant l’abîme, mais ce dernier s’est encore plus creuser, laissant présager des éruptions meurtrières sans commune mesure avec ce que l’Europe a subi. Après la Grande Guerre, nous avons versé dans une société de masse, la grande industrie et la technique ont mécanisé la vie et les hommes, les moyens de pulvérisation de la vie se sont accrus de façon démentielle, les patries charnelles se sont volatilisées (seuls 5 à 10 % des Français, désormais, se font inhumer dans la terre qui les a vu naître, quand ils ne se font pas incinérer – et le nombre de pratiquants catholiques est encore plus bas), les capacités critiques se sont effondrées, le nihilisme s’est imposé comme horizon existentiel. Si les questions posées par Barrès persistent encore comme hantise, elles ne portent plus de réponses. Peut-être au fond celle, spinoziste, qui concerne la « troisième connaissance », est-elle encore persistante, car, au fond, éternelle. Tant qu’il y aura des hommes, mais rien n’est moins sûr.
14:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, maurice barrès, enracinement, déracinement, hippolyte taine, baruch spinoza |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook