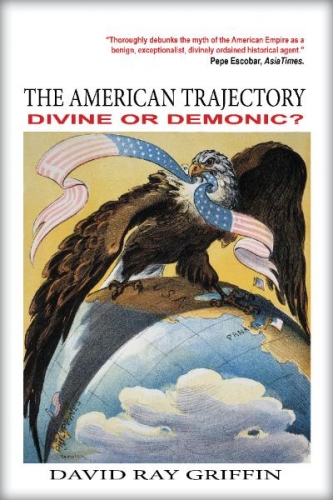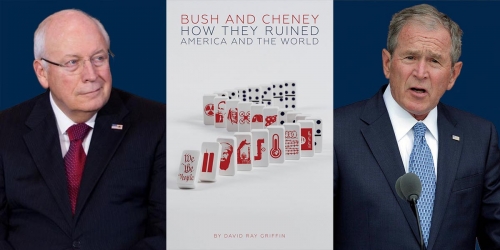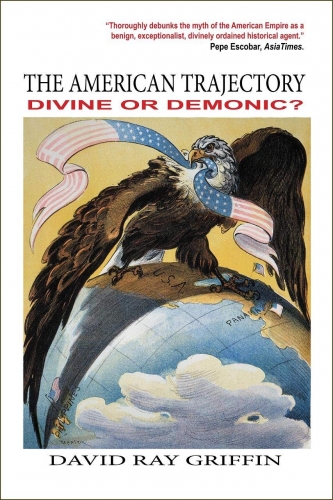Le passé n’est pas mort, ce sont les gens qui dorment. Les cauchemars et les rêves éveillés que nous connaissons aujourd’hui sont le résultat de meurtres qui se sont perpétués au plus profond de notre passé et qui se sont perpétués dans le présent. Aucune fausse amnésie n’effacera la vérité sanglante de l’histoire américaine, la grâce bon marché que nous nous accordons à nous-mêmes ; nous nous sommes, comme l’a dit Harold Pinterdans son discours du prix Nobel, nourris « du vaste tapis de mensonges » qui nous entoure, mensonges proférés depuis très longtemps par des dirigeants nihilistes et leurs porte-parole médiatiques ; nous avons ou devrions avoir mauvaise conscience de ne pas reconnaître être complices actifs ou silencieux de la répression de la vérité et de millions de crimes vicieux au Canada et ailleurs.
Mais, comme l’a dit Pinter :
« Je crois qu’en dépit des énormes obstacles qui existent, une détermination intellectuelle inébranlable, inébranlable et féroce, en tant que citoyens, à définir la vérité réelle de nos vies et de nos sociétés est une obligation cruciale qui nous incombe à tous. C’est en fait obligatoire ».
Nul n’est plus emblématique de ce noble effort que David Ray Griffin, qui, livre après livre depuis les attentats du 11 septembre 2001, a méticuleusement exposé les dessous de l’empire américain et de ses méchants maîtres. Sa persévérance à essayer d’atteindre les gens et de les mettre en garde contre les horreurs qui en ont résulté est extraordinaire. En excluant ses travaux philosophiques et théologiques, c’est son quinzième livre depuis 2004 sur ces graves questions de vie et de mort et sur l’avenir du monde.
Dans ce livre magistral, il fournit un argument historique puissant selon lequel, dès le début, avec l’arrivée des premiers colons européens, ce pays, malgré toute la rhétorique selon laquelle il a été fondé et guidé par Dieu, a été « plus malveillant que bienveillant, plus démoniaque que divin ». Il présente chronologiquement cette histoire, étayée par une documentation minutieuse, pour appuyer sa thèse.
Dans son livre précédent, Bush et Cheney : Comment ils ont ruiné l’Amérique et le monde, Griffin a catalogué les mauvaises actions qui ont découlé des attaques du 11 septembre, alors que dans celui-ci – un préquelle – il offre une leçon d’histoire américaine qui remonte à des siècles, et il montre qu’on aurait raison en traitant les États-Unis « d’empire de faux drapeaux ».
Les attentats du 11 septembre 2001 sont le point d’appui de ses deux livres. On ne saurait surestimer leur importance, non seulement en raison de leur cruauté inhérente qui a causé la mort de milliers d’Américains innocents, mais aussi depuis qu’ils sont devenus la justification des campagnes meurtrières des États-Unis, appelées « guerres contre le terrorisme », qui ont fait des millions de victimes dans le monde. Un éventail international de personnes sacrifiables. Aussi terrifiants qu’elles aient été, et devaient être, il y a de nombreux précédents, bien qu’une grande partie de cette histoire soit cachée dans l’ombre. Griffin les éclaire d’une lumière vive, la plupart de ses analyses se concentrant sur les années 1850-2018.
 En tant que théologien et philosophe, il est bien conscient de l’importance de la nécessité pour la société de légitimer religieusement son autorité séculière, d’offrir à son peuple un bouclier contre la terreur et les craintes multiples de la vie par un mythe protecteur qui a été utilisé avec succès par les États-Unis pour terroriser les autres, de montrer comment les termes selon lesquels les États-Unis sont légitimés comme « nation choisie » par Dieu et les Américains comme « peuple élu » par Dieu ont évolué au fil du temps, à la lumière de l’avancée des processus de sécularisation et de pluralisme qui se sont développés. Les noms ont changé, mais la signification est la même. Dieu est de notre côté, et quand c’est ainsi, l’autre côté est maudit et peut être tué par le peuple de Dieu, qui se bat toujours contre le Diable.
En tant que théologien et philosophe, il est bien conscient de l’importance de la nécessité pour la société de légitimer religieusement son autorité séculière, d’offrir à son peuple un bouclier contre la terreur et les craintes multiples de la vie par un mythe protecteur qui a été utilisé avec succès par les États-Unis pour terroriser les autres, de montrer comment les termes selon lesquels les États-Unis sont légitimés comme « nation choisie » par Dieu et les Américains comme « peuple élu » par Dieu ont évolué au fil du temps, à la lumière de l’avancée des processus de sécularisation et de pluralisme qui se sont développés. Les noms ont changé, mais la signification est la même. Dieu est de notre côté, et quand c’est ainsi, l’autre côté est maudit et peut être tué par le peuple de Dieu, qui se bat toujours contre le Diable.
Il l’illustre en commençant par une citation de la première allocution inaugurale de George Washington, où ce dernier parle de « la main invisible » et « d’agence providentielle » qui guide le pays, et en terminant par Obama qui dit « Je crois en l’exceptionnalisme américain de tout mon être ». Entre les deux, nous entendons Andrew Jackson dire que « la Providence s’est déversée sur cette terre bénie » et Henry Cabot Lodge en 1900 qualifie la mission divine de l’Amérique de « destinée manifeste ». La religion américaine d’aujourd’hui est l’exceptionnalisme américain, un euphémisme actualisé pour le « Nouvel Israël de Dieu » ou la « Nation rédemptrice ».
Au cœur de ce verbiage se trouve l’illusion que les Etats-Unis, en tant que pays béni et bon, ont une mission divine de répandre la « démocratie » et la « liberté » à travers le monde, comme l’a déclaré Hilary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016 en disant que « nous sommes grands parce que nous sommes bons » et en 2004 quand George W. Bush disait : « Comme des générations précédentes, nous avons un appel venant d’au-delà les étoiles pour défendre notre liberté ». De tels sentiments ne pouvaient être reçus qu’avec un rire sardonique de la part des innombrables victimes par-ci par-là « libérées » par les dirigeants violents de l’Amérique, comme l’atteste Griffin.
Ayant établi le fait que l’Amérique revendique le statut divin, il guide ensuite le lecteur à travers divers penseurs qui ont pris parti sur la question des États-Unis, qu’ils soient indulgents ou malveillants. Tout ceci est préliminaire au cœur du livre, qui est une leçon d’histoire documentant la malignité au cœur de la trajectoire américaine.
« On dit souvent que l’impérialisme américain a commencé en 1898, lorsque Cuba et les Philippines furent les principales récompenses », commence-t-il. « Ce qui était nouveau à cette époque, cependant, c’est que l’Amérique a pris le contrôle de pays en dehors du continent nord-américain ».
Le « droit divin » de s’emparer des terres des autres et de les tuer a commencé bien avant, et bien qu’aucune mer n’ait été traversée selon la conception habituelle de l’impérialisme, le génocide des Amérindiens a largement précédé 1898. De même que le « destin manifeste » qui a déclenché la guerre avec le Mexique, la confiscation de ses terres et l’expansion vers l’ouest, jusqu’au Pacifique.
Cette période de construction de l’empire dépendait fortement de « l’autre grand crime contre l’humanité » qu’était la traite négrière, où l’on estime que 10 millions d’Africains sont morts, en plus de la brutalité malsaine de l’esclavagisme lui-même.
« Peu importe la brutalité des méthodes, les Américains étaient employés comme instruments à des fins divines, écrit Griffin. Et, ajoute-t-il à juste titre, il n’est pas vrai que les entreprises impérialistes américaines à l’étranger ne se sont imposées qu’en 1898, car dans les années 1850, le commodore Perry a forcé « les arrogants japonais » à ouvrir leurs ports au commerce américain par la diplomatie de la canonnière ».
Puis, en 1898, le rythme de l’expansion impériale outre-mer s’est accéléré de façon spectaculaire avec ce qu’on a appelé « la guerre hispano-américaine » qui a abouti à la prise de Cuba et des Philippines et à l’annexion d’Hawaii. Griffin dit que ces guerres pourraient être appelées « les guerres pour s’emparer des colonies espagnoles ». Son analyse de la brutalité et de l’arrogance de ces actions fait comprendre au lecteur que le massacre de My Lai au Vietnam et d’autres atrocités plus récentes ont un lourd pedigree qui fait partie d’une structure institutionnelle, et pendant que les Philippins, les Cubains et tant d’autres étaient massacrés, Griffin écrit :
« Anticipant la déclaration du Secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, qui a dit : « Nous ne sommes pas un empire », le Président McKinley a déclaré que l’impérialisme était étranger au tempérament et au génie de ces peuples généreux et libres ».
A l’époque comme aujourd’hui, un fou rire peut-être est la seule réponse à de telles conneries, et comme Griffin cite Mark Twain qui dit qu’il serait facile de créer un drapeau pour les Philippines :
« Nous prenons juste notre drapeau habituel, avec les rayures blanches peintes en noir et les étoiles remplacées par le crâne et les os en croix ».
Cela aurait également fonctionné pour la Colombie, le Panama, Porto Rico, la République dominicaine, Haïti, le Nicaragua et d’autres pays soumis à l’idéologie de la Doctrine Monroe ; partout où la liberté et l’indépendance nationale ont soulevé la tête, les États-Unis sont intervenus rapidement avec leur puissante armée antirévolutionnaire et leurs brutalités financières. En Extrême-Orient, la politique de la « porte ouverte » a été utilisée pour piller la Chine, le Japon et d’autres pays.
Mais tout cela n’était que le début. Griffin montre comment Woodrow Wilson, la quintessence du libéral démocrate sournois et traître, qui prétendait vouloir tenir l’Amérique à l’écart de la Première Guerre Mondiale, a fait exactement le contraire pour s’assurer que les États-Unis en viennent à dominer les marchés étrangers que ses maîtres capitalistes demandaient. Ainsi, Griffin explore comment Wilson a conspiré avec Winston Churchill pour utiliser le naufrage du Lusitania comme un casus belli et comment le dur traitement de l’Allemagne par le Traité de Versailles a préparé le terrain pour la Deuxième Guerre Mondiale.

Il nous raconte comment, entre les deux guerres mondiales, la diabolisation de la Russie et de la nouvelle Union Soviétique a commencé. Cette déprédation de la Russie, qui rugit à plein régime aujourd’hui, est un thème qui revient tout au long de La Trajectoire américaine. On ne saurait trop insister sur son importance. Wilson qualifia le gouvernement bolchevique de « gouvernement de terreur » et, en 1918, « envoya des milliers de soldats dans le nord et l’est de la Russie, les laissant là jusqu’en 1920 ».
Que les États-Unis aient envahi la Russie est un fait rarement mentionné et même à peine connu des Américains. Peut-être que la prise de conscience et la diabolisation séculaire de l’URSS/Russie éclaireraient ceux qui achètent la propagande anti-russe actuelle appelée « Russiagate ».
Pour égaler cet acte « divin » d’intervention impériale à l’étranger, Wilson a fomenté la Peur Rouge chez nous, qui, comme le dit Griffin, avait une importance durable et incalculable car elle a créé la peur américaine de la pensée radicale et de la révolution qui existe encore aujourd’hui et sert de justification pour soutenir des dictateurs brutaux dans le monde et réprimer la liberté chez nous (comme cela se passe actuellement).
Il nous donne de brefs résumés de certains dictateurs que les États-Unis ont soutenus, et nous rappelle le dicton d’un autre démocrate libéral, Franklin Roosevelt, qui a dit du brutal dictateur nicaraguayen Anastasio Somoza :
« C’est peut-être un fils de pute, mais c’est notre fils de pute ».
Somoza terrorisera son propre peuple pendant 43 ans. Il en a été de même à Cuba, au Chili, en Iran, au Guatemala, en République dominicaine, en Haïti, etc. Les États-Unis ont également soutenu Mussolini, n’ont rien fait pour empêcher le renversement fasciste de la République espagnole par Franco et ont soutenu le gouvernement de droite de Chiang-Kai Shek dans ses efforts pour dominer la Chine.
C’est une histoire très sombre et très laide qui confirme la nature démoniaque des actions américaines dans le monde.
Puis Griffin fait exploser les nombreux mythes sur ce que l’on appelle la « Bonne Guerre » – la Seconde Guerre Mondiale. Il explique les mensonges racontés au sujet de l’attaque « surprise » japonaise contre Pearl Harbor, comment Roosevelt souhaitait faire entrer les Etats-Unis dans la guerre, tant dans le Pacifique qu’en Europe, et à quel point les intérêts économiques américains étaient en jeu. Il critique le mythe selon lequel l’Amérique souhaitait avec désintéressement défendre les peuples épris de liberté dans leurs batailles contre les régimes brutaux et fascistes. Cela, nous dit-il, n’est qu’une petite partie de l’histoire :
« Il ne s’agit toutefois pas d’une image exacte de la politique américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale. Certes, beaucoup de gens ont été libérés de terribles tyrannies par les victoires alliées. Mais le fait que ces personnes en aient profité n’était qu’un résultat fortuit et non un motif de la politique américaine. Ces politiques, comme l’a découvert Andrew Bacevich, étaient fondées sur un « intérêt personnel inébranlable ».
Ensuite, il y a les bombardements conventionnels et atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Rien n’est plus démoniaque, comme le montre Griffin. Si ces massacres de civils de sang-froid et les mensonges qui les justifient ne convainquent pas le lecteur qu’il y a longtemps eu quelque chose de radicalement mauvais au cœur de l’histoire américaine, rien ne le fera. Griffin montre comment Truman et ses conseillers et généraux, y compris Dwight Eisenhower et l’amiral William D. Leahy, chef d’état-major de Truman, savaient que le largage des bombes atomiques était inutile pour mettre fin à la guerre, mais ils le firent quand même.
Il nous rappelle la réponse de la secrétaire d’État, Mme Madeline Albright, à la question de savoir si elle pensait que la mort de plus de 500 000 enfants irakiens à la suite des sanctions économiques paralysantes imposées par Mme Clinton valait la peine :
« Mais, oui, nous pensons que le prix en vaut la peine » (remarquez l’utilisation du présent « en vaut la peine » exprime la nature continue de ces crimes de guerre). Mais c’est aussi la femme qui a dit : « Nous sommes la nation indispensable. Nous restons grands… »
Griffin consacre d’autres chapitres à la création de la guerre froide, à l’impérialisme américain pendant la guerre froide, aux interventions de l’après-guerre froide, à la guerre du Vietnam, à la course à la domination mondiale et aux opérations sous faux drapeaux, entre autres sujets.
Quant aux opérations de faux drapeaux, il affirme :
« En effet, la trajectoire de l’Empire américain s’est tellement appuyée sur ce type d’attaques qu’on pourrait le décrire comme un empire de faux drapeaux ».
Dans le chapitre sur les faux drapeaux et tout au long du livre, il discute de plusieurs des faux drapeaux dans lesquels les États-Unis se sont engagés, y compris l’Opération Gladio, l’opération terroriste États-Unis/OTAN dans toute l’Europe que l’historien suisse Daniele Ganser a largement documentée, une opération visant à discréditer les communistes et socialistes. Ces opérations étaient directement liées à l’OSS, à la CIA et à son directeur Allen Dulles, à son acolyte James Jesus Angleton et à leurs complices nazis, comme le général Reinhard Gehlen. Lors d’un attentat de ce type en 1980 à la gare de Bologne, en Italie, ces terroristes américains ont tué 85 personnes et en ont blessé 20 autres. Comme pour les bombes larguées aujourd’hui par l’Arabie Saoudite sur des écoliers yéménites, l’explosif utilisé a été fabriqué pour l’armée américaine. À propos de ces atrocités américaines avérées, Griffin dit :
« Ces révélations montrent la fausseté d’une hypothèse largement répandue chez les Américains. Tout en reconnaissant que les militaires américains font parfois des choses terribles à leurs ennemis, la plupart des Américains ont supposé que les chefs militaires américains n’ordonneraient pas le meurtre de civils innocents dans les pays alliés à des fins politiques. L’opération Gladio a montré que cette hypothèse était fausse ».
Il a raison, mais j’ajouterais que les dirigeants derrière tout cela étaient des civils, tout autant, voire plus que des militaires.
Dans le cas de l’Opération Northwoods, ce sont les chefs d’état-major interarmées qui ont présenté au président Kennedy cette proposition de faux drapeaux qui justifierait une invasion américaine à Cuba. Cela aurait impliqué le meurtre de citoyens américains sur le sol américain, des bombardements, des détournements d’avions, etc.
Le président Kennedy considérait de telles personnes et de tels plans comme insensés, et il les a rejetés en tant que tels. Ce faisant, il nous en dit long, car beaucoup d’autres présidents les auraient approuvés. Et encore une fois, combien d’Américains sont au courant de cette proposition dépravée qui est documentée et facilement accessible ? Combien d’entre eux veulent même la consulter ? Car la nécessité de rester dans le déni des faits de l’histoire et de croire en la bonté essentielle des dirigeants de l’Amérique est une noix très difficile à casser. Griffin a écrit une douzaine de livres sur le 11 septembre 2001, en essayant de le faire.
Si l’on est prêt à embrasser les faits historiques, ce livre exceptionnel ouvrira les yeux sur la nature démoniaque de longue date des actions des dirigeants des États-Unis. Un lecteur ne peut sortir de son histoire lucidement présentée sans être affecté, à moins de vivre dans un monde fantastique qu’il s’impose. Le dossier est clair, et Griffin le présente dans toute son horreur graphique. Ce qui ne veut pas dire que les États-Unis n’ont pas « fait à la fois le bien et le mal, et qu’ils ne peuvent donc pas raisonnablement être considérés comme purement divins ou purement démoniaques« . Les questions de pureté ont pour but d’obscurcir les vérités fondamentales. Et la question qu’il pose dans son sous-titre – Divin ou démoniaque ? – est vraiment une question rhétorique, et quand il s’agit de la « trajectoire » de l’histoire américaine, le démon gagne haut la main.
Je m’en voudrais de ne pas signaler un endroit où Griffin laisse tomber le lecteur. Dans son long chapitre sur le Vietnam, qui regorge d’excellents faits et analyses, il commet une erreur cruciale, ce qui est inhabituel pour lui. Cette erreur apparaît dans une section de quatre pages sur la politique du président Kennedy à l’égard du Vietnam. Dans ces pages, Griffin s’appuie sur le terrible livre de Noam Chomsky – Rethinking Camelot : JFK, la guerre du Vietnam et la culture politique américaine (1993), un livre dans lequel Chomsky ne montre aucun respect pour les preuves ou les faits – pour peindre Kennedy comme étant en accord avec ses conseillers, la CIA, et l’armée concernant le Vietnam. C’est tout à fait faux. Griffin a dû être plus attentif et l’a compris.
La vérité est que Kennedy a été assiégé et entouré par ces gens démoniaques, qui voulaient l’isoler, ignorer ses instructions et l’assassiner pour atteindre leurs objectifs au Vietnam. Au cours de la dernière année de sa vie, JFK avait pris un virage radical vers l’établissement de la paix, non seulement au Vietnam, mais aussi avec l’Union Soviétique, Cuba et dans le monde entier. Un tel revirement était anathème pour les amoureux de la guerre. Il devait donc mourir.
Contrairement aux tromperies de Chomsky, motivé par sa haine de Kennedy et peut-être quelque chose de plus sinistre (il soutient aussi la Commission Warren, pense que l’assassinat de JFK n’était pas grave, et accepte la version officielle manifestement fausse des attaques du 11 septembre 2001), Griffin aurait dû affirmer avec insistance que Kennedy avait publié la NSAM 263 le 11 octobre 1963 appelant au retrait des troupes américaines du Vietnam, et qu’après son assassinat un mois plus tard, Lyndon Johnson avait annulé cet ordre de retrait avec la NSAM 273. Malgré Chomsky, toutes les meilleures études et preuves documentaires le prouvent. Et pour Griffin, un merveilleux érudit, écrire que le passage de Kennedy à Johnson n’entraînerait aucun changement fondamental de politique est si scandaleusement faux que j’imagine que Griffin, un homme passionné par la vérité, s’est simplement trompé et qu’il a été négligent ici. Car rien n’est plus faux.
Ironiquement, Griffin présente un dossier magistral pour sa thèse, tout en oubliant le seul homme clé, le président John Kennedy, qui a sacrifié sa vie pour tenter de changer la trajectoire de l’histoire américaine de son cours démoniaque.
C’est une erreur dans un livre par ailleurs très important et excellent qu’il devrait être obligatoire de lire pour quiconque doute de la nature maléfique de la politique étrangère continue de ce pays. Ceux qui en sont déjà convaincus devraient également le lire, car il fournit une ressource historique et une impulsion nécessaires pour aider à changer la trajectoire qui mène le monde vers l’oubli nucléaire, si elle se poursuit.
Si – un vœu fantastique ! – La Trajectoire américaine : Divin ou Démoniaque ? étaient des lectures obligatoires dans les écoles et collèges américains, peut-être qu’une nouvelle génération se lèverait pour transformer nos démons en anges, l’arc de l’univers moral futur de l’Amérique au profit de la justice, et loin d’être le plus grand pourvoyeur de violence dans le monde actuel comme cela a été le cas si longtemps.
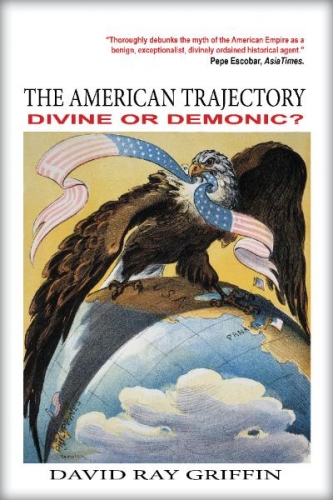
La Trajectoire américaine : Divine ou démoniaque de David Ray Griffin
Traduit par Pascal, revu par Martha pour Réseau International
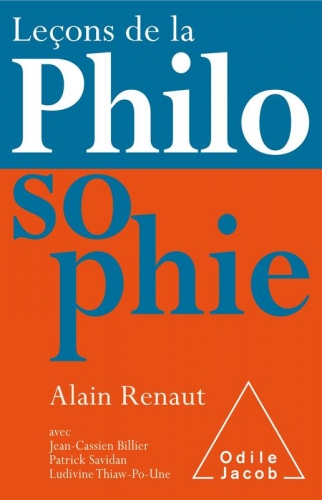 Les auteurs ne cachent pas, du reste, les réserves que peuvent leur inspirer ce plan de travail, qui est celui de l’éducation nationale, mais ils ont choisi d’en montrer les éventuelles limites de l’intérieur. Le déploiement de ce modèle classique d’exposition de la philosophie a le mérite de susciter des échos chez tous les lecteurs, avancés ou moins avancés, de thèmes philosophiques. Il montre aussi qu’il est possible d’entrer dans la philosophie par différentes portes. C’est pourquoi Alain Renaut précise à juste titre qu’il n’est aucunement indispensable de lire ce livre dans l’ordre des parties et des chapitres. Nous ne sommes donc ni face à un manuel scolaire/universitaire à proprement parler, ni face à un anti-manuel, ce qui serait bien prétentieux, et une vaine coquetterie.
Les auteurs ne cachent pas, du reste, les réserves que peuvent leur inspirer ce plan de travail, qui est celui de l’éducation nationale, mais ils ont choisi d’en montrer les éventuelles limites de l’intérieur. Le déploiement de ce modèle classique d’exposition de la philosophie a le mérite de susciter des échos chez tous les lecteurs, avancés ou moins avancés, de thèmes philosophiques. Il montre aussi qu’il est possible d’entrer dans la philosophie par différentes portes. C’est pourquoi Alain Renaut précise à juste titre qu’il n’est aucunement indispensable de lire ce livre dans l’ordre des parties et des chapitres. Nous ne sommes donc ni face à un manuel scolaire/universitaire à proprement parler, ni face à un anti-manuel, ce qui serait bien prétentieux, et une vaine coquetterie.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
 En tant que théologien et philosophe, il est bien conscient de l’importance de la nécessité pour la société de légitimer religieusement son autorité séculière, d’offrir à son peuple un bouclier contre la terreur et les craintes multiples de la vie par un mythe protecteur qui a été utilisé avec succès par les États-Unis pour terroriser les autres, de montrer comment les termes selon lesquels les États-Unis sont légitimés comme « nation choisie » par Dieu et les Américains comme « peuple élu » par Dieu ont évolué au fil du temps, à la lumière de l’avancée des processus de sécularisation et de pluralisme qui se sont développés. Les noms ont changé, mais la signification est la même. Dieu est de notre côté, et quand c’est ainsi, l’autre côté est maudit et peut être tué par le peuple de Dieu, qui se bat toujours contre le Diable.
En tant que théologien et philosophe, il est bien conscient de l’importance de la nécessité pour la société de légitimer religieusement son autorité séculière, d’offrir à son peuple un bouclier contre la terreur et les craintes multiples de la vie par un mythe protecteur qui a été utilisé avec succès par les États-Unis pour terroriser les autres, de montrer comment les termes selon lesquels les États-Unis sont légitimés comme « nation choisie » par Dieu et les Américains comme « peuple élu » par Dieu ont évolué au fil du temps, à la lumière de l’avancée des processus de sécularisation et de pluralisme qui se sont développés. Les noms ont changé, mais la signification est la même. Dieu est de notre côté, et quand c’est ainsi, l’autre côté est maudit et peut être tué par le peuple de Dieu, qui se bat toujours contre le Diable.