jeudi, 12 février 2026
La Russie et le Pakistan: renforcement des relations de partenariat

La Russie et le Pakistan: renforcement des relations de partenariat
Milana Gunba
Les relations entre la Russie et le Pakistan ont connu un parcours difficile, passant de l'antagonisme de la guerre froide à un partenariat pragmatique au 21ème siècle. Historiquement, le Pakistan était un allié clé des États-Unis en Asie du Sud, tandis que l'URSS soutenait l'Inde. Cependant, les changements dans l'architecture géopolitique mondiale, en particulier la formation d'un monde multipolaire, le déplacement du centre de gravité économique mondial vers l'Asie, ainsi que les défis communs en matière de sécurité, tels que le terrorisme et l'instabilité régionale (notamment la situation en Afghanistan), ont créé un terrain favorable au rapprochement entre les deux pays.
Au cours de la dernière décennie, on observe une tendance constante à l'approfondissement de la coopération russo-pakistanaise, qui dépasse le cadre des contacts diplomatiques traditionnels. Ce processus couvre un large éventail de domaines, allant des exercices militaires conjoints périodiques à la discussion et à la mise en œuvre de projets d'investissement à grande échelle dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures.
Évolution des relations et contexte géopolitique
Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a hérité de relations complexes avec le Pakistan. Les premières années de la période post-soviétique ont été marquées par une faible activité, mais dès le début des années 2000, des signes de rapprochement progressif ont commencé à apparaître. Les catalyseurs de ce processus ont été les suivants:
Le changement des priorités de la politique étrangère de la Russie: dans un contexte de confrontation avec l'Occident et de « tournant vers l'Est » actif, la Russie cherche à diversifier ses relations étrangères et économiques en trouvant de nouveaux partenaires en Asie.
La diversification des relations extérieures du Pakistan: confronté à l'instabilité et parfois à la pression de ses alliés occidentaux traditionnels (principalement les États-Unis), Islamabad cherche à mener une politique étrangère multivectorielle, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard d'un seul centre de pouvoir. Le renforcement des relations avec la Russie est perçu comme faisant partie de cette stratégie, en particulier dans le contexte de l'influence croissante de la Chine (à travers l'initiative « Belt and Road » et le Corridor économique Chine-Pakistan, CPEC).
Défis communs en matière de sécurité: le Pakistan et la Russie ont tous deux intérêt à assurer la stabilité régionale et à lutter contre le terrorisme international, le trafic de drogue et l'extrémisme. La situation en Afghanistan est l'un des principaux dénominateurs communs.
Intérêts économiques: le Pakistan, avec sa population croissante et son économie en développement, est un marché potentiellement important pour les biens et services russes, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la construction mécanique. La Russie, quant à elle, voit dans le Pakistan de nouvelles opportunités d'investissement et d'exportation d'hydrocarbures.
L'adhésion du Pakistan à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en 2017, dont la Russie est l'un des membres clés, a constitué une étape importante, offrant une plateforme pour la coopération multilatérale et donnant un élan supplémentaire aux relations bilatérales.
Coopération militaire et de défense
La coopération dans le domaine militaire, autrefois inimaginable, est devenue l'un des signes les plus visibles du changement dans les relations entre les deux pays. Alors qu'auparavant, la Russie vendait principalement du matériel militaire à l'Inde, le Pakistan est désormais également considéré comme un marché potentiel.
Exercices militaires conjoints:
« Druzhba »: Lancés en 2016, ces exercices conjoints entre les forces spéciales russes et pakistanaises ont lieu chaque année (avec quelques interruptions). Ils sont axés sur les opérations antiterroristes, l'entraînement en montagne et l'échange d'expériences dans des conditions de terrain difficiles. Les exercices « Druzhba » symbolisent non seulement l'approfondissement de la coopération militaire, mais aussi la démonstration publique d'un changement de paradigme dans les relations.
« Arabian Monsoon »: Des exercices navals conjoints sont également organisés périodiquement, démontrant la capacité des flottes des deux pays à coopérer.

Exercices multilatéraux: l'armée pakistanaise participe également à des exercices multilatéraux organisés sous l'égide de l'OCS, ce qui contribue à renforcer la compatibilité opérationnelle et la coordination.
Fournitures d'armes et coopération militaro-technique:
Hélicoptères Mi-35M: L'un des accords les plus importants a été l'acquisition par le Pakistan d'hélicoptères d'attaque polyvalents Mi-35M « Super Crocodile ». Cette transaction a constitué un précédent important, ouvrant la voie à une coopération future.

Discussion sur de nouveaux achats: Des négociations sont régulièrement menées sur d'éventuelles livraisons de systèmes de défense aérienne russes (y compris le S-400, bien que cela reste spéculatif en raison du caractère sensible du sujet pour l'Inde), de véhicules blindés, ainsi que sur la modernisation des systèmes existants et la création de productions conjointes.
Équipements et formation antiterroristes: la Russie aide le Pakistan à former du personnel et à fournir des équipements pour lutter contre le terrorisme, ce qui constitue une priorité commune.
Importance stratégique: pour le Pakistan, la coopération militaire avec la Russie signifie une diversification des sources d'armement, une réduction de la dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, ainsi qu'un accès aux technologies russes de pointe. Pour la Russie, il s'agit d'un nouveau marché pour la vente d'armes, d'un renforcement de ses positions en Asie du Sud et d'une influence accrue dans la région, ce qui correspond à sa stratégie de « pivot vers l'Est ».
Partenariat énergétique
Le secteur énergétique est sans doute le domaine le plus prometteur et le plus capitalistique de la coopération bilatérale, susceptible de générer des investissements de plusieurs milliards. Le Pakistan est confronté à une grave pénurie énergétique, tandis que la Russie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux d'hydrocarbures et de technologies.
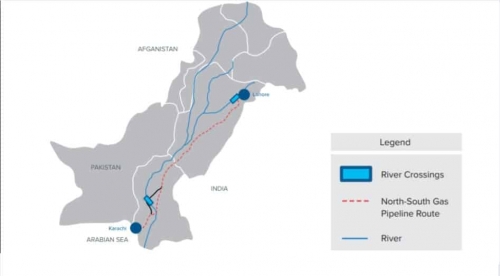
Gazoduc « Pakistan Stream »
Historique du projet: Initialement connu sous le nom de « Nord-Sud », ce projet prévoit la construction d'un gazoduc d'environ 1100 km entre le port de Karachi (où sera réceptionné le GNL regazéifié) et Lahore, afin d'assurer le transport du gaz vers les zones densément peuplées du pays.
Participants et statut: un protocole d'accord a été signé dès 2015, mais le projet a connu des retards en raison de lenteurs bureaucratiques, de problèmes de financement et de sanctions internationales contre la Russie. En 2021, les gouvernements des deux pays ont signé un accord intergouvernemental prévoyant une participation de 26 % pour le Pakistan et de 74 % pour la Russie. L'opérateur du projet devrait être la partie russe. Le projet est estimé à plusieurs milliards de dollars.
Pour le Pakistan, ce gazoduc est essentiel pour garantir la sécurité énergétique, développer l'industrie et réduire les coûts énergétiques. Pour la Russie, c'est l'occasion de s'implanter sur un nouveau marché gazier prometteur et de démontrer sa capacité à réaliser de grands projets d'infrastructure dans des conditions difficiles.
Livraisons de GNL et de pétrole brut: Le Pakistan est intéressé par des contrats à long terme pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) et de pétrole brut russes. Dans le contexte de la crise énergétique mondiale et de la volonté du Pakistan de diversifier ses sources d'énergie, les livraisons russes pourraient devenir un élément important de la stratégie énergétique du pays.
Raffinage du pétrole: Des projets de modernisation et de construction de nouvelles raffineries de pétrole au Pakistan avec la participation d'entreprises russes sont également à l'étude.
Exploration et production d'hydrocarbures: Les entreprises russes, qui disposent de technologies de pointe dans le domaine de l'exploration et de la production, manifestent leur intérêt pour la participation à des projets sur le plateau continental et sur terre au Pakistan.
Énergie électrique: Il existe des perspectives de coopération dans la construction et la modernisation de centrales électriques utilisant différentes sources d'énergie, notamment l'énergie hydraulique et les centrales thermiques.
Coopération commerciale, économique et en matière d'investissements
Outre les grands projets d'infrastructure, la Russie et le Pakistan cherchent à accroître le volume des échanges commerciaux bilatéraux et des investissements dans d'autres secteurs.
Dynamique des échanges commerciaux: Bien que le volume des échanges bilatéraux ait été historiquement modeste (environ 700 à 900 millions de dollars par an), on observe une croissance soutenue. Les deux pays se sont fixé pour objectif de le porter à 5 milliards de dollars dans un avenir proche.
Exportations de la Russie: principalement des céréales (blé), des machines et des équipements, des engrais minéraux.
Exportations du Pakistan: textiles, produits agricoles (mangues, riz), articles en cuir, articles de sport.
Coopération bancaire et financière: les possibilités d'utiliser les monnaies nationales dans les règlements mutuels, de créer des canaux bancaires directs et des systèmes de paiement pour contourner les sanctions internationales et renforcer l'autonomie économique sont en cours de discussion.
Opportunités d'investissement
Industrie: le Pakistan est intéressé par les investissements russes dans l'industrie lourde, la construction mécanique et l'industrie chimique.
Agriculture: la Russie peut fournir des machines et des technologies agricoles, tandis que le Pakistan peut augmenter ses exportations de denrées alimentaires.
Pharmacie: il existe un potentiel de coopération dans le secteur pharmaceutique.
Coopération douanière: l'optimisation des procédures douanières et la création de conditions favorables au commerce font également l'objet de discussions.
Coopération humanitaire, éducative et culturelle
Bien que moins importante, la coopération humanitaire joue également un rôle important dans le rapprochement des peuples.
Programmes éducatifs: la Russie accorde au Pakistan des quotas pour étudier dans les universités russes, en particulier dans les domaines techniques et scientifiques. Cela contribue à la formation d'une élite pro-russe et au renforcement des liens interculturels.
Échanges culturels: l'organisation de festivals culturels, de projections de films et d'expositions favorise une meilleure compréhension mutuelle et permet de dépasser les stéréotypes.
Tourisme: malgré les difficultés existantes, il existe un potentiel de développement du tourisme entre les deux pays, en particulier dans le domaine du tourisme écologique et culturel.
Défis et obstacles à la coopération
Malgré des progrès évidents, le partenariat russo-pakistanais est confronté à un certain nombre de défis majeurs :
Le facteur indien: les relations traditionnellement étroites entre la Russie et l'Inde constituent un point sensible. Delhi suit de près le développement du partenariat russo-pakistanais, craignant qu'il ne perturbe l'équilibre régional des pouvoirs ou ne porte atteinte à ses intérêts. La Russie est contrainte de trouver un équilibre entre les deux puissances sud-asiatiques.
Pression des États-Unis et de l'Occident: malgré sa volonté de diversification, le Pakistan entretient toujours des liens économiques et stratégiques importants avec l'Occident. Les sanctions américaines contre la Russie pourraient compliquer la mise en œuvre de projets communs, en particulier dans le domaine financier. Le Pakistan craint d'être soumis à des sanctions secondaires.
Contraintes financières: les grands projets d'investissement nécessitent des ressources financières importantes. Le Pakistan rencontre souvent des difficultés pour financer ses projets en interne et obtenir des crédits extérieurs. Les entreprises russes sont également confrontées à des restrictions sur le marché financier international.
Bureaucratie et instabilité politique: au Pakistan, les changements fréquents de gouvernement et le niveau élevé de bureaucratisation peuvent ralentir la mise en œuvre des projets et affecter leur viabilité à long terme.
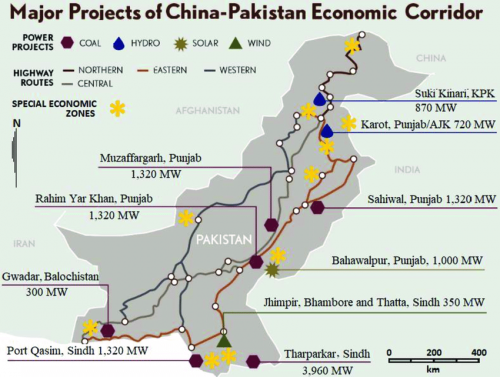
Concurrence avec la Chine: la Chine est le principal partenaire stratégique du Pakistan et l'investisseur le plus important via le CPEC. Les projets russes doivent rivaliser avec les initiatives chinoises pour attirer l'attention et les ressources d'Islamabad, même s'ils peuvent souvent être complémentaires.
Logistique et infrastructure: le développement des routes commerciales et de l'infrastructure logistique pour augmenter les échanges commerciaux nécessite des investissements et du temps considérables.
Perspectives et importance stratégique
Malgré les défis, les relations russo-pakistanaises ont un potentiel considérable pour se développer davantage.
Renforcement d'un monde multipolaire: L'approfondissement du partenariat entre la Russie et le Pakistan contribue à la formation d'un ordre mondial plus équilibré et multipolaire, réduisant la domination d'un seul centre de pouvoir.
Stabilité régionale: La coopération en matière de sécurité, en particulier en ce qui concerne l'Afghanistan et la lutte contre le terrorisme, est essentielle pour la stabilité et la sécurité régionales en Asie centrale et en Asie du Sud.
Sécurité énergétique du Pakistan: les investissements et les livraisons russes peuvent améliorer considérablement la situation énergétique du Pakistan, ce qui est une condition essentielle à sa croissance économique.
Diversification pour la Russie: le Pakistan devient un élément important de la stratégie russe de « pivot vers l'Est », offrant de nouvelles opportunités économiques et politiques.
Rôle de l'OCS: l'Organisation de coopération de Shanghai sert de plateforme importante pour le développement de relations multilatérales et bilatérales, fournissant un cadre institutionnel pour la coopération.
Les projets communs de la Russie et du Pakistan – des exercices militaires périodiques aux discussions sur les investissements majeurs dans l'énergie et les infrastructures – reflètent les profonds changements géopolitiques et l'approche pragmatique des deux pays dans l'élaboration de leurs stratégies de politique étrangère. Ce partenariat, qui était autrefois pratiquement inexistant, prend désormais de l'ampleur, motivé par des intérêts communs dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la recherche d'un monde multipolaire.
Bien que des obstacles importants, tels que la sensibilité du facteur indien, la pression occidentale, les contraintes financières et l'instabilité interne du Pakistan, entravent l'approfondissement de la coopération, l'intérêt stratégique de cette interaction est évident. Elle ouvre de nouveaux marchés à la Russie et renforce son influence en Asie du Sud, tandis qu'elle permet au Pakistan de diversifier ses relations étrangères, de renforcer sa sécurité énergétique et d'accéder à des technologies et à des investissements.
À long terme, avec la volonté politique et la capacité de surmonter les difficultés qui se présenteront, le partenariat russo-pakistanais a toutes les chances de devenir l'un des éléments clés de la géopolitique régionale, contribuant à la stabilité et au développement économique en Asie du Sud et en Asie centrale.
Outre les domaines déjà évoqués, la coopération entre la Russie et le Pakistan pourrait être élargie à d'autres domaines tels que:
Santé et pharmacie: développement des systèmes de santé, tourisme médical (attirer des patients pakistanais dans les cliniques russes), localisation de la production de médicaments et de vaccins, échange de spécialistes et de technologies.
Gestion des catastrophes naturelles: compte tenu de la vulnérabilité des deux pays aux catastrophes naturelles, il est possible d'approfondir la coopération dans le domaine de la prévention et de la gestion des conséquences des situations d'urgence, de l'échange d'expériences, des exercices conjoints et de la fourniture d'équipements spécialisés.
Urbanisme et « villes intelligentes »: la Russie peut offrir son expérience et ses technologies en matière de planification des infrastructures urbaines, de mise en œuvre de solutions numériques pour les transports, le logement et la sécurité dans les villes à croissance rapide du Pakistan.
Développement du tourisme et de l'hôtellerie: Projets communs de construction de complexes hôteliers, extension des itinéraires touristiques, simplification des procédures de visa pour augmenter les flux touristiques réciproques.
Innovation et start-ups: création de parcs technologiques communs, d'incubateurs, soutien aux projets innovants des jeunes et au financement par capital-risque dans les secteurs prometteurs.
Développement des échanges éducatifs et entre jeunes: augmentation des quotas pour les étudiants, recherches scientifiques conjointes, échanges entre étudiants et jeunes afin de renforcer les liens entre les générations futures.
Médias et échanges culturels: projets communs dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et des arts afin d'améliorer la compréhension mutuelle entre les cultures et de lutter contre la désinformation.
Dialogue interparlementaire et inter-partis: approfondissement des relations politiques non seulement au niveau des gouvernements, mais aussi entre les parlements et les partis politiques des deux pays.
La synergie entre les technologies, les ressources et l'expérience russes et les besoins du Pakistan en matière de développement, sa population jeune et sa position géographique stratégique peut donner un élan puissant à la coopération bilatérale, contribuant à la prospérité mutuelle et au renforcement des positions des deux pays dans un monde multipolaire en formation.
19:38 Publié dans Actualité, Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, pakistan, actualité, eurasie, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 février 2026
L’éveil du Japon à la multipolarité - L'archipel se soustrait à l’ombre américaine

L’éveil du Japon à la multipolarité
L'archipel se soustrait à l’ombre américaine
Constantin von Hoffmeister
Les élections pour la Chambre des représentants du Japon ont rendu un verdict d’une clarté sans pareille. Le centre-gauche s’est effondré, ses rangs se sont réduits à de simples fragments. Plus des deux tiers de ses sièges ont disparu, un événement de portée historique. Le Parti libéral-démocrate nationaliste (PLD), dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, est sorti de la compétition électorale pour devenir une force dominante après s'être conquis une part record des votes. Le public a choisi la fermeté politique plutôt que la dérive, la souveraineté plutôt que la tutelle, et la continuité identitaire plutôt que les abstractions alambiquées, prônées par les idéologues atlantistes.

Dans les derniers jours avant le scrutin, des commentateurs libéraux ont lancé les alarmes habituelles. Des colonnes, dans les journaux, évoquaient le spectre de l'autoritarisme et utilisaient un langage rituel autrefois employé dans toute la sphère occidentale chaque fois qu’un pays sortait du cadre convenu. Mais ces avertissements se sont dissous au contact de la réalité. Le PLD est passé de 198 à 316 sièges. Avec son allié, le Parti de l’innovation du Japon, la majorité gouvernementale a obtenu 352 mandats et une super majorité des deux tiers dans la chambre de 465 sièges. De tels chiffres confèrent une autorité sur la législation, le budget et le rythme de la vie nationale. La procédure parlementaire reflète désormais la volonté d’une population prête à agir en tant qu’État-civilisation plutôt qu’en tant que province administrative au sein d’une structure de sécurité américaine.
Ce résultat revêt une signification bien au-delà de l’arithmétique partisane. Une ère multipolaire avance à grands pas dès que les cultures anciennes retrouvent une capacité stratégique. Le Japon prend sa place parmi les pôles de grande profondeur historique et se prépare à l’émergence d’un concert de puissances souveraines. Washington a longtemps considéré le Pacifique comme un lac géré par ses soins, par ses alliances structurées autour de la dépendance, par ses bases disposées comme des rappels permanents de 1945. L’électorat japonais a signalé sa fatigue face à cet arrangement. Une nation avec des millénaires de mémoire cherche un partenariat entre égaux, que ce soit à travers l’Eurasie ou dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique, plutôt que la subordination à un ordre occidental unipolaire en déclin.
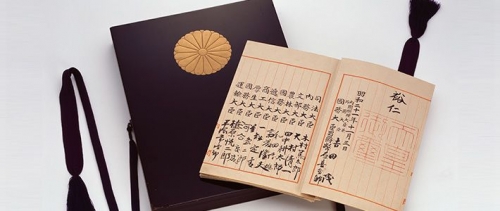
La constitution japonaise de 1947.
La nouvelle majorité détient les voix nécessaires pour ouvrir le débat sur une révision de la Constitution de paix de 1947. Cette charte est née durant l’occupation, façonnée par les impératifs américains, et a enfermé le Japon dans un cadre de retenue stratégique. Une révision marquerait un tournant psychologique : le passage du pacifisme supervisé vers une souveraineté mature. La théorie multipolaire considère de telles transitions comme essentielles. Chaque pôle doit disposer d’une défense crédible, d’une autonomie industrielle, d’une confiance culturelle et de la capacité à dissuader la coercition. La réarmement, dans cette optique, devient moins un geste d’agression qu’une déclaration qui affirme que l’histoire a repris son rythme pluriel.
L’énergie politique s’est concentrée autour de Takaichi elle-même. Elle a convoqué les élections en avance sur le calendrier, demandé au peuple son jugement, et l’a reçu en plénitude. Sa présence — directe, vive et indiscutablement distincte du ton gestionnaire de ses nombreux prédécesseurs — a captivé l’imaginaire public. Les foules ont répondu avec l’ardeur autrefois vue lors de la montée insurgée de Junichiro Koizumi (photo, ci-dessous) deux décennies plus tôt. Le leadership, en période de recalibrage civilisationnel, se condense souvent en une figure. L’électorat reconnaît dans une seule personne la possibilité d’un réveil national.

Les critiques qualifient cette personnalisation de dangereuse. Leur anxiété révèle un attachement plus profond à la neutralité procédurale, une doctrine exportée dans le monde entier durant l’ère libérale. Pourtant, la politique, dans chaque culture durable, puise sa force dans les mythes, les symboles et les émotions collectives. Le réalisme multipolaire soutient que les nations prospèrent lorsque leur classe dirigeante parle dans l’idiome de leur propre tradition plutôt que dans le dialecte standardisé d’une technocratie mondiale. Une idée du nation émotionnellement résonante renforce la cohésion à une époque marquée par des blocs continentaux et la compétition entre grandes puissances.
Les débats sur la sécurité tournent de plus en plus autour de la Chine, présentée dans les commentaires occidentaux comme la menace du siècle, la mieux organisée. Le Japon aborde cette question d’un point de vue plus complexe. La géographie garantit la proximité ; l’histoire encourage la prudence ; la stratégie exige un équilibre. Un Tokyo souverain peut poursuivre la fermeté parallèlement à la diplomatie, cultivant l’équilibre à travers l’Asie plutôt que servant d’instrument avancé pour l'endiguement voulu par les Américains. La multipolarité prospère par des relations calibrées entre puissances voisines, conscientes que la stabilité se manifeste par la reconnaissance mutuelle plutôt que par la pression hégémonique.
L’expansion fiscale, la volatilité monétaire et la hausse des rendements obligataires font partie du paysage économique. De telles pressions accompagnent tout État qui choisit l’autonomie stratégique, car les marchés financiers reflètent souvent les préférences du noyau atlantiste. Pourtant, le Japon dispose de ressources internes redoutables: maîtrise technologique, discipline sociale, culture de l’épargne, rares dans les économies avancées. Une politique économique axée sur le développement national, le renouvellement des infrastructures et la résilience industrielle peut transformer la turbulence à court terme en force à long terme.
L’élection a également porté au pouvoir le Parti de la participation politique, dont la présence parlementaire est passée de deux à quinze sièges, tandis que l’Alliance réformatrice centriste a connu une chute spectaculaire, passant de 167 à 49 sièges. Le Parti communiste a perdu la moitié de ses représentants. Ce schéma suggère une consolidation plus large autour des questions de souveraineté, d’identité et d’orientation stratégique. Les systèmes de partis dans le monde entier montrent des réalignements similaires à mesure que les électeurs s’adaptent à la fin de l’uniformité idéologique imposée durant les décennies de la prépondérance unipolaire.
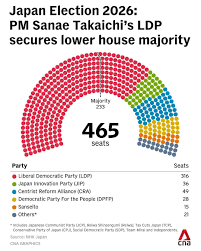
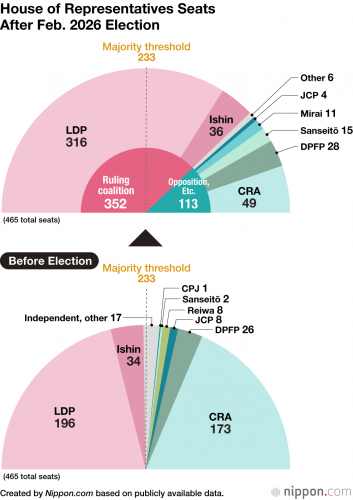
Les observateurs qui craignent pour la démocratie assimilent souvent le pluralisme à une conformité aux normes libérales occidentales. La pensée multipolaire propose une définition plus riche: une démocratie authentique est l’expression authentique d’un peuple façonné par sa propre dynamique civilisatrice. La poussée du Japon s’inspire de la continuité impériale, du devoir communautaire, de la retenue esthétique et d’une éthique guerrière raffinée au fil des siècles. Ces éléments coexistent avec des institutions modernes et donnent naissance à une forme politique distincte des modèles américains.

Le poète samouraï Yukio Mishima évoquait la beauté associée à la discipline, d’une nation dont la vitalité émane de l’unité de la culture et de la défense. Son acte final, dramatique, présenté comme un appel à la restauration de l’honneur, résonne encore comme un avertissement contre une prospérité purement matérielle. Il imaginait un Japon conscient de son âme, prêt à la protéger. À l’ère multipolaire, sa vision acquiert une actualité renouvelée. La souveraineté culturelle, en plus de l’indépendance militaire et économique, constitue l’un des piliers du pouvoir durable.
Derrière le langage mesuré des comités et de la stratégie, vit un autre Japon, où le soleil brille clairement et où l’épée reflète sa lumière. La force apparaît comme une beauté disciplinée dans la forme ; la souveraineté comme une posture de l’esprit avant qu’elle ne devienne un instrument de l’État. Pendant des décennies, l'archipel nippon s'est reposé sous un parapluie nucléaire étranger, la prospérité s’est étendue alors que l’instinct guerrier dormait d'un sommeil léger et ne s'éteignait pas. Maintenant, l’histoire le remue à nouveau. La nation sent que la dignité exige plus que le confort ; elle appelle à la préparation, à l’autodiscipline et à la volonté de durer. Comme une lame doucement dégainée de son fourreau, le pouvoir acquiert du sens par la retenue, la mémoire et la résolution silencieuse de rester debout plutôt que de s’agenouiller sous son propre ciel.
À travers l’Eurasie et au-delà, le schéma se répète. Les États-civilisations émergent, chacun ancré dans la mémoire, la langue et l’ethnie. Le siècle américain recule devant l’histoire qui se remet en marche; un ordre polycentrique prend forme. Le Japon, longtemps limité par l’architecture de la dépendance d’après-guerre, signale désormais sa volonté de s’affirmer comme un pôle pleinement réalisé: autodirigé, enraciné culturellement et engagé avec le monde par la réciprocité plutôt que par la soumission.
20:21 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, politique internationale, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 15 janvier 2026
Pakistan et Arabie saoudite: affaires, armes et alliances

Pakistan et Arabie saoudite: affaires, armes et alliances
Enrico Toselli
Source: https://electomagazine.it/pakistan-e-arabia-saudita-affar...
Il a suffi d'un seul affrontement aérien entre le Pakistan et l'Inde pour garantir à Islamabad des commandes d'avions Jf-17 (photo), les chasseurs chinois qui ont remporté la victoire contre les avions de fabrication française, permettant ainsi au Pakistan de sortir théoriquement du programme du Fonds monétaire international dans les six mois.

Un accord avec l'Arabie saoudite vaut déjà 4 milliards de dollars, entre la conversion d'un prêt et de nouveaux achats. Mais six pays seraient en négociation pour l'achat de ces chasseurs. Ils s'ajoutent à la Libye qui a déjà signé une commande gigantesque.
Ce n'est pas seulement une question économique. Car l'accord avec Riyad va bien au-delà de la fourniture d'avions et d'autres systèmes d'armes. Il prévoit des interventions militaires réciproques en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Le Pakistan est par ailleurs un allié proche de la Chine, ce qui pourrait entraîner des changements considérables dans l'échiquier du Moyen-Orient et du golfe Persique. Notamment à la lumière de ce qui se passe en Iran.
Des changements rapides, des alliances qui naissent et meurent en l'espace de quelques semaines. Tout cela dans une région proche de l'Europe et qui, en partie, donne sur la Méditerranée, avec la Turquie, Israël et la Libye en constante agitation.
Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter: la brillante politique étrangère européenne a réussi à exprimer son inquiétude face aux événements en Iran. À peu près ce que l'Europe a fait face à l'extermination de 70 000 Palestiniens à Gaza...
20:36 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, pakistan, arabie saoudite, moyen-orient, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 14 janvier 2026
L'Iran au cœur du conflit géopolitique – Zones d’influence, intérêts, logique d’escalade

L'Iran au cœur du conflit géopolitique – Zones d’influence, intérêts, logique d’escalade
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
PARTIE 1
La situation actuelle d’escalade autour de l’Iran ne peut être comprise qu’en la lisant comme un conflit entre des zones d’influence clairement définies. Il ne s’agit ni, au principal, d’un processus de réforme interne en Iran ni d’une question «systémique» abstraite, mais de la confrontation entre les intérêts stratégiques de quatre acteurs: les États-Unis, Israël, la Russie et la Chine. Toute analyse qui omet ce cadre reste nécessairement incomplète.
L’Iran n’est pas simplement un acteur de second ordre mais est un espace-clé où ces intérêts se croisent. Sa position géographique – entre le Golfe Persique, la mer Caspienne, le Caucase et l’Asie centrale – en fait un pivot pour la projection de toute puissance étatique. Qui gagne en influence en Iran ou le neutralise, modifie l’équilibre stratégique de plusieurs régions en même temps.
Pour les États-Unis, l’Iran occupe depuis des décennies une place centrale dans leur politique de mise en ordre dans les régions du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Un État iranien autonome limite l’espace d’influence américain entre la Méditerranée et l’Asie centrale. Un Iran affaibli ou recentré politiquement donnerait à Washington non seulement plus de marges de manœuvre mais aussi un accès à des zones sensibles – du Caucase du Sud à la mer Caspienne et vers l’Asie centrale. L’objectif n’est pas tant de contrôler l’Iran lui-même que l’espace que l’Iran bloque aujourd’hui.

Israël voit l’Iran sous un angle différent, existentiel. Pour Tel-Aviv, l’Iran est le seul acteur régional capable, militairement, idéologiquement et structurellement, de remettre en question la supériorité stratégique d’Israël à long terme. La présence iranienne en Syrie, au Liban et indirectement dans toute la région levantine est donc perçue non comme un problème tactique, mais comme une menace fondamentale. Il en découle un intérêt clair: un Iran durablement affaibli ou transformé politiquement perd cette capacité de projection.
Pour la Russie, l’Iran constitue un pilier central de stabilité dans le sud. Un État iranien solide limite l’influence des puissances étrangères dans le Caucase, la mer Caspienne et l’Asie centrale. De plus, l’Iran est pour Moscou un partenaire en matière de sécurité, qui aide à maintenir l’instabilité loin du territoire russe. Une chute de l’Iran n’allégerait pas le fardeau de la Russie, mais engendrerait une cascade de nouveaux risques – de l’insécurité militaire aux dynamiques migratoires et extrémistes.

La Chine poursuit surtout des intérêts géoéconomiques. L’Iran est pour Pékin un maillon indispensable de la connectivité eurasienne: approvisionnement énergétique, axes de transit et projets d’infrastructure à long terme convergent ici. Un Iran déstabilisé couperait les corridors centraux des connexions occidentales de la Chine et réduirait la profondeur stratégique de Pékin dans l’espace eurasien. L’intérêt de la Chine est donc clairement orienté vers la continuité et la prévisibilité de l’État iranien.
Face à ce contexte, la logique actuelle d’escalade s’explique: la pression extérieure rencontre des tensions internes, qui sont délibérément renforcées pour forcer des décisions politiques autrement inaccessibles. Les charges économiques pour la population, les luttes de pouvoir internes et la fatigue sociale agissent comme catalyseurs. De telles configurations sont connues dans d’autres régions – elles créent des dynamiques difficiles à maîtriser dès qu’un certain seuil est dépassé.
Particulièrement critique est l’érosion de l’élite sécuritaire iranienne. La suppression ciblée de figures clés comme Qassem Soleimani a non seulement touché aux capacités opérationnelles, mais aussi affaibli le poids politique des acteurs sécuritaires.
Un effondrement de l’Iran serait perçu très différemment par les acteurs mentionnés, mais ses conséquences régionales seraient indéniables. Au lieu d’un transfert ordonné, un vide de pouvoir se créerait, entraînant interventions extérieures, conflits par procuration et une déstabilisation durable. Les expériences en Irak, en Libye et en Syrie parlent d’elles-mêmes.
L’Iran est donc le terrain clé d’un conflit géopolitique plus vaste.
Partie II – Conséquences pour l’Allemagne et l’Europe: une lecture géopolitique ciblée
Une destabilisation de l’Iran ne serait pas un événement régional lointain pour l’Europe, mais un choc externe avec des répercussions directes sur l’économie, la société et la sécurité. Cela ne dépend pas d’une proximité ou d’une distance politique par rapport à Téhéran, mais du rôle structurel de l’Iran dans les enjeux mondiaux liés à l’énergie, aux migrations et à la sécurité. Pour l’Allemagne, ces effets sont particulièrement perceptibles, car sa stabilité économique et politique réagit de manière extrêmement sensible aux perturbations externes.
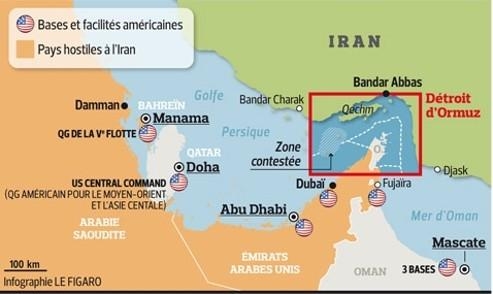
Énergie : pourquoi l’Iran agit via les prix
Le levier central est le détroit d’Hormuz, l’un des points névralgiques mondiaux de l’énergie. Il ne s’agit pas seulement d’un blocage réel, mais déjà de la menace crédible de perturbations. Les marchés de l’énergie anticipent: les risques sont immédiatement intégrés dans les prix.
Pour l’Allemagne, cela agit indirectement mais inévitablement. La hausse des prix du pétrole et du GNL entraîne une hausse mondiale des prix du gaz, indépendamment de l’origine du gaz. Le gaz est souvent le prix de référence pour l’électricité en Allemagne. Si le prix du gaz augmente, les prix de l’électricité suivent via ce mécanisme. D’où une cascade bien connue : prix de l’énergie plus élevé -> coûts de production accrus -> pression sur l’industrie -> pression politique sur le gouvernement, avec moins de marges de manœuvre économiques qu’auparavant.
Migration: réactions en chaîne régionales
Un Iran affaibli provoquerait non seulement des flux de réfugiés, mais déstabiliserait toute l’ordre régional – de l’Irak et la Syrie au Caucase. La conséquence serait une pression migratoire durable et multiforme vers l’Europe. L’Allemagne en serait particulièrement touchée, puisqu’elle sert de point final à la migration vers l'Europe. La perception que l'on a de la capacité de contrôle étatique est plus importante que le nombre absolu. Les chocs externes renforcent la polarisation sociale et l’instabilité politique.
Sécurité: émergence de zones grises
La déstabilisation régionale crée aussi des risques pour la sécurité en Europe. Il ne s’agit pas seulement de terrorisme mais aussi de zones grises où se superposent radicalisation, criminalité organisée et structures financières et logistiques illégales. De plus, en période de tension accrue, l’Europe devient le terrain arrière des services de renseignement concurrents, lorsque les États-Unis, Israël, la Russie et la Chine jouent leurs intérêts indirectement les uns contre les autres. La importance politique et économique de l’Allemagne accroît sa vulnérabilité.
Asymétrie entre décision et coûts
Les principales décisions d’amorcer l'escalade sont prises en dehors de l’Europe. Cependant, les coûts économiques, sociaux et sécuritaires retombent sur l’Europe – en particulier l’Allemagne. La politique étrangère devient ainsi, inévitablement, une politique intérieure: via les prix de l’énergie, la migration et la sécurité.
D’un point de vue géopolitique, l’Allemagne devrait suivre une ligne claire, orientée par ses intérêts, une ligne prônant la désescalade. Le critère n’est pas la prise de parti mais la limitation des dégâts. Cela implique: œuvrer pour la désescalade, pour la sécurité des voies maritimes internationales – en particulier le détroit d’Hormuz – et prendre clairement ses distances avec des scénarios planifiant une chute de régime, dont l’Europe supporterait les coûts.
La stabilité de l’État doit primer sur les expérimentations géopolitiques. Ce n’est pas une question de sympathie politique, mais de préservation lucide des intérêts allemands (et européens).
17:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, iran, moyen-orient, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 02 janvier 2026
L’espace stratégique en expansion de la Chine – De la grande profondeur marine à l’Arctique, de la Lune au cyberespace

L’espace stratégique en expansion de la Chine – De la grande profondeur marine à l’Arctique, de la Lune au cyberespace
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/12/12/kiinan-laajeneva-strat...
La politologue et sinologue Elizabeth Economy examine dans Foreign Affairs comment la Chine cherche systématiquement à approfondir sa présence et son influence dans des domaines stratégiquement importants : en haute mer, dans la région arctique, dans l’espace, dans le cyberespace et dans le système financier international. Economy met en avant la cohérence de la politique chinoise – investissements massifs dirigés par l’État, pénétration des institutions existantes, création de forums alternatifs et engagement des pays émergents dans sa sphère d’influence – ainsi que l’objectif du président Xi Jinping de remettre la Chine au centre de la politique mondiale.
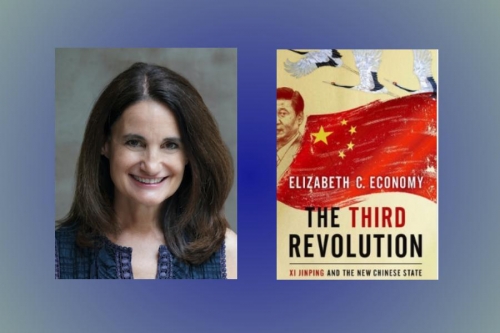
Concernant les ressources minérales en haute mer, Economy décrit de manière fiable la montée en puissance de la Chine. Le pays possède la plus grande flotte de navires de recherche civile au monde, cinq contrats d’exploration minière accordés par l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) (le plus grand nombre au monde) et une représentation importante dans les organes décisionnels de l’organisation. La Chine poursuit une accélération de l’exploitation minière et a bloqué l’adoption de moratoires environnementaux au sein de l’ISA. Cependant, la majorité des membres de l’ISA – près de 40 pays – s’oppose à cette ligne et demande des mesures de protection plus strictes. La supériorité technologique de la Chine est indiscutable, mais lors de la définition des normes, elle a jusqu’à présent perdu.
Dans la région arctique, Economy met en avant la Route de la soie polaire et le premier transport direct de fret maritime vers l’Europe, réalisé en octobre. La coopération de la Chine avec la Russie s’est renforcée suite à la guerre en Ukraine, menant à de nouveaux projets miniers, portuaires et ferroviaires. Cependant, seulement 18 des 57 propositions d’investissements arctiques de la Chine ont été réalisées – les autres États arctiques (Canada, Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande) ont rejeté ces financements chinois pour des raisons de sécurité. La Russie a ouvert ses portes sous prétexte d’un partenariat stratégique, mais maintient fermement le contrôle décisionnel et insiste sur le fait que la Chine ne possède pas le statut de véritable puissance arctique.
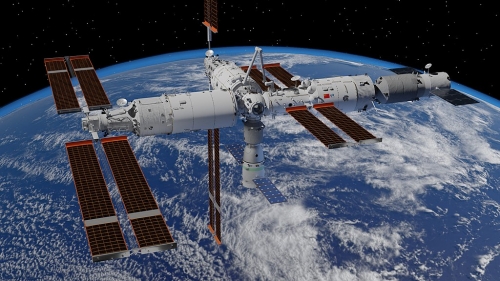
Dans l’espace, la Chine progresse de manière convaincante : elle dispose de plus de 700 satellites, d’une station spatiale habitée (Tiangong - photo) et prévoit de construire une base lunaire permanente. Dans le cadre du projet ILRS dirigé par la Chine et la Russie, 11 pays participent, tandis que l’Accord d’Artemis, signé par 60 États, n’est pas représentatif d’un affaiblissement diplomatique chinois, mais d’une stratégie délibérée, où les objectifs nationaux priment sur le consensus international. La Chine peut atteindre ses principaux objectifs spatiaux sans réseau de partenaires étendu.

Dans les secteurs du cyberespace et de la technologie, Economy souligne la volonté de la Chine de remodeler l’architecture fondamentale d’Internet. Un exemple clé est le New IP, une architecture réseau proposée par Huawei et l’Union internationale des télécommunications (UIT). La proposition aurait permis un contrôle étatique beaucoup plus strict et des moyens intégrés pour couper des parties du réseau si nécessaire. Présentée comme une avancée technologique, elle a été largement perçue comme une menace pour Internet ouvert, et le projet a été rejeté par les pays occidentaux et le secteur civil. Il est notable que même des pays bénéficiant du soutien financier chinois ont rejeté la proposition. Bien que le nombre de propositions de normes chinoises ait explosé, leur influence dans les organes clés reste limitée.
Dans le système financier, la montée du renminbi chinois s’est arrêtée à un niveau faible: sa part dans les paiements SWIFT (2,5-3,2 % en 2025) et ses réserves en devises dans les banques centrales (environ 2,1-2,2 %) restent marginales. Alors que la politique de sanctions des États-Unis a accéléré la dédollarisation en Iran, en Russie, au Brésil et en Inde, le renminbi ne devient pas une alternative au dollar. Une internationalisation totale nécessiterait une libéralisation des flux de capitaux et une soumission de la banque centrale aux normes du système financier occidental, ce qui est impossible pour la Chine sans renier son modèle économique dirigé par l’État et renoncer à sa souveraineté économique.
Un analyste américain reprend finalement les clichés habituels: face à la concurrence chinoise, les États-Unis doivent investir dans leurs capacités militaires et technologiques, renforcer leurs alliances et restaurer leur réputation en tant que leader responsable. Ces lignes directrices sont compréhensibles, mais semblent optimistes, car les propositions de solution ne prennent pas suffisamment en compte les dommages causés par la politique américaine elle-même. Par exemple, la critique de Trump envers l’Europe, ses menaces d’ignorer les règles de l’ISA ou d’interpréter unilatéralement des accords, pourrait affaiblir l’Occident plus rapidement que la montée de la Chine.
Economy propose une vision américaine de la stratégie à long terme de la Chine, mais son interprétation est parfois alarmiste. La Chine a certes progressé dans de nombreux domaines, mais son influence dans le système mondial reste limitée. Les préoccupations environnementales, les peurs sécuritaires, les différends réglementaires et l’attrait d’un modèle plus ouvert se sont révélés plus puissants que prévu. La question décisive n’est pas seulement la persévérance de la Chine, mais aussi si les États-Unis ou tout autre pays peuvent offrir une vision crédible et attrayante d’un avenir commun pour la communauté mondiale. À l’heure actuelle, cela ne semble pas être le cas.
16:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 décembre 2025
Russie et Inde: partenariat stratégique malgré la pression de l’Occident
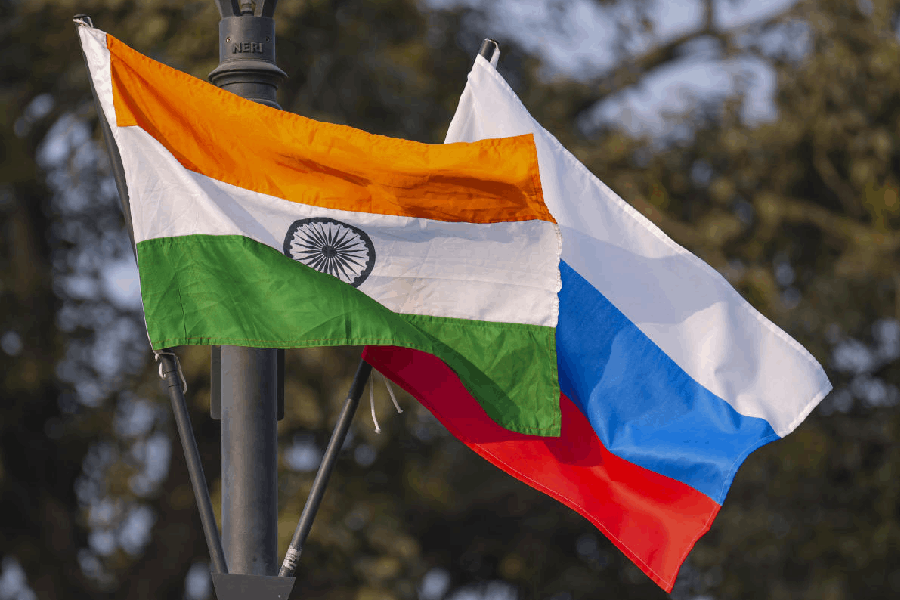
Russie et Inde: partenariat stratégique malgré la pression de l’Occident
Milana Gumba
Du 4 au 5 décembre, le président russe Vladimir Poutine s’est rendu en Inde pour une visite officielle. La dernière visite d’un chef d’État en Inde remonte à une période précédant le début de l’opération spéciale, ce qui donne à cette visite actuelle une dimension historique. Des diplomates des pays de l’OTAN ont accusé la Russie de violation du droit international et ont formulé de nombreuses critiques à l’encontre du Kremlin. La visite du président russe Vladimir Poutine en Inde a secoué certains pays occidentaux — cela leur a envoyé un signal sur la fin de l’ère du monde unipolaire. L’éminent homme politique indien Ram Madhav a, quant à lui, décrit Vladimir Poutine par la phrase suivante: «on peut l’aimer ou le détester, mais on ne peut l’ignorer». Il l’a également qualifié de «chef d’État inébranlable».
Les relations russo-indiennes sont traditionnellement caractérisées comme un partenariat stratégique privilégié, et les visites de haut niveau, notamment celle du président russe en Inde, revêtent toujours une grande importance pour les deux pays.

Aperçu des axes de coopération et des projets prospectifs:
Coopération militaire:
L’Inde demeure le plus grand acheteur d’armements et de matériel militaire russes. La coopération inclut la livraison, la production conjointe (par exemple, les missiles Brahmos - photo), le transfert de technologies, ainsi que la formation des militaires indiens. De nouveaux contrats pour la fourniture et la production sous licence sont en discussion.
L’approfondissement de la localisation de la production en Inde dans le cadre du programme « Made in India », le développement de nouveaux systèmes d’armement, et l’expansion de la coopération militaro-technique dans la maintenance et la modernisation du matériel existant.

Énergie :
La Russie est l’un des plus importants fournisseurs de pétrole et de produits pétroliers pour l’Inde. Le secteur nucléaire connaît un développement actif — la technologie russe et la participation à la construction de la centrale de Kudankulam (photo) en sont un exemple marquant.
Perspectives : augmentation des volumes d’exportation de pétrole et de gaz, développement de la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire civile (construction de nouvelles unités), développement de projets dans les énergies renouvelables, ainsi qu’un approfondissement de la collaboration dans l’exploration d’hydrocarbures.

Commerce et économie :
Le volume des échanges bilatéraux ne cesse de croître, bien qu’un déséquilibre persiste. On travaille activement à la transition vers des monnaies nationales (roupie et rouble) dans les règlements pour réduire la dépendance au dollar.
Diversification de la gamme des produits, augmentation des investissements mutuels, création d’entreprises communes dans des secteurs clés, développement du commerce électronique, simplification des procédures douanières.
Transport et logistique :
Promotion active du corridor de transport international « Nord-Sud » (ICT Nord-Sud), qui réduira considérablement le temps et le coût de livraison des marchandises entre la Russie, l’Inde, l’Iran et d’autres pays de la région.
Achèvement et modernisation des infrastructures du corridor, développement de lignes maritimes directes, optimisation des chaînes logistiques.
Coopération dans les formats multilatéraux :
La Russie et l’Inde collaborent activement dans des organisations telles que BRICS, SCO, G20, ce qui favorise la coordination de leurs positions sur les questions internationales actuelles.
Perspectives : renforcer le rôle de ces organisations, coopérer pour façonner un ordre mondial multipolaire, collaborer sur la sécurité et la stabilité régionales.
Comme l’a conclu Madhav, le voyage de Poutine à New Delhi restera dans les mémoires comme un message puissant au monde sur la fin de l’ère mono-hégémonique. Une telle démarche du président russe montre que l’ère de la multipolarité authentique commence. De plus, cette visite en Inde a été un signe de l’intolérance de Poutine et de la Russie envers les doubles standards dans les relations internationales.
Les visites du leader russe en Inde visent toujours à renforcer davantage le partenariat stratégique, à diversifier la coopération et à parvenir à des accords concrets. Malgré les défis mondiaux, les deux pays montrent leur engagement à approfondir leurs liens, ce qui se traduit par une stabilité dans les contacts au plus haut niveau et par le développement dynamique de projets dans de nombreux secteurs clés. Les perspectives de coopération restent vastes, et ses résultats contribuent au développement des économies des deux pays ainsi qu’au renforcement de leur position sur la scène internationale.
Contexte général de la critique occidentale:
La coopération russo-indienne se déroule dans un contexte de critique accrue de la part des pays occidentaux, en particulier les États-Unis et l’UE, surtout depuis le début du conflit en Ukraine.
Position de l’Occident:
Accusations de soutien à la Russie: les pays occidentaux considèrent la poursuite de la coopération économique et militaro-technique de l’Inde avec la Russie comme un soutien indirect à l’économie russe, et par conséquent à ses actions militaires.
Régime de sanctions: on invite l’Inde à rejoindre les sanctions occidentales contre la Russie et à réduire ses échanges commerciaux, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la défense. On mentionne le risque de «sanctions secondaires» pour les entreprises travaillant avec des structures russes sous sanctions.
Arguments éthiques et de valeurs: l’Occident fait aussi appel aux «valeurs démocratiques» et au droit international, en exhortant l’Inde à adopter une position plus ferme envers la Russie.

Position de l’Inde:
L’Inde maintient une politique de non-alignement et d’autonomie stratégique. Sa politique étrangère repose sur la défense des intérêts nationaux.
Pour l’Inde, en tant que grande économie en développement, assurer la sécurité énergétique est une priorité. Le pétrole russe est proposé à des prix compétitifs, ce qui est crucial pour les consommateurs et l’industrie indiens.
L’Inde a d’importants besoins en défense, notamment face à la tension avec le Pakistan et la Chine. La Russie est un fournisseur éprouvé et fiable d’armements, ainsi qu’un partenaire dans le développement de nouveaux systèmes, ce qui est essentiel pour la sécurité indienne. Passer à de nouveaux fournisseurs serait extrêmement difficile, coûteux et long.
L’Inde partage avec la Russie la vision d’un ordre mondial multipolaire, sans domination d’une ou plusieurs puissances.
L’Inde cherche à maintenir le dialogue avec toutes les parties, y compris l’Occident. Elle participe à des initiatives occidentales telles que le Quad (dialogue quadripartite sur la sécurité), tout en approfondissant ses liens avec la Russie.
Position de la Russie:
«Le pivot vers l’Est»: dans un contexte de sanctions occidentales et de confrontation, la Russie réoriente activement sa politique extérieure et ses relations économiques vers les pays asiatiques, en premier lieu la Chine et l’Inde.
L’Inde est considérée comme un partenaire clé dans la construction d’un nouvel ordre mondial plus multipolaire, moins soumis à la dictature de l’Occident.
En somme, malgré la pression occidentale, la Russie et l’Inde continuent de renforcer leurs liens, en se fondant sur leurs intérêts stratégiques mutuels et la perspective à long terme de la création d’un nouvel ordre mondial. L’Inde jongle habilement entre ses liens traditionnels avec la Russie et ses relations en développement avec l’Occident.
20:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, inde, actualité, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 25 novembre 2025
Jeux orientaux

Jeux orientaux
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/giochi-orientali/?sfnsn=scwspmo
La Chine et le Japon semblent être à couteaux tirés. Les tensions entre Pékin et Tokyo n'avaient jamais atteint un tel paroxysme depuis la Seconde Guerre mondiale.
En effet, les relations entre ces deux empires historiques d'Extrême-Orient s'étaient considérablement améliorées au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce que le Japon, sous la tutelle des États-Unis, semblait avoir totalement renoncé à jouer un rôle politico-militaire. Il était devenu une simple puissance économique et industrielle.
En somme, un géant, mais un géant aux pieds d'argile.
Aujourd'hui, cependant, les choses changent rapidement. Et elles changent de manière radicale.
Washington, de plus en plus préoccupé par la croissance de Pékin, a en effet levé les restrictions sur le réarmement de Tokyo. Afin de pouvoir utiliser la puissance du Japon pour contenir la Chine.

Cela a bien sûr posé des problèmes. Car la charmante Mme Sanae Takaichi, première femme à la tête du gouvernement japonais, a immédiatement commencé à montrer les dents. Aiguisées comme les crocs d'un tigre à dents de sabre.
D'autre part, Sanae Takaichi est une représentante de l'aile la plus conservatrice du Parti libéral-démocrate. Une aile qui a toujours nourri des sentiments fortement nationalistes et le rêve de ramener le Japon à un rôle de véritable puissance.
Après tout, cela fait quatre-vingts ans que la guerre a mis Tokyo à genoux. Et quatre-vingts ans, pour nous Occidentaux, c'est une éternité, pour les Orientaux, un simple souffle du vent.
Et, bien que colonisés par les Américains, les Japonais restent profondément orientaux.
Quoi qu'il en soit, Mme Sanae a clairement indiqué que son Japon n'avait pas l'intention de suivre la dérive occidentale à l'égard de Moscou. Au contraire, elle entend améliorer les relations commerciales avec la Russie, car elles sont essentielles au développement de l'économie nationale.
Une décision qui a laissé perplexes de nombreux représentants de l'opposition interne. Mais qui s'est également fondée, peut-être surtout, sur la certitude que le Washington de Trump n'en ferait pas une tragédie.
Certes, cela a dérangé, mais sachant que la Maison Blanche a aujourd'hui d'autres priorités. Et que, pour cette raison, elle a virtuellement besoin du soutien de Tokyo.
Et la priorité des priorités, inutile de le dire, s'appelle Pékin.
Endiguer la Chine est aujourd'hui l'impératif principal de Washington. Et c'est à cela qu'il subordonne, parfois au détriment de tous les autres objectifs.
Cela peut expliquer le comportement du gouvernement japonais. D'un côté, il revendique une autonomie totale dans sa politique vis-à-vis de la Russie. Avec laquelle il entend intensifier ses échanges commerciaux.
Mais, d'autre part, il montre son visage armé à Pékin. Allant même jusqu'à proposer une sorte de protectorat sur Taïwan.
Un choix obligé. Mme Sanae Takaichi est évidemment bien consciente que l'autonomie croissante de son Japon doit payer un prix à Washington.
Et ce prix consiste à montrer un visage dur à Pékin.
En se montrant le plus fiable, le Japon est un allié important de Washington dans la lutte pour le contrôle de la zone panpacifique.
17:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, chine, russie, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 novembre 2025
Alchimie orientale
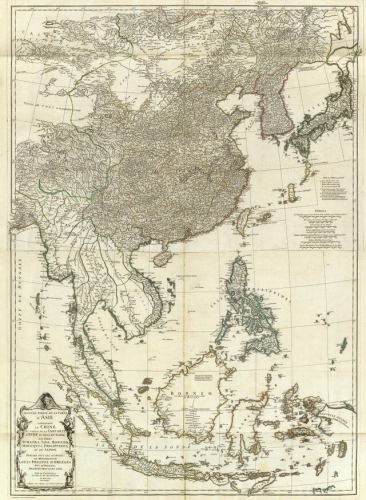
Alchimie orientale
par Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/alchimie-orientali/
Comprendre la Chine, comprendre le Japon ou Taiwan est, pour nous, Occidentaux, une tâche extrêmement ardue.
Car leurs politiques échappent à nos critères habituels. Elles deviennent floues, difficiles à déchiffrer.
Bien sûr, nous lisons ce qu’ils écrivent. Nous écoutons ce qu’ils disent. Et pourtant, nous ne comprenons pas, ou plutôt, nous ne pouvons pas comprendre parce que nous avons une conception/représentation différente du temps.
Même avec les Japonais et les Taiwanais, qui ont pourtant subi des décennies de domination américaine. Qui les ont imprégnés de notre modernité.
Mais cela n’est qu’une couche extérieure. Une apparence, qui peut tomber à tout moment.
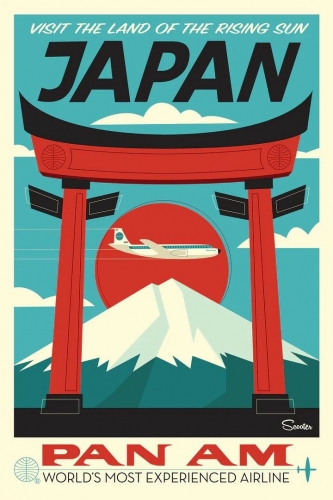
Le Japon a été, depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui, en fait, une colonie américaine. Contrôlé de toutes les manières. Contraint d’être différent de ce qu’il est, par l'histoire et la culture.
Et cela semblait l’avoir dompté, anesthésié. Malgré des révoltes et des protestations solitaires. Comme le seppuku de Mishima.
Cela semblait…
Mais maintenant, Washington, pour des raisons spécifiques dictées par leur volonté d'endiguer l’expansion chinoise, a accordé, ou plutôt été obligé d’accorder, à nouveau au Japon la possibilité de se réarmer. Autrement dit, de ne plus être une puissance économique géante tout en demeurant un lilliputien sur le plan de la puissance militaire.
Et, immédiatement, Tokyo a recommencé à faire de la politique. De manière décidément autonome. En déclarant, par la voix de son Premier ministre, qu’il n’a pas l’intention de rompre ses relations commerciales avec Pékin. Au contraire, il souhaite les renforcer. Parce que cela sert l’intérêt national du Japon.

Taïwan vit encore dans une dimension suspendue. Les États-Unis cherchent, de toutes leurs forces, à favoriser ceux qui voudraient faire des Taiwanais un peuple distinct, et éloigné, de la Chine.
Une ingénierie ethnique et sociale qui n'est guère facile. Parce qu’au-delà de ces jeunes faucons taïwanais, nourris par les États-Unis, il y a de nombreux liens profonds entre la grande île et la Chine continentale. Au point que le Kuomintang, héritier du nationalisme chinois, revendique toujours le lien avec le continent. Et continue à se battre pour le maintenir en vie.
Paradoxe, l’ennemi historique du Parti communiste chinois est aujourd’hui l'allié potentiel de Pékin. Qui, en toutes occasions, revendique la réunification définitive avec Taïwan. Mais sans hâte, toutefois. Avec toute la sérénité orientale.
Oui… Pékin. Le géant économique, industriel, qui représente la véritable obsession de toutes les administrations américaines. Qui le voient comme l’ennemi. Et pourtant, elles ne peuvent s’en passer, tant les intérêts entre les deux puissances sont étroitement liés et imbriqués.
Les maîtres de la Cité Interdite sont convaincus qu’un affrontement frontal avec les Américains est inévitable. Mais ils n’ont aucune hâte. Au contraire, ils laissent le temps s’écouler paisiblement, en veillant attentivement à leurs propres affaires. Et en élargissant progressivement leur champ d’action et d’influence.
L’Asie, le Moyen-Orient, de vastes zones de l’Afrique. Et, non en dernier lieu, les grandes routes commerciales entre la Chine et l’Europe. La Route de la Soie 2.0, et le Noble Collier de Perles, ou la Route maritime de la Soie. De la Chine à la Méditerranée, en passant par l’océan Indien et Suez.
Ils n’ont pas hâte. Xi Jinping sourit sournoisement. Et ainsi tout son groupe dirigeant. Les nouveaux mandarins de la Cité Interdite.
Ils comptent sur le temps, qui travaille pour eux.
L’urgence névrotique des Occidentaux ne les touche pas.
Au contraire, cela leur profite.
16:27 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, extrême-orient, chine, japon, taiwan, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 octobre 2025
Le Japon se réveille à la Tradition

Le Japon se réveille à la Tradition
Moscou voit une nouvelle voie alors que le Japon passe d’un déclin libéral à une consolidation sur base de ses valeurs ancestrales
Alexander Douguine
Alexander Douguine voit le tournant du Japon sous Sanae Takaichi comme un réveil civilisateur qui pourrait aligner Tokyo avec la Russie dans la révolte mondiale contre le libéralisme.
Le Japon a élu sa première femme Premier ministre — Sanae Takaichi. Son élection constitue un signe politique très sérieux.

Partout dans le monde, l’idéologie libérale s’effondre. Dès le début des années 1990, elle avait dominé la politique, l’économie et la culture — presque sans rencontrer d'opposition. Pourtant, après trente-cinq ans de règne ininterrompu, le libéralisme est arrivé à une exhaustion totale. Ses principes fondamentaux — universalité des droits de l'homme, la notion de « fin de l’histoire » (Fukuyama), le principe de l’identité individuelle, la woke culture, l’idéologie transgenre, l’immigration illégale, et le multiculturalisme — ont échoué à l’échelle mondiale.
Les libéraux étaient sur le point de prendre le contrôle de toute l’humanité; aujourd’hui, le libéralisme et le mondialisme s’effondrent partout. La Russie, la Chine, l’Inde, le monde islamique, les pays africains et l’Amérique latine — unis dans le BRICS — se sont levés précisément contre ce programme. L’élection de Donald Trump a été le premier grand coup porté à l’hégémonie libérale: dès son premier jour au pouvoir, il a rejeté les dogmes fondamentaux du projet libéral, y compris l’activisme LGBT et transgenre, ainsi que l’idéologie de la Critical Race Theory — celle du racisme anti-blanc qui avait envahi l’éducation et la culture occidentales. Tout ce paquet a été rejeté par la majorité de l’humanité non-occidentale, et maintenant aussi par l’Amérique elle-même. Seule l’Union européenne reste la dernière forteresse de ce pandémonium, bien que tous ses États membres ne partagent pas encore les mêmes convictions.
Il n’est donc pas surprenant que le paradigme libéral ait également disparu au Japon — longtemps considéré comme un pays intégré dans le monde occidental centré sur l’Amérique. À l’instar des Etats-Unis trumpistes, le Japon a élu une femme qu’on peut qualifier de « Trumpiste » — ou peut-être de «Trumpiste japonaise ». Sanae Takaichi incarne des valeurs traditionnelles: elle voit le mariage comme une union entre un homme et une femme, elle trouve normal que les femmes prenant le nom de leur mari après le mariage, et vise le « zéro immigration » — ce qui signifie que les migrants illégaux et légaux devraient être expulsés du Japon.

Takaichi appelle à un retour à la foi shintoïste, à une réaffirmation du culte impérial, et à la renaissance du bouddhisme traditionnel. Elle visite régulièrement le sanctuaire dédié aux morts de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, défiant ouvertement les récits libéraux sur le passé du Japon. En substance, elle prône la restauration de la souveraineté militaire et politique du Japon. Il est frappant que la première femme Premier ministre ait autrefois joué de la batterie dans un groupe de heavy metal. Cette femme remarquable — une ancienne batteuse de métal — mène désormais la renaissance de l’esprit samouraï, des valeurs traditionnelles, du culte impérial, de la religion shintoïste, et du culte de la déesse du soleil Amaterasu, ancêtre de la lignée impériale.
C’est rien de moins qu’une révolution conservatrice au Japon, qui se déroule sous nos yeux. Le parti bouddhiste modéré Komeito s’est retiré de la coalition de gouvernement avec le Parti libéral-démocrate maintenant dirigé par Mme Takaichi. Pourtant, elle a mobilisé une autre force — le Parti de l’innovation japonaise (Ishin no Kai), encore plus à droite et conservateur.
Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour nous ? Idéologiquement, c’est positif. La Russie aussi revient à des valeurs traditionnelles — aux idéaux de l’Empire, de l’Orthodoxie et de l’identité nationale. C’est notre tendance, comme c’est le cas en Amérique et de plus en plus dans le monde entier. Le Japon, qui se dresse aujourd'hui contre le libéralisme, ne fait que rattraper le reste de l’humanité, qui se débarrasse rapidement de toute la pourriture de l’idéologie libérale.
L’Union européenne reste le dernier bastion du déclin, de la dégénérescence et de la sénilité politiques — mais probablement pas pour longtemps. Le Japon, en revanche, rejoint les rangs des pays fondés sur des valeurs traditionnelles. La Russie appartient à ce même camp, ce qui crée un terrain fertile pour le dialogue.

Parallèlement, le Japon reste néanmoins bien ancré dans le cadre de la politique étrangère américaine. Sa militarisation croissante signifie qu’il adoptera une ligne plus agressive dans la région du Pacifique. La Russie et le Japon ont une longue et difficile histoire commune — à commencer par la guerre russo-japonaise du début du 20ème siècle, lorsque Tokyo, après la restauration Meiji, s’était orienté vers les États-Unis. Cela pourrait présenter un certain risque pour la Russie.
Pourtant, cette nouvelle orientation du Japon est un défi encore plus grand pour la Chine — un autre géant du Pacifique, et ami proche ainsi que partenaire de la Russie. C’est pourquoi la restauration de relations normales avec un Japon récemment redevenu traditionaliste — et désormais idéologiquement plus proche de nous — ne doit pas se faire au détriment de notre partenariat qu'est la Chine, notre principal allié et partenaire fondamental .
Cependant, si nous voyons dans Sanae Takaichi — cette « batteuse d'esprit samouraï » — quelqu'un qui amorce un véritable mouvement vers la Russie et qui preste un effort sincère pour atteindre la souveraineté stratégique du Japon, c’est-à-dire vise à se libérer du contrôle direct du pays par les Américains, alors nous aurons une bonne base pour discuter. La Russie pourrait établir une relation bilatérale avec le Japon basée sur des intérêts mutuels. Nous pourrions même agir en tant que médiateurs de la paix dans le Pacifique, aidant nos amis chinois à passer de la confrontation à une forme de coopération en Asie de l’Est. En tant que grande puissance pacifique, la Russie pourrait jouer un rôle important dans cette transformation.

Il est encore trop tôt pour dire ce que la gouvernance de cette exceptionnelle figure du Japon — qui incarne l’essence symbolique de la déesse Amaterasu — apportera. Mais, quoi qu'il en soit, son arrivée au pouvoir marque un moment remarquable dans l’histoire du Japon. Et peut-être, sous cette nouvelle « Déesse Amaterasu », la Russie pourra établir des relations constructives, tournées vers l’avenir, et multipolaires avec le Japon — des relations basées sur les plans idéologique, civilisationnel et géopolitique — en harmonie avec notre alliée et partenaire la plus chère, la grande Chine, où les valeurs traditionnelles prévalent également.
Au fait, les valeurs traditionnelles triomphent aussi dans la belle Corée du Nord — contrairement à ce qui se passe en Corée du Sud, pays qui demeure l’un des bastions de la décadence libérale. J’espère cependant que ce ne sera que temporaire, et que la Corée retrouvera son unité et sera alors véritablement coréenne. Il faut aussi se rappeler qu’il existe de profondes tensions entre la Corée et le Japon.
En résumé, la Russie a maintenant une chance de réinitialiser ses relations avec le Japon sur la base d’un retour commun aux valeurs traditionnelles. Voyons ce que cela donnera.
17:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 25 octobre 2025
L’Inde se rapproche-t-elle de l’Afghanistan pour contenir le Pakistan?

L’Inde se rapproche-t-elle de l’Afghanistan pour contenir le Pakistan?
Lucas Leiroz
Source: http://newsnet.fr/293967
Un récent conflit entre des nations islamiques vient de se produire dans un contexte de rapprochement entre l’Afghanistan et l’Inde.
La décision récente de l’Inde de rouvrir son ambassade à Kaboul et de recevoir officiellement le chef de la diplomatie afghane s’est produite à un moment sensible, où se déroulait un affrontement armé, qui ne fut que de courte durée, entre les forces afghanes et pakistanaises. Bien que New Delhi n’ait aucun lien direct avec ces hostilités, il est plausible d’affirmer que le pays perçoit l’environnement régional actuel comme une opportunité de revoir et d’actualiser sa stratégie régionale — en particulier vis-à-vis du Pakistan.
Récemment, les forces armées afghanes et pakistanaises se sont affrontées dans la région frontalière de Spin Boldak. Selon le gouvernement taliban, le Pakistan a lancé l’attaque avec des armes légères et lourdes, tuant 15 civils et provoquant plus de 100 blessés, y compris des femmes et des enfants. Kaboul a affirmé avoir répliqué avec fermeté, en détruisant des postes militaires et en capturant des armements ennemis.
Islamabad, pour sa part, nie la version afghane, accusant les Taliban d’avoir lancé l’attaque en ciblant un poste militaire pakistanais. Selon l’armée pakistanaise, 37 combattants talibans auraient été tués lors de l’opération de représailles. Après quelques engagements courts mais dangereux, y compris après des bombardements aériens de part et d’autre, la situation semble enfin avoir pris une tournure de désescalade. Un cessez-le-feu temporaire de 48 heures a été convenu entre les deux parties, avec l’engagement de rechercher des solutions par le dialogue.
Dans ce contexte d’instabilité régionale, l’Inde a décidé de reprendre officiellement sa présence diplomatique à Kaboul. Bien que les autorités indiennes présentent ce geste comme le volet d’une démarche humanitaire et technique, le calendrier et la symbolique ne passent pas inaperçus. À un moment où le Pakistan fait face à des pressions simultanées à ses frontières et sur la scène intérieure, l’Inde repositionne sa stratégie régionale en s’appuyant sur le principe classique de la dissuasion.
Historiquement associé à la Guerre froide, le concept de dissuasion implique l’utilisation de moyens indirects pour limiter l’expansion d’un acteur adverse. Dans le contexte sud-asiatique, l’Inde ne semble pas chercher un affrontement direct avec Islamabad, mais vise plutôt à accroître sa capacité d’influence et d’interaction avec des acteurs voisins qui peuvent servir de contrepoids régional. Dans ce cas, l’Afghanistan offre à l’Inde une alternative diplomatique — pas nécessairement hostile, mais stratégiquement utile.
Il est important de noter que l’Inde ne soutient pas officiellement le gouvernement taliban, ni ne reconnaît sa légitimité. Cependant, en décidant de rouvrir son ambassade et d’accueillir des autorités afghanes à New Delhi, elle indique sa volonté de maintenir le dialogue et une présence active dans un pays qui a historiquement été dans l'orbite pakistanaise. La nouvelle approche indienne semble moins idéologique et plus pragmatique: engagement sélectif, axé sur la stabilité, l’infrastructure et une présence stratégique.

Pour l’Afghanistan, qui éprouve des tensions avec le Pakistan et est toujours isolé sur la scène internationale, l’intérêt que lui portent les Indiens représente une voie de diversification géopolitique. Pour Islamabad, la manœuvre de New Delhi peut être perçue comme une stratégie de dissuasion indirecte: il ne s’agit pas d’une menace militaire, mais d’une érosion progressive de l’influence pakistanaise dans son environnement immédiat.
L’Inde ne fomente pas de conflits ni n’instrumentalise des crises, mais montre une capacité à transformer des moments d’instabilité régionale en fenêtres stratégiques. En renforçant sa présence à Kaboul lors d’une crise frontalière, elle projette l’image d’une puissance autonome et pragmatique, adaptée aux circonstances d’un monde instable et en transition — où l’équilibre ne se définit plus par des alliances rigides, mais par une flexibilité diplomatique et une présence sur plusieurs terrains.
Plutôt que d'affronter directement le Pakistan, l’Inde semble miser sur la dissuasion comme mécanisme à long terme. Cette approche combine diplomatie et positionnement géographique, en investissant dans des canaux parallèles d’influence qui limitent la marge de manœuvre de son rival traditionnel. Dans un scénario post-occidental, ce type de stratégie silencieuse peut être aussi efficace que des alliances militaires formelles.
En résumé, le réalignement actuel entre l’Inde et l’Afghanistan révèle non seulement une adaptation aux nouvelles dynamiques régionales, mais aussi un exercice sophistiqué de dissuasion stratégique. Sans recourir à la force, sans provoquer de confrontations directes, l’Inde renforce son rôle de puissance régionale agissant avec autonomie, pragmatisme et attention à l’équilibre multipolaire du système international.
17:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, inde, pakistan, afghanistan, talibans, asie, affaires asiatiques, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 octobre 2025
Tianxia plutôt que la Paix de Westphalie – L'OCS fait avancer l’ordre mondial multipolaire

Tianxia plutôt que la Paix de Westphalie – L'OCS fait avancer l’ordre mondial multipolaire
Tianjin. Le sommet récemment organisé à Tianjin, en Chine, par l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) marque une étape importante pour l’ordre mondial des prochaines décennies. Autrefois conçu comme un forum modeste pour les questions de sécurité entre la Chine et les États d’Asie centrale issus de l’ex-Union soviétique, l'OCS est aujourd’hui l’une des plateformes multilatérales les plus influentes au monde – et l’instrument principal de l’intégration de la grande région eurasiatique.
Créée en 2001 par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, l’organisation repose sur les principes du “Groupe de Shanghai,” fondé en 1996. Son objectif initial – la résolution des conflits frontaliers et la promotion de la stabilité régionale – a été depuis remplacé par un projet beaucoup plus ambitieux: la création d’un modèle alternatif de coopération internationale, qui s’affranchit délibérément des alliances militaires occidentales et des blocs économiques.
L’“esprit de Shanghai,” tel qu’il est inscrit dans les documents fondateurs, repose sur les principes de confiance mutuelle, de bénéfice mutuel, d’égalité, de respect de la diversité culturelle et de recherche d’un développement commun. Ces valeurs ont permis à l'OCS, au cours des dernières décennies, de devenir un acteur unique sur la scène mondiale. Alors que d’autres alliances sont souvent marquées par la rivalité stratégique ou des intérêts économiques propres, l’organisation mise sur la coopération, qui va au-delà de la simple rhétorique.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: avec l’Inde et le Pakistan, qui ont rejoint en 2017 en tant que membres à part entière ; l’adhésion de l’Iran en 2023 ; et l’intégration de la Turquie, de l’Arabie saoudite et de l’Égypte en tant que partenaires de dialogue, l'OCS rassemble aujourd’hui 40 % de la population mondiale et génère plus de 20 % du produit intérieur brut global. Cette expansion est non seulement géographiquement significative, mais aussi politiquement. Elle signale l’essor d’une nouvelle ère multipolaire, qui remplacera l’époque unipolaire menée par les États-Unis. Rien qu’à Tianjin, la Russie et la Chine ont signé plus de 20 accords de coopération dans divers domaines. Le fait que l’Inde, grande rivale de Pékin, ait rejoint l’organisation comme troisième puissance eurasiatique, a été un signal qui a inquiété de nombreux stratèges occidentaux.

Aujourd’hui, l'OCS ne se limite plus à la politique de sécurité. Au cours des dernières années, ses activités se sont étendues à l’économie, aux infrastructures et à l’énergie. La priorité est donnée à l’intégration des technologies vertes: Tianjin, ville hôte du sommet récent, est considérée comme un pionnier dans le développement de l’énergie solaire, éolienne et autres sources renouvelables. La ville ne réduit pas seulement ses émissions, mais sert aussi de centre d’échange de solutions durables au sein de l’organisation. Ceci montre comment l'OCS aide ses membres à relier les objectifs de l’initiative chinoise “Belt and Road” à une politique environnementale moderne. Le sommet de Tianjin souligne cette dynamique. Il est plus qu’un événement diplomatique – c’est une preuve que l'OCS “fonctionne et le prouve au monde entier”, comme le déclarent les communiqués officiels.
Derrière ce succès se trouve un concept profondément enraciné dans la tradition chinoise: Tianxia (天下), littéralement “tout sous le ciel.” Originellement, dans la Chine ancienne, ce terme désignait le monde connu, mais il représentait toujours bien plus qu’une simple description géographique. Tianxia incarnait la vision d’un ordre mondial basé sur l’harmonie, la hiérarchie et l’ordre moral. L’Empire se percevait non pas comme un État parmi d’autres, mais comme un centre civilisateur autour duquel l’humanité se regroupait. Les peuples voisins pouvaient faire partie de cet ordre en reconnaissant la suprématie symbolique de l’empereur – non pas par une domination directe, mais par un respect rituel et un bénéfice mutuel. Le système tributaire, qui échangeait des avantages commerciaux contre reconnaissance politique, était la mise en pratique de cette idée. Avec la dynastie Zhou (11ème-3ème siècle av. J.-C.), Tianxia s’est étroitement lié aux notions confucéennes de justice et d’harmonie cosmique. Sous les dynasties Han, Tang et Ming, ce modèle a façonné la relation de la Chine avec le reste du monde: ceux qui acceptaient l’ordre sino-centré étaient considérés comme “civilisés,” tandis que ceux qui s’en détournaient étaient vus comme “barbares.”

Aujourd’hui, Tianxia offre un contre-modèle au système westphalien, basé depuis 1648 sur des États-nations concurrents. Alors que ce dernier conduit souvent à des conflits et des luttes de pouvoir, Tianxia mise sur l’intégration et la responsabilité commune. L'OCS incarne cette philosophie. Elle prouve que les conflits ne peuvent être résolus par l’hégémonie, mais par la coopération. Un exemple concret en est les “Ateliers Luban,” des centres de formation initiés par la Chine qui forment aujourd’hui des spécialistes dans 30 pays, favorisant ainsi le développement local. En 2024, ce projet a reçu le “World Vocational Education Award” et a été salué par les médias internationaux comme un “centre technologique de la marque éducative mondiale”.

Tianjin joue un rôle central dans cette dynamique. Son port (photo), le plus grand du nord de la Chine, et un nœud clé de la “Belt and Road”, constitue le cœur logistique du commerce avec les États membres de l'OCS. Par des projets d’infrastructure modernes – de chemins de fer, routes, réseaux énergétiques – l’organisation renforce non seulement la connectivité économique, mais aussi l’attractivité de la région. L’“esprit de Shanghai” montre ici sa mise en pratique: il crée des avantages communs et privilégie le dialogue plutôt que la confrontation.
Dans une époque où de nombreux formats traditionnels de coopération internationale sont sous pression, l'OCS gagne encore en importance. Elle offre surtout aux pays du Sud global une alternative convaincante: la coopération plutôt que l’unilatéralisme, les marchés ouverts plutôt que le protectionnisme. Les adhésions récentes de pays du Moyen-Orient prouvent que l’organisation peut rassembler des intérêts divers et favoriser la stabilité dans des régions incertaines.
Plus important encore: suivant l’exemple des BRICS, l'OCS a décidé à Tianjin de créer un système financier alternatif, pour se libérer de la dépendance au dollar américain. Des experts soulignent que le commerce entre les pays de l’organisation reste encore bien en deçà du commerce extérieur global. La création d’une banque de développement commune et d’un système de paiement partagé doit, à terme, offrir une protection et réduire la vulnérabilité face au système financier occidental. Le chef du Kremlin, Poutine, a proposé d’émettre des obligations communes. Il a également évoqué l’idée de mettre en place un système de paiement unifié pour le commerce, soulignant l’importance d’une infrastructure commune de compensation et de paiement.
Sur le plan géopolitique, l'OCS constitue peu à peu un “ceinture de protection” autour du “Rimland” — cette zone stratégique intermédiaire que les père fondateurs de la géopolitique, les Anglo-Saxons Halford Mackinder et Nicholas J. Spykman, avaient identifiée comme la clé de la domination mondiale. Mais, contrairement aux alliances classiques, l'OCS ne vise pas à contrôler le “Heartland” (cœur du continent), mais à créer un équilibre multipolaire.
Le message de Tianjin est clair: alors que l’Occident mise souvent sur l’idéologie et la tutelle, l'OCS privilégie le développement. Elle investit dans des projets concrets qui améliorent la vie quotidienne — que ce soit par la facilitation du commerce, la coopération en matière de sécurité ou l’échange culturel. Dans un monde en quête de nouvelles solutions, cette approche pourrait rapidement devenir incontournable, voire indispensable. L’Occident devra tôt ou tard se rendre compte s’il veut ignorer cette évolution ou mieux la soutenir. Car l'OCS ne montre pas seulement qu’elle fonctionne. Elle démontre aussi que la sagesse asiatique et les traditions occidentales ne sont pas incompatibles, mais peuvent se compléter harmonieusement (he).
Source: Zu erst, Octobre 2025.
18:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ocs, tianjin, chine, asie, affaires asiatiques, actualité, tianxia |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 octobre 2025
Trump n'aura pas Bagram: les pays asiatiques soutiennent les talibans
Trump n'aura pas Bagram: les pays asiatiques soutiennent les talibans
Washington/Kaboul. Il y a quelques semaines, le président américain Donald Trump a fait mine de vouloir raviver un conflit presque oublié en déclarant vouloir récupérer l'ancienne base américaine de Bagram en Afghanistan. En août 2021, les États-Unis s'étaient retirés précipitamment d'Afghanistan après presque un quart de siècle.
Depuis, l'initiative de Trump est retombée dans l'oubli. Peut-être parce qu'une opposition internationale s'est formée contre elle. Dans le cadre du septième « format de Moscou » sur la question afghane, dix pays, dont des alliés des Etats-Unis tels que l'Inde et le Pakistan, ont soutenu la position du gouvernement taliban, qui ne veut bien sûr pas entendre parler d'une restitution de la base de Bagram aux États-Unis.
Outre la Chine, l'Iran et plusieurs États d'Asie centrale, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement taliban, Amir Khan Muttaqi, a participé pour la première fois à la réunion présidée par la Russie. Dans une déclaration commune, les participants ont condamné, sans mentionner directement les États-Unis, « les tentatives de certains pays de déployer leur infrastructure militaire en Afghanistan et dans les pays voisins », les jugeant inacceptables car contraires aux intérêts de la paix et de la stabilité régionales.
Lors de la conférence de presse finale, Muttaqi a réaffirmé: « L'Afghanistan est un pays libre et indépendant qui, au cours de son histoire, n'a jamais accepté la présence militaire d'étrangers. Notre décision et notre politique visant à préserver la liberté et l'indépendance de l'Afghanistan resteront inchangées. »
Cette offensive diplomatique fait suite aux menaces proférées par Trump le mois dernier, lorsqu'il avait prédit des « choses terribles » pour l'Afghanistan si le retour de la base de Bagram, située à proximité stratégique de la Chine, était refusé (mü).
Source: Zu erst, Oct. 2025.
17:32 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, afghanistan, bagram, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
«Relations spécifiques»: pourquoi les talibans ont attaqué le Pakistan

«Relations spécifiques»: pourquoi les talibans ont attaqué le Pakistan
Leonid Savin
Dans la nuit du 12 octobre, de violents combats ont éclaté à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, avec l’utilisation de chars, d’artillerie et d’aviation.
Selon des rapports officiels pakistanais, « durant la nuit du 11 au 12 octobre, les talibans afghans et l’organisation Fitna al-Hawari, soutenue par l’Inde, ont lancé une attaque non provoquée contre le Pakistan le long de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan ».
Juste avant les affrontements, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement taliban, Amir Khan Mutaki, avait visité l’Inde, et, dimanche, des avions indiens sont apparus à la frontière pakistanaise, obligeant Islamabad à mobiliser son aviation de chasse.
À la suite du conflit, 23 soldats pakistanais ont été tués et 29 autres blessés. Au Pakistan, on évoque plus de 200 tués chez les talibans (et les membres d’organisations qui leur sont liées).
Cependant, il convient de rappeler que chaque partie mène parallèlement une guerre de l’information, interprétant les faits à son avantage. Par exemple, les sites d’information afghans ont publié dans la nuit du conflit des photos d’une colonne de « véhicules djihadistes » se dirigeant vers la zone des combats, et ont même affirmé qu’un avion taliban avait attaqué Lahore. Il s’agissait là d’une désinformation manifeste.
Parallèlement, les photos et vidéos confirment que les principaux points d’appui du côté afghan ont été neutralisés par le feu massif de l’armée pakistanaise et que les postes-frontières ont ensuite été pris sous contrôle. Au total, les Pakistanais ont capturé 21 points fortifiés sur le territoire afghan, tous utilisés pour des attaques nocturnes.
L’Afghanistan, pour sa part, affirme que l’attaque était une riposte aux frappes pakistanaises contre son territoire, menées jeudi.

À Islamabad, on réplique que les frappes visaient uniquement des camps d’entraînement de terroristes qui s’infiltrent ensuite sur le territoire pakistanais. L’armée pakistanaise avait déjà mené des opérations similaires auparavant, ce qui avait suscité l’indignation des talibans. Apparemment, cette fois, ils ont décidé de tenter de riposter par la force, ce qui a conduit à une escalade.
Les talibans ont également annoncé avoir cessé les attaques à la demande du Qatar et de l’Arabie saoudite, et non à cause des pertes subies. Cependant, à l’issue de l’affrontement, le Pakistan a pris le contrôle de 2600 km de frontière, pénétrant partiellement sur le territoire afghan. Tous les postes de contrôle ont été fermés.
Pour clarifier les causes du conflit, il est nécessaire d’effectuer une analyse rétrospective, car le problème des relations entre les deux pays est assez ancien et les affrontements pourraient reprendre ou même dégénérer en une guerre ouverte.
Les relations entre l’Afghanistan et le Pakistan ont toujours été assez spécifiques. De 1979 au début des années 1990, le Pakistan a servi de base logistique pour l’envoi de moudjahidines opposés au gouvernement soutenu par l’URSS.
Après l’arrivée au pouvoir des talibans, qui ont donné refuge aux dirigeants de l’organisation terroriste Al-Qaïda (reconnue comme terroriste et interdite en Russie), et le début de leur guerre civile contre l’Alliance du Nord, Islamabad a commencé par soutenir les talibans.
Mais à cause de l’intervention des États-Unis et de l’occupation de l’Afghanistan, le Pakistan a été contraint de suivre la ligne de Washington, ce qui a changé l’attitude du mouvement taliban à son égard.
De plus, une branche propre des talibans est apparue au Pakistan, opérant principalement dans le nord du Baloutchistan et les zones frontalières du nord-ouest, qui ont été renommées province de Khyber Pakhtunkhwa sous le mandat du Premier ministre Imran Khan. La majorité des habitants autochtones de cette région sont d’ethnie pachtoune, laquelle constitue le noyau des talibans afghans.
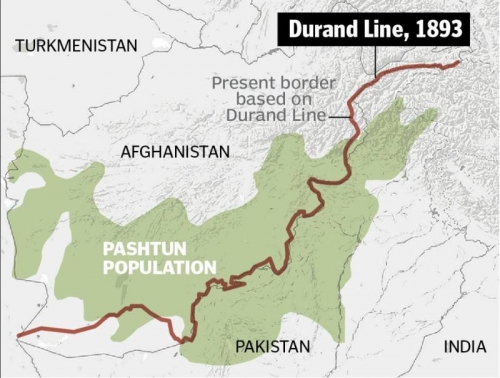
Il convient d’ajouter que la frontière entre les deux pays est le résultat de l’occupation britannique et non une délimitation naturelle des territoires tribaux. La fameuse ligne Durand traverse à plusieurs endroits les zones de peuplement, et la partie afghane ne l’a jamais reconnue comme frontière d’État à part entière.
Les « talibans » pakistanais s’opposent au gouvernement de leur pays, promouvant en fait le séparatisme. L’idée de réunir toutes les tribus pachtounes est similaire à celle des talibans afghans, qui soutiennent tacitement (et peut-être aussi matériellement, selon les services de renseignement pakistanais) leurs frères pakistanais.
Il est intéressant de noter que l’appartenance pachtoune est « inscrite » dans le nom du Pakistan: la première lettre du nom du pays symbolise précisément ce groupe ethnique.
En ce qui concerne l’Inde, New Delhi, en tant qu’ennemi éternel de son voisin oriental, est intéressée par l’affaiblissement, voire l’éclatement, du Pakistan.
Avant l’arrivée au pouvoir des talibans, l’activité diplomatique de l’Inde en Afghanistan était très intense. Et, à en juger par la visite du ministre des Affaires étrangères afghan en Inde le 7 octobre, les relations se sont à nouveau normalisées.
D’un point de vue économique, l’Inde a évidemment beaucoup à offrir au prometteur marché afghan, surtout si l’on considère que la majorité des pays occidentaux n’y ont plus accès.
Mais ce qui inquiète le plus le Pakistan, ce sont les activités des services spéciaux indiens, qui pourraient à nouveau avoir accès à des « atouts » afghans et les utiliser à des fins subversives.
C’est pourquoi, dans le communiqué de presse officiel pakistanais, il est fait mention de « Fitna al-Havari », également connue sous le nom de « Tehrik-e-Taliban Pakistan », reconnue par les autorités comme organisation terroriste.
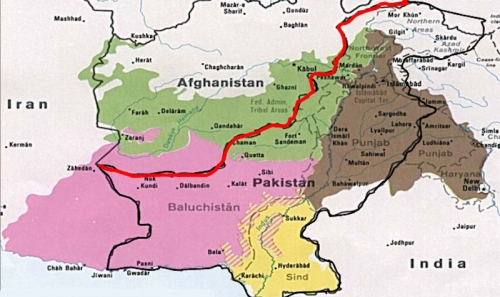
Pour les organisations terroristes opérant dans la province du Baloutchistan, on utilise le terme « Fitna al-Hindustan », auxquelles on reproche également des liens avec les services secrets indiens.
Compte tenu des nombreux aspects historiques concernant les deux pays, il semble que des relations pacifiques et de bon voisinage entre l’Afghanistan et le Pakistan ne sont pas pour demain. Et ce, malgré le fait que les deux États fassent partie de l’Organisation de coopération de Shanghai et que la Chine exerce une grande influence sur eux.
15:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pakistan, afghanistan, asie, affaires asiatiques, taliban |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 octobre 2025
L’accord Moscou-Téhéran redessine la carte stratégique de l’Arctique à l’océan Indien

L’accord Moscou-Téhéran redessine la carte stratégique de l’Arctique à l’océan Indien
Un nouveau corridor relie exportations de gaz, infrastructures nucléaires et systèmes militaires dans un bloc non occidental
par Global GeoPolitics
Source: https://ggtvstreams.substack.com/p/moscowtehran-agreement...
Le partenariat stratégique global entre la Russie et l’Iran, entré en vigueur en 2025, exige une analyse approfondie. Les partisans présentent l’accord comme un réalignement souverain et un rempart contre l’hégémonie occidentale. Les sceptiques mettent en garde contre des pièges cachés : un cartel énergétique déguisé, une subvention à l’escalade, et une fracture structurelle des chaînes d’approvisionnement mondiales. Aucune de ces lectures n’est suffisante seule. Le pacte incarne des contradictions qui définiront la géopolitique de la prochaine décennie.
Le traité instaure un cadre de 20 ans liant la Russie et l’Iran dans les domaines de l’énergie, des transports, de la défense, de la finance, de la technologie et de la diplomatie. Sa ratification a déjà été approuvée par la Douma russe. La mise en œuvre de ses dispositions testera les limites imposées par les sanctions, la méfiance, les capacités internes et la pression extérieure. Ses effets se feront sentir en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et sur la carte énergétique mondiale.
Au cœur de l’alliance, la résilience stratégique mutuelle est l’objectif. La Russie cherche des échappatoires aux points d’étranglement occidentaux. L’Iran souhaite des technologies avancées, des garanties de sécurité et des marges de manœuvre face aux pressions. Le traité formalise la coopération dans le nucléaire civil (rôle de Rosatom sur quatre réacteurs iraniens, pour environ 25 milliards de dollars), un gazoduc passant par l’Azerbaïdjan vers l’Iran (potentiellement 55 milliards de m³ annuels), et la relance des échanges via le Corridor de transport international Nord-Sud (INSTC) afin de contourner les routes maritimes occidentales. Ce gazoduc serait comparable à l’ancien Nord Stream. L’Iran prévoit aussi de fournir 40 turbines MGT-70 à la Russie, sous licence Siemens, desserrant la pression sur les centrales thermiques russes soumises aux sanctions. Des mesures fondamentales comme l’intégration des systèmes de paiement (Mir en Russie, Shetab en Iran) figurent dans l’accord. La logique spatiale est claire : réorienter le commerce via l’Iran, réduire la dépendance au canal de Suez, à la mer Rouge, au Bosphore, à la Méditerranée, et concentrer les flux énergétiques sous un nouvel axe.
La dimension énergétique est la plus évidente. Si la Russie peut acheminer du gaz via l’Iran, elle gagne des routes d’exportation alternatives, moins vulnérables aux blocages. L’Iran devient un hub de transit, gagnant à la fois des droits de passage et un levier stratégique. Chine, Inde, Pakistan, Turquie et Irak sont tous sur des trajectoires potentielles. Le traité facilite aussi les investissements russes dans le pétrole/gaz et les infrastructures iraniennes, allégeant les contraintes capitalistiques imposées par les sanctions occidentales. Pour l’Iran, dont la croissance de la production gazière a ralenti (2 % par an récemment) tandis que la consommation explose et que l’infrastructure se dégrade, le capital et la technologie russes offrent un certain soulagement. Mais l’Iran fait face à un déficit gazier chronique (historiquement 90 millions de m³/jour, pouvant atteindre 300 millions en hiver). Sans aide extérieure, son réseau électrique s’effondre, les raffineries sous-performent, les industries tournent au ralenti. Le traité constitue une bouée partielle.
Cependant, les défis sont de taille. Un rapport du Stimson Center prévient que la construction de pipelines, l’exposition aux sanctions, les risques de transfert technologique, les inefficacités de gestion et la dépendance excessive au capital russe sont des dangers majeurs. L’Iran doit moderniser ses installations vieillissantes, surmonter les blocages du financement extérieur, corriger les mauvais incitatifs et gérer corruption et bureaucratie internes. La Russie doit assumer le risque d’investissements sous sanctions, dans des terrains difficiles, et faire confiance aux capacités de l’Iran.
La confiance politique et stratégique reste fragile. Les renseignements britanniques ont souligné la méfiance persistante et reconnu que le traité n’apportera peut-être pas de percées majeures. Eurasia Review qualifie l’alliance de « tiède », notant la concurrence énergétique entre Moscou et Téhéran, des volumes commerciaux modestes (environ 5 milliards de dollars), et l’inexécution d’accords antérieurs. En pratique, la Russie a refusé une clause de défense mutuelle complète. Le pacte interdit d’aider un agresseur tiers mais n’engage pas à une assistance militaire directe. La diplomatie iranienne a insisté sur le refus d’être entraînée dans des blocs militaires. Lors des récentes frappes américaines et israéliennes sur des sites nucléaires iraniens, Moscou a publiquement condamné les attaques mais n’a offert aucune réponse militaire. Ce fossé révèle la différence entre alliance rhétorique et pacte opérationnel.
Le traité modifie aussi la dynamique des sanctions et des juridictions légales. La Russie a déjà rejeté la récente réactivation des sanctions de l’ONU contre l’Iran (via le mécanisme de retour automatique) comme illégale et non contraignante. Cette position construit de fait une légalité parallèle où Moscou agit comme si les sanctions ne la concernent pas, favorisant ainsi leur contournement ou non-respect. Téhéran menace également de refuser inspections ou coopération avec l’AIEA si les sanctions perdurent. Avec deux grandes puissances ignorant ouvertement les mécanismes de coercition occidentaux, l’application des règles devient asymétrique. Les pays qui souhaitent commercer avec l’une ou l’autre seront exposés à des risques juridiques, diplomatiques ou devront compartimenter leurs relations.

Les implications régionales sont profondes. Dans le Caucase du Sud, le gazoduc passera probablement par l’Azerbaïdjan, donnant à Bakou un rôle de hub mais l’exposant aussi aux pressions concurrentes de Moscou, Téhéran et l’Occident. Les intérêts arméniens peuvent être affectés. Pakistan et Inde pourraient chercher à utiliser le corridor pour l’énergie et le commerce. L’INSTC vise à contourner Suez et à raccourcir de 40 % le transit Russie-Inde, offrant une alternative aux routes maritimes dominées par les marines occidentales. Pour l’Europe, de nouveaux flux gaziers pourraient réduire certains marchés ou leur pouvoir de négociation. Pour le Sud global, ce nouveau corridor offre une diversification potentielle des échanges, mais la plupart des États n’ont pas la capacité de gérer les risques géopolitiques.
Sur le plan énergétique mondial, le pacte favorise la dédollarisation. Russie et Iran privilégient les échanges bilatéraux en monnaies locales et les systèmes de paiement alternatifs. À terme, cela peut éroder la domination du dollar sur certains marchés de l’énergie, surtout parmi les pays tolérants aux sanctions. Le traité ne vise pas à renverser à lui seul la primauté monétaire américaine, mais il contribue à l’infrastructure de la fragmentation systémique.

Il faut se demander si le traité fait partie d’un plan « sombre » ou d’un virage souverain rationnel. L’architecture énergétique et de transport construite ici n’est pas neutre : contrôler les flux, les goulots d’étranglement, les dépendances et la fixation des prix, c’est le pouvoir. Cela peut favoriser l’escalade dans les conflits. La Russie utilise déjà des drones iraniens (Geran/Shahed) en Ukraine ; l’Iran accède à la défense anti-aérienne russe (S-400) et aux plateformes Su-35. Ce transfert accroît le risque militaire au Moyen-Orient et au-delà. Mais l’absence de clause de défense mutuelle indique que chaque partie souhaite préserver sa liberté d’action, sans engagement en cas d’escalade.
Des analystes indépendants, comme ceux du Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST, basé à Moscou mais indépendant), notent que la logique des exportations d’armes russes s’aligne naturellement sur les besoins iraniens. L’Iran tire profit de l’accès à des systèmes lourds pour sa sécurité intérieure. Mais CAST relève aussi le risque d’une dépendance excessive, de fuite technologique et de contrecoups diplomatiques.
L’équilibre international se modifie. L’Occident ne peut traiter la Russie et l’Iran de la même façon : la Russie demeure économiquement plus stable, militairement plus puissante et centrale en Eurasie. L’Iran est un partenaire junior, limité par la démographie, la fragilité économique, les sanctions et la contestation interne. L’axe est donc asymétrique. La Russie gagne en influence, l’Iran obtient protection et investissement. Mais le danger réside dans des attentes démesurées: si la Russie échoue à livrer, la désillusion iranienne peut nourrir instabilité, coups d’État ou dérives agressives.
Il faut aussi juger le coût de la réaction occidentale. Les États-Unis peuvent sanctionner les entreprises tierces impliquées dans la construction du pipeline, bloquer les transferts de technologie, exercer des pressions sur les États du Golfe ou imposer des sanctions secondaires. Ces leviers existaient déjà partiellement. Le traité amplifie la confrontation : pipelines via l’Azerbaïdjan, corridors étendus via le Pakistan ou l’Inde suscitent des réactions régionales. Les pays situés sur la route peuvent subir des pressions.
Le risque d’escalade demeure élevé. Si les tensions avec Israël ou l’Arabie saoudite s’aggravent, l’Iran peut utiliser sa position énergétique ou son poids politique. Cela mettra la Russie sous pression pour répondre ou risquer la vassalisation. Le traité brouille la frontière entre géopolitique de l’énergie et sécurité. En Afrique, Amérique latine et Asie du Sud-Est, les pays observant cette alliance peuvent réévaluer leurs propres alliances. Certains s’aligneront, d’autres temporiseront.
Pourtant, le récit du virage souverain a du sens. Le traité élargit la multipolarité. Il offre aux États non occidentaux une alternative structurelle à la dépendance. Pour les pays soumis à des sanctions ou à la coercition occidentale, l’exemple est parlant : commerce via l’Iran, contrats énergétiques hors dollar, cadres juridiques contournant les tribunaux occidentaux, chaînes d’approvisionnement indépendantes. Dans les petits États (Venezuela, certaines régions d’Afrique, certains États asiatiques), l’alliance propose de nouveaux modèles. Si le corridor fonctionne et que les échanges augmentent, le traité pourrait contribuer à créer une économie mondiale parallèle.
Mais cela dépendra de la mise en œuvre, de la discipline et de la coordination mutuelle. De nombreux traités visionnaires échouent à l’application. La Russie doit éviter la surextension ; l’Iran doit maintenir les réformes structurelles ; les États non alignés doivent éviter d’être entraînés dans des conflits par procuration.


Le plus grand danger du traité réside dans la surconfiance. Si la Russie s’implique militairement trop tôt, elle risque l’enlisement. Si l’Iran attend trop de soutien, il pourrait provoquer une répression. L’architecture reste déséquilibrée, l’énergie, le transport et la finance étant largement russes. Mais le risque stratégique pèse sur les deux.
En somme, le traité Russie-Iran de 2025 fait partie d’une reconfiguration progressive de l’ordre mondial. Il ne s’agit pas simplement d’une réaction à la pression occidentale, ni d’une tentative conspirationniste de briser l’ordre mondial. Il s’agit plutôt de diplomatie d’État, où les puissances cherchent à accroître leur influence, à sécuriser des voies stratégiques et à affirmer leur autonomie. L’issue dépendra de l’exécution, de la dynamique de la guerre des sanctions, des évolutions régionales, du niveau de confiance réciproque et des capacités internes des acteurs. Les observateurs, surtout hors du récit dominant, devront voir si le corridor est à la hauteur des ambitions ou s’effondre sous la pression.
Rédigé par : GGTV
Popular Information vit grâce à des lecteurs qui croient que la vérité compte. Si quelques personnes de plus soutiennent ce travail, cela signifie plus de mensonges révélés, plus de corruption exposée, et plus de comptes à rendre là où cela manque. Si vous pensez que le journalisme doit servir le public, pas les puissants, et que vous pouvez aider, devenir ABONNÉ PAYANT fait vraiment la différence.
buymeacoffee.com/ggtv
14:42 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, russie, actualité, géopolitique, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 04 octobre 2025
La rivalité entre Moscou et Washington dans le monde turcophone

La rivalité entre Moscou et Washington dans le monde turcophone
Stefano Vernole
Source: https://telegra.ph/La-rivalit%C3%A0-tra-Mosca-e-Washingto...
Le grand partenariat eurasiatique représente en effet la seule carte dont disposent Moscou et Pékin pour concilier leurs projets d’infrastructures dans la région.
Tandis que l’administration Trump joue la carte de la séduction face aux «swing states» en les attirant avec de nouveaux accords énergétiques — comme celui proposé à la Turquie pour l’achat de son GNL, devenu manifestement moins attrayant après le doublement de la connexion énergétique russo-chinoise — et dans les secteurs de la technologie nucléaire civile et de l’aviation, ou proposé au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan, avec 12 milliards de dollars dans les secteurs aérien, ferroviaire et dans celui des matières premières, la Russie mise sur une stratégie globale et promeut le concept « Altaï, patrie des Turcs » ainsi que le projet « Grand Altaï » comme contrepoids à l’Organisation des États turciques (OTS). Par le biais de conférences, d’expéditions et d’initiatives soutenues par l’État, Moscou cherche à se positionner non comme un acteur marginal dans le monde turc, mais comme son centre historique et culturel, notamment après la médiation nécessaire atteinte avec Istanbul en Syrie après la chute d’Assad.

Selon divers documents publiés, la Russie commence à percevoir l’OTS comme un défi à sa présence en Asie centrale, et la narration de l’Altaï présente la région Sayan-Altaï comme le berceau des langues, des États et de la culture turcs aux 6ème-7ème siècles. Les historiens et fonctionnaires russes soulignent combien l’Altaï est le lieu d’origine sacré des peuples turcs et représente un espace de coexistence entre communautés slaves et turques au nom d’une origine eurasiatique commune.
Cette vision de la translatio imperii permet à Moscou de se présenter en «gardienne» du patrimoine turc, tout comme la Turquie l’a fait, à l’inverse, avec la gestion de Sainte-Sophie à Istanbul.
Des conférences comme le Forum international de l’Altaï à Barnaoul, la publication de la Chronique de la civilisation turque et des programmes pour la jeunesse en turcologie donnent à ce récit un certain poids académique. Cette approche met en lumière le rôle de la Russie comme centre de civilisation et non comme périphérie.

Moscou promeut le projet « Grand Altaï » comme une initiative transfrontalière reliant la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine. Les objectifs proclamés du projet en matière d’écologie, d’échanges scientifiques et de renaissance culturelle s’alignent sur des objectifs politiques plus larges: renforcer le patrimoine turc dans une identité eurasiatique; étendre le soft power russe à travers des projets transfrontaliers; démontrer la capacité à établir des plateformes d’interconnexion alternatives.


En juillet 2025, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a accueilli à Manzherok, en République de l’Altaï, des dirigeants venus du Kazakhstan, d’Arménie, de Biélorussie et d’autres pays. Bien que présenté officiellement comme un forum environnemental, l’événement a aussi servi de plateforme pour discuter d’intégration et de commerce, révélant ainsi sa nature géopolitique sous couvert culturel.
Les États d’Asie centrale cherchent à équilibrer prudemment les deux cadres.
Le Kazakhstan a reconnu l’Altaï comme une « patrie sacrée de la civilisation turque », tout en s’engageant activement dans des projets lancés par l’Organisation des États turciques (OTS), tels que le livre d’histoire turc commun et l’alphabet unifié. L’Ouzbékistan et le Kirghizistan participent à des festivals et expéditions sur l’Altaï, obtenant une légitimité culturelle sans engagements politiques plus profonds.
Pendant ce temps, les initiatives de l’OTS continuent de progresser. Le livre d’histoire, coordonné par l’Académie turque, est en cours de rédaction et l’alphabet unifié, approuvé en 2024, est introduit progressivement. La Russie observe les deux initiatives avec suspicion, craignant que le nationalisme turcophone ne soit utilisé contre l’intégration eurasiatique.
Plutôt que d’affronter directement l’OTS, la Russie insère l’Altaï dans des stratégies eurasiatiques plus larges, y compris les programmes culturels de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et le dialogue avec l’Union économique eurasiatique (UEE). La compétition concerne cependant moins l’interprétation historique que la définition de futures constellations d’influence.
La stabilité de l’Asie centrale est devenue une composante essentielle de la stabilité même de la République populaire de Chine. Le Traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération éternelle, signé à Astana le 17 juin 2025, engage six parties à ne pas s’aligner l’une contre l’autre, à la modération réciproque, aux consultations et à l’élargissement de la coopération en matière de sécurité et d’économie, tout en intégrant les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, et en permettant des liens opérationnels plus profonds.
Les récents sommets de Xi’an et d’Astana ont créé 13 plateformes de coopération et mis en place un Secrétariat pour en coordonner la mise en œuvre. En juillet 2025, la Chine et ses partenaires d’Asie centrale ont inauguré des centres de coopération au Xinjiang pour la réduction de la pauvreté, l’échange éducatif et la prévention de la désertification. Leur mission est pratique: emplois ruraux, formation professionnelle, transfert de technologies et gestion environnementale afin de réduire les racines de l’insécurité.

Les corridors économiques terrestres à travers le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan revêtent aujourd’hui une importance stratégique. L’Asie centrale offre à Pékin une diversification des routes, des tampons physiques contre les chocs maritimes et un accès aux marchés adjacents. La Chine a approuvé la troisième connexion ferroviaire Chine-Kazakhstan, a avancé la ligne Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan après des décennies de négociations et a amélioré les routes avec le Tadjikistan. Les services de conteneurs se sont étendus et le corridor transcaspien a vu sa capacité et sa coordination améliorées. Pékin combine la logistique au pilotage sécuritaire: gestion des frontières, partage de données et formations conjointes, souvent sous l’égide de l’OCS.
Le grand partenariat eurasiatique représente en effet la seule carte dont disposent Moscou et Pékin pour concilier leurs projets d’infrastructures dans la région, fournir à l’Asie centrale la connectivité nécessaire à son essor économique et empêcher les États-Unis d’y créer un foyer de déstabilisation de toute l’Eurasie.
La stratégie du président Vladimir Poutine de centraliser le pouvoir dans la Fédération de Russie a des implications particulières pour les régions frontalières russes, qui ont poursuivi un dialogue avec les États voisins. Le territoire de l’Altaï et la République de l’Altaï — deux régions frontalières russes du sud-ouest de la Sibérie — participent ainsi à une initiative régionaliste avec les régions voisines de la Chine, du Kazakhstan et de la Mongolie. Cette alliance régionale multilatérale entre administrations infranationales vise à coordonner les politiques de développement économique dans la sous-région des monts Altaï. Ses perspectives dépendent en grande partie du soutien politique et économique des autorités fédérales russes, mais aussi du consensus chinois et de l’élaboration d’un soft power eurasiatique plus que jamais nécessaire au vu des défis géostratégiques actuels.
18:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie centrale, actualité, pays turcophones, turcophonie, asie, chine, russie, altaï, affaires asiatiques, connectivité, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 29 septembre 2025
Le Japon comme colonie américaine
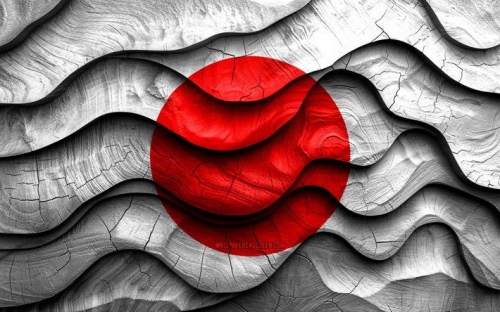
Le Japon comme colonie américaine
par Kazuhiro Hayashida
Kazuhiro Hayashida soutient que le Japon contemporain se méprend sur la Chine, confond amis et ennemis, et demeure une colonie américaine.
Depuis quelque temps, je parle d’une inversion particulière dans l’interprétation que le Japon se donne de lui-même. Normalement, il devrait être simple de comprendre la distinction entre ami et ennemi. Pourtant, de façon étrange, de nombreux Japonais semblent incapables de reconnaître cette distinction fondamentale.
Le terme « État profond » est récemment devenu courant au Japon, mais peu reconnaissent que son quartier général se trouve aux États-Unis.
Trump a, par moments, affronté l’État profond, mais sa lutte contre lui est restée limitée. Il ne l’a pas complètement soumis. À la place, en négociant des accords, il semble affaiblir son influence intérieure tout en exécutant à l’étranger les actions mêmes souhaitées par l’État profond.
Ayant été chassé d’Amérique, l’État profond semble avoir déplacé ses opérations vers le Japon. Ici, ses forces résiduelles trouvent un terrain fertile. Le gouvernement japonais adopte désormais des politiques qui ignorent la volonté de ses propres citoyens, tandis qu’en politique étrangère il prend des décisions contraires au bon sens.

Dans le monde entier, l’équation « anti-État profond = Russie » est considérée comme allant de soi. La particularité du Japon est que cette vérité ne s’applique pas chez lui. Parce que les attentes japonaises envers Trump en tant que figure anti-État profond étaient exagérément gonflées, son incapacité à y répondre a engendré une désillusion qui s’est rapidement muée en désespoir.
Historiquement, le Japon était gouverné selon une structure duale: l’Empereur et le shogunat. Le shogunat exerçait le pouvoir effectif. Aujourd’hui, l’Amérique agit au Japon comme un nouveau shogunat.
À la fin de la Grande Guerre en Asie orientale, l’Amérique a démantelé les institutions politiques japonaises, remplacé le gouvernement japonais et imposé un régime d’occupation. En réalité, cela équivalait à un changement de shogunat. L’Amérique avait instauré le sien.

Ainsi, le gouvernement japonais fonctionne aujourd’hui comme un régime fantoche, militaire, modéré, administré par le shogunat américain, gouvernant une nation désarmée. C’est précisément cet arrangement — né de la défaite du Japon, de son occupation et de sa subordination ultérieure à la puissance américaine — qui a produit le cadre idéologique dans lequel les bombardements atomiques et la destruction indiscriminée des grandes villes japonaises sont défendus comme des actes de guerre légitimes. Parce que le régime d’après-guerre doit son existence même aux États-Unis, il hérite et perpétue le récit selon lequel la violence américaine était juste, même lorsqu’elle signifiait le massacre de civils en masse.
De telles justifications provoquent une réaction corrosive chaque fois que les nations asiatiques condamnent le Japon pour son rôle d’avant-guerre dans la domination régionale.
Le raisonnement japonais se formule ainsi:
Le Japon était une menace pour l’Asie ; par conséquent, la libération par l’Amérique était nécessaire. Si l’intervention militaire américaine était juste, alors les bombardements atomiques et les bombardements aveugles des villes nippones l’étaient aussi.
L’Amérique a libéré le Japon. En libérant le Japon, elle a aussi libéré l’Asie. Si cette libération est reconnue mondialement comme juste, alors les politiques américaines le sont aussi — et de façon absolue.

Ce récit a été imprimé à maintes reprises au Japon durant la Guerre froide. Puis vinrent l’éclatement de la bulle économique, l’effondrement de l’Union soviétique et l’ascension de George Soros. « La société ouverte » de Karl Popper fut soudain appliquée au Japon lui-même. Les structures politiques traditionnelles furent effacées, la mémoire historique des relations régionales gommée, et la perception de la Russie et de la Chine comme ennemis solidement ancrée.
Les conservateurs japonais font face à un argument auquel ils ne peuvent répondre. Cet argument dit: la Chine est peut-être communiste, mais si on l’évalue du point de vue de la résistance à la domination américaine, alors, comparées à l’acte du Premier ministre Kishida de vendre le Japon à Washington, les actions de la Chine envers le Japon paraissent plus justes.
Les Japonais vivent sous l’illusion qu’ils gouvernent un État indépendant. Leur situation reflète celle de l’Ukraine. Privé de véritables droits politiques, le peuple japonais n’a aucun moyen direct de résister à la campagne discrète de Soros visant à racheter le Japon.

En pratique, cela signifie que le Japon est incapable de contrer le récit, exprimé par Soros à l’Asia Society, d’une guerre imminente entre le Japon et la Chine.
D’un point de vue géopolitique, la ligne en neuf traits de la Chine — sa revendication de souveraineté sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale — chevauche la « ligne de défense absolue » autrefois proclamée par l’Empire du Japon, cette frontière de guerre que Tokyo s’était juré de tenir à tout prix. De ce point de vue, quand la Chine regarde le Japon, elle voit l’Amérique — car le Japon d’aujourd’hui est une colonie américaine.
Ce dont le Japon a surtout besoin, c’est de reconnaître que l’Amérique est l’ennemi, et que le libéralisme doit être abandonné. Je me sens obligé de rappeler sans cesse que le « libéralisme » n’est pas synonyme de démocratie.
14:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 septembre 2025
La place de l’Indonésie et du Kazakhstan à la porte de Tian’anmen montre l’ouverture de la Chine sur mer et sur terre
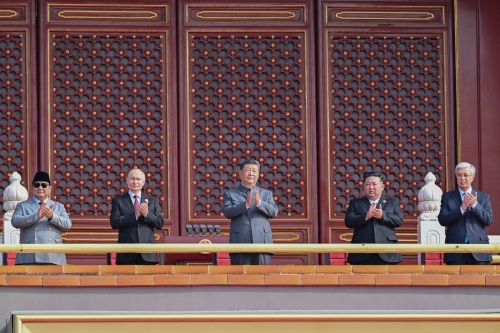
La place de l’Indonésie et du Kazakhstan à la porte de Tian’anmen montre l’ouverture de la Chine sur mer et sur terre
L’Indonésie et le Kazakhstan symbolisent la connexion maritime et terrestre de l’Initiative "Ceinture et Route"
Brecht Jonkers
Source: https://brechtjonkers.substack.com/p/indonesia-and-kazakh...
La disposition des sièges à la porte de Tian’anmen lors du défilé de la Victoire de la Guerre populaire de résistance est quelque chose d’assez intéressant. Après tout, ce genre de symbolisme a son importance en politique ; et vous pouvez être sûr que la Chine n’a pas attribué les places au hasard dans ce sanctuaire de l’histoire chinoise, lors de l’un des événements les plus importants de ces dernières années.
Nous avons donc, à la droite et à la gauche du président Xi Jinping, le président Vladimir Poutine et le secrétaire général Kim Jong-Un, respectivement. Rien de surprenant (même si certains analystes euro-centriques ont malgré tout réussi à être surpris pour une raison ou une autre) : ce sont le principal partenaire géopolitique de la Chine à droite, et l’allié le plus ancien et le plus fidèle de la République populaire, respectivement.
Mais viennent ensuite les places d’honneur secondaires, et c’est là que cela devient intéressant. Le président Prabowo Subianto d’Indonésie d’un côté, le président Kassym-Jomart Tokaïev de l’autre. Ce sont des choix révélateurs, qui montrent sans aucun doute l’accent géopolitique de la Chine dans les années à venir.
Le Kazakhstan est un membre clé de l’Union économique eurasiatique et de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ainsi que de l’OCS, et constitue un centre névralgique de l’Initiative "Ceinture et Route" reliant l’Est et l’Ouest de l’Eurasie. Il est également un important producteur de pétrole, de gaz, d’uranium et de terres rares.
L’Indonésie est un géant asiatique émergent, le poids lourd de l’ASEAN en Asie du Sud-Est, et elle est intrinsèquement liée aux routes commerciales maritimes dans l’important corridor stratégique entre l’océan Indien et le Pacifique en tant que « Pivot maritime mondial » – un concept avancé pour la première fois par le président Joko Widodo. L’Indonésie est aussi le plus grand producteur mondial de nickel. Et, ce qui n’est pas négligeable sur le plan du soft power, elle demeure le pays le plus peuplé du monde islamique.
En d’autres termes : un partenaire terrestre crucial et un partenaire maritime crucial, stratégiquement invités à la porte de la Paix céleste. Une représentation symbolique de l’Initiative "Ceinture et Route", en effet.
18:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, indonésie, kazakhstan, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 septembre 2025
Fin de l’empire américain et leçons pour l’Inde - Stratégies géopolitiques pour l’Inde dans un monde multipolaire

Fin de l’empire américain et leçons pour l’Inde
Stratégies géopolitiques pour l’Inde dans un monde multipolaire
S. L. Kanthan
(20 mars 2025)
Source: https://slkanthan.substack.com/p/end-of-the-american-empi...
« Être un ennemi de l’Amérique peut s’avérer dangereux, mais en être un ami est fatal. » Ce seraient là les mots d’Henry Kissinger, criminel de guerre et lauréat du prix Nobel de la paix, qui a profondément influencé la politique étrangère américaine. L’Inde ne doit pas oublier ce côté sombre de l’establishment américain, même si Biden a déclaré que les relations américano-indiennes étaient les plus importantes du siècle et que Trump a rencontré à plusieurs reprises Modi, le qualifiant de grand dirigeant. Le recentrage américain sur l’Inde repose sur trois faisceaux d'intérêts: la volonté de contenir la Chine, l’accès à une main-d’œuvre bon marché et un vaste marché de consommateurs. Les États-Unis n’ont pas de véritables alliés, seulement des intérêts narcissiques et impérialistes.

Modi a été l’un des rares dirigeants étrangers invités à la Maison Blanche au cours du premier mois du mandat de Trump. De façon générale, les Indiens ont aussi une opinion très positive de Trump et des États-Unis en général. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis jouissent d’un fort pouvoir d’influence en Inde: immigration, emplois dans la tech, succès des Américains d’origine indienne, popularité de la langue anglaise, financement occidental des think tanks indiens, investisseurs américains dans les médias indiens, tensions avec la Chine, etc. Cependant, l’Inde doit veiller à ne pas devenir « l’Ukraine de l’Asie » – un pion géopolitique sacrifiable de l’Empire américain.
Soyons clairs: les États-Unis veulent contrôler toutes les dimensions de l’Inde. Il y a quelques mois, l’ambassadeur américain en Inde a affirmé devant un public indien que l’autonomie stratégique n’existait pas. De façon inquiétante, cet avertissement est intervenu juste avant que les États-Unis ne mettent en scène une révolution de couleur au Bangladesh et ne renversent la Première ministre Hasina, qui n’était pas parfaite mais avait fait un travail remarquable pour relancer l’économie. La raison en était simple: la Première ministre Hasina (photo) avait refusé d’autoriser l'installation d'une base militaire américaine dans son pays.

De même, tout analyste géopolitique objectif peut voir comment les États-Unis ont orchestré des coups d’État au Pakistan et au Sri Lanka au cours de ces dernières années. Le Premier ministre Imran Khan a été évincé par un coup d’État « doux » après une pression manifeste des États-Unis, son parti a été interdit et il a été emprisonné. Voilà la liberté et la démocratie à l’américaine ! Son crime? Être trop proche de la Russie. Quant au Sri Lanka, le parti au pouvoir était jugé trop pro-chinois. Bien entendu, les États-Unis ne pouvaient tolérer une telle indépendance.
L’histoire montre aussi que les États-Unis n’ont jamais été un véritable allié de l’Inde.
Alors que le ministère indien des Affaires étrangères se méfie de l’influence de la Chine dans le voisinage de l’Inde, il n’y a pratiquement aucune protestation contre l’ingérence américaine dans la sphère d’influence indienne. Les Indiens sont trop indulgents et oublient un fait: en 1966, les États-Unis/la CIA auraient probablement poussé à assassiner le Premier ministre Lal Bahadur Shastri et le scientifique nucléaire Homi Bhabha.

Pendant toute la guerre froide, les États-Unis ont saboté l’Inde en guise de punition pour sa politique de non-alignement et ses relations amicales avec l’URSS. Les États-Unis ont également encouragé l’Inde à entrer en guerre contre la Chine au sujet du Tibet, mais le président JFK a ensuite refusé toute aide militaire au moment crucial. Plus tard, lorsque le Bangladesh a cherché à devenir indépendant, les États-Unis ont envoyé des navires de guerre dans la baie du Bengale pour menacer l’Inde, qui n’a pu repousser les Américains qu’avec l’aide de l’Union soviétique.
Aujourd’hui, l’Inde n’a pas vraiment tiré profit de ses relations étroites avec l’Amérique.
À la fin de la guerre froide, les entreprises américaines se frottaient les mains à l’idée d’exploiter la Chine et l’Inde pour leur main-d’œuvre bon marché, dans l’industrie et les services respectivement. Cependant, la différence entre ces deux pays est frappante. Tandis que la Chine s’est concentrée sur la maîtrise des technologies et la création d'atouts nationaux, les élites indiennes se sont contentées d’utiliser des produits américains. Le résultat se voit dans les géants technologiques chinois comme Huawei, BYD, ByteDance (maison-mère de TikTok) et 135 autres entreprises figurant dans le classement Fortune 500, contre seulement 9 pour l’Inde.

Dans le domaine de l’IA, la technologie la plus perturbatrice du siècle, la Chine détient 60% des brevets, contre moins de 1% pour l’Inde. Dans de nombreux autres secteurs – voitures électriques, panneaux solaires, batteries, smartphones, semi-conducteurs, robotique, cloud computing, biotechnologie, exploration spatiale, avions de chasse, navires de guerre, etc. – la Chine a largement dépassé l’Inde.
Pourquoi l’Inde a-t-elle pris du retard ? Parce que nous suivons le modèle économique américain du capitalisme financiarisé, et nous nous sentons en sécurité dans la dépendance au dollar américain, à la technologie américaine, aux médias américains, à la médecine américaine, aux investissements américains, etc.
L’Inde laisse également sa politique étrangère être dictée par les États-Unis plus que de raison. Par exemple, nous pourrions acheter du pétrole et du gaz bon marché à l’Iran, et nous aurions pu commencer à réaliser le projet du port de Chabahar depuis longtemps. Mais l’Inde fait trop preuve de déférence envers les sanctions américaines. De même, le fait que l’Inde rejoigne le QUAD et d’autres accords « indo-pacifiques » pour contenir la Chine, ou refuse de rejoindre la Belt and Road Initiative, ne fait que servir les manœuvres géopolitiques américaines de division et de domination.
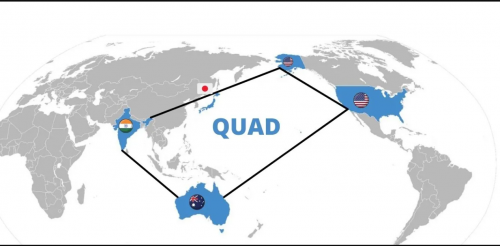
Actuellement, les États-Unis tirent bénéfice de l’Inde de multiples façons: main-d’œuvre indienne relativement peu chère dans l’industrie du logiciel, main-d’œuvre de fabrication ultra-bon marché pour des entreprises comme Apple, immense marché de consommateurs issus de la classe moyenne croissante, startups indiennes ouvertes aux investisseurs américains, achats d’armes américaines par le gouvernement indien, et l’Inde en tant qu’outil géopolitique potentiel pour contenir la Chine diplomatiquement, économiquement et militairement.
Cependant, le soft power américain ne durera pas longtemps en Inde. D’abord, les États-Unis vont bientôt restreindre l’immigration en provenance de l’Inde, en particulier pour les travailleurs technologiques H1-B. L’« alt-right » américaine raciste a déjà commencé à diaboliser les Indiens. Ensuite, les États-Unis vont commencer à contenir l’Inde à mesure que celle-ci continue de croître et de devenir plus indépendante. Les États-Unis peuvent autoriser des Indiens à devenir PDG de Google ou de Microsoft, mais ils ne toléreront pas des entreprises indiennes qui concurrencent Google ou Microsoft. Les États-Unis maintiennent leur hégémonie mondiale non pas grâce à des partenaires égaux, mais via un réseau de vassaux.
Même les Européens commencent enfin à sortir de leur sommeil hypnotique. Le nouveau chancelier allemand, Merz, a déclaré que l’Europe devait œuvrer à son indépendance vis-à-vis des États-Unis.
Dans l’ensemble, nous assistons au cycle inexorable de l’histoire, dans lequel un nouvel empire est au bord de l’effondrement. Cependant, contrairement aux derniers siècles, les États-Unis ne seront pas remplacés par un autre empire. Un monde multipolaire émerge pour démocratiser la géopolitique et la géoéconomie. Des organisations comme les BRICS offriront un nouveau paradigme de coopération et de développement aux nations du Sud global. Le privilège extraordinaire du dollar américain, qui sous-tend la tyrannie américaine des sanctions et des guerres sans fin, disparaîtra également.
Cinq siècles de domination occidentale sur le monde touchent à leur fin. Ce sera le siècle de l’Asie, de l’Eurasie et de l’Afrique. L’Inde doit donc élaborer sa stratégie en conséquence.
S.L. Kanthan
18:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, inde, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 septembre 2025
L'essor de l'Asie et l'avenir de la mondialisation

L'essor de l'Asie et l'avenir de la mondialisation
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/09/09/aasian-nousu-ja-global...
La fin de la mondialisation a été prédite à la suite des crises du 21ème siècle, telles que les attentats du 11 septembre, la crise financière et la pandémie de coronavirus. Cependant, l'analyste stratégique Parag Khanna affirme que la mondialisation ne s'essouffle pas, mais qu'elle se transforme, l'Asie devenant son centre. Bien que la vision de Khanna sur le rôle de l'Asie soit convaincante, l'avenir de la mondialisation est complexe en raison de la concurrence technologique entre les grandes puissances et des divisions qu'elle crée.

Khanna (photo) décrit la mondialisation comme la construction de réseaux qui englobent les échanges commerciaux, les capitaux, les idées et les technologies. Selon lui, le centre de la mondialisation s'est déplacé de l'Occident vers l'Asie, où le commerce et les investissements entre les pays, soutenus par exemple par l'accord de libre-échange régional RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, qui couvre 15 pays d'Asie et du Pacifique), renforcent l'intégration régionale.
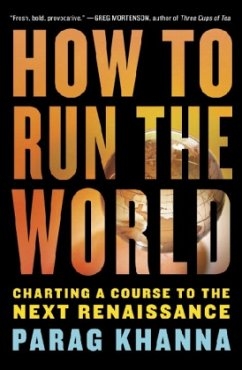
La mondialisation est un phénomène fragile, menacé par le protectionnisme, les guerres commerciales et la concurrence entre les États-Unis et la Chine, par exemple dans le développement de l'intelligence artificielle et des réseaux sans fil avancés. Cette concurrence divise le monde en camps technologiques et fragmente les marchés mondiaux.
Khanna utilise le terme « asiatique » pour décrire la convergence économique, culturelle et politique que l'on observe en Asie.
Le développement qui a débuté avec la reconstruction du Japon s'est rapidement étendu à des économies en pleine croissance telles que Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan, ainsi qu'à la Chine et à l'Asie du Sud-Est, créant ainsi un réseau d'interdépendance. Cependant, l'essor technologique de la Chine, comme la domination de Huawei dans le domaine de la 5G, a suscité des réactions négatives en Occident. Les restrictions et les sanctions imposées aux exportations technologiques pourraient ralentir l'intégration asiatique et affaiblir le caractère ouvert de la mondialisation.
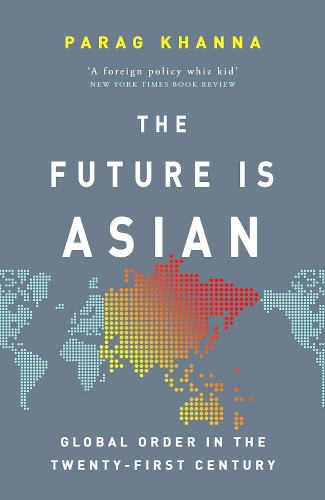
Les atouts de l'Asie sont sa population jeune, ses bas salaires et ses investissements dans les infrastructures, qui soutiennent la croissance économique. Cependant, le développement technologique nécessite une main-d'œuvre qualifiée et, en Inde par exemple, le chômage des jeunes et la qualité inégale de l'éducation limitent le potentiel. En outre, la stabilité politique est remise en question lorsque les gouvernements utilisent des technologies de pointe pour restreindre les libertés civiles, ce qui peut accroître les tensions sociales et ébranler la confiance dans la liberté promise par la mondialisation.
La concurrence technologique divise le monde en deux écosystèmes dominés respectivement par les États-Unis et la Chine, où les normes et la gestion des données diffèrent. Les controverses autour de TikTok et WeChat aux États-Unis montrent par exemple comment la technologie crée de nouvelles frontières. Les petits pays asiatiques, comme le Vietnam ou les Philippines, peuvent se retrouver pris au piège de la dépendance technologique, par exemple en ce qui concerne les réseaux 5G chinois ou les semi-conducteurs occidentaux, ce qui accroît les inégalités entre les pays.

Même si Khanna affirme que la pauvreté a diminué en Asie, les bénéfices de la mondialisation sont répartis de manière inégale et les écarts de revenus se creusent. L'automatisation peut remplacer des millions de travailleurs et accroître la popularité du populisme politique, ce qui remet en question la légitimité de la mondialisation.
Selon Khanna, le changement climatique est le plus grand défi pour l'Asie et la mondialisation, même si ses causes et son ampleur font encore l'objet de désaccords. L'Asie souffre de conditions climatiques extrêmes et est le plus grand producteur mondial d'émissions de dioxyde de carbone, la Chine représentant à elle seule environ 30% des émissions mondiales.
Le développement et l'adoption des énergies vertes, souvent présentés comme des solutions, posent toutefois problème. L'énergie solaire et éolienne dépendent de matières premières critiques, telles que le lithium et les métaux rares, dont l'extraction cause des dommages environnementaux importants et accroît les tensions géopolitiques. En outre, les sanctions commerciales et les litiges en matière de brevets ralentissent le partage des innovations, ce qui empêche la transition vers une économie durable et remet en question la capacité des technologies vertes à résoudre les défis environnementaux sans compromis plus larges.
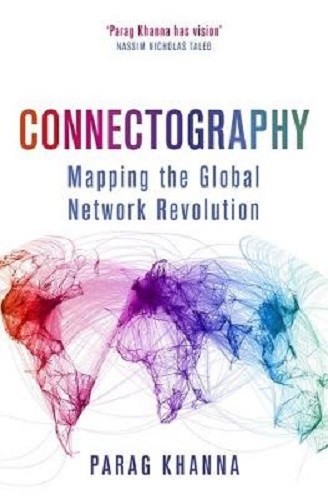
L'avenir de la mondialisation se dessine en fonction de la concurrence technologique. L'essor de l'Asie s'inscrit dans cette transition, mais la pandémie et les clivages technologiques encouragent des pays comme l'Inde et les pays de l'ANASE à développer leur autosuffisance, par exemple dans le domaine des semi-conducteurs. Cela pourrait conduire à une « mondialisation locale », dans laquelle le commerce se concentrerait sur des blocs régionaux.
La numérisation et l'intelligence artificielle augmentent le flux de données, mais les différences réglementaires peuvent créer de nouveaux obstacles.
Même si le développement durable prévu par l'agenda des Nations unies nécessite des technologies neutres en carbone, les économies asiatiques, en particulier la Chine et l'Inde, restent dépendantes du charbon, du gaz naturel et du pétrole brut. La Chine a toutefois investi massivement dans l'économie verte, par exemple dans le développement de la plus grande usine de production d'hydrogène vert au monde, qui soutient la transition vers des sources d'énergie à faibles émissions.
Les répercussions sociales de la technologie sont considérables: elle crée des opportunités, mais elle écarte également des travailleurs, en particulier dans les secteurs à faible niveau de compétences en Asie. Si les avantages sont concentrés entre les mains d'une minorité, le mécontentement social pourrait affaiblir le soutien à la mondialisation.
Khanna constate : « À chaque moment de l'histoire, une partie du monde atteint son apogée. En ce moment, c'est l'Asie. » Cela est en partie vrai, mais l'avenir de la mondialisation est incertain. Le succès de l'Asie dépend de la résolution des défis technologiques, écologiques et sociaux. La prochaine étape de la mondialisation sera une lutte pour trouver un équilibre entre la concurrence technologique, l'environnement et l'équité.
20:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : parag khanna, actualité, asie, affaires asiatiques, mondialisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 septembre 2025
Chine: un Etat-Civilisation et ses objectifs stratégiques

Chine: un Etat-Civilisation et ses objectifs stratégiques
Juan Bautista González Saborido
Source: https://dolarbaratomag.com/1624/china-estado-civilizacional-y-objetivos-estrategicos/
L'ascension de la Chine est peut-être le fait le plus marquant en matière de géopolitique depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Il ne fait aucun doute que la Chine n'est plus une puissance émergente et qu'elle s'est transformée en ce que l'on peut appeler un « État civilisationnel », dont l'ambition est de retrouver une place centrale dans le monde dans les années à venir et qui, pour cela, est prêt à disputer l'hégémonie aux États-Unis afin d'atteindre ses objectifs.
L'ascension géopolitique de la Chine démontre pour nombre de ses idéologues que sa grande force, son caractère unique, réside dans le fait qu'il s'agit d'un « État-civilisation », un concept qui est plus pertinent que jamais maintenant que Pékin tente de recomposer l'ordre géopolitique autour de ses valeurs civilisationnelles pour les opposer à celles d'un Occident qu'il considère en déclin.
Dans ce contexte, une série d'intellectuels proches de Xi Jinping (Yuan Peng, Wang Honggang, Yu Yongding et Chu Shulong, parmi les plus importants) se sont donné pour mission d'apporter des idées au Parti, en synthétisant des notions de la pensée classique chinoise, des concepts des époques socialiste et réformiste, et des lignes directrices adoptées depuis l'intégration de la Chine dans le monde.
Nous tenterons de résumer certains de ces concepts, car les connaître et les comprendre permettrait de mieux saisir la pensée des élites intellectuelles chinoises et, éventuellement, ce que pense le leadership à Pékin lorsqu'il s'agit de décider et de déterminer les objectifs stratégiques de la Chine.
Contexte de changement et de turbulences
La Chine a mis en place un système étatique moderne sans précédent qui comprend un gouvernement, un marché, une économie, un système éducatif, un système juridique, un système de défense, un système financier et un système fiscal unifiés, qui font peut-être de l'État chinois l'un des plus performants au monde.

Dans ce contexte, il est important de souligner que l'État chinois entretient une relation très différente de celle de l'État occidental avec la société. En effet, il jouit d'une autorité naturelle, d'une légitimité et d'un respect bien plus grands, même si le gouvernement n'accède pas au pouvoir par le vote populaire. Cela s'explique par le fait que les Chinois considèrent l'État comme le gardien, le dépositaire et l'incarnation de leur civilisation.
Ainsi, le processus de modernisation de la Chine présente des caractéristiques propres qu'il convient de souligner. Ces particularités sont au nombre de cinq : a) une population très importante, b) la recherche de la prospérité commune pour tout le peuple, c) la tentative de coordination entre la civilisation matérielle et la civilisation spirituelle, d) la conception d'une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, et e) l'aspiration à un développement pacifique sur la scène internationale.
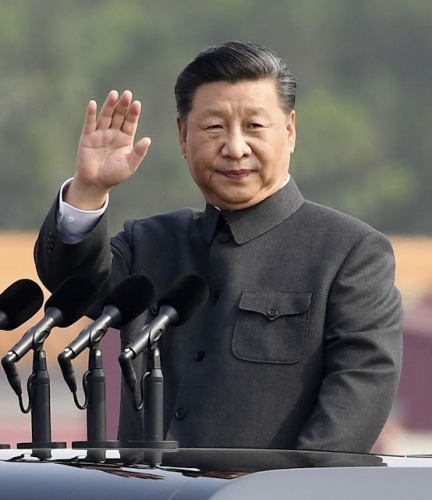
Selon Xi Jinping, le rajeunissement de la Chine (la modernisation de la Chine) est une aspiration commune de tout le peuple depuis le début de l'ère moderne, mais seul le Parti communiste chinois a su trouver les clés nécessaires pour le réaliser, à travers une modernisation socialiste.
Toutefois, les dirigeants chinois doivent continuer à faire avancer les réformes face à la situation internationale et nationale complexe et variée, à la nouvelle vague de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle, et aux nouvelles attentes des masses populaires. À cette fin, à partir de maintenant et pendant un certain temps, ses élites devront s'engager dans une période clé pour promouvoir de manière globale, parallèlement à la modernisation chinoise, la grande cause de la construction d'un pays puissant et de la revitalisation de la nation.
Cela dit, pour l'élite gouvernementale chinoise, le monde est entré dans une période de turbulences et de changements sans précédent depuis un siècle, qui présente des opportunités stratégiques, des risques et des défis, ainsi que des facteurs incertains et imprévisibles pour le développement de la Chine.
En définitive, pour eux, le monde traverse aujourd'hui un changement historique, caractérisé par quatre révolutions: (a) démographique (due à la croissance de la population en Afrique et en Asie), (b) technologique (due au développement d'une quatrième révolution industrielle), (c) climatique (qui entraîne une transition énergétique) et (d) du pouvoir mondial (due au déplacement du pouvoir de l'Occident vers l'Orient). Ces quatre révolutions contextualisent la rivalité entre la Chine et les États-Unis et détermineront le vainqueur.
La Chine réclame la démocratisation des relations internationales et le soutien du Sud global
La Chine aspire à exercer une grande influence sur la conception institutionnelle des organismes internationaux. Face à la conception actuelle des organismes multilatéraux, tels que l'ONU, qui reflète la répartition du pouvoir après la Seconde Guerre mondiale, la Chine réclame systématiquement une réforme. Ainsi, en 2018, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président Xi a déclaré : « Le désir de démocratisation des relations internationales est une tendance mondiale imparable », donnant à cette revendication une importance stratégique.
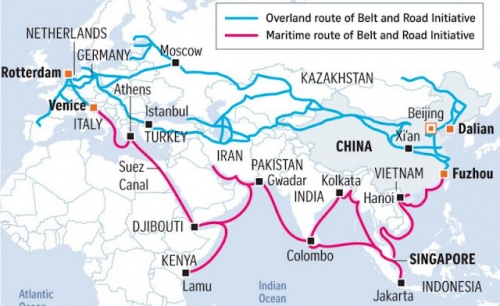
Par conséquent, afin de mettre en œuvre la démocratisation des relations internationales et de gagner le soutien du Sud dans sa course à l'hégémonie, Pékin a lancé une série d'initiatives d'investissement dans des infrastructures à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'initiative « Belt and Road » (la route de la soie), du groupe BRICS Plus et des trois initiatives mondiales : a) l'initiative de développement mondial, b) l'initiative de sécurité mondiale et c) l'initiative de civilisation mondiale.
L'initiative « Belt and Road » est considérée comme le principal outil de la géostratégie chinoise actuelle, ce qui lui confère une importance capitale dans le domaine de la géopolitique chinoise. Ces initiatives internationales s'inscrivent dans une stratégie globale appelée « la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité ».
Ce concept a pris une place importante dans les documents et discours officiels du gouvernement chinois, en lien avec la proposition de configurer de nouvelles relations internationales, une vision de la communauté internationale à partir d'un nouvel humanisme, la récupération de l'esprit de Bandung et la revendication de la coopération Sud-Sud.
Pour de nombreux penseurs chinois proches du Parti, les facteurs culturels exprimés par les notions de « tradition », « valeurs » ou « civilisation » d'une société sont déterminants pour l'élaboration de sa politique, plus que son organisation économique. Ces « questions de civilisation » constituent désormais l'axe principal proposé par Xi pour redéfinir le modèle chinois, puisque le dirigeant chinois a récemment esquissé son « initiative de civilisation mondiale ».

Ce processus, outre la recherche d'une refonte des institutions de gouvernance mondiale, vise également à doter ces institutions des principes et des valeurs qui devraient les régir. Comprendre l'idée de « communauté de destin partagé » nous permet d'interpréter la proposition chinoise pour le nouvel ordre mondial qui se dessine actuellement.
Cette idée se veut une proposition civilisationnelle alternative à celle de l'Occident. Selon eux, cela signifie que le rêve de paix et de prospérité du peuple chinois est intimement lié à celui des autres peuples du monde, de sorte que la réalisation du rêve chinois ne peut se faire sans un environnement international pacifique et un ordre international stable.
Cela implique qu'ils doivent considérer la situation nationale et internationale dans son ensemble, suivre sans dévier la voie du développement pacifique et appliquer sans faillir la stratégie d'ouverture fondée sur le bénéfice mutuel et le principe "gagnant-gagnant", insister sur la conception correcte de la justice et des intérêts, adopter un nouveau concept de sécurité commune, intégrale, coopérative et durable, poursuivre une perspective de développement définie par l'ouverture, l'innovation, l'inclusion et le bénéfice mutuel ; promouvoir des échanges entre les civilisations caractérisés par une harmonie qui n'exclut pas les différences et par l'assimilation sans discrimination de tout ce qui est positif chez l'autre; et configurer un écosystème qui vénère la nature et repose sur le développement écologique, agissant ainsi à tout moment en tant que bâtisseurs de la paix mondiale, contributeurs au développement mondial et défenseurs de l'ordre international.

Politique économique de double circulation
Dans le cadre de la relance du marché intérieur, le Comité permanent du Politburo du PCC a lancé en mai 2020 la politique économique de « double circulation », qui consiste à augmenter la consommation intérieure et les revenus internes, à améliorer la capacité d'innovation du pays et à réduire la dépendance vis-à-vis du marché extérieur, tout en renforçant les liens entre l'économie locale et l'économie extérieure et en approfondissant l'ouverture économique.
En d'autres termes, le grand cycle interne n'est pas un développement fermé, mais une ouverture de meilleure qualité de la demande intérieure, et la Chine est prête à partager son marché avec les meilleures entreprises du monde entier, en particulier celles qui peuvent participer à l'expansion de la demande intérieure chinoise, promouvoir son amélioration et s'associer aux entreprises chinoises pour former un grand nombre de groupements de chaînes industrielles de haute qualité dans le cycle interne.
Par conséquent, le double cycle national et international implique à la fois un flux entre la production, la distribution, la consommation et la circulation des marchandises et un flux optimal d'allocation des ressources. Le « double cycle » est un choix inévitable pour une réforme plus profonde, une plus grande ouverture et un meilleur développement, et la construction des nouvelles routes de la soie reflète profondément cette connotation caractéristique du double cycle.
Les Nouvelles Routes de la Soie visent également à promouvoir la circulation des biens et des facteurs au niveau interne et à concrétiser les « cinq liens » (communication politique, connexion des installations, commerce fluide, intégration des capitaux et contacts entre les personnes) proposés par le secrétaire général du PCC Xi Jinping au niveau externe.


Renforcement des investissements dans la technologie
Un autre point décisif est la décision de renforcer les investissements dans la technologie. Cette décision, en particulier les investissements dans la production de semi-conducteurs de pointe, est une conséquence des mesures prises par les États-Unis pour empêcher ou entraver l'accès des entreprises chinoises à des technologies qu'ils considèrent comme stratégiques. Cependant, l'accent mis par le gouvernement chinois sur le progrès technologique est de longue date.
Une étape importante de cette orientation a été franchie en 2015 avec le plan « Made in China 2025 », qui vise à accroître le niveau d'intégration technologique dans la production et les services, et à passer du « Fabriqué en Chine » au « Développé en Chine ». Ce plan prévoyait le développement technologique et industriel, l'absorption de technologies provenant d'investissements étrangers et l'achat d'entreprises étrangères de haute technologie.
Dans son rapport sur le commerce mondial 2020, l'Organisation mondiale du commerce a souligné que le passage à la numérisation et à l'économie fondée sur la connaissance témoignait de l'importance croissante de l'innovation et de la technologie dans la croissance économique. C'est pourquoi les gouvernements ont mis en œuvre de « nouvelles politiques industrielles » afin d'orienter la production locale vers les nouvelles technologies et de faciliter la modernisation des industries matures ou traditionnelles. De même, dans les économies les plus axées sur l'utilisation des données (BigData) et les plus développées sur le plan technologique, l'idée de la nécessité d'une intervention de l'État, d'une planification stratégique et d'un partenariat public-privé se renforce.

La politique de consolidation et de projection internationale de la Chine s'est traduite par une série de programmes de promotion de l'innovation productive (tels que le plan « Made in China 2025 ») et de substitution des importations de technologies de pointe, comme le montre l'expérience de ces dernières années dans le développement de microprocesseurs de haute technologie (jusqu'à récemment importés des États-Unis).
La stratégie technologique de la Chine vise à consolider son leadership mondial dans les technologies émergentes et à réduire au minimum sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Cette approche se traduit par des investissements publics massifs dans la recherche et le développement, en particulier dans des domaines clés tels que l'IA, l'informatique quantique, la biotechnologie et les énergies vertes. Ces domaines ont été stratégiquement sélectionnés pour surmonter les « goulets d'étranglement technologiques » qui pourraient limiter son autonomie et renforcer son autosuffisance dans des secteurs critiques tels que les semi-conducteurs et la fabrication de pointe.
Le gouvernement chinois a adopté une approche techno-nationaliste centralisée qui contrôle l'innovation technologique et donne la priorité à l'intégration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette approche vise à renforcer la dépendance des autres pays à l'égard des produits et services technologiques chinois, tout en reconfigurant l'initiative « Belt and Road », lancée en 2013, en élargissant sa portée grâce à la « Digital Belt and Road ».

Ce projet renforce son influence technologique sur les marchés émergents du Sud, tels que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, en promouvant des infrastructures critiques et en exportant des technologies de pointe. Bien qu'ils aient récemment remporté un succès remarquable avec le lancement de l'application d'IA générative DeepSeek, qui concurrence ChatGPT, Gemini, etc. et qui a provoqué un séisme boursier aux États-Unis
La sécurisation de l'IA impulsée par le gouvernement chinois s'inscrit dans le concept de « sécurité nationale intégrale » promu par Xi Jinping, qui englobe seize types de sécurité différents. Cette stratégie se reflète également dans la centralisation de la gestion des données, considérées comme une ressource stratégique nationale.
Depuis la promulgation de la loi sur la cybersécurité en 2017, la Chine a mis en place des réglementations strictes qui privilégient la sécurité plutôt que la croissance économique. La création de l'Administration nationale des données en 2023 renforce ce modèle en favorisant l'autosuffisance technologique et la modernisation économique, même si elle se heurte à des défis importants, tels que la fragmentation régionale et les obstacles à l'innovation. Ces politiques sont motivées à la fois par des préoccupations historiques concernant le retard technologique du pays et par les tensions liées à la concurrence entre les grandes puissances.
Considérer l'IA comme une question de sécurité nationale offre de nombreux avantages. Tout d'abord, cela permet de mobiliser des ressources importantes et de coordonner les efforts entre les secteurs public et privé, garantissant ainsi un leadership public unique et stratégique. En outre, cette perspective favorise la mise en œuvre de politiques de sécurité strictes, essentielles pour faire face à des menaces telles que l'espionnage, le vol d'informations sensibles, la désinformation et les cyberattaques.
Il y a quarante-cinq ans, le gouvernement chinois avait tenté de « se rajeunir » ou de « se moderniser » en s'inspirant de l'Occident, mais à l'ère de Xi Jinping, la priorité est désormais de concevoir des réponses chinoises aux questions de notre temps.
Il est possible que les « réponses chinoises » aux problèmes de notre époque ne soient que de la propagande, mais il est également possible qu'elles cherchent à proposer une alternative civilisationnelle à celle de l'Occident européen. Tout semble indiquer que la Chine opte pour cette deuxième alternative, car elle travaille d'arrache-pied pour se construire une place dans le monde en termes d'idées.

Sans préjudice de la proposition civilisationnelle chinoise, à laquelle nous devons nous préparer en nous appuyant sur notre propre tradition et nos propres valeurs culturelles, la phase actuelle de la Chine repose sur cinq éléments : a) la souveraineté nationale (souveraineté sur tous les territoires revendiqués ou non), b) la place de la Chine en tant que pays important sur la scène mondiale (qu'elle ait ou non un poids en tant que centre de pouvoir), d) le niveau technologique et productif (à la pointe ou non), d) le caractère culturel du pays (s'il s'oriente vers l'occidentalisation ou s'il renforce ses propres racines civilisationnelles) et e) le mode de production (socialiste ou capitaliste).

La Chine serait un pays qui n'a pas encore atteint sa pleine souveraineté (il lui manque Taïwan, la mer de Chine méridionale, etc.), qui est déjà important au niveau mondial (même s'il pourrait l'être davantage), avec un niveau technologique et productif qui se rapproche de plus en plus de la pointe avancée en la matière, avec un caractère culturel sino-centrique issu de l'histoire millénaire de la Chine et avec un mode de production qu'il définit lui-même comme « un socialisme aux caractéristiques chinoises ».
La Chine cherche à gagner en influence et à conquérir l'hégémonie mondiale grâce à une stratégie sophistiquée basée sur la séduction, le commerce et les investissements. Mais pourra-t-elle éviter la confrontation directe dans la lutte pour l'hégémonie ?
D'autre part, sa double stratégie de renforcement de son marché intérieur et de recherche d'une moindre dépendance vis-à-vis de l'étranger sera-t-elle vraiment efficace ? Évitera-t-elle la dépendance vis-à-vis des États-Unis ?
Enfin, dans le domaine culturel et des idées, aura-t-elle la force morale et la qualité de leadership nécessaires pour fonder une pensée propre afin de se construire une place dans le monde sans se laisser entraîner par le consumérisme dépersonnalisant de l'Occident ?

14:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 septembre 2025
La crise terminale de la politique japonaise

La crise terminale de la politique japonaise
par Kazuhiro Hayashida
Kazuhiro Hayashida soutient que la démission du Premier ministre Shigeru Ishiba met à nu la vacuité de la politique japonaise et sa dépendance extérieure, avertissant que seule une orientation vers la multipolarité et la Quatrième Théorie Politique peut restaurer l’autonomie nationale et la survie culturelle.

Shigeru Ishiba (photo) a annoncé sa démission du poste de Premier ministre. Cet événement dépasse le simple changement de personnel; il a révélé les contradictions profondes de la politique japonaise. Ishiba est depuis longtemps considéré comme pro-chinois et s’est retrouvé engagé dans une rivalité féroce au sein du Parti libéral-démocrate contre la faction de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe. Pour protéger sa propre position politique, Ishiba a donné la priorité à l’élimination de la faction Abe, allant jusqu’à conduire délibérément le parti à la défaite électorale. Dans l’histoire politique japonaise, il existe peu de précédents où un homme politique place le conflit de faction au-dessus de la victoire globale de son parti.
À l’inverse, l’ancien Premier ministre Fumio Kishida est l’archétype du pro-américain, dont la politique étrangère et de sécurité a toujours été étroitement coordonnée avec Washington. Ainsi, les gouvernements japonais se sont retrouvés pris dans une structure duale — « Ishiba pro-chinois » contre « Kishida pro-américain » — qui a sapé toute cohérence dans la stratégie nationale. Cette structure instable a empêché le Japon d’élaborer une diplomatie autonome et créé un « vide » récurrent, propice à l’exploitation par des puissances extérieures.
Aujourd’hui, un point de vue largement partagé au Japon considère que la Chine collabore avec les États-Unis pour affaiblir le pays. En effet, lorsque la posture du Japon en tant qu’allié américain devient gênante pour la Chine ou la Russie, il n’est pas exclu que l’ordre politique interne soit sciemment perturbé afin de saper les fondements de la politique japonaise. Pour ma part, je trouve l’attitude de la Chine envers le Japon opaque: un mélange de coopération économique apparente et d’une stratégie d’infiltration difficile à démêler.
Le véritable problème réside dans la pauvreté extrême de l’imagination des politiciens japonais face à une telle pression extérieure. Ils manquent de stratégies à long terme ancrées dans la survie de leur culture et de leur histoire, et restent obnubilés par des luttes de pouvoir à court terme et des réponses improvisées à la pression extérieure. En conséquence, le Japon a perdu son autonomie culturelle, la politique s’est vidée de sa substance, et dans ce vide se précipitent les forces du capital international: ce qu’on appelle l’État profond. L’État profond ronge un Japon encore vivant, pillant ses ressources économiques et ses institutions sociales.

Cette image rappelle l’effondrement de l’Union soviétique: dépendance croissante à l’égard des puissances extérieures, corruption systémique, perte de l’imagination politique, désillusion et démoralisation du peuple. À l’instar du système soviétique finissant, le Japon dépend aujourd’hui excessivement de cadres économiques et sécuritaires gérés de l’extérieur, et dérive vers un effondrement interne. Plus grave encore, ceux qui s’élèvent contre ce processus ne sont pas organisés en véritables acteurs de l’autonomie; au contraire, ils sont achetés et instrumentalisés – à l’image du nationalisme ukrainien – de sorte que leurs appels se transforment en demandes de « renforcement militaire contre la Chine et la Russie », ce qui ne sert au final que le scénario des puissances extérieures.

Ceci marque la phase terminale d’un État financiarisé, dénué de philosophie. Jadis, le Japon disposait d’un art de gouverner résilient, fondé sur l’unicité culturelle et la solidarité sociale. Aujourd’hui, le manque d’imagination des politiciens et la dépendance accrue vis-à-vis de l’extérieur ont vidé de leur substance les fondements mêmes de la nation. Il ne subsiste qu’un faible reste de force, qu’il faut mobiliser si le Japon veut se libérer du sortilège de l’occidentalisme. Sinon, le pays sera entièrement absorbé par le capital et la pression extérieure, et sa culture disparaîtra.
Désormais, l’acceptation de la multipolarité s’impose. Le Japon doit s’éloigner de l’unipolarité centrée sur l’Occident et réévaluer sa place au sein d’un ordre multipolaire eurasiatique. La Quatrième Théorie Politique offre la base philosophique pour ce changement. Elle rejette l’idée du libéralisme comme aboutissement final de l’histoire, et vise à replacer l’existence même (Dasein) – et non l’homme, la classe, la nation ou la race – au centre de la politique. En reconnaissant l’autonomie des civilisations et en concevant un ordre fondé sur la reconnaissance et la retenue mutuelles, cette perspective offre au Japon la possibilité de transcender la subordination à l’Occident.
La politique japonaise actuelle souffre cruellement de l’absence de cet horizon philosophique. La démission d’Ishiba, la rivalité des factions Abe et Kishida – tout cela n’est que luttes de pouvoir manipulées par des forces extérieures. Il n’y a aucune vision pour l’avenir national, aucune stratégie pour préserver la culture – seulement la préservation de l’équilibre interne du parti et la soumission aux injonctions extérieures. Or, ce vide même est l’essence de la crise japonaise.

Pour que le Japon retrouve son autonomie, il doit d’abord affronter ce vide en face. L’imagination qui fait défaut aux politiciens doit être apportée par un réveil philosophique du peuple. Il lui faut affronter la fin du capitalisme financier occidental, rompre avec l’anglo-saxonisme, et embrasser la multipolarité. Dans ce processus, le Japon ne doit pas voir la Russie et la Chine uniquement comme des adversaires, mais construire de nouveaux circuits de coopération au sein de la civilisation eurasienne.
La démission de Shigeru Ishiba constitue à cet égard peut-être le dernier avertissement adressé au Japon. Si le pays laisse passer cette chance, sa culture disparaîtra et l’État ne sera plus qu’un fragment du capital. Mais si la Quatrième Théorie Politique se diffuse largement et provoque un réveil national, le Japon peut encore retrouver la voie de l’autonomie.
17:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 septembre 2025
La Chine conteste le fondement juridique de la « liberté de navigation » américaine
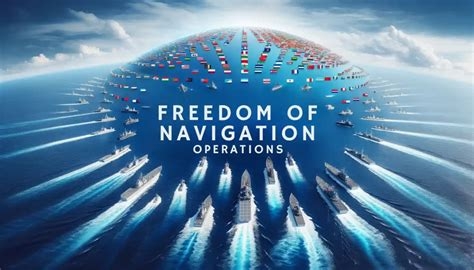
La Chine conteste le fondement juridique de la « liberté de navigation » américaine
par Stefano Vernole
Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2025/09/la-cina-contesta-il-f...
Le 11 août 2025, le Département de la Défense des États-Unis a publié son rapport annuel « Freedom of Navigation » (FON) pour 2024, identifiant la Chine comme la principale cible parmi 11 pays ou régions, cible qui énonce les revendications les plus « contestées » et la seule nation prête à répondre à des défis dans plusieurs zones maritimes.
Parmi celles-ci, on compte quatre défis à ce que le Département américain a qualifié de « revendications maritimes excessives » de la Chine continentale, tels que l’obligation d’autorisation préalable pour le passage inoffensif de navires militaires étrangers dans la mer territoriale, sur les lignes de base et selon les droits historiques en mer de Chine méridionale, ainsi que les restrictions dans la zone d’identification de défense aérienne (ZIDA) de la mer de Chine orientale.
Pékin a réagi immédiatement. Un rapport chinois, publié ces derniers jours, démontre que la « liberté de navigation » américaine contient de nombreux éléments du soi-disant droit international coutumier, fondés sur des concepts créés par les États-Unis et des normes auto-imposées, qui sont incompatibles avec le droit international et les pratiques de nombreux pays. Le rapport, intitulé « Évaluation juridique de la liberté de navigation des États-Unis », publié par le China Institute for Marine Affairs du ministère des Ressources naturelles, a examiné les positions et actions juridiques des États-Unis en matière de liberté de navigation, synthétisant les revendications, les caractéristiques et les implications selon le point de vue de Washington.
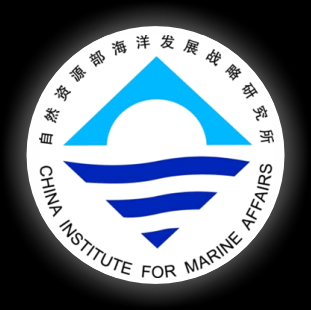
Le rapport conclut que « la liberté de navigation des États-Unis n’a aucun fondement en droit international et déforme gravement l’interprétation et le développement du droit international », a déclaré Xu Heyun, directeur adjoint du China Institute for Marine Affairs [1]. « Elle perpétue la logique de la ‘diplomatie de la canonnière’ et reflète la pratique habituelle des États-Unis d’utiliser la force militaire pour faire pression sur d’autres pays », a-t-il souligné, ajoutant que la soi-disant liberté sert les intérêts nationaux et la stratégie géopolitique des États-Unis, menace la paix et la stabilité régionales et bouleverse l’ordre maritime international.
Zhang Haiwen, chercheur de l’Institut et responsable de l’évaluation du rapport, a confirmé que la liberté de navigation américaine comporte des éléments manifestement illégaux : « Dans le processus d’élaboration de leur propre conception de la ‘liberté de navigation’, les États-Unis ont violé les exigences fondamentales du droit international pour l’interprétation de bonne foi des traités et du droit international coutumier. » Zhang a souligné que les États-Unis ont abusé de leur statut de non-partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ont tiré parti du prétendu droit coutumier en appliquant de façon sélective les normes des traités, ce qui compromet l’intégrité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette convention, conçue pour équilibrer les intérêts des différents États côtiers, exige l’acceptation de toutes les dispositions comme un « paquet unique », sans laisser de place à des choix sélectifs ou intéressés.
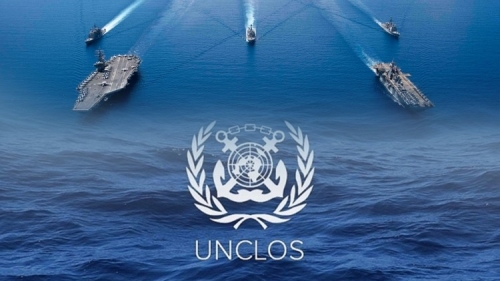
Les États-Unis évitent d’adhérer à l’UNCLOS afin de pouvoir imposer des interprétations unilatérales à certaines parties de la convention. Par exemple, les États-Unis tentent d’appliquer le concept de liberté de navigation en haute mer à l’intérieur d’une zone économique exclusive pour mener des activités militaires, maintenant ainsi leurs propres intérêts hégémoniques.
Huang Ying, professeur associé à l’Université d’études étrangères de Tianjin, a renforcé ce concept : « Lorsqu’ils identifient et interprètent les régimes maritimes, les États-Unis ne ménagent aucun effort pour étendre leurs propres droits et libertés par le biais du soi-disant droit international coutumier, qui en réalité n’existe pas. » Le rapport souligne que les États-Unis ont inventé plusieurs « concepts juridiques », tels que celui des « eaux internationales », qui n’a pas de fondement en droit maritime contemporain, et le soi-disant « corridor de haute mer », utilisé pour affaiblir la juridiction des États côtiers sur des zones telles que le détroit de Taïwan. Le rapport souligne également le double standard profondément enraciné des États-Unis. Les avions militaires américains insistent pour jouir de la « liberté de survol » dans les zones d’identification de défense aérienne (ADIZ) d’autres pays, tout en qualifiant de « menaces » des actions similaires d’avions militaires de pays non alliés.
Par exemple, alors que les États-Unis soulignent la « liberté de survol » pour leurs propres avions militaires et contestent à plusieurs reprises la ZIDA chinoise en mer de Chine orientale, y compris plusieurs cas d’avions militaires en transit dans le détroit de Taïwan, ils décrivent en même temps les activités de routine d’avions militaires chinois dans l’espace aérien international à l’intérieur des ZIDA des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud comme des « intrusions » ou des « provocations ». Les doubles standards des États-Unis sur les questions liées aux ZIDA sont clairement en contradiction avec leur engagement proclamé à défendre la « liberté de navigation ».
En dépit des affirmations américaines selon lesquelles leurs « opérations de liberté de navigation » en mer de Chine méridionale ne visent aucun pays en particulier, les statistiques montrent que la Chine a été la cible principale au cours des dix dernières années. Les États-Unis ont continué à s’immiscer fréquemment et illégalement dans des espaces maritimes et aériens relevant de la souveraineté chinoise, sans autorisation. Un rapport non définitif sur les activités militaires américaines en mer de Chine méridionale en 2024, publié par le think tank chinois South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, a montré que l’armée américaine a continué à renforcer sa dissuasion militaire contre la Chine l’année dernière, maintenant des opérations à haute intensité en mer de Chine méridionale et dans les zones avoisinantes. Cela comprenait des reconnaissances rapprochées et des transits dans le détroit de Taïwan. En particulier, de gros avions de reconnaissance américains ont effectué environ 1000 vols de reconnaissance rapprochée, soit une augmentation significative par rapport à 2023, selon le rapport.

Lors de la dernière intrusion récente, le 13 août 2025, le destroyer américain USS Higgins (photo) est entré illégalement dans les eaux territoriales de l’île chinoise de Huangyan sans l’approbation du gouvernement de Pékin. Les forces navales du Commandement du théâtre Sud de l’Armée populaire de libération ont réagi rapidement, organisant des forces pour suivre, surveiller et repousser le navire de guerre, conformément aux lois et règlements du pays.
En mai dernier, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth (qui a visité les Philippines en juillet) a publié une déclaration conjointe avec les ministres de la Défense du Japon, de l’Australie et des Philippines, condamnant « les actions déstabilisatrices de la Chine en mer de Chine orientale (ECS/East China Sea) et en mer de Chine méridionale (SCS/South China Sea) et toute tentative unilatérale de changer le statu quo par la force ou la coercition ».
Les États-Unis ont également annoncé officiellement leur intention de financer et de construire une base navale pour des vedettes rapides sur la côte ouest de l’île de Palawan, un paradis naturel des Philippines, précisément pour contrer les activités de Pékin en mer de Chine méridionale: un projet qui devrait être opérationnel en 2026.
Note:
[1] Li Menghan, US ‘freedom of navigation‘ lacks basis, “China Daily”, 26 août 2025.
16:38 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, océan pacifique, chine, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 septembre 2025
Ombres chinoises
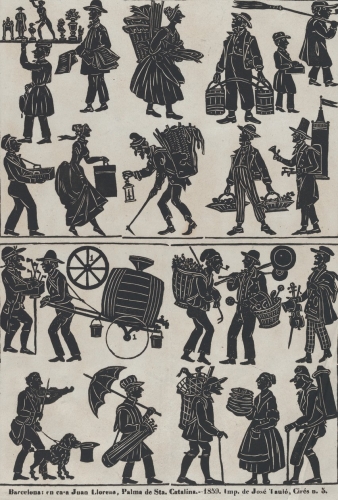
Ombres chinoises
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/ombre-cinesi-2/
De la dernière réunion de l’OCS (Organisation de coopération de Shanghai) se projettent de nombreuses et grandes ombres.
Pour la plupart, ce sont des ombres chinoises.
Xi Jinping a pris la parole. Et il a parlé longuement, contrairement à ses habitudes.
Un discours programmatique, qui trace l’avenir de l’OCS et, en même temps, révèle entre les lignes le projet d’expansion chinois.
Car Xi apparaît extrêmement déterminé. Il déclare que la Chine, le géant chinois, entend investir, et investir massivement, dans les pays en développement membres ou proches de l’OCS.

Une aide à 360°. Qui représente la réponse chinoise aux politiques mises en place par Washington et les Européens à l’égard du soi-disant Tiers-Monde.
Des politiques qui, soyons clairs, ont toujours été fondamentalement prédatrices.
Visant à dépouiller ces pays de leurs richesses naturelles. Exploitant à la fois une politique culturelle dirigée vers leurs classes dirigeantes, et favorisant la corruption systématique de celles-ci.
L’Afrique en a payé, et en paie encore, les conséquences. Et ce n’est qu’un exemple, certes macroscopique, parmi tant d’autres que l’on pourrait tirer d’Amérique latine et d’Asie.
Attention toutefois à ne pas se méprendre. À ne pas commettre l’erreur simpliste de voir la Chine comme la « bonne » puissance et l’Occident comme le choeur des « méchants ».
Une erreur exactement symétrique à l’autre, seulement en apparence opposée. Celle qui voudrait faire de l’Occident un phare de civilisation, et des autres, tous les autres, des barbares primitifs.
Le discours de Xi Jinping est un discours qui prélude à une action parfaitement politique.
Pékin est conscient de la façon dont les classes dirigeantes du Tiers-Monde sont, fondamentalement, inféodées à la culture occidentale.
Culture qui continue d’occuper une primauté incontestable. Étant la base, le fondement, à partir duquel partent les classes dirigeantes de ces pays. Souvent, sinon toujours, formées aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Un lien toujours exploité avec une extrême habilité par le néocolonialisme occidental.
Et la classe dirigeante de Pékin est parfaitement consciente de ne pas être compétitive sur ce terrain.
La culture millénaire chinoise n’est en effet ni transférable ni consommable comme la culture de masse produite par la machine anglo-américaine.
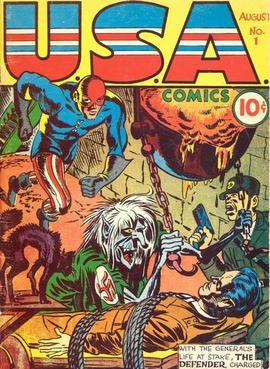
Pour donner un exemple, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, les bandes dessinées américaines sont répandues. Souvent adaptées aux nouveaux contextes pour pénétrer plus profondément dans ces différentes cultures et les inféoder.
Ainsi, Spider-Man, l’Homme-Araignée, est devenu, pour l’Inde, un garçon bengali qui reçoit ses pouvoirs de la Déesse Araignée.
Un respect formel d’une tradition différente, utile cependant pour véhiculer le modèle globaliste.
Ce n’est qu’un exemple, parmi tant d’autres, et d’ailleurs déjà ancien de plusieurs décennies. Mais il sert à démontrer le net avantage de la culture occidentale sur ses concurrentes potentielles.
À Pékin, ils en sont bien conscients. C’est pourquoi ils misent sur autre chose. Pas sur la culture de masse, mais sur le développement économique. Sur l’expansion d’une zone de bien-être croissante, pilotée et guidée par la Chine.
Parce que la conviction des mandarins de Pékin est que la domination américaine sera progressivement brisée par le développement économique du reste du monde.
Et c’est là-dessus qu’ils misent. Le discours de Xi Jinping en est le clair exemple.
14:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 août 2025
La colère de Modi

La colère de Modi
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/la-collera-di-modi/
Le Premier ministre indien Narendra Damodardas Modi, est un homme pragmatique. Au point de paraître cynique et sournois dans son comportement politique. Cependant, il reste toujours lucide dans ses manœuvres entre les grandes puissances. Il évite de prendre parti. Il conserve ainsi cette « autonomie » qui, à bien y regarder, a toujours caractérisé la politique indienne. Indépendamment de qui gouverne à New Delhi.
Cette fois-ci, cependant, les choses semblent avoir pris une tournure très différente.
Car Modi, et avec lui tout le sommet de l'Union indienne, n'a pu s'empêcher de se mettre en colère. Et de se mettre profondément en colère. Contre Trump.
Le président américain a en effet tenté de faire pression sur New Delhi pour la rapprocher de l'Occident. C'est-à-dire pour en faire une alliée, notamment contre la Russie. Pays auprès duquel l'Inde achète, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, une grande partie du pétrole et du gaz nécessaires à son économie en pleine croissance.
Ce qui n'a toutefois jamais impliqué un déplacement de l'axe de référence indien.
Avec Modi, l'Union a en effet poursuivi la politique de non-alignement qui a caractérisé toute son histoire.
Une politique difficile, certes. Et non dépourvue de zones d'ombre et d'ambiguïtés.
Cependant, Modi avait jusqu'à présent réussi à faire partie des BRICS sans devenir subordonné ou allié étroit de Moscou ou de Pékin.
Un art difficile, comme je le disais. Cependant, les Indiens sont parmi les pères fondateurs de l'alchimie et savent bien doser les poisons et les médicaments.
Trump, cependant, a exécuté une démonstration de force. Il a tenté d'imposer les États-Unis comme seul fournisseur de gaz et de pétrole, à un prix franchement absurde. Multiplié plusieurs fois par rapport à celui qu'offre la Russie.
Et il l'a fait en menaçant New Delhi d'imposer des sanctions, des droits de douane très lourds de 50%, sur les exportations indiennes vers les États-Unis.
Une perspective en soi déjà inacceptable pour Modi. À cela s'est ajouté le ton des déclarations publiques de Trump. Il s'est laissé aller à une ironie lourde sur l'Union indienne, se moquant de ses capacités de croissance économique, de son développement. De sa politique.

Nous savons bien que The Donald est ainsi. Et que c'est ainsi qu'il a l'habitude de mener ses « affaires ». En augmentant le prix, voire en insultant, pour ensuite parvenir à un accord.
En somme, c'est son « style ». Et il n'y a rien à y faire.
Seulement, Modi a lui aussi son style. Complètement différent. Et il s'est offensé. Tout comme, d'ailleurs, tous les dirigeants de l'Union indienne. Qui ne sont pas disposés à subir les diktats de Trump. Et ses crises de colère injustifiées.
La réaction a donc été extrêmement dure. Une réponse sèche. Qui ne laisse aucune place à des répliques ou à des négociations. Du moins pour le moment.
Le résultat est que l'Inde semble s'être encore davantage rapprochée de la Russie et de la Chine. Une musique douce aux oreilles de Poutine. Et, peut-être surtout, à celles de Xi Jinping. Qui voient ainsi se consolider le front hétérogène des BRICS.
Qui prend de plus en plus d'importance sur le plan politique. En plus de son importance économique.
20:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, inde, asie, affaires asiatiques, politique internationale, donald trump, narendra modi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 août 2025
L'Asie centrale, un point névralgique vulnérable dans la Grande Eurasie

L'Asie centrale, un point névralgique vulnérable dans la Grande Eurasie
Par Glenn Diesen
Source: https://steigan.no/2025/08/sentral-asia-som-et-sarbart-kn...
L'Asie centrale est un carrefour éminemment central au cœur géographique du partenariat eurasien et constitue un maillon fragile en raison de la relative faiblesse de ses pays, de la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles, de la faiblesse des institutions politiques, de l'autoritarisme, de la corruption, des tensions religieuses et ethniques, entre autres problèmes.
Ces faiblesses peuvent être exploitées par des puissances étrangères dans le cadre de la rivalité entre grandes puissances géopolitiquement centrées sur la Grande Eurasie. L'Asie centrale est vulnérable à la fois à la rivalité «interne» au sein du partenariat eurasien pour éventuellement obtenir un format plus favorable et au sabotage «externe» de ceux qui cherchent à saper l'intégration régionale afin de rétablir l'hégémonie américaine. Cet article esquisse les facteurs externes et internes qui pourraient permettre de manipuler l'Asie centrale.
Ingérence externe : maintenir l'Eurasie divisée
Les puissances maritimes européennes ont acquis leur domination dès le début du 16ème siècle en reliant physiquement le monde à la périphérie maritime de l'Eurasie, comblant ainsi le vide laissé par la dissolution de l'ancienne Route de la Soie. L'expansion de l'empire russe à travers l'Asie centrale au 19ème siècle, soutenue par le développement des chemins de fer, a relancé les liens qui avaient existé aux temps de l'ancienne Route de la Soie. Au début du 20ème siècle, Halford J. Mackinder a développé la théorie du « cœur de l'Eurasie » en réponse au défi que représentait la Russie, qui cherchait à rassembler les régions centrales de l'Eurasie par voie terrestre et menaçait ainsi de saper les fondements stratégiques de la domination britannique en tant que puissance maritime.
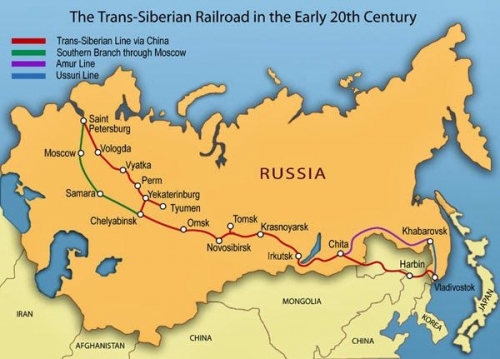
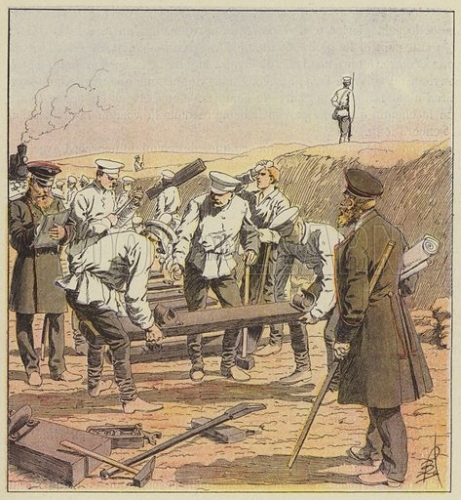
L'Asie centrale est le centre géographique où se rencontrent la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et d'autres grandes puissances eurasiennes. Afin d'empêcher l'émergence d'une hégémonie eurasienne, l'Asie centrale est désormais devenue un champ de bataille important. Le grand jeu du 19ème siècle s'est largement terminé par la création de l'Afghanistan en tant qu'État tampon pour séparer l'Empire russe de l'Inde britannique.
À mesure que les États-Unis devenaient la puissance hégémonique maritime, ils ont adopté une stratégie visant à empêcher l'émergence d'une puissance hégémonique eurasienne et la coopération entre les puissances eurasiennes. Kissinger a fait valoir que les États-Unis devaient donc adopter la politique de leur prédécesseur, la Grande-Bretagne:
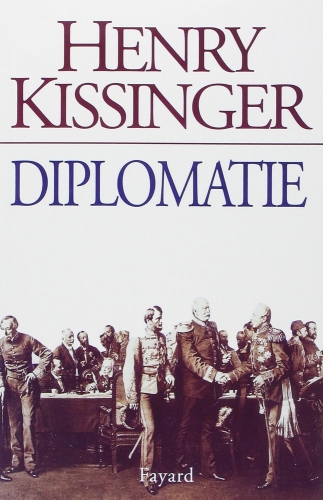 « Pendant trois siècles, les dirigeants britanniques ont agi en partant du principe que si les ressources de l'Europe étaient gérées par une seule puissance dominante, ce pays aurait les moyens de contester le contrôle de la Grande-Bretagne sur les mers et, par conséquent, de menacer son indépendance. D'un point de vue géopolitique, les États-Unis, également une île au large des côtes de l'Eurasie, auraient dû, selon le même raisonnement, se sentir obligés de s'opposer à la domination de l'Europe ou de l'Asie par une seule puissance, et plus encore, au contrôle des deux continents par la même puissance ». (Kissinger, H., Diplomacy, New York, Touchstone, 1994, p. 50-51.)
« Pendant trois siècles, les dirigeants britanniques ont agi en partant du principe que si les ressources de l'Europe étaient gérées par une seule puissance dominante, ce pays aurait les moyens de contester le contrôle de la Grande-Bretagne sur les mers et, par conséquent, de menacer son indépendance. D'un point de vue géopolitique, les États-Unis, également une île au large des côtes de l'Eurasie, auraient dû, selon le même raisonnement, se sentir obligés de s'opposer à la domination de l'Europe ou de l'Asie par une seule puissance, et plus encore, au contrôle des deux continents par la même puissance ». (Kissinger, H., Diplomacy, New York, Touchstone, 1994, p. 50-51.)
La stratégie visant à empêcher l'émergence de l'Union soviétique en tant qu'hégémon eurasien a dicté la politique américaine tout au long de la guerre froide. La Russie et l'Allemagne ont été divisées en Eurasie occidentale, et dans les années 1970, la Chine a été séparée de l'Union soviétique.
La stratégie visant à maintenir la division de l'Eurasie a été expliquée, dans les termes jadis forgés par Mackinder, dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 1988: "Les intérêts fondamentaux de la sécurité nationale des États-Unis seraient menacés si un État ou un groupe d'États hostiles venait à dominer le continent eurasien, cette région du globe souvent qualifiée de « cœur du monde»". Nous avons mené deux guerres mondiales pour empêcher que cela ne se produise ». (White House 1988. National Security Strategy of the United States, White House, avril 1988, p. 1.)
Après la guerre froide, la stratégie américaine pour l'Eurasie est passée de la prévention de l'émergence d'une hégémonie eurasienne à la préservation de l'hégémonie américaine. Les États-Unis ont ainsi tenté d'empêcher que l'unipolarité ne soit remplacée par l'émergence d'une Eurasie multipolaire équilibrée. Le système d'alliances, qui repose sur un conflit permanent, est essentiel pour diviser le continent eurasien en alliés dépendants et adversaires encerclés.
Si la paix devait s'établir, le système d'alliances s'effondrerait et les fondements de la stratégie de sécurité par la domination seraient ébranlés. Brzezinski affirmait que la domination en Eurasie dépendait de la capacité des États-Unis à « empêcher la coopération et maintenir la dépendance sécuritaire entre les vassaux, garder les alliés tributaires dociles et protégés, et empêcher les barbares de s'unir ». (Brzezinski, Z., 1997, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geopolitical Imperatives, Basic Books, New York, p.40.)

Moins de deux mois après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont élaboré la "doctrine Wolfowitz" pour assurer leur primauté mondiale. Le projet de directive sur la planification de la défense américaine (DPG) de février 1992, qui a fait l'objet d'une fuite, rejetait l'internationalisme collectif au profit de l'hégémonie américaine. Le document reconnaissait qu'« il est peu probable qu'un défi conventionnel mondial à la sécurité américaine et occidentale réapparaisse dans le cœur de l'Eurasie dans les années à venir », mais appelait à empêcher l'émergence de rivaux potentiels. Au lieu d'avoir des liens économiques croissants entre de nombreux centres de pouvoir, les États-Unis doivent « tenir suffisamment compte des intérêts des nations industrialisées avancées pour les dissuader de contester notre leadership ou de tenter de renverser l'ordre politique et économique établi ».
Afin de promouvoir et de consolider le moment unipolaire des années 1990, les États-Unis ont développé leur propre concept de « Route de la soie » visant à intégrer l'Asie centrale sous leur leadership et à la couper de la Russie et de la Chine. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a ainsi donné la priorité à une connexion entre l'Asie centrale et l'Inde :
 « Travaillons ensemble pour créer une nouvelle Route de la Soie. Pas une seule route principale comme son homonyme, mais un réseau international et un maillage de relations économiques et de liaisons de transport. Cela signifie construire plusieurs lignes ferroviaires, autoroutes et infrastructures énergétiques, comme le projet de gazoduc qui doit relier le Turkménistan à l'Inde en passant par l'Afghanistan et le Pakistan ». (Clinton, H.R. 2011a. Secretary of State Hillary Rodham Clinton Speaks on India and the United States: A Vision for the 21st Century, 20 juillet 2011.)
« Travaillons ensemble pour créer une nouvelle Route de la Soie. Pas une seule route principale comme son homonyme, mais un réseau international et un maillage de relations économiques et de liaisons de transport. Cela signifie construire plusieurs lignes ferroviaires, autoroutes et infrastructures énergétiques, comme le projet de gazoduc qui doit relier le Turkménistan à l'Inde en passant par l'Afghanistan et le Pakistan ». (Clinton, H.R. 2011a. Secretary of State Hillary Rodham Clinton Speaks on India and the United States: A Vision for the 21st Century, 20 juillet 2011.)
L'objectif de la route de la soie américaine n'était pas d'intégrer le continent eurasien; son objectif principal était plutôt de rompre le lien entre l'Asie centrale et la Russie. La route de la soie américaine était en grande partie basée sur les idées de Mackinder et la formule de Brzezinski pour la suprématie mondiale. (Laruelle, M., 2015. The US Silk Road: geopolitical imaginary or the repackaging of strategic interests?, Eurasian Geography and Economics, 56(4): 360-375.)
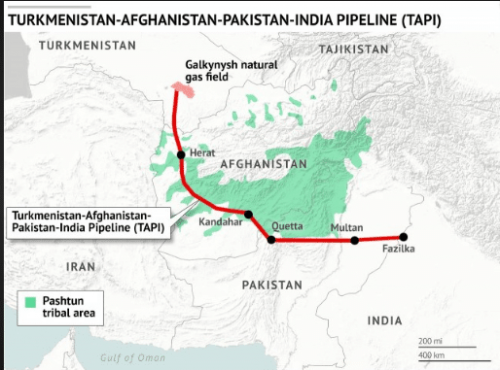 L'occupation de l'Afghanistan pendant deux décennies, le gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI), le corridor énergétique Géorgie-Azerbaïdjan-Asie centrale et d'autres objectifs politiques similaires reposaient sur la conviction que l'Asie centrale ne devait pas devenir un nœud de connexion eurasien. Tout comme l'Ukraine servait de point de connexion vulnérable entre l'Europe et la Russie, susceptible d'être perturbé par les États-Unis, l'Asie centrale représente également un point faible dans le cadre plus large de la Grande Eurasie.
L'occupation de l'Afghanistan pendant deux décennies, le gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI), le corridor énergétique Géorgie-Azerbaïdjan-Asie centrale et d'autres objectifs politiques similaires reposaient sur la conviction que l'Asie centrale ne devait pas devenir un nœud de connexion eurasien. Tout comme l'Ukraine servait de point de connexion vulnérable entre l'Europe et la Russie, susceptible d'être perturbé par les États-Unis, l'Asie centrale représente également un point faible dans le cadre plus large de la Grande Eurasie.
Divisions internes : formats concurrents pour l'intégration eurasienne
La Russie, la Chine, l'Inde, le Kazakhstan, l'Iran, la Corée du Sud et d'autres États ont développé différents formats d'intégration eurasienne afin de diversifier (répartir, étendre, ndlr) leurs liens économiques et de renforcer leurs positions dans le système international. Le système économique international dominé par les États-Unis n'étant manifestement plus viable, l'intégration eurasienne est reconnue comme un moyen de développer un système international multipolaire. L'Asie centrale est au cœur de la plupart des initiatives. Cependant, bon nombre des formats et initiatives d'intégration sont en concurrence.
La Chine est clairement le premier acteur économique en Eurasie, ce qui peut faire craindre des intentions hégémoniques. Des pays comme la Russie semblent accepter que la Chine soit la première économie, mais ne veulent pas accepter la domination chinoise. La différence entre une économie dominante et une économie leader réside dans la concentration du pouvoir, qui peut être atténuée en diversifiant les connexions en Eurasie. Par exemple, le corridor de transport international nord-sud (INSTC) entre la Russie, l'Iran et l'Inde rend l'Eurasie moins centrée sur la Chine.

La Chine a reconnu les préoccupations liées à la concentration du pouvoir et a tenté de répondre à d'autres initiatives visant à faciliter la multipolarité. Son projet « One Belt, One Road » (OBOR) a été largement rebaptisé « Belt and Road Initiative » (BRI) afin de communiquer une plus grande inclusivité et flexibilité, ce qui suggère qu'il pourrait être harmonisé avec d'autres initiatives. Les efforts visant à harmoniser l'Union économique eurasienne (EAEU) et la BRI sous l'égide de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont constitué une autre tentative pour éviter les formats à somme nulle en Asie centrale.
(La somme nulle décrit une situation dans laquelle la somme des pertes et des gains de tous les participants est à tout moment égale à zéro. Les gains et les pertes s'équilibrent. Wikipédia.)
Il est plus facile de gérer la concurrence entre les puissances eurasiennes en Asie centrale que d'empêcher le sabotage des États-Unis en tant qu'acteur extérieur. La stratégie américaine visant à maintenir son hégémonie se traduit par une politique de somme nulle extrême, car toute division ou perturbation en Asie centrale peut servir l'objectif d'une Eurasie dominée par les États-Unis depuis la périphérie maritime. À l'inverse, les puissances eurasiennes tirent profit d'une interconnexion eurasienne accrue. Des États tels que la Russie, la Chine et l'Inde peuvent avoir des initiatives concurrentes, mais aucune des puissances eurasiennes ne peut atteindre ses objectifs sans la coopération des autres. Il existe donc de fortes incitations à trouver des compromis et à harmoniser les intérêts autour d'une Eurasie multipolaire décentralisée.
Cet article a été publié par le Valdai Discussion Club: https://valdaiclub.com/a/highlights/central-asia-as-a-vulnerable-node/
Une source intéressante à suivre est BRICS Today: https://bricstoday.com/
18:34 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, eurasie, asie centrale, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



