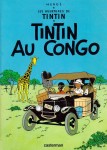Université d’été de «Synergies Européennes», Trente, 1998
Séminaire de Synergies-France, Pange/Lorraine, septembre 1998
Des effets pervers de la partitocratie
par Robert STEUCKERS
Très tôt, la science politique ou les observateurs des mécanismes de la politique dans les démocraties parlementaires occidentales ont été conscients des dérives potentielles de ce système.- Montesquieu insistait sur la séparation des pouvoirs, idéal à atteindre pour garantir les libertés citoyennes. Pour Montesquieu, la démocratie est le régime qui garantit justement ces libertés citoyennes: on ne peut les atteindre optimalement qu’en garantissant une séparation aussi nette que possible entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. En abattant toutes les cloisons entre ces pouvoirs, la partitocratie a annulé la démocratie au sens où l’entendait Montesquieu. Par rapport à l’idéal démocratique, la partitocratie constitue donc une régression. Et non, comme elle le prétend trop souvent, son accomplissement définitif.
- Tocqueville, en observant les mécanismes électoraux aux Etats-Unis dans la première moitié du XIXième siècle, constate, en fait, que la liberté d’entreprendre et de créer de la nouveauté, de penser, de vivre selon ses désirs et ses convictions, risque à terme d’être mise en danger par la démagogie égalitaire des partis et par l’action sans scrupules de démagogues irresponsables, regroupés en sociétés, en lobbies, en groupes de pression ou en patronnages divers, ne s’adressant quasiment jamais à la raison, mais toujours aux sentiments les plus troubles ou aux sens les plus veules, empêchant ainsi le citoyen moyen de regarder les réalités politiques avec lucidité. En principe, Tocqueville ne s’oppose pas à l’égalité, mais estime qu’elle ne doit jamais menacer l’exercice de la liberté.
- Max Weber, en prenant le relais de Tocqueville, écrivait dans Le savant et le politique que le système politique anglo-américain, en dépit de son étiquette démocratique, était “une dictature, reposant sur l’exploitation de l’émotionalité des masses”. Weber a d’abord plaidé pour un fonctionnariat d’Etat complètement détaché des partis car il craignait par dessus tout les dérives d’un spoil system à l’américaine, qu’avait déjà entrevues Tocqueville. Weber était cependant fasciné par les grandes machines politiques américaines du début de notre siècle, bureaucratisées à l’extrême mais plus honnêtes que leurs futures imitatrices européennes, dans la mesure où à chaque élection, les fonctionnaires nommés par le gouvernement précédent sont irrémédiablement démis de leurs fonctions si leur parti perd la partie: ils sont renvoyés à la société civile, quitte à recommencer leur quête politique, en se “rebranchant” à nouveau sur la vie réelle de la population, en partageant ses efforts et ses déboires face aux conjonctures économiques ou aux pratiques du pouvoir. Weber aura une position ambivalente: d’un côté, il admire la neutralité axiologique des fonctionnariats permanents et non partisans, sur le mode prussien; de l’autre, il admire la sélection impitoyable exercée par les “bosses” des partis américains qui se choisissent à chaque élection un personnel dévoué, qu’ils installent dans les rouages de l’Etat (mais pour quatre ans seulement, si la fortune politique ne leur sourit qu’une fois! Accepter le verdict électoral est honnête, en dépit des magouilles politiciennes; refuser le verdict des urnes est une malhonnêteté foncière, même si les magouilles sont mieux contrôlées!). La pratique de nommer définitivement les fonctionnaires des cabinets provisoires, en dépit des aléas électoraux, est notamment une perversion du système belge.
- Toujours dans Le savant et le politique, Weber a eu ces mots durs, pour les premières manifestations de partitocratie en Allemagne, qu’elles émanent des socialistes ou des démocrates-chrétiens: «[Les constitutionalistes révolutionnaires du pays de Bade] considèrent [...] l’Etat et les emplois administratifs simplement comme des institutions destinées à procurer uniquement des prébendes. [...] le parti du Zentrum (ndlr: d’obédience chrétienne-démocrate) [...] inscrivit même à son programme l’application du principe de la répartition proportionnelle des emplois selon les confessions religieuses, sans se soucier de la capacité politique des futurs dirigeants». Aberration aux yeux de Weber, car «... le développement de la fonction publique moderne [...] exige de nos jours un corps de travailleurs intellectuels spécialisés, hautement qualifiés, préparés à leur tâche professionnelle par une formation de plusieurs années et animés par un honneur corporatif très développé sur le chapitre de l’intégrité. Si ce sentiment de l’honneur n’existait pas chez les fonctionnaires, nous serions menacés d’une effroyable corruption et nous n’échapperions pas à la domination des cuistres. En même temps, il y aurait grand péril pour le simple rendement technique de l’appareil d’Etat...». Quant aux révolutionnaires les plus radicaux: «Ils abandonnent la direction de l’administration à de véritables dilettantes, tout simplement parce qu’ils disposent de mitrailleuses». Weber a dénoncé clairement l’esprit partisan, tant chez les pseudo-démocrates aux discours soft que chez les ultra-révolutionnaires annonçant l’avènement d’un système totalitaire.
Marco Minghetti, les partis politiques et leur ingérence dans la justice et l’administration
Marco Minghetti (1818-1886) était un homme politique italien du XIXième siècle, qui a vécu l’unification italienne et a assisté à l’émergence de la culture politique particulière de son pays. Très tôt, il a perçu les dérives potentielles de la partitocratie à l’italienne (et à la belge). Deux secteurs de l’appareil d’Etat sont principalement menacés par les démagogues de la partitocratie selon Minghetti: la justice et l’administration. Ces secteurs sont soumis à toutes sortes de pressions, afin d’édulcorer toute sévérité éventuelle des magistrats à l’encontre des démagogues. La partitocratie, dès son émergence dans l’histoire, tente d’abolir toutes les cloisons entre les pouvoirs, non pas pour rendre le pouvoir au peuple, mais pour le confisquer entièrement au profit d’états-majors occultes, qui ne veulent laisser aucun espace neutre dans l’appareil d’Etat.
Minghetti s’oppose à ce processus pour garantir les droits et les libertés de ses concitoyens. Dès lors, la lutte contre l’utilisation partisane de l’administration et de la justice a pour objectif de protéger les citoyens contre toutes interventions arbitraires, émanant d’une administration ou d’une justice ayant perdu et leur indépendance et leur objectivité, qui se montrent simultanément juge et partie, ce qui est une hérésie sur le plan du droit. Minghetti veut préserver la séparation des pouvoirs, afin d’éviter une trop grande concentration du pouvoir entre les mains de la majorité, qui contrôle déjà de droit le gouvernement. Il faut dès lors qu’au sein des assemblées législatives, les députés puissent conserver un maximum d’indépendance d’esprit et de vote; ensuite, que l’administration et la magistrature puissent, le cas échéant, résister efficacement à l’exécutif.
Entre les partis qui émergent au temps de Minghetti et les partis d’aujourd’hui, il y a une différence de taille. L’Etat n’était guère interventionniste du temps de Minghetti: il demeurait cantonné dans ses attributions classiques (battre monnaie, faire la guerre, organiser l’armée, assurer la diplomatie, maintenir l’ordre intérieur, etc.). Aujourd’hui, les attributions de l’Etat se sont considérablement étendues: elles englobent des pans entiers de la sphère sociale, du domaine de la santé, de l’enseignement et interpellent beaucoup plus étroitement la vie économique.
L’Etat a donc été amené à multiplier les contrôles de nature formelle et de tolérer le développement de pouvoirs de fait, vastes, arbitraires et largement capillarisés dans la société. Cette évolution n’est nullement condamnable en soi, mais elle implique une technicité accrue des interventions, que le personnel habituel, fauteur et bénéficiaire de la démagogie, n’est pas en mesure de prester, puisqu’il n’a pas été sélectionné pour ses compétences mais pour sa fidélité à des slogans, des doctrines simplistes et boîteuses ou une camaraderie de mauvais aloi avec des ténors sans scrupules. La complexification et la diversification des administrations auraient dû aller de paire avec une formation toujours plus poussée du personnel administratif et des fonctionnaires. Depuis une centaine d’années, constatent les admirateurs italiens actuels de Minghetti, malgré l’ampleur continue du processus de complexification des interventions de l’Etat, peu de choses sinon rien n’a été entrepris pour améliorer les qualifications professionnelles des fonctionnaires. Les décisions arbitraires d’un personnel inqualifié (sinon inqualifiable) sont effectivement condamnables et inacceptables, tandis que les décisions réfléchies d’un personnel bien écolé garantiraient efficacité et correction pour le bénéfice de tous. Un fonctionnariat qualifié constitue une garantie de liberté pour les citoyens. Un fonctionnariat non qualifié, recruté par démagogie partisane, constitue une menace permanente et inacceptable pour la masse des citoyens.
Minghetti et ses disciples actuels énumèrent quelques tares majeures de ce système de partis:
Première tare: Les “démocraties” multipartites ont œuvré pour que soient exclues de l’administration toutes les personnalités compétentes. Celles-ci se sont recyclées dans le secteur privé, affaiblissant du coup les pouvoirs réels de contrôle de l’administration étatique.
Deuxième tare: le personnel administratif est recruté trop exclusivement parmi les juristes, dont la tendance est de vénérer le formalisme juridique au détriment de toutes les autres démarches de l’esprit. Depuis Minghetti, peu de choses ont changé en ce domaine.
Troisième tare: le personnel administratif, recruté par les instances partisanes, se ligue désormais en syndicats, qui interviennent lourdement dans les mécanismes de la décision politico-admininistrative. Ou bloquent la machine étatique pour obtenir des avantages de toutes sortes, salariaux ou autres. Le risque est patent: aucun correctif aux dysfonctionnements ne peut plus être apporté, s’il égratigne, même très partiellement, les intérêts immédiats et matériels des fonctionnaires syndiqués.
Quatrième tare: l’indépendance des juges risque de devenir lettre morte. Les collusions entre élus de la classe politique et magistrats entraînent des alliances fluctuantes entre les uns et les autres, au détriment des simples citoyens non encartés et non politisés.
Face à ces déviances, Minghetti suggère:
- Une réduction de l’aire d’intervention de l’Etat (c’est une option libérale classique);
- Une décentralisation administrative;
- De développer des méthodes de contrôle de l’administration;
- D’assurer une meilleure formation des fonctionnaires, en limitant le juridisme de leur formation antérieure et en créant de bonnes écoles de sciences administratives, où le savoir empirique est mis à l’honneur, au détriment des savoirs trop abstraits (ce vœu de Minghetti n’a quasiment pas été exaucé);
Conclusion: Minghetti a plaidé pour une déconstruction des appareils partisans, auxquels il reprochait de représenter un “catholicisme étatique” ou “un catholicisme des partis”.
Moiséï Jakovlevitch Ostrogorsky (1854-1918), critique des démocraties partisanes
- Russe de confession israëlite, Ostrogorsky a étudié et enseigné à Saint-Petersbourg, à Paris (à l’Ecole libre des sciences politiques) et aux Etats-Unis.
- Ses références sont Montesquieu et Tocqueville; sa pensée est influencée par Roberto Michels et Max Weber (qui, à son tour, tirera profit de son œuvre).
- Il participe activement à la vie politique russe et en 1906 il est député à la Douma pour le parti constitutionnel-démocrate (les “Cadets”).
- En France, son œuvre, rédigée en français, influence Charles Péguy et Charles Benoist (tous deux sceptiques à l’égard du suffrage universel).
Pour Ostrogorsky, les partis ne sont au départ que de simples associations privées, des regroupements de citoyens qui demandent éventuellement, sur le mode de la pétition, au pouvoir politique de légiférer dans tel ou tel sens. Au titre d’associations privées, les partis ne sauraient être considérés comme des agents institutionnels permanents. Mais comme ils le sont devenus, on peut légitimement admettre que la démocratie parlementaire n’est plus qu’une façade, derrière laquelle se déploie un système de décision occulte, arbitraire, orchestré dans les états-majors des grands partis.
Ostrogorsky ne réclame pas la suppression des partis, mais prône le dépassement voire le démantèlement des “partis permanents” et leur remplacement par des “partis ad hoc”, c’est-à-dire des regroupements politiques qui se constitueraient à intervalles réguliers et sous la pression des faits, pour obtenir telle ou telle réforme concrète et disparaîtraient de la scène une fois celle-ci obtenue). Ostrogorsky nommait “ligues” ou “initiatives à projet unique”, ces “formations ad hoc”, destinées à soutenir des candidats prêts à voter ou faire voter un projet. Bien qu’il ne l’ait jamais dit explicitement, le modèle d’Ostrogorsky semble avoir été les ligues françaises de la fin du XIXième siècle: Ligue des Patriotes (1882), Ligue des Droits de l’homme (lors du procès Dreyfus), Ligue d’Action Française (Maurras et Daudet).
La permanence des partis indique qu’ils ne sont pas là pour réaliser des réformes concrètes, utiles et urgentes pour la communauté populaire, mais pour promouvoir des “chefs” (des “bosses”) ou des oligarchies fermées, à l’aide d’une idéologie préfabriquée, irréaliste et démagogique, incapable d’appréhender les ressorts du réel, excitant une fraction des masses d’électeurs, utile seulement au recrutement de voix qui seront comptabilisées pour maximiser l’influence du parti et de ses chefs dans la société en général, en s’emparant d’autant de postes de commande que possible, afin d’amorcer la pompe à finances via les recettes fiscales.
Ostrogorsky constate que la fonction des masses dans la démocratie moderne n’est pas de gouverner, comme l’affirme la théorie démocratique, car elles n’en seraient de toute façon pas capables, même si on leur donne tous les instruments constitutionnels et juridiques pour le faire (législation directe, référendum, etc.). Dans tous les cas de figure, ce sont de petites minorités qui accèdent au gouvernement des pays. Ces minorités agissent pour concentrer le maximum de pouvoir autour d’elles: c’est ce qu’Ostrogorsky appelle “la loi de gravitation de l’ordre social”. Les masses servent de réservoir de voix pour des minorités alternatives, qui concentrent petit à petit du pouvoir autour d’elles. Les masses les servent pour intimider les gouvernants, qui risquent de perdre des plumes dans les “loteries électorales”, s’ils ne vont pas à l’encontre des désirs divers et souvent incohérents du gros de la population.
Face à ces minorités, les individualités non encartées, non inféodées aux formations de masse sont écrasées et tyrannisées par le biais de la police ou surtout de l’impôt. Dans cette société civile se cristalisent des contre-poids, qui ne sont toutefois pas assez puissants pour abattre tout de suite les oligarchies dominantes. Les citoyens non encartés doivent louvoyer entre les obstacles dressés par les oligarchies, parier sur les innovations techniques (cf. Schumpeter) pour contourner les interdits imposés par le régime en place, ou en appeler aux anciens résidus religieux, forces morales établies et avérées, éventuellement mobilisables contre le régime en place.
Finalement, le citoyen isolé n’a que très peu d’influence sur la désignation des candidats figurant sur les listes qu’on lui présente à chaque élection. Il peut créer l’opinion, en pariant tantôt sur l’héritage du passé tantôt sur les espoirs d’avenir, mais cette opinion qu’il exprime ou formule sera filtrée par les états-majors des partis, qui désigneront des candidats qui voteront selon les injonctions du parti et non pas selon les intérêts des citoyens qui les ont élus.
Le gouvernement est donc aux mains d’une classe politique, certes relativement ouverte —elle n’est pas une caste fermée— mais qui constitue néanmoins un groupe en soi. Elle gère le pays face à l’indifférence et la passivité des masses. Celles-ci ne sont pas davantage actives que du temps où toute opposition était absente et où il n’y avait pas de “démocratie” . Le droit de vote est considéré comme une évidence, mais on ne lui accorde par une grande valeur, on ne comprend pas clairement l’enjeu et le sérieux de ce droit. Cette ignorance générale des masses laissent aux minorités actives une large marge de manœuvre.
Ostrogorsky dénonce enfin le “formalisme politique” ou le “formalisme partisan”. C’est, dit-il, un ennemi de la raison, il oblitère la conscience individuelle et le courage civil. L’organisation de tout parti est toujours trop rigide, la doctrine idéologique est trop simpliste, les rituels annihilent les volontés et l’esprit critique. Certes, admet Ostrogorsky, toute forme culturelle implique organisation, doctrine et rituels, mais, dans le cas des partis politiques modernes, le degré d’organisation, le poids de la doctrine et des rituels ont dépassé la limite acceptable. Le parti ne sert plus à faire passer de l’innovation dans la société, à y injecter un surplus d’éthique, à restaurer des valeurs estompées, mais à couvrir d’un “voile de bienséance” les turpitudes et les corruptions des oligarques.
Ce formalisme, explique Ostrogorsky, est le nouveau visage de la tyrannie, qui a toujours, au fil des temps, changé sa face pour mieux se dissimuler aux naïfs et les tromper. La tyrannie est une hydre à mille têtes: inutile d’en trancher une, il en repoussera d’autres, sans discontinuité. La liberté est un idéal qui a du mal à s’implanter dans les têtes, alors que les hommes acceptent benoîtement la tyrannie, sous quelque forme qu’elle se présente. Vouloir changer ces dispositions de l’âme est un travail de Sisyphe.
Panfilo Gentile reprend le flambeau de Minghetti
Panfilo Gentile (1889-1971), politologue et célèbre journaliste italien, n’hésitera pas à parler de déviances mafieuses du système des partis. Les démocraties partitocratiques sont pour lui des “démocraties mafieuses”. Il écrit: «Quand le pouvoir est exercé au profit du parti [...] tout scandale est couvert par un vaste réseau de complicités. La responsabilité remonte très haut, implique les leaders et les sous-leaders du parti, les hommes du gouvernement [...] Les faits scandaleux sont alors ignorés et si des adversaires les dénoncent, on trouve le moyen de les minimiser». Ou encore: «Les oligarchies mafieuses, que les démocraties modernes tendent à produire, sont des oligarchies de petits bourgeois sans occupation fixe, imbus de cléricalisme idéologique, portés à l’intolérance et à l’esprit sectaire». «Mais les idéologies ne sont en réalité que de vieilles idées, devenues populaires [...]. Des schémas doctrinaires ont été créés qui trouvent tout à coup une codification intangible. Chaque parti a sa Torah, ses docteurs, ses pharisiens et ses zélotes. L’idéologisme porte à la cléricalisation des esprits. Les démocraties modernes reposent sur le dogmatisme universel, même si l’on admet théoriquement la concurrence entre une pluralité de dogmatismes».
Le tableau est planté. Panfilo Gentile, disciple de l’école élitiste italienne (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Roberto Michels), a dénoncé, vingt-cinq ans avant les scandales politiques italiens du début des années 90, les mécanismes corrupteurs de la partitocratie. Ceux-ci se développent à partir des linéaments idéologiques suivants:
1. Le marxisme intellectuel, religionnaire, considéré comme l’ersatz d’une eschatologie ou d’une sotériologie religieuse (==> PCI). Les formations politiques qui se réclament de cette sotériologie laïque sont prêtes à mobiliser toutes les ressources sans hésitation pour accéder au pouvoir, prélude à l’avènement d’un modèle social, posé d’emblée comme définitif.
2. L’ingérence constante des ecclésiastiques dans la politique, dans l’espoir de forger un “parti unique des catholiques” (==> DC). Ce parti unique devra barrer la route à tous les autres et s’étendre à toutes les strates de la population.
3. L’engouement pour les programmations économiques et le planisme irresponsable, conduisant à énumérer toutes les choses désirables à réaliser, ... sans couverture financière réelle. Une fiscalité lourde étant censée alimenter le financement de ces projets fabuleux.
4. L’infiltration par les partis, mus par les idéologèmes que nous venons d’énumérer, de tous les rouages de l’Etat.
Dans l’Italie des années 60, la partitocratie, disait Gentile, est un “clérico-marxisme”, ou, disait Augusto Del Noce, un “catho-communisme”. Elle a conduit à “une politique purement démagogique qui a accumulé déficit sur déficit et a fragilisé l’économie”. C’est le “système de la carte du parti qui a pollué l’appareil bureaucratique et les pouvoirs de l’Etat. Un régime ainsi stratifié et consolidé semble aujourd’hui pratiquement impossible à modifier et à restructurer”. Dans un interview accordé en 1969, Panfilo Gentile précise sa pensée: «En d’autres mots, les démocraties mafieuses sont des régimes basés sur la détention de la carte du parti, tout comme dans les véritables régimes totalitaires. La différence entre les deux systèmes, c’est que dans les régimes totalitaires, il n’y a qu’un seul type de carte, tandis que dans les “démocraties mafieuses”, on consent à l’existence de plusieurs types de carte; mais il s’agit de cartes finalement “confédérées” au sommet et, en définitive, cela revient au même, c’est comme s’il n’y avait qu’une carte unique; celle au singulier du régime totalitaire ou celles au pluriel des régimes partitocratiques, sont toutes génératrices de privilèges, octroyés par ceux qui sont au pouvoir [...]. Alors, quand de tels régimes se constituent, les oppositions n’ont plus de place [...]. Les oppositions sont reléguées dans une espèce de ghetto invisible. Les détenteurs du pouvoir détiennent également le monopole des moyens de propagande et de persuasion occulte. Les éditeurs, la presse, les prix littéraires, les subventions aux théâtres et aux cinéastes sont invariablement soumis à une insupportable discrimination politique».
Les seize tares majeures de la partitocratie selon Gonzalo Fernandez de la Mora
Pour Gonzalo Fernandez de la Mora, ancien ministre d’Espagne, philosophe du politique de réputation internationale, directeur de la revue Razon española (Madrid), jette un regard critique sur les pratiques des partitocraties et y décèle seize contradictions majeures:
1. Les partis de la partitocratie subissent un processus d’oligarchisation interne:
Selon la loi mise en exergue au début du siècle par Roberto Michels, c’est-à-dire la “loi d’airain des oligarchies”, les partis tendent à se fermer sur eux-mêmes, à se hiérarchiser et à renforcer la puissance de leurs appareils. Ce processus relègue les bases à l’arrière-plan, celles-ci ne sont autorisées à voter que pour un délégué désigné par la direction. L’impulsion est donc autoritaire et non populaire. L’ensemble des adhérents aux partis en compétition n’excède jamais 5% de la population. Les partis sont donc de toutes petites minorités qui prennent arbitrairement en charge la totalité des électeurs. La contradiction est donc flagrante: les partis ne sortent en aucun cas du cycle des oligarchies qu’ils avaient prétendu abolir au nom de la démocratie.
2. Les partis de la partitocratie impliquent une professionnalisation de la politique.
Les membres des oligarchies partisanes se transforment rapidement en professionnels de la lutte pour le pouvoir. Mais ces professionnels ne se cantonnent pas dans un domaine précis, pour lequel ils auraient effectivement des compétences dûment sanctionnées par l’université ou une grande école. Les “professionnels de la politique”, au contraire, ne sont spécialistes de rien et se retrouvent tour à tour présidents d’une banque publique, directeurs d’un réseau ferroviaire, d’un service hospitalier, d’un service postal, d’une commission de l’énergie nucléaire ou ambassadeurs dans un pays dont ils ne connaissent ni la langue ni les mœurs. Nous nous trouvons dès lors face à un personnel non spécialisé, dépourvu de compétences, mais posé arbitrairement comme “omnivalent”.
La contradiction est également flagrante ici: les partis se présentent comme des agences efficaces, capables de placer au poste ad hoc les citoyens compétents, sans discrimination d’ordre idéologique, mais ne casent finalement que leurs créatures, en excluant tous les autres et en n’exigeant aucune compétence dûment sanctionnée.
3. Les partis provoquent une crise de l’indépendance.
L’idéal démocratique, c’est d’avoir des assemblées de notabilités capables de juger les choses politiques en toute indépendance et objectivement. Le système des partis coupe les ailes à ceux qui souhaitent se présenter en dehors de toute structure partisane. En effet, le parcours du candidat-député indépendant est plus long et plus difficile. Même s’il réussit à se faire élire, il aura des difficultés à faire entendre sa voix, face aux verrous placés par les partis dans la sphère des médias et de la presse.
La contradiction est une nouvelle fois patente: les partis annoncent qu’ils sont démocratiques, qu’ils défendent la liberté d’expression de tous indistinctement, mais, par leur action et leur volonté de tout contrôler et surveiller, il semble de plus en plus difficile de se porter candidat en dehors de leurs circuits.
4. Les partis provoquent l’appauvrissement de la classe politique.
Les oligarques des partis tendent à recruter des adjoints fidèles et naïfs incapables de leur porter ombrage ou de les dépasser. Conséquence: le niveau intellectuel et moral du parti s’effondre. Les ficelles sont tirées par des démagogues conformistes et peu compétents. Les quelques talents qui s’étaient perdus dans les coulisses des partis sont progressivement mis sur la touche ou quittent le parti, dégoûtés.
La contradiction est nette: les partis ne sont nullement des agences qui assurent la promotion des meilleurs, mais, au contraire, qui sélectionnent et propulsent aux postes de commande les plus médiocres et les plus corrompus.
5. Les partis éclipsent le décor politique.
Les états-majors des partis sont tenus à une certaine loi du secret. Ils ne dévoilent jamais entièrement leurs batteries. L’information qu’ils fournissent aux citoyens est souvent mensongère et biaisée.
Contradiction: l’électorat, censé choisir clairement ses dirigeants, ne reçoit que des informations tronquées et maquillées. L’électorat n’est pas informé mais désinformé. Ses choix sont dès lors peu raisonnables. Le décor politique devient flou, vu les dissimulations et la polysémie de langage dont usent et abusent les oligarchies politiciennes. On ne sait plus qui défend quoi.
6. Les oligarchies partisanes spolient l’électorat. Si de larges strates de l’électorat ne se retrouvent pas dans les principaux partis, si les candidats indépendants n’ont pratiquement aucune chance de faire passer leur programme, l’électorat n’a plus d’autre possibilité que l’abstention. Mais celle-ci, par la magie électorale, se transforme en appui à la majorité. Contradiction: non seulement les oligarques partisans cumulent les voix de leur propre clientèle (ce qui est logique), mais ils “rackettent” celles des opposants silencieux qui s’abstiennent. La démocratie partitocratique, qui avait claironné qu’elle serait plus représentative que les formes antiques et médiévales de la représentation populaire, constitue de fait une régression. Le citoyen n’a plus la liberté de ne pas être client, de vaquer tranquillement à ses occupations professionnelles, à ses devoirs familiaux, avec l’assurance d’être traité en toute équité en cas de problème. Il n’est plus perçu comme un homme libre, capable de faire un choix judicieux, qu’il s’agit de respecter, mais comme le réceptacle docile de propagandes simplistes, distillées par les bureaux des partis.
7. La partitocratie est un réductionnisme d’ordre éthique. Sur le plan éthique, le système des partis constitue également une régression dangereuse:
1. Tous les adversaires de ce système sont dénoncés comme des “ennemis de la démocratie”, dénonciation qui équivaut à celle de “satanisme” dans les procès de sorcellerie au moyen-âge. Or comme le terme de démocratie recouvre un océan de définitions divergentes, on peut condamner même la personne la plus innocente, en la désignant comme “ennemie de la démocratie”. Les partitocraties montrent par cette pratique qu’elles ne respectent aucune opinion qui serait susceptible de leur porter ombrage.
2. Les partis, pour fonctionner dans les partitocraties, pompent énormément de deniers publics, y compris auprès de ceux qui n’ont pas voté pour les formations du pouvoir. Si ceux-ci émettent des protestations, ils sont accusés de ne pas être “solidaires”. Les oligarques utilisent le réflexe de l’éthique de la solidarité pour justifier une spoliation, dont les victimes ne peuvent se défendre ni par le biais des tribunaux politisés ni à travers le travail des chambres qui sont muselées.
3. Les partis ont fait voté des lois qui leur permettent de récupérer en dotations publiques leurs frais de fonctionnement ou de propagande. Le procédé est malhonnête car ces sommes ont été levées par coercition, sans qu’aucun contribuable ne puisse y échapper. Pour Gonzalo Fernandez de la Mora, «c’est, assurément, la forme la plus répugnante de rapine à main armée que celle qui s’exerce par les armes de l’Etat et en marge de la légalité comme dans le pire des féodalismes, mais en proportions incomparablement supérieures».
8. L’instrumentalisation des parlementaires. La discipline qu’imposent les partis-machines aux députés qui ont été élus sur leurs listes est telle que le parlementaire ne peut plus émettre, dans les assemblées, un vote divergent de celui qu’ordonne le parti. Sinon, il est marginalisé voire exclu des prochaines listes électorales. La liberté individuelle du parlementaire est ainsi annulée.
9. Le paradoxe des transfuges. Le transfuge, qui, à la suite d’un désaccord ou par pur opportunisme, change de liste ou de parti, conserve son mandat et commet une double fraude: à l’égard de ses anciens dirigeants et à l’égard de ses électeurs. Mais la partitocratie admet ce genre de procédé, montrant ainsi la dépersonnalisation totale du député, qui devient un pion interchangeable.
10. les partis provoquent la dévaluation intellectuelle des chambres. Les projets de la majorité sont présentés au parlement. L’opposition minoritaire n’a que quelques minutes pour préparer ses réponses ou suggérer des amendements. Il est donc impossible, de cette manière, de lancer un débat de fond et de développer des arguments approfondis, raisonnables et cohérents. Les chambres déchoient ainsi en fictions rhétoriques, en spectacles.
11. Les partis provoquent la dévaluation politique des chambres. Comme l’exécutif procède de la majorité parlementaire, et que celle-ci est composée de députés dociles, dont le vote est parfaitement prévisible, les chambres perdent leur rôle politique: celui de critiquer l’exécutif, de lui imposer des amendements, de le faire tomber le cas échéant. La partitocratie confisque aux chambres leur rôle dans le fonctionnement de la démocratie.
12. Les partis dévaluent le rôle des chambres sur le plan fiscal. Les chambres sont nées justement pour limiter le pouvoir du souverain et surtout pour freiner ses appétits économiques. Les chambres sont là pour défendre les citoyens, faire en sorte que ceux-ci ne paient que le strict nécessaire en matière d’impôt. Dans les assemblées d’origine, les chambres s’opposent aux exagérations du Prince. Dans les partitocraties, au contraire, elles se transforment en assemblées dociles qui entérinent les décisions de l’exécutif et ne défendent plus les intérêts des citoyens. Ce qui est une entorse supplémentaire au principe de la représentation démocratique.
13. Les partis dévaluent le rôle législatif des chambres. Les chambres ont été créées pour contrôler le Prince ou le pouvoir exécutif en exerçant leurs compétences légiférantes. Les lois devaient ainsi être forgées pour le bénéfice du peuple, en le soustrayant à tout arbitraire du Prince ou de l’exécutif. Dans les partitocraties, ce rôle de légiférant-protecteur est annulé, dans la mesure où la majorité parlementaire entérine formellement les textes que l’oligarchie partisane a décidé de transformer en lois. L’idée inspiratrice de ces textes vient du chef ou de l’état-major et de leurs conseillers et non pas des membres de l’assemblée, qui n’ont même pas l’obligation de les lire!! les chambres déchoient ainsi en un espèce de notariat collectif qui accorde une sorte de caution publique à des textes composés et décidés ailleurs. Conclusion: la capacité législative des chambres dans les partitocraties décroît, jusqu’à atteindre le point zéro.
14. Le pouvoir des partis dans une partitocratie conduit à l’irresponsabilité du gouvernement. En théorie, le gouvernement est responsable devant les assemblées. Dans les partitocraties, où il y a une majorité stable, il a les mains absolument libres et n’est même plus obligé de tenir compte de l’opposition. Il s’accorde l’impunité et compte sur la mémoire courte des électeurs, qui oublieront ses trafics avant les nouvelles élections.
15. La partitocratie conduit à la politisation de l’administration. On peut parler d’une politisation de l’administration, dès que les fonctionnaires agissent dans le sens que leur dicte leur parti, ne cherchent plus à appliquer l’ordre juridique en place et ne respectent plus le principe de l’équité. L’oligarchie partitocratique peut ainsi politiser l’administration, en limitant son accès à ses affiliés ou ses sympathisants ou en octroyant des récompenses et des promotions à ses seuls féaux. Nous avons assisté à l’émergence d’une sorte de népotisme collectif. Toute administration politisée est par définition partiale et donc injuste.
16. La partitocratie conduit à la fusion des pouvoirs. L’idéal démocratique de Montesquieu, repose, pour l’essentiel, sur la séparation des pouvoirs. Depuis des temps immémoriaux, les hommes savent que l’on ne peut être à la fois juge et partie. Gonzalo Fernandez de la Mora écrit: «Pour faire en sorte que l’indépendance du pouvoir judiciaire ne soit pas diminuée ou annulée par des normes que le pouvoir exécutif fabrique à son bénéfice exclusif, il faut que le pouvoir législatif soit indépendant du pouvoir exécutif [...] (Mais) dans les partitocraties [...] le pouvoir exécutif assume de fait le pouvoir législatif et tend à influencer aussi l’interprétation et l’application des lois [...]. Le mode le plus efficace pour atteindre de telles fins est d’intervenir dans la nomination et le placement des magistrats».
Conclusion. Le constat de Gonzalo Fernandez de la Mora est simple: la partitocratie tend à confisquer à son profit tous les pouvoirs, en noyautant l’administration par placement de ses créatures, en intervenant dans la nomination des magistrats, en annulant l’indépendance des parlements et des députés. Elle est ainsi la négation de l’Etat de droit (qu’elle affirme être par ailleurs), parce qu’elle désarme les gouvernés face aux erreurs et aux errements de l’administration et face aux abus d’autorité. La fusion des pouvoirs, au bénéfice d’un exécutif de chefs de partis, correspond à ce que les classiques de la science politique nommaient la tyrannie. Même la dictature provisoire à la romaine respectait l’indépendance des juges et garantissait ainsi l’équité. Outre l’anarchie et la loi de la jungle, l’installation de tribunaux partiaux et partisans est la pire des choses qui puisse arriver à une communauté politique. Les événements de Belgique l’ont prouvé au cours de ces dernières années.
Robert STEUCKERS,
Forest, juillet 1998.
Bibliographie:
- Peter E. J. BUIKS, Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuursociologische interpretatie, Van Gorcum, Assen, 1979. - Alessandro CAMPI, «La critica alla partitocrazia nella cultura politica italiana: 1949-1994. Una rassegna storico-bibliografica», in: Futuro Presente, n°4, Perugia, 1993. - Ramon COTARELO, «¿Son necesarios los partidos politicos en la democracia?», in: Razón Española, n°53, mayo-junio 1992. - Gonzalo FERNANDEZ de la MORA, «Contradicciones de la partitocracia», in Razón Española, n°49, sept.-oct. 1991. - Gonzalo FERNANDEZ de la MORA, «Cooptación frente a sufragio universal», in: Razón Española, n°54, jul.-aug. 1992. - Julien FREUND, Sociologie de Max Weber, PUF, Paris, 1968. - Jesus FUEYO, «La degradación de la democracia», in: Razón Española, n°53, mayo-junio 1992. - Panfilo GENTILE, Democrazie mafiose (a cura de Gianfranco de TURRIS), Ponte alle Grazie, Firenze, 1997. - Hans-Helmut KNÜTTER, «Staats- und Parteienverdrossenheit - Ursache und Konsequenzen», in: Mut, 1994. - Hans-Helmut KNÜTTER, «Man weiß nicht mehr, was man will, sondern nur, was man ablehnt», in: Junge Freiheit, n°6/1994 (Interview réalisé par Peter Boßdorf). - Klaus KUNZE, «Der totale Parteienstaat», in: Junge Freiheit, Januar-Februar 1992. - Klaus KUNZE, «Der Weg der Parteiendemokratie in den feudalen Parteienstaat», in: Staatsbriefe, 3/1992. - Klaus KUNZE, «Plebiszite als Weg aus dem Parteienstaat», in: Junge Freiheit, Okt. 1992. - Angel MAESTRO, «La partitocracia en crisis», in: Razón Española, n°54, jul.-aug. 1992. - Marco MINGHETTI, I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e nell'amministrazione, Prefazione di Carlo Guarnieri, Societa Aperta, Milano, 1997. - Wolfgang MOMMSEN, Max Weber. Gesellschaft, Politik und Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1974. - Vincenzo PACIFICO, «Marco Minghetti: il padre della “destra storica” italiana e la sua opera. Spirito de patria», in Percorsi, n°4, mars 1998.
- Karl PISA, Alexis de Tocqueville. Prophet des Massenzeitalters. Eine Biographie, DVA, Stuttgart, 1984. - Caspar von SCHRENCK-NOTZING, «Die verdeckte Krise des Parteiensystems», in: Junge Freiheit, Juli/August 1991. - Caspar von SCHRENCK-NOTZING, «Das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, daß sie keine ist», in: Junge Freiheit, Dezmber 1993. - Robert STEUCKERS, Partitocratie et polyarchie: le cas belge, manuscrit non encore publié. - Helmut STUBBE-da LUZ, «“Nicht die Formen studieren, sondern die Kräfte!”. Moisei J. Ostrogorski (1854-1919), ein Pionier der Parteienkritik», in: Criticón, n°148, pp. 193-198, München, 1995. - Juan VALLET de GOYTISOLO, «¿Democracias no partitocracias?», in: Razón Española, n°54, jul.-aug. 1992. - Alberto VANNUCCI, Il mercato della corruzione. I meccanismi dello scambio occulto in Italia (Prefazione di Alessandro PIZZORNO), Sociéta Aperta, Milano, 1997. -Max WEBER, Le savant et le politique (Préface de Raymond ARON), UGE-10/18, Paris, 1963.






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

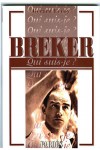







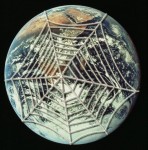




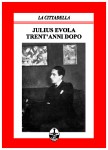
 Il est connu pour avoir donné une structure solide aux armées de mercenaires, nommés les “lansquenets”. Il en fit l’instrument de la puissance de Maximilien I dans ses guerres contre les rebelles suisses et vénitiens et contre les Français en Italie surtout. Il est l’un des artisans de notre victoire à Pavie en février 1525, qui a sauvé l’Europe de la tenaille franco-turque, en écrasant l’armée du roi dément et vaniteux, François I, qui voulait s’emparer de la Lombardie, tandis que les Turcs marchaient sur la Croatie. L’alliance des “Bandes d’Ordonnance” nobiliaires des Pays-Bas et des troupes populaires de lansquenets, issus surtout de la population paysanne, a fait merveille. Elle a combattu dans une situation difficile, contre les Français, le Pape Clément VII, les liguistes séditieux d’Italie du Nord, les Turcs de Soliman le Magnifique, les Protestants de la Ligue de Smalkalde.
Il est connu pour avoir donné une structure solide aux armées de mercenaires, nommés les “lansquenets”. Il en fit l’instrument de la puissance de Maximilien I dans ses guerres contre les rebelles suisses et vénitiens et contre les Français en Italie surtout. Il est l’un des artisans de notre victoire à Pavie en février 1525, qui a sauvé l’Europe de la tenaille franco-turque, en écrasant l’armée du roi dément et vaniteux, François I, qui voulait s’emparer de la Lombardie, tandis que les Turcs marchaient sur la Croatie. L’alliance des “Bandes d’Ordonnance” nobiliaires des Pays-Bas et des troupes populaires de lansquenets, issus surtout de la population paysanne, a fait merveille. Elle a combattu dans une situation difficile, contre les Français, le Pape Clément VII, les liguistes séditieux d’Italie du Nord, les Turcs de Soliman le Magnifique, les Protestants de la Ligue de Smalkalde.