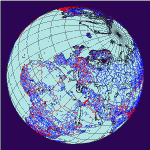Deuxième partie des “réponses de Robert Steuckers au questionnaire d’un étudiant…”
5. Dans vos revues, il y a beaucoup de traductions d’articles provenant du monde germanophone, mais aussi latin (hispanique et italien) et, plus original encore, de l’Europe slave, en particulier de la Russie. D’une certaine façon, ne peut-on pas considérer votre revue comme une sorte de « Courrier International » de la pensée européiste ?
En effet, le poids prépondérant de thématiques germanisantes au début de l’histoire de Vouloir, faisait dire, à quelques néo-droitistes parisiens jaloux, qui n’ont pas digéré entièrement l’anti-germanisme maurrassien en dépit de leurs dénégations et de leur germanomanie de pacotille, que mes publications étaient des « revues allemandes en langue française ». J’ai donc suivi des cours accélérés en langues espagnole, italienne et portugaise, de façon à acquérir une connaissance passive de ces langues et de traduire, avec l’aide d’amis et de mon ex-épouse, les articles de nos innombrables amis hispaniques et italiens. D’autres, que je remercie, m’ont aidé à traduire des articles du polonais et du russe. L’objectif a donc toujours été de dire « non » aux enfermements; « non » à un enfermement dans le carcan très étroit du belgicanisme institutionnel (ce qui n’est évidemment pas le cas de notre culture, qui a un message serein à offrir à tous), « non » à un enfermement dans le carcan de la francophonie officielle, « non » au carcan de l’eurocratisme, « non » au carcan de l’atlantisme. Par ailleurs, « non » aux carcans idéologiques et politiques, « non » aux deux carcans du « démocratisme chrétien » et du « laïcisme libre(!!!)-penseur » à la belge. La masse de textes, de thématiques diverses et variées, qu’offraient les éditeurs et les revues allemandes permettait de rebondir dans tous les domaines et dans tous les espaces culturels européens et d’éviter toute forme d’enclavement idéologique.
Au fond, je vais confesser ici pour la première fois que cette idée est très ancienne chez moi: elle vient de la victoire électorale du FDF aux élections communales de 1970. Flamand de Bruxelles, littéralement assis sur deux cultures, cette victoire électorale a fait pâlir mon père, l’angoisse se lisait sur le visage de cet homme de 57 ans, qui craignait la minorisation des Flamands de Bruxelles, un homme simple qui n’avait pas envie de subir l’arrogance d’une bourgeoisie et d’une petite bourgeoisie qui se piquait d’une culture française (qu’elle ne connaissait évidemment pas en ses réels tréfonds), un pauvre petit homme qui devinait aussi, instinctivement, que ce francophonisme de brics et de brocs, plus braillard que créateur de valeurs culturelles véritables, barrait la route de beaucoup aux cultures néerlandaise, allemande et anglaise, auxquelles les Flamands ont un accès plus aisé. Ensuite, ce qui le rendait malade, c’était les rodomontades des « traitres » : les Flamands de souche, installés à Bruxelles, qui croyaient s’émanciper, échapper à la culture, souvent rurale, qu’avaient abandonnée leurs parents en venant travailler dans la grande ville. Tout cela était confus dans la tête de mon père, qui aimait les Wallons, quand ils étaient authentiques. Il avait travaillé à Liège, comme beaucoup de Limbourgeois. Il aimait les Ardennais et surtout les Hesbignons, dont les Limbourgeois du Sud sont si proches et auxquels ils sont si souvent liés par des liens matrimoniaux. Et les Wallons du quartier, où nous vivions, n’avaient cure du bête « francophonisme » des nouveaux francophonissimes originaires de Flandre ou de Campine, qui n’avaient rien de wallon, qui agaçaient les vrais Wallons. Et les Ardennais de Bruxelles, comme mon père du Limbourg, ne reniaient pas leur culture catholique et rurale, qu’ils ne retrouvaient évidemment pas dans les rodomontades émancipatrices des zélotes du nouveau parti de Lagasse et de « Spaakerette ». Dans ma tête d’adolescent, tous ces affects paternels s’entrechoquaient, provoquaient des réflexions, sans doute fort confuses, mais qui allait être à la base de toutes mes entreprises ultérieures et surtout de ma décision d’étudier les langues germaniques. Car que proposaient les braillards du FDF, dont l’insupportable Olivier Maingain perpétue la triste tradition ? Rien d’autre qu’un réductionnisme intellectuel, inacceptable en notre pays, carrefour entre quatre grandes langues européennes. Le multilinguisme est une nécessité et un devoir: à quatorze ans, j’en étais bien conscient. Mon père aussi. J’allais donc devoir, adulte, me battre contre l’ineptie qui venait de triompher, par la grâce des dernières élections. Il fallait commencer la bataille tout de suite. A cette heure, je n’ai pas encore déposé les armes.
Mais, il fallait que je me batte en français car le vin avait été tiré, j’étudiais dans cette langue, depuis ma première primaire, sans renier mes racines; il me fallait donc utiliser la langue de Voltaire pour commencer le travail de reconquista qu’il s’agissait d’entreprendre, non pas tant contre le FDF, manifestation éphémère, politicienne et périphérique d’un « francophonisme » bizarre, mixte monstrueux d’ « illuminisme » révolutionnaire et de « postmaurrasisme panlatiniste » (qui ne voulait pas s’avouer tel), mais contre tous les simplismes et réductionnismes que le (petit) esprit, se profilant derrière sa victoire, amenait dans son sillage. Toute cette bimbeloterie francophonisante finissait par m’apparaître comme des « plaquages » artificiels, des agitations superficielles sans fondements. La culture rurale matricielle me paraissait seule authentique (quelques mois plus tard, Mobutu évoquait l’authenticité zaïroise, banalisait le terme d’ « authenticité » et je ne pouvais m’empêcher de lui donner raison…). Cette notion d’authenticité était valable pour la Flandre et le Brabant thiois, pour la Wallonie et les Ardennes. Elle était valable aussi pour la seule région d’Europe que je connaissais à l’époque: le haut plateau franc-comtois dans le département du Doubs, les Franches Montagnes, fidèles à la tradition burgonde, fidèles à l’Espagne et à l’Autriche contre le Roi-Soleil, comme l’écrivait, dans un opuscule anti-jacobin, un certain Abbé Mariotte, auteur d’une petite histoire de la Franche-Comté, que je lisais avidement, avec amour, chaque été, quand nous étions là-bas, à l’ombre du clocher de Maîche. Une authenticité que m’avait fait découvrir un cadeau du concierge permanent du formidable manoir qui nous hébergeait à Maîche: Le loup blanc de Paul Féval, roman chouan et bretonnant, qui accentuait encore plus cette volonté d’aller aux racines les plus profondes, ici les racines celtiques d’Armorique, comme là le « saxonnisme » de Walter Scott, avec Ivanhoe et Robin des Bois. L’homme était donc tributaire de (et non déterminé par) l’appartenance au terroir de ses ancêtres et le nier ou l’oublier équivalait à basculer dans une sorte de folie, de démence maniaque, qui s’acharnait à éradiquer passé, souvenirs, liens, traces… jusqu’à rendre l’homme totalement anémié, vidé de tout ce qui fait son épaisseur, son charme, sa personnalité. Un tel homme est incapable de créer de nouvelles formes culturelles, de puiser dans son fonds archétypal: les portes sont ouvertes alors pour faire advenir une « barbarie technomorphe ».
1970, l’année de mes quatorze ans et l’année du triomphe du FDF, a déterminé mon itinéraire de façon radicale: au-delà des agitations politiciennes, jacobines, modernistes, toujours aller à l’authentique, avoir une démarche « archéologique » et « généalogique », sortir du « francophonisme » d’enfermement, s’ouvrir au monde et d’abord au monde proche, tout proche, qui commence à Aix-la-Chapelle, qui nous ouvre à l’Est, comme la langue française, non reniée et cultivée, ouvre au Midi. Quelques semaines après la victoire électorale du FDF, je m’en vais d’ailleurs, muni d’un catalogue du « Livre de Poche », quémander au Frère Marcel, une liste de bons livres à lire: il m’a fait découvrir Greene et surtout Koestler, sources de mon engouement pour la littérature anglaise. Mais aussi tous les classiques de la littérature française à l’époque: Cesbron, Mauriac, Bazin, Troyat…
Le « germanisme » était présent, comme la matrice culturelle du Flamand de Bruxelles, du fils d’immigré limbourgeois. Mais le germanisme était ouvert, tant au français (qui n’est pas le « francophonisme ») qu’à la latinité, que nous faisait aimer notre professeur de latin, l’inoubliable Abbé Simon Hauwaert. Balzac, Stendhal, Baudelaire et Flaubert sont d’ailleurs des exposants ante litteram de la « révolution conservatrice », en sont la matrice à bien des égards, dans leur critique incisive du « bourgeoisisme »: donc, une fois de plus, pas de frontière entre un espace français, qui serait hermétique, et un espace germanique, qui serait tout aussi hermétique. Par ailleurs, ce sont le baron Caspar von Schrenck-Notzing, directeur de Criticón (Munich), qui me fait découvrir l’Espagne de Balthazar Gracian, puis Günther Maschke (et Arnaud Imatz), qui me font découvrir Donoso Cortès. C’est par des études allemandes, ou traduites en allemand, que je découvre d’Annunzio et Pessoã. Plus tard, j’allais constater que la culture italienne est très ouverte à l’Allemagne et à l’Autriche, qu’elle traduit bien plus que l’édition parisienne, sans perdre la moindre once de sa latinité. Un exemple à suivre…
La lecture conjointe de Herder et de Heidegger allait donner des assises philosophiques à ce magma informel de l’adolescent.
6. Justement, une spécificité importante de votre démarche réside dans votre philo-slavisme et votre anti-soviétisme modéré qui s’est manifesté dès le début de votre itinéraire (à l’époque, où, sous l’impulsion de Ronald Reagan, on renoue avec la Guerre Froide la plus glaciale) et que vous partagez, quoique dans une autre optique, avec le PCN. Qu’en dites-vous aujourd’hui ?
Entre 1970, que je viens de vous évoquer, et le début de l’aventure de Vouloir, treize années se sont écoulées. La Guerre Froide s’enlise. Le duopole n’a rien d’autre à proposer qu’une partition définitive du monde entre deux camps, animés chacun par une idéologie hostile aux matrices culturelles et aux authenticités fécondes, décrétées « archaïsmes » ou « fascismes » (à la suite notamment des hypersimplifications d’un Georges Lukacs). Derrière cette partition du monde, se profile une histoire européenne pluri-millénaire, où les horizons sont toujours vastes, où l’on ne bute pas sur un « Rideau de fer », à 350 km à vol d’oiseau de Bruxelles. Où l’on pouvait aller à Prague, à Varsovie et à Budapest, sans passer à travers un champ de mines, surveillé par des miradors. Le dégel avait fait espérer un assouplissement et voilà, soudain, que le reaganisme réactive la Guerre Froide, éloignant la possibilité d’une réconciliation européenne. La déception est immense, surtout, j’imagine, pour ceux qui avaient espéré que la « Doctrine Harmel », voire l’Ostpolitik de Brandt, allaient porter des fruits. La division européenne apparaît dès lors comme l’oeuvre d’un « talon d’acier », une anomalie scandaleuse, qu’il fallait combattre, à la suite de Thiriart et de son mouvement « Jeune Europe », afin de retrouver le dynamisme européen en direction du Sud-Est et des profondeurs du continent asiatique, conquis vers 1600 avant JC par les cavaliers iraniens, puis, à partir du 16ième siècle, par les Cosaques des Tsars. C’était un idéal d’ « Europe Totale », mixte de Harmel et de Thiriart. Et, derrière eux, se profilaient tout à la fois 1) un projet « démocrate-chrétien » (en réalité « conservateur » au sens metternichien du terme) de rééditer, cette fois sous le signe d’une pensée inspirée de « Rerum Novarum », la « Sainte-Alliance » conservatrice de 1814, Europe de l’Est voire Russie comprises, ou 2) une vision plus pragmatique, géopolitique et technique, comme celle d’Anton Zischka, inspirateur majeur du jeune Thiriart. Elle impliquait d’étudier les dynamiques à l’oeuvre dans ces espaces immenses. Une telle étude postule non seulement de connaître les atouts économiques de l’espace euro-sibérien, dans le sillage de Youri Semionov, mais aussi, à la suite de l’historien italien des religions, Giuseppe Tucci, l’héritage spirituel de ces peuples à la charnière de l’Europe et de l’Asie. Parmi les multiples aspects de cet héritage spirituel, la slavophilie et l’oeuvre de Leontiev, partisan d’une alliance avec les forces asiatiques contre un Occident « libéral-manchesterien » qui a trahi la Russie lors de la Guerre de Crimée. Raison pour laquelle mes amis et moi, nous n’avons cessé de nous intéresser à ces thématiques.
Le PCN, dans ses démarches, ne semble pas fort s’intéresser à la pensée organique russe. Or peu avant que la Guerre Froide ne reprenne sous Reagan, le dissident Yanov, établi en Californie, sort un ouvrage universitaire intitulé The Russian New Right, où il démontre que la pensée slavophile et néo-orthodoxe, fondamentalement anti-occidentale, et l’oeuvre de Soljénitsyne, impulsent, tant chez les établis que chez les dissidents de l’ex-URSS, une nouvelle révolution conservatrice, ou « nouvelle droite », avec des écrivains comme Valentin Raspoutine ou Youri Belov. Quant aux tenants de l’idéologie occidentaliste, on les retrouvait aussi, d’après Yanov, dans les deux camps. A Moscou, Alexandre Prokhanov, que j’allais rencontrer en 1992, était à l’époque directeur de la revue Lettres soviétiques. Il avait publié, pour la première fois dans une publication soviétique officielle, un numéro consacré à Dostoïevski, qui avait été mis à l’écart à l’ère soviétique la plus sourcilleuse. Prokhanov innovait. Je me suis procuré un exemplaire de cette revue à la « Librairie de Rome » à Bruxelles. Au même moment, Etudes sociales, autre publication émanant de l’Académie soviétique des sciences, réhabilitait le passé païen russe, dans un optique très semblable à celle de la « nouvelle droite ». Ces textes attestaient d’un changement et d’un abandon graduel des vieilles lunes progressistes du marxisme institutionnalisé, abandon qu’aucune officine « marxiste » belge ou française ne jugeait bon de faire. Les archaïsmes étaient toujours de mise chez nos communistes locaux. Leur déphasage par rapport aux legs de l’histoire et au réel ne faisait que s’accentuer. Rien n’a changé sur ce chapitre.
Ce chassé-croisé d’occidentalisme et de slavophilie chez les dissidents comme chez les établis, et le succès des néo-slavophiles, notamment dans l’orbite cinématographique, laissaient espérer une transformation lente de l’URSS en une nouvelle Russie conservatrice, capable de damer le pion à la superpuissance libérale, vectrice de toutes les déliquescences morales et spirituelles, fautrice du déclin intellectuel généralisé de l’Occident et matrice de la vulgarité marchande. Ce que nous haïssions dans le communisme s’estompait et ce que nous n’avons cessé de haïr, du plus profond de nos tripes, dans le libéralisme ne cessait de s’amplifier, jusqu’à atteindre l’effroyable monstruosité qu’il a acquise aujourd’hui, un monde où le banquier, être infect et infécond, inculte et vulgaire, accumulateur et comptable, vaut plus que le joueur d’accordéon du coin de la rue, être touchant de sincérité et de spontanéité. Chez nous, les acteurs de théâtre sont sûrs de crever de misère quand ils ne pourront plus monter sur les planches. En Italie, les professeurs d’université s’étaient mobilisés à l’époque contre les MacDo, qui finançaient Reagan et recevaient en échange le droit de s’établir dans tous les coins et recoins de l’américanosphère. Ces professeurs voulaient organiser un boycott général de la chaîne de « fast food »; chez nous, quand les étudiants de Gand ont voulu faire de même, par solidarité avec le corps académique italien, la minable crapule assurant la gérance d’une de ces auges de la mal-bouffe a eu le culot d’appeler les flics, qui ont verbalisé, et le corps académique, veule et lâche, n’a rien dit. On mesure aujourd’hui l’étendue du désastre. L’empoisonneur avait la « liberté » de commercer… et on ne pouvait y porter atteinte. La chaîne de ces fast-foods avait acquis le droit, grâce à Reagan, qu’elle avait financé, d’abaisser l’âge requis pour travailler dans le secteur de la restauration: depuis lors, les lycéens travaillent pour gagner l’argent de leurs cartes de GSM et le niveau d’instruction et d’éducation ne cesse de baisser; le monde sans relief des « petits jobs et boulots », stigmatisé par Hannah Arendt, est devenu la référence suprême.
Face à cette involution, perceptible dès le début des années 80, la société soviétique, malgré son caporalisme, sa froide rigueur idéologique, sa langue de bois, laissait entrevoir une renaissance, un dépassement de l’horreur économique par un retour aux valeurs qui avaient enthousiasmé les premiers slavophiles du 19ième siècle, ces disciples russes de Herder. Ensuite, sous les coups du néo-libéralisme triomphant, l’Europe perdait et le sens de l’Etat et le respect de ses héritages culturels. Face au « Dieu Argent », désormais honoré sans plus aucune retenue morale ou éthique en Occident, dans l’ « américanosphère » (Faye), Moscou semblait conserver un sens de l’Etat, avec une armée qui respectait des traditions russes (donc européennes), et un appareil culturel et académique, dont le Bolchoï, par exemple, était un fleuron. Les titres académiques semblaient mieux respectés qu’en Europe ou en Amérique. Le « fast food » est la manifestation sociale la plus tangible de cet avènement du « tout-économique », qui nous a tant scandalisé à l’époque, jusqu’à en devenir, je le concède, une véritable obsession récurrente, qu’atteste la littérature néo-droitiste et nationale-révolutionnaire.
Ensuite, Reagan et ses conseillers étaient bien conscients du fait qu’un discours exclusivement néo-libéral ne pouvait consolider leur pouvoir ni constituer une propagande efficace. Ils ont alors puisé dans le registre de l’idéologie religieuse puritaine, l’héritage américain des « Founding Fathers » et des « Pèlerins du Mayflower », où l’accent est souvent mis sur l’Apocalypse, jugée imminente, portée par le « Mal absolu », qu’il s’agit de combattre et d’éradiquer. Ce langage réactive les affects qui préfigurent les guerres de religion, alors que la pensée d’un Hobbes et toute l’évolution de la pensée politique européenne après les horreurs de la guerre de Trente Ans visaient justement à éviter de tels débordements. Le reaganisme met un terme définitif aux « formes » de la guerre et de la diplomatie traditionnelles. Cet infléchissement était inacceptable, même dans une optique conservatrice traditionnelle. Il ne faut pas se leurrer: si Reagan a été décrit par les gauches comme un « néo-conservateur », cette manière de percevoir les choses est fondamentalement erronée. Le puritanisme apocalyptique des « Pères Fondateurs » et des Puritains du 17ième siècle est le contraire diamétral des options « tacitistes » et « machiavéliennes », de la tradition régalienne européenne en général. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le retour, après Cromwell, du Roi en Angleterre ait contraint ces zélotes, à l’idéologie bibliste, à franchir l’Atlantique, où, espérait-on en Europe, ils allaient pouvoir vivre leurs utopies irréalistes et anti-historiques en vase clos.
Les Etats-Unis sont spécialisés dans le bricolage idéologico-théologique quand il s’agit de créer des vulgates médiatisables pour faire passer leur volonté dans les faits. Avec Reagan, nous avions, outre le néo-libéralisme, qui dissout toutes les formes politiques et culturelles, l’idéologie de l’Apocalypse, qui entend faire table rase des legs de l’histoire, et, surtout, une interprétation messianique des « droits de l’homme », impliquant un interventionnisme tous azimuts, qui flanquait tous les principes de la diplomatie traditionnelle par terre ! Le Général Jochen Löser s’est dressé, à l’époque, et avec vigueur, contre ce mixte idéologico-théologico-économique, qui revient aujourd’hui à l’avant-plan avec Bush junior; avec l’armement moderne, cette nouvelle idéologie agressive risquait de déclencher une guerre d’annihilation totale en Europe centrale. Si les Etats-Unis maniaient une telle idéologie, la fidélité à l’alliance atlantique pouvait être remise en question. Harmel s’était proposé d’assouplir la « Doctrine Hallstein », rigide et pérennisant par son intransigeance la césure européenne, afin de mettre lentement fin à la chape pesante qu’était le duopole né à Yalta. La « Doctrine Harmel » était aussi un retour à la diplomatie traditionnelle, laquelle devait recevoir à nouveau la préséance. Löser et Kiessling entendaient y revenir au début des années 80, juste avant la perestroïka de Gorbatchev. Ce débat n’est pas clos: au printemps 2003, quand les troupes anglo-américaines entrent pour la deuxième fois en Irak, et que les Européens s’insurgent en arguant que toutes les voies diplomatiques n’avaient pas été exploitées, Robert Kagan, idéologue au service de la politique de Bush junior, annonce clairement, sans circonlocutions inutiles, que la diplomatie, « c’est du passé » et que l’avenir appartient à ceux qui ne s’en soucient nullement. La « Vieille Europe » est donc celle de la diplomatie, à l’idéologie « machiavello-tocquevillienne » et « tacitiste ». La « Nouvelle Europe » est celle qui va renier cet héritage pour suivre aveuglément le nouvel « Empire » qui agit arbitrairement selon ses intérêts immédiats.
Je ne crois pas que le PCN ait vraiment mis tous ces éléments dans la balance: il m’a donné la triste impression de se muer en un calque maladroit du stalinisme (revu par la propagande américaine du temps de la Guerre Froide), attitude typique des mouvements politiques marginaux qui cherchent à attirer l’attention sur eux par des prises de position qui font bêtement scandale.
7. Autre point commun avec le PCN et, par-delà cette formation, avec Jean Thiriart, vous avez fait, vous aussi, votre pèlerinage à Moscou. Quelles sont les perspectives avec les Russes et notamment avec Alexandre Douguine et l’actuel président russe Vladimir Poutine, de créer cet empire européen que vous appelez de vos voeux ?
Je n’ai pas souvenir que le PCN, ou l’un de ces dirigeants, ait fait le « voyage à Moscou ». Fin mars, début avril 1992, je m’y suis effectivement rendu avec Alain de Benoist et Jean Laloux (secrétaire de rédaction de la revue Krisis). Les activités principales de ce voyage ont été 1) une conférence de presse où nous avons présenté les grandes lignes de la « nouvelle droite »; 2) un débat, dans les locaux de la revue moscovite Dyeïnn (« Le Jour ») avec Ziouganov et Volodine, exposants du parti communiste russe. Le dialogue a tourné autour de la notion de « Troisième Voie » en économie, c’est-à-dire, pour moi, ce que Perroux, Albertini et Silem ont nommé les « voies hétérodoxes », héritières de l’école historique allemande de Schmoller, Rodbertus, etc. Douguine et Prokhanov étaient les deux organisateurs de ces rencontres. Douguine a fait du chemin depuis lors. Il appuie aujourd’hui Vladimir Poutine, qui, à ses yeux, tente de redresser une Russie ruinée par le clan Eltsine et les oligarques.
Quelques mois plus tard, Thiriart, Schneider, Battarra et Terracciano se retrouvaient à leur tour à Moscou. En 1996, une équipe de « Synergies européennes », composée de Sincyr, Sorel et de Bussac, visite à son tour Moscou et rencontre d’autres personnalités, dont l’ex-dissident, le sorélien Ivanov, l’anthropologue Avdeev, et d’autres. Ces hommes oeuvrent dans d’autres perspectives. L’hispaniste Toulaev s’est joint à eux. Notre ami autrichien Gerhoch Reisegger s’est également rendu à plusieurs reprises à Moscou, ramenant de ses voyages des informations d’ordres économique et factuel très intéressantes. Wolfgang Strauss continue à publier une chronique permanente sur cet espace idéologique russe, dans les colonnes de la revue Staatsbriefe, qui paraît à Munich sous la direction du Dr. Sander. Tous les aspects de la pensée non conformiste —hétérodoxe— russe nous intéressent.
Quant à savoir si Poutine emportera le morceau, il me semble que la réponse se situe dans les extraits du dernier ouvrage de Reisegger que nous avons traduits. La consolidation du poutinisme dépend de l’organisation des transports (routes et chemins de fer), des gazoducs et oléoducs de l’Asie centrale, de la Sibérie, de concert avec l’Inde, le Japon et la Chine. Si une synergie parvient à s’établir, l’Eurasie demeurera eurasiatique. Sinon, les Américains préparent d’ores et déjà la riposte: le stratège Thomas Barnett propose aujourd’hui à l’établissement américain d’abandonner l’alliance européenne, de laisser l’Europe périr dans ses contradictions et de miser sur l’Inde et la Chine, voire sur une Russie détachée de l’Europe, afin de conserver les atouts américains en Asie centrale, acquis par la conquête de l’Afghanistan et la satellisation de l’Ouzbékistan. Barnett apporte la réponse américaine au projet de Henri de Grossouvre, soit le projet de créer un Axe Paris-Berlin-Moscou.
8. Après plus de vingt ans d’activités politiques et intellectuelles, quel est le bilan que vous tirez ? Notamment sur les Etats-Unis et l’Europe ?
Premier bilan, évidemment, comme Thiriart et de Benoist, et même comme Faye, c’est d’avoir constaté l’immense, l’incommensurable bêtise du « milieu identitaire ». En hissant la préoccupation au niveau européen, Thiriart avait voulu dépasser l’étroitesse des « petits nationalismes ». Avec son option « métapolitique », de Benoist avait voulu briser le cercle infernal des répétitions et des rengaines. Ils se sont tous deux heurtés à une incompréhension générale, hormis quelques notables exceptions qui ont tenté de poursuivre le combat. Thiriart n’a pas trop bien su emballer sa marchandise.Ses textes, denses, toujours au moins partiellement actuels, figuraient certes au milieu de dessins satiriques de toute première qualité, mais les écrits des autres « journalistes », dans la feuille du mouvement, laissaient vraiment à désirer et étalaient les fantasmes habituels du « petit nationalisme » ou de l’« extrême droite » au mauvais sens du terme. Thiriart a vraiment tout essayé pour gommer définitivement ces dérives: il avouait, dans un entretien accordé à l’avocat espagnol Gil Mugarza, n’avoir pas pu enrayer les multiples expressions de cette « psychopathologie » politique. Les hommes de notre temps ne raisonnent plus en termes de temps et d’espace, mais se laissent aveugler par les idéologies, les « blueprints » de Burke, déviance encore accentuée par la propagande médiatique, qui atteint désormais des proportions incroyables. Ignorant tout de la géographie, nos contemporains ne comprennent pas les enjeux spatiaux, seuls enjeux réels des conflits qui ensanglantent la planète. Leurs horizons sont vraiment limités, alors que l’on n’a jamais autant parlé de « mondialisme » ou d’« universalisme ».
Alain de Benoist, pour sa part, a tenté d’élargir et d’européaniser l’horizon culturel du milieu nationaliste français, dans lequel, dès l’adolescence, il avait fait ses premiers pas. Il lui a présenté des thématiques inhabituelles, fort intéressantes au départ, mais, en bout de course, force est de constater qu’il en a trop fait, qu’il a jonglé avec une quantité de choses diverses que ce public ne pouvait pas assimiler à la vitesse voulue. Alain de Benoist changeait trop souvent de sujet et son propre public, au sein du GRECE, ne suivait pas la cadence. Il s’en désolait, tempètait, rouspétait; on l’écoutait poliment, mais, au fond, on semblait lui dire, par le regard: « Cause toujours, tu m’intéresses ! ». D’où, ce que j’appelle le « mouvement brownien » des brics et brocs culturels et cultureux agités par de Benoist. Henry de Lesquen parlait, à son propos, de prurit « noviste ». Deux handicaps marquaient la démarche du « Pape de la nouvelle droite »: une incapacité —en fin de course, et non pas, curieusement, au début de sa trajectoire— à opérer une synthèse et à se concentrer sur l’essentiel; bref, la dispersion et la confusion; ensuite, un désintérêt pour l’histoire et ses dynamiques, au profit d’une sorte d’idolâtrie pour les idées toutes faites, pour les corpus moraux plus ou moins bien échafaudés, pour le clinquant de concepts immédiatement médiatisables (dans l’espoir d’être enfin accepté, comme figurant ou comme acteur, dans le « PIF » ou « paysage intellectuel français »). Enfin, l’homme est tenaillé par l’inquiétude, par d’inexplicables angoisses, par un doute incapacitant, aux dimensions qui laissent pantois. Si Thiriart a été une cohérence au milieu des incohérences de l’extrême droite belge et italienne de son époque, de Benoist, lui, a démarré dans la cohérence pour se disperser dans un fatras de thématiques différentes et divergentes, dans un capharnaüm conceptuel qu’il est désormais incapable de maîtriser. Il m’apparaît aujourd’hui comme une sorte d’âne de Buridan, qui n’a pas à choisir entre deux picotins d’avoine, mais est perdu au milieu d’une foultitude de picotins, tous aussi alléchants, et ne sait plus où donner de la tête.
Ne cédons pas à cette aigreur, que l’on retrouve aussi chez un Guillaume Faye, qui la tourne en cynisme avec son sens du canular qui est inégalable, ou chez un Christian Bouchet, qui ne mâche pas ses mots pour fustiger l’inculture du « milieu identitaire ». Cette inculture n’est pourtant pas le propre de ce milieu mais bien le lot général de notre temps. La gauche n’est plus aussi « intellectuelle » qu’elle ne l’a été. Sachons que l’OSS visait, dès l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1941-42, à faire perdre à l’Europe son leadership intellectuel. L’effervescence de mai 68 et les pédagogies démissionnaires qui en découlent, en dépit de l’excellence de ce que Luc Ferry appelle la « pensée 68 » (avec Deleuze, Guattari, Foucault, Lévi-Strauss, etc.), a donné le coup de grâce aux établissements d’enseignement en Europe. La vague néo-libérale a simplement parachevé l’horreur. La méditation, la lecture, l’étude, la recherche sont des activités qui prennent du temps, qui empêchent de gagner vite beaucoup d’argent, pour pouvoir consommer tout aussi rapidement. Et empêcher l’adolescent ou l’étudiant de gagner de l’argent, même au détriment de ses études, relève, au regard du mental contemporain, d’un « archaïsme », méchant et pernicieux, d’un « fascisme » rétrograde. Au bout d’une décennie à peine, on a des instituteurs, des régents et des licenciés mal formés, qui ont moins lu, qui n’ont pas de passions littéraires bien étayées, qui ont butiné bêtement autour de toutes les loupiotes médiatiques faites de variétés de plus en plus vulgaires (Loft, Star Academy, etc.), qui ont gagné des sous pour se payer de la bimbeloterie high tech ou des fringues ridicules et, partant, ne se sont pas constitué de bibliothèques personnelles. L’influence des sous-cultures et des modes est de plus en plus désastreuse. A cela s’ajoute que le milieu identitaire est tout aussi indiscipliné que le reste de la société, que les « egos » y sont encore plus surdimensionnés, générant à la pelle des personnalités caractérielles. Très difficile dès lors de faire éclore dans un tel milieu une conscience historique prospective et volontariste, comme le voulait Thiriart, ou d’entamer une longue bataille métapolitique, comme le voulait de Benoist.
Pourtant, de nouvelles initiatives voient le jour. Elles sont au moins portées par des hommes au caractère plus trempé. De vrais travailleurs. Qui multiplient les initiatives et sont très présents sur internet. Cette nouvelle génération semble ouverte sur le monde. Elle est européiste, même en France, car la France contemporaine, qui se veut championne des abstractions universalistes les plus délirantes, l’a déçue. L’avenir nous dira ce que ce travail parviendra à réaliser. Deux éceuils à éviter: se méfier des modes, ne pas y succomber (comme Ulysse face au chant des sirènes); ne pas tomber dans la dispersion.
Ensuite, force est de constater que les Etats-Unis ont gagné la guerre: en Europe en 1945 (mais ça, tout le monde le sait déjà), dans les Balkans en 1999, ce qui leur permet de contrôler l’espace-tremplin de l’Europe vers le Moyen-Orient, utilisé par Alexandre le Grand puis par les Ottomans, en Afghanistan en 2001, ce qui leur permet de contrôler l’Asie centrale, en Irak en 2003, où ils se sont emparé des principales réserves énergétiques du monde, en Afrique centrale et occidentale, ce qui leur permettra de contrôler les ressources pétrolières inexploitées du continent noir. Cette série de victoires est due à leur avance technologique, notamment sur le plan satellitaire. Pire: la riposte européenne ne sera guère possible car en s’emparant d’Avio en Italie, de Santa Barbara Blindados en Espagne, de l’usine de sous-marins allemand, bientôt de Rheinmetall, les consortiums américains, dont le fameux Groupe Carlyle, ont mis la main, par des coups en bourse, sur les entreprises qui forgent les armes européennes. Le Général allemand Franz Ferdinand Lanz a déclaré à ce propos: « Toute armée dépendant d’une industrie militaire étrangère est une armée de deuxième classe ». « Dans tous les cas de figure, l’armée est l’expression et la garante de la souverainté d’un Etat ». « Seules les puissances qui disposent d’un potentiel stratégique produit par une industrie militaire indépendante, sont en mesure de s’affirmer, même modestement, sur la scène internationale ». Cette fois, il n’y a pas lieu de parler de la simple souveraineté d’un Etat, mais de celle de tout un continent, de toute une matrice de civilisation. L’Europe est donc aujourd’hui une « impuissance » édentée.
![]()





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg