vendredi, 19 décembre 2025
Remettre la beauté dans la cité: une condition pour une société bonne

Remettre la beauté dans la cité: une condition pour une société bonne
Pierre Le Vigan
Etre conservateur ? Voire. Tout ne doit pas être conservé de notre monde. Il y a des choses contre lesquelles il nous faut réagir. Et des révolutions sont nécessaires, comme les non conformistes des années trente l’avaient déjà bien vu. Mais il serait fou de ne pas vouloir conserver ce qui fait que nous avons été un peuple grand et créateur. Une certaine conception de la beauté. Conserver : c’est prendre sous sa garde et c’est servir. Conserver intelligemment, c’est d’abord pérenniser.
Mais si le mot d’ordre « il faut conserver la beauté » parait simple, il ne l’est pas. Il suppose que la beauté soit un bien commun, donc partagé. Ce n‘est pas une évidence, ou plutôt, ce n’est plus une évidence. Nous sommes dans une époque de subjectivisme: de « tout à l’ego », dit Rémi Brague. Qui définit la beauté ? Et comment définir la beauté ? Ces questions touchent à ce qui nous unit, ou à ce qui devrait nous unir. Car nous sommes malheureusement dans une société de déliaison. La beauté est donc une notion à repenser. Il ne s’agit pas ici de philosopher une fois de plus avec la beauté, ou de « philosopher avec l’histoire de l’art » (Audrey Rieber) mais de clarifier cette notion de beauté et d’esquisser un programme de son bon usage. N’oublions pas que délibérer vient de « soupeser » et que la pensée est elle-même toujours une « pesée ». Que pèse la beauté et comment la soulever, la manipuler, en faire quelque chose ? Si l’Idée est dans le ciel, elle nous sert, comme une étoile, de point de repère quand nous marchons, et nous marchons sur la terre.
Levons tout d’abord une hypothèque. La beauté concerne l’art mais pas seulement. Peinture, architecture, musique: tout cela a à voir avec la beauté. Mais la nature aussi est concernée par la question de la beauté. C’est ce que l’on appelle la beauté naturelle. Elle nous est donnée. Encore faut-il que nous la voyons. C’est une montagne, un lac, un simple cheminement dans la nature, ou c’est une vieille ville dans laquelle, pourtant, la raison première des constructions n’a pas été de « faire du beau » mais de remplir des fonctions utiles. Tout cela peut relever de la beauté. Elle est donc question de perception. Mais quelles sont les raisons de cette perception ?
C’est là que les choses se compliquent.
Une théorie nous dit que des choses sont perçues comme relevant du beau pour des raisons internes à la chose. Et ce dans le domaine du regard (peinture, sculpture, architecture), comme dans celui de l’audition (musique). Ce sont des qualités intrinsèques à la chose qui la font paraitre belle : des proportions, une harmonie, un équilibre, etc. Le sculpteur grec Polyclète avait déjà dit que la beauté était question de proportion. L’harmonie comme critère du beau : c’est ce qu’avait dit aussi Pythagore. De son côté, Edmund Burke nous dit : « L’ordonnance des édifices religieux est fondée sur la “symétrie”, dont les architectes doivent respecter le principe avec le plus grand soin… Aucun temple ne peut effectivement présenter une ordonnance rationnelle sans la ‘’symétrie” ni la ‘‘proportion”, c’est-à-dire si les composantes n’ont pas entre elles une relation précisément définie, comme les membres d’un homme correctement conformé. » (Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757). Tout est question de proportion : « La proportion consiste en la commensurabilité des composantes en toutes les parties d’un ouvrage. », nous dit encore E. Burke. Bien avant Burke, à la Renaissance, Luça Pacioli, moine et géomètre, avait développé la théorie du nombre d’or: 1/1,618 (De divina proportione, 1509). La beauté vient donc de la chose même et d’abord des proportions. Telle est la première hypothèse sur le pourquoi de la beauté.

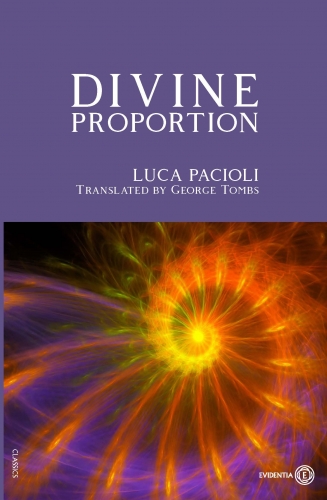
Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue. Une deuxième théorie voit le beau dans un facteur externe à la chose même. Le beau relèverait de la subjectivité de chacun, de la perspective de chacun. Le regard, l’ouïe de chacun serait à l’origine du beau. C’est donc une affaire personnelle et surtout une affaire de perspective, une question de point de vue. A chacun son idée du beau: en peinture, en musique, en architecture, en danse, etc. En ce sens, dans cette théorie, il n’y a plus de beau en commun. Il peut être une simple affaire de statistique : nous sommes peut-être nombreux à trouver belle telle œuvre ou tel paysage, mais il n’y a pas pas de critère autre que subjectif.
La beauté vient-elle donc des choses mêmes ou de l’effet que nous font certaines choses en fonction de ce que nous sommes et de notre état d’esprit présent ? Ce sont les deux théories qui se confrontent.
* * *
Pendant très longtemps, la théorie du beau comme interne à la chose a été privilégiée. « De là, la raison se dirigea vers les œuvres des yeux et, embrassant la terre et le ciel, se rendit compte quelle n’aimait rien d’autre que la beauté, et dans la beauté les figures, dans les figures les proportions, dans les proportions les nombres », dit Saint Augustin. Dieu a créé le monde beau, et dans ce monde, il a créé les choses belles. La raison fait ce constat. La beauté est interne au monde car Dieu l’a mis dans le monde. Pour Alberti (1404-1472), nature, raison et beauté forme un ensemble. La beauté est une affaire de convenance, une « harmonie réglée par une proportion déterminée, qui règne entre l’ensemble des parties du tout auquel elles appartiennent » (L’Art d’édifier). La beauté est « l’accord et l’union des parties d’un tout auquel elles appartiennent ». On retrouve les mêmes règles pour la peinture, la sculpture et même l’éloquence. Quant à l’origine même des choses, elle est, comme le suggère le trytique évoqué plus haut, dans la nature même.

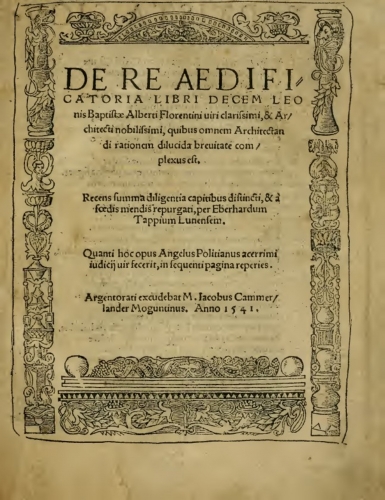
La vision d’Alberti est ici conforme à ce que dit Aristote : « en général les choses adviennent absolument, les unes par changement de forme, par exemple une statue, d’autres par addition, par exemple les choses qui croissent, d’autres par soustraction, par exemple l’Hermès à partir de la pierre, d’autres par composition, par exemple une maison, d’autres par altération, par exemple les choses qui changent du point de vue de la matière » (Physique, I, 7, 190 b trad. Pierre Pellegrin). Il en est de même pour les choses prétendant à l’art, c’est-à-dire, pour les Anciens, visant à la beauté. Pour Léonard de Vinci (Traité de la peinture, notes prises à partir de 1490), la peinture relève des proportions et est ainsi liée aux mathématiques. Là encore, nous sommes là dans une conception de la beauté comme intrinsèque aux choses. Les choses belles sont celles qui répondent à des critères internes de beauté. C’est une beauté objective. Un plafond peint est objectivement beau pour des raisons de proportion, d’harmonie, d’équilibre entre les masses, les couleurs, etc, et dans le mesure où il répond à ces exigences d’harmonie.
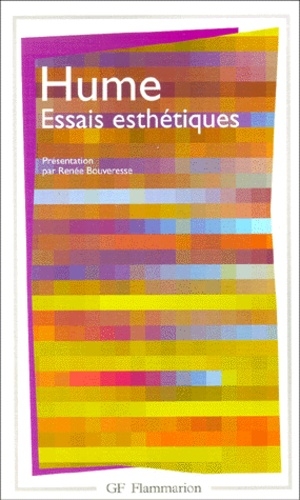 David Hume remet cela complètement en question. Selon lui, la beauté est subjective, elle relève du goût et de la jouissance que nous procure quelque chose : un tableau, un paysage, une musique. « La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente. » (De la norme du goût, 1757). Le beau est affaire de goût. Pour autant, ce goût, s’il est subjectif, n’est pas arbitraire. Il est façonné par des règles et celles-ci trouvent leur origine dans l’expérience. « Le fondement de ces règles est le même que celui de toutes les sciences pratiques, l’expérience. Elles ne sont que des observations générales sur ce qu’on a vu universellement plaire dans tous les pays et à toutes les époques. » (Essai sur la règle de goût, 1757). Chacun se dirigera vers ce qui lui procure du plaisir, mais il ne faut pas y voir un hédonisme primaire : ce qui procure du plaisir à un tel peut être la rigueur, l’exactitude, la vertu. On peut jouir de l’austérité des formes, des volumes, des couleurs.
David Hume remet cela complètement en question. Selon lui, la beauté est subjective, elle relève du goût et de la jouissance que nous procure quelque chose : un tableau, un paysage, une musique. « La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente. » (De la norme du goût, 1757). Le beau est affaire de goût. Pour autant, ce goût, s’il est subjectif, n’est pas arbitraire. Il est façonné par des règles et celles-ci trouvent leur origine dans l’expérience. « Le fondement de ces règles est le même que celui de toutes les sciences pratiques, l’expérience. Elles ne sont que des observations générales sur ce qu’on a vu universellement plaire dans tous les pays et à toutes les époques. » (Essai sur la règle de goût, 1757). Chacun se dirigera vers ce qui lui procure du plaisir, mais il ne faut pas y voir un hédonisme primaire : ce qui procure du plaisir à un tel peut être la rigueur, l’exactitude, la vertu. On peut jouir de l’austérité des formes, des volumes, des couleurs.
Kant propose une théorie qui tente la synthèse des deux premières : la beauté intrinsèque aux choses et la beauté comme relevant des goûts subjectifs. Pour Kant, la théorie des goûts subjectifs concerne l’agréable et non pas le beau. L’agréable est relatif à l’expérience de chacun, il est parfaitement subjectif, en matière de cuisine ou d’odeur. Mais le beau relève par contre d’une certaine objectivité. « Le beau est ce qui plait universellement sans concept. » (Critique de la faculté de juger, 1790). Universellement. Dés lors, il est peut-être subjectif mais il plait à tous, ce qui veut dire qu’il y a des critères universels au beau. « Ce qui est simplement subjectif dans la représentation d’un objet, c’est-à-dire ce qui constitue sa relation au sujet et non à l’objet, c’est sa nature esthétique » (Introduction à la Critique de la faculté de juger, 1790).
L’esthétique est, conformément à son étymologie grecque, ce que nos sens perçoivent, ou encore ce qui affecte nos sens. Pour Kant, le beau existe objectivement comme objet mais nous le percevons subjectivement. Bien que le jugement de goût, dont relève le beau, ne soit pas un jugement de connaissance (contrairement à un jugement tel que « le chat est un félin »), ce n’est pas pour autant un jugement purement subjectif. «Le beau est représenté sans concept comme objet d’une satisfaction universelle.» Cette satisfaction n’est pas exactement l’agréable, elle est le respect. En ce sens, si le beau ne relève pas de la raison pratique, c’est-à-dire du devoir-faire, il y a tout de même une notion de devoir qui intervient, qui est le devoir admirer. Une forme de convenance sociale, voire de décence sociale qui ne se réduit pas à la théorie de la distinction qui sera celle de Pierre Bourdieu. C’est le respect d’un en-commun et le respect d’une transmission.
Le beau ne se confond donc pas ce qui donne du plaisir, nous dit Kant. Il est par ailleurs strictement désintéressé, ce qui renvoie à sa distinction d’avec l’agréable. « La satisfaction qui détermine le jugement de goût est désintéressée » (Kant, Critique de la faculté de juger, 1790). On ne trouve pas beau un tableau parce que on va se l’offrir, et/ou parce que c’est un bon placement. Le beau n’a aucune utilité. Il doit « plaire sans intérêt ». En ce sens, le beau dans la nature est plus authentiquement beau que le beau humain, celui de l’art, car un tableau est fait pour être vu, pour obtenir au moins un succès d’estime, de même qu’une pièce de musique est faite pour être jouée, et si possible devant un public choisi, de qualité, de même qu’un discours est fait pour susciter les applaudissements, etc. On verra que c’est le contraire du point de vue de Hegel, pour qui le seul vrai beau et le produit de l’homme.
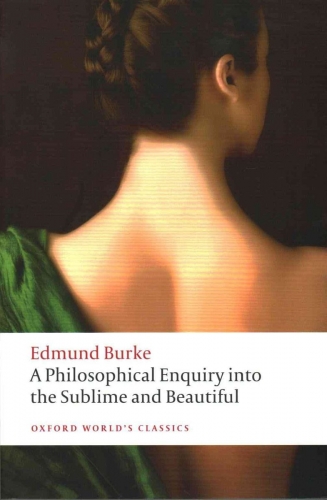 Le beau a aussi des limites hautes pour Kant : ce qui est au-delà. Ce qui est trop beau pour rester simplement beau. C’est le sublime – une notion qui a été développée avant Kant par Edmund Burke (Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757), et que l’on trouvait déjà chez différents auteurs, tel Nicolas Boileau. Or, le beau n’est pas le sublime, car le sublime excède l’entendement. Le beau et le sublime touchent, certes, tous deux l’âme, mais le sublime le fait avec violence. Il est « trop beau » pour être raisonnable. Le sublime est mélé d’effroi. Il est inévitablement violent. « (…) le beau et le sublime ne donnent-ils lieu qu'à des jugements particuliers, mais qui s'attribuent une valeur universelle, quoiqu'ils ne prétendent qu'au sentiment de plaisir, et non point à une connaissance de l'objet. Mais il y a entre l’un et l’autre des différences considérables. Le beau de la nature concerne la forme de l’objet, laquelle consiste dans la limitation ; le sublime, au contraire, doit être cherché dans un objet sans forme, en tant qu’on se représente dans cet objet ou, à son occasion, l’illimitation. » (Kant, Critique de la faculté de juger, II, 23). Le sublime ouvre sur un gouffre, à la différence du beau. Le sublime est ce qui déborde. « L'esprit se sent mis en mouvement dans la représentation du sublime dans la nature, en revanche, dans le jugement esthétique sur le beau dans la nature, il est dans une calme contemplation » (Critique de la faculté de juger). Kant dit encore : « Le sublime émeut, le beau charme » (Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 1770).
Le beau a aussi des limites hautes pour Kant : ce qui est au-delà. Ce qui est trop beau pour rester simplement beau. C’est le sublime – une notion qui a été développée avant Kant par Edmund Burke (Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757), et que l’on trouvait déjà chez différents auteurs, tel Nicolas Boileau. Or, le beau n’est pas le sublime, car le sublime excède l’entendement. Le beau et le sublime touchent, certes, tous deux l’âme, mais le sublime le fait avec violence. Il est « trop beau » pour être raisonnable. Le sublime est mélé d’effroi. Il est inévitablement violent. « (…) le beau et le sublime ne donnent-ils lieu qu'à des jugements particuliers, mais qui s'attribuent une valeur universelle, quoiqu'ils ne prétendent qu'au sentiment de plaisir, et non point à une connaissance de l'objet. Mais il y a entre l’un et l’autre des différences considérables. Le beau de la nature concerne la forme de l’objet, laquelle consiste dans la limitation ; le sublime, au contraire, doit être cherché dans un objet sans forme, en tant qu’on se représente dans cet objet ou, à son occasion, l’illimitation. » (Kant, Critique de la faculté de juger, II, 23). Le sublime ouvre sur un gouffre, à la différence du beau. Le sublime est ce qui déborde. « L'esprit se sent mis en mouvement dans la représentation du sublime dans la nature, en revanche, dans le jugement esthétique sur le beau dans la nature, il est dans une calme contemplation » (Critique de la faculté de juger). Kant dit encore : « Le sublime émeut, le beau charme » (Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 1770).
Le beau est par définition ce qui plait universellement (on peut toutefois se demander dans quelle mesure Kant prenait en compte l’existence de civilisations non européennes). Mais cet universel reste néanmoins subjectif à sa façon. Il n’est pas un jugement de connaissance comme « Un chat a des vibrisses ». Le beau qui croit parler d’une chose, - comme la phrase « Cette montagne est belle » - ne nous dit en fait rien de cette montagne (s’agit-il du Mont Blanc, du Puy de Sancy, du Ballon de Guebwiller?). Mais cette phrase dit quelque chose de celui qui est affecté par le spectacle de la montagne. Elle dit cela et seulement cela. Il (le sujet) a trouvé cela beau, que cela soit une grande montagne ou une petite montagne. Pour autant, ce subjectif, ce jugement personnel vise à une universalité. Quand l’un d’entre nous dit d’un paysage : « C’est beau », il pense que cette affirmation est non seulement audible par autrui, mais raisonnablement partageable. L’art, le beau et la sensibilité sont liés (Alexander G. Baumgarten, Esthétique, 1750).
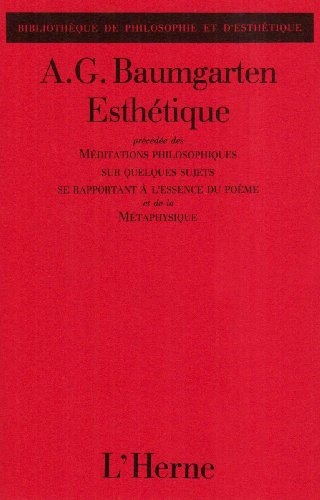 Il est entendu que ce serait rompre une sorte de pacte social implicite que ne pas trouver belle la vue du Pic du Midi, ou beau un tableau de Degas ou de Cézanne. En ce sens, il y a une universalité subjective que David Hume lui-même, pourtant subjectiviste et donc théoriquement individualiste, reconnaissait puisqu’il estimait que certaines œuvres sont amenées, en fonction de l’acquisition par chacun d’un « bon goût » esthétique à être appréciées par tous et à différentes époques. L’approche subjectiviste et nominaliste du beau trouve ses limites quand on affirme que par l’éducation, tout le monde doit se retrouver d’accord pour trouver belles certaines choses ou certaines œuvres.
Il est entendu que ce serait rompre une sorte de pacte social implicite que ne pas trouver belle la vue du Pic du Midi, ou beau un tableau de Degas ou de Cézanne. En ce sens, il y a une universalité subjective que David Hume lui-même, pourtant subjectiviste et donc théoriquement individualiste, reconnaissait puisqu’il estimait que certaines œuvres sont amenées, en fonction de l’acquisition par chacun d’un « bon goût » esthétique à être appréciées par tous et à différentes époques. L’approche subjectiviste et nominaliste du beau trouve ses limites quand on affirme que par l’éducation, tout le monde doit se retrouver d’accord pour trouver belles certaines choses ou certaines œuvres.
* * *
Dans toutes ses théories, il y a un manque, et c’est la théorie la plus originelle du beau. Il n’aurait rien à voir avec l’agréable ni avec la subjectivité. Il ne renverrait pas non plus à des qualités propres à l’objet, internes à celui-ci. Le beau, ce serait le vrai. Ce serait la vérité de la chose mais aussi la justesse de notre rapport à la chose. C’est la théorie de Platon. C’est aussi celle de Hegel : « Le beau c’est l’éclat du vrai ». C’est un point de vue que l’on trouvera aussi chez Jules Lequier pour qui le beau, c’est l’éclat de la raison, ce qui n’est pas très éloigné, et chez Jules Lachelier, pour qui la beauté est une expérience de l’esprit qui recherche le vrai. Nous sommes, là encore, dans la lignée de Platon. Il faut donc faire retour à lui.
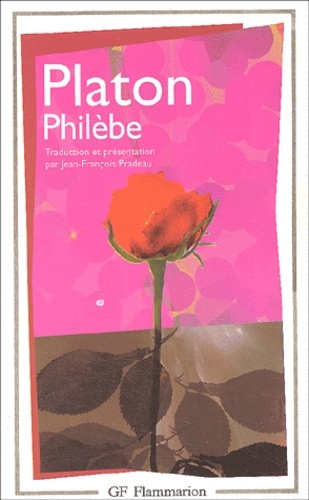 Pour Platon, le beau, c’est le vrai et c’est aussi le bien, ou au moins l’éclat du bien. Le beau n’est donc pas que l’apparence du beau, ni la belle représentation d’une belle chose. Il est le chemin vers le bien et le vrai. « La puissance du bien s’est réfugiée dans la nature du beau », dit Socrate (Platon, Philèbe ou Sur le plaisir, 64 e). La puissance du bien n’est pas tout à fait le bien, mais est le bien comme possibilité et potentialité. Mais précisément, comment saisir qu’il est possible ? « Si donc nous ne pouvons saisir le bien sous un seul caractère, saisissons le sous trois : beauté, proportion, vérité, et disons que par là comme s’il s’agissait d’un seul terme, nous pouvons indiquer avec certitude les causes des qualités du mélange et déclarer que si cela est bon, le mélange est tel lui aussi. » (Philèbe, 65 a). Par contre, le beau n’a rien à voir avec le plaisir et l’agréable. Il faut même prendre garde quand l’agréable est présent. Cela est signe de vulgarité. Le plaisir est en effet sans limite (illimité : apeiron). Or, seul ce qui est limité est beau pour les Grecs. Le beau ne peut être que limite et mesure. Il y a une clôture du beau.
Pour Platon, le beau, c’est le vrai et c’est aussi le bien, ou au moins l’éclat du bien. Le beau n’est donc pas que l’apparence du beau, ni la belle représentation d’une belle chose. Il est le chemin vers le bien et le vrai. « La puissance du bien s’est réfugiée dans la nature du beau », dit Socrate (Platon, Philèbe ou Sur le plaisir, 64 e). La puissance du bien n’est pas tout à fait le bien, mais est le bien comme possibilité et potentialité. Mais précisément, comment saisir qu’il est possible ? « Si donc nous ne pouvons saisir le bien sous un seul caractère, saisissons le sous trois : beauté, proportion, vérité, et disons que par là comme s’il s’agissait d’un seul terme, nous pouvons indiquer avec certitude les causes des qualités du mélange et déclarer que si cela est bon, le mélange est tel lui aussi. » (Philèbe, 65 a). Par contre, le beau n’a rien à voir avec le plaisir et l’agréable. Il faut même prendre garde quand l’agréable est présent. Cela est signe de vulgarité. Le plaisir est en effet sans limite (illimité : apeiron). Or, seul ce qui est limité est beau pour les Grecs. Le beau ne peut être que limite et mesure. Il y a une clôture du beau.
Un autre aspect du beau chez Platon est le refus de tout perspectivisme. Le beau n’est beau qu’en absolu, non quand il est conçu pour être vu d’un point de vue humain (Sophiste 235-237). Il faut, pour voir le beau, se déprendre de toute perspective (c’est l’opposé de ce que sera la position de Nietzsche). Pour Platon, il peut être nécessaire de prendre en compte une perspective et donc, par exemple, de déformer une statue pour séduire le goût commun, pour tenir compte du lieu à partir duquel on aura une vue sur elle, mais cela n’a aucun rapport avec la beauté véritable. C’est une apparence, et une apparence est du non-être. C’est du sophisme, c’est-à-dire non pas du savoir mais un mime du savoir. Une habileté sociale et langagière. C’est aussi de la rhétorique, c’est-à-dire une tentative de séduire, de convaincre d’une beauté qui n’est pas vraiment là. Cela relève donc de l’opinion (doxa) et non de la vérité. Or, la vraie beauté, la seule beauté doit se fonder sur la rectitude du jugement, sur le vrai (Les Lois, 667 c-669 b): «Aucune imitation ne doit se juger d’après le plaisir». Du reste, l’imitation est conforme à l’ordre naturel mais en dessous de l’ordre du vrai et du bien.
Le seul critère doit être le vrai. «(…) Préférer la beauté à la vertu, écrit encore Platon, ce n'est pas autre chose que déshonorer son âme réellement et entièrement ; c'est en effet dire, contre toute vérité, que le corps est plus estimable que l'âme» (Les Lois, livre V). Pour le dire autrement, il n’y a de vraie beauté que la vertu. Et la vertu consiste dans la rectitude de l’artiste, c’est-à-dire dans son sens exact des proportions, hors toute mise en perspective. C’est la proportion absolue – indépendante des perspectives humaines, par définition changeantes – ou encore l’harmonie dans l’absolu qui doit être sa règle de travail. La seule apparence des proportions, au prix d’artifices, serait une tromperie (ce qui renvoie à la condamnation de la séduction du goût commun évoquée plus haut). Pour trouver le vrai, les sciences sont nécessaires : la science des nombres, la géométrie, l’astronomie (La République, 491-494). De plus, l’harmonie est nécessaire pour trouver le bien et le vrai mais ne suffit pas. Il faut que le regard se lève des choses du bas pour aller vers les choses du haut, c’est-à-dire vers la science, c’est-à-dire les Idées ’’en soi’’ (par opposition au ’’pour soi’’ de toute perspective, pour le dire en langage post-platonicien, et en l’occurrence kantien).
Mesure, proportion, intellect : telles sont les trois étapes nécessaires pour accéder au bien et au vrai. Ecoutons Platon : « Socrate – Ainsi tu publieras partout, Protarque (…) que le plaisir n’est ni le premier, ni le second bien ; mais que le premier bien est la mesure, le juste milieu, l’à-propos, et toutes les autres qualités semblables, qu’on doit regarder comme ayant en partage une nature immuable. (…) Que le second bien est la proportion, le beau, le parfait, ce qui se suffit par soi-même, et tout ce qui est de ce genre. (…) Autant que je puis conjecturer, tu ne t’écarteras guère de la vérité en mettant pour le troisième bien l’intelligence et la sagesse. » Platon poursuit : « (…) N’assignerons-nous point la quatrième place à ce que nous avons dit appartenir à l’âme seule, aux sciences, aux arts, aux vraies connaissances, [66c] s’il est vrai que ces choses ont une liaison plus étroite avec le bien que le plaisir ? (…) Au cinquième rang, mettons les plaisirs que nous avons distingués des autres comme exempts de douleur, les nommant des perceptions pures de l’âme qui tiennent à la suite des sensations. (…) A la sixième génération, dit Orphée, mettez fin à vos chants. Il me semble pareillement que ce discours a pris fin au sixième jugement. Il [66d] ne nous reste plus qu’à couronner ce qui a été dit. » (Philèbe, 66 a-d, trad. Victor Cousin).
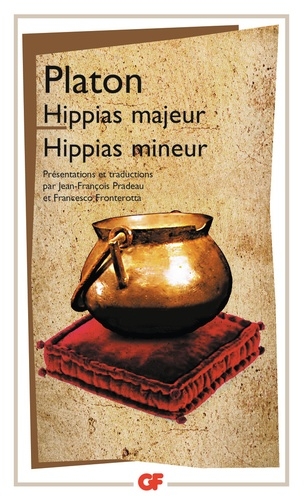 Voilà donc quels sont les biens qui mènent au Bien, au Beau, au Vrai. L’énoncé de ce chemin – mesure, proportion, sagesse, écoute de l’âme – répond à la question qui est débattue dans l’Hippias majeur ou De la beauté. Dans ce dialogue, Socrate interroge Hippias sur ce qu’est le beau. Hippias répond par un exemple: «une jeune vierge» c’est-à-dire «une belle jeune fille». Mais Socrate attend une réponse qui ne soit pas un exemple. Il voudrait savoir ce qui rend une chose belle. C’est pourquoi il émet l’hypothèse que le beau pourrait concerner des choses à laquelle on ne s’attend pas. Par exemple une marmite. Pour Socrate, une marmite peut être belle. Hippias ne voit pas les choses ainsi. Il voit de belles choses, mais ne voit pas comment des choses peuvent devenir belles. Il ne répond qu’à la question «Qu’est ce qui est beau?» et non à la question «Qu’est-ce que le beau?».
Voilà donc quels sont les biens qui mènent au Bien, au Beau, au Vrai. L’énoncé de ce chemin – mesure, proportion, sagesse, écoute de l’âme – répond à la question qui est débattue dans l’Hippias majeur ou De la beauté. Dans ce dialogue, Socrate interroge Hippias sur ce qu’est le beau. Hippias répond par un exemple: «une jeune vierge» c’est-à-dire «une belle jeune fille». Mais Socrate attend une réponse qui ne soit pas un exemple. Il voudrait savoir ce qui rend une chose belle. C’est pourquoi il émet l’hypothèse que le beau pourrait concerner des choses à laquelle on ne s’attend pas. Par exemple une marmite. Pour Socrate, une marmite peut être belle. Hippias ne voit pas les choses ainsi. Il voit de belles choses, mais ne voit pas comment des choses peuvent devenir belles. Il ne répond qu’à la question «Qu’est ce qui est beau?» et non à la question «Qu’est-ce que le beau?».
C’est ce que nous dit ce dialogue, dans lequel Socrate cherche des arguments pour convaincre non Hippias mais un supposé interlocuteur qui est absent. « Hippias – Tu sauras donc, puisqu'il faut te dire la vérité, que le beau, c'est une belle jeune fille. Socrate – Par le chien, Hippias, voilà une belle et brillante réponse. Si je réponds ainsi, aurai-je répondu, et répondu juste à la question, et n'aura-t-on rien à répliquer ? Hippias – Comment le ferait-on, Socrate, puisque tout le monde pense de même, et que ceux qui entendront ta réponse te rendront tous témoignage qu'elle est bonne ? Socrate – Admettons... Mais permets, Hippias, que je reprenne ce que tu viens de dire. Cet homme m'interrogera à peu près de cette manière : “Socrate, réponds-moi : toutes les choses que tu appelles belles ne sont-elles pas belles parce qu'il y a quelque chose de beau par soi-même?” Et moi, je lui répondrai que, si une jeune fille est belle, c'est qu'il existe quelque chose qui donne leur beauté aux belles choses. » (Hippias majeur, 287d-288 e). Les choses sont ainsi on ne peut plus claires : pour Socrate, il y a quelque chose qui peut rendre les choses belles, la jeune fille tout comme la marmite. Ce quelque chose, c’est l’Idée de la beauté. Et c’est en tant qu’une chose participe à cette idée de la beauté qu’elle peut devenir belle.
Participer à l’Idée de la beauté nécessite d’être dans le vrai et dans l’harmonie. On assimile souvent cela à être dans le bien. Cette interprétation est recevable, mais au sens où c’est être dans le bien qui est cause de l’harmonie, de la proportion et de la vérité, et donc au final de la beauté. Le bien est cause du beau, mais, en même temps, le beau est un repère : il fait signe vers le bien. Il nous indique où est la demeure du bien. Il aide à accoucher du bien, et c’est en cela qu’il est beau (osons dire : c’est en cela que le beau est beau). Le bien, qui est notamment le bien-faire, le bien travailler, permet le beau, qui se met lui-même au service du bien. On aurait tort de croire périmées les leçons de Platon. Faire coïncider le beau et le bien reste un objectif. Ajoutons y la force et la passion. Car il n’y a de beau et de bien que dans la force, l’énergie et la passion. Cette indispensable passion sans laquelle rien de grand ne se fait, avait remarqué Hegel.
* * *
Au terme de cette rapide enquête, il est possible de tirer quelques conclusions : que faire de la beauté ? Quelle place lui accorder? De la beauté, il faut faire une exigence - et non un pourcentage (le 1% artistique). De là, quelques points de repères s’imposent pour lui donner sa place.
1 – L’art n’est pas le beau. L’art peut certes être beau. Mais il peut aussi être autre chose. Il peut émouvoir, séduire, intéresser, voire déranger. Ce dernier aspect est très à la mode. L’art doit être « dérangeant ». Oublions cette coquetterie moderne. En tout état de cause, l’art tel qu’il est aujourd’hui ne relève ni du beau objectif – conçu selon des lois d’harmonie et de proportion – ni du beau universellement subjectif, perçu comme tel par tous. Le grand récit universel de l’art n’est que celui de l’Occident, et tout le monde l’a maintenant compris. Les arts ne suivent pas la pente du progrès comme le font les sciences, contrairement à ce que pensait Charles Perrault, à l’encontre de Nicolas Boileau, La Bruyère, La Fontaine.
2 – Le beau, non seulement ne se réduit pas à l’art, mais concerne bien des domaines. C’est le cas de la beauté dans la nature. C’est le cas de la beauté dans le quotidien, et notamment dans l’artisanat. C’est précisément dans ces domaines que la beauté manque le plus. Trop de technique répétitive, industrielle.

3 – Le beau est un enjeu social. Les bâtiments dans lesquels nous vivons, nous travaillons, nous consommons nous concernent tous. La production du beau n’est pas principalement une question d’artistes. Elle concerne les artisans et l’industrie, y compris bien entendu celle du bâtiment, qui a connu, comme l’a bien vu Françoise Choay, une révolution par l’industrialisation. Le beau a vocation à être dans la rue plus que dans les musées. Nous en sommes loin.
4 – Le beau est aussi une question qui concerne chacun. Il n’est pas raisonnable de demander du beau dans la rue quand on se promène en short dans une ville. C’est à chacun, à défaut de produire du beau, de ne pas ajouter à la laideur ambiante.
5 – Le beau est une question de civilisation. Le beau européen exclut ainsi la burqa, la djellaba, la casquette du rapeur, les robes d’indiennes, etc. Il y a d’autres « beau » que le beau européen, mais ils sont faits pour les pays non européens. En Europe, fais comme les Européens.
Pour la pensée progressiste, il n’y a pas de bien et de mal, il n’y a que du moderne, qui doit être remplacé par du toujours plus moderne. Il y a le progrès, qui est moderne, et la réaction, qui est toujours à proscrire, quand bien même estimerait-elle être une réaction contre le laid ou le mal. Pour la pensée conservatrice, celle qui veut conserver non pas tout ce qui est contemporain, mais ce qui le mérite, c’est-à-dire ce qui relève des permanences de notre civilisation, et pour tout dire de notre être, il y a du bien et du mal, du beau et du laid. Et non pas du moderne et du réactionnaire. C’était et c’est toujours la pensée des Anciens. Ce n’est pas la pensée d’avant, c’est la pensée de toujours.
De ce point de vue, qui refuse la dictature de la néophilie, le beau peut être du nouveau. Mais le nouveau n’est pas beau par le simple fait qu’il soit nouveau. L’enjeu du beau déborde aussi sur le sens de la vie. Konrad Lorenz écrit : « le sens esthétique et le sens moral sont manifestement étroitement liés » (Les huits péchés capitaux de notre civilisation, 1973). Vivre dans la laideur ne pousse pas à penser hautement. Ce qui pose la question fondamentale de la beauté nécessaire de notre « cadre de vie », de la qualité esthétique de notre environnement. La beauté est une question sociale. Elle est même souvent la forme que prend la question sociale.
* * *


Pierre Le Vigan est né en 1956. Il est urbaniste, essayiste et philosophe. Auteur de quelque 25 livres, il s’intéresse depuis des décennies au mouvement des idées et à l’évolution des sociétés. Ses derniers ouvrages porte sur Les démons de la déconstruction. Derrida, Lévinas, Sartre, éditions La barque d’or; Trop moche la ville. Comment nos villes sont devenues laides (et obèses), La barque d’or, 2025; Le Coma français, Perspectives Libres-Cercle Aristote, 2024; Clausewitz (PL, 2024).
15:30 Publié dans Architecture/Urbanisme, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, philosophie, esthétique, beau, beauté |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


