jeudi, 01 mai 2025
Une théorie des civilisations dans les années 1920-1940: Feliks Koneczny
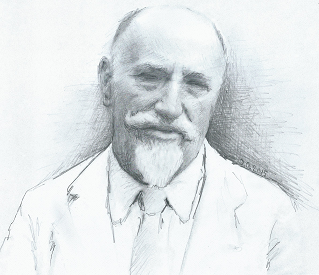
Une théorie des civilisations dans les années 1920-1940: Feliks Koneczny
Pierre Le Vigan
« Il n’est pas possible d’être civilisé de deux manières », dit Feliks Koneczny. Cette formule est vertigineuse. Elle bat en brèche l’universalisme. Elle ne dit pas qu’il y a « nous » et « les barbares ». Elle dit que l’on n’accède à cette forme universelle d’évolution de l’homme qu’est la civilisation que par plusieurs voies. En d’autres termes, il y a bien des façons d’être civilisé, mais il faut choisir : on ne peut être civilisé à cheval entre deux cultures (ou plus). On peut certes connaitre l’influence de diverses cultures, mais l’une doit être clairement prédominante. Dans l’histoire de l’humanité, la civilisation consiste précisément en ce qu’il y a toujours plusieurs civilisations. De même que l’existence d’une nation suppose qu’il y ait à côté d’autres nations.
On peut considérer que la formule de Koneczny (1862-1949) est celle de l’ethno-différentialisme ou du culturo-différentialisme. Trop de différences fait que l’on s’enlise dans les différences: on ne les surmonte pas. Mais qui est cet auteur peu connu ? C’est ce qu’Antoine Dresse nous fait découvrir dans son dernier essai publié sous le patronage de l’Institut Iliade. Polonais, Koneczny nait à Cracovie. Cette ville est alors rattachée à l’Empire d’Autriche qui devient la double monarchie en 1867: l’Empereur d’Autriche est aussi roi de Hongrie. Cracovie, à l’extrême ouest de la Galicie est rattaché à la partie autrichienne de l’Empire, la Cisleithanie. Cracovie est alors la capitale d’une Province appelée Petite Pologne.
La famille de Koneczny a des origines en Silésie, polonaise jusqu’au XIVe siècle, rattachée ensuite brièvement à la Bohème, puis autrichienne, et enfin prussienne depuis sa conquête par Frédéric II de Prusse, conquête validée au traité de 1763. Et de nouveau polonaise depuis 1945. L’histoire de la Silésie fut aussi très liée à celle de la Bohème et de la Moravie (l’actuelle Tchéquie). Koneczny est donc issu des marches occidentales de la Pologne. Il est slavophile et défend, à une époque où la germanité de la population silésienne ne faisait pas de doute, son caractère historiquement slave. Historien renommé à son époque, puis oublié, et redécouvert récemment, Koneczny est l’auteur de nombreux livres sur l’histoire de la Pologne et sur certaines de ses grandes figures, et aussi auteur d’une Histoire de la Russie, exercice d’autant plus intéressant que Pologne et Russie furent des puissances à la fois liées et presque toujours rivales.
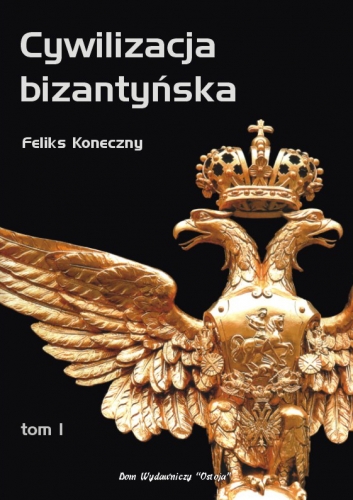
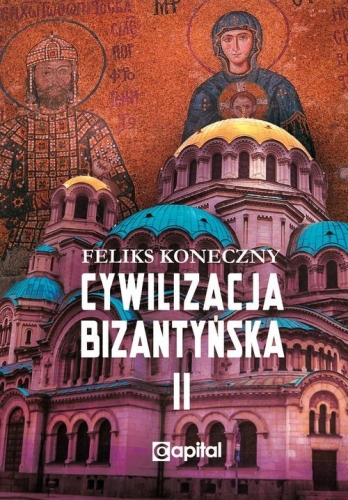
Koneczny cherche à expliquer comment les nations peuvent avoir plus qu’une histoire nationale, c’est-à-dire portent un modèle de civilisation et peuvent en être les garants. C’est là que l’historien devient aussi un philosophe de l’histoire. Dans cette perspective, à partir des années 1920 – celles de la renaissance de la Pologne, étendue jusqu’à Vilna/Vilnius –, Koneczny défend la thèse comme quoi la Pologne représente en Europe le pôle de la chrétienté latine. Elle est, plus précisément, ce qui, dans le pôle latin, se situe le plus à l’est. Et c’est justement parce que la Pologne est « entre Orient et Occident » selon ses propres termes, qu’elle doit savoir ce qu’elle est pour continuer à exister. Pour perdurer dans son être, disait Dominique Venner.
Feliks Koneczny publie ses premiers livres relevant de la philosophie de l’histoire, ou plutôt d’une méta-théorie de l’histoire dans l’entre-deux guerres. Bien que conservateur et « nationaliste » polonais, il n’a pas que des amis dans la droite polonaise. Il est mal vu du chef de l’Etat, Pilsudski. Ce dernier, ainsi qu’une partie des intellectuels nationalistes polonais, défend l’idée d’une union de nations de la Baltique à la Mer Noire, c’est à dire de la Pologne à la Roumanie, cette dernière alliée de la France pendant la Grande Guerre (la Pologne, quant à elle, n’existait pas comme Etat mais en 1916, les puissances centrales créent un Etat croupion en Pologne ex-Russe).
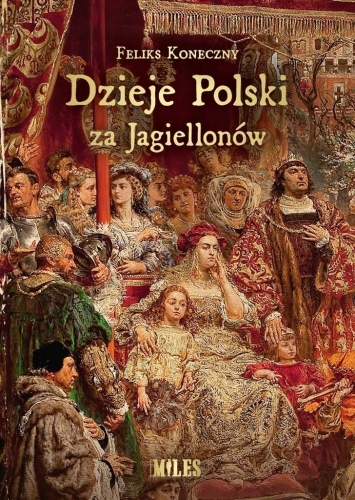
De son côté, contrairement à Pilsudski, Koneczny défend l’idée d’un nationalisme strictement polonais sans dissolution de l’identité nationale, même dans une union avec la Lituanie, qui aurait alors repris le schéma historique de la confédération Polono-Lituanienne (il y a du reste un contentieux lituano-polonais dans l’entre-deux guerre puisque Vilna, la capitale historique de la Lituanie est rattachée à la Pologne, la Lituanie ayant comme capitale Kaunas). Après l’occupation allemande qui frappe lourdement sa famille, Koneczny trouve plus que difficilement sa place dans la Pologne stalinienne de l’après-guerre. Il est redécouvert après 1989. Une de ses sentences devient emblématique de la droite polonaise : « La Pologne sera catholique ou ne sera pas. »
* * *
La théorie des civilisations de Koneczny a un point commun avec celle de Spengler. Ce dernier disait : « Ou bien l’humanité est un concept zoologique, ou bien elle est un mot vide de sens ». Koneczny est d’accord avec ce point de départ. Il développe une définition de la civilisation comme « la somme de tout ce qui est commun à une certaine fraction de l’humanité et en même temps la somme de tout ce par quoi cette fraction diffère des autres. »
Koneczny est influencé par des pensées sur l’histoire qui l’ont précédé. Il a lu avec intérêt Vico (La science nouvelle, 1725), sa théorie cyclique de l’histoire et sa vision des trois âges, celui des dieux, des héros, des hommes (qui correspondent à enfance-adolescence-âge mur). Koneczny est aussi influencé par Herder (Une nouvelle philosophie de l’histoire, 1774 ; Idées pour une philosophie de l’histoire de l’humanité, 1791)[1]
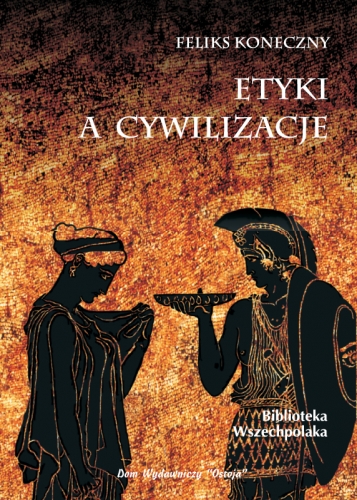
Koneczny reprend l’organicisme de Herder mais récuse par contre la conception morphologique des civilisations de Spengler qui lui parait trop abstraite. Il lui préfère une méthode plus empirique. Ses références sont Francis Bacon (Novum organum, 1620) et sa méthode scientifique, Montesquieu, et (moins connu) Kollataj, l’auteur de la Constitution polonaise de 1791 (en une période tragique de liquidation de la Pologne, avec les trois partages de 1772, 1793, 1795). Ajoutons que Koneczny est aussi proche du néo-thomisme (avec notamment Jacques Maritain) – plein de vitalité dans l’entre-deux guerres en Europe, et notamment en France.
Pour Koneczny, « la civilisation et avant tout un principe d’organisation de la vie collective ». Son approche n’est pas métaphysique, même si nous avons vu qu’il n’est pas indifférent aux questions philosophiques. Mais l’essentiel est pour Koneczny de voir comment les hommes mettent en œuvre des principes d’organisation collective de la vie, et ce dans tous les domaines, matériels et spirituels, ou si l’on préfère, mentaux. La vie collective nécessite en effet une organisation. Or, ce qu’observe Koneczny dans les différentes civilisations, c’est une diversité des droits, et une diversité des valeurs. Les deux domaines étant bien entendu en lien. Le droit, les mœurs et les représentations forment un ensemble. Ainsi, observe Koneczny, qui dit société polygame dit organisation clanique, et donc faible développement économique. La diversité des droits s’applique principalement au droit de la famille, au droit de propriété et au droit de l’héritage.
On voit donc tout de suite se profiler la question des rapports entre le public et le privé, et la question de la transmission, l’héritage n’étant pas seulement une question matérielle (léguer une maison de famille avec la bibliothèque familiale n’est pas une simple question matérielle, c’est aussi un acte à forte charge symbolique). Les valeurs, quant à elles, sont vérité, bonté, beauté, santé, prospérité. Des valeurs de l’esprit, et des valeurs du corps. Et une valeur qui participe des deux: la beauté.
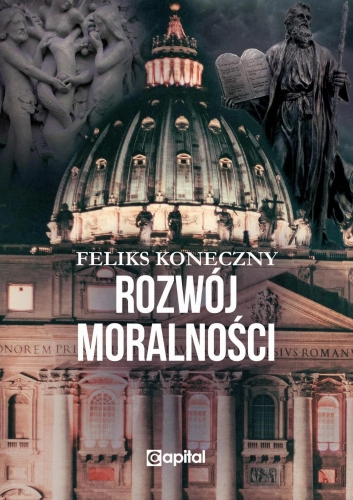
Ce schéma permet de distinguer différentes civilisations. Mais comment cela s’articule-t-il avec les autres différenciations de l’humanité: races, religions ? Pour Koneczny, les races existent mais elles ne coïncident pas avec les civilisations pas plus qu’elles ne les expliquent entièrement. Les deux cartes, races et civilisations, ne se superposent pas (même s’il peut y avoir des recoupements partiels). La race n’est pas en amont de la civilisation. Ce n’est pas la race qui fait la civilisation, c’est la civilisation qui fait la race. A partir du moment où il y a civilisation, il y a race car il y a endogamie. C’est ainsi que s’était créée une sorte de « race » pied-noir, issus des mélanges entre Européens d’Algérie. C’est ainsi que s’est créée une sorte d’ « ethnie israélienne », les Israéliens étant pourtant un mélange composite[2].
La carte des religions ne se superpose pas non plus avec la carte des civilisations. Les Allemagnes protestante et catholique appartiennent à la même civilisation. Néanmoins, Koneczny souligne que la religion est toujours l’élément le plus important d’une civilisation – plus important que la race. Il introduit en ce sens une typologie entre civilisation sacrales, non sacrales, semi-sacrales. Ce n’est pas l’aspect le plus convaincant de la théorie de Koneczny, ne serait-ce que parce qu’il existe plusieurs conceptions de la sacralité, et aussi des sacralités cachées (par exemple dans l’Occident, la religion du réchauffement climatique[3]).

Dans la notion de sacralité, Koneczny indique des éléments plus précis sur lesquels on peut s’accorder : le rapport au temps (vision linéaire du temps ou vision cyclique), le rapport entre droit public et droit privé (prédominance de l’un ou de l’autre, fusion ou séparation). Mais aussi les sources du droit : l’éthique ou la Loi (judaïsme). Enfin, l’existence ou non d’un sentiment national. En effet, selon Koneczny, appartenir à une civilisation est la condition de création d’une nation, même si toutes les civilisations ne donnent pas naissance à une nation. Ce n’est en tout cas pas l’Etat qui peut créer une nation, tout juste peut-il la conforter, ou la détruire si l’Etat est aux mains d’oligarques malfaisants (cf. le cas de la France).
* * *
Koneczny distingue 21 civilisations qui ont existé et 7 qui existent en son temps (les années 1930 et 1940). Dans sa typologie, fondée sur un certain type de conduite collective de la vie, le rapport au sol, au territoire n’est pas important. Une grande différence avec Spengler. La civilisation n’est pas non plus liée à la race comme on l’a vu plus haut. Ainsi, les Magyars sont devenus chrétiens bien que non Indo-européens (sans compter que bien des Indo-européens, comme les Afghans ou les Iraniens, sont musulmans). Koneczny souligne aussi que des peuples proches du point de vue ethnique, tels les Polonais et les Russes peuvent relever d’une civilisation différente (selon lui). De plus, au sein d’une même civilisation, il existe plusieurs cultures. Ainsi, la culture italienne au sein de la civilisation latine.
Précisément, comment Koneczny définit-il les civilisations qu’il dénombre ? La civilisation qu’il appelle « latine » est ce que l’on nomme usuellement la civilisation occidentale. Elle se caractérise par l’importance de la personne. Elle est aussi marquée par une culture de l’action, ce que Spengler appelait l’esprit faustien. Ce qui est original (et discutable) dans l’analyse de Koneczny, c’est de considérer que dans la civilisation latine, l’Etat est dissocié du sacré. Tout césaro-papisme est donc écarté. Toute intervention du temporel dans le spirituel au nom de ce que le pouvoir politique serait détenteur d’une sacralité au moins aussi importante que celle de l’Eglise est rejetée. C’est pour Koneczny une très bonne chose que le sacré soit écarté du politique. L’empire de Charlemagne[4] (800), puis le Saint Empire Romain germanique (962) – exactement le « Saint Empire romain de la Nation germanique » – sont donc exclus de la civilisation latine ainsi définie. Car ils prétendaient au sacré. Pas d’Empire sans sacralité. Et donc, pas de civilisation latine s’il y a un Empire. Nous sommes dans une vision de l’Europe proche de celle, très anti-germanique, d’Henri Massis (Défense de l’Occident, 1926). Comme le dit très bien Antoine Dresse, Koneczny est de ce point de vue plus « guelfe » que « gibelin ».
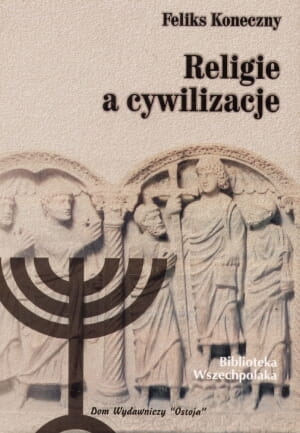 Autre civilisation : ce que Koneczny appelle la civilisation touranienne. Elle se caractérise par la non-reconnaissance de la personne humaine. Tout est dans l’Etat. Il n’y a pas de distinction droit public/droit privé. Le droit relève en fait du pur arbitraire d’un pouvoir despotique. Touranien : cela veut dire turco-mongol ou (plus largement) ouralo-altaïque. Pour Feliks Koneczny, la civilisation touranienne, c’est la Russie. Si la Rus’ (ou Rous) de Kiev était en partie latine, la Russie, héritière de la Moscovie, ne l’est quasiment plus, du fait de l’influence des invasions mongoles. La Russie a aussi cessé d’être byzantine et donc césaro-papiste. Elle n‘est plus que touranienne, c’est-à-dire spirituellement turco-mongole bien que sa population soit en grande partie slave. Décidément, la civilisation n’est pas la race. Et c’est la Turquie – cette Prusse du Proche-Orient – qui se retrouve un peu byzantine, en tout cas plus que la Russie, nous dit Koneczny. Il est d’ailleurs flagrant qu’à la chute de Constantinople en 1453, les Turcs musulmans aient essayé de s’approprier le prestige sacral de l’ancien Empire romain d’Orient.
Autre civilisation : ce que Koneczny appelle la civilisation touranienne. Elle se caractérise par la non-reconnaissance de la personne humaine. Tout est dans l’Etat. Il n’y a pas de distinction droit public/droit privé. Le droit relève en fait du pur arbitraire d’un pouvoir despotique. Touranien : cela veut dire turco-mongol ou (plus largement) ouralo-altaïque. Pour Feliks Koneczny, la civilisation touranienne, c’est la Russie. Si la Rus’ (ou Rous) de Kiev était en partie latine, la Russie, héritière de la Moscovie, ne l’est quasiment plus, du fait de l’influence des invasions mongoles. La Russie a aussi cessé d’être byzantine et donc césaro-papiste. Elle n‘est plus que touranienne, c’est-à-dire spirituellement turco-mongole bien que sa population soit en grande partie slave. Décidément, la civilisation n’est pas la race. Et c’est la Turquie – cette Prusse du Proche-Orient – qui se retrouve un peu byzantine, en tout cas plus que la Russie, nous dit Koneczny. Il est d’ailleurs flagrant qu’à la chute de Constantinople en 1453, les Turcs musulmans aient essayé de s’approprier le prestige sacral de l’ancien Empire romain d’Orient.
Ce que Korneczny appelle « civilisation byzantine » s’est incarné un temps dans l’Empire romain d’Orient, l’Empire « grec » (ou « gréco-oriental ») mais ne s’y identifie pas. Le byzantinisme comme forme d’organisation de la vie collective préexistait à cet Empire. C’est un Etat tout puissant et bureaucratique. C’est l’Etat qu’était devenu l’Empire romain décadent. Le modèle byzantin correspond à l’orientalisation de l’Empire romain. Le droit privé existe mais est limité. Le centralisme est la règle. Le pouvoir temporel (politique) prime sur le pouvoir spirituel. En fait, il l’incarne et fusionne avec lui. Dans ce modèle byzantin, le fédéralisme est impossible, nous dit Koneczny – qui aspire à un fédéralisme européen centré autour du modèle de la civilisation latine. L’Empire selon Koneczny est le contraire du fédéralisme (qu’il souhaite sous la forme des Etats-Unis d’Europe).
Nous rencontrons un lourd problème à propos de la civilisation byzantine : le modèle byzantin est, selon Koneczny, celui de l’Allemagne. « Byzantinisme allemand » : l’expression très critique, vient d’Edgar Quinet. Au contraire, Constantin Leontiev considérait que le byzantinisme était positif, permettait de juguler le féodalisme et de moderniser un pays[5]. Asiatiste et non pas slavophile, C. Leontiev voyait dans le modèle de Byzance une troisième voie, ni slavophile ni occidentaliste. Avec la conception du byzantinisme que développe Feliks Koneczny, l’Allemagne est vue comme contraire aux principes de la civilisation latine, c’est-à-dire occcidentale. Nous sommes à l’opposé de Spengler (et de C. Leontiev) qui voyait l’Empire carolingien puis le Saint-Empire romain germanique comme marquant la fondation de l’Europe, en enjambant les frontières de l’Empire romain, en associant l’ancienne Europe romaine et l’Europe centrale non romanisée.
Selon Koneczny, l’Europe byzantine, c’est-à-dire l’Europe germanique, est opposée à la civilisation latine et est inassimilable par sa volonté de faire prévaloir le pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. Hypothèse audacieuse, mais non totalement infondée : il est vrai qu’il y eut des liens entre Byzance et le Saint Empire. La princesse byzantine Theophania épousa (972) l’Empereur germanique Otton II. L’Empereur byzantin Manuel 1er Comnène épousa (1146) la princesse allemande Berthe de Sulzbach. Les liens matrimoniaux allaient de pair avec une alliance. Défendant sa thèse d’une Allemagne « byzantine », Koneczny rappelle que l’installation du protestantisme dans une grande partie de l’Allemagne renforce l’indépendance du pouvoir politique par rapport à tout pouvoir spirituel, donc papal. Ensuite, logiquement, la victoire de la Prusse sur l’Autriche (1866) marquerait la victoire en Allemagne du modèle byzantin sur le modèle latin. Point de vue qui reste surprenant compte tenu de ce que le Saint Empire a été longtemps tenu par la maison autrichienne des Habsbourg, catholique, et (moins longtemps) par les Wittelsbach de Bavière, eux aussi catholiques. N’ignorant nullement ces faits, Koneczny ne les pensait pas de nature à invalider sa théorie. Le Saint Empire n’était pour lui aucunement un relais du pouvoir papal mais une instance voulant s’y substituer.
Koneczny inclut dans sa typologie une civilisation juive. Cela peut étonner. 13 millions de juifs dans le monde et 7 millions en Israël, pour prendre les chiffres actuels, cela forme-t-il une civilisation ? Il ne s’agit pas d’une question de qualité mais parler de civilisation a-t-il un sens à une échelle aussi modeste ? Ne faut-il pas plutôt parler de culture ? Il existe une culture juive assurément, ou plutôt deux cultures, celle des Séfarades et celles des Ashkénazes, ces derniers étant dominants en Israël et pionniers de l’idée d’Israël. Selon Koneczny, l’essence du judaïsme est le messianisme. Il remarque que le marxisme (ajoutons : tel qu’il s’est fossilisé) est un décalque du messianisme juif. Il avance aussi la thèse comme quoi l’hitlérisme serait un judaïsme inversé (idée qui fut aussi celle de Maurras), les Allemands devenant le nouveau peuple élu. Cette idée, tout comme la première concernant le marxisme (entendons ici le marxisme-léniniste) comporte une part de vérité. Bertrand Russell, allergique à tous les messianismes, la reprendra d’une manière à la fois percutante et caustique. Il y a assurément une « eschatologie nazie » (Johann Chapoutot) de la fin des temps, croyant dans le triomphe final de l’Aryen, dont le Germain est la manifestation la plus éclatante.
Une part de vérité mais non toute la vérité.
Il faudrait nuancer cela par la prise en compte d’un élément très important dans l’hitlérisme : le darwinisme social. Il reste que regrouper sous le vocable « civilisation juive » tous les messianismes laisse perplexe. Les judaïsmes sionistes et non sionistes, le marxisme comme para-judaïsme athée et matérialiste, le contre-judaïsme d’Hitler dans la même catégorie ? Difficile d’être convaincu par cette catégorie. Mais aussi : qu’en est-il des aspects futuristes du communisme russe, du « cosmisme » soviétique ? Comment cela peut-il rentrer dans le schéma d’une « civilisation juive » de Koneczny ? Il est très aventureux de suivre le théoricien polonais sur ce terrain.
* * *
Ce qui est stimulant avec Koneczny est son opposition avec la théorie de Spengler. Le Polonais est loin de l’Allemand, et pourtant géographiquement si proche. Pour Spengler, les civilisations sont des organismes vivants qui connaissent une naissance, une jeunesse, une maturité, un vieillissement et la mort. Cette approche biologisante ne convainc pas Koneczny. Il pense qu’il faut s’interroger sur l’adéquation des civilisations à des lois de l’histoire sans guetter une « maturité » ou un « vieillissement » inéluctable. En sortant du calque trop facile de concepts biologiques pour voir ce qu’il en est réellement.
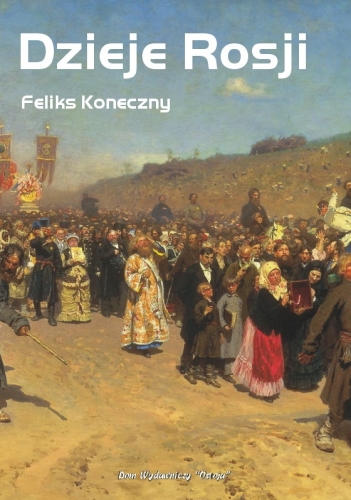
Pour ce faire, Feliks Koneczny établit six grandes « lois » de l’histoire.
1. La cohésion entre les valeurs. Le système de valeurs ne doit pas être contradictoire. Ainsi, une société libérale-libertaire ne peut être fondée sur des valeurs « traditionnelles » comme le goût du travail bien fait, la durabilité, etc.
2. L’acceptation de l’inégalité sociale. Les hommes n’ont pas des talents égaux. La justice n’est pas l’égalité. La volonté que personne ne vive dans la misère n’implique pas l’égalité. Pour que les pauvres vivent mieux, il n’est pas nécessaire ni souhaitable de supprimer les gens riches du fait de leurs talents.
3. Une civilisation doit se protéger contre l’immigration de masse venue d’autres civilisations. Elle se peut que perdre son identité à vouloir intégrer des populations dont la façon de vivre et de voir la vie est très différente.
4. Il faut être lucide sur l’impossibilité de faire coexister dans une civilisation des éléments issus de deux (ou plus) civilisations différentes. Un exemple historique est l’Empire d’Alexandre le Grand. Indépendamment de la mort précoce de l’élève d’Aristote, l’Empire gréco-perse qu’il avait fondé n’était pas viable compte tenu de son hétérogénéité culturelle, et malgré le fait que les peuples grecs et iraniens étaient tous deux indo-européens.
5. Les mélanges de civilisations sont tous conflictuels. Dans ces mélanges, il y a toujours un gagnant et un perdant, et au pire il y a deux perdants. Le mélange ne peut se faire qu’au profit du triomphe du relativisme, du consumérisme, voire du nihilisme.
6. Dans un mélange, c’est toujours l’élément inférieur qui domine (point très lié au point précédent). Il y a élément inférieur car Koneczny ne croit pas à l’égalité des civilisations (alors que Spengler pense qu’il est impossible de les hiérarchiser tant elles se placent sur des plans différents. C’est ce que l’on pourrait appeler un différentialisme absolu). Pour l’historien polonais, la médiocrité est plus facile que l’excellence, et si les deux sont côte à côte, la médiocrité, la bassesse l’emporteront. Pour prendre un exemple historique, il est plus facile d’être épurateur en 1944 que d’être résistant en 1942. Ce pourquoi les épurateurs étaient bien plus nombreux que les Résistants.
Tels sont les six lois de l’histoire des civilisations selon Koneczny.
La pérennité d’une civilisation, explique-t-il, implique que l’on soit conscient de la nécessité de lutter pour sa survie et même sa vitalité. Les civilisations sont en effet en lutte les unes contre les autres. Ne pas croire en soi, c’est laisser le champ libre à ceux qui croient en eux, à leur système de valeurs, à leur mode de vie, à leurs représentations du beau, du vrai et du bien.
* * *
On voit que bien des points de vue de Koneczny sont discutables, non pas tant dans les six points parfois un peu redondants mais pertinents qui caractérisent une civilisation, que dans sa typologie des sept civilisations. Et à propos de celles-ci, nous n’avons évoqué que celles relatives à l’Europe. Il faudrait la culture d’un René Grousset pour porter un jugement sur l’analyse par Koneczny des autres civilisations (Inde, Chine…).
Heureusement, le théoricien polonais de l’histoire ne prétendait pas que son système était à prendre ou à laisser. Son mérite est d’ouvrir sur des intuitions à coup sûr intéressantes. Ainsi, la guerre Russie-Ukraine, même si elle est avant tout une guerre Russie-OTAN, relève néanmoins aussi de la friction entre le monde « latin » (l’Ukraine occidentale) et le monde « touranien » russe, en tout cas l’univers impérial russe qui est autant une civilisation qu’une nation, voire d’abord une civilisation.
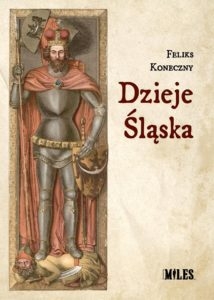 Enfin, l’immigration bouleverse l’identité européenne (Koneczny aurait dite « latine », ou « occidentale »), avec l’immigration arabo-musulmane, mais aussi indienne, touranienne-musulmane (Ouzbékistan et peuples turciques…), d’Indo-européens-musulmans (Pakistan, Afghanistan, …), et d’originaires d’Afrique noire, musulmans et chrétiens. Enfin, autre élément d’actualité de la théorie du méta-historien polonais, l’Union européenne technocratique – une « terreur sèche », peut-on dire en reprenant une expression d’Augustin Cochin – ne relève-t-elle pas ce que Koneczny appelait la « civilisation byzantine », c’est-à-dire un Etat inquisiteur, bureaucratique et prétendant exercer une fonction spirituelle ? Même si la spiritualité de l’UE consiste surtout à avoir des « gestes éco-citoyens », à trier ses ordures et à être ouvert à « l’accueil de l’Autre » : « Ouvert à l’ouverture », comme disait plaisamment Philippe Muray. Ainsi qu’à croire en la « religion réchauffiste », ce qui est à peu près le contraire de l’écologie intelligente telle qu’elle fut fondée par Ernst Haeckel. Autant dire que, plus de 70 ans après sa mort, mêmes les désaccords que l’on peut avoir avec Feliks Koneczny sont et seront – espérons qu’il soit mieux connu – sources de réflexions fécondes.
Enfin, l’immigration bouleverse l’identité européenne (Koneczny aurait dite « latine », ou « occidentale »), avec l’immigration arabo-musulmane, mais aussi indienne, touranienne-musulmane (Ouzbékistan et peuples turciques…), d’Indo-européens-musulmans (Pakistan, Afghanistan, …), et d’originaires d’Afrique noire, musulmans et chrétiens. Enfin, autre élément d’actualité de la théorie du méta-historien polonais, l’Union européenne technocratique – une « terreur sèche », peut-on dire en reprenant une expression d’Augustin Cochin – ne relève-t-elle pas ce que Koneczny appelait la « civilisation byzantine », c’est-à-dire un Etat inquisiteur, bureaucratique et prétendant exercer une fonction spirituelle ? Même si la spiritualité de l’UE consiste surtout à avoir des « gestes éco-citoyens », à trier ses ordures et à être ouvert à « l’accueil de l’Autre » : « Ouvert à l’ouverture », comme disait plaisamment Philippe Muray. Ainsi qu’à croire en la « religion réchauffiste », ce qui est à peu près le contraire de l’écologie intelligente telle qu’elle fut fondée par Ernst Haeckel. Autant dire que, plus de 70 ans après sa mort, mêmes les désaccords que l’on peut avoir avec Feliks Koneczny sont et seront – espérons qu’il soit mieux connu – sources de réflexions fécondes.
Pierre Le Vigan.
Antoine Dresse, La guerre des civilisations. Introduction à l’œuvre de Feliks Koneczny, La Nouvelle librairie/Institut Iliade, 2025, 104 p., 9 Euros.
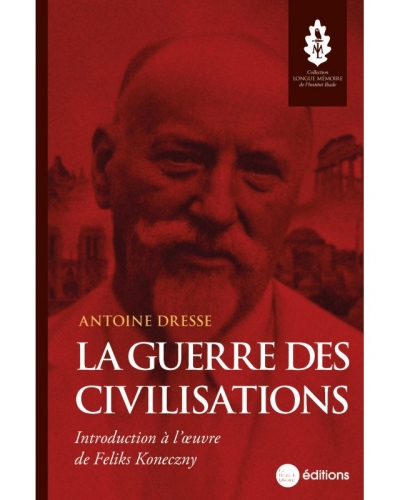
L’auteur de cet article a publié récemment (papier et numérique pour la barque d’or) :
Les démons de la déconstruction. Derrida, Levinas, Sartre, la barque d’or, 2024 (diffusion amazon)
Trop moche la ville. Comment nos villes sont devenues laides (et obèses), la barque d’or, 2025 (diffusion amazon)
Clausewitz, père de la théorie de la guerre moderne, Perspectives libres-Cercle Aristote, 2024.
Nietzsche, un Européen face au nihilisme, La barque d’or, 2024.
Notes:
[1] Herder était un critique « de gauche » des Lumières, contrairement à Joseph de Maistre qui le détestait. Herder héritier de Leibniz et de Rousseau, et perspectiviste comme le sera Nietzsche, développa l’idée d’une nécessaire diversité des peuples et des bienfaits de l’altérité. Herder était aussi parfaitement démocrate au sens où tout pouvoir doit être légitimé par le peuple, et hostile à tout suprématisme comme celui de la Grande Bretagne sur l’Irlande ou de l’Angleterre sur l’Ecosse.
[2] En 1850, les Juifs de Palestine ne représentent que quelque 3 % des 340 000 habitants, et leurs descendants sont une petite minorité de la population juive d’Israël. Ainsi, l’immense majorité des descendants des Hébreux de l’Antiquité sont les Arabes de Palestine, qu’ils soient musulmans ou chrétiens. Aux rares Hébreux restés juifs en Palestine se sont ajoutés, en Israël, les Séfarades, c’est-à-dire des descendants de Berbères convertis au judaïsme, et les Ashkénazes, descendants de Khazars turco-mongols, convertis au VIIIe siècle, mais aussi des descendants de Sémites de Mésopotamie et du monde gréco-romain, de Cananéens, sans oublier des Européens d’origine indo-européens judaïsés par exemple par le mariage, plus des juifs Mizrahim venus d’Afrique, Inde, Iran, Irak, etc.
[3] Ne serait-ce pas le seul problème écologique qui n’existe pas et qui permet d’occulter tous les autres, qui sont infiniment plus préoccupants ? Cela serait cohérent avec la logique du Capital qui cherche de nouvelles injonctions publiques sources de profits privés au nom d’une écologie falsifiée.
[4] Charles 1er était roi des Francs depuis 768 et roi des Lombards depuis 774. Napoléon Bonaparte se fera, avec un mimétisme significatif, Empereur des Français en 1804 et roi d’Italie en 1805. Pour résumer son projet, Napoléon disait : « Je suis Charlemagne ». Lire Jean-Claude Valla, La nostalgie de l’Empire, Librairie nationale, 2004.
[5] Lire Gregoire Quevreux, « Constantin Léontiev : l’homme le plus réactionnaire de l’empire russe », Philitt, 26 novembre 2020.
12:47 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie de l'histoire, feliks koneczny, pologne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


