
Présentation pressée de Paul Morand, l'anti-cosmopolite
Ex: http://dernieregerbe.hautetfort.com
En l’honneur de Paul Morand (1888-1976) dont on peut célébrer aujourd’hui le 125ème anniversaire, et qui ne fait pas son âge, je rassemble, sur une page connexe, une sélection de ses meilleurs aphorismes. Je me contenterai ici d'une simple présentation, rapide comme il se doit pour l'auteur de L'Homme pressé. [1]
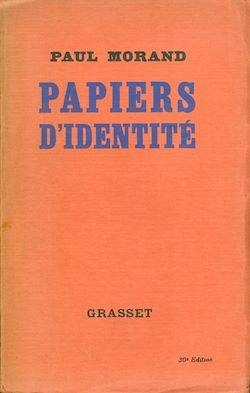 Morand n’est certes pas complètement sympathique : comme on le sait, son pacifisme et la faiblesse de son sens national l’ont amené à une attitude peu digne sous l’Occupation : diplomate en poste à Londres en juin 40, il se laisse ramener par sa femme en métropole (ce qui lui vaudra une mise à la retraite immédiate pour abandon de poste !). Ensuite, son principal fait d’armes consistera à profiter de son amitié avec Pierre Laval et Jean Jardin pour se faire nommer ambassadeur à Bucarest en 1943, dans le but à peine voilé d'y faire rapatrier les biens de sa femme, princesse Soutzo, avant que les Russes n’arrivent en Roumanie : difficile de trouver un exemple plus révoltant d’un haut-fonctionnaire qui, loin de servir l’État, met l’État à son service ! En juillet 1944, il se fait nommer ambassadeur à Berne : lâcheté de celui qui a senti que rien ne valait mieux que de s’installer en Suisse pour affronter la Libération, ou élégance de celui qui dédaigne de jouer la comédie du résistant de la onzième heure ? Dans un autre registre, on s’agace de lire, dans son Journal inutile, les jérémiades du nanti entouré de domestiques[2] qui redoute de voir réduit son train de vie, peste comme n’importe quel lecteur du Figaro contre l’excès des lois qui brident l’activité économique, et interprète chaque augmentation des impôts ou de l’inflation comme la preuve que le communisme sera là demain et la fin du monde après-demain[3]. Passons aussi sur sa sotte hostilité à de Gaulle, sur sa détestation aveugle et presque obsessionnelle de Gide, Cocteau et Malraux, sur ses réactions à l’actualité qui souvent ne dépassent pas le niveau du café du commerce[4], sur la complaisance qu’il met à s’impliquer dans les grenouillages de l’Académie, ou sur l’approximation constante des faits et des propos qu’il rapporte.
Morand n’est certes pas complètement sympathique : comme on le sait, son pacifisme et la faiblesse de son sens national l’ont amené à une attitude peu digne sous l’Occupation : diplomate en poste à Londres en juin 40, il se laisse ramener par sa femme en métropole (ce qui lui vaudra une mise à la retraite immédiate pour abandon de poste !). Ensuite, son principal fait d’armes consistera à profiter de son amitié avec Pierre Laval et Jean Jardin pour se faire nommer ambassadeur à Bucarest en 1943, dans le but à peine voilé d'y faire rapatrier les biens de sa femme, princesse Soutzo, avant que les Russes n’arrivent en Roumanie : difficile de trouver un exemple plus révoltant d’un haut-fonctionnaire qui, loin de servir l’État, met l’État à son service ! En juillet 1944, il se fait nommer ambassadeur à Berne : lâcheté de celui qui a senti que rien ne valait mieux que de s’installer en Suisse pour affronter la Libération, ou élégance de celui qui dédaigne de jouer la comédie du résistant de la onzième heure ? Dans un autre registre, on s’agace de lire, dans son Journal inutile, les jérémiades du nanti entouré de domestiques[2] qui redoute de voir réduit son train de vie, peste comme n’importe quel lecteur du Figaro contre l’excès des lois qui brident l’activité économique, et interprète chaque augmentation des impôts ou de l’inflation comme la preuve que le communisme sera là demain et la fin du monde après-demain[3]. Passons aussi sur sa sotte hostilité à de Gaulle, sur sa détestation aveugle et presque obsessionnelle de Gide, Cocteau et Malraux, sur ses réactions à l’actualité qui souvent ne dépassent pas le niveau du café du commerce[4], sur la complaisance qu’il met à s’impliquer dans les grenouillages de l’Académie, ou sur l’approximation constante des faits et des propos qu’il rapporte.

Il ne faut pas s’en tenir à celà, et du reste ce Journal est aussi plein de pensées saisissantes, comme on le verra dans les citations que j'ai rassemblées. Morand est un écrivain riche et complexe : on voit en lui un moderne par excellence, alors qu’il a été toute sa vie un vieux réac nostalgique ; un thuriféraire de la vitesse, mais il la critique et fait l’éloge de la lenteur[5] ; un voyageur compulsif[6], or il est très sensible à la vanité du voyage, et plus encore à sa dégradation par le tourisme ; un anglophile impénitent, pourtant il est surtout imprégné de Saint-Simon, Stendhal, Maupassant, Proust[7]. C’est avant tout un esthète pénétré d’une mentalité aristocratique, même si à vrai dire elle se dégrade souvent en snobisme de grand-bourgeois. Amoureux des diversités du monde, il est plus qu’un autre conscient que le voyage, dès lors qu’il n’est plus réservé à une élite minuscule, entraîne l’uniformisation généralisée, c’est-à-dire un appauvrissement maximal, et la multiplication du métissage, c’est-à-dire la laideur et la fadeur. Comme Pierre Loti ou Victor Segalen, c’est un exote, que le goût de l’ailleurs amène à condamner les nomades modernes, car à trop se rapprocher du lointain il devient le proche, à trop apprivoiser le différent il devient le semblable : si le goût de l’altérité n’est pas satisfait avec un précautionneux compte-goutte, mais à grandes rasades dévastatrices, il s’épuise et s’anéantit, car l’altérité s’est évaporée[8]. Le touriste occidental occidentalise tout ce qu’il va visiter : bientôt sa curiosité ne trouve plus rien d’extra-occidental à observer, – et en retour ce sont les étrangers qui bientôt viendront chez lui pour s’y sentir comme chez eux. Dès les années 20, Morand comprend avec une confondante prémonition qu’un raz-de-marée de métèques est appelé à envahir l’Europe : je publierai quelque jour ces pages étonnantes. Ainsi ce culte du voyage et de la fugacité dont il se sera fait le chantre, assumant la figure du voyageur de l’entre-deux-guerres jusqu’à la caricature, n’est pas tant pour lui une anticipation exaltée de l’avenir que l’ultime saisie d’un passé bientôt disparu : parmi ses influences et ses modèles majeurs, n’oublions pas Gobineau ! Il est dailleurs assez significatif qu’à partir de la deuxième guerre mondiale, l’œuvre de Morand se tourne principalement vers l’Histoire, faisant de plus en plus de place aux textes situés dans le passé, qu'il s'agisse de récits (Montociel, Le Flagellant de Séville, Parfaite de Saligny et bien d’autres nouvelles), de pièces (il en a fait trois : deux qui se passent à la fin du Moyen Âge, une au milieu du XIXe), ou d'essais biographiques (Fouquet, La Dame blanche des Habsbourg, Sophie-Dorothée de Celle, Monplaisir en histoire, etc) : manière de fuir par le temps, comme il l’avait fuie par l’espace, l’Europe décadente qui s’offrait à ses yeux.
__________________________
[1] Parmi les nombreux portraits de Paul Morand, je recommande celui du petit chef-d'œuvre de Pascal Jardin, La Guerre à neuf ans (Grasset, 1971), p. 110-119. Les informations factuelles de ce livre sont à prendre avec les plus grandes réserves (le père de l'auteur, Jean Jardin, en disait : « C'est le contraire d'un roman dont on dit que tout y est vrai sauf les noms: chez Pascal, seuls les noms sont vrais, tout le reste est faux ! », comme il l'a confié à François Périer ainsi qu'à François Nourissier : voir Pierre Assouline, Une éminence grise. Jean Jardin (1904-1976), Balland, 1986, Folio n°1921, p. 454, et comme Pascal Jardin l'a lui-même consigné dans Le Nain jaune, chap. VII, Julliard, 1978, p. 124), – mais l'atmosphère d'époque est assez bien restituée, et le mémorialiste excelle dans ses portraits. « Comme le héros de son roman L'Homme pressé, Morand est lui-même en proie à une fébrilité qui n'est pas dictée par le monde extérieur. Né pressé, il mourra pressé. Il a ce que Saint-Exupéry appelait "la nostalgie de là-bas". Persuadé que la vie se déroule derrière la ligne de l'horizon, il passe son existence à essayer de la rattraper. Quand il reste sur place, il a beau s'employer à vivre l'instant présent, cet instant-là se dérobe et coule entre ses doigts. Je l'ai vu bousculer les clients du bar de l'hôtel Plazza, houspiller les serveurs pour être servi plus vite et puis après, contempler son ouisqui avec regret. On le lui avait donné trop tard. Il n'avait plus soif. Avait-il eu vraiment soif ce jour-là ? » (p. 111). Et : « Le temps que j'essaie de lui répondre, il est déjà absent de lui-même ou sorti de la pièce. Il ne croit pas aux réponses, les questions lui suffisent. » (p. 112).
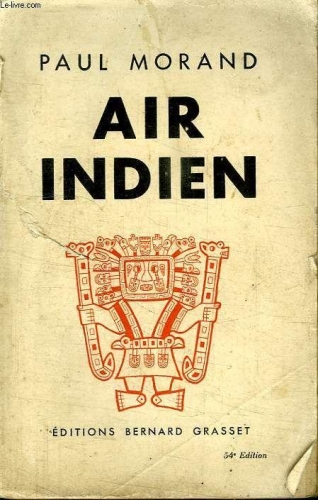 [2] Il n’hésite pas à mettre, au premier rang des facteurs qui ont « tué la famille », avant les ouiquennes et la télévision… l’absence de domestiques ! (Journal inutile, 4 mars 1972, tome 1 p. 672). Voilà qui en dit long sur la formidable étroitesse de son point-de-vue, qui n’imagine pas d’autre modèle à la famille que celle de la bonne bourgeoisie bien rentée. Que n’a-t-il plutôt pointé l’effondrement de la démographie, ce profiteur sans enfant ! Pascal Jardin, qui consacre une bonne part de son portrait de Morand à sa femme Hélène, écrit à propos de celle-ci : « Pour elle, la révolution russe de 1917 est un incident de parcours, par contre, la catastrophe, c'est 1914. Non pas parce que c'est le début d'une guerre qui va saigner la France à blanc, cette condottiere n'en a cure, mais la mobilisation générale, c'est la fin de la grande domesticité, la disparition d'une valetaille pléthorique happée par les champs de bataille gloutons. Oui, elle ne pardonnera jamais à ses gens d'avoir quitté leur livrée pour le bleu horizon. » (La Guerre à neuf ans, Grasset, 1971, p. 117).
[2] Il n’hésite pas à mettre, au premier rang des facteurs qui ont « tué la famille », avant les ouiquennes et la télévision… l’absence de domestiques ! (Journal inutile, 4 mars 1972, tome 1 p. 672). Voilà qui en dit long sur la formidable étroitesse de son point-de-vue, qui n’imagine pas d’autre modèle à la famille que celle de la bonne bourgeoisie bien rentée. Que n’a-t-il plutôt pointé l’effondrement de la démographie, ce profiteur sans enfant ! Pascal Jardin, qui consacre une bonne part de son portrait de Morand à sa femme Hélène, écrit à propos de celle-ci : « Pour elle, la révolution russe de 1917 est un incident de parcours, par contre, la catastrophe, c'est 1914. Non pas parce que c'est le début d'une guerre qui va saigner la France à blanc, cette condottiere n'en a cure, mais la mobilisation générale, c'est la fin de la grande domesticité, la disparition d'une valetaille pléthorique happée par les champs de bataille gloutons. Oui, elle ne pardonnera jamais à ses gens d'avoir quitté leur livrée pour le bleu horizon. » (La Guerre à neuf ans, Grasset, 1971, p. 117).
[3] Morand est littéralement hanté par sa terreur des Rouges, puisqu’il en fait des cauchemars la nuit : « Le capitalisme est mort : dans 10 ou 20 ans il n’existera plus. C’est la vision très nette que j’ai eue, cette nuit. Seul le travail. L’inflation non seulement l’aura détruit, mais aura tué l’épargne, sous toutes ses formes ; ce que l’État nous aura laissé, l’inflation l’aura confisqué. […] Ce n’est pas le communisme qui aura tué le capitalisme, mais le syndicalisme. Aux impôts nationaux est venu s’ajouter un impôt international, l’inflation. L’an 2000 aura vu disparaître le capitalisme. » (Journal inutile, 29 juillet 1974, tome 2 p. 298). Encore plus comique, une autre prophétie du 15 janvier 1975, annonçant que Giscard va être obligé d’ « étrangler » les riches : « Le fisc se jettera, grosse bête qu’il est, sur ce qui crève les yeux. Puis il raffinera. Ensuite, les œuvres d’art (les antiquaires, les salles des ventes où il va falloir donner son nom vont s’effondrer). Déjà, un château ne vaut plus rien. Ensuite, on ira vers le très petit, les bijoux, enfin, le fisc entrera dans les maisons, soulèvera les lames de parquet » (tome 2, p. 419). Il y a des dizaines de passages dans le même esprit, quoique plus laconiques.
[4] Par exemple, le 17 décembre 1969, il ne craint pas de consigner cette ânerie carabinée : « Le bruit court du retour de de Gaulle, pour remettre de l’ordre dans les rangs gaullistes. Que Pompidou sera débarqué » (tome 1, page 332).
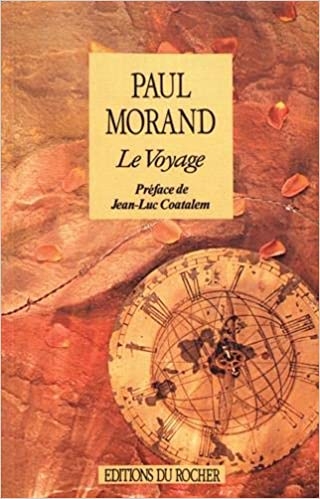 [5] Je pense à son petit essai « De la vitesse », paru en plaquette chez Simon Kra en 1929, repris dans Papiers d’identité (Grasset, 1931), et largement auto-plagié dans le chapitre conclusif d’Apprendre à se reposer sous le titre : « La vie intérieure, maîtresse de notre vrai repos ». Et est-il nécessaire de rappeler que son roman le plus fameux, L’Homme pressé (1941), est plutôt une satire qu’une apologie de la mobilité frénétique ?
[5] Je pense à son petit essai « De la vitesse », paru en plaquette chez Simon Kra en 1929, repris dans Papiers d’identité (Grasset, 1931), et largement auto-plagié dans le chapitre conclusif d’Apprendre à se reposer sous le titre : « La vie intérieure, maîtresse de notre vrai repos ». Et est-il nécessaire de rappeler que son roman le plus fameux, L’Homme pressé (1941), est plutôt une satire qu’une apologie de la mobilité frénétique ?
[6] Ce qui est évidemment très exagéré, comme il le reconnaît lui-même : « Depuis les années 30, j’ai raté, pour des raisons diverses, matérielles, familiales, sentimentales, etc, toutes les occasions de grands voyages. Et je passe pour un grand voyageur. Je suis un voyageur virtuel. » (Journal inutile, 19 février 1969, tome 1 p. 148).
[7] Il suffit de consulter l’index du Journal inutile qu’il a tenu dans les huit dernières années de sa vie pour constater que sa culture est terriblement franco-centrée. Très rares sont les écrivains étrangers qui ont droit à plus d’une dizaine d’occurrences. Je n’en vois que trois dont les numéros de page remplissent au moins trois lignes de l’index : Byron (19 occurrences), Goethe (24) et Shakespeare (25). À titre de comparaison, Balzac : 63 ; Chateaubriand : 61 ; Flaubert : 35 ; Hugo : 34 ; Montaigne : 31. Les contemporains de Morand en ont encore bien plus (jusqu’à 200 pour Proust).
[8] Lire par exemple « L’enfer des cosmopolites », chronique recueillie dans Rond-point des Champs-Élysées (1935), p. 21-23. Morand y distingue nettement, pour les opposer, le cosmopolitisme et l’internationalisme. Il explique que, confronté au feu croisé de ces deux ennemis que sont l’internationalisme et le nationalisme, le cosmopolite doit « sans hésiter » opter en faveur du second. Pour une raison particulière : la France est elle-même un « microcosme » d’une grande diversité, elle contient « cent civilisations et mille horizons » où le cosmopolite « peut, avec de l’imagination, se sentir à l’aise. S’il doit être dévoré, mieux vaut qu’il le soit à la sauce de la France, où la cuisine est bonne, qu’à la sauce internationale ». Et pour une raison générale (ici, Morand cite un Anglais de ses amis, « grand Européen » qu’il ne nomme pas), qui est que le nationalisme contribue à différencier les nations en les poussant à accomplir leur identité propre, donc à créer le terreau propice au cosmopolitisme de l’élite, alors que l’internationalisme nivelle tout et uniformise tout : « Un nationalisme éclairé doit être la seule base d’un cosmopolitisme éclairé. […] La vie internationale du peuple est un non-sens ; pour l’élite, elle doit être le sommet d’une pyramide de culture nationale. La vraie loyauté des clercs […] doit consister à extraire de leurs pays respectifs les éléments qui leur paraîtront apporter une contribution nationale à l’universel. Vous, Français, moi, Anglais, interprétons et classons les fleurs de nos apports nationaux. L’internationalisme n’a jamais donné que de mauvaises herbes. »





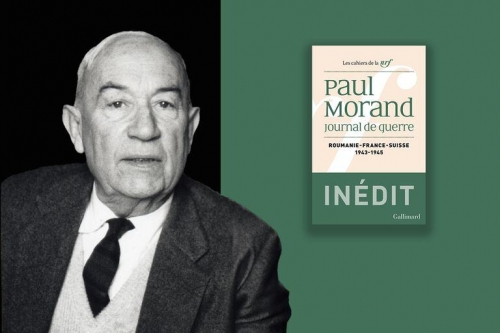

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
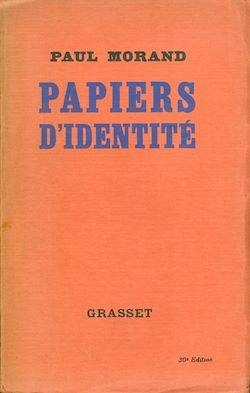 Morand n’est certes pas complètement sympathique : comme on le sait, son pacifisme et la faiblesse de son sens national l’ont amené à une attitude peu digne sous l’Occupation : diplomate en poste à Londres en juin 40, il se laisse ramener par sa femme en métropole (ce qui lui vaudra une mise à la retraite immédiate pour abandon de poste !). Ensuite, son principal fait d’armes consistera à profiter de son amitié avec Pierre Laval et Jean Jardin pour se faire nommer ambassadeur à Bucarest en 1943, dans le but à peine voilé d'y faire rapatrier les biens de sa femme, princesse Soutzo, avant que les Russes n’arrivent en Roumanie : difficile de trouver un exemple plus révoltant d’un haut-fonctionnaire qui, loin de servir l’État, met l’État à son service ! En juillet 1944, il se fait nommer ambassadeur à Berne : lâcheté de celui qui a senti que rien ne valait mieux que de s’installer en Suisse pour affronter la Libération, ou élégance de celui qui dédaigne de jouer la comédie du résistant de la onzième heure ? Dans un autre registre, on s’agace de lire, dans son Journal inutile, les jérémiades du nanti entouré de domestiques
Morand n’est certes pas complètement sympathique : comme on le sait, son pacifisme et la faiblesse de son sens national l’ont amené à une attitude peu digne sous l’Occupation : diplomate en poste à Londres en juin 40, il se laisse ramener par sa femme en métropole (ce qui lui vaudra une mise à la retraite immédiate pour abandon de poste !). Ensuite, son principal fait d’armes consistera à profiter de son amitié avec Pierre Laval et Jean Jardin pour se faire nommer ambassadeur à Bucarest en 1943, dans le but à peine voilé d'y faire rapatrier les biens de sa femme, princesse Soutzo, avant que les Russes n’arrivent en Roumanie : difficile de trouver un exemple plus révoltant d’un haut-fonctionnaire qui, loin de servir l’État, met l’État à son service ! En juillet 1944, il se fait nommer ambassadeur à Berne : lâcheté de celui qui a senti que rien ne valait mieux que de s’installer en Suisse pour affronter la Libération, ou élégance de celui qui dédaigne de jouer la comédie du résistant de la onzième heure ? Dans un autre registre, on s’agace de lire, dans son Journal inutile, les jérémiades du nanti entouré de domestiques
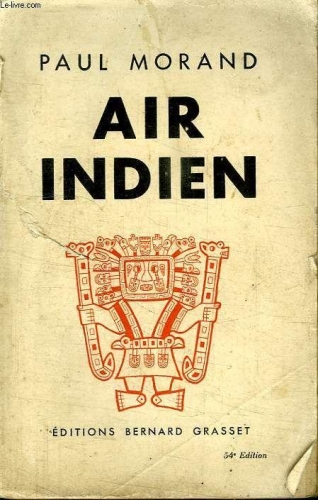 [2]
[2]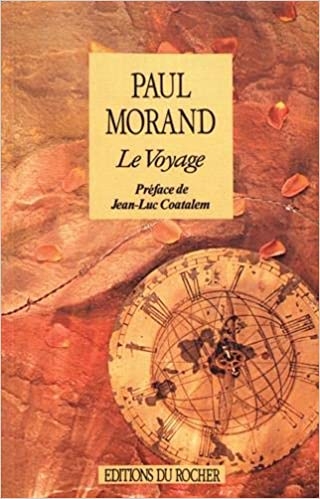 [5]
[5]
 Grâce à la campagne de presse orchestrée de main de maître par Nimier, c’est aussi, avec D’un château l’autre, le temps de la résurrection littéraire de Céline. Morand est désarçonné par les entretiens que Céline accorde à la presse, notamment à L’Express,
Grâce à la campagne de presse orchestrée de main de maître par Nimier, c’est aussi, avec D’un château l’autre, le temps de la résurrection littéraire de Céline. Morand est désarçonné par les entretiens que Céline accorde à la presse, notamment à L’Express,
