À propos de Boualem Sansal, 2084. La fin du monde (Gallimard, 2015).
2084 de Boualem Sansal est un assez beau roman parfois un peu trop didactique qui ne cache pas vraiment son intention : faire référence, de par son titre même, à 1984 bien sûr, de George Orwell, et évoquer les risques que nous fait courir la situation géopolitique actuelle, qui voit une explosion d'un Islam violent, guerrier, conquérant et apocalyptique, enté sur les techniques modernes de communication. Les déclarations récentes de l'auteur, qui affirme que la mondialisation est déjà intoxiquée par le virus d'un islam fanatique, servent de toile de fond journalistique à la promotion de son roman, comme c'est le jeu germanopratin, dans lequel tout le monde trouvera son compte et pour une fois, même le lecteur. Après Soumission de Michel Houellebecq, que les imbéciles prétendirent être un brûlot anti-islam alors qu'il était une charge contre le christianisme et la figuration de l'échec d'une conversion à ce dernier, il n'est pas très étonnant que le dernier roman de Boualem Sansal, auréolé d'un prestige de contestataire au sein même de son propre pays, l'Algérie, fasse bavarder et même écrire les journalistes. Ainsi ne tarissent-ils pas d'éloges sur ce livre, sans en dire grand-chose toutefois sinon, comme Marianne Payot pour L'Express, qu'il s'agit d'un roman total, ce qui ne nous avance guère sur la qualité dudit roman et est en partie faux. Il est amusant et désolant tout à la fois de constater que c'est sans doute parce que la rentrée dite littéraire est d'une navrante indigence et d'un cruel manque d'ambition, à quelques exceptions près que nous tenterons d'évoquer dans la Zone, que des journalistes peuvent se laisser aller à ce genre de facilités sémantiques, accolées à des romans qui sont bons, voire tout simplement honnêtes sans être remarquables, labyrinthiques ou même harmonieux dans leurs méandres. 2084 est l'un de ces romans réussis, mais cela ne suffit pas, du moins à mes yeux, à faire de lui l'illustration d'un roman total, qualificatif fourre-tout que nous pourrions par exemple réserver au Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki ou à l'univers imaginé par Tolkien dans ses différents textes, sans parler de la série de Franck Herbert prolongeant le chef-d’œuvre qu'est Dune.
Le genre romanesque auquel appartient 2084 est assez difficile à définir. Son sous-titre, La fin du monde, nous aiguillerait vers un classique récit d'anticipation, mais il faut remarquer que ce sous-titre est constamment infirmé par le développement même de l'histoire racontée par Boualem Sansal : aucune fin du monde dans son roman, et peut-être même, bien au contraire, une mystérieuse possibilité de victoire. Commençant sa lecture, étant frappé par une temporalité légendaire (cf. p. 183) qui semble dans le roman comme figée (1) ou qui s'écoule en tout cas avec une belle majesté, toute orientale, j'ai immédiatement pensé à des exemples tels que En attendant les barbares de J. M. Coetzee, Le désert des Tartares de Dino Buzzati, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq ou encore Sur les falaises de marbre d'Ernst Jünger. Boualem Sansal, comme ces écrivains, a inventé un univers cohérent avec ses coutumes, son organisation (cf. pp. 83, 85), son histoire (cf. p. 154), sa structure étatique planétaire, sorte d'immense Trantor poussiéreuse et sale, grouillante d'hommes, œcumenopole islamique tout entière gouvernée par Abi, délégué de Yölah sur une Terre ravagée par plusieurs conflits, y compris nucléaires. Nombre d'indices temporels visent ainsi à nous faire croire que l'Abistan est notre futur, ce qui, d'une certaine façon, est sans doute vrai, mais point tout à fait juste dans l'économie littéraire proprement dite de 2084.
En effet, c'est presque à la fin du roman, à la page 260, que l'un des personnages, donnant un cours d'histoire (voire de préhistoire islamique !) au naïf Ati, affirme, à propos d'une langue ancienne ayant été supplantée par l'abilang : «Comme elle inclinait à la poésie et à la rhétorique, elle a été effacée de l'Abistan, on lui a préféré l'abilang, il force au devoir et à la stricte obéissance. Sa conception s'inspire de la novlangue de l'Angsoc. Lorsque nous occupâmes ce pays, nos dirigeants de l'époque ont découvert que son extraordinaire système politique reposait non pas seulement sur les armes mais sur la puissance phénoménale de sa langue, la novlangue, une langue inventée en laboratoire qui avait le pouvoir d'annihiler chez le locuteur la volonté et la curiosité» (2). Nous apprenons que les chefs historiques de l'Abistan ont ajouté trois principes à ceux qui fondaient le «système politique de l'Angsoc», que je rappelle : La guerre c'est la paix, La liberté c'est l'esclavage, L'ignorance c'est la force, à savoir, donc : La mort c'est la vie, Le mensonge c'est la vérité et La logique c'est l'absurde.
2084 est donc un texte d'un genre particulier, une sorte d'uchronie (3) qui aurait pour ancêtre déclaré un autre texte uchronique, ô combien célèbre, d'ailleurs directement mentionné dans notre roman, et par deux références transparentes et ironiques (cf. pp. 32 et 42) ! Cet effet est du reste intéressant, car il permet à l'auteur de porter sa critique au sein même du monde occidental, décrit comme étant contrôlé par le novlangue, l'arme finalement la plus destructrice qui sera sortie de son imagination.

C'est d'ailleurs cette thématique d'une langue viciée, réduite à sa plus fonctionnelle pauvreté à des fins de contrôle politique, sorte de grammaire de la soumission par opposition à la grammaire de l'assentiment du grand John Henry Newman, qui me semble constituer l'aspect le plus intéressant du roman de Boualem Sansal. Comme le novlangue, l'abistan, que l'auteur écrit toujours en italiques, veut faire table rase du passé, car «il fallait tout renommer, tout réécrire, de sorte que la vie nouvelle ne soit d'aucune manière entachée par l'Histoire passée désormais caduque, effacée comme n'ayant jamais existé» (p. 22) et encore : «Pour les générations de la Nouvelle Ère, les dates, le calendrier, l'Histoire n'avaient pas d'importance, pas plus que l'empreinte du vent dans le ciel, le présent est éternel, aujourd'hui est toujours là» (p. 23), et c'est effectivement un temps figé que, je l'ai dit, évoque l'écrivain d'assez belle façon.
L'éradication du passé n'est point chose aisée, et le recours à une langue strictement mécanique, fonctionnelle, fonctionnarisée peut aider et accélérer le processus de décérébration, d'appauvrissement de la mémoire : comment une chose existerait-elle si aucun mot ne la nomme et ne lui donne consistance et être ? : «Sans témoins pour la raconter, l'Histoire n'existe pas», car il n'y a finalement personne pour «amorcer le récit pour que d'autres le terminent» (p. 26). Il est pour le moins étrange que, dans ce cas, aucun témoin n'existe de ce qu'aura découvert Ati, une fois qu'il aura constitué la pièce essentielle d'une diabolique machination comparable à «une pièce d'horlogerie capable de donner à chacun l'heure exacte de sa mort» (p. 228).
Si la langue s'appauvrit au cours des années, elle finira par ne plus rien nommer, comme le novlangue, et ce sera alors la mort, la prostration, une immense Machine qui continuera à ourdir ses trames sans le moindre repos ou faiblesse («L'Appareil allait parfois trop loin dans la manip, il faisait n'importe quoi, jusqu'à s'inventer de faux ennemis qu'il s'épuisait ensuite à dénicher pour, au bout du compte, éliminer ses propres amis», p. 28), fantôme d'acier survivant, mais pour quel but ?, dans un univers désolé, immobile, mort : «Révolte contre quoi, contre qui, [Ati] ne pouvait l'imaginer; dans un monde immobile, il n'y a pas de compréhension possible, on ne sait que si on entre en révolte, contre soi-même, contre l'empire, contre Dieu, et de cela personne n'était capable, mais aussi comment bouger dans un monde figé ?» (p. 38).
Se déplacer, bouger. Ce sera le sens de la révolte d'Ati que de parvenir à retisser la chaîne d'or qui le relie au passé, afin de comprendre que l'Abistan n'a pas existé de toute éternité et qu'une frontière, la Frontière même qu'il s'agit de trouver (et qu'Ati, peut-être, a trouvée, comme nous le suggèrent les toutes dernières lignes du roman) relie le monde immobile de l'Abistan englué dans un appareil étatique surpuissant à la possibilité d'une île, d'un îlot de pureté houellebecquien ou même dickien, bien que la vérité jamais n'éclate dans les romans de Dick : «Il n'empêche, ce que l'un a vu, entrevu, rêvé seulement, un autre, plus tard, ailleurs, le verra, l'entreverra, le pensera, et peut-être celui-là réussira-t-il à le tirer à la lumière de manière que chacun le voie et entre en révolte contre le mort qui le squatte» (p. 41). Ce verbe appartient à un registre de langue assez peu soutenu, qui surprend dans un texte à l'écriture fluide, et ce n'est pas la seule maladresse de Boualem Sansal, qui ose même l'improbable et très laide expression «Tout était visible de chez prévisible», p. 250).
Il s'agit bel et bien de dissiper les apparences, comme chez Dick, et de trouver la vérité : de s'extraire de cette dialectique infernale «où la soumission et la révolte sont dans un rapport amoureux» (p. 51), car c'est bien de «l'autre côté [que] nous verrons ce [que les frontières] interdisaient au moyen d'une si longue et si parfaite machination et nous saurons, avec effroi ou bonheur, qui nous sommes et quel monde était le nôtre» (p. 59).
Si le novlangue est une langue réduite à son épure ectoplasmique, l'abilang est «la langue sacrée enseignée par Yölah à Abi afin d'unir les croyants dans une nation, les autres langues, fruits de la contingence, éta[nt] oiseuses», qui «séparaient les hommes, les enfermaient dans le particulier, corrompaient leur âme par l'invention et la menterie» (p. 64). La langue unique serait un cauchemar, comme le supposait ainsi un commentateur évoquant le mythe de la tour de Babel, chance pour l'humanité et non plus catastrophe à ses yeux, selon l'interprétation classique : «On rappelle néanmoins, par le fait que le nom propre de Babel semble en apparence «motivé», ce que pouvait être la langue une qu’on a fuie – l’infernal cauchemar d’une langue totalement motivée, sans noms propres, sans identité possible, donc» (4).
Ati est aussi naïf je l'ai dit que son créateur, lui, est renseigné, un peu trop même, car les prises de position de Boualem Sansal ne sont pas franchement discrètes, ni peu nombreuses (5), alors que la critique de l'Abistan est à nos yeux infiniment plus fine lorsqu'elle est diffractée par la seule mention des caractéristiques et du rôle de l'abilang, langue sacrée et non langue mécanicisée, du moins à en croire ses thuriféraires : «Chacun par son chemin était arrivé à l'idée que l'abilang n'était pas une langue de communication comme les autres puisque les mots qui connectaient les gens passaient par le module de la religion, qui les vidait de leur sens intrinsèque et les chargeait d'un message infiniment bouleversant, la parole de Yölah, et qu'en cela elle était une réserve d'énergie colossale qui émettait des flux ioniques de portée cosmique, agissant sur les univers et les mondes mais aussi sur les cellules, les gènes et les molécules de l'individu, qu'ils transformaient et polarisaient selon le schéma originel» (p. 94).
 C'est sans doute la plus grande originalité de Boualem Sansal que d'avoir imaginé une espèce de novlangue irrigué par le sacré, à la différence du langage vicié, étique, détaillé par George Orwell : «Ati et Koa croyaient à ceci, qu'en transmettant la religion à l'homme la langue sacrée le changeait fondamentalement, pas seulement dans ses idées, ses goûts et ses petites habitudes mais dans son corps en entier, son regard et sa façon de respirer, afin que l'humain qui était en lui disparaisse et que le croyant né de sa ruine se fonde corps et âme dans la nouvelle communauté» (p. 95). Ainsi l'abilang ne poursuit-il qu'un seul but, qui est de destruction : «Elle ne parlait pas à l'esprit, elle le désintégrait, et de ce qu'il restait (un précipité visqueux) elle faisait de bons croyants amorphes ou d'absurdes homoncules» (p. 96).
C'est sans doute la plus grande originalité de Boualem Sansal que d'avoir imaginé une espèce de novlangue irrigué par le sacré, à la différence du langage vicié, étique, détaillé par George Orwell : «Ati et Koa croyaient à ceci, qu'en transmettant la religion à l'homme la langue sacrée le changeait fondamentalement, pas seulement dans ses idées, ses goûts et ses petites habitudes mais dans son corps en entier, son regard et sa façon de respirer, afin que l'humain qui était en lui disparaisse et que le croyant né de sa ruine se fonde corps et âme dans la nouvelle communauté» (p. 95). Ainsi l'abilang ne poursuit-il qu'un seul but, qui est de destruction : «Elle ne parlait pas à l'esprit, elle le désintégrait, et de ce qu'il restait (un précipité visqueux) elle faisait de bons croyants amorphes ou d'absurdes homoncules» (p. 96).
Langue sacrée, il est remarquable, et peut-être même assez paradoxal si l'on considère que l'essence même du sacré vise un dépassement, une ouverture, une transcendance, que l'abilang fonctionne en respectant les mêmes principes, de réduction, que le novlangue, comme l'explique Boualem Sansal : «Si d'aucun avaient pensé qu'avec le temps et le mûrissement des civilisations les langues s'allongeraient, gagneraient en signification et en syllabes, voilà tout le contraire : elles avaient raccourci, rapetissé, s'étaient réduites à des collections d'onomatopées et d'exclamations, au demeurant peu fournies, qui sonnaient comme cris et râles primitifs, ce qui ne permettait aucunement de développer des pensées complexes et d'accéder par ce chemin à des univers supérieurs» (p. 103).
En outre, l'un et l'autre de ces deux langages totalitaires sont fondés sur l'imposture selon laquelle l'Empire, l'Appareil ne peut qu'être toujours en guerre, et d'abord, donc, contre toute forme de conscience individuelle (cf. p. 194) : «Pour que les gens croient et s'accrochent désespérément à leur foi, il faut la guerre, une vraie guerre, qui fait des morts en nombre et qui ne cesse jamais, et un ennemi qu'on ne voit pas ou qu'on voit partout sans le voir nulle part» (p. 105), mais aussi, nous l'avons vu, contre le passé : «Depuis la formation de l'Abistan, les noms de lieux, de gens et de choses des époques antérieures ont été bannis, de même que les langues, les traditions et le reste, c'est la loi» (p. 127).
Il s'agit, par le truchement d'une langue sacrée bien que réduite et même militaire (cf. p. 204) et dont le processus de formation et de fonctionnement nous est détaillé (cf. p. 238), de provoquer un état de soumission, l'un des mots les plus répétés par Boualem Sansal (cf. pp. 156, 161 (6)) qui ne l'aime visiblement pas, état de soumission qui sera brisé par le retour du refoulé dirait quelque lecteur freudien, à savoir le passé honni, annihilé matérialisé sous les yeux d'Ati par la découverte, stupéfiante, d'objets, de bibelots, et même de livres comme dans 1984 et, bien sûr, des mots correspondant à ces réalités pieusement conservées par le puissant Toz (cf. p. 166) au rôle trouble.
Dès lors, se mettre en mouvement du sanatorium de Sîn jusqu'à Qodsabad l'immense, la Cité de Dieu et le siège de l'Abigouv, est pour Ati accomplir une quête qui sera symbolisée et résumée par son déplacement tout au long de l'étrange musée de Toz, qui résume une vie humaine, de l'enfance jusqu'à la mort, l'entrée et la sortie du musée matérialisant, par le vide du décor, ce qui précède et suit notre existence, le vide. C'est aussi se mettre en branle contre «la soumission à l'ignorance sanctifiée comme réponse à la violence intrinsèque du vide, et, poussant la servitude jusqu'à la négation de soi, l'autodestruction pure et simple» (p. 247). C'est en somme oser un acte véritablement réactionnaire, en réaction contre l'immobilisme dans lequel les habitants de l'Abistan sont enfermés, sans doute à jamais selon l'auteur : «L'air de rien, il s'ouvrit un chemin interdit et s'y engagea à fond. Il n'y en avait qu'un en vérité, celui qui remontait le temps» (p. 248).
Nous ne savons pas quel est le sort d'Ati car, une fois encore, l'écriture de Boualem Sansal s'enfonce dans une temporalité mythique et, pourquoi pas même, dans le fantastique, le personnage disparaissant purement et simplement aux yeux des Abistanais, peut-être parce qu'il a enfin réussi à traverser cette Frontière derrière laquelle, comme dans le village découvert par l'archéologue Nas et qui aura déclenché la trame complexe de l'intrigue, des hommes ont réussi à vivre dans «une communauté qui avait expérimenté là une façon de vivre et de s'administrer réglée sur le libre arbitre de chacun» (p. 253), unique refuge, dernière île peut-être «qui échappe encore à la juridiction de l'Abistan» (p. 256), comme si l'un des personnages de Philip K. Dick ou même de Michel Houellebecq était parvenu à découvrir la Vérité et s'extirper ainsi de l'hypnose provoqué par le Gkabul (cf. p. 248), le seul texte sacré ayant droit de cité, pour se transporter au-delà des faux univers tournant sans fin dans le vide comme une noria de mots perclus, soumis, morts. Mais ce n'est peut-être là qu'un nouveau leurre, et, après tout, seul Ati a réussi à s'échapper, tant Boualem Sansal est pessimiste, et ne semble absolument pas croire à la possibilité qu'un ferment de liberté se lève et grossisse au sein même de l'Abistan, notre futur selon ses dires.
Notes
(1) «Les caravaniers attendaient des ordres qui ne venaient pas, les camions attendaient des pièces de rechange introuvables, les trains attendaient que la voie soit rétablie et la loco ranimée. Et quand tout était fin prêt, se posait la question des machinistes et des guides, il fallait rapidement se lancer à leur recherche puis patienter» (p. 66).
(2) Notons que c'est par erreur qu'il est écrit la novlangue, alors que le texte de George Orwell, dans sa traduction française, donne le. Faut-il demander aux relecteurs de Gallimard de connaître, a minima, des textes qui ont été édités par la maison qui les embauche ?
(3) Sorte d'uchronie ou bien uchronie impure, car, comme je l'ai dit, le roman de Boualem Sansal s'efforce, par de nombreux détails, d'inscrire l'histoire d'Ati traversant l'Abistan dans notre propre futur, comme par exemple en évoquant un «antique, prestigieux et gigantesque musée appelé Louvre ou Loufre, qui avait été saccagé et rasé lors de la première Grande Guerre sainte et l'annexion par l'Abistan de la Lig, les Hautes Régions Unies du Nord» (p. 240). La page 250 comporte, ainsi, une chronologie des événements antérieurs à la fondation de l'Abistan. Il ne peut s'agir en revanche, au sens strict du terme, d'une utopie, puisque c'est bien de la Terre qu'il s'agit, une fois qu'elle a été ravagée par «la Grande Guerre sainte» appelée «le Char» (p. 20).
(4) Pierre Bouretz, Marc de Launay, Jean-Louis Schefer, La tour de Babel (Desclée de Brouwer, 2003), p. 128.
(5) «C'est son regard qui attira celui d'Ati, c'était le regard d'un homme qui, comme lui, avait fait la perturbante découverte que la religion peut se bâtir sur le contraire de la vérité et devenir de ce fait la gardienne du mensonge originel» (p. 74). D'autres exemples pourraient être cités, comme lorsque par exemple l'auteur évoque «l'écrasement de l'homme par la religion» et exalte la révolte (cf. p. 81).
(6) «Voilà un temps immémorial que l'esprit de jugement et de révolte a disparu de la terre, il a été éradiqué, ne reste flottant au-dessus des marécages que l'âme pourrie de la soumission et de l'intrigue...» (p. 193). Notons encore qu'«acceptation, Gkabul en abilang, était d'ailleurs le nom de la sainte religion de l'Abistan» (pp. 42-3).
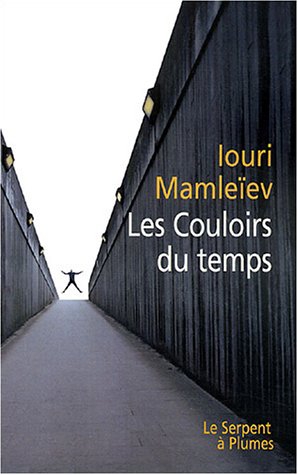 Né en Russie en décembre 1931, Youri Mamleev aura eu le parcours, quasi anonyme et pourtant, intérieurement flamboyant, des ses héros.
Né en Russie en décembre 1931, Youri Mamleev aura eu le parcours, quasi anonyme et pourtant, intérieurement flamboyant, des ses héros.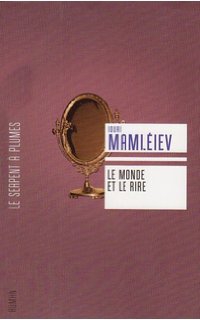 Publiant dès 1956 Youri Mamleev ne tarde pas à heurter les autorités soviétiques par une prose qui, si elle se veut réaliste, propose toute autre chose que celle dite socialiste. Le réalisme littéraire de Mamleev se veut métaphysique. Son dernier ouvrage traduit et publié en France, Destin de l’être, est en définitive moins la base de sa fusée théorique que son lanceur. Ces pages renferment tout ce qui humainement et théoriquement anima toujours l’art littéraire de Mamleev :
Publiant dès 1956 Youri Mamleev ne tarde pas à heurter les autorités soviétiques par une prose qui, si elle se veut réaliste, propose toute autre chose que celle dite socialiste. Le réalisme littéraire de Mamleev se veut métaphysique. Son dernier ouvrage traduit et publié en France, Destin de l’être, est en définitive moins la base de sa fusée théorique que son lanceur. Ces pages renferment tout ce qui humainement et théoriquement anima toujours l’art littéraire de Mamleev :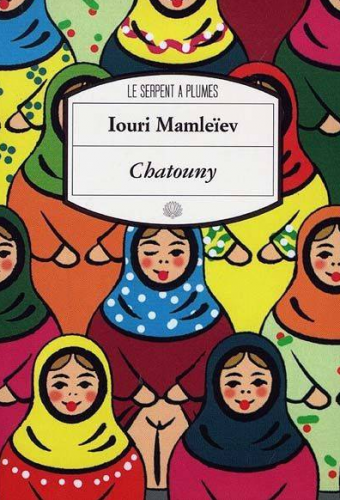 Quant à l’ambiance générale qui se dégage de Le Monde et le rire, elle n’est pas moins fantasque et lugubre. C’est le monde surnaturel lui-même qui y perd la tête. Et au cours de l’enquête surréaliste que nous fait suivre l’auteur nous croisons différents personnages psychiquement perturbés, fort différents du psychisme lambda en tout cas. Les personnages de cette galerie de portraits sont d’ailleurs regroupés génériquement et significativement sous le terme de « chamboulés ». Ici, le parallèle le plus signifiant avec la littérature russe antérieure serait sûrement le groupe de personnages évoqué par Pilniak dans son récit L’Acajou. Pilniak avait nommé cette troupe hétéroclite de clochards volontaires, de quasi fols mystiques, « okhlomon » (« emburelucoqués » dans la belle traduction française de Jacques Catteau).
Quant à l’ambiance générale qui se dégage de Le Monde et le rire, elle n’est pas moins fantasque et lugubre. C’est le monde surnaturel lui-même qui y perd la tête. Et au cours de l’enquête surréaliste que nous fait suivre l’auteur nous croisons différents personnages psychiquement perturbés, fort différents du psychisme lambda en tout cas. Les personnages de cette galerie de portraits sont d’ailleurs regroupés génériquement et significativement sous le terme de « chamboulés ». Ici, le parallèle le plus signifiant avec la littérature russe antérieure serait sûrement le groupe de personnages évoqué par Pilniak dans son récit L’Acajou. Pilniak avait nommé cette troupe hétéroclite de clochards volontaires, de quasi fols mystiques, « okhlomon » (« emburelucoqués » dans la belle traduction française de Jacques Catteau).




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
 Brèche bien plutôt qui permet un contact illuminant avec des énergies spirituelles invisibles et, parfois, inquiétantes. Mamleev prend à bras le corps l’énergie contenue dans le langage, avec l’énergie métaphysique que le langage contient, notamment dans sous sa forme de barrière protégeant d’un cataclysme ! D’un cataclysme d’autant plus terrible qu’il n’aurait rien de ces catastrophes naturelles car il est non rationalisable étant ancré dans une autre dimension !
Brèche bien plutôt qui permet un contact illuminant avec des énergies spirituelles invisibles et, parfois, inquiétantes. Mamleev prend à bras le corps l’énergie contenue dans le langage, avec l’énergie métaphysique que le langage contient, notamment dans sous sa forme de barrière protégeant d’un cataclysme ! D’un cataclysme d’autant plus terrible qu’il n’aurait rien de ces catastrophes naturelles car il est non rationalisable étant ancré dans une autre dimension !



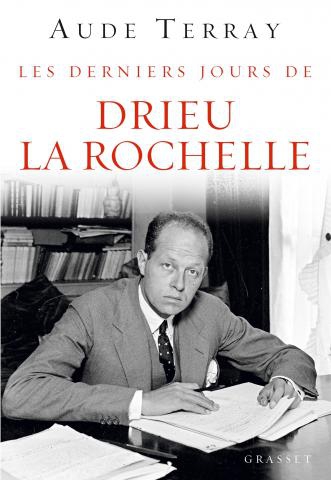 Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.
Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.


 C'est sans doute la plus grande originalité de Boualem Sansal que d'avoir imaginé une espèce de novlangue irrigué par le sacré, à la différence du langage vicié, étique, détaillé par George Orwell : «Ati et Koa croyaient à ceci, qu'en transmettant la religion à l'homme la langue sacrée le changeait fondamentalement, pas seulement dans ses idées, ses goûts et ses petites habitudes mais dans son corps en entier, son regard et sa façon de respirer, afin que l'humain qui était en lui disparaisse et que le croyant né de sa ruine se fonde corps et âme dans la nouvelle communauté» (p. 95). Ainsi l'abilang ne poursuit-il qu'un seul but, qui est de destruction : «Elle ne parlait pas à l'esprit, elle le désintégrait, et de ce qu'il restait (un précipité visqueux) elle faisait de bons croyants amorphes ou d'absurdes homoncules» (p. 96).
C'est sans doute la plus grande originalité de Boualem Sansal que d'avoir imaginé une espèce de novlangue irrigué par le sacré, à la différence du langage vicié, étique, détaillé par George Orwell : «Ati et Koa croyaient à ceci, qu'en transmettant la religion à l'homme la langue sacrée le changeait fondamentalement, pas seulement dans ses idées, ses goûts et ses petites habitudes mais dans son corps en entier, son regard et sa façon de respirer, afin que l'humain qui était en lui disparaisse et que le croyant né de sa ruine se fonde corps et âme dans la nouvelle communauté» (p. 95). Ainsi l'abilang ne poursuit-il qu'un seul but, qui est de destruction : «Elle ne parlait pas à l'esprit, elle le désintégrait, et de ce qu'il restait (un précipité visqueux) elle faisait de bons croyants amorphes ou d'absurdes homoncules» (p. 96).