vendredi, 19 octobre 2007
Extraits de l'autobiographie d'A. Mohler
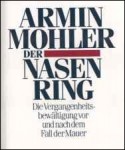
Extraits de l'autobiographie d'Armin Mohler
Pour expliquer ses positions critiques à l'égard de l'historiographie de la République Fédérale, Armin Mohler dans son ouvrage Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung (Heitz und Höffkes, Essen, 1989), évoque quelques péripéties de sa jeunesse. Pour fêter ses 80 ans, nous en donnons une toute première version française à nos lecteurs. Pour les anciens abonnés à Vouloir, cf. Willy Pieters, «Les Allemands, leur histoire et leurs névroses», n°40/42, 1987.
Mes années d'étude: Marx, Freud & Cie
Rétrospectivement, je ne regrette pas la ligne en zigzag qu'a pris mon cheminement à cette époque-là. Elle m'a permis des expériences qui m'ont préservé ultérieurement de tout encroûtement. Pendant quelque temps, je me suis défendu contre cette vision (fort juste) que la vie est faite de paradoxes. Pendant de nombreuses années, j'ai tenté de voiler, de refouler, cette vision pertinente du paradoxal de l'existence qui s'installait pourtant lentement dans mes idées, mes sentiments et mes représentations. Je me suis soumis à une doctrine sotériologique et universaliste qui promettait de liquider tous les paradoxes et de révéler le sens du Tout. Ce fut une expérience qui, au moins, me préserva de fabriquer une autre doctrine sotériologique après m'être débarrassé d'une première.
Cette expérience a commencé quand j'avais seize ou dix-sept ans. Je voulais articuler ma révolte contre l'environnement petit-bourgeois d'une façon “originale”, c'est-à-dire de “gauche”. Ce n'était pas si facile au milieu des années 30. La Suisse était déjà sur la voie de la “démocratie du consensus” (ou plus précisément: la démocratie des cartels). L'époque où la troupe avait tiré sur les ouvriers était passée, cela faisait au moins vingt ans. La couche de la population vivant dans le besoin s'amenuisait et se réduisait graduellement, pour rester confinée aux paysans des montagnes, dans les lointaines vallées alpines. Les associations et les cartels des employeurs et des travailleurs avaient décidé de se partager pacifiquement le gâteau. Sur le plan physionomique, les bosses d'un camp comme de l'autre ne se distinguaient quasiment plus. Dans une telle situation, un marxisme radical serait mort de ridicule, car chaque besoin de la classe ouvrière était satisfait par la création d'une nouvelle association. Un anarchisme radical aurait tourné à vide dans un pays, où, certes, chaque autochtone ressent un malaise, mais où aucun d'eux n'est vraiment opprimé. Personne ne pose des bombes contre soi-même.
S'introduire dans le monde des artistes
Parmi les mésaventures grotesques de mon existence: le fait que cette situation sociale, qui m'a fait fuir la Suisse, me rattrape dans ma nouvelle patrie d'adoption, l'Allemagne de l'Ouest. Des amis allemands, qui se moquent de moi, me posent malicieusement la question: «pensez-vous que certains signes permettent de dire qu'il y a “helvétisation” de la République Fédérale?». Je pense alors que peu avant la seconde guerre mondiale, seule une gauche intellectuelle avait ses chances dans ma patrie suisse. Or cette chance était limitée à un domaine vraiment réduit: la caste des intellectuels, des littérateurs, des artistes avec leurs mécènes issus des classes aisées de la société. C'est justement dans cette caste que je voulais m'introduire: elle me semblait être la porte ouverte sur le vaste monde. En 1938, je m'inscris donc à l'université de Bâle; branche principale: histoire de l'art; branches secondaires: philologie germanique et philosophie.
Juste avant cette inscription, j'avais pénétré dans un nouveau cercle de personnalités, celui des émigrés du Troisième Reich, composés surtout de nombreux Juifs. Les familles juives bien établies à Bâle n'étaient pas trop ravies de cet apport nouveau. Moi personnellement, je me passionnais pour ces Juifs non assimilés. Ils nous apportaient de Berlin un petit reflet des Roaring Twenties, de Prague l'air qu'avait respiré Kafka, de Vienne un zeste de la décadence la plus fascinante de l'histoire récente. Avec les émigrés non juifs, ils prétendaient être “la meilleure Allemagne”. Mais ce furent également des émigrés juifs qui m'ont apporté les premiers éléments philosophiques et esthétiques qui contredisaient mes options libérales. Sur ce chapitre, je m'étais contenté jusqu'alors d'étudier mon très proche compatriote, Carl Spitteler, natif du Baselbiet, le pays rural autour de la ville de Bâle. Spitteler était un poète épique, le seul Suisse qui avait reçu un Prix Nobel de littérature (sans compter Hermann Hesse, qui est un naturalisé). Mais, avec la vague d'émigrés de 1938, la communauté poétique fondée par Stefan George, installée à Bâle avant 1933, s'est trouvée renforcée numériquement, si bien que j'ai appris à connaître dans ce cercle des auteurs comme Rudolf Borchardt, Alfred Mombert, Ludwig Derleth, et même Vladimir Jabotinsky, père fondateur d'un fascisme juif.
Mes intérêts se concentrèrent d'abord sur le plat principal, mitonné par des Suisses et des étrangers, des hommes de gauche, des avant-gardistes et des libéraux, pour être servi à cette gauche culturelle. C'était un savant mélange, parfois assez pertinent, de marxisme, de psychanalyse, de peinture abstraite, de musique atonale, d'architecture du Bauhaus, de films soviétiques, le tout nappé d'une sauce sucrée faite de pathos libéral. De ce côté du front, dans la guerre civile mondiale, on trouvait ce qu'il y avait de meilleur dans les années 30, car on tentait de revalider le marxisme devenu un peu caduc en lui injectant de solides doses de psychanalyse. Wilhelm Reich n'a jamais été qu'un théoricien parmi beaucoup d'autres à avoir eu cette idée. C'était génial: faire entrer en scène de concert, Marx, le mage de la société, et Freud, le mage de l'âme, bras dessus bras dessous. Avec ce couplage, le regard devenu un peu myope que jetait la gauche sur le monde, fut renforcé comme par un effet stéréo. A l'époque aussi je croyais disposer, avec le psycho-marxisme, d'un code universel pour déchiffrer rationnellement le monde. Le tour de passe-passe scientifique, qui permit à cette doctrine sotériologique nouvelle d'entrer en scène, la rendit simultanément irrésistible. Voilà pourquoi, trois décennies plus tard, j'ai eu l'impression de voir des fantômes en République Fédérale quand les soixante-huitards se sont coiffés de ce vieux chapeau (mais, il est vrai, ils le portaient à la façon californienne et non pas à la mode zurichoise).
Nous nous prenions pour de grands réalistes…
Chez les soixante-huitards, j'ai également découvert une arrogance élitaire identique à celle qu'affichaient mes amis avant-gardistes en 1938. Nous aussi avions commencé notre quête en évoquant la “dialectique” et le “refoulement”, nous avions forgé le jargon de notre petite clique pour nous distancier des “masses”. Nous, nous savions “vraiment” ce qui se cachait “derrière” les choses. Une toile constructiviste de Piet Mondrian ne se composait pas seulement de traits droits qui formaient un angle droit, puis s'entrecoupaient, pour séparer agréablement et rythmiquement des carrés ou des rectangles rouges, bleus ou jaunes, le tout sur fond blanc (ce qui peut apaiser un individu hyper-stressé, tout comme un beau tapis). Non, non, ce n'était pas que cette simple géométrie, cela “signifiait” quelque chose. Ce que nous voyions n'était pas l'essentiel, mais ce que nous associions dans l'image. Nous nous prenions pour de grands “réalistes”, mais nous n'étions que des “réalistes des universaux” (et seulement, comme le veut la conditio humana, selon notre prétention).
Beaucoup d'entre nous pensaient avoir entre les mains la clef donnant accès aux énigmes de l'univers. En réalité, nous avions troublé notre regard sur le monde en usant d'un filtre d'abstractions. On devient ainsi la proie facile de ceux qui veulent nous faire gober que le vrai monde un jour viendra, mais dans le futur. Ou on devient la proie d'autres marchands d'illusions (moins nombreux mais plus dangereux) qui veulent nous faire croire que le vrai monde a déjà été, et qu'il est irrévocablement perdu. L'espoir existe, quand on commence à se rendre compte que l'on passe ainsi à côté de sa vraie vie, unique, spécifique et irremplaçable.
Armin MOHLER
(ex: Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung, op.cit., pp. 34-37).
Quand mes premières convictions se sont érodées…
Quand ai-je cessé d'être étudiant de gauche? Je sais du moins le jour où j'ai pris conscience que tout cela était absolument faux: le 22 juin 1941. Toutefois ma conviction que le psycho-marxisme était la clef de l'univers avait déjà été ébranlée.
Je n'étais pas le type prêt à déployer des efforts pendant toute sa vie pour réaliser les lunes de l'universalisme. Dans tous les cas de figure, on peut difficilement évaluer ce que l'on reçoit en héritage avant sa naissance. Personnellement, après ma naissance, j'ai eu de la chance. Mes parents vivaient un mariage heureux. Mon père était un homme discret, mais il possédait une autorité naturelle et incontestée. Ma mère, plus entreprenante, était son complément parfait dans la vie. La maison parentale était une maison où régnait l'ordre, mais elle n'était pas ennuyeuse. Je n'ai pas été gâté. Mes parents n'en avaient pas les moyens. Les petites misères quotidiennes, physiques ou psychiques, n'ont jamais donné lieu à des excitations ou des émotions hors de l'ordinaire: on savait qu'elles faisaient partie du lot de tous les vivants. Ainsi, j'ai hérité d'un état d'esprit que je ne qualifierais pas d'optimisme mais plutôt de “goût pour la vie” (Lebenslust).
Le mouvement frontiste en Suisse
Quand je me suis dégagé du corset des idéologies de gauche, c'est ce goût pour la vie qui a été le moteur principal. Mais ce n'était pas le seul. Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas la droite suisse de l'époque qui a constitué un moteur supplémentaire. Pour autant qu'il y ait eu des groupements qualifiables de “conservateurs” en Suisse du temps de ma jeunesse, et pour autant que ces groupements n'aient pas été édulcorés, ils étaient de nature “patricienne” et/ou catholique. Ces deux fondements m'étaient étrangers. J'étais issu de la petite bourgeoisie, je ne me suis jamais senti chrétien et, au jour de ma majorité, j'ai quitté volontairement l'église réformée, dans laquelle j'avais été éduqué. Le maurrassisme, représenté en Suisse romande, aurait pu m'attirer. Mais le Suisse alémanique a toujours été coupé de la Suisse francophone. En général, il connaît mieux Paris ou la Provence. Pour un garçon comme moi, qui tentait de trouver une voie à droite, il ne restait plus que le mouvement frontiste en Suisse alémanique (c'est-à-dire des mouvements comme le Neue Front, le Nationale Front, le Volksbund, etc.). Ce mouvement était un de ces nombreux mouvements de renouveau qui surgissaient partout en Europe à cause de la crise économique et que les politologues contemporains qualifient de “fascistoïde”.
En 1931, au moment où les fronts connaissaient leur printemps, je n'avais que onze ans, sinon je me serais facilement laisser entraîner par eux. Ce mouvement de renouveau, à ses débuts, pouvait compter sur l'assentiment de nombreuses strates de la population. Il avait été initié par des jeunes loups issus des partis établis, qui voulaient créer quelque chose pour absorber le mécontentement général et la lassitude de la population contre les partis conventionnels. Pourtant, très vite, les fronts suisses ont créé leur propre dynamique. On vit apparaître des similitudes de style avec le fascisme tel qu'il se manifestait dans toute l'Europe mais, à partir de 1933, l'ombre compromettante du Troisième Reich s'est étendue sur le mouvement frontiste. Les représentants des associations de l'établissement, qui participaient à ces fronts, ont rapidement pris leurs distances, dès 1933. Les intellectuels, qui étaient les pendants suisses de la “Révolution Conservatrice” allemande à Zurich ou à Berne, sont resté plus longtemps dans ces formations politiques et ont bénéficié de l'approbation de la Jeunesse dorée qui s'ennuyait. Cependant, lors des exécutions de la Nuit des Longs Couteaux, le 30 juin 1934, à Munich et à Berlin, plusieurs victimes étaient des représentants de la “Révolution conservatrice”; choqués, la plupart de ces intellectuels suisses conservateurs-révolutionnaires quittent la vie publique et se réfugient dans leur tour d'ivoire. Le seul siège frontiste au Parlement suisse est rapidement perdu. Ce qui a subsisté des fronts a été marginalisé par la société libérale avec tous les moyens dont elle disposait. Les chefs les plus modérés se sont repliés sur leur vie privée. Une partie des leaders les plus radicaux se sont réfugiés dans le Troisième Reich pour échapper à la police et à la justice helvétiques. Il n'est plus resté qu'une troupe sans chefs, dont le nombre ne cessait de se réduire: des petites gens, obnubilés par une seule idée fixe, que les francs-maçons et les juifs (dans cet ordre) étaient responsables de tous les maux de la Terre.
Le Major Leonhardt du Volksbund
Une théorie du complot aussi lapidaire n'était pas ce qu'il fallait pour un type comme moi, qui était sur le point de résoudre l'énigme de l'univers. Pourtant, un jour, je me suis hasardé dans l'antre du lion. J'ai assisté à un meeting du plus radical des chefs frontistes, le Major Leonhardt, chef du Volksbund, une dissidence du Nationale Front. (Comme l'armée, à l'époque, était encore une institution sacro-sainte, le fils d'un Allemand naturalisé utilisait ses galons d'officier pour faire de la propagande en faveur du Volksbund). Ce meeting a dû avoir lieu au plus tard en 1939, car j'ai lu dans une thèse de doctorat consacrée au Volskbund, que Leonhardt avait émigré en Allemagne en 1939 et qu'il y a trouvé la mort en 1945 lors d'un raid aérien allié. Extérieurement, il correspondait à son surnom: “le Julius Streicher suisse”. Effectivement, son corps était d'allure pycnique, tassée, il semblait ne pas avoir de cou; il avait le même crâne pointu que Streicher, un crâne qui semblait toujours prêt à l'attaque. Il avait aussi des talents d'orateur comparables, comme j'allais rapidement le constater à mes dépens. Après le discours du Major —sur la Suisse “souillée” par les francs-maçons et les juifs— j'ai osé formuler une remarque. Je ne sais plus aujourd'hui ce que j'ai dit alors. Mais je n'ai pas oublié que le Major Leonhardt a tout de suite repéré que j'étais étudiant. Il m'a directement attaqué ad personam. (Dans la thèse que j'évoquais tous à l'heure, j'ai lu qu'il avait justifié sa rupture et celle de ses ouailles avec le Nationale Front car celui-ci était entièrement tombé sous la coupe des universitaires). Le Major a commencé à me répondre froidement, puis m'a administré une litanie d'injures, d'une voix toujours plus élevée; les insultes successives semblaient s'enrouler autour de moi comme une spirale. Leur contenu approximatif? Le contribuable suisse fait construire des universités avec son argent et qu'en sort-il? Des universitaires étrangers au monde, qui ont appris tant de choses inutiles qu'ils ne savent même plus quels sont les véritables ennemis du peuple! Leonhardt avait bien chauffé son public: les uns me regardaient avec un air narquois, les autres me lançaient des regards haineux; quant à moi, j'étais également échaudé car que peut-on opposer à une telle avalanche d'insultes? Je n'ai revécu de situation semblable qu'à la fin des années 60 et au début des années 70 dans les “discussions” qui avaient lieu à l'époque dans les universités ouest-allemandes.
Mobilisé dans l'armée suisse en 1940
Comme les fronts n'ont nullement contribué à me faire descendre de mon petit trône de libéral de gauche, quelle est alors la force qui m'en a fait descendre? Avec la distance que procure l'âge, je dois bien constater que ma mobilisation dans les rangs de l'armée suisse en 1940 a eu sa part. Le “drill” helvétique de l'époque était encore très rude: mes compatriotes qui ont d'abord servi dans l'armée suisse puis, plus tard, dans la Waffen SS allemande, considèrent que l'instruction dans notre pays était plus dure que celle qui prévalait dans les divisions de Himmler. Avec l'état d'esprit qui était le mien en ce temps-là, j'ai endossé l'uniforme avec des sentiments anti-militaristes. Je n'ai pas été un bon soldat et, à la fin de mes classes de conscrit, mon commandant m'a demandé si je voulais devenir aspirant officier (on le demandait automatiquement à tout universitaire à l'époque). J'ai répondu “non merci!” et je suis resté simple fantassin. A ma grande surprise toutefois, je sentais que certains aspects du service me plaisaient. Ainsi la course avec paquetage d'assaut et fusil me plaisait. Je ne pouvais pas me hisser au-dessus de la barre fixe mais j'étais un bon coureur à pied. Pour un étudiant anti-militariste, ces petits plaisirs peuvent encore se justifier: c'est du sport. Mais, il y avait plus inquiétant pour un pacifiste de gauche: des plaisirs quasi ataviques m'emportaient dans un domaine strictement militaire, notamment le drill. Je ne pouvais pas réprimer une profonde satisfaction quand mon peloton, après des journées d'exercices, faisait claquer ses fusils sur le sol sans “effet de machine à écrire”. (Pour les civils, cela signifie: lorsque les crosses des fusils tombent sur le sol en ne faisant plus tAc-TaC-taC-Tac dans le désordre et sans unisson, mais avec un seul et unique TAC métallique sur les dalles de la cour de la caserne). Quinze jours auparavant, je me serais encore moqué de ces “enfantillages”.
Aller au peuple
Cependant, l'expérience la plus importante de mon service militaire est venue après l'école des recrues, quand je suis passé au service actif et quand j'ai été affecté à la garde de la frontière. On m'avait envoyé dans une compagnie de Schützen (= tirailleurs), composée d'hommes, aptes à porter les armes, issus de toutes les classes d'âge mais aussi, comme habituellement dans l'infanterie, d'hommes venus de tous les horizons de la vie civile. Dans une société hautement spécialisée, l'intellectuel éprouvera des difficultés à faire ample connaissance avec des “gens du peuple”. Il n'existe que deux institutions où il peut le faire, vingt-quatre heures sur vingt-quatre: la prison et le service militaire. Les deux ans de mon service le long de la frontière m'ont beaucoup plus apporté dans ma formation humaine que le double du temps que j'avais passé auparavant dans les universités. (…) Dans cette optique autobiographique, je me contenterai d'une citation, qui résume bien l'affaire. Elle provient de l'œuvre d'un Suisse original, Hans Albrecht Moser (1882-1978); je l'ai tirée de son journal Ich und der andere, paru à Stuttgart en 1962. La voici: «L'humain se trouve plus facilement dans l'homme normal que dans l'homme exceptionnel. C'est pourquoi cet homme normal m'attire davantage. Pour satisfaire des besoins spirituels, il existe des livres».
Découvrir Spengler
Pour ce qui concerne les livres, je m'empresse de dire ceci: j'ai continué à en dévorer, sans discontinuité, et, parmi eux, j'ai surtout lu les grands critiques du libéralisme. Ces lectures ont beaucoup contribué à faire crouler mes palais imaginaires et utopiques. J'avais déjà commencé à lire Nietzsche quand j'étais scout. Pendant mes deux ans de garde le long de la frontière, je suis passé aux autres grands anti-libéraux. L'expérience la plus originale que j'ai eue, c'est en lisant Oswald Spengler. Au sommet de ma période de gauche, j'avais tenté de lire Le Déclin de l'Occident. (Bien sûr, pour apprendre à connaître l'adversaire). Mais je n'étais pas parvenu à franchir le cap des premières pages: pour moi, le texte était absolument incompréhensible. La notoriété de cet ouvrage restait un mystère pour moi, même d'un point de vue thérapeutique. Vers la fin de ma période d'incubation, que je viens de vous esquisser —ce devait être au début de l'année 1941— les deux énormes volumes me sont tombés une nouvelle fois entre les mains. J'ai ouvert le premier à n'importe quelle page et j'ai commencé à lire, sans m'arrêter, et au bout de quelques jours, j'avais entièrement parcouru les deux tomes. Pourquoi n'avais-je pas pu faire la même expérience lors de ma première tentative? Quelque chose d'essentiel en moi avait changé, mais je n'en avais pas encore idée.
Armin MOHLER
(ex: Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung, op.cit., pp. 37-41).
01:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Commentaires
Rodrigo,
Voici le texte sur Armin Mohler que tu cherchais...
Écrit par : Steuckers | mardi, 29 avril 2008
Les commentaires sont fermés.