vendredi, 21 décembre 2012
Clément Rosset ou l’éloge du réel
Clément Rosset ou l’éloge du réel
par Pierre LE VIGAN
 Clément Rosset est un philosophe matérialiste. Il rabote. Il ne cesse de couper dans la matière philosophique pour en ôter tout ce qui ne serait pas strictement philosophique. Il expulse hors du champ philosophique ce qui relèverait de la morale, ou de l’histoire, ou de la psychologie. Résultat : une philosophie réduite à un pur constat de l’exister, au pur mystère du jeu des êtres, des bêtes et des choses du monde dans le monde. Il semble que pour Clément Rosset, être philosophe soit travailler à réduire le nombre de questions que l’on se pose, et cela parce que c’est sans doute le meilleur moyen de réduire le nombre de réponses.
Clément Rosset est un philosophe matérialiste. Il rabote. Il ne cesse de couper dans la matière philosophique pour en ôter tout ce qui ne serait pas strictement philosophique. Il expulse hors du champ philosophique ce qui relèverait de la morale, ou de l’histoire, ou de la psychologie. Résultat : une philosophie réduite à un pur constat de l’exister, au pur mystère du jeu des êtres, des bêtes et des choses du monde dans le monde. Il semble que pour Clément Rosset, être philosophe soit travailler à réduire le nombre de questions que l’on se pose, et cela parce que c’est sans doute le meilleur moyen de réduire le nombre de réponses.
La philosophie de Rosset peut se résumer en deux aspects : 1° comment voir le monde, 2° comment s’accommoder du monde. Voir le monde tel qu’il est, tel est son point de départ, qui est aussi son point d’arrivée. Entre les deux, de quoi s’agit-il ? Il s’agit de ne parler que de ce qui est, et de cerner l’existant au plus près et au plus juste. Par voie de conséquence, il s’agit de ne plus parler de ce qui n’est pas. C’est-à-dire de ce qui n’est pas vraiment : de ne plus parler du monde idéal, des excuses aux imperfections du monde et des hommes, de l’au-delà, etc. Lire Rosset, c’est apprendre à parler de moins en moins. Un éloge de la concision et du silence : le silence comme forme radicale de la concision.
Le point de départ est que l’homme est condamné à être. Il est condamné à être dés maintenant ce qu’il est dés maintenant. Il n’y a aucune place pour la distinction entre ce qui est de toujours et ce qui ne serait « que » de maintenant. L’être n’est pas un « être des étants » qui siégerait « au-dessus » des étants et ré-instaurerait une coupure métaphysique entre être et étant. Il n’y a donc pas d’étant qui serait autre chose que « être ». Il n’y a pas d’être qui serait l’être des étants. Parménide écrit : « ce qui existe existe, ce qui n’existe pas n’existe pas ». L’être est l’événement d’être lui-même. L’être, de ce fait, n’existe pas. Le monde est, ce qui n’est pas la même chose que de dire « l’être est ». L’être est verbe, et il n’est que cela. Il n’est pas un substantif. Il faut d’ailleurs se méfier des substantifs : ils finissent par être des substituts. La seule chose que l’on peut dire de l’être est qu’il est le monde tel que jamais la connaissance ne le rattrapera. « Le simple fait d’être n’est-il pas à lui seul l’événement le plus inattendu auquel il nous soit donné d’assister ? (1) »
Clément Rosset voit résolument le monde comme un, au sens d’un seul. Ce monde Un n’est pas unique pour autant. Il est « un seul à la fois ». Quand il est là, il est pleinement là, et totalement là. Il n’y a place que pour lui; il prend toute sa place, et donc il prend toute la place. Ici et maintenant, on trouvera ainsi tout le réel, mais rien que du réel. « Ne cherchez pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant », écrit Clément Rosset. Ailleurs, en l’occurrence, on trouvera bien des choses. Mais pas du réel. Des succédanés. Alors, si, précisément, nous cherchons autre chose que le réel, allons voir ailleurs. Nous y trouverons ce que nous cherchons : rien. Si nous préférons nous raconter des histoires plutôt que trouver du réel c’est notre problème. Mais encore faut-il le savoir.
Il n’y a qu’un seul monde, et ni un ni plusieurs arrière-mondes. Clément Rosset critique une idée courante : celle d’un réel doté d’un double, l’idée comme quoi le sens du réel ne se trouverait pas dans celui-ci mais à coté. Doublant le réel, un autre réel remettrait le réel « dans sa vraie perspective ». Un arrière-réel plus intelligent, mieux éduqué que le réel simplement réel. Le réel idéel – qu’il conviendrait de s’employer à rendre idéal – expliquerait le sens présent et le devenir du réel observable, que l’on pourrait qualifier de réel vulgaire ou simple réel réellement existant (R.R.E.) – un réel en quelque sorte trop simple pour être vrai. Le réel idéel donnerait la loi explicative du R.R.E. Telle est la théorie de la réminiscence : le réel d’ici et de maintenant s’expliquerait par un réel voilé, par un réel déjà-vécu, par un déjà-là, une sorte d’être qui précéderait les étants. L’immédiat – l’immédiatement perçu – est ainsi dévalorisé. Rosset critique, autrement dit, l’idée de l’idiotie du réel, cette idée qui est la définition même du romantisme. Pour Rosset le réel réellement existant n’a pas besoin d’être « éclairé » par un « vrai réel », un double, qui l’expliquerait « de l’extérieur ». À l’extérieur du réel, il n’y a rien. Et le rien n’a évidemment rien à dire sur ce qui est, et qui lui n’est pas rien. En résumé, tout double paraît à Rosset une fuite devant la réalité, qu’il s’agisse concernant ce double d’un arrière-monde, d’un autre monde, ou d’une essence dissociée d’une existence (2).
Pour Clément Rosset, la question de l’unicité du réel, donc de sa non-dualité, est la question proprement philosophique, qui ne se superpose ni à la question morale, ni à la question de l’histoire, et de son sens éventuel. L’unicité du réel se trouve exprimée par Parménide mais aussi par Lucrèce indiquant en substance que le monde se compose de ce monde-ci, et de mondes non réels mais possibles dont nous ne pouvons rien dire. Cette question de l’unicité du réel aboutit à s’interroger sur les histoires homériques elles-mêmes, dans lesquelles les dieux agissent dans l’histoire des hommes. Le monde visible des hommes n’est-il pas dans ces histoires le reflet du monde réel des dieux ? Or, à partir du moment où le réel visible est supposé « agi » par un réel invisible, la suspicion sur le visible s’installe. L’idée du « peu de réalité » (André Breton) du réel visible s’insinue. C’est un tort.
Certes, la dévalorisation du Réel Réellement Existant n’est pas inéluctable. Ainsi, le réel peut être, chez Hegel, un double de l’Unique réel, qui récapitule tous les instants passés dans l’instant présent. Le réel d’ici et maintenant est ainsi en quelque sorte « anobli » mais reste un double. C’est ainsi un « monde renversé ». C’est encore ce que Gérard de Nerval désigne par un « état de grâce » (3). La plupart des philosophes ont défendu cette idée simple : le réel et son double sont proches, voire identiques (voir plus haut). Une fois encore, Hegel représente bien cette conception portée au stade supérieur de cohérence interne.
Mais cette identité du réel et de son double est en fait impossible. Deux choses identiques ne seraient pas deux. Comme l’écrit Montaigne, « la ressemblance ne fait pas tant un comme la différence fait autre ». Au vrai l’identification d’une chose nécessite que soit posée à côté une autre chose qui ne soit pas exactement la même. C’est pourquoi un réel sans double est proprement non identifiable. Ce qui caractérise le réel est qu’il est toujours totalement là et prend toute la place. C.F. Ramuz dit : « Un bonheur c’est tout le bonheur; deux, c’est comme s’il n’existait plus ». Clément Rosset remarque justement que l’on peut en dire autant du réel. Ainsi, plus un objet est réel, plus il est unique, donc moins il est identifiable. Si le réel est vraiment là, il n’y a plus de distance par rapport à lui, et donc plus d’identification possible. Prenons un exemple : on peut identifier un nuage parce qu’il y a plusieurs nuages, et même plusieurs formes identifiées de nuages. Mais d’une forme inédite, on ne peut rien dire si ce n’est qu’elle est un monstre. On ne peut la « décrire » que comme une chose qui ne ressemble précisément à aucune autre, comme les « choses » de H. P. Lovecraft.
Ce qui angoisse, par exemple le néant, est souvent – loin d’être irréel – on ne peut plus réel. Car le néant, contrairement aux autres « objets du monde » n’a pas de double. Et il est d’autant plus réel qu’il est unique. D’où la thèse de Clément Rosset comme quoi la plus réelle des choses, c’est la mort, dans la mesure où c’est aussi la plus unique des choses. En ce sens, le réel ne peut avoir d’histoire. Une histoire du réel supposerait en effet que l’on puisse se placer d’un point de vue autre que le réel. Or, si le réel est tout le réel, il est non identifiable et non historicisable. Le matérialisme en tant que prise en compte sans conditions du réel est en ce sens inévitablement non-historique (d’où selon Rosset le non-sens du « matérialisme historique » de Marx).
Rosset, c’est le réel sans double. Mais c’est un peu plus compliqué que cela (4). Le double est en effet pensable dans certaines conditions, quand il prend l’une des trois formes suivantes : l’ombre, le reflet, l’écho.
Le double peut ainsi être une ombre, et en ce sens être les confins, la banlieue d’un existant, quelque chose comme l’util (l’outil) chez Heidegger, une chose « à portée de la main », un prolongement de soi, un double qui n’est pas une illusion mais un « à côté de soi », un « avec soi » dans la contrée de soi. C’est le double de proximité. Ce n’est donc pas une illusion, mais c’est la trace et la marque d’un existant. Tout vivant a son ombre ou meurt. Les fantômes n’ont pas d’ombre, car ils sont déjà morts. Ou n’ont jamais pu naître. Telles les créatures évoquées par Ravel : ogres, lutins, diables, follets (5). Ainsi sont-elles des ombres sans être l’ombre de quiconque (6). L’ombre comme vrai double d’un vrai existant, ainsi que l’est le rêve peut être plus inquiétante. Platon évoquait cette « espèce de désirs qui est terrible, sauvage, et sans égard pour les lois (7) ».
Si l’ombre est vrai double d’un vrai existant (d’un « étant dans le monde » dirait Heidegger), le reflet, ou encore le miroir (mieux : le reflet en tant que ce qui empêche de passer à travers le miroir), est double sans objet. Double d’un objet certes mais sans objet. Exemple : la passion. On n’aime jamais (tout à fait) qui on croit aimer. Et on ne s’aime pas non plus pleinement à travers l’autre (l’amour n’est pas qu’effet de miroir). L’amour n’est jamais pur reflet ni pure altérité. Il est entre. C’est d’ailleurs tout son « intérêt » (un intérêt sans rapport avec le sens économique de ce terme, car en ce registre tout peut se donner, tout peut se perdre, rien n’est négociable). C’est là qu’est sa profondeur, précisément sans fond, car il est entre. C’est pourquoi on ne peut vivre sans ombre mais on peut vivre avec ou sans un reflet. Sauf qu’existe le risque de devenir ce reflet. Hanté et transformé par ce reflet, – pétrifié aussi par ce reflet -, reflet de soi perdu ou de l’autre perdu. Comme écrit Rosset, « dans cet autre coté du miroir où s’aventure Alice, on ne fait pas que de bonnes rencontres (p. 62) ».
L’écho est l’autre – le troisième – réel comme double, vrai réel vraiment double d’un authentique réel, qui atteste de la présence dans le monde le plus fortement. C’est le moins autiste des doubles. Et pourtant l’écho est tautologique. « Où es-tu ? » dit l’un, « où es-tu ? » répond l’écho. Même si la tautologie est parfois plus subtile, comme dans le judaïsme. « Qui es-tu ? » questionne Moïse. « Je suis celui qui suis » répond l’écho (écho-Dieu ou écho de Dieu). Pourquoi cet écho est-il en même temps le plus vivant des doubles ? Parce qu’il est dans le monde. Plus encore, il rend présent le monde. Il est le monde en sa présence. Il est la pure présence du monde. « Il est vrai (…) que l’écho, qui ne sait que nous renvoyer à nous-mêmes, possède un pouvoir de nous conforter dans notre identité et notre réalité supérieur à celui dont disposent l’ombre et le reflet » note Rosset (p. 71). L’écho nous échappe, il est du monde avant d’être de nous, il nous défie d’être au monde, d’y être plus encore, d’y être toujours plus. « Double sans maître » dit Rosset. Ce n’est pas assez dire. C’est, plus encore, l’écho qui ambitionne d’être notre maître. C’est lui qui nous intime l’ordre d’assumer tout le bruit que nous faisons en société, même si nous ne faisons pas beaucoup de bruit. C’est lui qui nous demande d’être, plus encore, dans le spectacle de la société du spectacle. L’écho, c’est la mise en abîme perpétuelle : à perpétuité. C’est l’effet vache qui rit – sans le rire. Disons-le tout net : l’écho est de tous temps, mais il est aussi bien de notre temps (comme on dit : bien de chez nous).
L’allégresse est aussi un savoir sur le réel
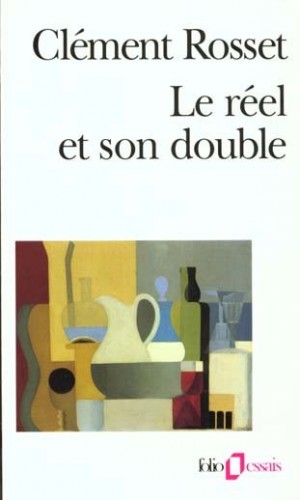 « Rien n’aura eu lieu » notait Mallarmé. Cela résume en quelque sorte le matérialisme intégral et anhistorique de Rosset. Revenons sur cette question : le réel est l’inconditionné même, le non-mesurable. Le réel est précis, exact – il est exactement là – en tant qu’il n’est pas mesurable, ce qui supposerait un Autre du réel, fusse une duplication, une copie certifiée conforme (dieu, l’être, avec ou sans majuscule…), l’audace étant parfois poussée loin, quand la copie se prétend l’original, attribuant au réel visible et palpable le statut de simple copie. Mais que le réel soit là, qu’il occupe toute la place n’enlève pas à l’homme une liberté : celle de prendre le temps de savourer, du réel, c’est-à-dire du monde, l’inépuisable simplicité. Ainsi, trois principes se rejoignent : le principe de l’unicité du monde (pas d’arrière-monde), le principe de lucidité (voir le monde tel qu’il est), le principe de cruauté (ne pas se cacher la cruauté du monde). La vérité crue doit être crue. Ce dernier principe est bien résumé par Ernesto Sâbato : « Je désire être sec et ne rien enjoliver ». Le réel est cela, et seulement cela.
« Rien n’aura eu lieu » notait Mallarmé. Cela résume en quelque sorte le matérialisme intégral et anhistorique de Rosset. Revenons sur cette question : le réel est l’inconditionné même, le non-mesurable. Le réel est précis, exact – il est exactement là – en tant qu’il n’est pas mesurable, ce qui supposerait un Autre du réel, fusse une duplication, une copie certifiée conforme (dieu, l’être, avec ou sans majuscule…), l’audace étant parfois poussée loin, quand la copie se prétend l’original, attribuant au réel visible et palpable le statut de simple copie. Mais que le réel soit là, qu’il occupe toute la place n’enlève pas à l’homme une liberté : celle de prendre le temps de savourer, du réel, c’est-à-dire du monde, l’inépuisable simplicité. Ainsi, trois principes se rejoignent : le principe de l’unicité du monde (pas d’arrière-monde), le principe de lucidité (voir le monde tel qu’il est), le principe de cruauté (ne pas se cacher la cruauté du monde). La vérité crue doit être crue. Ce dernier principe est bien résumé par Ernesto Sâbato : « Je désire être sec et ne rien enjoliver ». Le réel est cela, et seulement cela.
Un des problèmes qui se posent, c’est que l’essentiel de la philosophie part du postulat qu’il y aurait plus à dire de mondes dont nous ne pouvons rien dire que de ce monde-ci. La réalité immédiate est ainsi dévalorisée au profit de mondes dont l’existence est improuvable. C’est le « principe de réalité insuffisante » : raisonner à partir du réel serait insuffisant, voire vulgaire. Le succès de ce principe vient d’une crainte bien compréhensible devant la cruauté du monde. Que la réalité soit triste est triste. Que cette réalité soit de surcroît vraie est cruel. Que le remède contre l’angoisse humaine soit la révélation de la vérité, comme le suggère Lucrèce, apparaît ainsi problématique. Car en effet la vérité fait mal. Souvent. On peut même se demander si la pratique de la vie ne nécessite pas au contraire un minimum d’aveuglement (souvent un maximum d’aveuglement d’ailleurs). Cette cruauté de la vie se manifeste fort bien dans l’amour. Celui-ci commence, rappelle Rosset, par un baiser comme envie de mordre, et se termine, « si l’itinéraire amoureux va jusqu’à son terme – avec l’écartèlement et la mise en miettes (8) ».
Un autre motif de scepticisme, ou bien de paresse est que le réel n’est pas façonné par l’homme en fonction de l’énergie qu’il investit dans le monde. En effet, il faut de l’énergie pour accepter le réel tel qu’il est, mais il en faut aussi pour inventer (ce que fait le fou) un autre réel. L’énergie n’est pas un critère de vérité (non plus que le travail. Le réel n’a décidément pas de morale, ce qui n’interdit pas à l’homme d’en avoir mais en son nom propre).
Le monde selon Rosset ne comporte donc ni double ni arrière-monde. Il est réel en tant qu’il est présent à nous ici et maintenant. Il change mais il ne se transforme pas, ou si l’on préfère il bouge mais ne change pas. Il n’est jamais pareil mais c’est toujours le même. Dans la Lettre sur les chimpanzés. Plaidoyer pour une humanité totale (Gallimard, 1965 et 1999), Clément Rosset critique – avant Pierre-André Taguieff – le bougisme qui s’est tant développé depuis et cite à son propos quelques exemples particulièrement pittoresques. « Mais nous bougeons, mais nous avançons ! » écrivait Teilhard de Chardin dans L’avenir de l’homme. L’humanité de demain, c’est l’humanité « réconciliée avec elle-même », disait-on alors. C’est la christosphère. « En haut – et en avant ! » disait le père Bergougnioux. « Le dénouement se précipite » prophétisait encore Teilhard de Chardin (9). Toutes ces propositions n’avaient d’égale que la totale gratuite de leur affirmation. Du moins cet éloge du mouvement était-il un progressisme. Alors que nous en sommes à l’éloge du « mouvement pour le mouvement », et du nouveau pour le nouveau.
En tant qu’il est donné, le réel est inévitablement tragique. Le tragique c’est penser le pire (sans s’y complaire, ce qui est coquetterie d’esthète). C’est donc penser que l’homme peut être le pire ennemi de lui-même. Le monde réel est peut-être le meilleur possible (Leibniz) ou le pire (Schopenhauer). Cela importe peu. Il peut être le meilleur tout en étant mauvais, et le pire sans être si mauvais. Le donné et le tragique désignent la même chose : ce qui ne dépend pas de nous, le fatum. L’existence, et notamment l’existence de l’homme, est l’indéterminé même. Le monde dans lequel l’homme est jeté n’est ni absurde, ni rationnel, ni raisonnable. Il est tout simplement incompréhensible. Ce monde tragique, plein des « soucis de tous les jours et de toutes les nuits (10) » ne dit mot de la peine et de la détresse des hommes. Au delà de la mince écorce des bruits du monde règne le silence. C’est le caractère angoissant de ce silence qui explique la tentation du bavardage moral. Mais c’est là encore une tentation de refus du réel.
Accepter le réel, c’est accepter un monde sans morale. Parce que l’objectif de la morale c’est de faire parler le monde. C’est de le sommer de nous livrer sa signification. Si le monde parle, et l’exigence morale le veut, c’est pour nous en dire plus sur lui, pour se justifier. Si le monde a quelque chose à nous dire c’est qu’on peut y comprendre quelque chose et aussi qu’il est « perfectible » comme disait George Sand. Si le monde n’est pas parfait, et/ou si un monde parfait n’est pas réel, cela prouve, nous dit la morale, l’existence de contre-forces au bien et à la perfectibilité. Là où il y a douleur, il doit y avoir péché. Il doit donc y avoir pénitence. « Verglas assassin, Mitterrand complice » proclamait le groupe humoristique Jalons des années 1980. Cela n’est pas si mal représenter l’esprit du temps. Conséquence : voir le monde tel qu’il est est devenu l’indécence suprême. Voir les choses comme elles sont est devenu très obscène.
Le principe de base de Rosset est de voir le monde tel qu’il est. Sécheresse du constat. Mais comment peut-on s’accommoder de ce monde ? En l’accueillant comme un don. En remplaçant l’espérance d’un autre monde par l’étonnement devant ce monde-ci. C’est le monde d’ici et de maintenant qu’il faut respecter – sinon diviniser comme le souhaitait Nietzsche (La volonté de puissance, « Les trois siècles» ). Il faut tout ramener au réel et se contenter du réel. « Ne plus se raconter d’histoires » comme disait Louis Althusser. Abandonner tout espoir, toute illusion et gagner par là le sens de la précision des choses. Avoir le souci de l’exactitude. Préférer, comme Samuel Butler, le mensonge à l’imprécision (qui est souvent un mensonge plus grand). Ne pas tricher. Ou tricher en grand. Pour que, au moins, cela se voit.
Il y a bien des mondes dans le monde
Du point de vue de l’homme, deux conditions minima suffisent à faire un monde : le tragique et l’artifice. À l’unicité / simplicité du regard de Plotin, opposons la diversité des regards. Le réel n’est pas monolithique. Il comporte des aspérités, des zones convexes et d’autres concaves, des angles morts : il y a bien des mondes dans le monde. Condamné à l’existence, l’homme est contraint à coller au plus près à sa propre présence. Il revient à chacun d’avoir un monde, de trouver ou de construire (son) monde. « Ne faire qu’un avec sa propre course. » Mais deux modes de présence au monde sont possibles, et ils sont contradictoires. La nausée est un de ces modes de présence au monde. Mais elle est inconfortable. Elle est même justement le sentiment de l’inconfort de tout ce qui est. À l’inverse, la jubilation est confort total et plein. Elle est le sentiment que tout ce qui est est réjouissant. Le point de vue jubilatoire est que tout, dans le monde, et tout, du monde, est à déguster.
Le dyonisiaque est ici le contraire du romantisme : il se réjouit de ce monde-ci. La nausée et la jubilation ont un point commun : elles concernent le réel, et elles concernent le présent du réel. Finalement, rien de moins névrotique que la nausée ou la jubilation (d’où le fait qu’elles ne sont pas sans risque puisque nous n’aurons garde d’oublier que la névrose protège). Entre les deux – nausée ou jubilation – n’existe que la différence de l’artifice, la posture, la « disposition à ». Tant la nausée que la jubilation relèvent d’une certaine rigueur, à laquelle s’oppose le goût de l’irréel. À l’extrême, le goût de l’irréel mène à la folie. Mais dans sa version douce, c’est une simple névrose. Et donc une protection. En effet, le goût de l’irréel peut-être un petit divertissement domestique qui protège de la paranoïa, vraie folie en tant qu’elle est – comme disait les Grecs – « excès de raison ». Si la folie est une tricherie avec le réel en tant qu’elle est un artifice majeur, fréquentes sont les petites tricheries comme le dédoublement, et le mélange de bonne et de mauvaise conscience qui va avec. Autrement dit, fréquente est la fausse conscience. Celle qui consiste à tricher en petit. Quitte à tricher, il faut tricher en grand. Facile à dire certes.
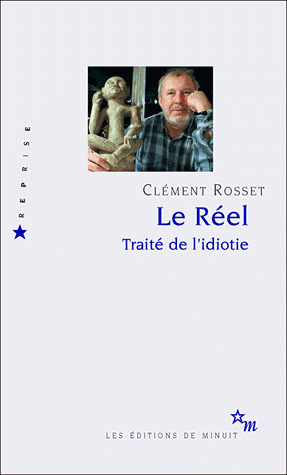 Précisons alors : qu’est-ce que la fausse conscience ? La fausse conscience est la conscience dédoublée. C’est celle du bourreau qui dit : « Achevons-le vite. Je déteste voir souffrir ». S’accommoder du monde, c’est aussi s’accommoder d’être toujours moins « moral » qu’on ne le souhaiterait. Mais aussi, c’est être ce que l’on est; c’est pour l’homme accepter d’être comme l’animal en un sens et ne pas être comme l’animal en un autre sens. De fait, ce n’est pas en tant qu’il raisonne, en tant qu’il a des stratégies (de chasse, de conquête, de séduction…), en tant qu’il est prédateur mais aussi altruiste, en tant qu’il est pudique, ce n’est pas en ce sens que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il est un être d’excès que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il recherche l’ivresse, en tant qu’il est un être de pathos, en tant qu’il ne se contente pas du présent, en tant qu’il est lubrique, pervers, et parfois même zoophile que l’homme se distingue de l’animal. Au fond, en tant qu’il est animal, l’homme est rassurant, réaliste, prévisible. C’est en tant qu’il n’est pas seulement animal que l’homme cherche à s’évader hors du réel. Que l’homme est inquiétant. L’animalité de l’homme (ce qu’il en subsiste), c’est au contraire sa garantie de ne pas décoller complètement du réel.
Précisons alors : qu’est-ce que la fausse conscience ? La fausse conscience est la conscience dédoublée. C’est celle du bourreau qui dit : « Achevons-le vite. Je déteste voir souffrir ». S’accommoder du monde, c’est aussi s’accommoder d’être toujours moins « moral » qu’on ne le souhaiterait. Mais aussi, c’est être ce que l’on est; c’est pour l’homme accepter d’être comme l’animal en un sens et ne pas être comme l’animal en un autre sens. De fait, ce n’est pas en tant qu’il raisonne, en tant qu’il a des stratégies (de chasse, de conquête, de séduction…), en tant qu’il est prédateur mais aussi altruiste, en tant qu’il est pudique, ce n’est pas en ce sens que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il est un être d’excès que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il recherche l’ivresse, en tant qu’il est un être de pathos, en tant qu’il ne se contente pas du présent, en tant qu’il est lubrique, pervers, et parfois même zoophile que l’homme se distingue de l’animal. Au fond, en tant qu’il est animal, l’homme est rassurant, réaliste, prévisible. C’est en tant qu’il n’est pas seulement animal que l’homme cherche à s’évader hors du réel. Que l’homme est inquiétant. L’animalité de l’homme (ce qu’il en subsiste), c’est au contraire sa garantie de ne pas décoller complètement du réel.
Une autre digression hors du réel est l’excès de bons sentiments : un excès parmi d’autres, comme l’abus d’alcool, avec lequel il entretient d’ailleurs quelque parenté. « Frémir de bons sentiments, c’est (la même chose) que bouillir de rage » rappelle Clément Rosset. On sait que la seule morale repérable selon Kant est celle de la bonne volonté. C’est le contraire d’une morale des moyens. Les conséquences des actes sont en effet susceptibles d’interprétations diverses : on peut massacrer allègrement afin d’éliminer le méchant adversaire et donc toute source de conflit futur. En d’autres termes, on peut massacrer par pacifisme foncier. C’est une histoire de ce genre que relate le film Bulletin spécial : un groupe de savants menace de faire sauter la planète… si le Pentagone ne renonce pas à ses essais nucléaires (11).
D’une manière générale, le souci de l’avenir est généralement meurtrier. Pour assurer aux Allemands une paix de mille ans, Hitler a estimé plus prudent d’éliminer le danger slave et de chercher à dominer le monde. Un principe de précaution en quelque sorte. Bilan : une atroce guerre mondiale. Avec l’Allemagne parmi ses principales victimes. Pour assurer la construction du socialisme dans des conditions paisibles, Staline a estimé « raisonnable » de liquider les restes de la bourgeoisie russe. Bilan : la déportation de masse et l’échec économique. Moins de riches sans doute, mais des pauvres encore plus pauvres. En résumé, trop de sollicitude amène souvent à de copieux massacres – et au moins à de sinistres gâchis.
Mettre les passions au régime
C’est ainsi qu’il faut aborder la question des passions. Trop souvent l’amour est considéré comme la passion-type. Nous verrons qu’il n’en est rien. L’avarice, la haine, la tyrannie domestique, l’ambition, le goût de la collection sont des passions bien plus assurées. La passion est une souffrance : c’est la souffrance d’un objet qui fait défaut. « Ma faim qui d’aucuns fruits ici ne se régale » écrit Mallarmé (12). La passion en ce sens est proche de l’hystérie : elle entretient le malheur du manque. Mais l’hystérie s’acharne sur le réel, elle lui en veut, mais elle l’affirme, quitte à l’affirmer déformé. C’est le distort de Binswanger comme forme manquée de la présence au monde. L’hystérie entretient ainsi quelque lien avec la paranoïa. La passion, par contre, tend à ignorer le réel qui, bien évidemment, se dérobe. Elle entretient ainsi quelque lien avec la mélancolie, qui peut lui succéder – la passion étant, bien sûr, toujours déçue. La passion est ainsi une façon de tenter de fuir le réel.
S’accommoder du réel, c’est ne pas vouloir un autre réel absolument meilleur, donc absolument autre, ce qui aboutit inexorablement à dévaloriser le réel d’ici et de maintenant. S’accommoder du réel c’est aussi accorder sa place à l’artifice. Reconnaître l’artifice, c’est reconnaître un lien « naturel » entre l’homme et celui-ci. L’artifice doit servir à l’homme à introduire une distance artificielle entre lui et lui. C’est Lucrèce qui propose comme remède à la douleur d’être homme la mise à distance par rapport à la vision de notre propre finitude, de notre propre mort, et donc la mise en œuvre d’une certaine dose d’inconscience et d’auto-amnistie (oubli) de ce que nous savons (13).
Il nous faut prendre acte de ce qu’il y a une aisance naturelle de l’homme dans l’artifice. Il n’y a pas une intériorité de l’homme qui s’opposerait à une extériorité socialement exposée. (Dans le bla-bla moderne, l’intériorité de l’homme est souvent appelé spiritualité). L’homme est tout de surface c’est-à-dire tout d’exposition – ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas de profondeur. En effet, le moi, c’est la faculté de se souvenir. Or, il n’y a pas de moi autre que le moi social car ce dont on se souvient c’est de soi parmi les autres, c’est d’émotions dont les autres sont partie prenante. Un moi non social ne peut pas être un moi réel. L’identité personnelle est sociale ou n’est pas. Bien connaître quelqu’un c’est bien connaître son comportement, le rôle qui est le sien, et l’interprétation qu’il a choisit de celui-ci. C’est connaître ce qu’il donne à voir. L’homme qui se connaît a renoncé, comme Don Quichotte, aux illusions de l’individualité.
A contrario, quand le moi social n’existe plus, que se passe-t-il ? Un sentiment de légèreté s’installe, le stress social disparaît – car le stress est le contraire du vide. Reste donc le vide. Ce qui s’installe est un sentiment qui caractérise la psychose mélancolique, remarque Clément Rosset (14). Ce qui est perdu dans cette psychose, c’est ce qui existait de façon certaine : l’identité sociale. Si l’identité sociale est la seule attestée, c’est que s’exposer aux autres est non seulement la seule façon d’exister mais aussi la seule façon de se connaître. Les renseignements que l’on possède sur soi même, on les a au travers du miroir que sont les autres. Ce sont des renseignements de seconde main. Peut-être. Mais ce sont les seuls fiables. À l’illusion du « libre-arbitre » qui permettrait le « maintien de soi » (Paul Ricoeur), on peut préférer, comme plus réelle, la constatation que c’est le sentiment (si possible joyeux) du lien social qui garantit au mieux l’identité personnelle.
Si on accepte l’autosuffisance du tragique et de l’artifice pour faire un monde, on doit logiquement se désintéresser des causes premières tout comme des fins ultimes. On se retrouve logiquement hors d’un mouvement qui, remplaçant la religion par le rationalisme, a accru le champ de l’explicabilité du monde. Loin d’être opposés, la religion et le rationalisme ont partie liée dans la mesure où « la superstition demande des causes » (C. Rosset), tandis que la vraie raison se contente de constater que nombre de choses sont sans causes, ou bien relèvent d’une « anti-cause » comme le hasard.
Reconnaître le caractère hasardeux du monde, son caractère indéterminé, c’est considérer le hasard comme la négation même de tout destin, de toute contingence, de toute nécessité. La nature s’oppose ainsi au hasard dans la mesure où elle est constituée, déjà-là, non hasardeuse. Ainsi, l’idée de nature suppose des interventions, pas forcément humaines, tandis que le hasard postule la vanité même de toute intervention. La « nature » est ainsi l’anti-hasard. Non qu’il n’y ait de hasards dans la nature. Mais s’il y a des hasards, il s’agit de hasards contingents, de marges d’indétermination qui concernent des lois, des processus repérables et repérés. Le hasard contingent s’oppose ainsi au hasard « pur », que l’on pourrait appeler hasard purement hasardeux, et qui est le hasard constituant, désignant la nature même de la présence de toute chose au monde, et de la présence du monde, un hasard originel en amont de tous les hasards contingents, et au fond un hasard antérieur à la constitution même de toute « origine ». L’idée de hasard, même quand elle est appelée fors par Lucrèce, est en ce sens le contraire de l’idée de nature.
Aussi, la seule « nature », pour Rosset, c’est la mort. C’est-à-dire que la seule constante, la seule détermination purement assurée, c’est la mort. Parce que, au fond, la seule chose pas du tout hasardeuse c’est la mort. Conclusion de Rosset : ce qui existe, ce qui existe vraiment, ne peut être appelé que « la mort ». La vie n’en est qu’un dérivé. Rosset défend ainsi un point de vue qui – on le remarquera – pourrait facilement être inversé. L’aurait-il choisi… par pur hasard ? Nous le croirions si la psychologie la plus élémentaire ne nous indiquait qu’il n’y a pas de hasard dans son affirmation. Ou plus précisément qu’il y a dans cette affirmation de Rosset pas autre chose qu’un hasard constituant. Celui de sa vision du monde.
Une vision du monde tragique
En conséquence de cette vision du monde tragique, l’homme est perpétuellement en état de perdition. De perdition et non de perte car il ne peut rien avoir perdu, n’ayant jamais rien possédé. La perdition, ou angoisse, ou nausée, ou mélancolie, tous ces états sont, non des synonymes, mais des approches convergentes de la condition de l’homme. Mais les nuances ne sont pas minces. Si on a en vue la perdition, on est dans le registre de la pensée tragique. Si on a en vue la perte, on est dans le registre d’une pensée pessimiste, soit fondamentalement dans une pensée historique, mélancolique si l’on veut, mais historique. La perte est en effet quelque chose d’identifiable, qui renvoie à la nature des choses (qui postule la croyance en une « nature »), et non à un hasard primordial. La mort est ainsi une perte.
La perception des choses est toute différente dans la pensée tragique. La vie elle-même y est perdition. La pensée tragique n’est pas désespérée, elle est désespérante. C’est plus grave, mais c’est aussi un principe plus « actif ». Actif dans le registre corrosif. Quand Rosset définit (paradoxalement) la vie comme étant la mort, cela veut dire qu’elle est mouvement même vers la mort (c’est un point de vue qu’avait exprimé par exemple Pierre Drieu La Rochelle). La vie est mort en tant qu’elle se consume. Mais là encore, le point de vue final n’est-il pas inversable ? À savoir que la mort est preuve même de la vie et que seule la vie est réelle ? Puisque le hasard, et donc l’arbitraire est possible, puisqu’ils sont même la seule chose possible, pourquoi ne pas défendre l’idée que la mort n’est qu’une parenthèse dans la vie, que toute vie concourt à la poursuite de la vie, c’est-à-dire poursuite d’elle-même, le conatus de persister en soi qu’évoque Spinoza, que la vie est un grand flux, que le mouvement du vivant est le mouvement même de tout ce qui est ? « On ne meurt pas puisqu’il y a les autres » disait Aragon. Position d’ailleurs tragique, elle aussi, voire la plus « tragique », car, au fond, quoi de plus désespérant qu’un mouvement que rien ne pourra jamais arrêter ?
Que tout soit « vie » ou que tout soit « mort », l’absence de croyance en la « nature » et en ses « lois » a pour corollaire le scepticisme vis-à-vis de la notion de « l’être ». Cette notion apparaît pour Rosset un nouvel avatar de la théorie du « monde-reflet ». Rosset rejette cette notion car si le monde est monde de l’être, il est monotone – et en ce sens il est déjà mort, car l’être, par définition, ne survient jamais, il est toujours déjà-là. À l’inverse, si le monde d’ici est le monde du non-être, il se passe au moins quelque chose par la représentation tragique du rien. Il est ainsi légitime d’opposer un monde de l’être, dans lequel on s’ennuie, et un monde du non-être dans lequel l’artifice peut avoir sa place. Avec le non-être, il y a place (au moins) pour le théâtre. Choix délibérément factice de Rosset (mais nous avons vu la légitimité, voire la « naturalité », du point de vue de l’homme, de cette facticité/artificialité. La nature de l’homme est sa culture).
Si l’artifice est ce qui rend le monde supportable, chacun l’accommode à sa façon. Accepter le monde, c’est accepter la différence des autres, tous singuliers puisqu’il n’y a pas de nature donc pas de nature humaine. Si la nature de l’homme c’est sa culture donc c’est l’artifice. L’homme est mû par le besoin de reconnaissance. Mais la reconnaissance de soi par soi se heurte à la difficulté de saisir ce qui est dans une extrême proximité. La reconnaissance de soi passe par la reconnaissance des autres par soi et de soi par les autres. Il apparaît alors que c’est en tant qu’ils sont ressemblants que les autres sont dérangeants pour l’identité. De là se pose la question des conditions de la tolérance. Cette question ne se pose pas principalement pour des raisons morales. Elle se pose pour des raisons de confort. Un monde sans tolérance est en effet invivable : pour soi et pour les autres. Et on tolère tout simplement ce qui ne dérange pas trop.
Les philosophies qui ne se contentent pas du réel sont portées à l’intolérance. Au nom d’un mieux-être, au nom d’un devenir « plus et mieux », au nom de l’idée de la perfectibilité infinie du monde et des sociétés humaines, il est normal d’être excédé par les imperfections, les résistances au changement, les effets imprévus de décisions pourtant bien inspirées (hétérotélie). L’optimisme tend naturellement à être intolérant – et impatient – envers ce qui paraît le contredire. La pensée tragique est au contraire la condition nécessaire à la tolérance. Seule une indifférence aux « essences » du monde permet de ne pas faire un drame des différences, des marginalités, des dissidences. Seule une conception qui ne déifie rien dans le monde, et surtout pas l’homme ni l’avenir de l’homme, peut être tolérante car justement cette conception ne demande pas trop à l’homme.
Toutes les pensées qui mettent l’homme dans un rapport privilégié avec Dieu, de ressemblance avec et/ou de rédemption par, toutes ces pensées tendent à être intolérantes. Des nuances existent certes. Ainsi, le christianisme peut renoncer à la conversion de certains hommes en qui il ne voit pas des semblables. « Maigre tolérance, dira-t-on, qui n’a pas empêché un certain nombre des ces “ hommes ” sans “ nature ” de périr dans les flammes et la langue arrachée. Sans doute : mais c’est paradoxalement une insouciance, plus qu’une intolérance, à l’égard de ces hommes qui rend possibles de telles pratiques. Tuer un “ homme ” qui, malgré toutes les bienveillantes sollicitations dont il a été l’objet, refuse de reconnaître en lui une nature divine, c’est attenter à aucune nature, tuer rien; bien de la bonté, en un sens, qu’on en ait tant fait pour lui (15). » En effet, c’est du libéralisme, de l’ouverture d’esprit que de savoir reconnaître en l’autre un étranger. « Ce que le chrétien exterminait dans l’autodafé, c’était rien; ce qu’un idéologue moderne traduit en son tribunal, c’est l’autre – soit un semblable rétif, mais semblable tout de même, en vertu de l’idée de nature (idem). » En définitive, c’était par ouverture d’esprit que les chrétiens finissaient par exterminer des gens qui, en résistant à la conversion, avaient décidément prouvé leur étrangeté. Et en d’autres termes, l’intolérance moderne est d’autant plus forte qu’elle admet, et même qu’elle veut que l’autre soit semblable. Il est alors inexcusable de ne pas être… pareil. L’« ouverture d’esprit » qui veut que les étrangers puissent devenir comme nous c’est justement cela l’intolérance.
Nous voyons que la cohérence de la pensée de Rosset est forte : matérialisme, regard sans illusion, et sans arrière-monde, acceptation de l’artifice. Les choses sont toutes là, et même déjà-là, présentes, offertes au regard, à la surface du monde et non moins profondes pour autant. Le monde est donné mais insaisissable, sans nature mais inchangeable, inchangeable mais toujours mouvant. Invivable à beaucoup de points de vue, mais de toute façon déjà-mort. Cette vision serait désespérante si elle n’était pas d’emblée désespérée. C’est une vision qui relativise la portée du libre arbitre. Il y a, bien plus qu’un libre arbitre, des compromis entre soi et le monde, entre soi et la maladie (16).
On peut imaginer que Rosset aimerait à se résumer par la phrase suivante : « Je dis les choses comme elles sont ». Mais cela ne serait pas tout dire. Rosset voit les choses noires. Il les voit très exactement comme Louis-Ferdinand Céline : « Dans l’histoire des temps, la vie n’est qu’une ivresse, la vérité c’est la mort (Semmelweis) ». Céline écrivait encore : « L’heure trop triste vient toujours où le Bonheur, cette confiance absurde et superbe dans la vie, fait place à la Vérité dans le coeur humain. Parmi tous nos frères, n’est-ce point notre rôle de regarder en face cette terrible Vérité, le plus utilement, le plus sagement ? Et c’est peut-être cette calme intimité avec leur plus grand secret que l’orgueil des hommes nous pardonne le moins (idem) ». À l’origine de la philosophie de Rosset, il y a cette vision de Louis-Ferdinand Céline, et l’étonnement devant « cette confiance absurde et superbe dans la vie ». Le paradoxe est là : le tragique n’empêche pas la jubilation.
Il y a un mystère du réel puisqu’il est non identifiable, un mystère sans doute proche du mystère de l’allégresse, de la joie, de la félicité sans cause. En tout cas sans autre cause que la coïncidence avec le réel. Car l’allégresse n’est pas seulement un état, une « humeur », c’est un savoir du réel et sur le réel, comme l’est aussi l’ennui, la tristesse, l’acédie, le spleen de Baudelaire. L’amour, parfois mis au dessus de tout, est (et n’est qu’) une allégresse conditionnée. Rosset écrit : « L’amour n’est rien d’autre – rien de plus – qu’un peu de joie s’étant déposé, par hasard, sur un objet quelconque (17) ». C’est pourquoi l’amour est un savoir inférieur à l’allégresse, plus fréquent, plus historique et moins réel.
Il reste enfin à savoir la chose suivante. Si la jubilation possible n’est que temporaire, si, de la vie il ne faut pas trop attendre, une autre chose est sûre : de « ce qui n’est pas la vie » il ne faut rien attendre du tout.
Pierre Le Vigan
Notes
1 : Clément Rosset, Le monde et ses remèdes, P.U.F., 1964 et 2000.
2 : Clément Rosset, Le réel et son double. Essai sur l’illusion, Gallimard, 1984.
3 : Idem, p. 83.
4 : Clément Rosset, Impressions fugitives. L’ombre, le reflet, l’écho, Minuit, 2004.
5 : Maurice Ravel, Trois chansons pour cœur mixte sans accompagnement, 1914-15.
6 : Tanizaki Junichirö, Éloge de l’ombre, Publications orientalistes de France, 1977, 1re éd. 1933
7 : Platon, La République, livre IX.
8 : Clément Rosset, Le principe de cruauté, Minuit, 1988.
9 : Teilhard de Chardin, « La grande monade », dans Propos sur le bonheur.
10 : Céline, Nord.
11 : Clément Rossel, Le principe de cruauté, Minuit, 1988, p. 80.
12 : Mallarmé, Poésies.
13 : Clément Rosset, Le régime des passions et autres textes, Minuit, 2001.
14 : Clément Rosset, Loin de moi. Étude sur l’identité, Minuit, 1999, p. 72.
15 : Clément Rosset, Logique du pire. Éléments pour une philosophie tragique, P.U.F., 1971 et 1993.
16 : Clément Rosset, Route de nuit. Épisodes cliniques. L’infini, Gallimard, 1999.
17 : Clément Rosset, L’objet singulier, Minuit, 1995, p. 105.
• Texte paru en partie dans Éléments, n° 106, septembre 2002, et remanié pour Europe Maxima.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2176
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, clément rosset |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.