Longtemps responsable de la revue Contrelittérature, Alain Santacreu a publié chez Alexipharmaque, sympathique éditeur en Béarn, un étonnant roman (à clé ?) qui se palce dans le sillage de Raymond Abellio et de Jean Parvulesco, Opera Palas. La forme romanesque y est en effet triturée, malaxée, décantée au point de tendre vers l’essai qui ne s’avoue pas !
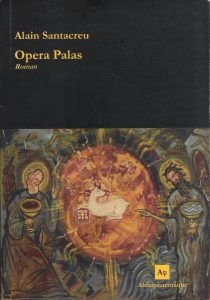 Les personnages de cet essai romanesque (le narrateur travaille sur Opera Palas – belle mise en abyme , le journaliste étatsunien Julius Wood qui fait plus que du journalisme) pratiquent à leur façon l’impersonnalité active. Toutefois, bien que mise en arrière-plan, c’est une œuvre d’art qui focalise l’attention : Le Grand Verre de Marcel Duchamp, aussi connu sous le nom de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Réalisé entre 1915 et 1923 sur du verre (fils de plomb, feuilles et peinture), cette œuvre inachevée et fêlée présente une riche polysémie propice aux interprétations érotiques, psychanalytiques ou ésotériques. C’est dans ce dernier champ qu’intervient principalement Opera Palas.
Les personnages de cet essai romanesque (le narrateur travaille sur Opera Palas – belle mise en abyme , le journaliste étatsunien Julius Wood qui fait plus que du journalisme) pratiquent à leur façon l’impersonnalité active. Toutefois, bien que mise en arrière-plan, c’est une œuvre d’art qui focalise l’attention : Le Grand Verre de Marcel Duchamp, aussi connu sous le nom de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Réalisé entre 1915 et 1923 sur du verre (fils de plomb, feuilles et peinture), cette œuvre inachevée et fêlée présente une riche polysémie propice aux interprétations érotiques, psychanalytiques ou ésotériques. C’est dans ce dernier champ qu’intervient principalement Opera Palas.
Chaque chapitre – il y en a vingt-sept – commence par une lettre de l’alphabet hébraïque. Raymond Abellio rappelait souvent que ces lettres se calculent, d’où la guématrie qu’il pratiquait régulièrement. L’écrivain n’oubliait pas pour l’occasion ses années polytechniciennes. La référence n’est pas inutile. « L’écriture abellienne est une décantation humaine, un processus alchimique qui va transfigurer Soulès en Abellio. Œuvre polymorphe, constituée de romans, d’essais et de mémoires, dont la combinatoire des genres participe d’un processus de purification (p. 199). » Alain Santacreu souligne que Montségur fut sa seule pièce de théâtre. « De son vrai nom Georges Soulès, le romancier avait pris le pseudonyme d’Abellio en référence au dieu solaire celtibère vénéré dans les Pyrénées de ses ancêtres (p. 191). » Si son engagement politique avant 1939 est mentionné au sein de la SFIO parmi les courants les plus marxistes (La Bataille socialiste de Jean Zyromski, puis le Parti socialiste ouvrier et paysan de Marceau Pivert), il n’est pas évoqué que sous l’Occupation il fut proche d’Eugène Deloncle, qu’il milita au Mouvement social révolutionnaire et qu’il se lia avec certains réseaux de résistance. Avec André Mahé, il signa en 1943 La Fin du nihilisme, apologie planiste d’un grand continent autocentré eurafricain.
Action d’écrire
La présence en tête de chapitre d’une lettre hébraïque signifie-t-elle une réhabilitation de l’écrit à un moment où « la lettre a perdu sa substance matérielle et sa relation directe au corps, son tracé sensible qui rassemblait l’œil et la main (p. 21) » ? Interrogation légitime quand on sait que presque plus personne n’écrit à la main d’abord sur une feuille de brouillon un texte long et construit. En saisissant sur le clavier de l’ordinateur ses pensées, il en vient à oublier le frottement de la pointe du stylo sur le papier, le changement régulier des cartouches, les mains salies fréquemment par l’encre… Il en omet même la tenue correcte du stylographe. Dans bien des écoles d’Occident, stylo et papier sont maintenant remplacés par des tablettes numériques, des tableaux interactifs et des écrans digitaux. Jean Cau remarquait que « mon contemporain, lui,“ écrit ” (?) à la machine. Soit ! Mais imagine-t-on Racine écrivant Bérénice, toc, toc, toc, à la machine ? […] Ses doigts volent, légers, sur les touches et, comme il aime le bruit de toutes les mécaniques, le toc toc toc de son engin lui est agréable (Éloge incongru du lourd qui précède Contre-attaques, Le Labyrinthe, 1993, pp. 53 – 54) ». Pour sa part, « je m’ébahis […] d’être ce moine qui écrit à la main, à l’encre (je préfère ne pas connaître sa composition…) sur du papier (même observation), à l’aide d’un lourd stylo à la plume en or 18 carats (Idem, p. 53) ». « Écrire, selon Julius Wood, était une aventure mystique, une quête vers le point de jonction des deux livres, l’intérieur et l’extérieur (p. 12). » Est-ce toujours le cas devant son écran et le clavier ?
Alain Santacreu se préoccupe tout particulièrement du conflit civil espagnol entre 1936 et 1939. « La guerre d’Espagne a ouvert l’ère apocalyptique de la fiction absolue (p. 162). » À l’instar d’Eric Blair alias George Orwell qui comprit sur place les manigances criminelles du communisme soviétique, l’auteur estime qu’« en 1936, en Espagne, le système techno-industriel de l’idéologie libérale a été mis en péril par un mouvement révolutionnaire impulsé par les anarchistes (p. 162) ». Parce qu’« il y a deux nationalismes, l’un civique, égoïste et chauvin, l’autre culturel et universel où s’affirment les qualités intrinsèques d’un peuple (p. 171) », il rêve rétrospectivement d’une alliance révolutionnaire et nationale entre la CNT anarchiste et la Phalange espagnole de José Antonio Primo de Riviera, influencé par les non-conformistes français des années 1930 (la revue L’Ordre nouveau et la « Jeune Droite »), et de Ramiro Ledesma Ramos, père du « national-syndicalisme [qui] se fonde sur un double rejet du capitalisme et du marxisme. Le système démocratique libéral est illusoire car il repose sur la liberté supposée du citoyen soumis à la volonté générale, les techniques de manipulation de l’opinion restant à la dispositions des puissances financières (pp. 168 – 169) ». Cette convergence était-elle plausible ? Un tel rapprochement anarcho-phalangiste aurait modifié l’histoire de l’Espagne. L’hypothèse n’est pas absurde. Anarchisme, phalangisme et même indépendantismes basque et catalan proviennent du même terreau politique, le carlisme dont les foyers de prédilection se trouvaient au Pays basque et en Catalogne. La défense des fueros n’est-elle pas une critique empirique du centralisme et de l’étatisme ainsi qu’un appel (illusoire ?) au sursaut des corps intermédiaires traditionnels ?
Entre Espagne et Russie
Opera Palas expose aussi la grande diversité théorique et géographique de l’anarchisme ibérique tiraillé entre la Catalogne et l’Andalousie d’une part, entre le fédéralisme mutualiste de Proudhon, l’anti-étatisme radical de Bakounine et le communalisme de Kropotkine qu’on retrouve aujourd’hui via l’influence posthume de Murray Bookchin au Rojava kurde en Syrie, d’autre part. C’est avec raison qu’il établit un parallèle entre la révolte de Cronstadt en 1921 et l’épuration de Barcelone en 1937. « Cronstadt voulait faire revivre le mir et l’artel. La révolte anarcho-populiste est dans la lignée des narodniki de la seconde moitié du XIXe siècle pour lesquels la commune rurale et la coopérative ouvrière sont les fondement de la société communiste, le moyen pour la Russie de sauter l’étape du capitalisme et de parvenir par ses voies propres à l’état social parfait. Supprimer le mir archaïque signifiait supprimer des millions de paysans, c’est ce que feront les bolchéviques, par le crime et la famine (p. 253). » Outre l’Espagne, un second tropisme géo-spirituel s’invite : la Russie, en particulier celle d’avant 1917. Comme dans Comment réaménager notre Russie ? (1990) d’Alexandre Soljenitsyne, on devine que « dans l’autocratie, il y a une perspective anarchiste, une aversion pour la politique et pour l’exercice du pouvoir (p. 265) ». D’autres phrases pourraient être d’Alexandre Douguine. « À la base du slavophilisme se trouve l’orthodoxie russe et non la byzantine, distingue Alain Santacreu. L’âme russe est infiniment distincte de l’âme byzantine; en elle, il n’y a ni la malignité, ni l’obséquiosité devant les puissants, ni le culte de l’étatisme (p. 264). » Mieux encore, « contre le bureaucratisme ecclésial, les slavophiles affirment la communion – sobornost – ecclésiale ; à leurs yeux, le peuple est le centre de gravité de l’Église. Ils ne reconnaissent aucun autre chef de l’Église en dehors du Christ. Le tsar est investi des pouvoirs que le peuple lui a confiés (pp. 264 – 265) ». Dans cette perspective bouleversante, l’entente entre Buenaventura Durutti et José Antonio aurait-elle eu des répercussions jusqu’en Russie ? À la chute de l’URSS s’esquissa une association entre les « Rouges » et les « Blancs » brisée nette lors de la crise sanglante d’octobre 1993. En tout cas, « si la Guerre d’Espagne fut la tragédie de notre temps, la deuxième guerre mondiale en aura été le drame et, depuis Yalta, nous sommes tombés dans la farce – une farce sanglante et spectaculaire qui semble s’éterniser ! (p. 199) ».
C’est donc tout le monde actuel qu’il faut remettre en question. L’auteur le pense sans pour autant souscrire aux Protocoles des Sages de Sion, un faux incontestable dont l’énoncé n’en dévoile pas moins une actualité certaine. Complotisme ? Pas du tout, surtout si « le complot pour réussir doit rester ignoré. Il est donc indispensable pour le pouvoir et ses mandarins de le dénier et d’en ridiculiser l’idée, afin de s’assurer son succès et de s’en réserver l’avantage (p. 248) ». Alain Santacreu prend un risque en suggérant que, comme l’avait bien perçu Martin Heidegger, l’esprit hébraïque est l’une des sources de la modernité. « La prépondérance de l’élément juif dans l’essor moderne de la finance remonte au califat abbasside (p. 208). » Le hassidisme, les sabbatéens, les frankistes, les karaïtes, voire « le sionisme [qui] a provoqué l’état de séparation entre l’âme juive et son corps (p. 260) » constituent des adaptations circonstanciées pour ce Golem guère contrôlable qu’est le monde contemporain. Il en ressort une division du judaïsme actuel en trois factions rivales : un mondialisme globalitaire, un sionisme en mutation qui consacre les thèses de Vladimir Jabotinsky, et un organicisme juif traditionnel anti-sioniste. Mais qu’on se rassure ! Toute cela n’est bien sûr que du contre-roman !
On comprendra qu’Opera Palas déroute, agace, étonne. Ne s’agit-il pas finalement d’« une édification gnostique qui s’affirme non seulement comme une incarnation dans l’intériorité, mais aussi comme une tâche historique inscrite dans le destin de l’Occident, son but civilisationnel ultime, à la fois couronnement et négation de son histoire (p. 199) »?
Georges Feltin-Tracol
• Alain Santacreu, Opera Palas, Alexipharmaque, coll. « Les narratives », 2017, 300 p., 19 €.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Les commentaires sont fermés.