jeudi, 13 février 2025
Terroristes et commanditaires. Quelques questions gênantes
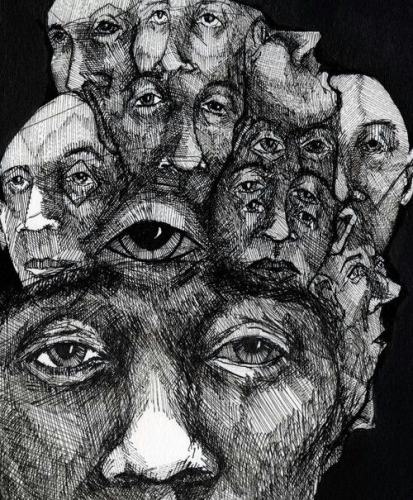
Terroristes et commanditaires. Quelques questions gênantes
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/terroristi-e-mandanti-qualche-domanda-scomoda/
On parle, peut-être trop, des « terroristes ». Des terroristes islamistes, ou jihadistes pour ceux qui ont une certaine familiarité, même confuse, avec cette terminologie.
On brandit ce spectre de manière répétée et cyclique, comme un épouvantail ou une menace pour l’ordre mondial.
Cependant, il me semble qu’à force de tant en parler, quelque chose manque toujours dans le récit. Quelque chose d’important, voire de fondamental. Sans cela, comprendre ce phénomène (appelons-le ainsi) devient très difficile. Ou plutôt, impossible.
Car si le soi-disant terrorisme jihadiste provient bien de certaines franges, plus ou moins répandues, du monde islamique, il est tout aussi indiscutable qu’il faudrait se poser quelques questions sur ceux à qui ce terrorisme profite.
En somme : Cui prodest ?
C’est la question essentielle à laquelle il faut répondre si l’on veut comprendre ce phénomène. Et ne pas se contenter de le condamner ou, pire encore, de s’en étonner et de s’en horrifier, comme une sorte d’Alice gothique au pays des merveilles.
Se demander à qui ce terrorisme profite implique une autre question: Qui le finance, l’alimente, le protège? En substance, qui l’utilise ? Et dans quel but?
Il n’est pas facile d’y répondre. D’autant plus qu’on ne peut pas lire toutes les situations comme si elles étaient une seule et même chose.

Les États-Unis ont incontestablement combattu Daech et, peut-être surtout, Al-Qaïda sur certains théâtres d’opérations. Par exemple en Afghanistan, du moins au début. Et de manière plus ambiguë en Irak.
Cependant, cet engagement a été assez… inégal. Il y a eu des zones d’ombre et de lumière. D’autant plus que l’objectif de Washington en Irak n’était pas d’éradiquer l’islamisme radical, mais de provoquer un changement radical de régime. Éliminer Saddam Hussein et son système de pouvoir.
Saddam était peut-être un tyran, je ne dis pas le contraire. Mais il est certain que son régime était une dictature laïque, farouchement opposée aux islamistes radicaux. Or, ce sont justement ces derniers qui ont tenté de prendre le dessus après sa chute, entraînant une réaction américaine.
Mais il convient de rappeler que la défaite de Daech en Irak est avant tout due à l’Iran. À l’intervention du général Soleimani, chef des forces Al-Qods, qui fut ensuite éliminé, autrement dit assassiné, par les Américains. Sans déclaration de guerre.
Cela, pour être précis. Sans aucun parti pris.
Un point doit être clairement établi. Les chiites ne sont pas, par formation culturelle et tradition, des jihadistes radicaux. Au contraire, ils se sentent généralement menacés par ces groupes, issus des courants les plus extrêmes du sunnisme. Et ils les combattent, comme ils l’ont fait en Irak.
Toutefois, il est vrai que dans certaines circonstances, l’Iran chiite a soutenu des groupes islamistes radicaux. Le cas le plus significatif étant celui du Hamas dans la bande de Gaza.
Compliqué, n’est-ce pas ? Difficile de démêler tout cela et, surtout, de s’orienter dans ce labyrinthe. D’autant plus qu’une certaine propagande, volontairement simpliste, cherche à nous faire croire que l’islamisme radical est promu par Téhéran.
Ce qui est tout simplement un mensonge.
D’ailleurs, si l’on observe le monde islamique, on constate que les formes les plus radicales et violentes du jihadisme proviennent du monde sunnite. Certes, de certaines franges extrêmes. Mais celles-ci trouvent souvent protection et refuge dans la péninsule arabique. En Oman et surtout en Arabie saoudite. Où, soit dit en passant, les chiites – probablement majoritaires – sont persécutés et privés de droits.
Ceci est un fait. Sans aucune appréciation de valeur. Juste un élément nécessaire à l’établissement de la vérité.
Et en Égypte se trouve la grande université d'Al-Azhar, d’où sont issus de nombreux idéologues et chefs du jihadisme. Réprimés en leur temps par Nasser, Sadate et, enfin, Moubarak. Puis propulsés au pouvoir par une révolution, curieusement « colorée ». Certains se souviendront peut-être de l’accueil réservé à l’époque au président Obama dans cette grande université, qui faisait la promotion du jihad islamique.
Puis est arrivé Al-Sissi. Qui a remis les choses en ordre, à sa manière.
Pour simplifier : le terrorisme jihadiste, d’origine radicalement sunnite, constitue un problème avant tout dans le monde islamique.
Mais uniquement dans le monde islamique.
Car il n’a jamais constitué une véritable menace pour l’hégémonie américaine ou pour son allié israélien. À l’exception, peut-être, de Daech à son apogée. Et, encore peut-être, d’Al-Qaïda et des talibans en Afghanistan à certaines périodes.
Certes, il y a eu des attentats, parfois sanglants, en Europe. Surtout en France et au Royaume-Uni. Mais au Moyen-Orient, le jihadisme n’a jamais représenté un problème majeur pour Israël ni, surtout, pour l’hégémonie américaine. Il a même souvent été utilisé pour contrer les tentatives de Téhéran d’exporter le modèle de la Révolution iranienne.
Comme je le disais : un labyrinthe. Une réalité extrêmement complexe, qui mérite une lecture attentive. Sans simplifications qui ne servent qu’à dissimuler de la propagande partisane.
20:52 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terrorisme, terrorisme islamiste |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.