lundi, 11 août 2025
Ismail Kadare (1936-2024) – nécrologie

Ismail Kadare (1936-2024) – nécrologie
Konrad Markward Weiß
Source: https://sezession.de/59634/ismail-kadare-ein-nachruf
L'écrivain albanais Ismael Kadare est décédé l'an passé à Tirana. En août 2017, Konrad Markward Weiß avait rédigé pour le 79ème numéro de la revue Sezession un portrait de cet auteur exceptionnel qui mérite d'être lu. Nous le republions ici en hommage à Kadare.
C'était une ville étrange, qui semblait avoir surgi soudainement dans la vallée comme une créature préhistorique par une nuit d'hiver, puis s'être blottie contre le flanc de la montagne après avoir gravi péniblement ses pentes. Tout dans cette ville était vieux et de pierre [...]. Difficile de croire que sous cette carapace solide, la chair tendre de la vie bouillonnait et se renouvelait: elle donna naissance en 1936 à Ismail Kadare, aurait-on envie d'ajouter à la préface de sa Chronique en pierre, dans laquelle le plus grand écrivain albanais rend hommage à sa ville natale, Gjirokastra. C'est là qu'il découvre la mythologie grecque et Macbeth, et commence à écrire à l'âge de onze ans ; la maison familiale, avec ses nombreuses pièces vides, devient le terrain de projection de son imagination.
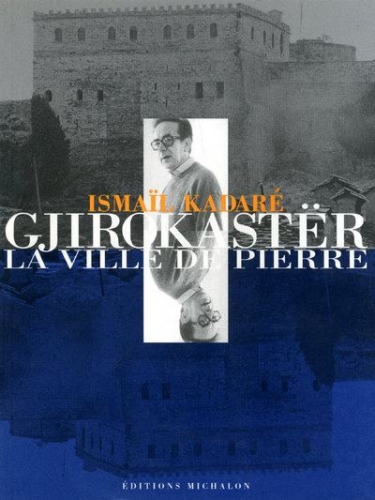
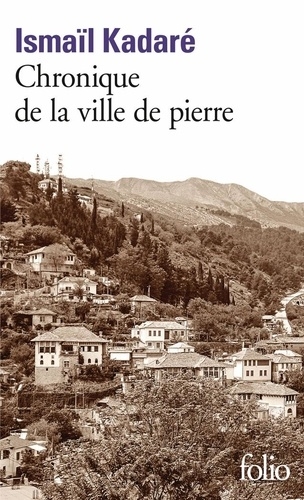
On trouve déjà ici les éléments décisifs de l'œuvre de Kadare : les aspects meurtriers de l'État, la terre natale intemporelle, considérée comme une sorte d'être vivant et donc comme une transition fluide entre la matière morte et le monde des vivants, les mythes et les fantômes : tous se retrouvent dans Qui a ramené Doruntine?. C'est le cœur lourd qu'une mère marie sa fille unique loin de chez elle. Son fils Konstantin donne sa parole d'honneur de ramener sa sœur à la maison si leur mère en a besoin ; étrangement pâle et couvert de boue, il ramène effectivement Doruntina devant la maison familiale des années plus tard.
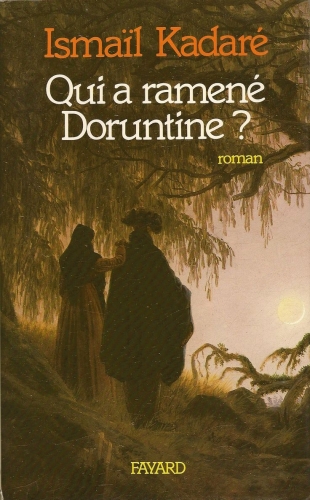
C'est seulement là que la mère, horrifiée, lui révèle que ses neuf frères sont morts depuis longtemps. Konstantin est sorti de sa tombe pour tenir sa parole ; la Besa albanaise, qui doit désormais assurer la survie de la nation en tant qu'essence et refuge.
Car la tempête redoutée éclate et une première puissance mondiale s'abat sur la petite Albanie avec l'Empire ottoman. Comme dans ses romans écrits plus tard, qui traitent de confrontations avec l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique et la Chine communiste, l'œuvre de Kadare se concentre sur la lutte séculaire contre les Ottomans et sur l'identité propre, « le développement de cette confrontation identitaire entre les Albanais et les autres » (M. Marku).
À nos pieds s'étendait l'Asie avec son mysticisme et ses cruautés. Nous regardions cette mer sombre et nous avons compris que c'était leur monde, leur mode de vie, qu'ils voulaient nous imposer avec les chaînes de l'esclavage.
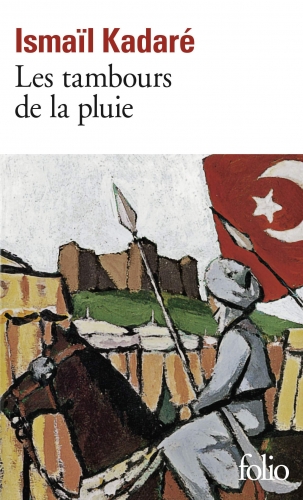
Dans Les tambours de la pluie, des assiégés anonymes commentent laconiquement les événements qui se déroulent devant leurs murs, tandis que la machine de guerre turque est représentée dans une somptueuse palette de couleurs. Des formations de plus en plus élitistes, jusqu'aux Serdengetschti, qui ne sont pas autorisés à revenir vivants après un assaut infructueux, sont lancées par le pacha de plus en plus désespéré contre la forteresse sous « l'effrayant drapeau à l'oiseau noir à deux têtes », lui-même constamment harcelé par le héros national albanais Skanderbeg, « qui erre comme un esprit maléfique à travers les montagnes ».
L'Empire ottoman, sur lequel Kadare s'acharne dans de nombreuses œuvres, n'est pas toujours représenté de manière historiquement exacte, mais plutôt comme un « prototype de super-empire » (Joachim Röhm) afin de révéler des schémas fondamentaux – ceux des hommes et du Léviathan.
Cette Albanie éternellement rebelle – « la mère patrie du mécontentement », comme le note Kadare non sans fierté – revient sans cesse dans les colonnes interminables de soldats du padischah, précédés d'épouvantails en signe de mépris pour les insurgés ; mais elle est encore plus sinistre après la guerre : Avec l'état d'urgence ou « terre de malice », « fondé sur l'idée d'une fragmentation totale : religieuse, régionale, féodale, selon les castes, les coutumes et les traditions » – et par la dénationalisation ou Krakra.
L'appauvrissement planifié de la langue, qui finit par perdre toute capacité à « donner naissance à des poèmes, des légendes et des récits » (et donc au moindre germe de rébellion), évoque clairement la novlangue d'Orwell.
Mais les Albanais ont réussi à sauver leur patrie et leur nation, « des mots derrière lesquels se cachaient toujours des menottes », même après quatre siècles de domination étrangère sans État propre, sans doute aussi en recourant aux « structures internes » mentionnées plus haut, que Kadare introduit avec le mot d'honneur Besa, qui constitue à son tour le pivot du droit coutumier albanais, le Kanun, encore en vigueur aujourd'hui pour une partie.
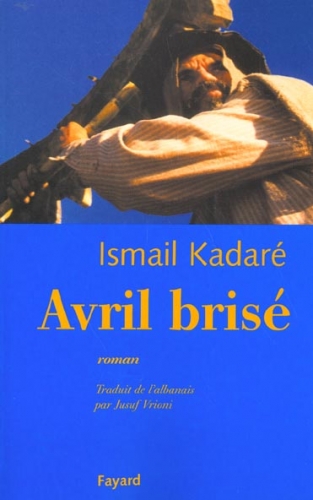
Celui-ci est moins connu pour ses normes de droit civil que pour celles relatives à la vendetta, qui développent une sombre fascination dans Avril brisé – et où le caractère pragmatique et peu dramatique de tous les protagonistes d'une querelle, « une histoire assez banale avec vingt-deux tombes de chaque côté », est bouleversant, tout comme la nomenclature pertinente: ceux qui donnent leur sang et ceux qui le prennent portent un ruban noir, « marqués pour la mort comme des arbres destinés à être abattus » ; après l'obligation incontournable d'assister aux funérailles et au repas funèbre de sa victime, alors qu'il est son ennemi juré, Gjorg doit encore payer l'impôt du sang avant de commencer sa « vie de chauve-souris » dans l'une des innombrables tours de fuite, dans la tour du prince d'Orosh, auprès de son « administrateur du sang ».
L'univers de Kadare, et en particulier son empire ottoman en partie dénaturé, ne manque vraiment pas de personnages, de symboles et d'institutions sinistres : ainsi, même ses desserts traditionnels peuvent être synonymes d'estime ou de malheur, comme le « baklava brûlé que l'archevêque des Arméniens a reçu peu avant le pogrom dévastateur contre son peuple » ; le palais kafkaïen des rêves, quant à lui, a pour mission « le tabir total », c'est-à-dire l'enregistrement et l'interprétation des rêves de tous les citoyens sans exception.
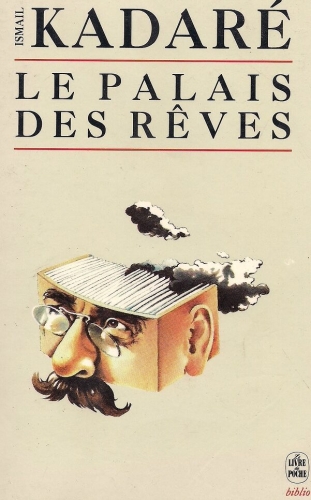
D'innombrables Albanais ont fait carrière au service de la Sublime Porte, grâce à la sélection des jeunes garçons et au-delà: «Aucune autre nation n'avait donné autant de pachas, d'amiraux et de vizirs à l'Empire que ce peuple lointain des Balkans». Mais à la veille de la Première Guerre mondiale, celle-ci échappe définitivement à « l'homme malade du Bosphore », pour se retrouver dans des décennies marquées par les douleurs de la naissance, jusqu'à ce qu'après de nombreux changements de régime, de nouveaux occupants et une autre guerre mondiale, l'une des plus anciennes nations d'Europe accède enfin à une indépendance durable – malheureusement sous la forme d'une dictature communiste.
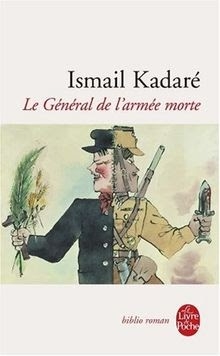
Le Général de l'armée morte traite des longues séquelles de la Seconde Guerre mondiale, dont les sinistres fouilles font grossir les rangs de ses troupes – « sauf qu'au lieu d'être en uniforme, ils sont maintenant dans des sacs en nylon ».
La noirceur de cette œuvre, avec laquelle Kadare « sans être particulièrement audacieux, avait marqué une « petite dissidence », contraste fortement avec le réalisme socialiste qui lui avait été inculqué à l'Institut Gorki de Moscou ; mais la lecture précoce de Shakespeare et des classiques grecs l'avait « déjà immunisé », tout comme le grand succès du Général, notamment à l'étranger, contre la critique (littéraire) officielle dans son pays – autour de laquelle tourne toujours l'œuvre colossale de Kadare, avec toute sa métaphorique et sa validité universelle, en tant que chroniqueur.
L'« auteur patriote inébranlable » « reprend une mission ancestrale de l'épopée [...], celle de représenter les grandes questions de survie de la nation dans l'image littéraire et d'agir sur la collectivité en tant qu'interprète et fondateur d'identité » (Karl-Markus Gauß dans le Süddeutsche Zeitung). Pendant des années, Kadare a qualifié l'appartenance du Kosovo à la Serbie de « scandale qu'au milieu de l'Europe, un peuple vive sous domination coloniale », après la sécession de celui-ci, il a évoqué le désir de réunification avec l'Albanie.
Rares sont les descriptions qui ne citent pas un critique – sans doute l'un des plus beaux reproches que l'on puisse faire à un écrivain, surtout à un patriote indéfectible : « Quand il s'agit de sa nation, Kadare est aussi aveugle qu'Homère. » Ce dernier objecte « que le nationalisme ne signifie pas aimer son propre peuple, mais ne pas supporter les autres ». Son traducteur allemand et confident de longue date, Röhm, nie « la moindre nuance chauvine » chez Kadare, qui aurait au contraire « constamment souligné l'appartenance européenne » de l'Albanie et « défendu avec ferveur la poursuite de son européanisation ».
Cependant, et malgré les objections de Röhm, dont le parcours politique haut en couleur l'a conduit des cadres du KPD à la tentative d'importation des idées de Hoxha en RFA, jusqu'à la réinterprétation politiquement correcte – parfois à la limite de l'interprétation – de l'œuvre de Kadare : dans plusieurs déclarations parfois sensationnelles, il considère que son pays et son peuple ont été temporairement retirés à l'Europe par l'occupation ottomane qui a duré des siècles et qu'ils ont été méprisés par celle-ci, qui les considérait comme des Turcs des Balkans.
Lorsque Kadare réclame avec véhémence une « européanisation » de l'Albanie, cela n'a donc pas grand-chose à voir avec un abandon de l'identité nationale au profit d'une identité européenne floue, mais plutôt avec la défense de son identité propre et, en particulier, avec une démarcation par rapport à l'identité islamique et proche-orientale qui lui a été imposée ; car « faire disparaître l'identité albanaise et européenne », selon Marku, « les conquérants ottomans s'étaient énormément épuisés ».
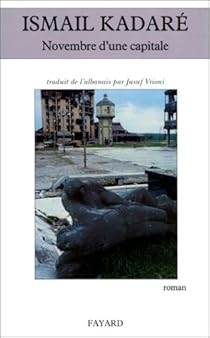
C'est un retour aux traditions albanaises préislamiques que Kadare réclame et qui, comme mentionné plus haut, ont déjà assuré la survie de la nation. Bien que sa famille appartienne de jure à l'islam, on ne trouve dans son œuvre pas la moindre sympathie pour cette religion, bien au contraire. De Novembre d'une capitale où « la voix du muezzin, empreinte de la tristesse islamique, fait penser au désert arabe » à l'essai « L'identité européenne des Albanais » : La Turquie actuelle tente, avec l'aide de la religion islamique, de diviser le peuple albanais le long des lignes de fracture religieuses et, par la suite, de le coloniser culturellement et économiquement – pour la deuxième fois. Kadare, quant à lui, qualifie le christianisme de « fondement spirituel et culturel » de sa nation.
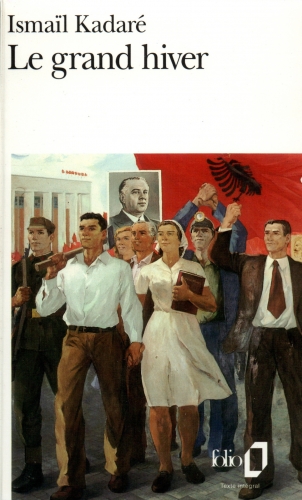
Dans deux romans épiques, Le Grand Hiver et Concert à la fin de l'hiver, Kadare décrit la vie quotidienne dans l'Albanie communiste et ses luttes avec l'Union soviétique et la Chine ; à la fin, les Albanais rebelles, « auxquels les Allemands, pour attiser encore davantage leur fierté, avaient attribué les caractéristiques d'une race supérieure », se retrouvent dans une situation plus proche de la misère nord-coréenne que d'une splendide isolation. Dans des scènes fantomatiques telles que la « nuit des limousines noires ZIM », dont le cortège de fonctionnaires communistes est censé ramener le petit État à la raison, l'auteur retrace la rupture de 1960/61 entre les Albanais staliniens invétérés et l'URSS « en dégel » de Khrouchtchev.
Contrairement aux œuvres « ottomanes », qui lui permettaient d'écrire de manière voilée sur le communisme sous le communisme, Kadare, dans une interprétation bienveillante, attaque ici de front l'idéologie – mais toujours uniquement en ce qui concerne ses insuffisances ailleurs ; le bouclier d'honneur de l'Albanie reste pur, et « c'est eux qui ont commencé ».
Le sanguinaire Hoxha apparaît comme un père de la nation sévère mais invincible ; plus tard, Kadare le fait frissonner de manière théâtrale au souvenir des méfaits d'un complice auquel – encore Orwell, selon le modèle Goldstein/Trotski – toute la faute est imputée, alors qu'il n'était en fin de compte qu'un simple rival dont les crimes devaient être largement surpassés par ceux du vainqueur. La description impitoyable de l'ancienne bourgeoisie, des « déclassés » déjà humiliés et privés de leurs droits, sous forme de caricatures larmoyantes et grotesques, contraste fortement avec l'image du héros du roman qui, après avoir traversé maints périls, est enfin « prêt à porter la couronne d'épines de la révolution ».
En 1988, c'est la Chine à la fin de l'ère Mao dont Kadare retrace la terreur d'État et la lutte contre la culture, et fait dire au grand président qu'il les balayera […] : le président Cervantes, le prince Beethoven, le généralissime Shakespeare, le comte Tolstoï.
À cette époque, Kadare avait déjà derrière lui des décennies d'un « jeu mortel du chat et de la souris » (S. Guppy) avec le régime, suivies de reproches parfois amers d'une trop grande proximité avec celui-ci. Cinq de ses livres avaient été interdits, la censure était intervenue d'innombrables fois, mais sa position exceptionnelle, due notamment à son succès international, lui avait permis de réécrire lui-même les passages incriminés.
À la provocation permanente que constituait le mépris quasi constant de Kadare pour les principes du réalisme socialiste s'ajoutait le courage considérable d'avoir écrit des paraboles sur les États totalitaires sous une dictature stalinienne – tout en étant un haut dignitaire et fonctionnaire de celle-ci. Contrairement à d'autres régimes comparables, il n'y avait cependant pas de dissidents en Albanie, ou seulement dans la clandestinité, dans les mines où ils étaient réduits à l'esclavage ou dans des tombes creusées trop prématurément.
Mais là encore, même en 1990, Kadare déclarait encore, selon Thomas Kacza, « qu'après la libération, la censure n'avait jamais existé en Albanie et n'existait toujours pas, ce qui fait honneur à notre État socialiste ».
Leur héroïsme n'a aucune importance pour l'évaluation de l'œuvre des écrivains, surtout lorsque le chemin vers le martyre n'était pas très long.
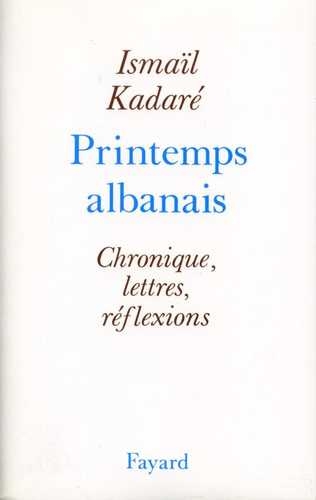
Cependant, comme le dit même le fidèle traducteur Röhm, « les écrivains ne sont pas toujours les interprètes les plus intelligents d'eux-mêmes » ; au lieu de répondre, entre autres dans Printemps albanais, à des accusations en partie haineuses par des auto-stylisations en partie embarrassantes, il aurait sans doute été plus judicieux de laisser l'œuvre parler d'elle-même, même si elle a été rédigée en partie post festum: la contrainte permanente, menant à la destruction totale, de s'accuser soi-même et d'accuser les autres, dans le bouleversant La fille d'Agamemnon, ou encore dans ce même ouvrage, le personnage de Qeros, qui doit, à chaque croassement, donner « des morceaux de sa propre chair » à l'aigle insatiable qui doit le transporter des ténèbres vers le monde supérieur, afin de ne pas être « irrémédiablement précipité dans l'abîme » par le « monstre d'État avec l'oiseau de proie dans ses armoiries ».
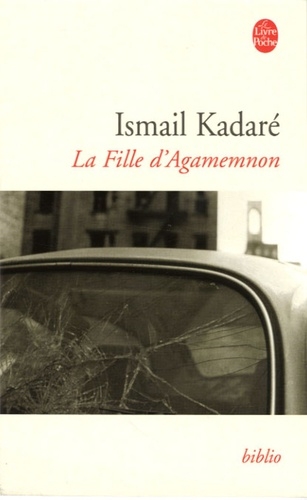
Le monde de Kadare n'est pas un havre de bonheur – cependant : « La littérature n'a rien à voir avec le bonheur ; je ne connais aucune œuvre de la littérature mondiale où l'on puisse le rencontrer. » Sa œuvre, traduite dans plus de 40 langues, est sans aucun doute une œuvre littéraire mondiale intemporelle, particulièrement appréciée en France, où Kadare réside depuis des décennies, parallèlement à l'Albanie, et où il est membre de la Légion d'honneur depuis 2016. La conclusion, qui est aussi celle de son roman Le successeur, est signée par l'écrivain lui-même ; elle réunit avec force ses leitmotivs récurrents, notamment la référence à sa ville natale, qu'il partage avec le dictateur, et est mise dans la bouche de tous les tyrans : « Nous ne connaissons ni la prière ni le pardon, alors ne songez pas à allumer des bougies pour nos âmes. Gardez vos prières pour quelque chose de mieux. » Priez plutôt pour que nous ne découvrions pas un soir, dans l'espace noir où nous errons perdus, les lumières lointaines de la Terre et que, comme des meurtriers que le hasard ramène devant le village où ils sont nés, nous disions: "Oh, regarde, voilà la Terre ! Car alors, nous pourrions revenir vers vous, à votre grand malheur, le visage masqué, les mains encore ensanglantées, sans remords, sans pardon, sans consolation".
17:24 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ismail kadaré, littérature, albanie, littérature albanaise, lettres, lettres albanaises, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.