mercredi, 28 février 2007
Le siècle des guérillas selon G. Chaliand

A lire sur: http://www.geostrategie.com/
Gérard Chaliand/ Marion Van Renterghem
Le siècle des guérillas
Pour Gérard Chaliand, spécialiste des conflits armés, les guerres asymétriques entre grandes puissances et forces non conventionnelles vont se multiplier. Les armées n’y sont pas préparées.
06:30 Publié dans Défense, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Charles IV, Duc de Lorraine: cauchemar de Richelieu
Laurent SCHANG :
Charles IV, Duc de Lorraine: le cauchemar de Richelieu
Trouvé sur : http://theatrumbelli.hautetfort.com/
 Glorieuse et apaisée. C’est en ces termes que le Père Wilhelm, dans son Histoire abrégée des Ducs de Lorraine (terminée de rédiger en 1735), conte la mort, survenue trois quarts de siècle plus tôt, de Charles IV de Lorraine et de Bar, de très noble et antique lignée.
Glorieuse et apaisée. C’est en ces termes que le Père Wilhelm, dans son Histoire abrégée des Ducs de Lorraine (terminée de rédiger en 1735), conte la mort, survenue trois quarts de siècle plus tôt, de Charles IV de Lorraine et de Bar, de très noble et antique lignée.
Comme le comédien rêvait de mourir sur scène, Charles IV expira sur son lit de camp, dans sa douzième campagne, au quatorzième jour du cinquième mois de sa soixante et onzième année, son fidèle tambour ruisselant de larmes à ses pieds.
Lorsque, soulevant le lourd brocart, le chirurgien général parut hors de la tente, sa perruque à la main, tous comprirent que l’âme de leur seigneur et duc s’en était retournée vers Dieu. Alors la plaine résonna d’une même plainte et dix mille Lorrains s’agenouillèrent pour demander pardon.
Une dernière salve, puis l’instrument se tut. L’enfant avait crevé la peau du tambour.
Ainsi s’acheva la vie courtoise et picaresque du chevalier Charles de Vaudémont, duc de Lorraine, descendant en ligne directe de l’Empereur Charlemagne et de Godefroy de Bouillon, le 18 septembre 1675, consacré depuis date de grande affliction pour les défenseurs des libertés ducales.
La dépouille, encore toute auréolée de l’écrasante victoire remportée le 11 août à Consarbrück, non loin de la ville de Trèves, contre l’armée du roi de France, sous le commandement du présomptueux maréchal de Créqui, fut prestement embaumée et ramenée à Nancy.
Destin de reître que celui de cet aristocrate, promis à briller dans les meilleures cours d’Europe, et qui voua sa vie et sa fortune à contrecarrer les plans hégémoniques de la couronne de France sur tous les champs de bataille du continent.
Fils né le 5 avril 1604 de François de Lorraine-Vaudémont et de Chrétienne de Salm, Charles va prendre une part active à tous les événements d’un siècle agité par les appétits de conquête et l’émergence, sur fonds de guerre religieuse, d’une idée nouvelle : les frontières « naturelles » des Etats. S’il rechigne à l’étude, le garçon montre tôt des dispositions de bretteur et de cavalier, de même qu’un goût prononcé pour l’art de la guerre, qu’il saura mettre à profit le moment venu.
Sa majorité seigneuriale acquise, Charles monte sur le trône de Lorraine. L’historien Christian Bouyer nous brosse le portrait du jeune souverain : « Agé de vingt-trois ans, Charles IV est un personnage orgueilleux, insouciant, étourdi et brouillon. Au physique, c’est un homme d’une taille élancée, avec un visage osseux, une abondante chevelure blonde et ‘‘un nez flairant loin’’. Malgré une éducation incomplète, le duc possède certaines qualités : c’est un excellent cavalier qui aime l’exercice au grand air, il est aussi un beau parleur qui ne néglige pas les choses de l’esprit. » (in La duchesse de Chevreuse, Pygmalion, 2002)
Une autre de ses qualités, et non des moindres, est sa fidélité. Fidélité intangible au Saint Empire romain germanique. Fidélité à la parole donnée à ses sujets lors du sacre, en la chapelle des Cordeliers. Fidélité enfin au parti catholique, dont il s’érige en champion.
Aussitôt, la guerre de Trente Ans le jette dans la mêlée européenne.
Ses détracteurs posthumes auront beau jeu de lui reprocher son entêtement à refuser le retournement d’alliance offert par Louis XIII, sur les conseils de son Premier ministre, le cardinal de Richelieu. Rarement l’adjectif machiavélique convint davantage à un homme d’Etat. Depuis Louis XI, le royaume de France convoite le duché, à la fois passage obligé vers la riche Alsace, Strasbourg et le Rhin qui la borde, et obstacle intolérable dans sa politique du Pré carré. Or, Charles IV ne cache pas ses ambitions d’intercesseur dans le conflit qui déchire l’Europe rhénane. Le cardinal, que hante le souvenir des ducs de Guise et leurs intrigues – des Lorrains eux aussi – tient son prétexte.
Quarante années durant, dont vingt à cheval et en armure, Charles IV va défendre bec et ongles l’indépendance du duché. Prenant la longue route de l’exil à la tête de son armée pour soutenir la maison d’Autriche. N’hésitant pas à abdiquer en faveur de son frère Nicolas-François afin que la famille ducale ne soit pas inquiétée.
L’époque, le « Grand Siècle » comme on l’appellera plus tard, est à la rouerie, la duplicité diplomatique. Charles IV évolue dans ce monde de faux semblants en grand capitaine de compagnie. Quand il ne franchit pas le Rhin pour reprendre Nancy, il chevauche du Palatinat jusqu’aux Flandres et porte secours aux Impériaux.
De siège interminable en bataille rangée, sa témérité, sa crâne attitude sous la mitraille stupéfient les chroniqueurs. De Lisbonne à Moscou, les cours d’Europe s’enthousiasment au récit de ses exploits. Charles n’est pas homme à diriger ses troupes à bonne distance du feu ennemi. Piétinée par les Suédois, occupée par les Français, ravagée par les Croates, la Lorraine moribonde renaît partout où se dressent ses couleurs : « Etendard à fond jaune, traversé d’une croix rouge. Au centre, l’écusson ovale de Lorraine surmonté d’une couronne ducale ; à chaque angle une croix à double croisillon. » (M. Dumontier)
En 1638, déferlant du Luxembourg, il réussit un temps à chasser l’armée royale du pays. Un camouflet pour Louis XIII et une humiliation personnelle pour Richelieu, qui désormais, jusqu’à sa mort, va poursuivre Charles IV d’une haine vengeresse. Par tous les moyens, « l’âne rouge », ainsi que le surnomme Charles, va tâcher d’attenter à la vie de son irréductible ennemi. Des tentatives d’assassinat, d’empoisonnement par lettre dont les mémorialistes tiendront le registre détaillé. Le cardinal botté et caparaçonné du siège de La Rochelle s’avère bien digne du sinistre personnage dépeint par Alexandre Dumas dans Les trois mousquetaires.
Le 5 août 1643, tandis que les foudres cardinalesques se déchaînent contre le malheureux duché, Charles IV défait encore de belle manière Turenne et le Grand Condé à la bataille de Fribourg. Mais en cette vingt-cinquième année de guerre ininterrompue en Europe, les gazettes se passionnent d’abord pour ses péripéties amoureuses.
Charles IV a épousé Nicole de Lorraine en 1621. Son titre, il le doit à Nicole. Cela ne l’empêche pas en avril 1637 de contracter secrètement mariage avec Béatrix de Cusance, veuve de François-Thomas de Cantecroix, sa maîtresse.
Le prince des Ligueurs, bigame ! Excédé, le Pape Urbain VIII finit par excommunier Charles le 13 avril 1642. Les Lorrains, pourtant fervents catholiques, ne lui en tiendront pas rigueur, bien au contraire, qui continueront à acclamer Béatrix comme leur seconde duchesse. Il est vrai qu’à la différence de Nicole, la belle accompagne le duc Charles dans toutes ses expéditions militaires.
En 1648, le subit mouvement de Fronde qui succède au traité de Westphalie redonne à Charles l’espoir de reconquérir son duché. Il caresse même l’idée grandiose d’assiéger Paris. Mais ses talents de négociateur révèlent bientôt leurs limites et Charles, abandonné par les Impériaux, doit rebrousser chemin.
D’autres aventures l’attendent ailleurs. Contraint à un nouvel exil en 1654, sous la poussée des armées françaises, Charles IV est arrêté par les Espagnols ses alliés le 25 février et envoyé sous forte escorte à Tolède. La trahison scandalise jusqu’au Pape. Libéré en 1659, il ne fait son entrée à Nancy qu’en 1663, sous la protection, ironie de l’Histoire, de Louis XIV.
L’idylle cependant ne dure pas. Le roi de France accorde certes aux Lorrains le droit de tenir cour, de légiférer, mais Charles est empêché de commander et toute politique étrangère lui est interdite. Convaincu de conspiration en 1670 par un Louis XIV qui prépare l’invasion de la Hollande et a besoin pour ce faire de garantir la paix sur ses marches, Charles IV prend la fuite à l’arrivée des mousquetaires puis rejoint le camp des Impériaux. Sa dernière campagne commence.
Laurent SCHANG
-------------------------------------------------
Charles IV en quelques dates :
•5 avril 1604 : naissance de Charles IV
• avril 1637 : Charles IV épouse en secret Béatrix de Cusance, sa maîtresse.
• 13 avril 1642 : le pape Urbain VIII l’excommunie.
• 5 août 1643 : Charles IV bat à plate couture Turenne et le Grand Condé à la bataille de Fribourg. Richelieu fait raser les villes fortifiées qui jalonnent les frontières sud et ouest du duché.
• 1645 : Charles IV arme le navire « L’Espérance de Lorraine » pour venir en aide aux Irlandais insurgés.
• 1648 : signature du traité dit de Westphalie. La Lorraine sort de la guerre dépeuplée aux deux tiers, sa population décimée par les pillages, la famine et la peste.
• 25 février 1654 : Charles IV est arrêté par les Espagnols et envoyé en détention à Tolède.
• 1663 : Charles IV rentre à Nancy.
• 1665 : Charles IV épouse Marie-Louise d’Apremont, de très loin sa cadette.
• 1670 : Charles IV s’enfuit de Nancy et rejoint le camp des Impériaux en Hollande.
• 11 août 1675 : victoire de Charles IV à la bataille de Consarbrück
• 18 septembre 1675 : mort de Charles IV. Enterré en l’église de la Chartreuse de Bosserville, au sud de Nancy, sa dépouille ne sera pas transférée dans le caveau ducal de la Chapelle des Cordeliers avant 1823.
-------------------------------------------------
A lire également :
Henry Bogdan, La Lorraine des ducs – Sept siècles d’histoire, Perrin, 2005.
06:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Coopération Russie/Amérique latine
Russie-Amérique latine : coopération dans les sciences, les techniques et l’innovation
trouvé sur: http://www.geostrategie.com/
Parmi les priorités majeures de la politique extérieure de la Russie figure l'intensification du dialogue politique et de la coopération économique avec les Etats d'Amérique latine. Cela s'explique par le volume important du marché latino-américain, les possibilités élevées de livraison aux pays de cette région de produits russes de haute technologie et de services, ainsi que par les positions de leader occupées par les pays latino-américains sur des marchés mondiaux des matières premières agricoles et de l'agroalimentaire.
Globalement, les perspectives de la coopération économique entre la Russie et les pays d'Amérique latine sont bonnes. Le commerce avec l'Amérique latine représente aujourd'hui environ 4 % de l'ensemble des échanges extérieurs de la Russie, et ce chiffre pourrait parfaitement doubler, voire tripler. Avec le Brésil, par exemple, les échanges bilatéraux atteignent dès à présent les 3 milliards de dollars. A l'époque soviétique, le record avait atteint 835 millions de dollars, mais il n'avait tenu à ce niveau qu'en 1983. Toutefois, à l'époque, 60 % des exportations étaient constituées par des machines et biens d'équipement. Aujourd'hui, les 3/4 des livraisons russes à destination du Brésil, de l'Argentine et du Mexique sont constituées par des engrais minéraux. Il n'y a qu'avec Cuba que le volume des équipements dans la balance commerciale soit assez élevé. Mais il s'agit, pour l'essentiel, de pièces pour des matériels achetés à l'époque de l'URSS.
La coopération dans le secteur de l'innovation n'est à l'évidence pas assez développée. Elle est même tout simplement absente depuis des années avec certains pays. Le Chili et le Pérou, par exemple, donnent une liste des 25 pays qui sont les plus gros investisseurs dans leur économie. La Russie n'y figure pas. Il en va de même pour le Mexique : il y a bien des investissements russes, mais ils sont très faibles. Les axes de coopération les plus prometteurs de la Russie avec les pays latino-américains sont les matières premières énergétiques, les combustibles, l'énergie, la métallurgie, l'industrie chimique et pétrochimique, les constructions mécaniques, le transport et l'agro-industriel.
Dans le secteur des hautes technologies, il convient de noter la coopération dans le secteur spatial. Des satellites mexicains, chiliens et argentins sont lancés à l'aide de fusées russes. Un cosmonaute brésilien a effectué un vol dans l'espace à bord d'un vaisseau russe Soyouz, et l'on est en train de réaliser un programme de création, d'après un projet russe, d'un polygone de tir moderne sur le cosmodrome d'Alcantara, dans l'Etat de Maranhao. Les spécialistes russes apportent une aide au Brésil pour élaborer des moyens efficaces de mise orbite de charges utiles.
Dans le secteur énergie-combustibles, la coopération et la transmission de technologies pourraient s'orienter vers l'introduction de méthodes modernes de recherche, de prospection et de monitoring des réserves de matières premières minérales et organiques (notamment à partir de l'espace), d'élévation du niveau d'extraction et d'exploitation, ainsi que vers la création de systèmes très fiables et écologiquement sûrs de transport. C'est ainsi que le russe Rusal a acquis au Guyana une des plus grosses compagnies d'extraction de bauxite et y a déjà réalisé pour plusieurs milliards de dollars d'investissements. Ces investissements permettront à la Russie de recevoir annuellement deux millions de tonnes de bauxite. Un chiffre assez élevé à l'échelle de la Russie, et a fortiori du Guyana.
Le géant pétrolier russe Lukoil s'emploie activement à consolider ses positions sur le marché latino-américain des matières premières énergétiques.
Dans la production d'énergie, la politique d'innovation peut se concentrer sur la création et l'utilisation d'installations vapeur/gaz pour les centrales électriques brûlant du combustible gazeux et d'unités force/vapeur à très haut rendement, utilisant de toutes nouvelles technologies de combustion des combustibles solides. La compagnie électronénergétique russe Silovye Mashiny (anciennement Energomashexport) a remporté les enchères pour la livraison d'équipements pour des centrales électriques au Mexique, au Brésil et au Chili.
La réalisation de cycles technologiques de production directs, garantissant une économie maximale de ressources et d'énergie à tous les stades du processus, est particulièrement d'actualité pour les pays latino-américains ayant une industrie métallurgique assez développée. Le même objectif – introduction de technologies économisant les matériaux et l'énergie – est fixé dans l'industrie chimique et pétrochimique.
Dans les constructions mécaniques, l'expérience russe d'automatisation des processus de développement et de production peut faire l'objet d'une demande, de même que l'utilisation de méthodes novatrices de traitement haute précision des matériaux, de contrôle et de diagnostic des pièces et agrégats au cours du processus de leur fabrication et de leur exploitation.
La coopération technologique dans les transports peut se développer dans les domaines du renouvellement et du perfectionnement des moyens de transport, des véhicules et des équipements. Des camions russes Oural sont achetés par l'armée uruguayenne. Une usine de montage d'Avtovaz fonctionne en Equateur. Du matériel aéronautique, essentiellement des hélicoptères, est vendu au Mexique, au Venezuela, à la Colombie et au Pérou.
Pour de nombreux experts russes, la principale forme de coopération garantissant l'élaboration et la commercialisation des projets d'innovation russes devrait être la création avec des compagnies latino-américaines de coentreprises dans des secteurs des hautes technologies aussi bien pour élaborer des modèles pilotes de coopération de productions conjointes de haute technicité que pour porter des réalisations russes novatrices au stade de l'utilisation commerciale. Il convient d'avoir présent à l'esprit, ce faisant, que les projets d'innovation ne seront efficaces que s'ils reposent sur des recherches fondamentales et appliquées de pointe et s'ils sont destinés dès le début à être commercialisés.
Une condition importante, même si elle n'est pas décisive, du succès dans la coopération scientifique, technique et dans le secteur de l'innovation entre la Russie et les pays latino-américains est sa stimulation active par l'Etat russe. Ce dernier doit notamment soutenir les projets nationaux présentés lors des salons internationaux, élargir la délivrance de licences de technologies nationales à l'étranger, garantir la transparence des exportations et importations de technologies.
L'Amérique latine constitue pour la Russie un partenaire économique et commercial extraordinairement intéressant et prometteur. Il en est ainsi du Brésil, qui est le quatrième producteur mondial d'avions et un leader sur le marché des appareils régionaux et moyen courrier, dont il détient 45 %. Avec pourtant un paradoxe : la Russie achète ces avions aux Etats-Unis, alors que les Etats-Unis eux-mêmes les achètent au Brésil…
Youri Zaïtsev est conseiller académique de l'Académie des sciences de l'ingénierie
RIA Novosti
06:00 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 février 2007
Réponses à José Luis Ontiveros
Réponses à José Luis Ontiveros
Il y a plus d’une dizaine d’années (le temps passe si vite…), le journaliste et écrivain mexicain José Luis Ontiveros avait interviewé Robert Steuckers pour le grand journal de Mexico « Uno mas Uno ». Voici la version française de cet entretien, pour la première fois sur le net !
1. Quelle géopolitique devrait déployer un pays émergeant comme le Mexique?
RS: Il me semble difficile de répondre à cette question à la place des Mexicains. Néanmoins, vu d'Europe, il semble que le Mexique n'a pas actuellement les moyens financiers et militaires d'imposer une ligne directrice dans la région. Surtout, sa flotte ne fait évidemment pas le poids devant celle du gendarme du globe, les Etats-Unis. Que faire dès lors qu'on ne peut pas affronter directement le maître du jeu? Les règles sont simples: elles dérivent de la pensée de Frédéric List, qui a jeté les bases de la pratique autarcique. Bien sûr, il sera difficile de faire passer une logique autarcique dans le contexte actuel; les adversaires intérieurs et extérieurs de toute logique autarcique passeront leur temps à la torpiller. La lutte pour un projet géopolitique indépendant et autonome passe par une lutte quotidienne pour la “colonisation intérieure”, c'est-à-dire pour la rentabilisation maximale et pour le centrage maximal possible des capitaux mexicains au Mexique. La “colonisation intérieure”, dans la tradition politique autarciste, c'est d'abord constater que si notre propre outillage industriel, technique, éducatif est limité, nous entrons automatiquement dans la dépendance d'un Etat possèdant un outillage plus complet. Il s'agit alors de travailler politiquement, patiemment, au jour le jour, à combler la différence. Ce processus pourra s'étendre sur un très long terme. Mais au quotidien, toute politique de “petits pas” peut payer. Et il s'agit aussi, pour les tenants de la logique autarciste, de critiquer sans relâche et de combattre les politiques libérales qui entendent faire de tous les systèmes socio-politiques de la planète des systèmes “pénétrés”. Le meilleur exemple, pour les pays émergents, reste celui de France-Albert René, Président de l'Archipel des Seychelles, qui disait qu'il fallait que les petits pays diversifient au maximum leurs sources d'approvisionnement, afin de ne pas trop dépendre d'un seul fournisseur. Situé entre les deux plus vastes océans du Globe, le Mexique pourra difficilement se soustraire dans l'immédiat de la forte tutelle américaine, mais en se fournissant en Europe, au Japon, dans les autres pays ibéro-américains, il pourra réduire à moyen ou long terme ses dépendances à l'égard des Etats-Unis au moins au tiers du total de ses dépendances. Le reste suivra.
2. Quelle sont les principales caractéristiques de la géopolitique depuis la “fin de l'histoire” annoncée par Fukuyama et la domination unipolaire des Etats-Unis qui règne aujourd'hui sur la planète?
Que Washington croie que la “fin de l'histoire” soit advenue ou que la domination des Etats-Unis soit désormais unipolaire ne change rien à la complexité factuelle et constante des options géopolitiques des Etats ou des groupes d'Etats ou même des Eglises ou des religions. Mais le “Nouvel Ordre Mondial” que Bush a tenté d'imposer avait été prévu avec clarté par un conseiller du Président algérien Chadli, le diplomate et géopolitologue Mohammed Sahnoun. Pour lui, l'analyse d'une constante de l'histoire, en l'occurrence l'“hypertrophie impériale”, par le Prof. Paul Kennedy, dans son célèbre livre The Rise and Fall of the Great Powers (1987), a obligé Washington à modifier sa stratégie planétaire: pour éviter cette hypertrophie qui mène au déclin, elle devait concentrer son pouvoir militaire sur l'essentiel. Et, pour Washington, cet essentiel est constitué par les zones pétrolifères de la péninsule arabique. La Guerre du Golfe a été un ban d'essai, pour voir si la logistique américaine était au point pour déployer rapidement des forces conventionnelles dans cette zone et vaincre en un laps de temps très court pour éviter tout syndrome vietnamien. Ensuite, il a fallu démontrer au monde que les Etats-Unis et leurs alliés étaient capables de contrôler une zone de repli et une base arrière, la Corne de l'Afrique et la Somalie. D'où les opérations onusiennes dans cette région hautement stratégique. Les Etats-Unis ne pouvaient envisager un retrait partiel d'Europe et d'Allemagne que s'ils étaient sûr qu'un déploiement logistique massif pouvait réussir dans la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique.
3) Quelles sont les perspectives de la géopolitique dans le monde islamique qui permettrait à celui-ci de se soustraire au schéma démo-libéral qu'imposent les Etats-Unis et l'Occident?
Parler d'un seul monde islamique me paraît une erreur. Le géopolitologue français Yves Lacoste parle à juste titre “des islams”, au pluriel. Il existe donc des islams comme il existe des christianismes (catholiques, protestants, orthodoxes), poursuivant chacun des objectifs géostratégiques divergents. Dans le monde islamique, il y a des alliés inconditionnels des Etats-Unis et il y a des adversaires de la politique globale de Washington. Aujourd'hui, dans les premiers mois de 1996, il me paraît opportun de suivre attentivement les propositions que formulent les diplomates iraniens, dans le sens d'une alliance entre l'Europe, la Russie, l'Iran et l'Inde, contre l'alliance pro-occidentale, plus ou moins formelle, entre la Turquie, Israël, les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite, les Emirats et le Pakistan. Cette alliance occidentale regroupe des islamistes laïcs et modérés (les Turcs) et des islamistes fondamentalistes et conservateurs (les Saoudiens). Le clivage ne passe donc pas entre fondamentalistes et modérés, mais plus exactement entre les diverses traditions diplomatiques, très différentes et souvent antagonistes, des pays musulmans respectifs. La Turquie laïque veut contenir la Russie et revenir dans les Balkans (d'où son soutien à certains partis bosniaques), vœux qui correspondent aux projets américains, qui cherchent à éviter toute synergie entre l'Europe, la Russie, l'Iran et l'Inde. L'Irak de Saddam Hussein représentait un pôle à la fois panarabe et stato-national, comparable, en certains points, au gaullisme anti-américain des années 60. Ce pôle a cessé d'avoir du poids après la Guerre du Golfe. L'Arabie Saoudite veut contenir et le nationalisme arabe des baasistes irakiens et et les chiites iraniens, ce qui l'oblige à demander constamment l'aide de l'US Army. Le Pakistan reprend son vieux rôle du temps de l'Empire britannique: barrer à la Russie la route de l'Océan Indien. Dans le Maghreb, des forces très divergentes s'affrontent. En Indonésie, autre grand Etat musulman, —mais où l'islamité ne prend pas la forme des intégrismes intransigeants, très religieux et très formalistes, d'Iran, d'Arabie Saoudite, du Soudan ou d'Algérie—, il s'agira de repérer et de distinguer les forces hostiles des forces favorables à une alliance entre Djakarta et un binôme indo-nippon. En effet, le Japon tente de financer et d'équiper une puissante flotte indienne qui surveillera la route du pétrole depuis le Golfe Persique jusqu'à Singapour, où une nouvelle flotte japonaise prendrait le relais, assurant de la sorte la sécurité de cette grande voie de communication maritime à la place des Etats-Unis. A la suite de la Guerre du Golfe, les Américains avaient demandé à leurs alliés de prendre le relais, de les décharger de leurs missions militaires: mais l'initiative japonaise soulève aussi des inquiétudes...
4) Quel doit être le point de référence d'une géopolitique ibéro-américaine et quelles doivent être les alliances stratégiques de la «Romandie américaine»?
Je ne devrais pas répondre à la place des Ibéro-Américains, mais, vu d'Europe, il me semble que la géopolitique continentale ibéro-américaine devrait tenir compte de trois axes importants:
a) Se référer constamment aux doctrines élaborées au fil des décennies par les continentalistes ibéro-américains qui ont compris très tôt, bien avant les Européens, quels étaient les dangers d'un panaméricanisme téléguidé par Washington. Il existe donc en “Romandie américaine” une tradition politico-intellectuelle, portée par des auteurs très différents les uns des autres, mais qui, au-delà de leurs différences, visent tous un but commun: rassembler les forces romandes du Nouveau Monde au niveau continental pour conserver les autonomies et les différences au niveau local.
b) Pour échapper à toute tutelle commerciale et industrielle de Washington, les Etats latino-américains doivent appliquer au maximum la logique autarcique, base du développement autonome des nations, imposer la préférence continentale ibéro-américaine et diversifier leurs sources d'approvisionnement dans les matières que les autarcies locales et grand-spatiale ne peuvent pas encore leur procurer. Dans un premier temps, il faudrait que les fournitures non nationales et non ibéro-américaines viennent à 30% des Etats-Unis, à 30% du Japon, à 30% d'Europe et à 10% d'ailleurs.
c) Ensuite, il faut se souvenir d'un projet que De Gaulle avait carressé dans les années 60: organiser des manœuvres navales communes dans l'Atlantique Sud entre la France, l'Afrique du Sud (ce qui est désormais problématique), l'Argentine, le Brésil, le Portugal et le Chili. Une coopération qu'il serait bon de réactiver. L'écrivain français Dominique de Roux voyait dans ce projet l'ébauche d'un “cinquième empire”.
5) Un réaménagement géopolitique mondial aura-t-il lieu contre la domination de l'américanosphère?
En dépit du matraquage médiatique, l'américanosphère n'est plus un modèle, comme c'était le cas de la fin des années 40 jusqu'aux Golden Sixties. L'hypertrophie impériale, la négligence des secteurs non marchands au sein de la société civile nord-américaine, l'effondrement de la société sous les coups de boutoirs de l'individualisme forcené, a créé, sur le territoire des Etats-Unis une véritable société duale qui exerce de moins en moins de pouvoir de séduction. Le mythe individualiste, pierre angulaire du libéralisme et de l'économisme américain, est aujourd'hui contesté par les “communautariens” et par des idéologues originaux comme les biorégionalistes. Les Etats-Unis, en dépit de leur protectionnisme implicite (où le “laissez-faire, laissez passer” n'est bon que pour les autres), ont négligé la colonisation intérieure de leur propre territoire: routes, infrastructures, chemins de fer, lignes aériennes, écoles, etc. laissent à désirer. Le taux de mortalité infantile est le plus élevé de tous les pays développés. Tôt au tard, ils devront affronter ces problèmes en abandonnant petit à petit leur rôle de gendarme du monde. L'ère des grands espaces semi-autarciques, annoncés par l'économiste hétérodoxe français François Perroux, s'ouvrira au 21ième siècle, cherchera à mettre un terme au vagabondage transcontinental des capitaux, à imposer une logique des investissements localisés et surtout, comme le voulait Perroux (qui admirait les continentalistes ibéro-américains) pariera pour l'homme de chair et de sang, pour l'homme imbriqué dans sa communauté vivante, et pour ses capacités créatrices.
6) Quel est le futur de l'Etat national? Sera-t-il remplacé par un “Etat universel”?
En Europe, l'Etat national est en crise. Mais cette crise n'est pas seulement due à l'idéologie libérale et universaliste dominante. Si la centralisation de l'Etat a été un atout entre le 17ième et le 19ième siècles et si les Etats centralisateurs, tels l'Espagne, la France ou la Suède, ont pu déployer leur puissance au détriment des pays morcelés issus directement de la féodalité, les nouvelles technologies de communication permettent dorénavant une décentralisation performante pour la société civile, l'économie industrielle (et non spéculative!) et, partant, pour les capacités financières des pouvoirs publics, ce qui a immédiatement des retombées dans les domaines de la haute technologie (maîtrise des télécommunications et des satellites), de la chose militaire (armement de pointe) et de la matière grise (université et recherche performantes). Ou permettent des recentrages différents, en marge des vieilles capitales d'Etat. Pour cette raison le fédéralisme est devenu une nécessité en Europe, non pas un fédéralisme diviseur, mais un fédéralisme au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un fédéralisme qui fédère les forces vives du pays, ancrées dans des tissus locaux. Je veux dire par là que les provinces périphériques des grands Etats centralisés et classiques d'Europe ont désormais le droit de retrouver un dynamisme naturel auquel elles avaient dû renoncer jadis pour “raison d'Etat”. Le fédéralisme que nous envisageons en Europe est donc un fédéralisme qui veut redynamiser des zones délaissées ou volontairement mises en jachère dans les siècles précédents, qui veut éviter le déclin de zones périphériques comme l'Arc Atlantique, du Portugal à la Bretagne, le Mezzogiorno, l'Extramadure, etc. Et puis, dans un deuxième temps, rassembler toutes ces forces, les nouvelles comme les anciennes, pour les hisser à un niveau qualitatif supérieur, dont Carl Schmitt, déçu par l'étatisme classique après avoir été un fervent défenseur de l'Etat de type prussien et hégélien, avait annoncé l'advenance: le Grand-Espace. En Europe, la réorganisation des pays, des provinces, des patries charnelles et des vieux Etats sur un niveau “grand-spatial” est une nécessité impérieuse. Mais hisser nos peuples et nos tribus à ce macro-niveau grand-spatial exige en compensation une redynamisation de toutes les régions. L'objectif grand-spatial est inséparable d'un recours aux dimensions locales. Ailleurs dans le monde, cette dialectique peut ne pas être pertinente: en Chine et au Japon, l'homogénéité du peuplement rend inutile ce double redimensionnement institutionnel. En Amérique latine, l'hétérogénéité culturelle et l'homogénéité linguistique exigeront un redimensionnement institutionnel différemment modulé. Nous aurons donc une juxtaposition de “grands espaces” et non pas un Etat unique, homgénéisant, policier et planétaire, correspondant aux fantasmes des idéologues universalistes, qui continuent à faire la pluie et le beau temps dans les salons parisiens.
06:30 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'eau: atout russe à l'ère post-pétrolière
L'eau sera l'atout majeur de la Russie à l'ère post-pétrolière
trouvé sur: http://theatrumbelli.hautetfort.com/

Selon le "Rapport sur le développement de l'homme" rendu public récemment par le Programme de développement de l'ONU (PNUD), l'accès à l'eau douce doit être reconnu comme un "droit de l'homme". Or, les prévisions n'ont rien de rassurant: d'ici à vingt ans pas moins de 40% des habitants de la planète seront confrontés à une grave pénurie d'eau tandis qu'entre 2025 et 2035 la consommation mondiale d'eau douce sera proche du niveau des ressources disponibles.
Cette situation est annonciatrice d'une crise globale gravissime parce que la concurrence toujours plus âpre liée à l'utilisation des ressources hydrauliques pourrait provoquer des conflits armés, des actes de terrorisme "hydraulique", de véritables guerres. D'ailleurs, 37 affrontements ayant trait à l'eau se sont déjà produits au cours du dernier demi-siècle. Cependant, durant la même période plus de 200 accords interétatiques sur l'utilisation des ressources hydrauliques ont été conclus. Par conséquent, le spectre des "guerres de l'eau" pourrait aisément disparaître si l'humanité réussissait à mettre en place un système raisonnable et sûr de coopération dans le domaine des ressources hydrauliques.
Les Etats ne disposent pas tous, tant s'en faut, de grandes réserves naturelles d'eau. 90% des habitants de la terre vivent dans des pays contraints de partager leurs ressources hydrauliques avec des voisins. Dans ce sens, la Russie se trouve dans une situation avantageuse parce qu'elle est riche en eau douce et occupe la seconde place dans le monde (derrière le Brésil) pour ses réserves naturelles. On recense en territoire russe deux millions et demi de cours d'eau, plus de trois millions de lacs, dont les réserves totales sont estimées à 26.000 kilomètres cubes.
A l'heure qu'il est la Russie utilise pour ses besoins pas plus de 2% de ses réserves d'eau, par conséquent elle pourrait en faire profiter les autres. D'ici à 30-40 ans, en Russie le pétrole pourrait être remplacé par l'eau qui deviendrait ainsi la principale ressource budgétaire.
Bien sûr, il n'est pas question que l'eau devienne un article d'exportation comme le pétrole en qualité de "ressource pure". En matière d'utilisation de l'eau il y a ce que l'on appelle la loi du rendement décroissant. Les dépenses de transport de l'eau en quantités nécessaires à sa consommation industrielle, domestique et agricole augmentent brusquement en franchissant les frontières du bassin de sa source.
Cette forte hausse du coût du transport est justement la première raison qui empêche que l'eau soit commercialisée comme le brut. Par conséquent, à de rares exceptions près les dimensions des marchés de l'eau n'iront pas au-delà de celle d'un bassin. C'est la raison pour laquelle dans les pays où il y aura pénurie d'eau pour y remédier on recourra principalement aux technologies économisatrices d'eau. On pourra aussi cesser la fabrication d'articles aquavores pour privilégier leur importation.
Pour la Russie il sera bien plus rationnel et avantageux de passer aux technologies intensives en matière de rendement, d'économie et de stockage. Ces technologies se développeront activement sur le marché mondial au fur et à mesure de l'aggravation de la pénurie globale. Nous le soulignons, le marché mondial des produits aquavores est un marché de produits et non pas de matières premières. Pour que la Russie y figure en qualité de vendeuse, ses seules réserves naturelles ne suffisent pas, il faut également faire intervenir les productions utilisant de l'eau. La Russie dispose de très grandes possibilités pour bien figurer sur le marché des produits aquavores. Dans ces secteurs on trouve l'électricité, la métallurgie, l'industrie papetière, la chimie des polymères et aussi l'agriculture. Potentiellement la Russie est à même de s'imposer sur ce terrain et de devenir une importante exportatrice des produits en question.
Ces articles ne pourront être proposés que par les pays disposant de ressources hydrauliques excédentaires (Russie, Canada, Brésil, Australie). La restructuration de l'économie mondiale qu'implique le danger de crise de l'eau globale place dans une situation extrêmement favorable les pays riches en eau du moment que la demande et le prix des produits aquavores vont nécessairement croître. Par conséquent les exportateurs de ces articles se retrouveront dans une situation aussi prospère que celle que connaissent actuellement les exportateurs de pétrole. Il est très probable que la fabrication des produits aquavores constituera un volet prédominant de l'économie russe dans l'après-pétrole.
La menace de crise de l'eau globale et la hausse des prix régionaux de l'eau et des prix mondiaux des produits aquavores vont assurément ralentir la consommation d'eau. Maintenant la question est de savoir quelles seront les conséquences économiques, sociales et politiques de cette situation. Si elle sera le résultat d'actions spontanées des forces du développement économique et social, face auxquelles la civilisation sera impuissante, ou bien le fruit d'actions conséquentes, visant à assurer le développement durable de la civilisation dans le contexte d'une pénurie globale d'eau douce.
Viktor DANILOV-DALINIAN
membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie
Source du texte : RIA NOVOSTI
06:25 Publié dans Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pas de parallèle entre les guerres du Vietnam et d'Irak

Evgueni SATANOVSKI:
Ne pas établir un parallèle entre la guerre en Irak et la guerre au Vietnam
Depuis quelque temps on a de plus en plus tendance à comparer les résultats de la guerre en Irak avec le bilan de la guerre au Vietnam. On, ce sont les alliés des Etats-Unis et leurs adversaires. Les congressmen américains et les chefs des terroristes. Les politiques professionnels et "l'homme de la rue". Les journalistes et les généraux. Et ils sont tous dans l'erreur. L'Irak, ce n'est pas le Vietnam. La situation y est bien pire. Et la plupart des parallèles fondés sur les souvenirs de la guerre au Vietnam sont inapplicables dans la situation prévalant en Irak.
La différence ne réside pas dans le fait qu'au Vietnam les Américains combattaient dans la jungle alors qu'en Irak ils font le coup de feu dans le désert ou dans les quartiers urbains. Ni dans le niveau des armements et des technologies utilisés. Ni dans ce que l'Amérique était alors et ce qu'elle est devenue plusieurs décennies plus tard.
Ce qui est essentiel, c'est que la guerre au Vietnam opposait moins le Nord et le Sud de ce pays que les grandes puissances. Les Etats-Unis luttaient contre l'URSS, la guerre était un reflet de la rivalité à laquelle se livraient des modèles modernisés qui initialement appartenaient à une même civilisation. Le commerce et les contacts diplomatiques entre Washington et Moscou avaient contribué à atténuer la confrontation et à la maintenir dans un cadre déterminé. La guerre au Vietnam était un élément du "Grand jeu". Ses règles étaient peut-être pas très ragoutantes et leurs conséquences exécrables, mais elles avaient néanmoins le mérite d'exister.
A la différence de la guerre en Irak, celle du Vietnam était exempte de composante religieuse ou ethnique. Au Vietnam, un voisin ne tuait pas son voisin parce que celui-ci ne priait pas exactement de la même façon ou appartenait à une autre ethnie. La guerre du Vietnam n'était pas un conflit de civilisations. En Irak la plupart de ceux qui combattent contre les troupes de la coalition américano-britannique croient fanatiquement qu'ils défendent le monde islamique contre les "croisés". Le discours politique, il est de mise dans les parlements occidentaux, mais pas à Erbil, à Bassorah ni même à Bagdad.
Quitter le Vietnam avait été relativement facile. Le Sud-Vietnam avait subi une défaite, le Nord avait triomphé, mais c'était la victoire d'un Etat et non pas d'un élément anarchique mêlé de fanatisme religieux. Ceux qui ont triomphé au Vietnam n'avaient pas l'intention de poursuivre le combat en Europe et aux Etats-Unis. Par contre, ceux qui peuvent vaincre en Irak ne dissimulent pas que c'est là leur objectif et de par leurs actes ils montrent que ce ne sont pas là des paroles en l'air. Bien sûr, on pourrait retirer de là-bas les troupes et les conseillers militaires. Pour le congrès, le sénat et l'administration des Etats-Unis cela signifierait que la guerre en Irak est terminée. Mais pour ceux qui se battent là-bas contre l'Amérique et en sa personne l'Occident, cela ne voudrait rien dire du tout.
Aujourd'hui la guerre en Irak c'est une guerre de tous contre tous. Une guerre d'insurgés contre des occupants du point de vue irakien. Une guerre de forces coalisées contre des terroristes, du point de vue occidental. Une guerre d'arabes et de kurdes. Une guerre de kurdes et de turcomanes. Une guerre de chiites et de sunnites. L'Irak est le front principal de cette guerre qui fait rage partout dans le monde islamique, du Liban jusqu'au Pakistan. La guerre en Irak est une guerre intestine dans les communautés sunnites et un affrontement entre les leaders chiites. C'est une guerre entre les baasistes et les partisans d'Al-Qaïda. Entre les cheiks chiites locaux et ceux qui ont le regard tourné sur l'Iran. Entre les adversaires du gouvernement fantoche et les peu nombreux partisans de celui-ci. C'est une guerre de tous ces groupes contre les chrétiens, dont les communautés vivent leurs dernières années sur une Terre qu'elles avaient considérée comme natale pendant près de 2.000 ans. Une guerre de clans familiaux et de tribus, une guerre
d'autochtones contre des étrangers, peu importe d'où ils viennent et ce qu'il font. Telle est la guerre en Irak.
Si au Vietnam l'objectif de la guerre était de prendre le contrôle du pays, en Irak le pays n'est plus qu'un territoire depuis belle lurette. Aucune des parties au conflit, y compris les troupes coalisées et le gouvernement irakien, n'est à même de le contrôler ni même de prétendre sérieusement à le contrôler. L'Irak n'est plus un pays. C'est désormais un "terrain vague" de la grandeur d'un pays.
Le 11 octobre 2006, le parlement irakien a adopté la loi instituant le fédéralisme dans le pays. C'était en quelque sorte la légalisation de la création en Irak de régions autonomes ce qui, comme l'estiment la plupart des experts, débouchera prochainement sur la désintégration du pays. Parmi les chiites, le plus radical est l'imam al-Sadr qui estime possible la création en Irak d'un Etat islamique sur le modèle iranien. En 2006, le Conseil consultatif des Moudjahédines avait annoncé la création d'un Etat islamique indépendant dans les régions sunnites. L'idée d'une étaticité fédéraliste est appuyée par les dirigeants kurdes et chiites contrôlant les principales régions pétrolifères.
Le président George W. Bush est-il conscient de tout cela quand il parle de sa nouvelle "stratégie"? C'est possible. En tout cas il est prêt à assumer la responsabilité de ce qui se passe en Irak, et cela représente un poids substantiel pour tout politique. A-t-il la possibilité d'aller au devant de ses critiques? C'est exclu. D'abord parce que c'en serait fini de lui en tant que président et ensuite on lui collerait l'étiquette de pire des présidents américains du XXe siècle. Cela n'aurait tout simplement aucun sens. Atténuer les effets d'une défaite militaire, minimiser les pertes subies par les Etats-Unis, réduire le préjudice causé au Parti républicain par sa politique, c'est une chose. Prendre une décision qui permettrait de porter de nouveaux coups contre les Etats-Unis comme celui du 11 septembre, c'en est une toute autre. Aucun président américain n'envisagerait cela. D'autant que George W. Bush n'a pas fait que déclencher cette guerre, il la gère mal aussi.
En 2006, les effectifs des troupes américaines oscillaient de 123 à 150.000 hommes. Au 1er janvier 2007, les Etats-Unis avaient en Irak quelque 140.000 soldats et officiers. L'année dernière les contingents des autres pays de la coalition en Irak ont été ramenés de 21 à 16.500 hommes. Les 21.500 militaires américains supplémentaires déployés dans le pays ne feront que compenser les départs de troupes observés l'année passée et accroîtront quelque peu les forces dans les zones où les pertes américaines sont particulièrement élevées. Il s'agit en premier lieu de Bagdad et de la province occidentale d'Anbar où 30.000 militaires américains ne sont pas en mesure de faire face aux insurgés locaux et aux combattants d'Al-Qaïda.
La "stratégie" du président Bush est tout ce que l'on veut sauf une véritable stratégie. Cependant, en tant que démarche tactique elle pourrait avoir un sens. Les Américains vont devoir se redéployer. Transférer leurs troupes dans les bases situées au Kurdistan irakien, en Jordanie et dans les monarchies du golfe Persique. En contrôlant les oléoducs et les terminaux pétroliers, les gisements de pétrole et le quartier des ambassades à Bagdad, le parlement et le gouvernement, ils pourraient "partir tout en restant". Pour pouvoir réussir un redéploiement sous le feu il faut au préalable porter des frappes préventives contre l'ennemi. Pour ce faire il faut accroître les effectifs des troupes destinées à couvrir les mouvements des unités. Cela ressort de la lecture de tout manuel militaire.
Que reste-t-il à faire au président américain? La guerre civile en Irak a acquis un caractère irréversible. La démocratie, au nom de laquelle, si l'on fait abstraction de la bombe atomique inexistante de Saddam Hussein, la guerre avait été déclenchée, n'a apporté ni la sécurité ni la paix aux habitants de l'Irak. Sous la tyrannie de Saddam ils connaissaient une existence meilleure. Actuellement en Irak l'électricité est distribuée 12 heures par jour et seulement pendant 6-7 heures à Bagdad. Dans certaines régions le taux de chômage atteint 70%. Les Irakiens fuient le pays. On en recense de 500.000 à 1.000.000 en Syrie, de 500 à 700.000 en Jordanie, environ 100.000 en Egypte. Selon les autorités irakiennes, en 2006 cet exode était de 100.000 personnes par mois. Depuis 2003, plus de 2.000 000 d'Irakiens ont immigré, dont plus de 18.000 médecins, chercheurs, ingénieurs et enseignants. A l'intérieur du pays plus de 500.000 personnes craignant des persécutions ont quitté leurs lieux de résidence pour se réfugier dans les régions habitées par de fortes concentrations de leurs communautés religieuses.
Au début de 2007, les autorités irakiennes contrôlaient trois des dix-huit provinces du pays. En 2006, l'armée irakienne alignait 119.000 soldats et officiers, les effectifs de la police se montaient à 199.000 hommes. Cependant, sans le soutien de l'armée américaine, la plupart des unités irakiennes ne sont pas en état de combattre contre les insurgés et les terroristes. Exception faite des Pechmerga (combattants des unités armées kurdes) dont le nombre dépasse 100.000 et qui sont subordonnés aux leaders kurdes.
A Bagdad, les 20.000 insurgés de l'Armée du Mahdi, subordonnés au leader chiite radical al-Sadr, évincent les sunnites. Au cours de la seule année 2006, dix quartiers de Bagdad à population mixte sont devenus entièrement chiites. Les chiites prédominent également au sein de l'administration municipale. Ils ont face à eux l'Armée islamique en Irak, le Nouveau Parti Baas, les Brigades de la révolution de 1920, l'Armée de Muhammad - tous sunnites - ainsi qu'environ 1.300 combattants étrangers.
Dans le même temps Riyad et Le Caire ont exhorté les Etats-Unis à ne pas s'empresser de retirer leurs troupes d'Irak. Le premier ministre turc, Tayyip Erdogan, estime qu'il faut établir le calendrier du retrait des troupes, mais que la "réduction des effectifs doit être lente", surtout qu'en raison des actions des combattants kurdes la tension se maintient à la frontière séparant la Turquie du Kurdistan irakien. La situation est agitée aussi à la frontière avec l'Iran, quoique l'Iran ait établi des relations tant avec les chiites majoritaires au sein du gouvernement à Bagdad qu'avec les chiites radicaux qu'il aide à former des combattants et approvisionne en armes. En 2006, la Syrie a rétabli avec l'Irak les relations diplomatiques rompues depuis plus de vingt ans, mais elle a fermé sa frontière avec lui en y déployant 7.500 militaires.
Il semble bien que toutes les erreurs possibles aient été commises en Irak. Les prochaines à venir pourraient être celles faites par l'administration américaine et le président des Etats-Unis à l'égard de l'Iran ou de la Syrie, cependant elles ne devraient pas aboutir à une catastrophe régionale. La catastrophe, elle s'est déjà produite. De nouvelles guerres ou des démarches diplomatiques maladroites ne pourraient qu'accélérer ou ralentir son évolution. Le temps est le seul remède aux erreurs historiques de cette envergure. L'expérience des vieux empires coloniaux doit aujourd'hui être sollicitée plus que jamais. Elle commande d'éviter tout empressement. De ne pas se hâter de retirer les troupes pour ne pas "perdre la face". De s'entendre avec ceux avec qui il est possible de s'entendre et d'opérer avec rigueur là où il n'y a personne avec qui s'arranger. D'oublier les clichés de la seconde moitié du XXe siècle. En premier lieu de cesser de penser que la "communauté mondiale" est une réalité à même de faire quelque chose de sensé. Cette expérience demande aussi de bien comprendre que ce petit groupe de hauts fonctionnaires, de journalistes et de bureaucrates internationaux s'arroge le titre de "gouvernement universel" sans en avoir la moindre justification. Il faut procéder à une analyse poussée de la situation. Maintenir la stabilité des régimes régionaux, qu'ils soient démocratiques ou non. Cadenasser les frontières de l'Irak. Etablir progressivement des relations avec ceux qui prendront le pouvoir dans ce pays ou dans les enclaves qu'il formera en éclatant.
Ce remède a un goût amère. La réalité est injuste. Hideuse. Vexante. Très loin de l'infantilisme des politiques messianiques. Mais il faut la prendre comme elle est car il n'y en a pas d'autre.
Evgueni Satanovski est président de l'Institut du Proche-Orient,
RIA Novosti
06:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 février 2007
Pour une grande alliance eurasienne et ibéro-américaine
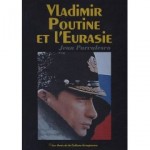
Pour une Grande Alliance eurasienne et ibéro-américaine
Extrait d’une conférence prononcée par Robert Steuckers à la tribune de l’association “Terre & Peuple” de Nancy, 26 novembre 2005
Henri de Grossouvre a publié naguère un ouvrage important, suggérant à ses lecteurs les bases concrètes d’une alliance Paris/Berlin/Moscou. Cette alliance, nécessaire, ne pouvait être que défensive, n’être qu’une première étape en direction d’un projet plus vaste, dans la mesure où les territoires de cette “Triplice” étaient dépourvus de glacis, surtout en Asie centrale, après la dissolution de l’URSS, héritière de l’empire des tsars dans cette région. Pour être complète, l’alliance doit également comprendre l’Iran, l’Inde, la Chine et le Japon. De cette façon, la puissance thalassocratique du Nouveau Monde éprouverait d’immenses difficultés à se fixer et s’incruster dans les rimlands et à y disloquer les cohésions impériales.
Les cinq premières puissances de cette alliance à sept, jusqu’ici hypothétique, sont indo-européennes, c’est-à-dire qu’elles ont des références à un passé indo-européen, en dépit de l’adstrat chrétien ou musulman, le bouddhisme étant une émanation particulière de la psyché indo-européenne de l’Inde, portée au départ par un prince indien, issu de la classe des kshatriyas. L’Iran n’est islamiste aujourd’hui que parce les Etats-Unis ont soutenu Khomeiny au départ, pour éliminer le Shah et son programme de retour aux racines perses de l’antiquité, assorti d’une vision diplomatique active axée sur l’organisation du pourtour de l’Océan Indien. Le projet géopolitique du Shah était visionnaire et intéressant: Zaki Laïdi et Mohammed Reza Djalili, géopolitologues de langue française, originaires du monde musulman et, de ce fait, excellents connaisseurs des sources arabes, iraniennes, pakistanaises et indiennes, l’ont bien mis en exergue dans leurs divers travaux. La nouvelle campagne médiatique contre l’Iran, engagée à fond depuis cet automne, au nom de la non-prolifération des armements nucléaires, est un prétexte, un de plus, pour intervenir sur le rimland eurasien, et élargir les conquêtes effectuées en Afghanistan et en Irak.
Le projet de « Grand Moyen Orient »
Comme le titrait le Corriere de la Sera du 25 novembre 2005, l’Iran envisage de traiter son uranium sur le sol russe, échappant de la sorte à d’éventuelles représailles américaines ou israéliennes. Beijing soutient ce projet, tout simplement parce que l’apport de pétroles iraniens est vital pour la Chine en pleine expansion, une expansion que tente de contrecarrer Washington.
L’Europe, pour sa part, n’a aucun intérêt à ce qu’un embargo général, dans le cadre de sanctions décidées par Washington, soit imposé à l’Iran: elle en ferait les frais, car les échanges entre les Etats-Unis et l’Iran sont infimes; de ce fait, les manques à gagner frapperaient uniquement les exportateurs européens de technologies, qui, en ne commerçant pas avec l’Iran, ne bénéficieraient pas de fonds suffisants pour investir ultérieurement dans la recherche et les innovations. L’affaire iranienne, si elle est analysée au départ des règles éternelles de la géopolitique, pourrait contribuer à consolider, de manière effective, un projet de défense commun sur la masse continentale eurasienne, car, en frappant l’Iran, les Etats-Unis frapperaient le coeur géopolitique de l’espace central de cette immense masse territoriale, feraient tomber le dernier obstacle politique à leurs projets. Ils veulent en effet fabriquer un “Grand Moyen Orient”, équivalant au territoire de l’USCENTCOM, et qui serait le débouché majeur de leurs industries de consommation, tout en excluant toutes les autres puissances économiques de ce marché juteux. Ni Moscou ni Beijing ne peuvent le tolérer, car ce ré-agencement géostratégique réduirait leurs territoires respectifs à une périphérie affaiblie, sans accès à l’Océan du Milieu, objet de toutes les convoitises impériales depuis la plus haute antiquité.
Dans cette synergie, qui se dessine actuellement, les sixième et septième puissances de l’hypothétique “Grande Alliance” (GA), que nous appelons de nos voeux, soit la Chine et le Japon, commenceraient par restaurer la fameuse “sphère de co-prospérité est-asiatique”, qui donnerait ipso facto cohérence à l’aire orientale de la masse continentale eurasienne. Sur le plan spirituel et métaphysique, ces deux puissances reposent sur des religions autochtones non prosélytes, non messianiques. On ne peut donc pas se servir d’une religion de ce type, dans ces deux pays, pour déclencher désordres et révolutions, comme on le fait avec l’islam, ou pour enclencher un processus d’auto-dénigrement masochiste, comme on le fait avec le christianisme en Europe, et plus particulièrement en Allemagne et dans les pays protestants. L’héritage religieux, en Chine et au Japon, y est un faisceau de legs ancestraux, de rites et de coutumes qui échappent à toute manipulation, car elles sont fixes et immuables, tout en permettant la modernité technologique.
La Chine se défend
Dans l’espace de co-prospérité est-asiatique, il y a certes l’Indonésie, agitée par quelques sectes fondamentalistes musulmanes, mais ses réseaux nationalistes, arrivé au pouvoir après 1945, ont participé aux efforts japonais, pendant la seconde guerre mondiale, pour que cette sphère voie le jour et se consolide. Le projet de “Grande Alliance” —qui comprendra aussi la Thaïlande, autre ancien allié des Japonais, considéré pendant longtemps comme “pays ennemi des Nations-Unies”— implique la défense, dans ce pays, de la tradition nationale bouddhiste contre les menées subversives d’éléments fanatiques musulmans dans le sud, qui entendent déstabiliser le pays et freiner son élan économique.
La Chine, de son côté, s’est toujours défendue contre les désordres provoqués par les nomades hunniques et turco-mongols: c’est sa raison d’être, le secret de sa continuité politique pluri-millénaire. De ce fait, fidèle à cette continuité, à cette longue durée, en dépit des idéologies occidentales et modernistes qui l’ont travaillée, elle n’est pas prête à lâcher du lest dans le Sinkiang, anciennement dénommé le “Turkestan chinois”, ni à y accepter l’émergence de bandes insurrectionnelles musulmanes, turco-ouïghoures, téléguidées par un panturquisme activé en ultime instance par les Etats-Unis. Et qui viserait à détacher ce Sinkiang de la sphère d’influence chinoise (et russe) pour en faire un éventuel appendice du “Grand Moyen-Orient”. Les Etats-Unis réaliseraient par personnes interposées le projet arabo-musulman jadis avorté de conquérir les avant-postes turkestanais de la Chine et, dans une phase ultérieure, se serviraient, pendant longtemps, du trop-plein démographique musulman pour contenir la Chine sur ses confins occidentaux.
Le problème de l’Islam, et plus exactement de ses factions les plus extrémistes, c’est qu’il est allié des Etats-Unis, en dépit des proclamations et des rodomontades, des attentats et des croquemitaines que l’on agite dans les médias. L’espace du “Grand Moyen Orient” (GMO), voulu par les Américains, sera musulman, si possible rétrograde pour éviter tout envol industriel et économique (comme l’envisageaient les agents de la CIA qui ont mis Khomeiny en selle), de préférence prosélyte pour grignoter les territoires adjacents comme en Thaïlande, mais aussi, à terme, dans la vallée de la Volga et de la Kama sur le territoire de la Fédération Russe, dans le Sin-Kiang contre la Chine et dans les communautés immigrées en Europe occidentale (qui serviront, le cas échéant, quand il le faudra, de leviers pour provoquer des désordres ingérables, déstabiliser les systèmes de sécurité sociale et affaiblir financièrement les concurrents européens sur tous les plans, comme on le voit aujourd’hui, en novembre 2005, dans les banlieues des grandes villes françaises).
La leçon de Naipaul, Prix Nobel de littérature
L’antidote idéologique à ce prosélytisme virulent nous est livré aujourd’hui par le Prix Nobel de littérature V. S. Naipaul, un Indo-Britannique auquel nous devons plusieurs livres très intéressants sur le destin de la civilisation indienne, minée par le prosélytisme islamique. Naipaul, notamment dans India: A Wounded Civilization et Among the Believers. An Islamic Journey, démontre la nocivité de tout prosélytisme, car il mutile en profondeur les peuples ou les civilisations qui le subissent. Le premier de ces livres a été écrit en 1975, à la suite d’une troisième visite en Inde, patrie de ses ancêtres qui l’avaient quittée pour se fixer en Jamaïque. Ses pérégrinations d’émigré, qui revient à ses sources, lui révèlent la profonde mutilation de l’Inde hindouiste, après des siècles de domination étrangère, musulmane et britannique.
Cette blessure fait que l’Inde n’avait pas encore trouvé l’idéologie de sa régénérescence, car le gandhisme, malgré qu’il ait in fine obtenu l’indépendance du sous-continent, se solde, aux yeux de Naipaul, par un échec. Le gandhisme ne fait pas revivre le passé, ne donne pas les recettes d’un Etat efficace, viable sur le long terme; il exprime les sentiments d’une Inde qui résiste, mais nous pas d’une Inde qui guérit et ressuscite, se fortifie et s’impose. Sous les coups d’un prosélytisme étranger, un “vieil équilibre” a été rompu, constatait Naipaul en 1975, la règle qu’il énonce là pouvant s’appliquer à tous les prosélytismes et à tous les “vieux équilibres” qu’ils ont rompus au cours de l’histoire.
Prosélytisme islamique et prosélytisme médiatique
Le second livre, que nous évoquons ici, montre la rage que les nouveaux convertis développent pour détruire les legs de leur civilisation-mère. L’apport de la Chine et du Japon serait dès lors, dans la “Grande Alliance”, celui d’une force qui résiste aux prosélytismes, qui leur demeure imperméable, qui permet de garder ses forces originelles intactes, de ne pas rompre le “vieil équilibre”. Au 21ième siècle, cette force servirait à résister à deux formes de pénétrations mutilantes, de prosélytismes actuels, l’un laïc, l’autre religieux: celle du discours médiatique véhiculé par les grandes agences de presse américaines et celui de l’Islam, sur le terrain, à la périphérie du “Grand Moyen Orient” (GMO).
Les médias américains servent à endormir et distraire les esprits en Europe et en Russie, à oblitérer la conscience géopolitique; le prosélytisme islamique sert à élargir l’espace du GMO par une application dosée et bien téléguidée de la djihad contre les minorités non musulmanes ou contre des pays limitrophes afin de grignoter leurs frontières (comme ce fut le cas avec les mudjahiddins et les talibans: argent saoudien et armes américaines); ensuite ce prosélytisme sert à disloquer la paix intérieure dans les pays européens accueillant une forte immigration islamique (les événements de la France en novembre 2005 deviendront à ce titre un exemple d’école).
Les deux prosélytismes ont pour objectif de gommer des mémoires vives, de briser des continuités historiques, d’instaurer des systèmes manipulatoires. Sans mémoire vive, sans le sentiment de vivre dans une continuité historique, les peuples, comme le peuple indien selon Naipaul, tombent dans l’apathie, chavirent dans le désordre et la putréfaction, après des crises de fanatisme et d’iconoclasme.
HUIT AXES D’ACTION
Concrètement, la Grande Alliance émergera, si les dirigeants européens, russes, chinois, iraniens, indiens et japonais appliquent huit axes d’action:
1. Réaliser de concert un réseau indépendant d’oléoducs et de gazoducs dans toute l’Eurasie (cf. les articles de Gerhoch Reisegger dans Au fil de l’épée/Arcana Imperii). La visite récente de Poutine au Japon, où les pourparlers ont été concluants, abonde dans ce sens. Poutine vise à arbitrer un équilibre entre la Chine et le Japon, alors que les grandes agences médiatiques excitent les deux puissances asiatiques l’une contre l’autre, au nom de différends issus des années 30 et 40. Cette politique vise à raviver de vieux conflits, aujourd’hui dépourvus de pertinence, et à entraver toute synergie commune en matière de communication et de transport de l’énergie dans cette région à très forte densité démographique. Notre objectif doit être de contrer cette propagande, de créer les conditions idéologiques qui la rendraient inopérante, de faire éclore les réflexes psychologiques forts qui les rendraient nulles et non avenues.
2. Créer un réseau de routes et de chemins de fer entre la Russie, la Chine, les Corées et le Japon, d’une part, la Russie et l’Inde, d’autre part. La nécessité d’assurer des liaisons terrestres optimales entre la Russie et l’Inde donne tout leur relief aux questions tadjiks et cachemirites. En effet, le Tadjikistan et le Cachemire sont des terres indo-européennes, partiellement islamisées mais persophones au Tadjikistan, qu’il convient de dégager de toutes influences étrangères. Le soutien à l’Inde, dans ses revendications légitimes à l’endroit du Cachemire, est un impératif incontournable de la future nouvelle géopolitique de la Grande Alliance. En aucun cas, le Cachemire et le Tadjikistan ne doivent être inclus dans le GMO.
Le projet GALILEO
3. Sous l’impulsion de l’UE, le Grande Alliance (GA) doit se constituer autour du projet satellitaire GALILEO, qui doit être la réponse européenne, russe, chinoise et indienne à la domination américaine dans l’espace et, partant, dans le domaine des télécommunications. La demande d’Israël, de participer à ce projet, doit être vue avec la plus grande méfiance, vu les liens trop étroits de vassalité qui lient ce petit pays du Moyen Orient au géant américain.
4. Il faut soutenir et amplifier le projet de gazoduc de la Baltique, créant de facto un axe économique germano-russe. Ce projet, en voie de réalisation grâce à l’entêtement de l’ancien Chancelier Schröder, permet de contourner les pays de la “Nouvelle Europe”, satellisés par les Etats-Unis, comme l’Ukraine, après sa “révolution” orange, comme la Pologne, entièrement inféodée à l’OTAN, et la Lituanie, qui suit la même détestable orientation. Le gazoduc de la Baltique a permis de réduire à néant la nouvelle stratégie du “cordon sanitaire”, soit la création d’un chapelet de puissances petites et moyennes entre l’UE (jadis l’Allemagne) et la Fédération de Russie (jadis l’URSS), auxquelles on accorde une garantie parce qu’elles s’inféodent à l’OTAN. Cette contre-stratégie germano-russe avait connu un antécédent en 1986, avec le projet de relier, par un système de ferries et de gros transporteurs, le port de Memel/Klaipeda en Prusse orientale à Kiel, et via le canal de Kiel, à la Mer du Nord. Avant que ces tractations n’aboutissent, tout au début de l’ère Gorbatchev, le ministre-président du Slesvig-Holstein avait été retrouvé mort, assassiné, dans sa baignoire... (cf. Vouloir, n°30 & 31). On n’a jamais retrouvé les assassins. Si la future Grande Alliance ne peut atteindre l’Océan Indien, vu la présence militaire américaine dans les eaux de cet “Océan du Milieu”, elle doit avoir une ouverture sur le large en Mer Baltique. Ainsi se réalisera le rêve de Haushofer: celui de la “Troïka” eurasiatique, avec les trois chevaux que sont l’Allemagne (l’UE), la Russie et le Japon. Une autre stratégie de “dés-étranglement” est en train de se mettre en place dans l’Arctique: les brise-glace russes de la nouvelle génération, qui sont simultanément des usines nucléaires flottantes, générant leur propre énergie, ouvriront bientôt la voie du Nord et relieront Hambourg au Japon.
Briser l’alliance entre Washington et Ankara
5. Autre objectif: faire sauter l’alliance entre les Etats-Unis et la Turquie. Cette alliance, indéfectible jusqu’aux prémisses de l’invasion de l’Irak en mars 2003, bloquait l’Europe dans les Balkans, visait l’endiguement de l’UE sur le cours du Danube à hauteur de Belgrade, empêchait une voie terrestre directe entre la plaine hongroise et l’Egée, et endiguait ensuite la Russie en Mer Noire et dans le Caucase. Clinton, dans les discours qu’il avait tenus à Istanbul et à Ankara lors de sa dernière visite officielle en Turquie, jouait à fond la carte de l’alliance américano-turque; il exerçait des pressions constantes pour faire entrer la Turquie dans l’UE, de façon à ce que les Européens épongent les déficits turcs et accueillent son trop-plein démographique. Bush ne suit pas exactement la même politique, une politique qui était dictée, certes par les droits de l’homme, mais encore pour une bonne partie par le jeu classique des alliances. Bush II, lui, privilégie une stratégie pétrolière, bien dans la tradition de sa famille et des lobbies qui la soutiennent. La guerre en Irak est, à l’évidence, une guerre pour le pétrole. Les pétroliers américains veulent s’assurer la gestion de toutes les nappes pétrolifères du pays, voire de la région, pour trois raisons essentiellement:
a) maximiser leurs profits dans l’immédiat et couvrir les frais des opérations militaires;
b) pomper le pétrole partout et diminuer ainsi la dépendance à l’égard du pétrole saoudien, vu l’ambiguïté de la politique saoudienne, qui proclame, d’une part, sa fidélité à l’alliance américaine, mais, d’autre part, est “mouillée” dans l’affaire d’Al Qaeda, un réseau de la stratégie anglo-saxonne de l’“insurgency”, mais qui a suivi sa propre piste, jouant double ou triple jeu (cf. les ouvrages d’Eric Laurent à ce sujet);
c) ôter la gestion du pétrole à toutes les autres puissances de la masse continentale eurasienne, exploiter les champs pétrolifères pendant les années de “pic pétrolier” et au cours des premières décennies du déclin annoncé du pétrole, afin d’engranger des plus-values pour financer les technologies de l’après-pétrole et continuer de la sorte à dominer la planète.
Avec les promesses de Clinton, les Turcs avaient espéré récupérer la région du Kurdistan irakien autour des champs pétrolifères de Mossoul, quitte à envahir cette province septentrionale de l’Irak, à y liquider les implantations du PKK kurde et à l’annexer de facto, de manière à gagner une certaine indépendance énergétique, dont ils étaient privés depuis les accords de Lausanne en 1923. La stratégie américaine aurait dans ce cas parié sur son allié de longue date et fait jouer la position centrale de la Turquie dans l’arc de crises qui va des Balkans à la frontière iranienne. Mais faire jouer l’armée turque, comme le voulait la dernière administration démocrate, impliquait de renoncer à des puits particulièrement abondants. La stratégie pétrolière de Bush II ne pouvait l’accepter. Faire la guerre contre Saddam Hussein exigeait une mise énorme, qui, à terme, en butin, devait rapporter gros. Les puits du Kurdistan irakien ont constitué ce butin idéal. Pas question donc de le laisser aux Turcs.
Depuis les préliminaires de la guerre contre l’Irak, les relations américano-turques se sont considérablement refroidies. L’opinion publique turque se sent trahie. Non récompensée pour son indéfectible fidélité à l’Alliance Atlantique, depuis les prémisses de la guerre froide et la Guerre de Corée, où les troupes turques avaient payé le prix du sang pour se faire accepter dans la “communauté atlantique”.
Pire: pour conserver cette place qu’elle estimait valorisante, la Turquie avait créé les conditions matérielles de sa rupture avec les pays arabes du Croissant Fertile. Le barrage Atatürk, inauguré par l’ancien homme fort de la Turquie, Özal, entre bel et bien dans la ligne kémaliste, occidentaliste et libérale. La construction des barrages reflète une volonté de couper avec le monde arabe, avec les sources du pétrole, avec le passé ottoman. En coupant le cours des fleuves du Croissant Fertile, en limitant leur débit, les Turcs fragilisent ipso facto les économies et les agricultures de leurs voisins arabes. Ce qui va dans l’intérêt des Etats-Unis, qui, à terme, pourront pratiquer leur éternelle politique d’aide alimentaire (Food Aid) contre des matières premières ou des concessions politiques, et à consolider ainsi leur emprise sur les Etats.
Soutien total à l’Arménie
6. Faire sauter l’alliance américano-turque implique un soutien à l’Arménie enclavée dans le massif caucasien. L’an dernier, en août 2004, quelques semaines à peine avant l’abominable massacre des écoliers de Beslan en Ossétie, l’armée arménienne avait organisée des manœuvres remarquées dans la région, avec l’appui russe, démontrant par là même que le pays constituait un solide abcès de fixation, empêchant le projet panturquiste de s’élancer de l’Egée aux confins chinois, comme l’avait espéré Özal. Il faut avoir en tête que la dynamique du projet panturquiste, ou pantouranien, est l’un des ingrédients qui sert les Etats-Unis à créer le « Grand Moyen Orient » ou à asseoir leur domination sur la « nouvelle Route de la Soie », comme l’a théorisé Zbigniew Brzezinski (« New Silk Road Project »). L’objectif de toute bonne politique eurasienne serait dès lors de ralentir ou de contrer tous ces projets, en mobilisant les forces hostiles au panturquisme. Le hérisson militaire arménien est de première utilité dans toute contre-stratégie de la « Grande Alliance » que nous appelons de nos vœux.
7. Il convient ensuite d’organiser l’espace pontique, les pays riverains de la Mer Noire. Les grands axes fluviaux que sont le Danube, le Dniepr, le Don et, via le canal Don-Volga, la Volga et le bassin de la Caspienne doivent être organisé en synergies, en en excluant la Turquie, qui est étrangère à l’espace pontique, vu qu’aucun fleuve important ne provient du territoire anatolien et ne participe à la synergie hydrographique de la région. L’espace pontique doit être dominé par les puissances qui lui donnent l’eau de leurs fleuves, dans la perspective des puissances européennes qui ont voulu soustraire cet espace de civilisation à l’emprise de conquérants étrangers, des Seldjoukides aux Ottomans. Pour notre tradition politique, la reconquête de cet espace pontique, pour la consolidation de l’Europe, est inscrite à l’ordre du jour depuis plus de six siècles, depuis le Duc de Bourgogne Jean Sans Peur et la création de l’Ordre de la Toison d’Or : tous ceux qui s’y opposent, à commencer par les sinistres souverainistes gallicans qui suivent la détestable tradition de François I, sont de vils traîtres, qu’il faut empêcher de nuire et combattre sans merci. L’espace pontique sera dès demain le site sur lequel transitera le brut de la Caspienne et les gaz de Russie et du Kazakhstan : aucune puissance qui n’est pas européenne de souche ne devrait avoir barre sur l’acheminement de ces matières premières.
Soutien total à Chavez
8. Enfin, il convient de défendre les intérêts communs des principales composantes eurasiatiques de la « Grande Alliance » en Amérique ibérique et d’englober ce continent dans le combat planétaire contre Washington. Dans l’immédiat, cela implique un soutien sans faille à Chavez, président du Venezuela. L’Espagne, au nom de l’hispanité, a un rôle-clef à jouer dans cette stratégie. La présence de Zapatero au sommet latino-américain de la fin de l’année 2005 avait été un signe prometteur : Zapatero y avait affirmé le refus de tout boycott contre Cuba, qui, pour nous, demeure une province espagnole, puisque nous n’acceptons pas les retombées de la guerre hispano-américaine de 1898, déclenchée après un casus belli fallacieux et une campagne de presse hystérique et mensongère, orchestrée par l’infâme Teddy Roosevelt. Condoleeza Rice a évidemment refusé de mettre un terme à ce boycott, ce qui a créé l’unanimité contre elle et donné le rôle de la vedette à Zapatero, qui ne tiendra évidemment pas ses promesses de faux socialistes à la mode. Le premier ministre espagnol a promis de vendre des armes au Venezuela, de façon à ce que celui-ci puisse, disent les autorités américaines, « exporter sa révolution bolivariste » partout en Amérique ibérique. Lors de ce sommet, dont les travaux permettent de dégager les grandes lignes d’une éventuelle politique eurasiatico-ibéro-américaine, la promesse de vendre des armes espagnoles à Chavez est une riposte parfaitement justifiée à la vente de F-16 et d’autres matériels performants au Maroc, juste avant l’invasion de l’îlot de Perejil en juillet 2002, un acte de guerre que l’on peut considérer comme purement « symbolique ». Mais l’Europe ne peut se permettre de perdre une bataille « symbolique » supplémentaire, surtout dans le bassin occidental de la Méditerranée.
Conclusion philosophique
La vulgarisation de ce programme, son ancrage dans les pratiques diplomatiques, est le but de notre combat. Notre combat est identitaire ; il vise un retour à notre identité, à notre authenticité profonde. Mais cette authenticité ne saurait demeurer une petite pièce de musée que l’on admire avec tendresse, sans agir. Hegel nous a enseigné qu’être homme, cela ne se faisait pas seul, mais que cela se faisait au sein de « nous collectifs ». Hier, ces « nous collectifs » étaient des identités régionales ou nationales. Aujourd’hui, nous visons l’avènement d’un « nous collectif » plus vaste, celui de la communauté des peuples européens et des peuples qui refusent la logique du prosélytisme qui, comme nous l’a enseigné Naipaul, éradique les identités et rend les hommes malheureux. Hegel disait que nous ne pouvions vivre notre liberté que si nous donnions un sens, notre sens, à la réalité concrète du monde qui nous entoure. L’humanité est un mot vide de sens, ajoutait-il, si les hommes ne retournaient pas à leur moi profond avant d’arraisonner une réalité concrète, ici et maintenant, une réalité concrète qui subit sans cesse des mutations et des changements qu’il s’agit aussi d’affronter. Et l’ « humanité » de nos adversaires est effectivement un mot vide de sens, puisqu’ils refusent ce retour à l’authenticité profonde des peuples pour adopter les schémas figés, dépourvus de dialectique combattante, invitant à la démission, que leur suggèrent les prosélytes de tous poils, surtout ceux qui véhiculent les discours médiatiques. Washington représente la thèse, le pouvoir mondial en place, figé, dépourvu de sens pour les autres ; notre Grande Alliance représente l’anti-thèse, encore fragile, encore en jachère, mais seule pourvue d’un réel dynamisme. Je vous invite à y participer.
Robert STEUCKERS,
Forest-Flotzenberg, Nancy, novembre 2005.
10:35 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Inde: amie ou alliée des Etats-Unis?

L’Inde : amie des Etats-Unis, non alliée
Il suffit de jeter un coup d’œil sur la composition des forces armées indiennes pour comprendre quelle voie le pays suivait pendant la Guerre Froide. Les rapports avec les Etats-Unis n’étaient pas au beau fixe et les Indiens s’approvisionnaient en armements dans les arsenaux soviétiques. De ces bonnes relations d’antan avec l’Union Soviétique, il reste quelques solides reliefs. Ou bien doit-on dire que ces liens se renforcent à nouveau avec la Russie de Poutine ? Ce n’est pas un hasard, en effet, si le Président Poutine était récemment l’invité d’honneur lors de la fête de la Fédération indienne à la fin du mois de janvier. Après l’implosion de l’URSS, de nouvelles priorités s’étaient imposées aux deux pays. La Russie devait sortir d’une dépression profonde ; l’Inde menait à bien une série de réformes économiques nécessaires. Aujourd’hui, au bout de quinze années, les résultats de ces deux opérations politiques sont devenus visibles et les deux pays se retrouvent et se rapprochent. Un bon mot indien dit que « Putin » (selon la graphie anglaise) signifie « P » pour « planes/avions », « U » pour « uranium », « T » pour « tanks », « I » pour « infrastructure » et « N » pour « nucléaire ».
Les Etats-Unis aussi s’intéressent tout particulièrement à la « plus grande démocratie du monde ». Et ici l’adjectif « grand » signifie « très grand ». On ne fait plus guère attention, chez nous, à la Chine, tant abondent les dépêches qui annoncent la marche en avant de l’ancien Empire du Milieu ; pourtant, des voix autorisées annoncent que dans quelque 25 ans, l’Inde aura dépassé la Chine sur le plan démographique.
Messianisme
Il y a un peu moins d’un an, le Président américain Bush a dit, lors d’une visite qu’il rendait à New Delhi, que « l’Inde avait une mission historique dans le soutien à apporter à la démocratie dans le monde ». Assertion typique d’un Américain dont l’idéalisme naïf trouble quelque peu le regard qu’il porte sur la réalité du monde. Il ne s’agit évidemment pas de dire que les Indiens ne sont pas conscients de l’importance de la démocratie sur cette planète. Après les Etats-Unis, l’Inde est le principal « sponsor » du « Fonds pour la démocratie », une initiative lancée par l’ONU et soutenant dans le monde entier les projets qui apportent leur pierre à la généralisation de l’idéal démocratique. Cependant, le regard que les Indiens portent sur la démocratie est un peu moins messianique que celui des Américains. Le ministre indien des affaires étrangères a été très clair à ce propos : « Nous devons aborder les gouvernements étrangers tels qu’ils existent réellement », a-t-il déclaré. Ensuite, autre déclaration : « Nous n’avons pas l’ambition d’exporter notre propre idéologie. Chaque pays doit générer sa propre version de la démocratie ».
Une série de pays que les Américains considèrent comme des menaces pour la démocratie sont justement des pays avec lesquels l’Inde entretient de bons rapports : l’Iran, la Syrie, Cuba ou le Myanmar (l’ancienne Birmanie). Pour n’en citer que quelques-uns… Le ministre indien des affaires étrangères, Mukherjee, n’a vu aucun inconvénient à rendre visite à la junte qui dirige le Myanmar. De cette visite dépendait également un contrat fort lucratif. Et, très symboliquement, au Myanmar, dès le départ de Mukherjee, on préparait activement la prochaine visite officielle : celle d’un délégué du Congrès Populaire chinois.
Une « Grande-Bretagne » ou une « France » asiatique ?
Sur le plan de la Realpolitik, l’Inde revêt une indéniable importance stratégique pour les Etats-Unis. Mais les Américains aimeraient bien jouer l’Inde contre la Chine. La mayonnaise ne prend toutefois pas. L’ouverture de l’économie indienne aux investisseurs étrangers (et principalement américains) ne s’opère pas assez vite selon Washington. En fait, les Américains souhaitent que l’Inde joue un rôle diplomatique plus important en Asie, un continent en pleine effervescence, avec des foyers réels ou potentiels de conflit comme l’Iran, l’Afghanistan, la Corée du Nord… L’idéal, pour les Américains, serait que l’Inde devienne une sorte de « Grande-Bretagne » asiatique, un allié fidèle qui s’alignerait sur la ligne tracée par Washington dans la lutte contre le terrorisme, pour promouvoir la démocratie et le libre marché. Pur « wishful thinking », purs vœux pieux.
Certes, il existe quelques solides accords entre les deux pays. Depuis 2005, les deux puissances s’accordent à dire qu’elles sont des « partenaires stratégiques ». Elles ont signé un accord intéressant à analyser sur le nucléaire, qui a rendu certains observateurs euphoriques. Un an et demi plus tard, le réalisme est à nouveau à l’ordre du jour. La grande ambition de la diplomatie indienne est dès lors la suivante : garder les bons liens qui existent avec les Etats-Unis sans que cela ne se fasse au détriment de la politique étrangère indépendante de l’Inde. L’Inde deviendra-t-elle alors une sorte de France asiatique, c’est-à-dire une alliée qui, de temps à autre, optera pour une politique diamétralement opposée et suivra sa propre voie ? Dans les années à venir l’Inde sera sans doute une puissance qui se situera à mi-chemin entre la position de la « Grande-Bretagne » asiatique et celle de la « France » asiatique. Ou comme le formulait récemment un diplomate indien : « L’Inde ne sera jamais une alliée des Etats-Unis, mais seulement une amie. Nous coopérerons en tous domaines où cela sera possible et pour le reste, non ». Une nuance de taille qui porte véritablement sur l’essentiel.
M.
(article paru dans « ‘t Pallieterke », 14 février 2007).
10:23 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Robo-bugs et nanobots: armes de demain
Karl RICHTER :
Les micro-armes de la guerre de demain : robo-bugs et nanobotsExtrait du livre de Karl RICHTER, Tödliche Bedrohung USA – Waffen und Szenarien der globalen Herrschaft, Hohenrain Verlag, Tübingen, 2004, ISBN 3-89180-071-1[= La menace mortelle des Etats-Unis – Armes et scénarios de la domination globale]. Un ouvrage à lire et faire lire, pour connaître les armes terribles de l’ennemi américain !
Au début des années 80, au 20ième siècle, l’écrivain de science fiction polonais Stanislav Lem a publié une étude sur les systèmes d’armement du 21ième siècle (1), laquelle s’est révélée une remarquable vision prémonitoire. Lem a ainsi prédit qu’à la suite du progrès technologique, d’une part, à la suite de l’élaboration d’armes toujours plus précises et mortelles, d’autre part, une certaine tendance “évolutionnaire” sera inévitable dans les forces armées de l’avenir : cette tendance, qu’il désignait ainsi, est la tendance à la miniaturisation et à la “fragmentation fonctionnelle” des instruments de combat. Et, de fait, quand on observe une série de produits “high tech” du 20ième siècle, on s’aperçoit qu’une telle évolution est en cours et qu’en règle générale elle est dictée par le besoin de se donner toujours davantage de sécurité.
Et Lem écrivait : “Pour tous les systèmes, qui se caractérisent par leur haut taux de complexité, qu’il s’agisse de systèmes industriels ou militaires, biologiques ou techniques, qu’il s’agisse de systèmes appelés à traiter d’information ou de matière, leur “infiabilité” est, de manière caractéristique et mathématique, proportionnelle à la quantité des éléments dont ils se composent (...). Pour éviter que de tels systèmes ne tombent en panne, les ingénieurs y ont injecté des trop-pleins de fonctionnalité et de capacités de résistance : par exemple, à titre de réserve d’énergie ou, notamment dans la construction des premières navettes spatiales américaines telles le “Space-Shuttle Columbia”, ils ont dédoublé voire quadruplé les dispositifs existants, ce qui fit que les premières navettes spatiales américaines possédaient au moins quatre ordinateurs principaux, pour éviter l’échec et la catastrophe au cas où la panne de l’un d’eux serait survenue. Mais il est impossible d’éviter totalement les pannes. Lorsqu’un système est composé de millions d’éléments, chaque élément est donc exposé au fonctionnement ou au dysfonctionnement de millions d’autres, ce qui entraîne que le fonctionnement de l’ensemble dépend du fonctionnement de tous les éléments, ce qui implique l’inévitabilité des pannes. La physique des animaux et des plantes, toutes espèces confondues, se composent de milliards de particules fonctionnelles, ce qui n’exclut pas que la vie elle-même est exposée au phénomène de l’échec inévitable. De quelle manière? Les spécialistes considèrent qu’il s’agit là de systèmes fiables composés de parties non fiables” (2).
La transposition des résultats de ces observations dans les systèmes futurs d’armement est évidente. Quand l’épée de Damoclès nucléaire est suspendue en permanence sur le champ de bataille et quand, le plus souvent, les armes conventionnelles de plus en plus précises et mortelles, les militaires ne peuvent plus engager sur le terrain des appareillages de grandes dimensions ou exécuter des manoeuvres tactiques englobant l’ensemble du terrain. La solution à ce défi réside dans la construction de micro-puces de plus en plus performantes, ce que permet aujourd’hui la “nanotechnologie” : cette science vise à produire des “micro-organismes artificiels intelligents dont les tâches sont plurielles; ils seront dotés d’une sorte d’”instinct” synthétique, permettant de construire de grands organismes techniques, difficiles à repérer et quasiment inattaquables car ils ne se constitueront et ne se monteront en systèmes de combat compacts que sur le terrain même où ils doivent être engagés.
L’histoire de la vie (biologique) nous enseigne de manière optimale la façon dont se déroulera une évolution de ce type : à la fin du Crétacé, il y a plus de 65 millions d’années, qui fut vraisemblablement provoquée par la chute d’un météorite sur la Terre, ce ne sont pas les grands organismes qui ont survécu, mais les petits. Les dinosaures se sont éteints, mais non pas les insectes. La miniaturisation et la diversification se révèlent donc les meilleures stratégies évolutionnaires face aux grandes catastrophes. Et Lem écrivait : “Ce que nous enseigne la paléontologie est clair. La catastrophe qui est survenue, et qui est comparable à la puissance destructrice d’une guerre nucléaire généralisée, a éliminé tous les animaux de grandes dimensions, n’a pratiquement pas affecté les insectes et n’a pas touché les bactéries. Par conséquent, il faut en déduire que, plus les effets destructeurs d’une force élémentaire ou d’une arme technique sont importants, plus les petits groupes seront épargnés et échapperont à l’annihilation. Une bombe atomique peut vitrifier et carboniser des armées entières et des soldats isolés (...). Par conséquent, ce ne seront pas des automates semblables à l’homme qui formeront les armées nouvelles, mais des insectes synthétiques, des “synsectes”, des sortes de micro-crustacés en céramique, des lombrics en titane et de pseudo-insectes volants dotés de nodalités nerveuses en laisons d’arsenic et de dards constitués d’éléments lourds et fiscibles (...). Le “synsectes” volants combineront avion, pilote et munition en un tout unifié et miniaturisé. Une telle micro-armée deviendra unité opérationnelle, qui tirera sa force de son “holicité” dans la force et la valeur combatives qu’on exigera d’elle, tout comme l’essaim d’abeilles constitue en lui-même une unité de survie, ce que n’est pas l’abeille isolée” (3).
Cela ne m’étonnera pas de voir figurer l’étude de Lem, qui date de 1983, dans la littérature spécialisée en l’an 2025, car, effectivement, les réflexions, que les stratèges qui élaborent la politique spatiale américaine couchent aujourd’hui sur le papier, vont exactement dans le même sens. Ils expriment leur espoir que la “nanotechnologie” offrira bientôt la possibilité de créer des ateliers de fabrication à l’échelle moléculaire, capables de produire des miloiers de nano-machines hautement spécialisées. Les experts partent du principe que seules vingt ou trente années suffiront pour obtenir des résultats probants dans le domaine de la nanotechnologie” (4).
Cette tendance évolutionnaire, décrite par Lem et bien d’autres, qui va dans le sens d’une diversification et d’une miniaturisation, a été bien perçue en haut liue. On ne s’étonnera dès lors pas que les stratèges de la guerre des étoiles réclament de mini- et des micro-satellites hautement spécialisés pour le Space Command. Leurs tâches seront très diversifiées, quand ils seront sur orbite. Il s’agit principalement d’engins de deux catégories :
◊ 1. Les satellites “gardes du corps” : ils serviront à protéger les grands satellites dont l’importance est primordiale. Cette mission de sécurisation sera effectuée par un grand nombre de satellites de ce type. Le document 2025 les compare à ces essaims de chasseurs qui escortaient les escadres de bombardiers américains pendant la seconde guerre mondiale. On sait déjà qu’il y aura plusieurs sous-espèces de “satellites gardes du corps” : des satellites de défense passifs et actifs, des satellites chargés de renforcer les ondes qui, si besoin s’en faut, renforceront le flux de signalisaztion émanant des satellites de communication attaqués, des satellites de maintenance et de réparation et beaucoup d’autres.
◊ 2. Les “Robo-Bugs”, ou “insectes-robots” : leurs tâches seront de “parasiter”, d’émettre des parasites à proximité des satellites ennemis, dont ils devront faire cesser le bon fonctionnement en paralysant les échanges d’ondes et en entreprenant toutes sortes d’autres manoeuvres dans la guerre électronique. Le document 2025 fait référence à une vérité stratégique éternelle, déjà mise en exergue par le théoricien chinois de la guerre, Sun Tzu, qui écrivait, dans l’une des maximes de son “Art de la Guerre” : “Toute bonne guerre se mène en créant des illusions” (5). Les futurs “robo-bugs” utiliseront, eux aussi, les techniques de camouflage, de dissimulation et d’illusion, afin de s’approcher des satellites ennemis, sans se faire repérer, afin de troubler leur fonctionnement, de pomper les informations qu’ils glânent ou de les mettre hors d’état de fonctionner. Les satellites ennemis pourront aussi être détournés, dans la mesure où les “robo-bugs” interromperont le contact qu’ils entretiennen avec leur station de contrôle. Ces satellites ennemis seront alors pris sous le contrôle de la puissance qui aura envoyé les robo-bugs. Dans la mesure du possible, il faudra laisser l’ennemi le plus longtemps possible dans l’incertitude quant à la raison de la perte de ses satellites. Le “retournement” des satellites ennemis sera la stratégie privilégiée, plutôt que leur destruction pure et simple.
Une classe particulière de “robo-bugs” devra mettre hors de combat les satellites ennemis par un bombardement par micro-ondes ou par des impulsions électromagnétiques. Ces deux modes d’intervention énergétique sont parfaitement appropriées pour les missions contre la “vie intérieure” des satellites, animés par des techniques ultra-sensibles. Les “frondes électroniques volantes” opèreront très près de leurs cibles et, par leur intervention énergétique, pourront, par exemple, parasiter les communications ennemies. On pourra les disperser dans le cosmos à l’aide soit de planeurs spatieux soit de fusées. Elles possèdent une charge énergétique d’une durée limitée, de 30 à 60 jours, et seront rassemblées après avoir perpétré leur mission de sabotage, probablement à l’aide d’un planeur atmosphérique. Elles sont donc les armes idéales contre les capacités satellitaires des pays alliés ou neutres, dont les “corps célestes” ne doivent pas être détruits mais simplement paralysés pendant un certain laps de temps, par exemple pour ne pas fournir involontairement des informations aux forces armées ennemies. Si le système de navigation européen “Galileo” venait à être mis sur orbite dans les prochaines années, c’est à ce genre d’actions de sabotage qu’il faudra s’attendre de la part du “partenaire” américain.
Comme on pouvait le lire dans le livre de Stanislaw Lem, le concept de “Star Tek” vise également à automatiser les futurs satellites de petites dimensions, à relier entre eux des “méta-réseaux” informatisés, au sein desquels toutes les composantes fabriquées prendront en charge des tâches particulières et, simultanément, nourriront sans arrêt le “cerveau d’ensemble” d’une pluralité d’informations.
Les problèmes techniques, qu’il faudra résoudre avant de mettre en état de fonctionner ces organismes satellitaires et quasi-intelligents, sont évidents. Il faudra d’abord d’autres progrès dans le domaine de la miniaturisation des processeurs, ensuite il faudra régler toutes les questions de la propulsion. Ce qui semble le plus plausible à l’heure actuelle, c’est l’élaboration de nouveaux types de batteries nucléaires et le développement de batteries solaires plus performantes. Des chercheurs français planchent depuis un certain temps sur d’autres possibilités (6). Ils ont réussi à développer une puce propulseuse spéciale pour les petits satellites et les micro-satellites, qui est formée de plusieurs couches de silicone et brûle une petiute réserve de carburant liquide. La pression gazeuse qui provient de la combustion passe par de minuscules réacteurs. Des centaines de réacteurs de ce type devraient pouvoir tenir sur une surface de quelques cm2 et rendre possibles une pluralité de manoeuvres directionnelles. Toutefois, chacun de ces réacteurs ne peut donner qu’une seule fois, car le minuscule réservoir de carburant est consommé immédiatement lors de chaque mission. Mais, dans le cosmos, il suffit de faire donner des quantités relativement réduites de forces propulsantes, pour impulser une modification de direction. La puce-fusée sera prête à être produite en série d’ici peu d’années.
Mais il ne faut pas seulement résoudre le problème de la propulsion. Pour que les micro-satellites deviennent un facteur digne d’être pris au sérieux et mis sur orbite, il faut qu’ils aient les capacités suffisantes pour propulser ces minuscules “corps célestes” en nombre suffisant.Les missions des futurs robo-bugs ne peuvent être comparées aux missions de grands satellites actuels, qui demandent non seulement plus de doigté technologique, mais aussi beaucoup de temps pour être préparé. Les robo-bugs doivent, eux, être alignés rapidement et en grand nombre.
Et, finalement, il faudra développer de nouvelles méthodes du type “Stealth”, capables de satisfaire les exigences de l’avenir. Les capacités actuelles des engins de type “Stealth”, comme les avions B-2 et F-117 sont loin d’être satisfaisantes et ne rencontrent pas encore la nécessité d’être totalement invisibles sur les écrans-radar ennemis. Les nouvelles solutions sont à trouver dans la composition moléculaire des futures couches qui recouvriront les engins de type “Stealth”. Il s’agit plus précisément de trouver des alliages spéciaux qui, non seulement seront capables de découvrir et d’analyser par eux-mêmes toutes les formes de rayons qui se présenteront, mais, simultanément, en un espace-temps absolument minimal, de transformer leur composition moléculaire, afin d’échapper à l’oeil des senseurs ennemis. On cherche donc une sorte d’”épiderme intelligent”, capable de s’auto-reproduire et de s’auto-guérir : “Des ordinateurs à l’échelle moléculaire serviront de “cerveaux” à ce bouclier de défense très particulier et permettront, ipso facto, au système de réagir en temps réel aux impulsions des unités que sont les senseurs. L’arrivée des nano-ordinateurs (...) nous procurera des machines utiles, qui seront des trillions de fois plus performantes que les ordinateurs actuels, le tout dans des dimensions moléculaires ! (...) Tout d’abord, le système classera le signal informateur arrivant comme un signal radar, un signal infra-rouge ou un signal optique (...). L’information captée par les senseurs est ensuite transmise au système de contrôle du nano-ordinateur, qui passe les ordres aux “blocs de finalisation” se situant dans l’épiderme du satellite. Ces “blocs de finalisation” fonctionnent comme des “chaînes de production” moléculaires propres et fabriquent ainsi une nouvelle couche, qui peut réfléchir ou absorber l’énergie arrivante de manière optimale (...). Cette couche, spécifique aux engins spatiaux, relève de la nanotechnologie, et se montrera capable de réparer, par exemple, des dégâts dus aux combats et portés aux véhicules spatieux (il s’agit, ni plus ni moins, d’un satellite capables de s’auto-réparer). Cette capacité d’auto-réparation autonome diminue considérablement le besoin en systèmes logistiques, ce qui entraîne, dans l’espace, une diminution importante des coûts et un bon gain de temps” (7).
Les avantages en matières de coût et de temps ont conduit au développement de petits satellites relativement plus performants au cours de ces dix dernières années. Mais les laboratoires de recherche militaires et civils sont encore bien loin de pouvoir réaliser les capacités envisagées, c’est-à-dire de transformer les micro- et nano-satellites en organismes intelligents de dimensions très réduites,capable de travailler en interaction. Dans ce contexte, nous devons souligner une finesse conceptuelle, car sinon nous risquons d’oublier que les capacités techniques réellement existantes aujourd’hui se situent encore bien en-deça des attentes futuristes. Tandis que la “nano-technologie” traite du domaine des machines les plus petites qui existent actuellement, et qui relève en effet des dimensions extrêmement réduites, que l’on qualifie de “nano” (naines), les “nano-satellites”, eux, sont par rapport à elles, des éléments envoyés dans le ciel, dont les dimensions sont relativement plus importantes. Pour donner un ordre de grandeur, ces “nono-satellites” pèsent de un à dix kilos. Comparés aux satellites “high tech” habituels, ils sont effectivement petits, mais par rapport aux micro-satellites prévus et aux tâches révolutionnaires qui leur seront dévolues, la taille des nano-satellites actuels relève d’un autre ordre d’idée.
Mais cela ne change rien au fait que la recherche bat son plein, à une cadence accélérée. L’Université de Surrey, dans le Comté anglais du Sussex, a réalise un travail pionnier depuis longtemps déjà; en 1985, une entreprise commerciale spécialisée en technologies satellitaires a été fondée : la SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd). En juillet 1995, la SSTL lance son premier mini-satellite militaire dans l’espace, dans le cadre d’une mission Ariane. En 1999, les Français emboîtent le pas. Deux ans après, l’US Air Force suit (8). Les chercheurs de Surrey estiment que le lancement de satellites, dont la taille sera celle d’une carte de crédit, sera bientôt possible. Le directeur de la SSTL, Martin Sweeting, se montre très confiant. Il effectue une comparaison, qu’il aurait pu glaner chez Stanislaw Lem ou chez les spécialistes qui ont rédigé le rapport “2025” : “Les insectes sont probablement l’espèce la plus solide sur la Terre: ils ont vu arriver et disparaître les dinosaures et, aujourd’hui, ils dépassent largement les hommes en nombre. Bien sûr, on peut dire qu’un seul insecte isolé ne peut déployer des effets réels, mais, par exemple, un nuage de sauterelles se comportera de façon bien différente. Les systèmes actuels mécaniques et micro-électroniques et la nano-technologie en marche, poussée par les besoins de l’industrie et de ses clients, nous conduiront à élaborer et à fabriquer en masse des “pico- et femto-satellites, qui seront plus petits qu’une carte de crédit. Un seul de ces satellites ne se montrera guère utile. Mais un nuage entier de “femto-satellites” mis sur orbite —avec des noyaux-processeurs interchangeables, avec un système de communication synchronisé et des capacités à indiquer très précisément leur position— nous promet l’avènement dans l’espace d’un système hautement inaccessible à toutes manoeuvres de diversion ou de sabotage et capable de se regrouper en temps réel, pour réagir très rapidement à des exigences extrêmement dynamiques (...)” (9).
Le Professeur Sweeting sait de quoi il parle. Certes, la plupart des projets actuels n’en sont qu’aux premiers stades et avancent encore lentement dans cette direction, soit vers le lancement dans l’espace de nano-machines; mais quelques-uns de ses collègues chercheurs britanniques ont pu faire des progrès remarquables en ce sens au cours de ces dernières années, même s’ils sont restés sur terre pour élaborer leurs expériences. Dans les bureaux de l’Université d’Oxford, on est convaincu de pouvoir bientôt fabriquer des micro-avions, ressemblant à des insectes, dont l’envergure ne dépassera pas 10 cm (10). Ils seront téléguidés par ondes radio ou pourront voler de manière autonome, en étant dotés de caméras minuscules, ce qui en fera des instruments d’espionnage parfaits. La clef qui fera le succès de ces appareils sera une étude détaillée du comportements des insectes en vol. Ces études prendront douze ans à l’Université d’Oxford. L’un des principaux résultats de ces études, c’est d’avoir constaté qu’il ne suffit pas de miniaturiser toujours davantage les avions conventionnels, parce qu’à partir d’une certaine dimension, la portance sous les surfaces porteuses n’est plus siffisante. Les ailes des insectes fonctionnent de manière fondamentalement différente et génèrent par le rythme de leurs battements une portance dix fois supérieure à celle des ailes d’avion.
Les constructeurs américains ont déjà réussi à exploiter ces nouvelles connaissances. La firme californienne “AeroVironment”, qui s’est spécialisée dans la construction de micros volants, a présenté le premier “insecte-robot” capable de voler au printemps 2001, le “Microbat”, un appareil volant dont les ailes mesurent 20 cm et fonctionnent comme celles d’une chauve-souris. Dans ce cas, la réalisation de ce “Microbat” a été précédé de longues recherches sur les ailes d’insectes. Le “Microbat” possède un avantage par rapport aux petits drones conventionnels : il vole plus lentement et peut modifier son comportement de vol, exactement comme les insectes et les chauve-souris.
L’objectif étant de fabriquer des engins-espions, il a été le véritable moteur de ce nouveau développement technologique. La firme AeroVironment a également développer et fabriquer un autre produit : un petit avion de 15 cm, résultat du programme “Veuve Noire” (“Black Widow”). Les forces armées américaines l’ont déjà utilisé pour parfaire des missions de reconnaissance. “A 100 m au-dessus du sol”, explique le directeur du projet, Matt Keennon, “on n’en croit pas ses yeux et ses oreilles et l’on découvre des images claires comme le cristal, qui sont immédiatement renvoyées au sol” (11). Pourtant, les caractéristiques de ces petits engins volants ne satisfont pas encore les concepteurs. Les futures générations de “micros volants” parviendront à pénétrer dans des immeubles et pourront commettre leurs activités d’espionnage dans des pièces fermées, sans se heurter aux murs. Et ils seront encore plus petits. Le “Microbat” n’est jamais qu’une étape dans cette direction.
Mais une étape parmi beaucoup d’autres étapes. Car dès le début de l’année 2001, le gouvernement américain investira chaque année la somme gigantesque de près de 200 millions de dollars dans le développement de MEM (des “Micro-Electronic Machines”). Cette part du budget est l’une des plus élevées dans l’ensemble des postes réservés à l’armement. Au cours des deux années 1997 et 1998, le budget s’élevait à seulement 134 millions de dollars, tandis qu’en 1999 déjà 71,5 millions avaient mis à la disposition de ces projets (12). La plus grande partie de ces montants sont partagés par la DARPA, soit l’agence centrale de développement et de recherche du Ministère de la Défense, par les “Sandia National Laboratories” dans le Nouveau-Mexique, soit l’agence de l’Etat américain qui est responsable du développement futur des armes nucléaires américaines. Cette dernière reprend en quelque sorte du poil de la bête dans la hiérarchie des secteurs de la Défense, grâce aux travaux entrepris pour réaliser les programmes MEM. Chez Sandia, on travaille selon la devise : “Tout ce qui est bon pour les MEM, est bon pour la défense” (13). Raison pour laquelle le gouvernement américain observe les progrès qui se font dans le domaine technologique des MEM avec les yeux d’Argus. Eric Pearson, directeur d’une autre entreprise spécialisée dans les MEM et proche de l’armée, exprime son opinion: “Le gouvernement a la main dans presque tous les projets de recherche en matières de MEM, depuis les automobiles jusqu’aux systèmes d’optique. Il observe ces domaines très attentivement” .
Entre-temps, la course a commencé. Les grandes firmes d’armement, telles Raytheon, Boeing et Lockheed Martin, ont désormais des départements qui s’occupent des MEM et ont créé des cellules de recherche en ce domaine. Des effets de synergies sont d’ores et déjà programmés. Quant aux adversaires potentiels de demain, ils ne s’endorment pas. En 1996, l’Académie des sciences militaires de Chine fait publier un article sur les multiples possibilités de mettre en oeuvre des “robots-fourmis”, qui disposeraient d’un cycle de vie de plusieurs décennies et qui pourraient être “déposés” en temps de paix sur le territoire d’un ennemi potentiel, pour être aussitôt activés si des hostilités échaudes” éclatent. Ils auraient notamment pour mission d’infiltrer et de brouiller les systèmes d’approvisionnement énergétiques de l’adversaire (14).
Les “robo-bugs” deviendront une réalité, tout n’est plus qu’une question de temps : ils seront présent d’abord sur la Terre, ensuite dans l’espace. L’évolution technique suivra, elle aussi, les traces annoncées par la nature. Non seulement, elle imitera les capacités de voler, de percevoir et de se camoufler de leurs modèles naturels, mais aussi d’autres capacités encore, bien plus vitales, telles la reproduction, l’auto-guérison et le métabolisme. Et puisque la division du travail, la spécialisation et la constitution d’Etats augmentent les chances de survie, des unités auto-organisées de “nano-insectes”, connaissant la division du travail, deviendront un jour réalité. Ernst Jünger avait en quelque sorte anticipé, il y a déjà quelques décennies, en imaginant, dans le domaine de la création littéraire, la vision d’essaims d’abeilles, créés par la main de l’homme, tels qu’ils apparaissent dans son roman “Les Abeilles de verre”. Il exprimait toutefois un certain malaise en évoquant cette invention qui dépassait son modèle original en efficacité, tout en sacrifiant l’ordre naturel pré-établi. Jünger était bien conscient des innombrables potentialités de tels essaims d’insectes artificiels, utilisés comme armes. Un passage de son roman est très explicite sur ce sujet : “Je ne savais pas ce qui m’étonnait le plus, l’invention artistique et synthétique de ces corps distincts ou leur synchronisation. Sans doute était-ce, au tréfonds, cette force chorégraphique du regard porté qui me subjuguait et m’enchantait, une puissance hautement ordonnée et concentrée, qui n’avait pas de fin (...). Oui, sans aucun doute, je me trouvais sur un champ d’expérimentation (...), sur le terrain d’aviation pour micro-robots. Je pensais que c’était des armes et je pense que j’avais vu juste (...). Lorsque Zapparoni avait réduit ses abeilles au simple rang d’ouvrières, il ne leur avait pas enlevé le dard, au contraire” (15).
Les experts de la “nano-révolution” n’émettent donc pas des prophéties pour un futur très lointain, mais pour l’année 2020. Les effets que ces engins minuscules produiront seront révolutionnaires et, en même temps, inquiétants. Les précurseurs de ce domaine scientifique envisagent déjà de créer des verres de lunettes qui ne se grifferont jamais, des cuvettes de WC qui ne devront jamais être nettoyées, des disques durs miniaturisés qui disposeront de gigantesques mémoires et des robots minuscules qui lutteront contre les tumeurs ou la calcification et la sclérose des artères. Lors d’une exposition, on a déjà pu voir le prototype d’un “sous-marin” nano-électronique destiné à surveiller médicalement l’intérieur du corps humain en y patrouillant. “Nous nous attendons à une révolution dans tous les domaines de production”, a déclaré l’expert en informatique Ralph Merkle, l’un des principaux théoriciens de la nano-technologie, “révolution qui sera liée à la possibilité d’offrir des gammes de produits bien plus vastes pour un prix considérablement réduit et qui, de surcroît, seront bien plus fiables. Ces productions seront plus robustes et aussi plus légères (...). Dans l’avenir, nous disposerons d’appareils chirurgicaux de dimensions moléculaires. Ils se porteront exactement là où nous le voudrons, là où une lésion sera survenue et où nous l’élimineront. Cela conduira à une révolution dans la médecine (...)” (16).
Mais toutes les voix ne sont pas aussi enthousiastes. Il y a celles qui nous avertissent de dangers. Le spécialiste ès-logiciels, Bill Joy, voit dans la “nano-révolution” l’un “des plus grands dangers pour l’avenir de l’humanité”. A quoi ressemblera cet avenir? Michael Crichton, auteur de best-sellers, a tenté de le décrire dans son roman “Butin” paru en 2002. Le scénario est terriblement actuel et, comme chez Lem ou Jünger, la caractéristique la plus étonnante des robots qu’il a inventé, est la capacité à s’auto-organiser. Chez Crichton, il s’agit de nano-robots qui sont téléguidés dans les airs et y virevoltent pour ensuite se regrouper en un essaim sur le lieu ciblé —par exemple une fabrique d’armement suspecte— et fonctionner comme un oeil, comme un système d’observation parfait. Dans le roman, cet essaim est fabriqué, sur commande du Pentagone, par une entreprise de haute technologie installée dans le déseert du Nevada. Mais tout finit par aller mal; les nuages de robots s’autonomisent et deviennent un danger mortel.
Crichton n’invente rien, au fond. Il se borne à exagérer quelque peu les tendances à l’oeuvre aujourd’hui en ces domaines de très haute technologie. “Les effets pour l’humanité”, écrit-il dans la préface de son roman, en citant deux scientifiques renommés, “pourraient être désastreux, plus importants que ceux de la révolution industrielle, de l’invention de l’arme atomique ou de la pollution de l’environnement” (17). Ce n’est certainement pas exagéré.
Karl RICHTER.
Notes:
(1) Stanislaw LEM, Waffensysteme des 21. Jahrhunderts oder The Upside Down Evolution (Die verkehrte Evolution), Frankfurt a. Main, 1983.
(2) Ibid., pp. 19 et ss.
(3) Ibid., pp. 55 et ss.
(4) “Star Tek – Exploiting the Final Frontier : Counterspace Operations in 2025”.
(5) James CLAVELL (éd.), Sunzi, Die Kunst des Krieges, Munich, 1988, p. 24.
(6) Kimberly PARCH / Eric SMALLEY, “Rocket chips to propel small satellites”, http://www.trnmag.com/Stories/2002/013002/Rocket_chips_to_propel_small_satellites_013002.html .
(7) “Star Tek – Exploiting the Final Frontier : Counterspace Operations in 2025”.
(8) D’après : Martin SWEETING, “Micro/NanoSatellites – A Brave New World”, in: “Guardian Unlimited”n 10 octobre 2002, http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0.4273.4274597.00.html
(9) Ibid. ; la mesure “femto” indique une taille d’un billiardième de mètre.
(10) “Butterflies point to micro machines”, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2566091.stm
(11) “Robotic insect takes to the air”, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1270306.stm
(12) D’après : George Leopold, “Military Invests In Microelectronic Machine Technology”, in : “Times”, 21.3.1998, http://www.techweb.com/wire/story/TWB19980321S0001
(13) Andrew Freiburghouse, “The MEMs Microcosm: Military”, http://www.forbes.com/aspa/2001/0402/052.html
(14) Bertil Hagman, “Ernst Jünger, the Technological Revolution and Titanism”, http://www.juenger.org/mailarchive/5_2001/mgs00006.php
(15) Ernst Jünger, “Gläserne Bienen”, Roman, Reinbeck bei Hamburg, 1960, pp. 94 & 99.
(16) Stefan Krempl, “Nano – die elementare Revolution”, http://tor.at/resources/focus/telepolis/container/heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/7273/1.html
(17) Cité d’après : Jobst-Ulrich Brand, “Killer-Kollektiv”, in: “Focus”, n°49/2002, p. 103.
06:25 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Georges SOREL: socialisme et violence
Georges Sorel : Socialisme et violence
> Source : Ange Sampieru, revue Orientations n°11 (juil. 1989).
Pour la plupart de nos contemporains, l'évocation de Georges Sorel revient le plus souvent à l'analyse du théoricien de la violence. Son ouvrage le plus célèbre, Réflexions sur la violence (1908), constitue une contribution irremplaçable au mythe révolutionnaire. On sait l'importance que constitue pour ce penseur exceptionnel le concept de "mythe". Le mythe révolutionnaire sorélien est inspiré d'une vision polémologique des rapports sociaux. La violence informe l'action révolutionnaire et l'investit d'une conception réaliste de l'histoire. Comme moyen d'agir sur le présent, le mythe prolétarien est un outil au service de la révolution anti-bourgeoise. C'est aussi un outil conceptuel qui doit d'abord s'opposer à la fois à l'utopie socialiste et au conservatisme libéral. Ce discours très original, activiste par excellence, donne une place privilégiée à l'œuvre de Sorel dans notre conception du socialisme.
Avant d'aborder l'analyse proprement dite du mythe de la violence comme idée-force chez Sorel, il est utile de présenter l'homme et son œuvre. C'est à partir de cette connaissance de l'environnement idéologique que nous pourrons, dans une 2nde partie, présenter les caractères de cette "violence" en tant que mythe et des conséquences qui en découlent sur notre propre position.
*** I. Sorel : l'homme et l'œuvre ***
Georges Sorel (1847-1922) commence sa carrière en 1889. C'est l'époque des 1ères traductions françaises des œuvres de Marx. Déjà, on peur trouver en librairie Le Capital et Socialisme utopique et socialisme scientifique ; il faudra en effet attendre 1895 pour que paraisse le fameux Manifeste du parti communiste. En France, il est un fait que le marxisme constitue en 1889 un mouvement idéologique, beaucoup plus qu'un parti révolutionnaire. Et c'est en 1893 que Sorel se convertit au marxisme. Ce rapprochement de Sorel marquera toute son œuvre. Il n'impliquera aucun attachement aveugle aux valeurs marxistes. Le personnage est trop indépendant pour inscrire ses réflexions dans un système total. Mais au fait, qui est Sorel ? Le personnage a été l’objet de nombreuses analyses aussi brillantes que contradictoires. Pour les uns, Sorel est un penseur attaché à l'école rationaliste. Pour d'autres encore, il serait un chantre remarquable de l'irrationnel. Dans ses opinions politiques, il apparaît à certains comme un conservateur révolutionnaire (une espèce rare à son époque) ; pour d'autres, il est un néo-marxiste. Et les ouvrages abondent qui veulent prouver définitivement le bien-fondé de l'une ou l'autre opinion. Pour notre part, nous ne rentrerons pas dans ce débat.
Nous suivrons une analyse chronologique, découpée en phases successives, mais où chaque strate soutient pour une part la pensée suivante. Il est indéniable que Sorel, par ex., a été séduit à un moment de son évolution par la nouveauté radicale des textes marxistes. Comment un intellectuel de son époque, ouvert aux idées neuves, en rapport épistolaire avec de nombreux intellectuels européens de toutes tendances (citons pour mémoire Roberto Michels, Benedetto Croce) n'aurait-il pas été attiré par un discours révolutionnaire proposant une lecture "scientifique" de l'histoire et de la misère. Mais il ne faut pas pour autant croire au "marxisme", orthodoxe ou non, de Sorel. De la même façon, nous ne croyons pas au soi-disant "fascisme" de Sorel, qu'il est difficile de rattacher à l'idée contemporaine (historique) que l'on s'en fait aujourd'hui où 66 années se sont écoulées depuis la prise du pouvoir par Mussolini. L'œuvre de Sorel est beaucoup plus complexe.
Selon Paolo Pastori (Rivoluzione e continuita in Proudhon e Sorel, Giuffre, Roma, 1980, 244 p.), l'œuvre de Sorel constitue "une alternative au conservatisme réactionnaire et au progressisme révolutionnaire". Ce dernier ajoute que la pensée sorélienne est un dépassement des oppositions traditionnelles de la pensée moderne entre, d'une part, les théories du droit naturel et, d'autre part, les théories subjectives du droit, du rationalisme absolu et du volontarisme. La finalité politique de l'idéologie est une révolution "pluraliste", qui restaure une société ouverte, seule à même de contrer la menace par l'entropie sociale du capitalisme. La modernité n’est pas niée, elle est intégrée dans un ensemble communautaire organique. Plus proche de Proudhon que de Marx, Sorel adhère aux fondements idéologiques du penseur socialiste français. C’est-à-dire :
- Une conception plurielle de la raison. Le marxisme est un rationalisme moniste et absolu qui, comme le capitalisme, inscrit un projet social desséchant.
- Une vision pluridimensionnelle de l'homme. Le marxisme est un réductionnisme dangereux pour l'homme (à cause de son déterminisme économique) et la société (mécanique de la lutte des classes). La prise en compte d'une dialectique sociale qui refuse le dualisme classe ouvrière/entrepreneurs capitalistes et reconnaît un jeu plus riche de rapports sociaux.
- Un projet de synthèse sociale, où le sens de l'équilibre (en devenir) des classes sociales souligne la dialectique autorité/liberté, individu/communauté, passé/présent.
Sorel et Proudhon : un rapport de continuité
Il y a sans aucun doute chez Sorel et Proudhon un rapport de continuité. Sorel est un élève de Proudhon, qui actualise sa réflexion, au cours des différentes phases de ses recherches. Pour Pastori, Sorel est d'abord : un conservateur libéral (1889-1892), puis un marxiste de "stricte obédience" (1893-1896) ; cette 2nde phase débouche sur une période de révision du marxisme déterministe et scientiste, pour aboutir en 1905-1908 à un retour à la pensée de Marx, qui sera définitivement abandonné en 1910-1911. Cette dernière phase constitue pour Sorel un point de retour à la pensée de Proudhon. Nous apprendrons donc à mieux connaître Sorel si nous voulons bien nous atteler à la tâche d'une étude sérieuse de l'auteur de La Guerre et la paix et de La capacité politique des classes ouvrières...
Proudhon est un penseur révolutionnaire dans ce XIXe siècle de la raison bourgeoise. Attaché à l'idée, il ne peut être considéré comme un "rationaliste" au sens commun du terme. Proudhon distingue plusieurs catégories du concept de raison : la raison humaine, la raison naturelle, la raison pratique, d'une part et, d'autre part, la raison publique et la raison particulière. La raison humaine est la faculté supérieure de concevoir "l'idéal qui est l'expression du libre pouvoir créateur des groupes historiques et des personnes". Face à la raison raisonnante de la pensée bourgeoise et du marxisme à prétention scientifique, Proudhon revendique avec force l'espace de liberté de la pensée historique des groupes sociaux, et même de l’homme conçu comme un être de culture non-conditionné par des déterminisnes absolus.
Cette 1ère raison est limitée à son tour par la raison dite, dans le langage proudhonien, "raison naturelle" ou "raison des choses". Elle est nécessité objective, qui retient dans certaines limites indépassables, les aspirations démiurgiques de l’homme. La raison pratique est la synthèse finale des 2 précédentes. C'est à travers elle que l'on peut appréhender la confrontation de 2 raisons, celle de l'homme libre non-déterminé par un mécanisme de la matière, et celle du réel qui est la frontière des pouvoirs créatifs humains. Proudhon s'inspire d'une conception pragmatique. La 2nde catégorie se décompose en raison publique ou générale, et raison particulière, reproduction de "l’instance de l'universalité" (la nécessité) et celle de la particularité (la liberté). La non-coïncidence des raisons évoquées implique une critique radicale des systèmes de pensée "absolutistes" en termes contemporains, des pensées totalitaires (marxisme, jacobinisme et rousseauisme démocratique). Proudhon, militant anti-totalitaire, privilégie la raison particulière. Ce "rationalisme pluraliste" informe alors la conception socio-politique de Proudhon.
La dialectique sérielle de Proudhon
La théorie des séries est un élément nécessaire pour comprendre sa pensée. Proudhon distingue dans tout processus 2 moments séparés : le 1er moment est la division-individuation (constitution de séries simples), le 2nd, celui de la recomposition de l'unité-totalité (constitution de séries composées). Proudhon affirme aussi l'indépendance des ordres de séries et l'impossibilité d'une science universelle (De la création de l'ordre dans l'humanité). Paolo Pastori parle de la "dialectique sérielle" de Proudhon, qu'il oppose à la dialectique hégélienne, et rapproche de la dialectique crocienne des instincts. Cette dialectique sérielle confirme Proudhon dans son refus de toute analyse réductionniste. L'existence sociale ne se ramène pas a un référent unique, universel et déterminant. La sociologie proudhonienne, que Sorel reprendra à son compte, est une "sociologie de la composition" (division du travail et organisation, reconnaissance des économies rurales et industrielles, fonctions centrales et décentralisation).
Cet aspect de la pensée Proudhon/Sorel est opposé aux tendances à l'unidimensionnalité de la société capitaliste. L'économie libérale qui est sa forme historique, confond ensuite liberté et libre concurrence, créant "une nouvelle féodalité anti-organique et anti-politique". Proudhon n'est pas ennemi de l'initiative individuelle. Il soumet celle-ci à sa théorie des séries. À savoir : le moment subjectif de l'initiative individuelle, et celui, objectif, de la soumission aux fins collectives du peuple.
L'apologie concomitante du monde rural constitue, chez les socialistes français, une véritable critique de "la réduction économiste de la réalité humaine" (Idée générale de la Révolution). Mais cette apologie ne doit pas être confondue avec un quelconque attachement réactionnaire au monde paysan. L'idéologie socialiste de Proudhon défend la production agricole sans lui coller des valeurs de droite, telles que le fit l'État français entre 1940 et 1944. La terre et l'industrie sont 2 facteurs de travail et de production reliées par un système englobant de fédérations. Et la révolution est "le refus de la réduction d'un ordre social pluridimensionnel à la seule finalité économique" (P. Pastori, op. cit.).
La révolution n'est pas un simple mouvement de destruction et de contestation d'une classe (la Révolution française est le mouvement de la bourgeoisie trop à l'étroit dans une société traditionnelle où les valeurs dominantes sont celles de l'aristocratie - valeurs sociales - et de l'État monarchique - valeurs du politique). Contre cette idée dévoyée de la révolution, les socialistes français (Proudhon et Sorel) ont une conception révolutionnaire de l'équilibre. La synthèse par le haut (le dépassement) de valeurs en apparence seulement contradictoires : individualité et communauté, propriété privée et intérêt public.
En ce qui concerne, par ex., la propriété, le socialisme s'oppose à la fois à son élimination radicale (communisme) et à son maintien en l'état. La bourgeoisie nie la signification sociale de la propriété. La propriété socialiste la reconnaît. D'où, chez ces penseurs, une valorisation constante de la JUSTICE, valeur pivot de la nouvelle société envisagée. Et, chez Proudhon, puis Sorel, le développement d'un discours fédéraliste, antiéconomique et anti-bourgeois (les socialistes parlementaires sont compris dans cette dernière catégorie).
Séduisante discipline marxiste et rigorisme déterministe
On doit remarquer que Sorel reste dans une position critique vis-à-vis de l'œuvre de Proudhon, qu'il accuse de tendances à un "esprit de système". "L'ontologisation" de la Justice est le fondement philosophique de l'apologie de l'équilibre. Au-delà de cette critique, Sorel reste néanmoins un élève fidèle du proudhonisme. Il rejoint Proudhon dans sa réflexion sur la liberté, qui est le nœud gordien de l'éthique socialiste. Il y a chez Sorel un attachement souvent proche de l'inconscience aux valeurs "libertaires" du "socialisme utopique". Cette méfiance et cette inconscience expliquent, pour une part, l'adhésion au socialisme "déterministe" de Sorel. Face à l'individualisme bourgeois, Sorel se tourne vers un socialisme radical, un socialisme de combat. Le marxisme représente alors chez Sorel un germe d'ordre face au chaos créé par le capitalisme de la bourgeoisie. Le monde de la production sous-tend alors cette révolution culturelle réclamée par Sorel. Sorel est partisan d'une raison pratico-politique, doublée d'une conception historiciste.
À partir de 1896, Sorel suit une évolution qui l'éloigne de cette raison déterministe. Sa critique philosophique du positivisme s'étend à un discours politique où la "raison absolue" tient le rôle souverain. Il y a, écrit P. Pastori, "une rupture radicale avec le rigide schéma matérialiste du marxisme orthodoxe". Et, en 1898, Sorel revient plus sérieusement vers Proudhon : il écrit alors L'avenir socialiste des syndicats. La révolution qui instaure la dictature du prolétariat est rejetée par Sorel. Il accuse ce projet de masquer la dictature des intellectuels. Derrière la conception finaliste et proprement "apocalyptique" de la révolution prolétarienne, entendue au sens marxiste, on reconnaît sans peine une tyrannie économico-intellectuelle, une idéocratie despotique. Et Sorel propose au prolétariat un 1er acte révolutionnaire : rejeter définitivement la dictature des intellectuels, qui reproduit la discipline externe du capitalisme. À la place, il faut instaurer une discipline interne, que Sorel qualifiera de "morale". Enfin, en 1903, Sorel, selon l'opinion de Pastori, rejoint une fois pour toutes Proudhon, quittant les terrains dangereux du marxisme orthodoxe. Il écrit alors son Introduction à l'économie moderne.
Sur 2 points surtout, Sorel est proudhonien : il faut conserver la propriété privée, qui est une garantie sérieuse de la liberté des citoyens. Cette propriété sociale est réelle face à la forme bourgeoise de "propriété abstraite" où le propriétaire du moyen de production n'est pas le producteur. 2nd point : restaurer l'idéal qui animait l'antiquité romaine d'une "compénétration harmonieuse des intérêts individuels, familiaux et sociaux". Sorel propose aussi un ordre juridique bien loin de tout "rationalisme politique". Il réclame l'apparition de nouvelles "autorités sociales". Enfin, il donne à l’État un rôle de médiateur et une fonction d'initiative.
Le mythe : outil spirituel de mobilisation
Sorel développe d'autre part une théorie des mythes sociaux. Le mythe est la synthèse nécessaire entre la raison et "ce qui n'est pas rationnel". Le mythe est une traduction symbolique du réel, qui autorise et favorise une mobilisation totale des masses. En ce sens, le mythe est le contraire du rationalisme intellectuel, par ex. celui des marxistes. Sans contester cette "raison des choses" dont parlait Proudhon et les "pesanteurs objectives" qui en découlent, Sorel retient le mythe comme outil spirituel de mobilisation. L'ordre social et ses dépendances idéologiques (comme le droit) sont fondés sur une conception commune du monde, une vision du social et du politique qui ne se réduisent pas à un pur discours rationnel. L'ordre est le résultat conjoint de cet ensemble d'images (le mythe) et d'une volonté populaire (la mobilisation).
Cette position sera à nouveau l'objet d'une révision provoquée par la "révolution dreyfusienne" de 1905-1908. Pour Pastori, il y a un retour à une conception "dichotomique" : Sorel est partagé entre la relation continue raison/irrationnel et la rupture révolutionnaire comme explosion totale et irrationnelle. On trouve ce partage dans ses écrits réunis sous le titre de Réflexions sur la violence. Sorel distingue la grève générale syndicaliste (création d'un nouvel ordre) et la grève générale politique (nous préférons dire : politico-partitocratique), c-à-d. exploitée et dirigée par les politicards sociaux-parlementaires. La révolution est un élan créateur, que la grève informe et qui consiste en une critique totale de l'ordre existant. La figure du héros révolutionnaire se dégage : le syndicaliste est le guerrier vertueux de cette révolution, mû par des valeurs de sacrifice, du désir de surpassement. Sorel analyse certaines institutions traditionnelles comme exemplaires d'une structure révolutionnaire : ainsi l'Église catholique, à la fois acteur séculier et dont les membres sont voués à un absolu. Idéalisme transcendant et action directe et permanente sur l'histoire sont les 2 qualités d'un parti de la révolution. En 1910, Sorel écrit de l’Église qu'elle est une élite.
C'est aussi l'époque où Sorel réfléchit sur les questions du droit romain et des institutions historiques qui composèrent l'ordre social antique. À savoir et principalement le patriarcat. Il distingue 3 sources de l'esprit juridique : la guerre, la famille, la propriété. La guerre est une des dimensions de la dialectique des relations sociales. Et la révolution doit utiliser à son profit cette pluralité des relations sociales, non point au nom d'un finalisme catastrophique (révolution finale du marxisme orthodoxe), mais pour le rétablissement de cette "justice supplétive", fondement de l'ordre juridique. Sorel exclut de tout compromis le domaine des relations avec la partie de la bourgeoisie qui "réduit tout à l’utile économique". D'où une certaine fascination pour la révolution bolchévique, qui n'est pas le résidu d'un quelconque attachement idéologique au marxisme, mais une reconnaissance de la révolution totale en actes. Peut-être est-ce aussi un désir de bien démarquer sa pensée de ce social-réformisme qu'il exécrait par dessus tout (Sorel parle du "socialisme hyper-juridique de nos docteurs en haute politique réformiste", in Introduction à l'économie moderne, cité par Marc Rives : À propos de Sorel et Proudhon in Cahiers G. Sorel n°1, 1983).
*** II. Socialisme et violence ***
Sorel est un grand penseur non pas tant pour ses œuvres que par l'originalité de ses réflexions et la "marginalité" de ses positions. Qui fut Sorel ? Un traditionaliste, un marxiste, un dreyfusard, un champion du syndicalisme révolutionnaire, un nationalisme volontariste ou un léniniste de cœur et d'esprit ? Certains hommes sont rétifs à toute classification. Les étiquettes ne parviennent pas à les maintenir dans une case et les maîtres en rangement ont des difficultés insurmontables à "normaliser" ce type d'hommes. Certains chercheurs se sont pourtant essayés à mieux cerner Sorel. Citons pour mémoire : Georges Sorel, Der revolutionäre Konservatismus de Michael Freund (Klostermann, 1972) ; Notre maître G. Sorel de Pierre Andreu (1982) ; enfin : Georges Sorel : het einde van een mythe, J. de Kadt (1938).
Pour Claude Polin, la question est claire : un homme qui fut tout à tour un admirateur de Marx, Péguy, Lénine et Le Play, Proudhon, Nietzsche, Renan, James, Maurras et Bergson, Hegel et Mussolini, etc. fut-il "brouillon" ? Sa réponse est tout aussi directe : il s'agit là d'un chaos apparent qui cache une logique hors des sentiers battus par la pensée universitaire. Sorel est l'homme des intuitions. Il est en même temps celui du refus total des systèmes de pensée, que beaucoup de ses contemporains voulaient imposer comme "horizons indépassables de leur temps" (exemples du comtisme et du marxisme). Cette liberté de pensée, ce désir de ne pas enfermer sa réflexion sur le monde et la société dans un cadre idéologique figé et mécanique, Sorel l’a exprimé dans un de ces ouvrages les plus forts : Réflexions sur la violence (1906).
Dans son ouvrage sur la "droite révolutionnaire", suivi de Ni droite, ni gauche, l'historien Z. Sternhell intitule un de ses chapitres : "La révolution des moralistes". Sorel est donné dans ce chapitre comme l'un des représentants les plus remarquables de ce courant "moraliste". Face au révisionnisme libéral de Bernstein et de Jaurès, attachés aux valeurs libérales traditionnelles (à propos de ces valeurs, Lafargue parlait de "grues métaphysiques", cité par Sternhell p.81), les "moralistes" sont les hommes du refus de tout compromis déshonorant : compromis avec les valeurs de la société bourgeoise, compromis avec le matérialisme sous toutes ses formes, c-à-d. : marxiste, bourgeois (on retrouve ce même sentiment dans d'autres groupements européens de notre époqu e: Congrès de Hoppenheim (1928), Congrès du Parti Ouvrier Belge (manifeste du 3 juillet 1940), où De Man évoque une révolution spirituelle et éthique devant les congressistes). Ce "socialisme éthique", on le retrouve à l'origine de ce mythe de la violence.
Violence, prolétariat et grève générale
Il est tout d'abord utile de ne pas confondre la "violence" sorélienne avec les formes physiques d'agressivité que nos sociétés modernes nous exposent. La notion de violence chez Sorel se conjugue avec 2 autres notions toutes aussi essentielles : celle de "prolétariat" (le monopoleur de cette violence) et celle de "grève générale", qui est l'arme de la révolution. Il y a en effet une liaison intime entre la grève générale et l'exercice de la violence. La grève générale est l'expression privilégiée et unique dans l'histoire contemporaine de la violence du prolétariat. C'est, écrit Sorel, un "acte de guerre", semblable à celui d'une armée en campagne. La grève générale est un acte de guerre, ce qui implique qu'elle en possède les mêmes caractéristiques. Notamment qu'elle se produit sans haine et sans esprit de vengeance. Sorel écrit : "En guerre, on ne tue pas les vaincus".
L'emploi effectif et actualisé de la violence physique n'est pas consubstantiel à la violence de la grève générale. Cette violence est une sorte de "démonstration militaire" de la force prolétarienne. La mort d'autrui n'est qu'un accident de la violence, ce n'est pas son essence. Sorel oppose la violence militaire bourgeoise et la violence guerrière prolétarienne limitée (les travaux des historiens démographes démontrent tout au contraire le caractère beaucoup plus sacrificateur et sanglant des guerres non-conventionnelles, dites "guerres atomiques", par rapport aux guerres traditionnelles). La violence de Sorel est donc une attitude, une attitude de détermination face à l'adversaire. La violence est une idée qui favorise la mobilisation et l'action qui en découle. Sorel écrit aussi : "Nous avons à agir".
Cette optique explique aussi le mépris sorélien de la classe des intellectuels, incapables de toute action offensive, ignorant du terrain des luttes. A contrario, on peut remarquer que ces mêmes intellectuels, qui refusent le contact de la réalité avec le réel, sont des dirigeants sanguinaires. Leur "violence" d'intellectuels au pouvoir (Sorel pense peut-être à la révolution de 1791 et à la répression de 1870) est erratique, cruelle, terroriste. La violence qu'ils exercent est pathologique. Elle traduit leur impuissance à réunir les masses autour de leurs valeurs. La violence sorélienne est tout à l'opposé de cette violence - on pense à la violence des jacobins de 1791, à la violence léniniste de la NEP contre les paysans d'Ukraine, etc. - parce qu'elle a pleine conscience de sa dignité, de sa générosité. Sorel se réfère à une violence guerrière qui, comme chez Clausewitz, est la marque d'une volonté. La violence est une manifestation de détermination, de fermeté dans ses objectifs et son idéal.
Cette idée de "violence créatrice" débouche sur un mythe historique chez Sorel : la grève générale. La violence volontariste est une idée qui doit se poser comme acte historique. L'idée anime une volonté et le mythe médiatise le rapport entre le réel (la grève générale) et l'idée. Le mythe, écrit Sorel, est la réalisation d'espoirs en actions, non pas au service d'une doctrine, parce que les doctrines et les systèmes sont des spéculations intellectuelles hors du champ de faction et de l'intérêt des prolétaires. La violence est la doctrine en actes, elle est volonté pure et non représentation pensée. L'idée de la grève générale est "une organisation d'images", un instinct collectif et un sentiment général qui manifeste la guerre du socialisme moderne contre la société bourgeoise. Et Sorel revient à cette notion d'intuition, qui n'est pas réductible à un classement clair, précis, bref mécanique, d'idées alignées et normalisées. La violence est, chez Sorel, proche de l'idée bergsonienne. Polin écrit : "Dans la violence, le mythe devient ce qu'il est". La notion de confusion entre le devenir et l'intuition joue le même rôle chez nos 2 auteurs.
Le syndicalisme révolutionnaire s'oppose au social-réformisme
La violence est enfin la matrice d'un socialisme prolétarien. Le socialisme de Sorel né de cette violence n'est pas un social-réformisme. Sorel fait confiance au syndicalisme révolutionnaire pour bâtir ce socialisme. Le syndicat est ce faisceau des forces vives du prolétariat. Le socialisme de Sorel refuse le socialisme du rêve ou de l'éloquence parlementaire, celui des partis et des intellectuels qui les mènent à des songeries creuses. Citons encore Sorel : "Le syndicat : tout l'avenir du socialisme réside dans le développement autonome des syndicats ouvriers" (Matériaux pour une théorie du prolétariat). Et Polin note avec justesse que le syndicat est dans l'idée sorélienne le "Cogito du prolétariat".
Sorel considère le syndicat comme la cheville de la révolution. Les groupements naturels du prolétariat sont les syndicats. Ils sont le creuset de sa volonté manifestée de libération. Le syndicat, qui exclut les intellectuels et les parlementaires, est une communauté de combat authentique. Sorel dit d'ailleurs aux marxistes que le vrai marxiste est celui qui comprend que le marxisme est inutile aux masses ouvrières. Le syndicat agit par lui-même, pour ceux qui sont ses membres. Il ne suit pas les programmes des partis et des professionnels de la pensée. Ces derniers, que Sorel appelle "les docteurs de la petite science", eurent à l'égard de ce jugement une réaction corporatiste dont Sorel se moqua. Sorel renvoie dos à dos les intellectuels des partis bourgeois et les intellectuels qui se prétendent prolétaires. Il dénonce leur nature proprement parasitaire. L'utopie de leurs discours est réactionnaire. L'intellectuel bloque le mouvement révolutionnaire et aliène la pensée des travailleurs. La révolution est pensée en actes. La révolution des intellectuels est pure image.
Mais il ne faut pas pour autant confondre "action violente" et "action pour action". Sorel, précise Polin, n'est pas un penseur nihiliste. L'agitation n'est pas la révolution. La violence ne se limite pas à une série de secousses. La violence engendre des actions que Sorel nomme "actions épiques". L'épopée révolutionnaire n'est pas négativiste, elle est une néguentropie sociale. La violence est la forme la plus haute de l'action, parce qu'elle a pour finalité de CRÉER. En ce sens, elle est responsabilisation des acteurs, noblesse des combattants, dépassement de soi-même. Elle éveille "le sentiment du sublime", et "fait apparaître au premier rang l'orgueil de l'homme libre" (Réflexions…). On peut rapprocher cet aspect créateur, proprement faustien de la violence, des valeurs nouvelles du "philosophe au marteau" de Sils-Maria.
La violence est un moyen de créer, elle n'est pas une fin en soi. Cette créativité l'investit d'une valeur sans pareil. Et elle est au service du socialisme puisque celui-ci veut, selon le mot fameux de Marx, transformer le monde et non plus seulement le comprendre. Le socialisme est une idée neuve pense Sorel. Il a cette jeunesse qui refuse les programmes et les idées claires et distinctes. Enserré dans un discours, il perd toute vitalité. Il devient vieux, identique à ses adversaires. Le socialisme est une idée en actes, c'est un produit spontané. Il est évident que ce socialisme-là n'a que peu de rapport avec les partis sociaux-démocrates actuellement existants dans les "démocraties occidentales". Le seul commun dénominateur est ce nom de "socialisme". Quant au reste...
Un socialisme étranger au monde des sophistes, des économistes et des calculateurs
Nous avons rappelé l'hypothèse de Sternhell selon laquelle Sorel est un penseur de la "Révolution moraliste". Polin le rappelle, Sorel est un "pessimiste par tempérament". Ainsi pour lui, le progrès traduit avant tout une notion bourgeoise. Il est contre Hegel et pense que "la nature humaine cherche toujours à s'échapper vers la décadence". L'homme est soumis à la loi éternelle du combat. Il doit éviter les obstacles que lui oppose la nature et sa nature elle-même (veulerie, lâcheté, médiocrité, etc.). Le grand danger de l'entropie guette l'homme. Sorel écrit : "Il est vraisemblable que les collectivités soient attirées vers un magma assez compliqué et dont la base serait le désordre". La violence révèle alors cette énergie créatrice qui combat l'entropie.
Sorel est un philosophe de l'énergie. L'homme, pense Sorel, se satisfait d'un sentiment de lutte. Dans cette optique, l'effort est plus que positif, recherché comme une fin en soi. La violence donne à l'homme une énergie salvatrice qui le retient d'être médiocre (Polin compare l'énergie sorélienne exprimée par la violence au thumos stoïcien). L'homme, par la violence émergée de son individualité créatrice, rejoint ultimement la morale. La violence est la forme permanente de la morale. La morale est donc une lutte contre l'entropie appauvrissante. On peut encore se référer à Nietzsche. La nouvelle table de morale du philosophe allemand est proche des valeurs de lutte et de dépassement que Sorel réclame des ouvriers.
Morale égale chez Sorel à sacrifice de soi, abnégation, héroïsme, désintéressement, effort. L'ouvrier est le guerrier romain, le conquérant du XXe siècle ; il doit posséder les qualités morales qui l'ennoblissent et lui assurent sa supériorité face à la bourgeoisie. Sorel parle avec sympathie de cette race d'hommes "qui considère la vie comme une lutte et non comme un plaisir". Ses maîtres-mots sont : énergie personnelle, énergie créatrice, énergie agissante. Ce type d'homme est élève du guerrier grec. Il refuse le monde des intellectuels qui l'affaiblit. Comme E. Burke, il est étranger au monde des sophistes, des économistes et des calculateurs. Et Sorel va plus loin quand il écrit : "Le sublime est mort dans la bourgeoisie" et ce sublime est l'apanage de la violence dans l'histoire. C'est la source de la morale révolutionnaire. Le syndicat renoue avec un monde de la morale, donc du sublime et de l'héroïsme. C'est un lieu, une école de moralisation collective. Le syndicat est autonome et sa morale est une conception du monde totale.
Mais Sorel est un apôtre de la violence parce qu'il croit dans la figure nouvelle du Travailleur. Sorel identifie pour nous le travail. Il récuse la dichotomie guerre/travail d'Auguste Comte. Le travail est une œuvre créatrice qui ne se plie pas au fond aux calculs sordides des capitalistes. Le travail est désintéressé. Comme la violence. La grève générale est aussi un acte libre de toute recherche de profits matériels. De même, Polin ressent la notion du travail comme une lutte à part entière. Le travail est, dans l'intuition de Sorel, un acte prométhéen. Le travail n'est pas seulement action de transformation sur les choses, il rétro-agit sur soi-même et la collectivité tout entière. La violence ennoblit la conscience du travail ; en d'autres termes, elle donne forme à l'œuvre de création et de transformation.
Le travail, qui n'est pas un simple "facteur de production" comme le prétendent les penseurs (?) et les économistes de l'école libérale, ni une source de profit pour le travailleur et de plus-values pour les entrepreneurs comme le croient les marxistes stricto sensu, est une forme sublimée de création. Il est bien évident que la violence sorélienne est une qualité qui est propre au monde des producteurs ; la réduction de la violence à une domination de l'homme par l'homme est le contraire de cette violence prolétarienne de Sorel. Sorel ajoute même qu'au cœur du travail lui-même, on trouve la violence comme moteur intime. Les notions sont ainsi reliées entre elles : Travail, Violence, Morale. Et le socialisme est ensuite le résultat de cette "vertu qui naît" (Réflexions...). Le travail est une lutte, où le producteur est soulevé par une violence absolue, et dont découle l’acte créateur historiquement.
La violence, antidote aux bassesses d'âme
Pour Sorel, il est évident que cette émergence du socialisme de la violence se fera au détriment du vieux monde bourgeois. Si la violence est une notion positive parce que créatrice, il faut qu'elle s'attende à des oppositions farouches. Sorel se propose de délimiter le territoire du conflit et de situer l'ennemi en face. La civilisation, c'est l'ennemi n°1 du socialisme naissant, ennemi qui s'appuie sur 2 autres instances du vieux monde : la démocratie et l'État. Les troupes qui défendent ces citadelles sont variées et quelquefois ennemies en apparence : c'est le camp de la bourgeoisie (libéraux, radicaux, partisans du capitalisme pur et dur, droite conservatrice) et des pseudo-socialistes (les membres responsables des partis réformistes, la "gauche" démocratique, les progressistes de toutes tendances).
Derrière ces abstractions (démocratie, civilisation, État), Sorel combat inlassablement les mêmes valeurs communes aux idéologies de la médiocrité. Il y a chez Sorel le sens de la guerre culturelle, du combat des valeurs. Il ne croit pas aux étiquettes que le discours bourgeois aime attribuer aux acteurs de son jeu. Les mots dans le jeu politique ne sont souvent que des apparences. Sorel cherche à fouiller les racines des discours. Être "socialiste" ne signifie rien si on n'est pas conscient d'une conception du monde en rupture avec la société marchande. Paresse, bassesse, hypocrisie, incompétence, veulerie, sont des traits communs aux partis officiels.
La violence sorélienne est en effet très consciente de l'enjeu réel et historique de la lutte. Les non-valeurs, qui asservissent les producteurs et lui ôtent toute liberté, sont concentrées dans la conception économique de l'homme, que les maurrassiens ont appelé "l'économisme". Les principes de cet économisme sont au nombre de 2 : la croyance au progrès matériel, la réduction de l'homme à des valeurs matérialistes. L'homme bénéficie en même temps que le confort matériel d’un "confort" intellectuel. L’homme est un énorme estomac, destiné à la soumission sociale et politique. La société de consommation est alors le plus grand camp de normalisation intellectuelle. On peut penser que la violence sorélienne aurait été en en état de rupture avec le monde occidental, et tout ce que ce monde charrie derrière lui. De la même façon, il aurait du mal à se reconnaître dans certaines critiques progressistes de la société de consommation, dont le fondement réside dans une exigence encore plus grande de confort. La philosophie du bonheur est anti-sorélienne et Marcuse serait considéré par Sorel comme un cas typique d'utopisme bourgeois. L'homme qui réclame la fin du travail, qui refuse la lutte, qui conteste la guerre sociale, cet homme que nos philosophes des années 70 appellent de tous leurs vœux, n'a que de très lointains rapports avec le producteur à la mentalité guerrière des Réflexions sur la violence.
Les illusions du progrès
Quant au "progrès", Sorel a senti le besoin de lui consacrer un ouvrage entier tant il lui a semblé que ce concept était un fleuron de la mentalité bourgeoise. Il s'agit des Illusions du progrès. L'illusion suprême d'un paradis terrestre retrouvé à la fin des temps provoque chez Sorel une réaction épidermique. Le pessimisme sorélien est la conclusion d'un constat : l'homme ne change pas fondamentalement. Sorel approuve les actes de progrès matériels mais il s'agit chez lui d'une admiration pour la "créativité" dont ces actes sont les manifestations. De la même façon, il croit au prolétariat non pas comme Marx croyait à la "classe élue de l'histoire" mais parce qu'il constate que la bourgeoisie n'a plus l'énergie de mener la lutte éternelle.
L'histoire est pour Sorel une succession d'énergies manifestées dans des groupes restreints. Le capitaine d'industrie est une figure positive. Ce n'est plus qu'une idée à son époque. En outre, les valeurs marchandes sont des valeurs de dégénérescence. Partir en guerre contre la société moderne (entendez marchande) est un point commun de Sorel et de Maurras. La haine du bourgeois, écrit Polin, est un point de rencontre entre l'Action Française et Sorel. C'est une classe sans volonté, sans honneur, sans dignité. Le régime démocratique lui convient parce qu'il conserve, non parce qu'il est source de création. Sorel parle durement de la bourgeoisie puisqu'il constate chez elle "une dégradation du sentiment de l'honneur".
Cette démocratie, Sorel la vitupère, il écrit : " (la démocratie) est le charlatanisme de chefs ambitieux et avides" (Réflexions…). Peu importe que cette démocratie soit conservatrice ou populaire, elle conserve et favorise la même décadence. Les socialistes démocrates sont des "politiciens épiciers, démagogues, charlatans, industriels de l’intellect". En outre, non contents de maintenir le peuple sous un régime oppressif (où sont les libertés des ouvriers travaillant 16 heures/jour, 6 jours/7 ?). La démocratie établit le règne de l’argent. C’est une tyrannie, une tyrannie ploutocratique, dirigée par des hommes d’argent, qui veulent préserver leurs intérêts propres. Sorel écrit : "Il est probable que leurs intérêts sont les seuls mobiles de leurs actions". Quant aux responsables de l'Internationale Ouvrière, Sorel les dénonce comme des apprentis dictateurs. Leur objectif est l'instauration d'une "dictature démagogique".
Sorel ne veut pas d'un socialisme d'État. Il manifeste dans sa critique de l'État des tendances anarchisantes, fort peu compatibles avec la dictature d'État du prolétariat désirée par les marxistes. L'État (même socialiste) est un "État postiche", porteur d'une "merveilleuse servitude". L'État démocratique s'achève dans l'histoire avec les massacres de septembre. Et ce que C. Polin appelle, comme Sorel, "le cortège idéologique" de la démocratie (droits de l'homme, humanitarisme, charité, pacifisme, etc.) ne change rien au caractère oppressif de ce régime. Sorel est l’auteur d'une phrase célèbre sur la démocratie : "La démocratie est la dictature de l'incapacité" (Réflexions…). Deux mots nous frappent : la dictature, l'incapacité.
La critique anti-démocratique de Sorel ne doit pas être confondue avec l'idéologie réactionnaire du courant autoritaire ni avec le discours conservateur de l'Ordre-pour-l'Ordre. D'ailleurs, on voit bien chez Sorel un rejet des 2 camps : le camp de la bourgeoisie, où la lâcheté domine, et celui du social-réformisme mené par la corruption. Sorel croit en la lutte des classes. Ce qui le rend irréductible aux étiquettes conservatrices et social-démocrates. La violence qui manifeste cette lutte des classes est aussi un facteur d'énergie en action. Comme Pareto, il croit que la lutte des classes accouche de nouvelles élites sur les cadavres des classes déchues. La paix sociale est pour Sorel l'état d'entropie sociale absolu. Pourtant, Sorel ne peut être marxiste parce qu'il n'adhère pas à la vision finaliste du monde de Marx. La lutte est une activité normale de l'humanité. Elle n'a pas de sens, si ce n'est celui de faire circuler les élites dans l'histoire. En résumé, la violence est porteuse d'un projet de création en devenir infini, porteuse d'une conception morale de la vie, source d'une organisation des producteurs.
*** III. Conclusions ***
Dans son introduction aux Réflexions, Sorel écrit : "Je ne suis ni professeur, ni vulgarisateur, ni aspirant chef de parti ; je suis un autodidacte qui présente à quelques personnes les cahiers qui ont servi pour sa propre instruction". Les Réflexions constituent donc un ensemble de constatations pratiques. Sorel le répète : il ne veut pas faire une œuvre universitaire. C'est plutôt une pédagogie à l'usage des syndicalistes libres, qui sont prêts à recevoir un message révolutionnaire.
La violence sorélienne est la dimension purement morale et créatrice du socialisme de Sorel. Le message de Sorel est que le socialisme n'est pas un programme politique, ni non plus un parti politique. Le socialisme est une révolution morale ; en d’autres termes, le socialisme est d'abord un bouleversement des mentalités. On pourrait parler à la limite de "révolution spirituelle". Et la violence informe ce brutal changement dans les âmes. Le socialisme sans la violence n’est pas le socialisme. Seule l'utilisation de la violence assure une révolution positive. Sorel ne reconnaît pas dans les événements de la Révolution française une violence créatrice. Il rejette tout ce qui vise à détruire pour le plaisir de détruire. La violence donne au socialisme la marque de sa noblesse. Elle constitue une valeur essentielle de l’organisation progressive et indépendante des producteurs.
Il est certain que, pour nous, le socialisme n’est pas un discours rigide. Nous ne voulons pas reconnaître dans la social-démocratie un régime ou une idéologie socialiste. Le socialisme n’est pas un ersatz bâtard du libéralisme occidental. Les régimes occidentaux qui se réclament aujourd'hui du socialisme sont, à l'exception peut-être de l'Autriche en matière de politique internationale, des compromis honteux, ou "heureux", de social-libéralisme (à ce sujet, lire dans Le Monde Diplomatique de février 1984, l'article intitulé "Un socialisme français aux couleurs du libéralisme"). Sorel avait pressenti cette involution vers un discours mixte, où socialisme et libéralisme feraient "bon ménage"...
Le socialisme de Sorel n'est pas un compromis. Il se présente comme une révolution culturelle. Son objectif n'est pas de gérer le capitalisme par un nouveau partage du pouvoir (quelles différences entre un technocrate de gauche et de droite ?) mais de poser les vraies valeurs de la révolution. La violence est un garant de la fidélité aux valeurs révolutionnaires. Il ne s'agit pas de casser des vitrines des grands magasins ni de pratiquer une violence terroriste. La vraie violence consiste à renverser les tabous. Il faut dénoncer les blocages intellectuels de l'Occident. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause le système. Voilà la vraie violence de Sorel : autonomie intellectuelle... Alors, Sorel, une alternative radicale ?...
06:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 février 2007
TIAS: nouvel instrument de surveillance totale
Karl RICHTER :
Le nouvel instrument américain de surveillance totale : “Total Information Awareness System” (TIAS)
Extrait du livre de Karl RICHTER, Tödliche Bedrohung USA – Waffen und Szenarien der globalen Herrschaft, Hohenrain Verlag, Tübingen, 2004, ISBN 3-89180-071-1[= La menace mortelle des Etats-Unis – Armes et scénarios de la domination globale]. Un ouvrage à lire et faire lire, pour connaître les armes terribles de l’ennemi américain !
Les nouvelles qui nous viennent des Etats-Unis ont quelque chose de bizarre en soi depuis quelques années, c’est-à-dire qu’elles recèlent une sorte d’aura, se situant entre les fictions d’Hollywood et les films d’horreur. Depuis le 11 septembre 2001, cette tendance s’est nettement accentuée. Pourtant, pendant toutes les années 90, on pouvait déjà s’apercevoir que l’Oncle Sam devait de moins en moins tenir compte de ses concurrents et adversaires potentiels. Les objectifs et les intentions apparaissent en clair dans les rubriques “informations” de la presse quotidienne. Ceux qui ne se satisfont pas de ces rubriques, ne devront pas surfer longtemps sur internet. Le reste du monde n’a plus le choix qu’entre l’étonnement et l’incrédulité, d’une part, les lamentations désespérées, d’autre part. Rien de tout cela n’est bien utile.
En novembre 2002, la “Süddeutsche Zeitung” présentait à ses lecteurs une autre de ces nouvelles étranges, mi-apocalyptiques. “Pêcher dans l’océan des données”, tel était le titre choisi par le quotidien bavarois. Sous-titre : “Les Etats-Unis planifient le mise sur pied du plus grand système de surveillance de tous les temps” (“Die USA planen das aufwendigste Überwachungssystem aller Zeiten”) (1).
L’objet de l’article était un nouveau système informatique qui, dans les années proches, serait mis en œuvre grâce à un investissement financier de 200 millions de dollars par an, par un sous-département du ministère américain de la défense. Ce système prévoit rien moins qu’une surveillance électronique sans faille du plus grand nombre possible de citoyens de la planète Terre. C’est cela qui se dissimule derrière l’abréviation “TIA”, soit “Total Information Awareness”.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans mon livre, il ne s’agit nullement de science fiction mais de réalité, d’une réalité qui rendra plus totale encore la domination américaine sur cette planète et qui réduira encore davantage la liberté, la sphère privée et la sphère intime des citoyens au cours du 21ième siècle.
De quoi s’agit-il? En janvier 2002, un nouveau département est créé au sein du ministère de la défense américain, l’IAO, soit “Information Awareness Office”. En français : “Bureau pour la prise de conscience de l’information”. “Awareness”, en anglais, ne signifie pas seulement “conscience”, mais aussi, et surtout dans le contexte qui nous préoccupe ici, “prise en compte”, “perception”; en français, le terme anglais “aware” peut aussi se traduire par “saisir par les sens”, “saisir par la conscience”, “capter”, “capter des informations”.
L’IAO sait parfaitement ce qu’il veut. Dans le logo de ce nouveau bureau, on aperçoit un oeil ouvert et vigilant, semblable à celui que l’on voit au dos des billets de banque américains, où l’on nous promet un “novus ordo seclorum”, un “nouvel ordre mondial”; cet oeil se trouve au sommet d’une pyramide maçonnique et regarde le globe terrestre. Les mots inscrit au bas du logo sont : “Scientia est potentia”, soit “La science est le pouvoir”. Pour ne pas inquiéter outre mesure les critiques et les théoriciens conspirationnistes, le logo a été subrepticement effacé du site de l’IAO dès l’automne 2002.
Le programme ambitieux, qui consiste à prendre le monde entier sous la loupe et de le scruter avec le regard d’un “Illuminé”, doit devenir réalité dans les prochaines années. Si les choses évoluent de la sorte, les systèmes d’écoute actuels comme “Carnivore” et “Echelon” apparaîtront comme d’inoffensifs précurseurs. Car le futur “Data-Mining-System”, qui sera issu de l’IOA, a pour objectif déclaré de saisir et d’exploiter véritablement toutes les données électroniques créées —et laissées en tant que traces— par tous les citoyens du monde. Non seulement les traces laissées par les coups de téléphone ou par l’utilisation d’internet, mais aussi à mille autres occasions : les passages à la caisse électronique de la banque, à la bibliothèque publique, à l’assurance maladie, à la pompe à essence, à l’office social, auprès de toute institution financière.
Le problème de la protection des données privées est une question purement académique pour l’IAO. Le bureau peut se revendiquer du plus haut intérêt de la nation américaine, car il lutte contre le “terrorisme”. On peut se contenter d’une simple apparence légale quand on institue un nouveau système de surveillance de cet acabit. D’après une information publiée dans le “Washington Post”, l’IAO négocie déjà avec le FBI et avec l’agence nationale pour la sécurité du trafic, la TSA, qui gère déjà les données relatives aux passagers des avions, afin d’échanger toutes informations utiles. Mais tout cela n’est qu’un début, rien que le sommet émergé de l’iceberg. Car l’oeil vigilant de l’IAO est dardé sur l’Europe. En décembre 2002, un accord a été scellé —sans qu’on ait fait beaucoup de publicité à son sujet au sein de l’opinion publique— entre le gouvernement des Etats-Unis et les ministres de la Justice et de l’Intérieur de l’UE, afin de régler, pour l’avenir, un transfert sans heurts de données entre les instances européennes en matières de sûreté et leurs homologues américaines. Lors des négociations, Washington avait lourdement insisté pour ne pas être handicapé par les standards européens relatifs à la protection des données, en cas d’exploitation des informations collationnées par Interpol. Bien entendu, l’Oncle Sam a réussi à faire triompher son point de vue.
D’après la déclaration officielle, l’objectif de cet échange et de cet accord serait “de prévenir , de repérer, d’empêcher et de poursuivre tout acte délictueux dans le cadre de la jurisprudence [sic!] propre aux parties signataires et, en particulier, de faciliter l’échange mutuel d’informations, y compris les données personnelles” (2). Rien que la formulation laisse deviner que les citoyens européens deviendront dans l’avenir encore plus transparents que jamais auparavant. Mais ce qui m’étonne encore bien davantage, c’est que ce flux routinier de quantités impressionnantes d’informations ultra-confidentielles, relatives à des millions de citoyens européens, vers les ordinateurs d’autorités américaines et de services secrets ne constitue pas un sujet à débattre au sein de l’opinion publique pour les médias et pour les politiciens.
Cet accord scellé avec les Etats-Unis constitue une nouvelle génuflexion européenne devant Washington. Si les Européens avaient refusé de céder, l’IAO aurait de toute façon pompé les réseaux informatiques européens sans couverture légale, exactement comme l’ont toujours fait des services de renseignement comme la NSA ou le réseau Echelon. Ils n’ont jamais tenu compte des droits à la souveraineté des pays européens. Nos Etats sont considérés comme inexistants. De même, la présentation officielle de cet accord par Eurobruxelles n’est rien d’autre qu’une circonlocution pour camoufler le statut d’ilote des Européens. L’accord de décembre, comme le formule le conseil de l’UE pour la justice et l’intérieur, englobe “de nouvelles formes d’assistance juridique mutuelle, rendues possibles par les technologies modernes, comme par exemple l’échange d’information sur les comptes en banque [!] et les conférences sur vidéo” (3).
Cette formulation, qui accepte benoîtement le fait accompli, est bien forte de tabac quand on connaît les règles censées présider à la protection des données informatiques en Europe. Ce qui pose encore plus problème, c’est la nouvelle dimension que prend la lutte contre la criminalité, dimension qui fait l’unanimité entre les “Big Brothers” de part et d’autre de l’Atlantique. Dans la déclaration des ministres de l’UE, on souligne la nécessité de lutter contre les crimes, “qui auraient été commis ou pourraient probablement [!] être commis dans le cadre d’activités terroristes (...)” (4).
Ces formules rappellent immanquablement le film de fiction américain, qui passait à peu près au même moment dans les salles de cinéma en Allemagne, intitulé “Minority Report”. Ce film nous dévoilent partiellement ce qu’est et sera la guerre psychologique. Le réalisateur Steven Spielberg place son scénario en l’année 2054 et il s’agit aussi de combattre des crimes qui n’ont pas encore été commis. Il y a du vrai dans cette fiction cinématographique : les procédés décrits dans ce film sont en train d’être mis au point aujourd’hui. La répartition des rôles est également exacte : les ordres viennent de Washington et l’UE a simplement le droit de jouer avec, mais à titre de simple exécutant.
A partir de janvier 2003, signalons que les citoyens non-américains sont expressément discriminés par rapport aux citoyens américains, par une décision du Sénat des Etats-Unis. En effet, l’observation permanente des citoyens américains ne plaisait pas à certains sénateurs démocrates, qui estimaient que les choses allaient trop loin. Ils ont donc demandé à ce que des limitations soient introduites dans la législation, afin que les surveillances perpétrées aux Etats-Unis soient soumises à des critères plus stricts. Mais pour le reste du monde, ces restrictions ne comptent pas (5).
Le système technique, qui rend possible cette observation permanente et tous azimuts des citoyens, se trouve encore aujourd’hui dans sa phase de développement. Rien que son nom est déjà tout un programme : “Total Information Awareness System” (TIAS). Le but de la manoeuvre apparaît clairement dans l’intitulé, exactement comme dans le logo de l’institution, avec cet oeil divin, qui voit tout. Pour des raisons de discrétion, ce logo a été transformé, afin de ne pas alarmer des “fanatiques” qui ne raisonnent qu’en termes conspirationnistes, les juristes qui cherchent à étayer la protection des données personnelles des citoyens et les âmes trop sensibles. Le sigle “TIAS” a donc reçu une autre appellation officielle depuis le printemps 2003 : l’adjectif ‘total”, qui qualifiait la nature de la surveillance informatique planifiée, a disparu; TIAS signifie désormais “Terrorism Information Awareness”. Mais, dans le fond, rien n’a changé. Aux Etats-Unis, à l’heure actuelle, on peut très vite se voir transformer en “terroriste”, surtout après le “Patriot Act” qui a été passé à l’automne de 2001. Ce n’est donc pas un hasard si le ministre de la justice Aschcroft a qualifié la loi d’”arme clef contre le terrorisme” (6). Bon nombre de libertés citoyennes ont été tout bonnement mis hors circuit par cette loi, qui a aussi rendu les citoyens américains encore plus transparents que jamais auparavant.
Actuellement, le programme TIAS est donc en phase de développement. Cette phase doit durer cinq ans. Pendant cette période quinquennale, il est prévu d’installer un prototype du système à Fort Belvoir, où se trouve le Commandement des services de renseignement et de sécurité de l’armée. Dès 2005, les prototypes en état de fonctionner, installés dans toutes les branches du projet, devront faire convergence, se mettre en réseau et se synchroniser. Les directives ont été données depuis longtemps. Tous les services secrets américains, toutes les universités renommées, tous les laboratoires de recherche et de nombreuses industries de pointe y participent, dont certaines sont très connues, comme IBM, SAIC et Visionics. “Toutes les entreprises, organisations et collaborateurs personnels, qui y participent, sont soumis à un “examen de sûreté” (“clearance”) et sont tenus à respecter scrupuleusement le secret. Quelques entreprises étrangères ont été sollicitées, mais pour l’élaboration de composantes annexes du projet, qui sont toutes considérées comme “de-classified”, c’est-à-dire non secrètes (7).
En avril 2002, près de 75 institutions participaient à l’élaboration du projet TIAS. Le budget annuel, que quelques partenaires de l’entreprise ont reçu à leur disposition, varie entre 200.000 et 1.000.000 de dollars. Cela signifie que pendant la phase de probation, qui durera cinq ans, le volume global et maximal des sommes allouées sera de 375 millions de dollars. Le personnel mobilisé à cette tâche est également impressionnant. L’institution, qui fera tourner TIAS, soit l’IAO, occupe d’ores et déjà 170.000 personnes.
Karl RICHTER.
Notes:
(1) Patrick ILLINGER, “Fischen im Daten-Ozean”, Süddeutsche Zeitung, 14 nov. 2002.
(2) Cité par : Florian RÖTZER, “Freier Fluß persönlicher Daten zwischen Europol und US-Behörden vereinbart”, http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/13831/1.html
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Florian RÖTZER, “Das DARPA-Überwachungsprojekt soll an die Leine gelegt werden”, http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/14031/1.html
(6) Michael LANG, “Big Brothers großer Bruder”, Süddeutsche Zeitung, 17 juin 2003.
(7) (auteur anonyme), “Scientia est Potentia – Wissen ist Macht” – “Die Pläne der DARPA-Behörde”, http://mlists.in-berlin.de/pipermail/ds-news/msg00827.html
06:25 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 février 2007
J. F. Mattéi: du bon usage de l'indignation
Pierre CORMARY :
Sur "Du bon usage de l'indignation" de Jean-François Mattéi
http://pierrecormary.blogspirit.com/archive/2005/09/05/du-bon-usage-de-l-indignation.html
06:30 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nationalismes constitutionnel et dynastique en Russie

Nationalisme constitutionnel et nationalisme dynastique, germanophobie et anglophobie, néoslavisme et panslavisme dans le débat russe du début du siècle
Robert STEUCKERS
Analyse: - Caspar FERENCZI, «Nationalismus und Neoslawismus in Rußland vor dem Ersten Weltkrieg», in Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Band 34, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1984. - Caspar FERENCZI, Außenpolitik und Öffentlichkeit in Rußland 1906-1912, Matthiesen Verlag, 1982.
A l'aube du siècle, la question d'Orient et celle des Détroits mobilisent l'attention de tous les polémistes russes. Après la parenthèse du communisme, qui a duré 70 ans, la Russie semble confrontée aux mêmes défis géopolitiques. Nous allons examiner, tout au long de cet exposé, comment se cristallisait les idéologies et leurs compléments géopolitiques. En effet, chaque idéologie russe proposait une géopolitique différente, sans qu'on ne puisse distinguer réellement un “bloc d'idées incontestables” qui aurait pu susciter le consensus en politique étrangère, en dépit des dissensus intérieurs.
Deux formes de “nationalismes” s'affrontent à l'aube du siècle: le nationalisme constitutionnel, libéral et pro-occidental, anglophile et germanophobe, et le nationalisme dynastique, autocratique et anti-occidental, anglophobe et plutôt germanophile.
1. Le nationalisme constitutionnel:
La caractéristique majeure de ce nationalisme constitutionnel est une référence au “peuple” (narod), non pas dans le sens essentiel et métaphysique des slavophiles du XIXième siècle, mais comme concept de transition entre la réalité autocratique de la Russie tsariste et la Douma, appelée à “libéraliser” la Russie. Le peuple des nationalistes constitutionnels n'est donc pas un concept désignant une classe, ou les classes pauvres et exclues du pouvoir, comme chez les socialistes qui déclenchent la révolution avortée de 1905. Il n'est pas non plus un concept religieux-mythique comme chez les narodniki du XIXième siècle.
Pourtout, dans le contexte de l'époque, la classe ouvrière s'éveille. Des troubles sociaux graves éclatent. En 1912, les ouvriers des mines d'or de la Lena déclenchent une grève violente. La troupe tire dans le tas. Le nombre des morts est impressionnant. Depuis cet incident jusqu'en 1914, les troubles sont constants, apportant de l'eau au moulin des socialistes et des futurs bolcheviques.
Les nationalistes constitutionnels raisonnent en termes progressistes sans limiter le concept de peuple aux seuls ouvriers, comme les socialistes, ou sans en faire la notion-clé d'une métaphysique nationaliste, à la façon des narodniki slavophiles du XIXième siècle.
Jamais la Russie ne connaîtra de synthèse entre ces deux formes d'appréhension du peuple. En Allemagne, la sociale-démocratie parvient à intégrer la classe ouvrière dans le fonctionnement du pays. Les socialistes ne partagent peut-être pas la mystique germano-nordique de la bourgeoisie, pendant allemand du narodnikisme slavophile, mais, en fin de compte, le wagnérisme était révolutionnaire en 1848 et on assiste à la fin du siècle à une wagnérisation et une nietzschéisation du socialisme. Mystique nationale et souci socialiste se compénètrent dans le Reich de Bismarck et les socialistes russes modérés, et, même, certains nationalistes constitutionnels admirent et envient cette synthèse. Ils sont enchantés de voir que Lassalle appuie Bismarck et que Liebknecht senior introduit une forme bien profilée de nationalisme dans la sociale-démocratie: l'Allemagne est la patrie des ouvriers, c'est là qu'ils bénéficient de la sécurité sociale la mieux élaborée du monde, c'est là que leurs syndicats ont leur mot à dire. Les ouvriers allemands sont les mieux émancipés. C'est grâce à l'excellence des traditions politiques allemandes.
Le modèle germanique ne pourra pas être importé en Russie en dépit des efforts de Stolypine et de Kokovtchov. La juxtaposition sans fusion ni synthèse des deux formes de nationalisme donnent les clivages suivants, qui ne seront pas surmontés:
1) Orthodoxie, autocratie paternaliste, peuple et populité au sens mystique du terme.
2) Peuple-société (idem chez Gorbatchev et Eltsine!), démocratie constitutionnelle (Eltsine jusqu'en octobre 1993!), réformes.
Parmi les tenants du nationalisme constitutionnel, on compte les “Cadets”, qui théorisent dans la cohérence un projet politique pro-occidental en Russie, que ne partagent évidemment pas les nationalistes dynastiques, les orthodoxes intégristes et les mystiques narodniki. Les Cadets, comme plus tard Gorbatchev, voudront accorder aux peuples périphériques une pleine autonomie (Polonais, Finlandais). Leur théoricien est Struve. Il veut la démocratie dans le cadre d'un impérialisme libéral. Mais il ne veut pas d'une Russie faible qui serait incapable de s'affirmer sur la scène internationale. Les efforts de la Russie doivent se porter vers le Moyen-Orient (ce qui est pourtant contradictoire avec son désir d'une alliance anglaise) et elle doit dominer pour toujours et fermement l'ensemble du bassin de la Mer Noire.
Struve s'oppose à la xénophobie et à l'antisémitisme. Comme en Allemagne, dit-il, il existe des Juifs patriotes, qui peuvent servir d'intermédiaire entre la Russie et les autres peuples, via les relais de la diaspora. Les Polonais sont un tremplin vers les Slaves de l'Ouest de confession catholique. Il faut valoriser le rôle des Polonais dans l'Empire russe, pense Struve, pour s'opposer efficacement à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. Une Pologne loyale constitue une protection du flanc occidental de la Russie, permettant par ailleurs une poussée vers le Sud et une maîtrise de la Mer Noire. Si la Russie ne parvient pas à fidéliser les Polonais à sa cause, la Pologne deviendra automatiquement un tremplin de l'Allemagne et de l'Autriche en direction de la Russie. La non-résolution de la question polonaise conduira à une vassalisation de la Russie par le Reich allemand.
L'impérialisme libéral préconise donc une alliance avec la France (pour clouer les Allemands à l'Ouest) et avec l'Angleterre, qui doit toutefois laisser à la Russie les mains libres en Mer Noire. Mais Struve aura quelques difficultés à faire admettre cette alliance anglaise: les souvenirs de la guerre de Crimée, où les Anglais et les Français s'étaient alliés aux Turcs, restent cuisants et douloureux.
A l'intérieur Struve veut une organisation bismarckienne, avec un appareil d'Etat réconcilié avec le peuple, par le biais de l'idée nationale (démocratique). L'appareil d'Etat doit se servir de l'idée nationale-démocratique, c'est-à-dire du nationalisme de la révolution de 1848, et se laisser compénétrer par elle. En bout de course, on aura un renforcement de l'Etat, comme dans la nouvelle Allemagne de Bismarck.
Finalement, l'impérialisme libéral de Struve est d'inspiration parlementariste à la mode anglo-saxonne, assorti de quelques correctifs d'origine allemande. Dans sa vision géopolitique, les Polonais et les Finlandais deviennent des alliés des Russes. Quant aux autres peuples, considérés comme moins importants ou moins développés, ils doivent subir une assimilation douce au modèle russe, comme dans le creuset américain.
2. La germanophobie et la crise bosniaque:
La germanophobie, en dépit de la fascination pour le modèle bismarckien, éclate surtout en 1908, au moment de la crise bosniaque, quand l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine (en respectant les accords de 1878). Cette main-mise sur la province centrale des Balkans, qui permet de contrôler toute cette vaste péninsule, pousse définitivement l'opinion publique russe dans l'alliance franco-britannique, alors qu'elle était fort hésitante auparavant.
Les Cadets, qui se perçoivent comme révolutionnaires dans le cadre de l'autocratie russe, chantent les mérites de l'Allemagne culturelle et sociale mais s'opposent à l'Allemagne officielle. De même qu'à la forte présence allemande et balte-germanique à la Cour du Tsar. Cette aristocratie germanique est accusée de pratiquer une politique coercitive, qui maintient les ouvriers et les paysans russes dans un état de sujétion dramatique. Les Cadets admirent la dynamique industrielle allemande mais constatent que cette dynamique s'oriente vers les Balkans, l'Empire Ottoman, le Moyen-Orient (la “Question d'Orient”) et la Perse, ce qui menace l'exclusivité russe en Mer Noire et confisque l'espoir de s'ancrer à demeure sur les rives du Bosphore et dans les Dardennelles. En 1906, la revue Novoïe Vremje évoque un complot “germano-sioniste”, où le sionisme de Herzl est défini comme un instrument allemand pour pénétrer l'Empire Ottoman.
3. Le nationalisme dynastique:
Ce nationalisme dynastique repose sur trois piliers: l'autocratie (paternaliste), l'orthodoxie et la populité au sens mystique des narodniki. Ce nationalisme dynastique s'oppose à toute forme de constitution, à toute idée de progrès, mais veut réaliser la fraternité entre tous les Orthodoxes, car l'Occident a promis la fraternité lors de la Révolution française, sans jamais avoir été capable de la réaliser. En politique intérieure, les nationalistes dynastiques veulent diminuer l'influence allemande dans la Cour, dans le haut fonctionnariat, et l'influence juive dans l'économie et le socialisme. En politique extérieure, en revanche, ils refusent toute alliance avec la France ou l'Angleterre, parce que ces pays sont les foyers du parlementarisme, du capitalisme et du constitutionalisme, toutes formes politiques jugées perverses et délétères. Les nationalistes dynastiques évoquent sans cesse le “péril jaune”: il faut battre les Chinois, les Perses, les Turcs, pour redorer le blason de l'armée. Ils développent une perspective eurasienne somme toute assez agressive et impérialiste et nous découvrons chez eux les premiers balbutiements de cet eurasisme récurrent, de Staline aux néo-impérialistes actuels. Les nationalistes dynastiques préconisent de se retirer d'Europe, sous-continent en proie à la décadence, et de se chercher, par les armes, un destin en Asie. La Russie, disent-ils, n'a pas intérêt à participer à l'équilibre européen, car toute notion d'équilibre est une idée “germano-romaine” prouvant la mesquinerie et l'étroitesse d'esprit des Occidentaux. Enfin, les nationalistes dynastiques s'opposent au néoslavisme des Slaves occidentaux, surtout des Tchèques, car ce néoslavisme est tout compénétré d'idées modernes et libérales, donc inadéquates pour la Russie.
Face à l'Allemagne, les nationalistes dynastiques sont ambivalents. Avant 1908, donc avant l'annexion par Vienne de la Bosnie-Herzégovine, ils voulaient une alliance avec le Reich. En 1908, au plus fort de la crise bosniaque, ils veulent la guerre contre l'Allemagne et l'Autriche. A partir de 1909, quand les esprits se calment, ils veulent une alliance avec l'Allemagne seule. La faiblesse des nationalistes dynastiques, c'est de ne pas avoir un théoricien de la trempe de Struve. Si ce dernier avait eu des opposants de son acabit, il n'est pas sûr que la Russie serait resté dans l'Entente.
En 1909, Menchikov, théoricien et polémiste nationaliste dynastique, développe, après la crise bosniaque une vision géopolitique assez contradictoire. La Russie ne doit pas servir de réservoir de chair à canon pour l'Angleterre. Contre le péril jaune japonais et chinois, et contre la péril blanc allemand, elle doit forger une réseau d'alliance. Dans le Pacifique et en Extrême-Orient, elle doit s'allier à la Chine et aux Etats-Unis pour damer le pion au Japon. Pour barrer la route à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, elle doit s'allier à la France, à l'Italie et aux petites puissances balkaniques (surtout la Serbie). Mais en dépit de cette esquisse contradictoire, où Menchikov est anglophobe tout en voulant s'allier à tous les pions de l'Angleterre dans le monde, il croit à la paix, estimant que les nations occidentales sont désormais trop décadentes pour oser commencer une guerre.
Les autres polémistes nationalistes dynastiques se bornent à vouloir une politique militaire défensive, impliquant un modus vivendi avec le Reich allemand. Les nationalistes dynastiques ont peur de la guerre parce que celle-ci pervertira immanquablement le peuple. Les masses de soldats mobilisés entreront en contact avec le socialisme et le libéralisme de l'Europe. Si la guerre éclate demain, disent-ils, la révolution éclatera après-demain, parce que les soldats issus du prolétariat et du paysannat seront fascinés par le modèle allemand et voudront le transposer de force dans une Russie qui n'est pas prête à le recevoir. Pire, ce modèle, occidental, germanique, ne pourra jamais harmonieusement se greffer sur le corps gigantesque de la Russie.
Dournovo, plus germanophile, plus fidèle à l'ancienne alliance entre le Tsar et Bismarck, plaide pour un partage de l'Europe centrale et orientale entre l'Allemagne et la Russie. Il souhaite une disparition de l'Empire austro-hongrois et l'apparition d'une Grande Allemagne et d'une Grande Russie, flanquées de deux petites puissances balkaniques, la Roumanie et la Serbie. Dournovo affirme que les “progressistes” sont les alliés objectifs de l'Angleterre, pire ennemie de la Russie. Les soldats russes, dit-il en reprenant l'argumentation de Menchikov, vont servir de chair à canon pour les capitalistes anglais qui veulent abattre leurs concurrents allemands. La Russie doit dès lors mettre tout en œuvre pour détourner les Allemands des Balkans et pour soutenir leurs projets coloniaux en Afrique et en Micronésie. Germanophile, Dournovo rappelle que l'Allemagne, depuis 1813, a toujours été fidèle à sa parole, qu'elle n'a pas soutenu les Occidentaux et les Turcs lors de la Guerre de Crimée et qu'en 1905, pendant la guerre russo-japonaise, elle n'a pas participé au projet anglais d'affaiblir la Russie partout dans le monde. L'Allemagne et la Russie ont des ennemis communs, argumente Dournovo: la franc-maçonnerie occidentale et le péril jaune.
Mais même les germanophiles sont hostiles à l'Autriche-Hongrie. Cet Empire est faible et bigarré (la “Kakanie” de Musil), affirment-ils avec mépris; pire, il domine des Slaves, ce qui est jugé inacceptable. La Russie et l'Allemagne doivent donc liquider de concert l'Etat austro-hongrois et s'en partager les dépouilles. Mais, nous allons le voir, l'hostilité des nationalistes dynastiques russes à l'Autriche-Hongrie n'est pas du tout de même nature idéologique que l'hostilité des néoslaves tchèques.
4. L'anglophobie russe:
L'anglophobie russe est de même nature que l'anglophobie allemande de la même époque. Les polémistes anglophobes utilisent le même vocabulaire. Pour eux, l'Angleterre est le berceau de la modernité et du capitalisme. Les anglophobes russes les plus radicaux et les plus virulents opèrent une distinction entre anglo-osvoboditel'noïe (anglo-libéral ou, plutôt, anglo-libériste) et germano-pravoïe (germano-juste, germano-orthodoxe, germano-droit, germano-cohérent, en vertu de la grande plasticité sémantique du terme pravo). De plus, vogue darwino-racialiste aidant, les Russes anglophobes proclament que les Allemands sont plus fiables parce qu'ils ont du sang slave, alors que les Anglais en sont dépourvus. L'anglophilie est attribuée aux Cadets, aux “Oktobristes” et à certains “néo-slavistes”. L'anglophilie veut introduire le parlementarisme en Russie, ce qui l'affaiblira et la ruinera, la réduira à un statut de colonie. Il y a incompatibilité entre orthodoxie et anglicanisme.
La question bosniaque, estiment les polémistes anglophobes, est exploitée par Londres pour entraîner la Russie dans une guerre contre l'Allemagne, donc pour utiliser le potentiel biologique des masses russes pour éliminer un concurrent en Europe. Les Anglais veulent aussi attirer la Russie hors d'Asie, où elle faisait directement face aux Indes, clef de voûte de l'Empire britannique.
Cette droite national-dynastiste radicale et anglophobe minimise curieusement les contradictions qui existent entre Allemands et Russes au Proche-Orient. Car si la puissance économique allemande s'empare des Balkans dans leur ensemble, en fait un “espace complémentaire” (Ergänzungsraum) de la machine industrielle germanique, s'allie aux Ottomans et contrôle de ce fait implicitement les Dardannelles, tous les vieux espoirs russes et panslavistes de contrôler effectivement l'ancienne et mythique Byzance s'évanouissent. Les nationaux-dynastistes radicaux veulent une grande offensive de la puissance russe en Asie, car là-bas, les soldats russes ne seront jamais contaminés par les idées subversives et révolutionnaires de l'Allemagne et de l'Occident.
Dans la Question d'Orient, où l'Allemagne, qui n'est pas une grande puissance coloniale africaine en dépit de son installation au Togo, au Cameroun, au Tanganika et dans le Sud-Ouest africain, cherche des débouchés dans les Balkans et dans l'Empire Ottoman. Elle cherche à organiser une diagonale partant de Hambourg pour s'élancer vers Istanbul, Mossoul, Bagdad, Bassorah et, de là, se tailler une “fenêtre” sur l'Océan Indien, que les Britanniques considéraient comme leur chasse gardée. L'organisation de cette diagonale impliquait une alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et l'Empire Ottoman. Les Russes, du moins qui ne voient aucun inconvénient à cette gigantesque alliance, estiment que la Russie doit s'y joindre indirectement en organisant de son côté une diagonale parallèle, partant de Moscou vers le Caucase et, depuis cette chaîne de montagne, vers les hauts plateaux de l'Iran et, enfin, vers les rives du Golfe Persique et de l'Océan Indien. La Russie aussi devait se tailler une “fenêtre” donnant sur la “Mare Nostrum” indo-britannique. Pour réaliser cette diagonale Moscou-Téhéran, il fallait empêcher l'avènement du parlementarisme en Iran. Le diplomate polonais, inféodé aux Cadets, Poklevsky-Kotsell, tente, avec l'appui implicite des Anglais, d'introduire le parlementarisme en Iran; ce sera un échec qui conduira à l'anarchie. Les nationalistes-dynastistes tirent les leçons de cette aventure: la Russie doit soutenir l'autocratie du Shah; ils esquissent ensuite une politique eurasienne: les Allemands s'allient aux Ottomans et organisent l'économie du Moyen-Orient, les Russes soutiennent le Shah et aident à la réorganisation de la Perse. Allemands et Russes marchent de concert vers l'Océan Indien, sur des routes diagonales différentes, pour y occuper des positions bien circonscrites.
Les nationalistes-dynastistes veulent une politique de force. Leur raisonnement? Si les Français occupent le Maroc et les Anglais l'Egypte (1882), alors la Russie a le droit d'avancer ses pions en Perse et de les y ancrer. Les Allemands et les Austro-Hongrois s'installent dans les Balkans parce qu'ils sont bloqués en Afrique et en Amérique latine par la «baleine anglaise». Si les Slaves balkaniques sont lésés, c'est à cause de l'Angleterre.
5. Le néo-slavisme:
Entre 1905 et 1914, avec une nette recrudescence lors de la question bosniaque en 1908, s'organise en Europe orientale un mouvement “néoslaviste”. On ne confondra pas ce néoslavisme avec le panslavisme, dont l'apogée se situe entre 1860 et 1880. Le néoslavisme préconise le libéralisme, pour les Russes comme pour les autres peuples slaves. Mais ce libéralisme conduira à un échec relatif du néoslavisme, dans le sens où, à l'époque des guerres balkaniques, la majorité balkanique des congrès néoslavistes impose une ligne conservatrice, plus proche de l'ancien panslavisme. Mais ces congrès demeurent hétéroclites: les clivages religieux (entre Catholiques et Orhodoxes) restent trop forts, mêmes dans leurs formes laïcisées. Les Polonais s'opposent aux Russes et les Serbes aux Bulgares. Le seul résidu du néoslavisme a été le renforcement de l'illyrisme ou yougoslavisme, y compris chez les Croates.
Le néoslavisme entendait “libéraliser” les idées de Danilevski et de Dostoïevski, où austrophobie et anti-catholicisme se mêlaient étroitement. Il voulait promouvoir un slavisme libéral, constitutionaliste, pro-occidental, “européen”, mais les nationalistes-dynastistes, souvent germanophiles, estimaient, sans doute à juste titre, que ce néoslavisme était une manœuvre anglaise, car il ne contrecarrait pas les projets britanniques en Asie. Il convenait aux Tchèques et aux Polonais, moins aux Russes, qui entendaient conserver les atouts de l'autocratie, ou qui préféraient le retour à la ligne conservatrice dure du panslavisme ou de l'école de Danilevski. Tchèques et Polonais, en outre, ne saisissaient pas l'importance géopolitique de la Perse et de l'Asie centrale, où les intérêts russes et anglais entraient directement en collision. Ce néoslavisme était diamétralement opposé aux idées de Konstantin Leontiev, pour qui l'Empire ottoman et l'Empire russe devaient coopérer pour barrer la route au libéralisme anglais et occidental, éventuellement avec l'appui du Reich. Leontiev ne voulait pas d'irrédentisme slave en Autriche-Hongrie et dans l'Empire Ottoman, à la condition que les Slaves puissent vivre sous un régime traditionnel, autocratique, religieux, sans être livrés aux affres de la déliquescence libérale/occidentale. Les dissidences slaves dans les Empires sont toujours, aux yeux de Leontiev, des dissidences libérales.
6. Conclusion:
Les polémiques entre les différentes fractions du nationalisme russe du début du siècle sont instructives à plus d'un égard: elles nous enseignent quelles sont les diverses options géopolitiques qui s'offrent à la Russie. Aujourd'hui, où la chape communiste n'existe plus, ces options contradictoires et divergentes reviennent à l'avant-scène. Il me semble bon d'analyser les effervescences actuelles ou les projets géopolitiques formulés dans l'actuelle Douma sur base d'une bonne connaissance historique. Tel est l'objet de cet exposé et de cet article.
Robert STEUCKERS.
(Conférence prononcée à Strasbourg en avril 1994, dans le Cercle animé par Pierre Bérard et à Paris, en juin 1994, lors de la visite d'Alexandre Douguine en France)
06:30 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 23 février 2007
G. LOcchi: Definizioni

Definizioni
Editore: Società Editrice Barbarossa
Autore: Giorgio Locchi
Anno: 2006
Pagine: 320
Sezione: Arte cultura e letteratura
Argomento: Cultura e intellettuali
Codice: BROSSA0276LB
Prezzo:18,00 € (I.I.)
Attenzione: la scheda completa di questo libro al momento della messa in vendita.
16:40 Publié dans Définitions, Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
J. de Maistre ou le Sade de l'ordre moral
Pierre Cormary:
Joseph de Maistre ou le Sade de l'ordre moral
06:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
R. Lussac: Devenir de la civilisation occidentale
Rodolphe LUSSAC :
Réflexions sur le devenir de la civilisation occidentale: entre agonalité et irénisme
Le cours de l'histoire contemporaine et événementielle, avec son cortège de guerres, de conflits inter-ethniques, de catastrophes humanitaires, de terrorisme transnational, met en exergue, et de manière évidente, l'irruption, ou plutôt le retour en force, du fait religieux et de l'irrationalité politico-idéologique, qui s'enracinent dans les différentes aires civilisationnelles et minent peu à peu les fondements humanitaro-pacifistes de la civilisation occidentale moderne.
Ce constat nous conduit à nous interpeller sur le sens et le devenir des civilisations et surtout de la destinée de la civilisation occidentale. S'il est établi, en reprenant un mode de pensée spenglerien, que toutes les civilisations sont périssables, il est pertinent de s'interroger sur les causes de déclin et de mort des dites civilisations. En ce sens, il convient de rappeler qu'à juste titre, Arnold Toynbee a affirme que les civilisations se font par l'action des minorités créatrices et se défont quand la force de création diminue. En un mot, toute civilisation est vouée au déclin lorsqu'elle n'a plus de défi à relever. Force est de constater que la civilisation occidentale (qui serait constituée de l'aire civilisationnelle européenne et “extrême-européenne” américaine) serait indéniablement vouée au déclin par défaut de défi régénérateur et d'absence d'élites créatrices de valeurs et vecteurs de mimétisme socio-politique , qui transcendent les seuls pseudo-défis économiques et financiers qui justifient les entreprises belliqueuses comme c'est le cas pour les Etats Unis.
Hobbes et Kant
La perception que l'on se fait de la civilisation occidentale procède d'une dissonance cognitive (pour reprendre un concept sociologique) entre, d'une part, l'image d'une Amérique va-t'en guerre dont les valeurs se fondent sur un réalisme “hobbesien” de recours à la force et, d’autre part, l'image d'une Europe bercée par l'irénisme kantien et idéaliste d'une "paix perpétuelle" et illusoire, aux accents mielleux, “pacificards”, dignes des héritiers de Kellog et de Briand. L'un et l'autre des deux camps qui sont l'incarnation d'un même mal économiciste et ploutocratique, pêchent par excès d'ignorance car tous deux se réfèrent de manière messianique (pour les Etats Unis) et de manière timorée (pour l'Europe) aux sacro-saintes pseudo-valeurs désuètes de la démocratie, de l'économie libérale de marché et de l'égalitarisme “droit-de-l'hommien”, qu'ils entendent propager coûte que coûte aux "confins barbares" et périphériques des autres peuples et civilisations extra-occidentales. Baignant dans le registre bien connu de la pensée unique, de l'indignation, de la condamnation et du pathos incantatoire face au terrorisme de type ethnique et religieux, ils se refusent à croire que, malheureusement, le moteur de l'histoire humaine résulte de ressorts irrationnels enracinés dans la religion et l'identitarisme national et ethnique dont les irruptions violentes sont cycliques mais constantes.
De récentes fouilles archéologiques et anthropologiques ont établi que le sacrifice humain rituel était la pierre angulaire de toute civilisation, et que la guerre a bien été à la source des premières civilisations et constitue un processus nécessaire du degré de complexification des dites civilisations (l'action guerrière serait fondatrice de la première ville-mère), alors que les thèses sociologiques conflictuelles comme celles avancées par Lewis Coser (http://www.net-lexikon.de/Lewis-Coser.html - http://www.asanet.org/footnotes/septoct03/indexthree.html - http://cgi.sociologyonline.co.uk/News/coser.shtml) ainsi que l'herméneutique de Gadamer démontrent combien les préjugés, les conflits sociaux et la conflictualité générale ont joué un rôle de résolution et de stabilisation des sociétés humaines. La principale erreur de jugement de la civilisation occidentale moderne est de croire aveuglément que toutes les civilisations se valent sur un même pied d'égalité et sont réductibles à l' omniprésence de la démocratie, des droits de l'homme et de la suprématie de l'économie de marché.
Agonalité
L'histoire démontre au contraire que toutes les grandes civilisations ont émergé et vécu sur un mode d'agonalité ( d'opposition, de conflictualité), un mode donc éminemment conflictuel, et s'insèrent dans une structure d'inégalité. Déjà les travaux de Lévi-Strauss faisaient état d'une opposition entre cultures chaudes et cultures froides, par référence aux cultures actives prométhéennes et aux cultures passives et contemplatives. L'anthropologue K. Avruche (http://www.republique-des-lettres.com/samuel_huntington/huntington_contre.php ) a démontré, en ce sens, que les concepts de tradition et de nation sont impliqués dans un processus constant et interactif de constructions sociales et culturelles et résultent de luttes et de conflits d'identités opposées. Ainsi, les matières premières des traditions, de la religion et de l'idéologie peuvent être utilisées pour générer une gamme extrêmement large de civilisations alternatives. Dans cette structure d'inégalité agonale, on assiste à une échelle variable du fait religieux, des ressorts irrationnels, de degrés divers de sacralisation et de sécularisation qui font que les civilisations, à un moment donné historique, peuvent se compénétrer, évoluer de manière synchronique, puis dériver vers une confrontation diachronique de rupture et d'hostilité (le cas le plus flagrant pour la période pré-moderne est celui de l'Empire musulman d’ Al-andalus en Espagne, annihilé à la fin du 15ième siècle par la Reconquista).
A l'époque du mondialisme triomphant, les changements brutaux, économiques et sociaux, détachent les peuples de leur identité locale séculaire. La dé-sécularisation du monde, remarqué par Arthur Weigall, est une réalité de la vie contemporaine. Dans la plupart des civilisations du monde, la religion vient combler ce vide spirituel par un retour aux racines identitaires: “asianisation” au Japon, hindouisation en Inde, ré-islamisation au Moyen Orient, etc. Le fait religieux et, plus largement, la religion, constituent un facteur structurant et permanent de l'identité nationale, sous forme de ciment d'une identité nationale menacée, et certains aspects de la religion cristallisant les antagonismes sociaux entre nations et communautés cohabitant au sein d'une même nation, et peuvent aboutir à des manifestations de violence fanatique, reflet de l'exacerbation du moi collectif, de doctrine libératrice ou de messianisme prophétique, qui peuvent être, tour à tour, conjoncturelles ou structurelles (cf. Les travaux récents de l’anthropologues américaine Amy Chua, originaire de la communauté chinoise des Philippines).
Principes structurants et hiérarchies de valeurs
Les conditions de structuration et d'évolution d'une culture ou d'une identité sont évolutifs et, par rapport à d'autres cultures étrangères, s'articulent selon les principes structurants et des hiérarchies de valeurs variables d'un groupe à un autre. Les contacts peuvent être pacifiques mais sont le plus souvent conflictuels. Les sociologues appellent “acculturation” le fait, pour les membres d'une culture donnée, d'adopter contre leur gré des éléments d'une autre culture; les conquêtes militaires sont souvent suivies de stratégies d'acculturation, d'assimilation, voire de destructions pures et simples. Ainsi, les civilisations connaissent une phase d'expansion caractérisée par un processus combinant la dilation spatio-temporelle, l'absorption-domination de cultures mineures, d'assimilation et d'acculturation.
A la lumière de cet enseignement, force est de constater combien est vulnérable la civilisation occidentale matérialste et libérale, laquelle a pour base des stéréotypes médiatiques et des dingueries publicitaires, et doit, à l’aide de ces pauvres schémas, faire face aux assauts parfois violents et aspirants d'autres civilisations théocratiques et holistes, car elle a déjà succombé au phénomène d'acculturation, adoptant des modes vie et de pensée extérieurs, que je qualifierai d’ “orientalo-anglo-saxons”, de sorte que le pacte culturel "originel", européano-centré, qui touche à la structuration intellectuelle, affective et symbolique (vision du monde, attitudes morales, croyances, réactions affectives) est largement contaminé par des éléments exogènes et verse dans l'anomie généralisée.
Ce n'est qu'au prix d'une ré-européanisation identitaire, que l'Europe redeviendra ce qu'elle est et que l'européanité (Roland Barthes parle aussi d'américanité) ne sera plus un vague concept technocratique vide de sens et définira une essence spirituelle héroïco-aristocratique comme l'a si bien évoqué Hugo von Hoffmannsthal. A cette “acculturation culturelle” qu’est la colonisation culturelle de l'Europe, les peuples européens opposeront le retour à leur propre identité culturelle, à un nativisme post-moderne, qui se traduirait par le rejet de toute culture étrangère dominante, vecteur de ce que Léo Hamon appelle la “causalité extérieure comme forme absolue d'hétéro-détermination”; les Européens se dresseront pour réactiver leurs cultures chtoniennes spécifiques, et, dans ce mouvement, viendrait éclore ce que le sociologue Heiner Mülhmann (http://www.brock.uni-wuppertal.de/Schrifte/Habil/Rezens1.html ) nomme l'adhésion et l'identification de la masse à un chef prestigieux et charismatique dans le sens wébérien du terme et ce que Jean Lacouture appelle "l'homme-témoin-drapeau" qui incarne l'identité nationale.
La société néo-libérale gangrénée par le syndrome de la modernité
La société globale et néo-libérale est irrémédiablement gangrénée par le syndrome de la modernité, vision mono-linéaire de l'évolution de l'humanité, le miroir aux alouettes des parvenus et des drogues de l'illusion du progrès, l'ambition des "feuilles mortes" comme l'appelait Kundera, la chasse gardée de la caste du "mandanirat" technocratique, vilipendé par Noam Chomsky comme les représentants de la nouvelle oligarchie ploutocratique. Au lieu de se lamenter sur son sort et de faire l'anathème d'un monde qui trébucherait sur des anachronismes et des guerres de religions, la civilisation européenne (enfin ce qu'il en reste) ferait bien d'accepter l'évidence que la religion est une expression naturelle, une forme de croyance, la traduction d'un désir d'interprétation du monde et qu'au lieu de s'indigner et de dénoncer la violence aveugle, elle s'attache à réfléchir sur la grille de lecture que procure le radicalisme religieux et plus précisément sur le sacré, qui, selon Regis Debray, se révèle être une voie de compréhension et d'accès au profane.
Le fait religieux restera indubitablement un indicateur de la réalité humaine et collective. A rebours d'une Amérique messianique contemporaine, qui, au moins, a eu le mérite de remettre au goût du jour le concept de recours à la force, la civilisation européenne plonge dans un irénisme béat et fonctionne sur un mode expiatoire d'auto-flagellation, rongée par ce que Spinoza fustigeait comme la complainte sanglotante de l'homme blanc : le remord, le ressentiment et la propension européenne à culpabiliser sur son passé colonial, ainsi qu'à se morfondre dans une compassion “victimaire” au lieu de se ressaisir sur un mode matriciel et de renouer avec le concept de puissance fondé sur un projet commun géopolitique eurasiatique, la défense des valeurs spirituelles, politiques et culturelles séculaires.
Même si les thèses de Huntington sur le choc de civilisations pêchent par réductionnisme et par culturalisme, et font l'impasse sur les conflits intra-civilisationnels (qu’Amy Chua met bien en exergue), elles ont eu le mérite de remettre au goût du jour les ressorts conflictuels latents, inhérents à toute civilisation, ressorts qui peuvent être, selon le contexte, réactifs par la religion, l'identité ethnique et nationale. A l'instar de ce que l'historien Edward Gibbons a declaré jadis, à savoir que dans l'histoire des civilisations, seuls la naissance et le décès ont une valeur explicative, l'analyse des causes de déclins des civilisations s'avère fondamentale, sans oublier que le déclin de la civilisation occidentale moderne et libérale peut être une lente agonie, compte tenu des capacités d'autorégulation et de régénération du capitalisme de marché, si bien expliquées par Joseph Schumpeter.
Le philosophe Ernst Troeltsch, qui se rattache à l'école de Bade et à l'historisme de Dilthey, a considéré qu'il existe une unité de devenir à travers chaque culture et ses valeurs, et l'on pourrait dire qu'il existe indéniablement une unité de régression propre à toutes les civilisations dont les symptômes sont: anomie généralisée, multiculturalisme exacerbé, persistance du crime, drogue et violence, déclin de la famille et de la natalité, déclin du capital social, faiblesse générale de l'éthique et du civisme, désaffection pour la politique et le savoir, suprématie de l'industrie du spectacle, syncrétisme néo-spirituel et hédonisme généralisé.
De la “communauté de gorets” (Platon) au “meilleur des mondes” (Huxley)
Arnold Toynbee écrira, à juste titre, que la civilisation contemporaine est corrompue par les images et les ondes et le résultat de cette désastreuse nouvelle donne culturelle a été le désert spirituel que Platon avait décrit comme une "communauté de gorets" et qu’Aldous Huxley avait raillé sous le nom de "meilleur des mondes". L'imaginaire collectif européen est purement et simplement colonisé par la société de la communication et de l'information, l'hyper-festif fictif et par les pilules anesthésiantes de la télé-réalité, qui constituent aujourd'hui ce que Louis Althusser appelait les relais modernes de l'"appareil idéologique d'Etat".
Tous ces maux qui accablent la civilisation occidentale procèdent d'un principe du mal que Baudrillard a nommé le “principe de dé-liaison”, ce qui veut dire que l'Occident est en dé-liaison avec ses racines spirituelles et cuturelles comme la societe occidentale est en “dé-liaison” avec le respect du civisme, de l'autorité et de la hiérarchie. Pour se régénérer , la civilisation occidentale se doit de se soumettre à un devoir de mémoire, non pas une mémoire accablante et culpabilisante, mais une mémoire sous forme de maïeutique, que prône le précepte husserlien du "retour aux choses mêmes", du retour aux origines spirituelles et culturelles originelles. Une fois désintoxiquée, cette mémoire collective serait à même, comme le préconise Merleau-Ponty, de mesurer sa conscience au monde, et, en s'incarnant en situation historique, de se confronter aux autres civilisations par l'affirmation de sa volonté de puissance.
Dans la compréhension des dynamiques des civilisations, au pessimisme spenglerien, au réalisme et l'élitisme de Toynbee, il faudrait ajouter une dose de réalisme darwiniste social, selon lequel il est établi que, dans la survie et la suprématie, la victoire appartiendra à la civilisation la plus unifiée culturellement et la plus déterminée ainsi que la plus adaptée à la poursuite de la puissance mondiale. Oui, il faut croire que la civilisation occidentale, plongée dans une longue déliquescence morale et politique, peut encore s'inscrire dans une sorte de "possibilisme", et envisager un sursaut salvateur, un déterminisme à rebours et relever un nouveau défi culturel et identitaire comme le prônait Arnold J. Toynbee. Pour ce dernier, "la facilité est nuisible à la civilisation", et il est vrai que toutes les grandes constructions se sont édifiées dans un cadre difficile par ré-activité volontariste. L'art politique est agonal, naît de la lutte, vit de contrainte et meurt de facilité. "Le stimulant de la civilisation croit en proportion de l'hostilité du milieu". La renaissance de la civilisation européenne se fera si il y a lieu dans un climat de rivalité sous l'impulsion de minorités agissantes et déterminées, car comme le disait si bien Bernanos, les "hommes d'exception naissent à la lisière des pouvoirs forts". Les futures guerres et conflits décisifs seront combattus le long des fractures civilisationnelles et identitaires. La civilisation exprime la plus vaste base symbolique et pratique d'affiliation culturelle humaine en aval d'une conscience d'appartenance à l'espèce humaine. C'est pourquoi, la culture, l'identité et non la classe, l'idéologie ou la nationalité fera la différence dans la lutte des puissances du futur.
Rodolphe LUSSAC,
(Toulouse, avril 2004).
06:00 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 février 2007
Une étude sur Paul Colin
Pascal Martin
(correspondant scientifique du Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale) :
D'une croisade à l'autre ou la paix à tout prix
Analyse du regard porté par le journal "Cassandre" sur les événements d'Espagne
http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2019,%201988,%203-4,%20pp%20395-416.pdf
Article fouillé permettant de comprendre certains glissements dans la politique belge des années 30, sans tomber dans les errements de la "correction politique"
06:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Entretien avec Mario Borghezio

Entretien avec Mario Borghezio, député de la "Lega Nord" au Parlement Européen
Sur l'immigration en Italie, sur la "Loi Bossi-Fini", sur le "mandat d'arrêt européen", sur l'entrée de la Turquie dans l'UE, sur les axes de combat pour les Européennes de juin 2004
Né en 1947 à Turin, Mario Borghezio est docteur en droit, avocat, spécialiste du droit du Saint-Empire germanique diplômé de l’Université de Modène. Il est élu parlementaire de la “Lega Nord” en 1992, devient vice-ministre de la justice sous le premier gouvernement Berlusconi en 1994; depuis lors il est député européen de son parti.
Q. : Monsieur Borghezio, vous avez été vice-ministre de la justice dans le premier gouvernement Berlusconi en 1994. Pourquoi avez-vous été choisi pour remplir cette fonction?
MM : J’étais l’homme qui traitait les dossiers relatifs à la mafia, la criminalité et l’immigration dans les diverses commissions de la “Lega Nord”, dont je suis par ailleurs l’un des fondateurs. A la suite de mon mandat de Vice-Ministre, j’ai été membre de la “Commission anti-mafia” du Parlement italien pendant trois législatures. Le problème que j’ai abordé en priorité pendant tout ce temps a été celui des prisons. En Italie, elles étaient pleines à craquer. On craignait l’explosion. Cette situation était due aux dizaines de milliers de détenus immigrés qui affluaient dans nos établissements pénitenciers. L’actuel ministre Roberto Castelli, membre, lui aussi, de la “Lega Nord”, réalise notre programme dans une belle continuité, dans la mesure où l’Etat fait construire de nouvelles prisons, une politique que la gauche refusait car elle était en faveur de vagues d’amnisties générales pour vider les centres de détention avant l’expiration des peines pour les remplir de nouveaux détenus, qui devinaient qu’ils ne purgeraient jamais leur peine complète. Nous avons veillé à ce que les espaces dans les prisons italiennes soient répartis selon les origines ethniques et religieuses des détenus, ce que bien souvent d’ailleurs ils souhaitent eux-mêmes. La “Lega Nord” a donc impulsé une politique plus sévère, hostile à ces amnisties qui ramenaient à intervalles réguliers les criminels dans la rue. A leurs yeux, l’Etat italien n’était qu’un Etat fantoche, affaibli par un laxisme incompréhensible. Castelli et moi-même avons toujours soulevé le problème des conditions de vie de nos concitoyens plus démunis, contraints de vivre dans des quartiers soumis à une immigration débordante, comme c’est le cas à Milan, Turin, Vérone et Padoue. Personnellement, j’ai organisé des marches de protestation et des manifestations de citoyens et de commerçants, lassés de subir l’insécurité, en grande partie due à l’immigration clandestine.
Q. : L’Italie connaît une loi, que l’on appelle la “Loi Bossi-Fini”, qui impose des restrictions à l’immigration. Qu’en est-il?
MM : La Loi Bossi-Fini sur l’immigration est le résultat des réflexions et des travaux fournis par les diverses commissions de la Ligue, qui s’est davantage occupé des questions migratoires que l’Allianza Nazionale. Cette loi fixe clairement le parcours juridique des expulsions. Avant, avec le laxisme de la gauche, l’immigré clandestin expulsé recevait un simple papier qui lui signifiait son expulsion. Vous imaginez bien que ce simple papier était inutile, car on ne prenait aucune mesure concrète et la désobéissance à l’ordre d’explusion n’avait aucune conséquence légale. Si le clandestin restait en Italie et venait à être repris par un service de police, il n’était pas sanctionné. On lui donnait un deuxième papier! Aujourd’hui, ne pas obéir à l’ordre d’expulsion est un délit. De cette manière, l’Italie peut mieux combattre l’immigration clandestine et les diverses formes de criminalité qui y sont liées.
Q. : Quelles sont les principales composantes de l’immigration qui pose problème en Italie aujourd’hui? Quelle est la nature de la criminalité attribuable à ces groupes particuliers?
MM : Pour répondre à votre question, il faut d’abord formuler une remarque sur la situation générale : l’immigration se concentre essentiellement dans les zones urbaines du Nord de l’Italie, que nous appelons la Padanie, soit le bassin du Pô. La réaction de la population a été vive, a porté notre parti au pouvoir (en dépit de sa localisation limitée aux provinces du Nord), car elle craignait la submersion, elle craignait de voir la situation devenir totalement incontrôlable. Le danger subsiste aujourd’hui. Et les gens craignent que le terrorisme islamiste s’infiltre dans le magma incontrôlé de l’immigration clandestine. Beaucoup d’observateurs politiques et économiques constatent d’ores et déjà qu’il existe des “zones franches” ou “zones de non droit” (comme on dit en France), où personne ne sait vraiment ce qui se passe. La “Lega Nord” et moi-même, personnellement, avons organisé des manifestations devant des centres islamiques qui prêchaient la violence et le terrorisme ou qui recrutaient des hommes de main pour des activités violentes ou terroristes. Plus particulièrement, à Turin, à Crémone et à Varese, nous avons pu découvrir que certains groupes islamistes avaient des liens avec les fauteurs de l’attentat sanglant de Casablanca au Maroc, apparemment le même réseau que celui qui a commis l’horrible forfait de Madrid, le 11 mars 2004. Les groupes les plus dangereux, en matières de violence et de terrorisme potentiel, sont constitués de ressortissants nord-africains agités par l’idéologie salafiste. Ils sont très actifs chez nous, comme en Belgique ou en France, et apportent, dans la plupart des cas, un soutien financier aux activités diverses de l’islamisme radical. Ces fonds proviennent des multiples activités de l’immigration clandestine, comme le trafic de drogue, les activités commerciales non déclarées ou enregistrées, comme la plupart des “phone-shops” en Italie. Ces activités commerciales ont une façade légale, mais sont en fait les paravents d’activités illégales, surtout en ce qui concerne la fabrication de faux documents, le recel de marchandises volées ou introduites en fraude dans l’UE, etc. La deuxième composante de l’immigration clandestine en Italie est constituée d’Albanais, qui arrivent facilement chez nous, en utilisant des embarcations de fortune, les “scafisti”, dotées de petits moteurs qui permettent de traverser l’Adriatique et de débarquer clandestinement sur les côtes des Pouilles. L’actuel gouvernement est parvenu à freiner, voire à bloquer, cette immigration mais la présence des mafias albanaises est désormais bien ancrée dans le pays, à cause du laxisme des gouvernements de gauche, qui ont régularisé aveuglément des centaines de milliers de clandestins, sans aucune vérification ni difficulté.
Le troisième groupe est constitué de Chinois, qui ne sont pas criminels au sens habituel du terme, mais présentent un danger économique et social évident, notamment pour les petits artisans locaux et pour les restaurants. La présence des Chinois et leur redoutable efficacité a ruiné des milliers et des milliers de petits artisans italiens, surtout dans le domaine du cuir. Cette concurrence déloyale crée du chômage et un mécontentement légitime. Les Chinois excellent dans l’art des contrefaçons. La situation conduit à la ruine de bon nombre de traditions artisanales et micro-économiques locales.
Q.: Vous vous êtes insurgé contre l’idée d’un “mandat d’arrêt européen”? Pourquoi?
MM : Nous nous opposons fermement à cette idée de “mandat d’arrêt européen”. C’est, à nos yeux, un projet orwellien issu tout droit des esprits délirants de la nomenklatura euro-bruxelloise. Cette idée met la liberté du citoyen en danger et vise principalement ceux qui prônent ou prôneraient des opinions jugées “non conformes” ou “politiquement incorrectes”. Ainsi, un citoyen danois pourrait être poursuivi par un magistrat français parce qu’il est membre du “Parti populiste” local, dans un pays où la liberté d’expression est totale, même pour ceux qui s’opposent aux immigrations, alors qu’en France celle-ci est jugulée par toutes sortes de lois arbitraires et scélérates. Le danger sera plus grand encore si la candidature turque est acceptée : n’importe quel citoyen allemand ou grec qui aurait montré des sympathies pour le combat des Kurdes ou qui se serait opposé à la candidature turque à l’UE pourrait, en théorie, être cité à comparaître devant un tribunal turc. Notre ministre de la Justice, Roberto Castelli, issu de la “Lega Nord”, s’y oppose formellement et fermement. Grâce à lui, jusqu’ici, l’Italie tient bon et ne cède pas. Nous n’accepterons cette idée de mandat d’arrêt européen que s’il est assorti de sérieuses garanties quant aux droits fondamentaux des citoyens, en matière de liberté d’opinion.
Q. : Vous vous opposez également à l’entrée de la Turquie dans l’UE?
MM : Oui. Sur le plan international, c’est un de nos axes de combat principaux. Pour les élections européennes de juin 2004, nous dirons “non” à l’entrée de la Turquie, non au “mandat d’arrêt européen”, non à une constitution qui n’est pas l’expression de la volonté des peuples et de leurs valeurs identitaires, mais est davantage l’œuvre d’un grand sanhédrin constitués par les banquiers, les dirigeants des trusts anonymes, bref du mondialisme dans toute son “horreur économique” pour reprendre l’expression favorite de Viviane Forrester, une femme de gauche.
06:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Note officielle sur Henri de Man

Notice parue dans la Biographie nationale publiée par l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Tome 38, fascicule 2, p. 535 à 554, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles, 1974.
Trouvé sur le site de l'Université du Québec
http://classiques.uqac.ca/classiques/de_man_henri/de_man_henri_photo/de_man_henri_photo.html
06:00 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 février 2007
Neo-Conservative Reich of E. J. Jung

Dr. Alexander Jacob :
The Neo-Conservative Reich of Edgar Julius Jung
06:40 Publié dans Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Petite note sur R. Abellio
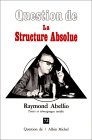
Robert STEUCKERS :
Petite note sur Raymond Abellio
11 novembre 1907 : Naissance à Toulouse de Raymond Abellio. De son vrai nom Georges Soulès, Raymond Abellio entre à Polytechnique en 1927 pour devenir ingénieur des Ponts et Chaussées. Il commence par militer fort à gauche, dans les rangs de la « gauche révolutionnaire », et se montre favorable au Front Populaire, qui accède au pouvoir en 1936. Il entre ainsi au cabinet de Charles Spinasse, ministre de l’Economie nationale.
De 1937 à 1939, il dirige le syndicat socialiste SFIO. Officier de génie, il est mobilisé en 1939, fait la campagne de 1940, est pris prisonnier et envoyé dans un Oflag en Allemagne, où il donne de nombreuses conférences philosophico-politiques. Déçu par la gauche traditionnelle, ses options politiques évoluent vers un révolutionnisme, non plus marxiste ou para-marxiste, mais d’inspiration totalitaire et nationale socialiste.
Revenu en France dès 1941, il adhère au mouvement du cagoulard Eugène Deloncle, qui, comme chacun le sait aujourd’hui, joue double jeu entre Londres et Vichy. Avec André Mahé, il publie un livre-manifeste, intitulé « La fin du nihilisme », qui est indubitablement l’ouvrage le plus clair et le plus concis sur les projets de la nouvelle collaboration, version maximaliste. L’ouvrage conserve pertinence et intérêt aujourd’hui encore, tant il est significatif pour l’époque qui l’a vu éclore.
En 1945, Soulès-Abellio se réfugie en Suisse, d’où il ne revient qu’en 1952, après avoir été acquitté, vu certains services rendus, via la Cagoule, à la résistance gaulliste. A partir de ce moment-là, il fonde une agence d’ingénieurs-conseils et entame une carrière d’écrivain et d’essayiste. Parmi les ouvrages les plus significatifs de l’après-guerre, citons « L’Assomption de l’Europe » (1954), où l’auteur appelle à l’émergence, dans toute l’Europe, d’une nouvelle caste de prêtres, dont l’objectif n’est pas d’introduire, dans notre sous-continent, une nouvelle forme de dévotion ou de bigoterie, mais de conforter une nouvelle connaissance, basée sur les œuvres de Saint Thomas, Descartes, Husserl, Nietzsche, Spinoza et Maître Eckhart.
Abellio constatait, dans cet essai, dont on ne mesure encore ni la profondeur ni l’intensité, que l’Europe, contrairement à d’autres civilisations, n’avait pas encore eu de « caste sacerdotale » proprement dite, au véritable sens du terme. L’Europe est en phase d’assomption parce qu’elle n’a pas généré cette caste et qu’elle a connu l’hypertrophie des castes guerrière et technocratique. En plus de cet appel à une nouvelle caste sacerdotale, Abellio évoque la nécessité de redynamiser le culte marial, la Vierge Marie étant la véritable déesse de l’Europe. Le romancier et essayiste Jean Parvulesco a consacré un ouvrage remarquable à Abellio, intitulé « Le Soleil rouge de Raymond Abellio » (paru chez Guy Trédaniel à Paris en 1987), immédiatement après sa mort, survenue le 26 août 1986 à Nice. L’intérêt de cet essai de Parvulesco réside aussi dans la perspective complémentaire qu’il nous offre : donner les fondements spirituels à un futur « Axe Paris-Berlin-Moscou ».
06:20 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le concept d'aristocratie chez N. Berdiaev

Le concept d'aristocratie chez Nicolas Berdiaev
Pierre MAUGUÉ
Par son livre La philosophie de l'inégalité (1), Berdiaev (2) s'inscrit dans la grande tradition des écrivains contre-révolutionnaires. Bien qu'il ait été écrit dans le chaos de la révolution russe, et tout imprégné qu'il soit du mysticisme propre à l'orthodoxie, ce livre recèle en effet un message de portée universelle. Par delà le temps et le fossé culturel qui sépare l'Europe latine du monde slave orthodoxe, les analyses de Berdiaev rejoignent celles de Maistre et de Bonald; elles mettent non seulement en lumière les racines communes à la révolution jacobine et à la révolution bolchevique, mais concluent à la primauté des principes sur lesquels reposent les sociétés traditionnelles.
Comme Joseph de Maistre (3), Berdiaev voit dans la révolution une conséquence de l'incroyance et de la perte du centre organique de la vie. «Une révolution, quelle qu'elle soit, est anti-religieuse de par sa nature même, et tenter de la justifier religieusement est une bassesse... La révolution naît d'un dépérissement de la vie spirituelle, de son déclin, et non de sa coissance ni de son développement intérieur». Mais la révolution ne s'attaque pas seulement à la religion en tant qu'elle relie l'homme au sacré et à la transcendance, mais aussi dans la mesure où elle établit un lien entre les générations passées, présentes et futures. Comme le note Berdiaev, «il existe non seulement une tradition sacrée de l'Eglise, mais encore une tradition sacrée de la culture. Sans la tradition, sans la succession héréditaire, la culture est impossible. Elle est issue du culte. Dans celle-ci, il y a toujours un lien sacré entre les vivants et les morts, entre le présent et le passé... La culture, à sa manière, cherche à affirmer l'éternité».
Berdiaev ne peut donc que s'insurger contre la prétention des révolutionnaires d'être des défenseurs de la culture. S'adressant à eux, il écrit: «Vous avec besoin de beaucoup d'outils culturels pour vos fins utilitaires. Mais l'âme de la culture vous est odieuse». Ce que Berdiaev leur reproche, c'est aussi leur mépris des œuvres du passé: «La grandeur des ancêtres vous est insupportable. Vous auriez aimé vous organiser et vous promener en liberté, sans passé, sans antécédents, sans relations», et il se voit obliger de rappeler que «la culture suppose l'action des deux principes, de la sauvegarde comme de la procréation».
Le principe conservateur dont Berdiaev se fait le héraut n'est donc pas opposé au développement, il exige seulement que celui-ci soit organique», que l'avenir ne détruise pas le passé mais continue à le faire croître». L'antimarxisme de Berdiaev n'en fait pas pour autant un défenseur inconditionnel du libéralisme. Bien qu'il reconnaisse, avec Tocqueville, qu'«il y a dans la liberté quelque chose d'aristocratique» et qu'il considère que «les racines de l'idée libérale ont une relation plus étroite avec le noyau ontologique de la vie que les idées démocratiques et socialistes», il n'en estime pas moins que, dans le monde actuel, le libéralisme «vit des miettes d'une certaine vérité obscurcie».
Berdiaev relève ainsi que l'individualisme libéral sape la réalité de la personne, à laquelle il entendait donner la première place, du fait qu'il détache l'individu de toutes les formations historiques organiques. «Pareil individualisme», dit-il, «dévaste en fait l'individu, il lui ôte le contenu super-individuel qu'il a reçu de l'histoire, de sa race et de sa patrie, de son Etat et de l'Eglise, de l'humanité et du cosmos». Quant au libéralisme économique, il lui paraît avoir plus d'affinités avec une certaine forme d'anarchisme qu'avec la liberté aristocratique. «L'individualisme économique effréné, qui soumet toute la vie économique à la concurrence et à la lutte d'intérêts égoïstes, qui ne reconnait aucun principe régulateur, semble n'avoir aucun rapport nécessaire avec le principe spirituel du libéralisme».
En définitive, Berdiaev considère que la philosophie de l'état et des droits naturels, prônée par les libéraux, est superficielle, car «il n'y a pas et il ne peut y avoir d'harmonie naturelle». Pour lui, «la foi libérale» n'est donc pas moins fausse que «la foi socialiste».
La «philosophie de l'inégalité» se présente comme une suite de lettres traitant chacune d'un thème bien précis. Hormis la première lettre, qui traite de la révolution russe, toutes les autres lettres abordent des sujets qui ne sont pas spécifiquement liés à la situation de la Russie. Partant d'une analyse «des fondements ontologiques et religieux de la société», Berdiaev va nous parler de l'Etat, de la nation, du conservatisme, de l'aristocratie, du libéralisme, de la démocratie, du socialisme, de l'anarchie, de la guerre, de l'économie, de la culture, et, pour conclure, d'un sujet qui n'intéresse généralement pas les politologues: du royaume de Dieu.
La lettre sur l'aristocratie est peut-être celle qui retient le plus l'attention, car elle ose faire l'apologie d'un principe que, depuis deux siècles, l'on s'est plus non seulement à dévaloriser, mais à désigner à la vindicte populaire. Aujourd'hui, note Berdiaev, il est généralement considéré qu'«avoir des sympathies aristocratiques, c'est manifester soit un instinct de classe, soit un esthétisme sans aucune importance pour la vie».
La vision réductrice de l'aristocratie que l'on a tout fait pour imposer depuis la Révolution française est battue en brèche par Berdiaev en partant d'un point de vue spirituel. Pour lui, l'aristocratie a un sens et des fondements plus profonds et plus essentiels. Alors que «le principe aristocratique est ontologique, organique, qualitatif», les «principes démocratiques, socialistes, anarchiques, sont formels, mécaniques, quantitatifs; ils sont indifférents aux réalités et aux qualités de l'être, au contenu de l'homme». La démocratie, dépourvue de bases ontologiques, n'a au fond qu'une nature “purement phénoménologique”; elle ne serait finalement rien d'autre que le régime politique correspondant au “règne de la quantité”, à l'“âge sombre”, dont parlent les représentants de la pensée traditionnelle, notamment René Guénon.
Mais Berdiaev ne met pas seulement en valeur la supériorité du principe aristocratique du point de vue spirituel. Comme Maurras, il voit en lui un élément fondamental de l'organisation rationnelle de la vie sociale; il rappelle que tout ordre vital est hiérarchique et a son aristocratie. «Seul un amas de décombres n'est pas hiérarchisé» et «tant que l'esprit de l'homme est encore vivant et que son image qualitative n'est pas définitivement écrasée par la quantité, l'homme aspirera au règne des meilleurs, à l'aristocratie authentique».
Berdiaev refuse de croire que la démocratie représentative ait, comme elle le prétend, la capacité d'assurer cette sélection des meilleurs et le règne de l'aristocratie véritable. «La démocratie», estime-t-il, «devient facilement un instrument formel pour l'organisation des intérêts. La recherche des meilleurs est remplacée par celle des gens qui correspondent le mieux aux intérêts donnés et qui les servent plus efficacement».
La démocratie, le pouvoir du peuple, ne sont pour Berdiaev qu'un trompe-l'oeil. «Ne vous laissez pas tromper par les apparences, ne cédez pas à des illusions trop indigentes. Depuis la création du monde, c'est toujours la minorité qui a gouverné, qui gouverne et qui gouvernera. Cela est vrai pour toutes les formes et tous les genres de gouvernement, pour la monarchie et pour la démocratie, pour les époques réactionnaires et pour les révolutionnaires». Cette vue de Berdiaev n'est pas sans rappeler Pareto et sa théorie de la circulation des élites. Mais à la question de savoir si c'est la minorité la meilleure ou la pire qui gouverne, berdiaev ne donne pas la même réponse que Pareto (4). Il considère en effet que «les gouvernements révolutionnaires qui se prétendent populaires et démocratiques sont toujours la tyrannie d'une minorité, et bien rares ont été les cas où celle-ci était une sélection des meilleurs. La bureaucratie révolutionnaire est généralement d'une qualité encore plus basse que celle que la révolution a renversée».
Pour Berdiaev, la réalité est qu'«il n'y a que deux types de pouvoir: l'aristocratie et l'ochlocratie, le gouvernement des meilleurs et celui des pires». Vue peut-être un peu trop manichéenne dans la mesure où la médiocratie, ou gouvernement des médiocres, paraît être aujourd'hui la forme de pouvoir la plus répandue, et qu'elle est d'autant plus forte qu'elle se trouve en accord quasi parfait avec l'esprit même du monde moderne.
L'aristocratie est quant à elle en porte-à-faux avec les idées modernes parce qu'elle suppose la sélection et la prise en compte du temps. Pour Berdiaev, l'aristocratie s'inscrit dans l'histoire, elle présuppose une filiation et le lien ancestral. «La formation sélective des traits nobles du caractère s'effectue avec lenteur, elle implique une transmission héréditaire et des coutumes familiales. C'est un processus organique».
Il faut, dit Berdiaev, qu'il y ait dans la société humaine des gens qui n'ont pas besoin de s'élever et que ne chargent pas les traits sans noblesse de l'arrivisme. Les droits de l'aristocratie sont inhérents, non procurés. Il faut qu'il y ait dans le monde des gens aux droits innés, un type psychique qui ne soit pas plongé dans l'atmosphère de la lutte pour l'obtention des droits».
Mais à ce privilège correspondent des devoirs qui ne peuvent précisément être remplis qu'en raison même de ce privilège originel. «L'aristocratie véritable peut servir les autres, l'homme et le monde, car elle ne se préoccupe pas de s'élever elle-même, elle est située suffisamment haut par nature, dès le départ, elle est sacrificielle». Vue extrêmement exigeante pour laquelle «l'aristocratie doit avoir le sentiment que tout ce qui l'élève est reçu de Dieu et tout ce qui l'abaisse est l'effet de sa propre faute», alors que le propre de la psychologie plébéienne est de considérer «tout ce qui élève comme un bien acquis et tout ce qui abaisse comme une insulte et comme la faute d'autrui».
Du fait que «l'aristocrate est celui auquel il est donné davantage» et qu'il peut ainsi «partager son surcroît», il est appelé à jouer un rôle de médiateur entre le peuple et les valeurs supérieures. Berdiaev tient ainsi à rappeler que, dans toute l'histoire, «les masses populaires sortent de l'ombre et qu'elles communient avec la culture par l'intermédiaire de l'aristocratie qui s'en est distinguée et qui remplit sa tâche». C'est la raison pour laquelle les valeurs aristocratiques doivent demeurer prédominantes, car «c'est l'aristocratisation de la société et non pas sa démocratisation qui est spirituellement justifiée». Berdiaev tient d'ailleurs à rappeler que l'attitude méprisante envers le menu peuple n'est pas le fait de l'aristocratie, mais qu'«elle est le propre du goujat et du parvenu».
Tout en affirmant les principes qui forment la trame des valeurs aristocratiques, Berdiaev n'ignore pas que, «dans l'histoire, l'aristocratie peut déchoir et dégénérer», qu'«elle peut facilement se cristalliser, se scléroser, se clore sur elle-même et se fermer aux mouvements créateurs de la vie». Elle trahit alors sa vocation et, «au lieu de servir, elle exige des privilèges». Pour Berdiaev, les conséquences qu'entraîne cette décadence sont les mêmes que celles qu'envisage Joseph de Maistre. «Lorsque les classes supérieures ont gravement failli à leur vocation et que leurs dégénérescence spirituelle est avancée, la révolution mûrit comme un juste châtiment pour les péchés de l'élite».
Mais quelle que soit la décadence qui peut frapper l'aristocratie, le principe qui est à son origine n'en garde pas moins une valeur éternelle. La noblesse peut mourir en tant que classe, «elle demeure en tant que race, que type psychique, que forme plastique». Ainsi, la chevalerie, dont Berdiaev regrette l'absence dans l'histoire de la Russie, fut plus qu'une catégorie sociale et historique, elle est un principe spirituel, et «la mort définitive de l'esprit chevaleresque entrainerait une dégradation du type de l'homme, dont la dignité supérieure a été modelée par la chevalerie et par la noblesse, d'où elle s'est diffusée dans des cercles plus larges».
Si l'influence de la noblesse fut plus tardive en Russie, il serait injuste, estime Berdiaev, de méconnaître le rôle important qu'elle a joué dans le développement intellectuel de ce pays. «Elle a», dit-il, «été notre couche culturelle la plus avancée. C'est elle qui a créé notre grande littérature. Les gentilhommières ont constitué notre premier milieu culturel... Tout ce qui comptait dans la culture russe venait de l'aristocratie. Non seulement les héros de Léon Tolstoï, mais encore ceux de Dostoïevski, sont inconcevables en dehors de celle-ci... Tous nos grands auteurs ont été nourris par le milieu culturel de la noblesse».
Berdiaev, qui appartient à la noblesse, héréditaire, n'en reconnaît pas moins qu'«il n'y a pas seulement l'aristocratie historique où le niveau moyen se crée grâce à la sélection raciale et à la transmission héréditaire», mais qu'«il y a aussi l'aristocratie spirituelle, principe éternel, indépendant de la succession des groupes sociaux et des époques». Cette aristocratie spirituelle, qui se forme selon l'ordre de la grâce personnelle, n'a pas un rapport nécessaire avec un groupe social donné, elle n'est pas fonction d'une sélection naturelle. «On n'hérite pas plus du génie que de la sainteté». Mais cette «aristocratie spirituelle a la même nature que l'aristocratie sociale, historique; c'est toujours une race privilégiée qui a reçu en don ses avantages».
Opposer la démocratie à l'aristocratie n'est pas concevable pour Berdiaev. «Ce sont là des notions incommensurables, de qualités complètement différentes». Il voit d'ailleurs dans le triomphe de la métaphysique, de la morale et de l'esthétique démocratiques «le plus grave péril pour le progrès humain, pour l'élévation qualitative de la nature humaine». «Vous niez», dit-il, «les fondements biologiques de l'aristocratisme, ses bases raciales, ainsi que celles de la grâce et de l'esprit. Vous condamnez l'homme à une existence grise, sans qualités». Quant à la volonté affirmée de porter une masse énorme de l'humanité à un niveau supérieur, elle résulte, selon Berdiaev, non pas d'un amour de ce haut niveau, mais avant tout d'un désir d'égalitarisme, d'un refus de toute distinction et de toute élévation.
Se plaçant délibérément à contre-courant des idées qui ont cours à son époque et qui ont aujourd'hui acquis une valeur de dogme, Berdiaev s'adresse en ces termes aux grands-prêtres de l'idée démocratique: «Ce qui vous intéresse par-dessus tout, ce n'est pas d'élever, c'est d'abaisser. Le mystère de l'histoire vous est inaccessible, votre conscience y reste à jamais aveugle. Le mystère de l'histoire est un mystère aristocratique. Il s'accomplit par la minorité».
Pierre MAUGUÉ.
(décembre 1993).
Notes:
(1) La philosophie de l'inégalité, écrite en 1918, a été publiée à Berlin en 1923. Sous le titre De l'inégalité, une traduction en français a été éditée en 1976, à Lausanne, par les Editions L'Age d'Homme.
(2) NIcolas Berdiaev est né à Kiev en 1874 et mort à Clamart en 1948. Sa mère était une princesse Koudachev, apparentée à la famille Choiseul. Professeur de philosophie à l'Université de Moscou, Berdiaev, que l'on a parfois qualifié d'existentialiste chrétien, s'oppose à toutes les formes modernes de matérialisme. Expulsé d'Union Soviétique en 1922, il s'établira en France, où il demeurera jusqu'à sa mort.
(3) Cf. Considérations sur la France. Cette œuvre a récemment été rééditée par “Les Editions des Grands Classiques” (ELP) (37, rue d'Amsterdam, F-75.008 Paris).
(4) Cf. Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale.
06:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
F. Schuon: Questions and Answers
06:15 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 février 2007
Stratégies et géopolitiques chinoises
Il y a près d’un demi siècle, Mao Tse Toung, fâché, avait dit que « la Chine n’était même pas capable d’envoyer une pomme de terre dans l’espace ». Entre temps, la situation a bien changé. Avec une fusée balistique, la République Populaire de Chine a réussi à détruire l’un de ses propres satellites météorologiques. Comme c’est souvent le cas chez les Chinois, toute cette opération a été enveloppée d’une aura de mystère. Ils avaient préalablement mis les Japonais et les Américains au courant, mais très peu de temps seulement avant le lancement de l’opération. L’opinion publique européenne l’a appris par les Américains. Si cela n’avait tenu qu’aux Chinois, rien n’aurait été dévoilé. Les faits sont ce qu’ils sont et ils ne sont guère impressionnants. Bien que… Tous les pays n’ont pas la possibilité technique de réduire un satellite en charpie ; ce que les Chinois ont réussi à faire en janvier 2007, les Russes et les Américains sont capables de le faire depuis plus de deux décennies. « One shot, many motives » ont dit les spécialistes du « Council on Foreign Affairs » (CFR). Et ce sont bel et bien ces nombreux motifs qui rendent toute l’affaire fort intéressante.
Une démonstration
Les analystes sont à l’unisson pour dire que le message majeur que les Chinois veulent transmettre au monde est de nature militaire. La destruction d’un satellite lancé par eux en 1999 démontrait clairement le savoir-faire chinois. Cela constitue donc un défi adressé aux Américains. En août 2006, les Etats-Unis ont constaté que les Chinois avaient pointé un laser sur l’un de leurs satellites. Cela pourrait signifier que les Chinois testent des méthodes pour « aveugler » des satellites du même type. Les Chinois, on le sait, sont patients et étudient de fond en comble tous les problèmes qu’ils abordent, même si cela prend de très nombreuses années. L’appareil militaire américain dépend largement des informations apportées par les satellites : état de choses qui n’a pas échappé aux spécialistes chinois. Peut-on imaginer l’armée américaine sans GPS ou sans disposer d’une information détaillée sur ses adversaires ? Non, bien sûr. De ce fait, les satellites sont le talon d’Achille de la machine militaire américaine. C’est donc à ce niveau-là que les Chinois iront les taquiner. « Lorsque ton adversaire a un tempérament volcanique, tu dois l’irriter encore davantage » : telles étaient les paroles de Sun Tzu ; il les a écrites il y a 2500 ans.
Tout cela signifie-t-il que la Chine est passée à la vitesse supérieure ? En fait, non. Au fond, ce teste, contesté, se situe dans le prolongement d’une tendance perceptible depuis quelques années déjà. La Chine est en phase ascensionnelle (« on the rise »), comme le signalait très récemment un rapport du Pentagone ; qui précisait en outre : « elle fait montre d’une ascension rapide et abrupte sur la voie de la grande puissance spatiale ». Si le programme spatial chinois se poursuit comme Pékin le souhaite, vers 2020, la Chine sera capable d’envoyer une mission dans l’espace. L’année prochaine, le programme spatial chinois prévoit le troisième voyage de cosmonautes.
Ironie : la destruction consciente de ce satellite météorologique met en danger ces multiples projets spatiaux qui devront se succéder. Parce qu’ils ont agi de cette manière, les Chinois seront confrontés à des centaines de fragments erratiques qui sont en fait de petits projectiles, qui peuvent endommager sérieusement d’autres satellites ou engins spatiaux.
Ensuite : quels sont les autres motifs qu’évoquaient les spécialistes du CFR ? Certains pensent que la Chine veut contraindre les Etats-Unis à s’asseoir à une table de négociations. En d’autres termes : qu’ils veulent des promesses claires sur le développement et l’usage des technologies spatiales. Il est toutefois peu probable que les Chinois essayent ainsi d’éviter une sorte de courses aux armements dans l’espace. La véritable intention, qui se profile derrière ces manœuvres spatiales, trouverait ses sources dans la grande question stratégique à laquelle la Chine se voit confrontée aujourd’hui.
Stratégie et géopolitique
Sur le plan géopolitique, la Chine, finalement, est un pays relativement bien protégé. Elle dispose de quelques frontières naturelles : la plaine sibérienne, le massif de l’Himalaya. Ces frontières naturelles permettent d’éviter bon nombre de dangers qui pourraient survenir de ces points cardinaux-là, ce qui permet à la Chine de résoudre déjà quelques problèmes militaires potentiels de taille. Certes, la Chine a des intérêts importants en Asie centrale. Mais, dans cette région, la concurrence est grande, raison pour laquelle la Chine y opte pour des formes douces d’accroissement de son influence. Mais il y a un lieu où la Chine entend bien imposer sa puissance militaire : la mer. La Chine est devenue une nation commerçante de tout premier plan ; par conséquent, la liberté des voies maritimes acquiert, pour elle, désormais, une importance cruciale. Sur ce point, Chinois et Américains sont sur la même longueur d’onde ; mais aucune nation fière d’elle-même -et la Chine en est une, à un point quasi pathologique- ne veut dépendre, en ultime instance, d’une autre, plus puissante, pour assurer sa propre sécurité.
Donc la Chine investit en masse dans sa propre marine, opération qui porte nettement sur le long terme. Si l’on veut miner à court terme les capacités de contrôle de l’US Navy, alors il faudrait procéder d’une autre manière. Le test, qui vient d’être effectué, peut-il être mis en rapport avec ce souhait chinois ? Sans doute. Ce raisonnement chinois est-il rationnel ? Non, mais c’est ainsi que l’on raisonne dans l’Empire du Milieu…
M.
(article paru dans « ‘t Pallieterke », Anvers, 7 février 2007).
15:24 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Montaigne stratège

Dimitri SEVERENS :
Montaigne stratège
Les lectures de l’Ecole des Cadres
Eric WERNER, Montaigne stratège, Essai, Ed. L’Age d’Homme, coll. “Mobiles politiques”, Lausanne, 1996, ISBN 2-8251-0730-1.
On connaît l’intransigeance tranquille d’Eric Werner, chargé de cours à l’Université de Genève, qui ne cède jamais devant les ukases de la pensée dominante, faite de schémas stériles, de prêt-à-penser, de slogans tout faits. Il nous enjoint depuis plus d’une décennie à revenir à l’essentiel, c’est-à-dire à relire les classiques de la pensée européenne. Parmi ces classiques : Montaigne. Auquel il a consacrer le petit ouvrage dense et précis que nous vous invitons aujourd’hui à lire. Pourquoi Montaigne? Sans doute parce qu’il est un de ces hommes du 16ième siècle, qui n’est plus prisonnier de certaines limites médiévales mais n’est pas encore prisonnier des lubies post-médiévales, modernes et contemporaines, beaucoup plus exigentes. Dans le fond, constate Werner, Montaigne, en nous enjoingnant à “suivre la nature” (Sequi Naturam), reste dans la ligne d’Aristote et des Grecs : la loi, qui gouverne les hommes, ou est censée les gouverner, dérive du donné objectif que constitue la nature même des choses. Les hommes se soumettent à la loi parce que cette loi exprime, tout bonnement, le “common sense”, le sain entendement de l’homme de bien. La pensée de Montaigne est itinérante, elle voyage au milieu des faits de monde, elle demeure sereine et se défie de toute systématicité inutile. Pour Werner, elle est un modèle pour notre époque, où la loi n’est plus ce reflet naturel et serein de l’ordre cosmique des Grecs, mais, au contraire, l’expression d’une volonté perverse, et pervertie par l’idéologie ou par la folie de vouloir tout transformer; dans sa conclusion, Werner écrit : “La loi, telle qu’on la conçoit aujourd’hui, n’est plus un simple rapport dérivant de la nature des choses, l’expression d’une réalité extérieure s’imposant au législateur, sa raison d’être est au contraire de faire évoluer la réalité à laquelle est s’applique, voire de la transformer de fond en comble, en fonction de critères qui n’ont en règle générale plus rien à voir avec le bien commun (...) mais ne font au contraire qu’exprimer un volontarisme partisan, d’où toute référence aux rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses a désormais disparu. La loi s’érige ainsi en instrument de transformation sociale au service d’idéologies à prétentions le plus souvent hégémoniques, jouant le rôle de véritable religions séculières. C’est une arme de guerre (...)”.
Cette hypertrophie, démesurée et problématique, du domaine de la loi (ou du “nomos” dirait un Carl Schmitt) est inacceptable à deux titres : d’abord, pour une raison pratique, parce que son applicabilité générale, à l’ensemble des faits qu’elle entend soumettre à sa férule, est impossible, vu les limites naturelles et l’inextricable nodalité de toutes choses, à commencer par la nature humaine et les fondements ontologiques et anthropologiques de l’homme; à partir d’un certain moment, la loi moderne, transformatrice et interventionniste, sera impossible à appliquer sans un exercice de terreur; ses prétentions étant illimitées, elle recèle en elle le crime absolu contre les peuples humains, réceptacles différenciés de choses héritées, mais réceptacles toujours limités par des donnés naturels. Cette loi moderne, interventionniste, est ensuite inacceptable pour une raison éthique : son statut d’instrument de guerre, bien mis en exergue par Werner, fait d’elle —à rebours de la loi traditionnelle, factuelle et postulant un ordre cosmique immuable, loi que l’on qualifie généralement de “grecque” dans la pensée européenne— fait qu’elle s’attaque aux fondements ontologiques et anthropologiques, môles d’une résistance tenace à ses prétentions exorbitantes, et aux héritages et aux légitimités héritées, qui constituent le patrimoine des peuples et ne peuvent se réduire au schématisme d’une norme, dont l’intention malveillante est partisane.
Werner se réfère à Montaigne, comme d’autre se réfèrent à l’anarque d’Ernst Jünger ou à l’”homme différencié” de Julius Evola, pour dire, avec lui : “Le sage doit au dedans retirer son âme de la presse, et la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses; mais, quant au dehors, qu’il doit suivre entièrement les façons et formes reçues”. Face aux sottises des hommes, à leurs affects, à leurs délires, qu’ils coulent aujourd’hui en lois et veulent imposer à tous, il faut opérer un recul, dit Montaigne. Werner est conscient de la difficulté qu’un tel recul, de nos jours, aussi modeste puisse-t-il paraître, dans le contexte de surveillance totale que nous subissons, où la parole médiatique s’insinue en permanence dans nos oreilles et nos cerveaux. Il n’empêche : le sage, et le militant politique différencié, anarque malgré lui, parce qu’il n’y a rien d’autre à faire, face à la masse de Big Brother, doit refuser le discours dominant, celui des médias et des politiciens, des relais de la grande puissance d’Outre Atlantique qui orchestrent les machines à ahurir, pour mieux dominer les “alien audiences”.
Ce travail de recul, de saut en arrière et en dehors, est très difficile. Il exige énormément de volonté. Il exige d’imiter les militants indépendantistes indiens du mouvement RSS, qui prend son envol dès la fin du 19ième siècle : devenir et surtout rester, comme eux, des “renonçants”, des “renonçants” qui méprisent les gadgets du monde consumériste et ne s’intéressent qu’à leur travail de resourcement, de réactivation des forces toujours latentes de notre civilisation européenne. Dans ce travail de recul, plus concrètement, la lecture de Machiavel et de Montaigne, deux hommes de ce 16ième siècle si fascinant, s’avère utile sinon indispensable. Notre club de “renonçants” les pratiquera, les remettra en perspective, en transmettra, avec Werner, si direct, si simple et si serein en son style, la substantifique moelle à ceux, plus jeunes et de plus en plus nombreux, qui se porteront volontaires pour effectuer, volontairement et en pleine conscience, ce recul, seule démarche intelligente pour échapper aux tourbillons du consumérisme qui jettent l’homme contemporain hors de lui-même, hors de ses héritages et le rendent fou, l’assomment, le condamnent à ingurgiter des cachets de Prozac pour tenir bêtement le coup et continuer à les subir.
Dimitri SEVERENS (Ec.C.SYN.EUR./Bruxelles).
06:30 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



