mercredi, 31 octobre 2007
K. Hamsun: éveil de la glèbe

Bénédiction de la glèbe
31 octobre 1917: Le célèbre roman de Knut Hamsun « Bénédiction de la glèbe » (ou "L'éveil de la glèbe") paraît en Norvège. Ce roman, poignant, est ruraliste et vitaliste : il décrit l’âpreté de la vie dans le Nord de la Norvège, pays au sol terriblement ingrat, qui contraint des centaines de milliers de Norvégiens à émigrer vers les Etats-Unis, où ils peupleront notamment le Montana et les états qui lui sont limitrophes. En Norvège même, les immigrants, venus du Sud plus chaud, s’accrochent à la terre septentrionale, avec une volonté inouïe, et finissent par la rendre fertile. Hamsun dépasse le simple roman paysan ou ruraliste en donnant à son œuvre une dimension bien plus profonde que la description des faits et gestes quotidiens des fermiers norvégiens. Il pose l’homme, son « Dasein » (pour parler comme Heidegger), au beau milieu d’un environnement hostile, qu’il surmonte par la volonté et par l’ascétisme en communion avec les forces cosmiques. Hamsun dénonce aussi l’artificialité et la vanité de la vie urbaine, produisant des types humains dégénérés et superficiels.
02:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Quand l'Alaska était russe...

Erich KÖRNER-LAKATOS :
Quand l’Alaska était russe
L’Alaska fut la seule colonie russe d’outre-mer mais elle était peu rentable et difficile à administrer
« Les Russes arrivent ! ». Au milieu des années 60 du 20ième siècle, un film, qui passait dans les salles américaines, portait ce titre et évoquait la visite fatidique d’un sous-marin russe dans une petite crique de la côte des Etats-Unis. Le film, bien qu’il ait été avant toute chose une comédie, révélait que dans le subconscient de beaucoup d’Américains, il y avait, à l’époque, la peur d’une attaque soviétique.
Si le producteur de cette comédie avait eu davantage de culture historique, il aurait dû titrer : « Les Russes reviennent ! ». Bon nombre de nos contemporains s’étonnent quand ils lisent que les Russes, au 19ième siècle, ont disposé pendant longtemps d’une base sur la côte californienne, à laquelle ils ont donné un nom qui rappelle clairement leur présence d’antan, là-bas. Ce fortin se trouve à quelque 80 km au nord de San Francisco, sur l’estuaire de Russian River, une rivière qui se jette dans le Pacifique. Le nom de ce fortin est Fort Ross, diminutif ultérieur de Fort Rossiya, soit « Fort Russie ». Aujourd’hui, cette petite place forte est un site magnifiquement entretenu par l’Etat de Californie. La maison du commandant de la place, avec ses deux étages, contient six pièces d’habitation et une cuisine qui ont toutes été conservées en leur état original. Une palissade faite de troncs hauts de quatre mètres protégeait les habitants de leurs ennemis car, en 1812, quand il fut décidé de construire la place pour ravitailler les colons russes de l’Alaska, les indigènes amérindiens n’appréciaient guère l’arrivée de ces étrangers. Plusieurs combats ont eu lieu entre les chasseurs de peau sibériens et les Amérindiens du lieu, guerriers quasi nus et rapides à la course. Les Russes étaient désavantagés, à cause de la chaleur, de même que leurs auxiliaires originaires des Iles Aléoutiennes.
L’expédition de Vitus Bering
Dans la métropole de l’Empire des Tsars, Pierre le Grand se demandait s’il était possible de naviguer vers l’Est en longeant la côte arctique de la Sibérie puis de mettre le cap vers le sud pour cingler vers la Chine et le Japon et aussi s’il existait un pont terrestre entre l’Asie et l’Amérique. Pour être éclairé, le Tsar mande l’explorateur danois Vitus Bering et lui confie la mission de vérifier sur place. En janvier 1725, deux jours avant la mort de ce grand empereur russe, l’expédition s’ébranle : elle compte vingt-cinq traîneaux. Devant elle : l’immensité territoriale de la Sibérie et, au bout de celle-ci, la presqu’île du Kamtchatka. Le chemin semble interminable mais Dame Fortune est clémente et généreuse pour l’expédition russo-danoise. A la fin de son expédition, Bering arrive à la pointe orientale extrême du continent asiatique, au cap qu’on appellera par la suite « Cap Dejnev », de même qu’au détroit qui porte aujourd’hui son nom et qui n’est large que de 85 km. Les indigènes parlent d’un très grand pays au-delà de cette petite étendue marine, à l’Est.
Après les expéditions de Bering, les Russes partent à tâtons à la découverte en suivant le chapelet des Iles Aléoutiennes et déboulent finalement en Alaska. Dans les îles, ils trouvent des loutres de mer, très appréciées pour leur fourrure. Des marchands s’intéressent désormais à ces expéditions. Le 3 août 1784, un certain Grigori Ivanovitch Chelikov fonde le premier véritable établissement russe d’Alaska, le hameau de Tri Svetoi (= « Trois-Saints »). Face aux Amérindiens de l’ethnie Tlinkit, agressifs et fort pugnaces, les Russes finissent par s’imposer en avançant cinq canons. Ce fut un massacre qui laissa cinq cents morts sur le terrain mais la résistance des indigènes cessa.
Le commerce des peaux étant très lucratif, les colons arrivent plus nombreux : une demie douzaine de villages russes se construisent en Alaska. En 1799, l’Etat russe devient partenaire de la colonisation et impose une société monopolistique qui commercialisera les précieuses peaux. Elle s’appelle la « Compagnie Russo-Américaine » ; quelques membres de la famille impériale en sont actionnaires. Le centre de la colonie est alors Novo-Arkhangelsk, que l’on débaptisera plus tard en Sitka.
Inquiétudes espagnoles
La présence des sujets du Tsar inquiétait une autre puissance mondiale de l’époque : en effet, l’Espagne revendiquait toute la côte ouest des Amériques. Un livre intitulé « Les Moscovites en Californie » avait alarmé les Espagnols, qui décidèrent de doter la Californie de bases, qu’ils appelaient « presidios » et dont le plus avancé vers le Nord se situait entre Los Angeles et San Francisco. A cette présence militaire s’ajoutaient les missions de l’Ordre des Franciscains, successeurs des Jésuites qui avaient été expulsés d’Espagne.
Mais les craintes espagnoles s’avèrent sans objet car les Russes ne revendiquaient que les régions jusqu’au 55ième degré de latitude, soit une région se trouvant à quelque 2000 km au nord de San Diego. Une seule fois seulement, en 1774, un noble espagnol, Juan Perez, à bord du voilier San Antonio, s’aventura jusqu’à ces zones fort inhospitalières. Le brouillard permanent et les pluies interminables ont dégoûtés ces Européens du Sud, qui sont repartis sans l’intention de revenir un jour.
Les Britanniques, plus habitués aux climats ingrats, se montrèrent plus entreprenants. Ils observaient avec envie ce commerce des peaux en pleine expansion. Ils décidèrent de lancer une expédition sous le commandement de James Cook en direction de l’Alaska. Cook passa le Détroit de Bering et ne fit demi tour qu’une fois arrivé en lisière de la banquise. Sur le chemin du retour, il noua des contacts amicaux avec les Russes, mais sans perdre le nord, les marins anglais s’emparent, au nom de leur Roi, de l’Ile de Vancouver, à proximité de la ville contemporaine de Seattle. Madrid tente de se défendre, en vain, contre cette annexion britannique sur la côte du Pacifique, mais rien n’y fit.
A partir de 1794, l’Amérique russe a donc un nouveau voisin, redoutable, sur ses confins méridionaux. A l’Est de l’Alaska se trouve l’immense Rupertsland, qu’exploite la Compagnie de la Baie d’Hudson fondée en 1670 en jouissant de pleins droits de souveraineté. Les Anglais ne s’embarrassent pas de scrupules et excitent les Amérindiens locaux contre les Russes. Mais ceux-ci s’accrochent et parviennent à conserver leurs colonies, qui se lancent dans un commerce intense avec le Royaume des Iles Hawaï grâce aux initiatives d’excellents gouverneurs.
Du gouverneur Wrangel au Général Wrangel
L’un de ces gouverneurs était issu d’une très ancienne famille allemande des Pays Baltes : le Baron Ferdinand Petrovitch Wrangel, qui dirigera l’Alaska pendant cinq ans à partir de 1830. Après cela, il deviendra le Ministre de la Marine du Tsar. Jusqu’à la fin de la monarchie russe, cette famille allemande des Pays Baltes conservera ses attaches à la dynastie régnant à Saint-Petersbourg : en effet, en novembre 1920, à la fin de la guerre civile russe, les restes de l’Armée Blanche, battus, quittent la Crimée à bord de navires français qui mouillaient à Sébastopol. Le dernier commandant en chef de ces forces tsaristes fut le Général Peter Nicolaïevitch Wrangel (ndt : qui s’installera à Uccle, où sa famille a fait souche).
Au début de l’année 1864, le Prince Dimitri Maksoutov, descendant d’une famille tatare, devient le nouveau gouverneur de la colonie russe de l’Alaska. Ce noble, qui vient de convoler en justes noces, ne s’imagine pas que son avenir est bien sombre. Non seulement il sera le dernier gouverneur de l’Amérique russe, mais, vingt-cinq ans plus tard, il mourra seul et abandonné, totalement ruiné. Pourtant, au début de sa carrière de gouverneur, Maksoutov pouvait être satisfait de la situation qui régnait en Amérique russe. Certes, le poste de ravitaillement de Fort Ross en Californie avait dû être cédé en 1841, pour 30.000 dollars américains ; l’acheteur était une personnalité privée et farfelue. Le commerce des peaux périclite lentement. Les épidémies s’étaient succédée et avaient exigé leur lugubre lot de victimes, mais, malgré ces déboires, le nombre d’habitants de Novo-Arkhangelsk a augmenté jusqu’à atteindre les 2000 habitants. C’est la Compagnie de la Baie d’Hudson qui leur fournissait des vivres.
Mais il y a une chose que le Prince Maksoutov ignore : le Tsar Alexandre est sous l’influence de son frère puîné, Constantin, qui hait la Compagnie russo-américaine. Cette société monopolistique, prétendait le frère du Tsar, ne sert qu’à enrichir de manière éhontée ses actionnaires, tandis que le ministère des finances devait la soutenir en avançant des fonds considérables.
L’Alaska sera vendu, par la volonté du Prince Constantin
Le 16 décembre 1866, la décision tombe suite à une audience auprès du Tsar. En présence des ministres des affaires étrangères et des finances, du Prince Constantin et de l’Ambassadeur russe Edouard von Stöckl, en poste à Washington, l’autocrate de toutes les Russies accepte que la colonie soit vendue aux Etats-Unis. L’ambassadeur devra, pour conclure ce marché, réclamer aux Américains la somme de cinq millions de dollars américains (ce qui équivaut à quelque 70 millions d’euro actuels).
Edouard von Stöckl se rend immédiatement à Washington, distribue des pots-de-vin, joue un véritable jeu de poker, sans état d’âme, et parvient à obtenir 7,2 millions de dollars pour le trésor russe. A la fin du mois de mars de l’année suivante, le traité de cession de l’Alaska est signé. Au gouverneur, le Prince Maksoutov, échoit le triste devoir d’annoncer la nouvelle à la population de Novo-Arkhangelsk, rassemblée sur la place publique. Ces Russes d’Amérique ne pouvaient le croire, étaient atterrés. Ils se regroupèrent immédiatement dans l’église orthodoxe pour baiser les icônes et invoquer les saints. En vain. Lorsque la colonie est officiellement cédée aux nouvelles autorités américaines, pas un Russe n’est présent à la cérémonie. Sur place, il n’y a plus que des marchands de peaux américains qui espèrent de plantureux profits. Le 6 octobre 1867, à trois heures et demie de l’après-midi, la bannière étoilée flotte sur Novo-Arkhangelsk, que les Américains débaptisent aussitôt pour lui donner le nom de Sitka, aujourd’hui Saint Michael sur l’Ile Baranov.
Les nouveaux maîtres des lieux apportent une nouveauté supplémentaire : le calendrier grégorien, ce qui fait que ce 6 octobre devient le 18. Les sujets du Tsar sont désormais des étrangers indésirables, qui devaient donner logis aux soldats américains. Dégoûtés, ils plient bagage et quittent l’Alaska pour la Russie.
Erich KÖRNER-LAKATOS
(article tiré de l’hebdomadaire viennois « Zur Zeit », n°39/2007).
Source : Peter LITTKE, « Vom Zarenadler zum Sternenbanner », Essen, 2003.
01:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
El socialisme ético de Henri De Man

Infokrisis.blogia.com / Ernesto Mila
La revision idealista del marxismo: el socialismo ético de Henri De Man
http://infokrisis.blogia.com/2007/092701-la-revision-idea...
00:30 Publié dans Biographie, Définitions, Histoire, Philosophie, Politique, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 octobre 2007
Du symbolisme de l'épée

Du symbolisme de l’épée
Les plus célèbres épées de l’histoire ou de l a mythologie portent un nom: Balmung, Nagelring, Excalibur, etc. Ces noms expriment la valeur symbolique et magique qu’elles reflètent. Leur nom et les actes qu’elles ont accomplis leur procurent simultanément une particularité. Souvent, ces épées uniques en leur genre ont une origine divine, ont été données à l’homme par des dieux et reviennent souvent à ceux-ci en bout de course. Si un héros possède l’une de ces épées, il possède en même temps et puissance et salut. Pour cette raison, l’épée, tenue en main, exprime la force et les capacités masculines et phalliques, ce qui, par extrapolation, symbolise la puissance dominante. Ainsi, les héros solaires et les vainqueurs des forces chtoniennes/telluriques ont pour attribut l’épée.
Sur le plan de l’histoire évolutive de l’humanité, l’épée n’est forcément pas un symbole très ancien, car ce n’est qu’à l’Age du Bronze que les hommes ont disposé des capacités de fabriquer des épées. Les premières d’entre elles sont fort décorées, ce qui indique leur usage principalement sacré. Et si l’épée est l’attribut de la classe guerrière dominante, le fabricant d’épées, acquiert, lui aussi, une dimension plus importante : il s’agit du forgeron. Dans la mythologie scandinave, le dieu du tonnerre, Thor, entretient un rapport médiat avec l’épée. Si son attribut majeur est le marteau, celui reste tout de même aussi l’oeuvre du forgeron, dont le travail consiste à manier le feu et d’autres marteaux, que l’on associe ensuite à l’éclair et au tonnerre. Jörd, d’après l’Edda de Snorri, est la mère de Thor; elle est la personnification de la Terre. C’est d’elle que jaillissent les métaux que travaillent le forgeron. Le dieu solaire Freyr possède, lui aussi, une épée, capable de combattre seule. Il est le dieu de la fertilité, de la richesse matérielle, du développement pacifique. Ses représentations accentue sa dimension phallique.
Dans l’hindouisme védique et dans le bouddhisme, l’épée et le “varya” revêtent le même symbolisme; le terme sanskrit de “varya” désigne tout ce qui est masculin/viril, dont le phallus et la semence. Il signifie aussi la “foudre” et symbolise tout ce qui relève symboliquement de l’éclair. La massue à lancer, attribut d’Indra, se nomme également “varya”. Comme le marteau de Thor, cette massue d’Indra peut ôter comme donner la vie; elle est ainsi un symbole herculéen. Dieu qui décide de l’orage, Indra est représenté en couleur rouge, ce qui indique une appartenance à la caste des guerriers, ou “kshatriya”, caste qui le vénère en Inde.
Le rapport à l’épée a une dimension encore plus philosophique en Asie. Au Japon, la noblesse chevalière, c’est-à-dire les samourais, cultive une conception spirituelle à l’égard des deux épées que possède le samourai, soit le katana et le wakizashi. L’épée, pour eux, n’est pas seulement un objet de vénération, mais est aussi un symbole de l’âme. Par voie de conséquence, les samourais maintenaient leurs épées dans un état de pureté absolue et ne les maniaient qu’avec le plus grand respect. Les ninjas, en revanche, considéraient les épées d’une manière bien plus prosaïque. Leurs épées, contrairement à celles des samourais, n’étaient pas courbées, mais droites, ce qui avait pour avantage de pouvoir les utiliser comme outils, d’en faire éventuellement une arme de jet, de donner des coups d’estoc, de s’en servir comme levier ou comme échelle, etc. Pour le samourai, un usage aussi vil de l’épée était totalement inconcevable. En Orient, l’épée a une dimension féminine. En Occident, elle a généralement une lame droite, tandis qu’en Orient elle est courbée, à la façon des sabres ultérieurs. Au Japon, comme dans l’espace indo-européen, l’épée est l’attribut des divinités masculines du tonnerre et de la tempête, telles Susano-o au Japon, Indra en Inde, Mars dans le monde romain...
L’épée est également mise en équation avec l’intellect et possède de ce fait une vertu séparante, scindante: Alexandre le Grand a résolu une tâche autrement impossible, défaire le noeud gordien, tout simplement en le tranchant. La déesse Iustitia tient en une main une balance, en l’autre une épée. Ces deux objects ne représentent pas seulement les aspects législatif et exécutif. L’épée symbolise la force de sa capacité de juger; elle l’aide à séparer culpabilité et innocence. Au moyen âge, lorsque le chevalier passait la nuit avec la Dame qu’il admirait, il plaçait son épée entre lui et elle, posant de la sorte une barrière insurmontable qui symbolisait leur chasteté à tous deux. Enfin, lorsque le chevalier est frappé sur l’épaule lors de son adoubement, ce geste symbolise la séparation en deux de sa vie: celle d’avant l’adoubement, et donc l’entrée en chevalerie, et celle d’après. C’est clairement un rituel d’initiation.
Tacite évoquait déjà la danse de l’épée chez les Germains. L’histoire de ce rituel et de cette chorégraphie s’est poursuivie jusqu’au 20ième siècle. Bon nombre d’indices nous signalent qu’il s’agit pour l’essentiel d’une cérémonie d’initiation.
Comme l’épée est un objet récent dans l’histoire du développement général de l’humanité, les mythes, où l’épée joue un rôle, ne datent pas d’un passé fort lointain, comme l’indique notamment le mythe judéo-chrétien où Adam et Eve sont chassés du paradis terrestre. Dans ce mythe biblique, l’épée a aussi une fonction “séparatrice”; elle est en l’occurrence l’épée de feu de l’Archange Michel, qui sépare l’homme du Jardin d’Eden. Vu que Michel a des origines iraniennes et qu’après la christianisation de la Germanie, il a remplacé Wotan/Odin dans tous les symboles religieux, avec une interprétation chrétienne nouvelle, où son épée de feu sépare l’homme chrétien nouveau de son passé païen organique. L’épée de Michel est pour l’humanité germanique une sorte d’épée de Damoclès...
D. A. R. SOKOLL.
Article paru dans la revue “Hagal”, 2/2002, http://www.verlag-zeitenwende.de .
Bibliographie:
BIEDERMANN, Hans, Knaurs Lexikon der Symbole, Augsburg, Weltbild, 2000.
COOPER, J. C., Illustriertes Lexikon der traditionellen Symbole, Wiesbaden, Drei Lilien, 1986.
LURKER, Manfred, Lexikon der Götter und Dämonen: Namen, Funktionen, Symbole/Attribute, 2. erw. Aufl., Stuttgart, Kröner, 1989.
PASTENACI, Kurt, Die Kriegskunst der Germanen, Karlsbad u. A., Adam Kraft, 1942.
00:50 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ein Kampf für eine frech-bissige Sprache in der Politik

BOTSCHAFT ROBERT STEUCKERS ZUR GELEGENHEIT DES JUBILAEUMSFEIER DER WIENER WOCHENZEITSCHRIFT "ZUR ZEIT"
Ein Kampf für eine frech-bissige Sprache in der Politik !
„Political Correctness“? Nein Danke ! Noch eine Schablone der Moderne bzw. Postmoderne, die aber nicht als „modern“ gelten will? Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Eine wertkonservative und freisinnige Wochenzeitschrift zu gründen heisst selbstverständlich den Bürger gegen die Zugriffe steifer „Verallgemeinheiten“ immunisieren zu wollen. Ein solcher Kampf ist nicht von gestern noch von vorgestern. Die Ahnenreihe der Kämpfer in diesem Ringen ist lang.
Unser aller Lehrmeister Armin Mohler hat der Kampf gegen alle „Verallgemeinheiten“ und für die zu erhaltende Buntheit der weiten Welt als das „Agonale“ schlechthin gestellt. An der Quelle der heutigen „Verallgemeinheiten“ steht eine verballhornte Interpretation der Aufklärung, die an eine Apologie des Schwätzens in der Form der Habermaschen Kommunikationsvernunft gekoppelt ist. Diese verarmte Aufklärungsdeutung jakobinischer Prägung a) schliesst jede partikularen Kontinuität geschichtlicher Art aus, da alles was einmal da war, als mangelhaft weil unvermeidlich veraltet betrachtet wird, und 2) geometrisiert bzw. abstrahiert jedes politische Denken (George Gusdorf), was dazu leitet, dass jedes gewachsene organisch-politische Gemeinwesen seiner ursprünglichen Kräften willkürlich durch besessene Eiferer entledigt wird, sodass nur noch eine einzige Möglichkeit toleriert wird: die endlose Wiederholung des gleichen eintönigen und blutlosen Diskurses, d. h. das Repetieren der schon einmal für immer autoritär gesetzten abstrakten „Wahrheiten“.
Völker hört das Signal: Proletarier aller Länder, werdet endlich schwatzhaftige Papageien! Jedes Wort, das nicht Wiederholung des Wiederholten ist, wird als skandalös nicht-papageiisch betrachtet, also als „faschistisch“, um das fade Sprachgebrauch unserer zeitgenössischen Misere einmal ironisch zu benutzen. Orwell lässt grüssen! Wir fordern das Recht, nicht mehr starre Schlagworte wiederholen zu dürfen, das Recht zu erneuern, das Recht, wieder zur Quellen zu pilgern, zu Flüssen, die zwar immer die gleichen Flüsse sind, aber wo die Gewässer nie wiederholend-identisch sind (Herakleitos!). Deshalb ist die Schaffung einer anderen Politsprache notwendig, eine Sprache, die die Begriffe wieder flüssig macht, die die Rigiditäten des Etablierten durch ihre Frechheit und Bissigkeit lachend und spottend ätzt und auflöst! Unsere Hauptwaffe sollte wieder die Ironie sein und bleiben; unsere Hauptaufgabe ist die Seele des guten alten Diogenes wieder frisch lebendig zu machen!
Zeitschriften sind Laboratorien der Zukunft, die das Werden und die Gärung der Welt ergreifen, und es gibt aber keine mögliche Zukunft, wenn nicht erneuernd und furchtlos neue Werte oder neu wieder belebte Werte behauptet werden dürfen.
Deshalb wünsche ich „ZZ“ und seinen Mitarbeitern und unter ihnen insbesondere diejenigen, die ich schon so lange Jahre kenne und die noch damals in ihren sehr jungen Jahren im ostflämischen Munkzwalm mit Freunde aus ganz Europa mit mir getagt haben, was eine sehr dauerhafte Freundschaft geschmiedet hat, noch viele lange Jahre „Agonalität“, was unzweifelhaft Salz in unserer täglichen Lebenssuppe streuen wird. Ich wünsche uns alle, einen langen Weg voller Entdeckungen und Bereicherungen, mit Auf und Ab, stets weit von den blassen Gesinnungen unserer satten Zeitgenossen, Gesinnungen, die wir frech, pausenlos und lustig bespotten werden! Glück Auf!
Robert Steuckers, Brüssel.
00:40 Publié dans Affaires européennes, Nouvelle Droite, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
India e Myanmar

India e Myanmar vicini a siglare l'Accordo Strategico di Port Sittwe |
| Secondo fonti ufficiali di Delhi, l'India è vicina a siglare un accordo con la giunta militare del Myanmar per sviluppare il porto di Sittwe. Il porto dovrebbe permettere un facile ed economico trasporto di beni nei distanti e isolati stati nord-orientali dell'India. L'India investirà 103 milioni di dollari nel progetto, nonostante gli inviti internazionali per delle sanzioni contro il governo militare. 'Enormi benefici' "Siamo alla fase finale dei negoziati e l'accordo dovrebbe esserci in un mese", afferma un ufficiale del ministero degli esteri Indiano, che vuole restare anonimo. Con l'accordo, l'India investirà 103 milioni di dollari per sviluppare il porto e installare le infrastrutture per usare il fiume Kaladan. L'India sosteneva il movimento birmano per la democrazia fino a metà degli anni '90, quando iniziò a migliorare le relazioni con la giunta in uno sforzo per competere con la crescente influenza della Cina in Myanmar. Adesso costruisce strade e ferrovie nel Myanmar occidentale, e le sue compagnie cercano di avere l'accesso ai ricchi depositi di petrolio e gas naturale. |
00:25 Publié dans Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 29 octobre 2007
HAARP: contrôle du climat?

Roberto TOSO:
Quand les Etats-Unis veulent contrôler le climat sur toute la planète...
Y a-t-il quelqu’un qui joue avec les chiffres?
Les dates ne sont que coïncidence: 26 décembre 2002 : cyclone “Zoé” en Polynésie; 26 décembre 2003: tremblement de terre en Iran; 26 décembre 2004: le gigantesque tsunami qui vient de ravager les côtes de l’Océan Indien. Je ne dirais pas, dans la suite de cet article, que le tsunami de décembre 2004 a été provoqué, comme l’affirment certains sites “conspirationnistes”, par un expérimentation technologique secrète, et donc “voulue”, ajouteront certains commentateurs. Mais cette coïncidence dans les dates et cette volonté, qui est mienne, de ne pas céder à la tentation conspirationniste ne doivent pas nous conduire à rejeter en bloc et a priori le fait que l’idée a sûrement déjà germé dans certains esprits, de vouloir contrôler les phénomènes atmosphériques. Dont acte. Les hypothèses conspirationnistes et paranoïaques n’existeraient toutefois pas, si certaines prémisses n’avaient pas existé pour étoffer de tels délires, car, de tous temps, l’imagination la plus débridée a toujours besoin d’un point d’appui dans la réalité pour pouvoir se déployer.
Le Projet HAARP
Au cours des siècles, les modifications climatiques ont toujours représenté l’un des catalyseurs les plus puissants capables de susciter les facultés humaines de penser et de réfléchir. Elles ont en effet influencé les croyances et les actions, les motivations et les décisions, toujours, en apparence sur le mode de la causalité, alors qu’en réalité, nos facultés étaient guidées par une logique de fer: celle que nous impose la nature.
Toutefois, depuis l’ère de la révolution industrielle jusqu’à nos jours, l’homme a infligé à la Terre des blessures profondes, si bien qu’aujourd’hui, celle-ci ne présente plus, comme dans l’antiquité, un équilibre quasi parfait sur le plan bio-environnemental.
La communauté scientifique nous avertit sans cesse des dangers d’une surchauffe de la planète. Il n’en demeure pas moins que le risque majeur, que nous courrons et que les mass-media ignorent en règle générale, provient de mutations climatiques provoquées pour des raisons militaires.
Depuis 1992, le Département de la Défense des Etats-Unis développe un projet, coordonné tout à la fois par la marine et l’aviation américaines, que l’on a appelé HAARP (pour: “High Frequency Active Auroral Research Program”). En réalité, il s’agit du noyau même d’un projet bien plus vaste, et bien plus connu, notamment sur le nom de “Guerre des étoiles”. Il a été commencé dès le début des années 80 sous Reagan, pour se poursuivre à la fin de cette décennie sous Bush-le-Père. Ce projet connaît actuellement une phase d’accélération, dopé par un budget militaire d’une ampleur sans précédent, que l’on justifie au nom d’un “double langage” d’orwellienne mémoire: “La guerre, c’est la paix”.
La base principale, où l’on développe le Projet HAARP, se situe dans une vaste zone à Gakona en Alaska. Sur ce terrain, 180 pylônes d’aluminium, hauts de 23 m, ont été installés. Sur chacun de ces pylônes, nous trouvons deux antennes, l’une pour les basses fréquences, l’autre pour les hautes fréquences. Cette dernière est en mesure de transmettre des ondes de hautes fréquences jusqu’à une distance de 350 km. Ces ondes peuvent être dirigées vers des zones stratégiques pour la planète, que ce soit sur le sol ou dans l’atmosphère.
Comme on peut l’imaginer, toute l’opération se mène au nom de nobles objectifs: il s’agit d’études universitaires sur l’ionosphère et de développer de nouvelles techniques radar, qui permettront, à terme, d’accélérer les communications avec les sous-marins et de rendre possibles des radiographies de terrain, afin de déceler la présence d’armes ou d’équipements, jusqu’à des dizaines de kilomètres de profondeur. Pour confirmer cette vocation pacifique, le projet a mis un site en ligne qui nous donne l’image d’une station scientifique bien innocente, visibilisée par une quantité de “webcams”.
Mais la réalité, comme d’habitude, il faut aller la rechercher en dessous de la surface.
De Tesla à Eastlund
Dans les années 80, Bernard J. Eastlund, un physicien texan attaché au MIT de Boston, s’est inspiré des découvertes de Nikola Tesla, qui avait enregistré aux Etats-Unis le brevet n°4.686.605, dénommé “Méthode et équipement pour modifier une région de l’atmosphère, de la magnetosphère et de l’ionosphère terrestres”. Tesla avait ensuite déposé onze autres brevets. Dans l’un d’eux, il décrivait la propriété réflexive de l’ionosphère, qu’il convenait d’utiliser comme “systèmes de rayons énergétiques”, capables de “produire des explosions nucléaires graduelles sans radiations”, ainsi que des “systèmes de détection et de destruction de missiles nucléaires” et des “systèmes de radars spatiaux”.
L’ARCO a acquis certaines de ces inventions. L’ARCO est propriétaire de vastes réserves de gaz naturel en Alaska, qui peuvent être converties en énergie électrique redistribuable via l’ionosphère à tous les clients dans le monde: la vision de Tesla, qui voulait distribuer l’énergie sans fil et gratuitement à tous les foyers de la Terre, a donc été partiellement réalisée, mais viciée dans son principe généreux par de solides intérêts économiques.
En outre, ces inventions font qu’il devient possible de manipuler le climat, c’est-à-dire de créer de la pluie quand cela s’avère nécessaire pour l’agriculture ou de neutraliser des phénomènes destructeurs comme des tornades ou des ouragans.
C’est à ce niveau-ci que le gouvernement américain est entré dans le jeu, rendant l’histoire plus compliquée.
Tous les brevets d’Eastlund ont d’abord été mis sous scellés, à la suite d’un ordre ultra-secret, pour être ensuite transmis à la “E-Systems”, une des principales entreprises qui fournit des technologies avancées aux services secrets de grandes puissances du monde. Cette entreprise a ensuite été absorbée par Raytheon, l’une des quatre grandes entreprises fournissant du matériel à la défense américaine. Elle produit notamment les missiles Tomahawk et Stinger (dont la plupart ont fini entre les mains de pays classés dans l’Axe du Mal ou de groupes terroristes), ainsi que les fameux “Bunker Busters”. Les connexions, qui unissent ces firmes au pouvoir, passent toutes par la personne de Richard Armitage, aujourd’hui vice-ministre des Affaires Etrangères au sein de l’Administration Bush. Armitage, qui était déjà “consultant”, est membre du conseil d’administration, détenteur de signature et “supporter” convaincu de la PNAC, impliquée dans de nombreuses opérations de la CIA, depuis l’époque de la Guerre du Vietnam à aujourd’hui.
Sur base des découvertes d’Eastlund, c’est lui qui orienterait le potentiel du Projet HAARP en direction d’un point spécifique de l’ionosphère, afin de la réchauffer jusqu’à ce qu’elle s’élève physiquement, de manière à créer un gonflement hautement réfléchissant, qu’il définit comme un “effet lent”. Le but est d’acheminer les rayons vers la Terre en leur procurant des effets dévastateurs: la puissance de telles ondes serait telle qu’elle provoquerait des modifications de dimensions moléculaires au sein de l’atmosphère, causant —suite aux diverses fréquences— des modifications climatiques ou la désagrégation des processus mentaux de l’homme, voire, aussi, des effets sur les mouvements tectoniques de magnitudes encore imprécisées.
Des stratégies globales
Les événements géopolitiques actuels étaient prévisibles depuis de nombreuses années: il suffisait de lire certains livres prophétiques comme “Le Grand échiquier” de Zbignew Brzezinski, paru en 1997, ou les textes programmatiques de la PNAC (“Project for a New American Century”), parus la même année.
Nous pourrions deviner l’avenir aujourd’hui aussi, si nous lisions plus attentivement les écrits et les déclarations de penseurs influents et de personnalités militaires haut placées, qui évoquent un futur relativement proche.
Le même Brzezinski, conseiller en matières de sécurité au temps de Carter, écrivait déjà en 1970, dans son livre “Entre deux époques”: “La technologie va rendre disponibles, aux leaders des principales nations, des moyens pour conduire des opérations de guerre secrète, qui exigeront seulement la mise sur pied de forces de sécurité très réduites [...]. Il s’agit de techniques capables de modifier le climat afin de provoquer des périodes longues de sécheresse ou de tempête”.
Brzezinski fait référence, à cette époque-là, aux armes rudimentaires qui existaient déjà, résultats des premières études sur le développement de la guerre climatique. Songeons, dans ce cadre, au Projet Popeye, visant à étendre la saison des moussons au Vietnam.
Le document le plus intéressant est une étude rédigée par sept officiers de l’armée américaine en août 1996 et qui porte pour titre “Le climat comme démultiplicateur de puissance: le contrôler avant 2025”. Cette étude a vu le jour à la suite d’une directive émise par la Commandement des forces aériennes américaines et visait à stimuler un débat intellectuel au sein de l’armée, pour affirmer finalement : “En 2025, les forces aéro-spatiales des Etats-Unis pourront contrôler le climat, si elles parviennent, dès aujourd’hui, à cumuler les nouvelles technologies et à les développer dans la perspective de les utiliser en cas de guerre [...]. Il s’agira d’améliorer les conditions en cas d’opérations menées par des alliés ou d’annuller les effets de celles menées par l’ennemi, au moyen de scénarios climatiques faits “sur mesure”. Enfin, il s’agira de se donner les moyens de dominer complètement, à l’échelle globale, l’ensemble des moyens de communications et de l’espace; les modifications climatiques offriront aux combattants une vaste gamme de moyens possibles pour battre ou soumettre l’adversaire”.
Ces projets ont été confirmés par une étude ultérieure, qui date de 2003. Celle-ci porte pour titre: “Maîtriser l’ultime champ de bataille: les prochaines avancées dans l’utilisation militaire de l’espace”. Elle est l’oeuvre du “Project Air Force” de la Rand Corporation, une “boîte à penser” liée aux lobbies du pétrole et de l’armement, dont l’un des administrateurs fut Donald Rumsfeld et l’un des conseillers-administrateurs Lewis Libbey, membre fondateur de la PNAC, actuel directeur du personnel de Dick Cheney.
Le concept qui est à la base de ce rapport est celui de “Full Spectrum Dominance”. Ce qui revient à dire: une politique d’investissements militaires exceptionnels, visant la conquête de l’espace et le maintien dans l’espace d’une position de supériorité, sinon de contrôle absolu. Cette position de supoériorité obligerait donc ceux qui veulent en découdre avec l’ “Empire” de le faire pas terre ou par mer. Sur ce chapitre, les paroles prononcées par Joseph W. Ashby, le Commandant en chef du “Spatial Command” américain sont significatives: “Certaines personnes n’aiment pas en entendre parler, mais, en termes absolus, nous serons bientôt capables de combattre dans l’espace. Plus précisément: nous combattrons dans l’espace et depuis l’espace. Un jour, nous frapperons des objectifs terrestres, des navires, des avions ou des objectifs situés sur la terre ferme, tout cela depuis l’espace”.
Le 22 février 2004, le journal “The Observer” a publié un rapport “secret”, réclamé préalablement par Andrew Marshall, un conseiller influent de Rumsfeld, et échappé du Pentagone. La conclusion de ce rapport était la suivante: “Un brusque changement climatique conduira à une catastrophe globale de proportions gigantesques, avec une guerre nucléaire et des désastres naturels, condamnant des nations entières à la disparition sous les eaux des océans; les rares survivants lutteront pour les ressources raréfiées, soit les céréales, l’eau et l’énergie”.
On peut s’imaginer qu’il s’agit là de la description d’un futur fort lointain, tel qu’on le met en scène dans un film d’Hollywood; pourtant, en 2006 déjà, le lancement dans la stratosphère du “Falcon” aura lieu; c’est un drone armé de têtes nucléaires capable de voler à douze fois la vitesse du son, virtuellement inattaquable; des développements ultérieurs le rendront capable de frapper de manière ubiquitaire, à partir du territoire des Etats-Unis.
En 2006 aussi, ce sera l’année où le Projet HAARP se verra doter de ses derniers transmetteurs prévus, portant l’ensemble du système à sa puissance maximale. Est-ce toujours bien dans le but annoncé, celui d’aider l’agriculture dans le monde?
La communauté scientifique
Nombreuses sont les voix qui protestent face à ces folies et ces projets destructeurs. Parmi elles, celle d’une scientifiques de réputation internationale, Rosalie Bertell, qui dénonce “les scientifiques militaires américains qui travaillent sur des systèmes climatiques comme armes potentielles. Les méthodes qu’ils tentent de mettre au point comprennent l’accroissement des tempêtes et le déviement des flux de vapeur de l’atmosphère terrestre afin de produire des sécheresses et des inondations voulues”. Richard Williams, physicien et consultant auprès de l’Université de Princeton, dit que “les tests visant la surchauffe de l’ionosphère constituent autant d’actes irresponsables, relevant d’un vandalisme global [...]. Le Projet HAARP pourrait constituer un danger sérieux pour l’atmosphère terrestre. Avec des expérimentations de ce type, on apportera des dommages irréparables en peu de temps”.
Certains chercheurs soupçonnent d’ores et déjà que quelques modifications climatiques actuelles, bien observables, telles des séismes, des ouragans, des raz-de-marée ou des sécheresses persistantes, proviennent de ces expérimentations à buts militaires.
La Russie
Le Parlement russe, la Douma, a émis un communiqué en 2002, signé par 188 députés, où il était écrit: “Sous le couvert du Programme HAARP, les Etats-Unis sont en train de créer de nouvelles armes géophysiques intégrales, qui pourront influencer les éléments naturels par le biais d’ondes radio de haute fréquence. La signification de ce saut technologique est comparable au passage historique des armes blanches aux armes à feu, ou des armes conventionnelles aux armes nucléaires”. Quelques scientifiques craignent que l’ionosphère pourrait imploser sous l’effet de déséquilibres électriques. Leurs conclusions: “Pouvons-nous en vérité risquer d’altérer quelque chose que nous ne comprenons pas du tout, et qui appartient à toutes les formes de vie (et non pas seulement de la vie humaine) présentes sur cette planète?”.
Récemment, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé avoir développé un nouveau type de missile balistique télécommandé, capable de changer de trajectoire au cours de son voyage, rendant du coup complètement inutile les systèmes de défense inclus dans le fameux “bouclier spatial”: est-ce un bluff ou non? Quoi qu’il en soit, il est certain que les projets militaires des Etats-Unis, mis au point au cours de ces dernières années, ont généré une nouvelle course aux armements, sans précédent dans l’histoire, qu’il conviendrait de ralentir et de réguler. Mais ce projet de modérer les effets pervers de cette nouvelle course aux armements est systématiquement freiné et saboté par l’unique super-puissance restante qui s’est arrogé le droit de juger l’accumulation d’armements, non pas au nom d’intérêts globaux, mais au nom de ses seuls intérêts propres. Les accumulations américaines sont donc, dans cette optique, au service du “Bien”, tandis que les autres ne sont que l’expression d’une indicible méchanceté, celle de l’ “Axe du Mal”. Dans de telles conditions, nous avons sous les yeux les prémisses d’une nouvelle guerre froide de dimensions globales.
Quant à la Russie, elle a, elle aussi, mis en avant certains projets basés sur les découvertes de Tesla de la fin des années 50, développant de la sorte une recherche parallèle à celle des Etats-Unis, sauf qu’elle s’avère plus lente vu la faiblesse économique terrible de la Russie actuelle. Qui sait si Emmanuel Todd, le chercheur français qui avait prédit la fin de l’empire soviétique dès 1976, dans “La chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique” (R. Laffont), n’a pas raison une fois de plus quand il décèle, dans ses nouvelles analyses, les mêmes indicateurs, notamment dans son livre de 2003, “Après l’Empire. Essai sur la décomposition du système américain” (Gallimard), où il annonce la déliquescence de l’ultime super-puissance. Pour l’heure, la Chine se tait. Comme l’affirmait Bertold Brecht: “La science, quand elle est au service du pouvoir, n’apporte que des malheurs à l’humanité entière”.
Roberto TOSO.
Article trouvé sur : http://www.luogocomune.net ; sources: New York Times, Heart Island Journal, BBC, Canadian Working TV, Earthpulse Press, autres. Cet article a été reproduit par le quotidien romain “Rinascita”, 11 janvier 2005.
00:40 Publié dans Affaires européennes, Défense, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 octobre 2007
1970: coopération russo-iranienne
1970: déjà une coopération russo-iranienne
28 octobre 1970: 
Le shah d’Iran voulait jouer une carte autonome, ne craignait plus les Soviétiques comme au début de son règne, quand les troupes soviétiques venaient de quitter le territoire iranien, après une occupation de quatre ans (1941-45) et que Moscou soutenait des indépendantistes azéris dans le nord-ouest de l’ancienne Perse. Le soutien inconditionnel apporté par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et Israël aux mollahs aux débuts de la révolution khomeyniste avait pour but de déstabiliser, et jeter bas, un régime personnel qui avait appuyé l’OPEP, entendait mener une politique indépendante face au bloc soviétique, affirmer ses droits historiques dans le Golfe Persique, tendre une main à l’Inde, dégager l’Océan Indien des tutelles étrangères à son espace.
Il ne fallait surtout pas que ce régime ait une autonomie énergétique (ni par le pétrole ni par le nucléaire) ; l’hostilité au shah, qui avait acquis les premiers rudiments d’une énergie nucléaire, est paradoxalement la même que celle qui oppose Ahmadinedjad à Washington, en dépit de la différence idéologique entre l’autocratie éclairée du souverain Pahlavi et le fondamentalisme chiite professé par l’entourage de l’actuel président iranien. L’intention américaine, en appuyant la révolution des mollahs, était de bloquer la grande œuvre de modernisation du shah et de replonger l’Iran dans un régime fait d’archaïsmes que l’on voulait incapacitants et cela, jusqu’à la consommation des siècles.
Ahmadinedjad veut sortir de ces archaïsmes, relancer le programme nucléaire abandonné depuis le shah : raison de l’hostilité des Etats-Unis à son égard.
02:10 Publié dans Affaires européennes, Défense, Economie, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 octobre 2007
Qu'est-ce que la mondialisation?

Qu'est-ce que la mondialisation?
L’économie mondiale résulte des centres mondiaux de production, de la propagande mondiale diffusée par des médiats très concentrés et des marchés financiers. La mondialisation, c’est la constitution de décisions économiques à l’échelle mondiale et dotées de moyens mondiaux.
Certains utilisent plus volontiers le terme de globalisation, pour désigner l’accroissement de la mobilité de tout ce qui est codifiable et se transporte indépendamment des hommes. Une firme globale procède ainsi : elle décompose la chaîne de production, qui va de la recherche-développement d’un nouveau produit à sa distribution, en activités unitaires simples. Puis, elle localise les activités sédentaires (par exemple, un supermarché proche des consommateurs éventuels) et localise tout le reste dans les territoires qui offrent les meilleures conditions. Finalement, le commerce international est, pour plus de la moitié, un commerce entre différentes filiales de firmes globales. Cela crée partout chômage et désindustrialisation, accroît la puissance de quelques oligarchies et utilise force propagande pour affirmer que les pauvres sont responsables de leur pauvreté.
I - Les dogmes de l’occidentisme.
1 - Le dogme commun aux institutions internationales (OMC, FMI, OCDE) peut se résumer en quatre propositions :
- L’accroissement du commerce international explique fondamentalement la croissance du PIB. Mais il n’y a aucune possibilité de prouver cela. On peut tout aussi valablement soutenir que c’est la croissance du PIB qui a suscité la croissance des exportations européennes (et françaises) ou bien que l’un et l’autre (croissance et exportations) ont crû en raison d’autres facteurs.
- La poursuite de ce développement peut dégager des “ gains colossaux “ mais on ne précise jamais les coûts.
- Le refus de la poursuite de la libéralisation des échanges entraînerait une situation catastrophique.
- Le meileur moyen de combattre le chômage en occident est de poursuivre la libéralisation mondiale des échanges.
2 - Le modèle globalitaire s’appuie sur la théorie des coûts comparés formulée en 1817 par Ricardo. Mais elle est erronée sur un point essentiel : la structure des coûts comparés ne reste pas invariable dans le temps, sauf pour les ressources naturelles et les produits tropicaux.
3 - Les prix mondiaux sont des prix en $. Or, les taux de change sont flexibles. Donc les taux de change permettent d’égaliser dans les pays les prix des biens exprimés en dollar.
Les causes de la servilité des Européens face aux diktats US sont connues et sans originalité : déplaire aux factions US, c’est s’interdire toute carrière dans les organismes internationaux ou dans certaines affaires privées.
II - Le libre-échangisme responsable du chômage massif (1)
a) Le ralentissement de la croissance en Europe, la désindustrialisation et la montée d’un chômage massif ont la même cause : la rupture de 1974. A cette époque, l’entrée dans le marché commun, le 1° janvier 1973, de la Grande-Bretagne, a entraîné une orientation majeure de l’organisation de Bruxelles vers une politique de libre-échange mondialiste. Au début de 1973, le système monétaire international s’est disloqué et, à partir de Mars 1973, le système des taux de change flottants s’est établi. Le commerce international et les taux de change correspondent à deux aspects indissociables qu’on ne peut considérer isolément. Si le change peut varier de 50% en quelques années, aucun calcul économique n’est possible.
b) Le libre-échangisme crée partout une forte pression à la baisse des coûts. Partout on entend dire que le coût du travail non qualifié est trop élevé. Mais personne ne dit de combien...Pour survivre, les entreprises délocalisent...Le chômage résulte de charges salariales globales trop élevées au regard de la productivité externe du travail (i.e. des travailleurs étrangers) au cours des changes.
c) Les effets de tout progrès technologique sont progressifs et continus. Ils ne peuvent générer du chômage massif. Le développement des machines à vapeur, des chemins de fer et de l’électricité n’a jamais été brutal. Il n’a jamais impliqué le sacrifice de générations entières. Le libre-échange détruit les investissements industriels dans les secteurs défavorisés et nécessite de nouvelles ressources pour effectuer de nouveaux investissements.
III - Pour une Europe auto-centrée
L’objectif des USA, tant en matière agricole qu’industrielle, et dans les industries du divertissement, est d’accroître les exportations des firmes US et d’augmenter les importations européennes. Nombre d’importations transitent d’ailleurs par les USA et sont en réalité des importations de pays à bas salaires. Le libre-échangisme est une ruse. Il convient :
1 - Réformer le Système monétaire :
- Organiser le contrôle monétaire des activités, avec sanctions des créditeurs et des débiteurs qui sont autant responsables. En particulier, il convient de réduire massivement la titrisation (et d’interdire la défaisance) qui crée des parts de fonds communs à partir de prêts. Par cette astuce, une dette illiquide, non négociable, portée par une banque, donne naissance à des titres la représentant. La finance indirecte se transforme en finance directe avec, comme pour la défaisance, l’objectif inadmissible d’étaler les pertes, de façon à ne pas déclarer la cessation de paiements et d’échapper à la liquidation judiciaire qui découlerait de l’application des règles en vigueur.
- Créer des organismes de compensation des dettes et créances à côté des banques. Notamment, utiliser le mécanisme des caisses de conversion. Un débiteur en dollar verse les intérêts de sa dette en monnaie locale. La caisse crédite en cette monnaie le créancier en dollar qui dispose d’un pouvoir d’achat avec lequel il acquiert des biens et services produits dans le pays. Ce mécanisme aide simultanément à relancer l’activité de la région et à embaucher.
- Créer une monnaie internationale commune à l’ensemble des pays ou nations qui délimitent leurs propres espaces monétaires. Elle fonctionne selon deux préceptes :
* La monnaie internationale est instituée d’emblée comme une monnaie de crédit, moyen exclusif de règlement des dettes extérieures qui naissent des échanges.
* La monnaie commune ne se substitue pas aux monnaies existantes. Elle est une monnaie de conversion émise par une banque mondiale ayant un département dans chaque zone monétaire.
2 - Instaurer des quotas d’importations par catégories de produits. Un pourcentage de 20% maximum d’importations serait autorisé, sauf pour les matières premières et les produits exotiques.
3 - Réformer les organisations mondiales.
L’OMC et le FMI doivent fusionner car commerce et taux de change sont deux aspects d’un même problème. L’OCDE serait réorientée vers la fourniture de statistiques fiables et fournirait des expertises en concurrence avec les organisations de l’ONU.
Conclusion
Aucune civilisation n’a pu exister en l’absence des multiples fonctions économiques, notamment sans industrie, et en présence de plus de 10% de la population active alimentée par l’aide sociale. Or, ces tendances amorcées en 1974 ne s’inversent pas, au contraire. La désindustrialisation de l’Europe et le chômage massif (y compris l’immigration incessante extra-européenne) ne peuvent être remplacés par des écoles d’hôtellerie pour créer des activités de tourisme. Cela est totalement niais. Le suicide de notre civilisation est programmé dans ces tendances.
Frédéric VALENTIN.
NOTE 1 : D’après M. ALLAIS : La mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance. Cl.Juglar, 1999.
00:35 Publié dans Définitions, Economie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 octobre 2007
1959: bataille pour le Ladakh

Bataille pour le Ladakh
26 octobre 1959: De violents combats éclatent entre troupes chinoises et indiennes sur les hauteurs himalayennes du Ladakh. Les deux puissances tentent de dominer le toit du monde, surtout après la conquête chinoise du Tibet. L’enjeu géopolitique de cette guerre, tout comme celle qui oppose l’Inde et le Pakistan au Cachemire, est de s’assurer un espace stratégique surplombant sur les plaines et vallées environnantes. L’Inde cherche également à avoir un corridor territorial la liant à l’URSS, à l’allié russe traditionnel des nationalistes hindous.
Le Pakistan existe pour éviter cette liaison territoriale, politique qui lui est dictée par Londres et Washington.
La Chine, en s’insérant dans l’espace hautement stratégique du Ladakh, cherchait un lien avec le Pakistan, et par là même, une fenêtre sur la partie occidentale de l’Océan Indien, qualifié par la géopolitique anglo-saxonne, dérivée de Halford John Mackinder, d’ « Océan du Milieu ». Dans cette volonté chinoise de faire cause commune avec le Pakistan, et de couper par la même occasion l’Inde de l’URSS, il faut voir les prémisses du rapprochement sino-américain sous la Présidence de Nixon et sous la houlette du Realpolitiker Kissinger.
En 1972, la Chine, qui a soutenu et soutiendra le Pakistan, allié de Washington, dans toutes ses guerres contre l’Inde, participe, elle aussi désormais, à l’endiguement (« containment ») de l’URSS, qui n’a plus, comme allié de revers, qu’un Vietnam exsangue, épuisé par une longue guerre inégale ; un Vietnam de surcroît menacé au sud et à l’ouest par un Cambodge pro-chinois et donc pro-américain.
01:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Protection sociale et colonies de peuplement
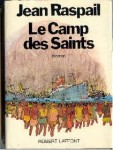
Protection sociale et colonies de peuplement : la grande iniquité
L'occidentisme, selon Alexandre Zinoviev, est «Un phénomène unique en son genre et exceptionnel dans l'histoire de l'humanité... Il n'y en aurait plus jamais dans l'avenir si, d'aventure, il se dégradait et quittait la scène historigue» (1). Or, des dizaines de millions d'étrangers vivent en occident stricto sensu sans s'y assimiler. On peut envisager que ces migrants deviennent majoritaires (2). Si tous les peuples sont capables de jouir des bienfaits matériels de l'occident, peu sont capables de créer eux-mêmes une civilisation de ce genre. D'autres peuples ont créé des civilisations de type différent. L'occident sera détruit par l'immigration.
La croissance de la population française : rappel historique
Les effets de l'augmentation de la population avaient éveillé l'intérêt du pasteur-économiste Malthus au XVIIIième siècle, lorsque Benjamin Franklin décrivait les colonies anglaises où la population avait doublé en 25 ans (3). Le pasteur Malthus s interrogea sur l'équilibre entre population et ressources. Or, dans l'Europe du XIXième, l'équilibre fut trouvé. Comment ?
En France, selon l'historien Michel Morineau, l'accroissement démographique conduisit, jusqu'aux années 1840-1850, à un système d'exploitation complexe destiné à élever les ressources au niveau des bouches à nourrir. A titre complémentaire, certaines catégories de la population en âge de travailler effectuaient des migrations temporaires ou se livraient à de nouvelles activités commerciales. En même temps, l'industrialisation, en tuant l'artisanat paysan, provoqua de partout la pauvreté. Celle-ci fut éliminée peu à peu par des activités de remplacement, à condition d'accepter le passage de la migration temporaire à la migration définitive. C'est dire que l'exode définitif des populations quittant la terre fut acquis parce qu'il existait des offres d'emplois en ville, avec un revenu, ou des terres vierges à mettre en valeur dans le monde. Rien de tel aujourd'hui. Les diasporas du monde entier bénéficient d'un revenu par l'intermédiaire de prestations sociales multiples, utilisent gratuitement les services collectifs, mais n'ont pas d'emplois durables car le problème actuel est d'ordre qualitatif : la technologie requiert des compétences précises en termes de métier et des qualités personnelles solides : claire compréhension d'une langue, des usages, des modes de raisonnement et des références culturelles.
L'existence de diasporas multiples a déjà engendré des problèmes qui comptent parmi les plus importants et les plus difficiles de notre époque. La contrainte incessante à l'immigration est une source de conflits permanents car elle ôte à la population autochtone l'espace dans lequel ses enfants auraient pu agir. Les Européens de vieille souche y voient une menace pour la vie et l'avenir de leur descendance.
La rupture du lien entre générations
Dans l'installation de colonies de peuplement, deux mouvements se superposent :
- Nombre d'immigrés viennent parce que leur pays ne leur donne pas une instruction solide ou n'offre pas assez de travail. D'aucuns affirment faussement qu'ils paieront les retraites des Français en phase de vieillissement de leur pyramide des âges. Mais les jeunes que les pays pauvres envoient le plus facilement en France sont les moins formés. Entretenus sans effort, ils subsistent massivement par le branchement sur les mécanismes d'assistance et de protection sociale. Ces immigrés sont inutilisables dans les conditions technologiques actuelles. Ils ne seront jamais en mesure de financer la retraite des Européens.
- Des jeunes immigrés sont éduqués dans leur pays puis viennent en France. C'est le drainage des cerveaux issus des pays pauvres, dans des conditions culturelles difficiles.
Les problèmes soulevés par ces diasporas sont multiples. Au niveau macroéconomique, le prix Nobel Maurice Allais les expose de la manière suivante : «C’est un fait que dans les différents pays le capital national reproductible est de l’ordre de quatre fois le revenu national. Il résulte de là que lorsqu'un travailleur immigré supplémentaire arrive, il faudra finalement pour réaliser les infrastructures nécessaires ( logements, hôpitaux, écoles, universités, infrastructures de toutes sortes, installations industrielles, etc.) une épargne supplémentaire égale à quatre fois le salaire annuel de ce travailleur. Si ce travailleur arrive avec sa femme et trois enfants, l'épargne supplémentaire nécessaire représentera suivant les cas dix à vingt fois le salaire annuel de ce travailleur, ce qui manifestement représente une charge très difficile à supporter» (4). Or, la part de l'épargne fixée par les investisseurs institutionnels (fonds de pension, fonds communs de placement, OPCVM) s'est presque partout très fortement accru. Il y a concentration de la gestion de l'épargne entre les mains de professionnels ouverts aux opportunités du marché global, qui placent en titres libellés en différentes monnaies. L'Etat n'est plus qu'un emprunteur parmi d'autres et, déjà sur-endetté par la politique des factions qui le contrôlent, se rabat sur l'épargne forcée, le pillage des classes moyennes versant un Tribut croissant en faveur du gouffre sans fonds de la protection sociale.
La seconde question clairement identifiable est celle de l'équité intergénérationnelle. L'équité, ou justice commutative, impose de faire en sorte que chacun reçoive en proportion de ce qu'il apporte. L'équité se préoccupe d'équivalence : il faut assurer un traitement équitable entre les générations. Or, les diasporas détruisent l'équité. Les diplômés originaires des pays en développement, souvent confrontés à des perspectives de gain médiocres dans leur pays, et à un environnement technologique limité, préfèrent s'installer en France, en sorte que «si nous parvenons à prendre ces jeunes aux sociétés qui les ont formés et envers lesquels ils ont des devoirs, nous commettons un véritable vol et nous privons le tiers monde de sa seule chance de développement» (5). L’investissement dans la jeune génération, consenti par leurs aînés, est perdu et la dette de ces étudiants à l'égard de leur pays n'est pas remboursée. Aux conséquences délétères pour le développement de ces régions s'ajoute l'injustice d'une dette non remboursée.
Recréer l’harmonie
Une solution alternative consiste, selon l'analyse de l'économiste J. Bichot, à stopper le nouveau commerce du bois d'ébène en explorant la piste suivante : «Ne donner à un diplômé d'un pays pauvre l'autorisation de venir exercer une activité professionnelle dans un pays riche que dans la mesure où, en sens inverse, un technicien du Nord irait exercer ses talents au Sud» (6). Il s'agit de respecter le principe d'un échange équitable : celui qui se rend utile a des droits, celui qui déçoit a des devoirs.
La contribution apportée par la France à l’instruction des ressortissants du monde entier est considérable, comme le montre toute visite des établissements d'enseignement. Cela est inique! Rien n'est comptabilisé ! La valeur de la formation dispensée aux étudiants étrangers devrait être facturée et, par un échange équitable, la "matière grise" importée de l'étranger serait payée.
Ce principe se substituerait à l'injustice actuelle où le plus grand nombre des diplômés appartenant aux multiples diasporas évite de rembourser les dettes dues à leur pays d'origine ; où les non qualifiés préfèrent vivre en France du RMI et de diverses prestations plutôt que de demeurer sans emploi dans leurs pays.
Erreur sur le coût du travail
Pour faire semblant de lutter contre le chômage, le premier ministre a proposé de réduire les charges sociales des entreprises et d'accroître, à la place, les prélèvements sur les revenus de la population. Mais, pour les entreprises dans leur ensemble, le coût du travail ne changera pas. Que les charges sociales soient payées sous la forme de cotisations ou sous la forme d'impôts sur les revenus des ménages (cas du Danemark par exemple ), les salariés demanderont une compensation à cette fiscalité par des salaires nets plus élevés. Le vrai problème est le coût global du travail (salaires plus charges) comparé à sa productivité. Or, les colonies de peuplement provoquent des distorsions sur les salaires de certaines activités et sur la productivité de nombreux secteurs. L'iniquité va consister à appauvrir l'ensemble de la population au profit des diasporas qui subsistent de notre subsistance.
Les hommes ne sont pas interchangeables, sauf dans les délires religieux, lorsque la race autoproclamée supérieure des bergers encadre le bétail, vaste masse d'impurs mêlés dans le pandémonium de toutes les nations dissoutes. Les tyrans capitalo-théocratiques de l'occidentisme méprisent les facteurs qualitatifs, les grâces spécifiques des peuples et des patries, comme des brutes pédophiles qui veulent les violer dans un fossé le sont aux minauderies des enfants. Mais c'est un suicide, car la culture professionnelle est un pilier fondamental de notre civilisation. Forgée au cours des siècles, elle permet à des millions d'individus d'exécuter correctement leur travail. Or, l'arrivée massive de diasporas du monde entier, qui en sont dépourvus, a entraîné une transformation de celle-ci. Une conséquence de cette inadéquation est la baisse des normes culturelles et professionnelles. Une autre est l'extension indéfinie du prélèvement obligatoire sur les revenus professionnels pour financer le niveau de vie des nouveaux occupants.
Questions annexes
L'installation de colonies de peuplement pose enfin deux questions annexes qui ne sont pas sans importance.
- Mircea Eliade, grand spécialiste de l'histoire des religions, a décrit dans son Journal des Indes (7), la méthode préférée des Anglais. Ils payaient quelques voyous pour jeter un porc égorgé dans la cour d'une mosquée. Les musulmans lançaient des émeutes, de connivence avec la police anglaise qui intervenait seulement quand un Hindou prenait les armes pour se défendre. Les colonies de peuplement rendent peut-être des services auxquels un travailleur du monde de la technique ne pense pas...
- La société occidentale tend vers une société du crime (8) . Sous sa forme externe, le crime se présente comme mise à sac de la totalité de la planète. Alors, tout comme l'extinction des espèces ou la pollution généralisée du globe, la migration annoncée par Boumedienne est l'une des participations au crime, déguisée en vertu.
PONOCRATES.
(1) Alexandre ~INOVIEV : L'Occidentisme, Essai sur le triomphe d'une idéologie. Plon, 1995.
(2) Zinoviev fait dire à l'un de ses personnages littéraires : «Un jour, le muezzin criera "Allah akhbar!" du haut de la tour Eiffel».
(3) Au Canada français, la population était passée de 60.000 personnes en 1760 à 127.500 en 1790. En Nouvelle-Angleterre, aux mêmes dates, elle était estimée respectivement à 459.000 et 923.865 personnes. D'après Michel Morineau : Malthus au village. Dans : Pour une histoire économique vraie, PUL, 1985, pp.493-512.
(4) Maurice ALLAIS : L'Europe face à son avenir : que faire ?, R. Laffont/C. Juglar, 1991, p.99.
(5) Jacques BICHOT : Quelles retraites en l'an 2000 ? A.Colin, 1993, p.60.
(6) J. BICHOT : Ouvrage cité, p. 124.
(7) Mircea ELIADE : Journal des Indes, L'Herne, 1992, p.128.
(8) Christian CARLE : La société du crime. Les éditions de la passion, 1996.
00:25 Publié dans Affaires européennes, Economie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 octobre 2007
Sacrifice de T. Mac Swiney

Le sacrifice de Lord Terence Mac Swiney
25 octobre 1920 : Lord Terence Mac Swiney, le maire nationaliste irlandais de la ville de Cork, dans le sud de la Verte Erin (Eirinn), meurt dans une prison anglaise, après 73 jours de grève de la faim. Il était un militant du Sinn Fein et avait refusé d’abandonner ses convictions pour conserver ses honneurs et ses positions.
Lord Mac Swiney demeure, dans la mémoire vive des Irlandais, une des victimes les plus sublimes de la barbarie britannique. Une chanson poignante, souvent chantée en Irlande, rappelle sa mémoire et incite le peuple à la vengeance. La mort de cet aristocrate ami du peuple, qui confine à la sainteté, radicalisera le mouvement irlandais.
Sous l’énergique direction de Michael Collins, l’Irish Republican Army passera à l’offensive, repèrera les agents britanniques en poste à Dublin et les abattra sans pitié dans les rues de la capitale irlandaise, dès le 20 novembre 1920, où quatorze d’entre eux paieront de la mort leurs crimes abjects contre la nation irlandaise.
Le 21 novembre 1921, les Britanniques se vengent et massacrent au hasard 72 personnes dans les rues de Dublin : c’est le fameux « Bloody Sunday ». La spirale de la violence est enclenchée, mais elle conduira à la victoire des nationalistes irlandais et à l’indépendance du pays.
Le 21 octobre 1921, un an après la mort de Mac Swiney, les Britanniques sont contraints de négocier avec les indépendantistes républicains irlandais. Le film naguère consacré à Michael Collins restitue de manière véritablement sublime la lutte qui s’est jouée à l’époque.
01:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 octobre 2007
Henri III contre la simonie

Henri III contre la simonie
24 octobre 1046: Notre Empereur Henri III, lors du synode de Pavie, fait interdire la pratique de la simonie, c’est-à-dire celle qui consiste à acheter et vendre des charges ecclésiastiques.
Cette pratique, très peu spirituelle, était monnaie courante. Elle porte un coup au prestige de l’Eglise et du Pape Grégoire VI, soupçonné d’avoir effectivement acheté sa charge. La papauté se vengera en réclamant le droit exclusif de nommer les évêques, sans intervention de l’Empereur. Le fils de Henri III, Henri IV, devra subir l’humiliation de Canossa, qui ruina le crédit de l’institution impériale, la seule qui aurait été capable de donner une véritable colonne vertébrale à l’Europe. Tout le déclin de l’Occident, si souvent évoqué et déploré, réside dans cette volonté mesquine de se venger, parce qu’on ne pouvait plus se livrer à des pratiques douteuses, pré-mafieuses.
01:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Russie: arrière-cour de l'Europe ou avant-garde le l'Eurasie?

Wladimir WIEDEMANN
Intervention lors de la “Freideutsche Sommeruniversität”, août 1995
Lorsque nous évoquons la notion d'Empire, nous devons nous rappeler que ce concept, au sens classique, se manifeste sous deux formes historiques légitimées: une forme occidentale (ou “romaine occidentale”) et une forme orientale (ou “romaine orientale”, byzantine). Ainsi, l'idée authentique d'Empire est liée indubitablement à une perspective téléologique: la réunification finale de deux parties provisoirement séparées d'un Empire originel. Du moins sur le plan des principes. Car il est bien évident que cette “réunification de l'Empire” ne peut se réduire au niveau d'accords politiques purement formels dans l'esprit d'une diplomatie utilitaire et profane. Néanmoins, ce problème peut et doit être discuté par les deux parties concernées au niveau d'une idéologie impériale actualisée voire d'une théologie impériale. Mais qu'en est-il de ces deux parties?
La dernière héritière des traditions impériales romaines-occidentales a été la Germanie, tandis que la dernière héritière des traditions romaines-orientales ou byzantines a été la Russie. Comme le philosophe allemand Reinhold Oberlercher le remarque très justement, les Allemands et les Russes sont les deux seuls peuples d'Europe capables de porter à bout de bras de véritables grandes puissances politiques. Dans son ouvrage Lehre vom Gemeinwesen, il écrit: «En tant qu'Empire (Reich) porté par les tribus de souche germanique, la forme politique propre du peuple allemand a pour mission de constituer un Reich englobant tous les peuples germaniques, lequel devra, de concert avec l'Empire des peuples russes (Grands-Russes, Petits-Russiens et Biélorusses), constituer un Axe de sécurité nord-asiatique et établir l'ordre sur la plus grande masse continentale du monde» (1).
Permettez-moi d'étudier plus en détail les thèmes de l'idée impériale en son stade actuel et de la politique impériale de la Russie. L'effondrement de l'Etat communiste a conduit en Russie à un vide idéologique, à la perte de toute orientation générale. Mais on sait pourtant que la nature ne tolère aucun vide. Ainsi, l'antique idée impériale, l'idée d'un Empire religieux-orthodoxe, dans le contexte d'un nouveau sens historique, doté d'un nouveau contenu social et géopolitique, est en passe de renaître. De quoi s'agit-il?
Bien évidemment, la Russie nouvelle, post-communiste, n'est plus la vieille Russie féodale, tsariste, avec son servage. Aujourd'hui, il n'y a en Russie ni aristocratie ni classe moyenne. Il y a toutefois des intérêts historiques, objectifs et nationaux bien tangibles: ce sont les intérêts d'une nation qui compte dans le monde, les intérêts d'un peuple porteur d'Etat, et ces intérêts sont clairement délimités: il faut du pain pour le peuple, du travail pour tous les citoyens, de l'espace vital, un avenir assuré. Mais pour concrétiser ces intérêts, il y a un hiatus de taille: la nomenklatura paléo-communiste demeurée au pouvoir jusqu'ici n'avait aucun projet social “créatif” et ne voulait que se remplir les poches avec l'argent volé au peuple et, pire, placer cet argent sur des comptes à l'étranger, dans des banques fiables. En d'autres mots: ce nouveau capitalisme spéculateur montre les crocs en Russie: il est incarné par cette nomenklatura, liée à la caste corrompue et bigarrée des “hommes d'affaire”, et parasite sans vergogne le corps d'une Russie devenue “libérale-démocrate” et dépouillée de toutes ses protections. Ainsi, depuis le début de la perestroïka, un capital de 500 milliards de dollars américains a quitté le pays. Le gouvernement Eltsine ne dit pas un mot sur ce “transfert”, mais dès que quelques misérables milliards sont offerts à titre de crédit par la Banque Mondiale, il fait battre tambour et sonner buccins!
Mais le temps est proche où ces crocs mafieux recevront l'uppercut définitif qui les mettra hors d'état de nuire. Ce coup, ce sont les forces intérieures de la Russie qui le porteront et ces forces sont actuellement incarnées par les nouveaux propriétaires du capital industriel et producteur. Bien entendu, il s'agit ici, en première instance, du complexe militaro-industriel qui se trouvait jusqu'ici, à titre formel sous contrôle étatique. Quelle sera l'intensité du processus de privatisation dans ce domaine? C'est une question de temps et cela dépend aussi des circonstances globales, politiques et économiques, qui détermineront l'histoire prochaine de la Russie. Mais une chose est claire d'ores et déjà: tôt ou tard, le pays générera une classe de véritables industriels et c'est à ce moment-là que naîtra la future grande puissance russe.
Je voudrais maintenant parler des fondements géopolitiques, économiques et idéologiques de la grande puissance russe. C'est connu: le bien-être du peuple et la puissance réelle d'un Etat dépend des placements en capital domestique, parce que ces placements garantissent la création de nouveaux emplois et augmente le pouvoir d'achat de la population. Ensuite, il est clair qu'au stade actuel de développement de la production, ce ne sont pas les entreprises moyennes et petites qui s'avèreront capables de générer et de placer de tels capitaux. Seules les très grandes entreprises d'envergure internationale sont en mesure de le faire, car elles peuvent financer une recherche très coûteuse et une formation de personnel adéquate. Ce sont surtout les Américains et les Japonais qui possèdent aujourd'hui des sociétés disposant de telles masses de capitaux et sont capables de faire face dans le jeu de la concurrence planétaire. Ces entreprises sont celles qui créent dans le monde la majeure partie des nouveaux emplois, bien rémunérés.
Les centres principaux de production de haute technologie moderne se concentrent de plus en plus dans les zones autour des grandes métropoles des côtes pacifiques, parce que la base du développement d'une production de ce type, c'est l'accès au commerce planétaire. Aujourd'hui, dans ce domaine, c'est le commerce maritime qui joue le rôle-clef, dont les voies de communication sont contrôlées par la politique militaire américaine dans toutes les zones stratégiquement importantes. C'est en constatant ce centrage sur le Pacifique qu'est née la thèse du “Pacifique comme Méditerranée du XXIième siècle”, c'est-à-dire du Pacifique comme nouvel espace où se développe actuellement la civilisation du progrès technique. Si les choses continuent à se développer dans ce sens, les conséquences en seront fatales pour tous les pays européens; ceux-ci seront contraints, sur le plan économique, à se soumettre à l'hégémonie américaine dans toutes les questions-clefs de la dynamique de la production moderne et aussi pour tous les mécanismes socio-politiques. Ce sera également le problème de la Russie. Mais ce sera justement le “facteur russe” qui permettra aux autres Européens de prendre une voie alternative, qui permettra de libérer toutes les initiatives russes et européennes des diktats américains. Cette alternative, c'est le “commerce continental”.
Imaginez un instant que les grandes voies de communications du commerce mondial —ou du moins celles qui relient l'Europe à l'Asie méridionale et à l'Extrême-Orient (surtout l'Inde et la Chine)— deviennent continentales. Ce serait là un accès direct et alternatif aux grands marchés qui sont déjà prospères aujourd'hui et qui sont potentiellement de longue durée. Cet accès par voie continentale serait d'abord plus rapide et offrirait des avantages non négligeables à certains technologies qui sont en train de se développer. Sur le plan théorique, tout cela semble séduisant, mais, en pratique, l'essentiel demeure absent, c'est-à-dire un système réellement existant de communications transcontinentales.
Pourquoi un tel système de communication n'est-il pas déjà disponible? Parce que la politique extérieure de la Russie bolchévique-stalinienne a commis une erreur fondamentale. En effet, les communistes ont été perpétuellement induits en erreur par un pronostic illusoire d'origine idéologique, prévoyant une évolution sociale conduisant à une révolution mondiale, qui, elle, allait réaliser l'“Idée” sur la Terre. En d'autres mots, au lieu de détruire la société bourgeoise, l'élite révolutionnaire russe aurait dû la consolider, afin de concentrer les énergies des masses sur la construction réelle du pays et sur l'exploitation “civilisée” de ses espaces et de ses richesses. La chimère de la révolution mondiale a englouti en Russie de colossales richesses, mais, simultanément, son importance géopolitique en tant que puissance continentale ne pouvait être détruite sur l'échiquier international.
L'ancien Empire russe avait justement émergé autour d'un axe constitué par une voie commerciale traversant l'Europe orientale, soit la voie ouverte par les Scandinaves et “conduisant des Varègues aux Grecs”. Par une sorte de constance du destin, le devenir actuel de la Russie dépend une nouvelle fois —et directement— de l'exploitation efficace d'un commerce transcontinental, de la croissance de marchés intérieurs au Grand Continent eurasien. Ce destin géopolitique, grand-continental et eurasien, les forces réellement productrices de la Russie commencent à la comprendre. Ces forces sont potentiellement génératrices d'Empire et peuvent être définie comme telles. Elles commencent aussi à formuler des exigences politiques propres. Et, à ce propos, Sergueï Gorodnikov, qui a consacré beaucoup d'attention à cette problématique, écrit:
«Notre besoin est le suivant: nous devons rapidement construire des structures de transport commerciales paneurasiatiques qui relieront toutes les civilisations créatrices; ensuite, notre besoin est de garantir militairement la sécurité de ces civilisations, ce qui correspond aussi complètement aux intérêts de l'Europe, je dirais même à ses intérêts les plus anciens et les plus spécifiques, tant dans le présent que dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle le nationalisme russe ne doit pas seulement compter sur une neutralité (bienveillante) de l'Europe dans sa politique d'Etat. Mieux, il trouvera en Europe des forces très influentes qui pourront et devront devenir ses alliés. C'est toute particulièrement vrai pour l'Allemagne qui s'est renforcé par sa réunification et désire en secret retrouver toute son indépendance en tant qu'Etat et toute sa liberté de manœuvre» (2).
La nouvelle alliance stratégique paneurasiatique entre l'Est et l'Ouest aura pour élément constitutif l'alliance géopolitique inter-impériale entre l'Allemagne et la Russie, les deux détenteurs de la légitimité impériale romaine en Europe. Ce recours à l'antique légitimité romaine est une chose, la tâche actuelle de cette alliance en est une autre: il s'agit pour elle de fédérer les intérêts économiques et politiques dans une perspective de progrès tecnologique global. Il s'agit de rassembler toutes les forces intéressées à développer l'espace économique eurasiatique. Pour réaliser ce programme, il faudra créer des unités économiques suffisamment vastes pour obtenir les moyens nécessaires à développer des projets de telles dimensions et pour se défendre efficacement contre les résistances qu'opposeront les Américains et les Japonais. Construire des entités économiques de cette dimension implique une coopération étroite entre les potentiels techniques russes et européens.
Le combat qui attend Russes et Européens pour établir un nouvel ordre paneurasiatique sera aussi un combat contre les résidus de féodalisme et contre les formes politiques dépassées à l'intérieur même de ce grand continent en gestation, c'est-à-dire un combat contre les forces qui se dissimulent derrière une pensée tribale obsolète ou derrière un fondamentalisme islamique pour freiner par une résistance douteuse la progression d'une culture et d'une économie grande-continentale. Comme le développement de notre civilisation postule des exigences globales, ce combat devra être mené avec tous les moyens diplomatiques et militaires, jusqu'à la destruction totale des forces résiduaires. Seule une lutte sans merci contre les résidus d'un féodalisme millénaire, contre le “mode de production asiatique”, nous permettra de détruire les derniers bastions du vieux despotisme tyrannique et de la barbarie, surtout sur le territoire de la Russie où, aujourd'hui, ces forces se manifestent sous les aspects de la criminalité caucasienne et asiatique, des sombres bandes mafieuses, résultats de cette peste léguée par le bolchevisme: l'absence de toute loi et de tout droit.
Sur ce thème, je me permets de citer une fois de plus Sergueï Gorodnikov: «Il est clair qu'une tâche de ce type ne pourra être menée à bien que par un Etat fortement centralisé selon les conceptions civiles. Un tel Etat ne pourra exister que si l'armée marque la politique de son sceau, car l'armée, de par son organisation interne, est la seule institution étatique capable de juger, étape par étape, de la valeur politique des choses publiques et dont les intérêts sont identiques à ceux de la bourgeoisie industrielle en phase d'émergence. Seule une alliance étroite entre l'armée et la politique est en mesure de sauver l'industrie nationale de l'effondrement, les millions de travailleurs du chômage et de la faim et la société toute entière de la dégradation morale, d'extirper le banditisme et le terrorisme, de faire pièce à la corruption et de sauver l'Etat d'une catastrophe historique sans précédent. L'histoire du monde dans son ensemble a prouvé qu'il en est toujours ainsi, que les efforts d'une bourgeoisie entreprenante et industrielle ne peuvent reposer que sur l'institution militaire; ensuite, dans la société démocratique, il faudra accroître son prestige social au degré le plus élevé possible et l'impliquer dans l'élite effective de la machinerie étatique» (3).
Certes, cet accroissement du rôle socio-politique de l'armée, garante de la stabilité globale de l'Etat dans la situation présente, mais aussi de la stabilité de cette société civile en gestation, implique une légitimisation du statut particulier qu'acquerront ainsi les forces armées. En d'autres termes, il s'agit de créer une forme d'ordre politique où les autorités militaires et les autorités civiles soient des partenaires naturels sur base d'une séparation de leurs pouvoirs respectifs. Ensuite, un tel régime, qui pourrait être défini comme “régime de salut national”, postule l'existence d'une troisième force, une force intermédiaire, investie de la plus haute autorité dans cette tâche aussi important que spécifique consistant à fixer des normes juridiques. Une telle force pourrait s'incarner dans l'institution que serait la puissance même de l'Empereur, exprimant en soi et pour soi, et en accord avec les traditions historiques dont elle provient, l'idée d'un “compromis mobile” entre les intérêts de toutes les couches sociales. Ainsi, la dignité impériale à Byzance, qui s'est également incarnée dans les réalités de l'histoire russe, présentait quatre aspects fondamentaux. Ce qui revient à dire que l'Empereur russe-orthodoxe devrait être:
1) Protecteur de l'Eglise d'Etat en tant qu'institution sociale (C'est le pouvoir de l'Empereur en tant que Pontifex Maximus).
2) Représentant dans intérêts du peuple (Pleins pouvoirs de l'Empereur en tant que tribun populaire).
3) Chef des forces armées (Pleins pouvoirs d'un Proconsul ou du Dictateur au sens romain du terme).
4) Autorité juridique supérieure (Pleins pouvoirs du Censeur).
L'autorité et la stabilité d'un véritable pouvoir d'Imperator dépend directement de la fidélité de l'Empereur aux principes fondamentaux de la Tradition, au sens théologique comme au sens juridique du terme. C'est pourquoi ce pouvoir dans le contexte russe signifie que, d'une part, le rôle social de l'Eglise orthodoxe devra être fixé et déterminé, de même que, d'autre part, les traditions de la société civile. Une particularité de l'idée impériale russe réside en ceci qu'elle a repris à son compte l'idéal byzantin de “symphonie” entre l'Eglise et l'Etat, c'est-à-dire de la correspondance pratique entre les concepts d'orthodoxie et de citoyenneté, sur laquelle se base également la doctrine russe-byzantine d'un Etat éthique qui serait celui de la “Troisième Rome”, d'un nouvel Empire écouménique.
Dans quelle mesure ces idéaux sont-ils réalisables à notre époque? Question compliquée, pleine de contradictions, mais que les Russes d'aujourd'hui sont obligés de se poser, afin de s'orienter avant de relancer le traditionalisme russe et d'en faire l'idéologie de la grande puissance politique qu'ils entendent reconstruire. Le retour de ces thématiques indique quelles sont les tendances souterraines à l'œuvre dans le processus de formation de la société civile russe. Si, en Europe, c'est la culture qui a été porteuse des traditions antiques et donc des traditions civiles, en Russie c'est la religion qui a joué ce rôle, c'est-à-dire l'Eglise orthodoxe; c'est elle qui a fait le lien. En constatant ce fait d'histoire, nous pouvons avancer que la renaissance réelle de la société civile en Russie est liée inévitablement au déploiement de l'héritage antique véhiculé par l'Eglise orthodoxe. Il me semble que l'essentiel des traditions politiques antiques réside justement dans les traditions qui sous-tendent la puissance impériale au sens idéal et qui sont proches du contenu philosophique de l'Etat idéaliste-platonicien.
Quelles sont les possibilités d'une restauration concrète de l'idée impériale civile et d'un ordre impérial en Russie? Ce processus de restauration passera sans doute par une phase de “dictature césarienne”, parce que, comme l'a un jour pertinemment écrit Hans-Dieter Sander, on ne peut pas créer un Empire sans un César. En effet, seul un César, élevé légitimement au rang de dictateur militaire, est capable de consolider les intérêts des forces les plus productives de la Nation à un moment historique précis du développement social et d'incarner dans sa personne les positions morales, politiques et socio-économiques de ces forces et, ainsi, sous sa responsabilité personnelle en tant que personalité charismatique, de jeter les fondements d'une nouvelle société, représentant un progrès historique.
Le but principal en politique intérieure que devrait s'assigner tout césarisme russe serait de préparer et de convoquer une représentation de tous les “états” de la nation, en somme une Diète nationale, qui, en vertu des traditions du droit russe, est le seul organe plénipotentiaire qui peut exprimer la volonté nationale génératrice d'histoire. Cette Diète nationale détient aussi le droit préalable de déterminer la structure générale de l'Etat russe et de réclamer l'intronisation de l'Empereur. La Diète nationale est ainsi en mesure de légitimer la restauration de l'Empire et, s'il le faut, de constituer un régime préliminaire constitué d'une dictature de type césarien (Jules César avait reçu les pleins pouvoirs du Sénat romain qui avait accepté et reconnu officiellement sa légitimité).
Toute restauration cohérente de l'Empire, au sens traditionnel, métaphysique et politique du terme, n'est possible en Russie, à mes yeux, que si l'on accroît le rôle socio-politique de l'armée et de l'Eglise, mais aussi si l'on consolide l'autorité des juges. Car ce sont précisément les juges (et en premier lieu les juges à l'échelon le plus élevé de la hiérarchie et de la magistrature impériales) qui pourront jouer un rôle médiateur important dans la future restructuration totale de la société russe, en travaillant à créer des institutions juridiques stables. D'abord parce que cette valorisation du rôle des juges correspond à la tradition historique russe, à l'essence même de l'Etat russe (par exemple: dans la Russie impériale, le Sénat était surtout l'instance juridique suprême, disposant de pleins-pouvoirs étendus et normatifs, dans le même esprit que le droit prétorien romain). Ensuite, cette revalorisation du rôle des juges constitue également la réponse appropriée à l'état déliquescent de la société russe actuelle, où règne un nihilisme juridique absolu. Ce phénomène social catastrophique ne peut se combattre que s'il existe au sein de l'Etat une caste influente de juristes professionnels, disposant de pouvoirs étendus.
Lorsqu'on évoque une société reposant sur le droit —ce qui est d'autant plus pertinent lorsque l'on se situe dans le contexte général d'un Empire— on ne doit pas oublier que tant l'Europe continentale que la Russie sont héritières des traditions du droit romain, tant sur le plan du droit civil que du droit public. Lorsque nous parlons dans la perspective d'une coopération globale entre Européens et Russes, nous ne pouvons évidemment pas laisser les dimensions juridiques en dehors de notre champ d'attention. Le droit romain, dans sa version justinienne, a jeté les fondements de l'impérialité allemande et de l'impérialité russe. C'est donc cet héritage commun aux peuples impériaux germanique et slave qui devra garantir une coopération harmonieuse et durable, par la création d'un espace juridique et impérial unitaire et grand-continental. En plus de cet héritage juridique romain, Allemands et Russes partage un autre leg, celui de la théologie impériale. A ce propos, j'aimerai terminer en citant un extrait du débat qu'avaient animé le Dr. Reinhold Oberlercher et quelques-uns de ses amis:
OBERLERCHER: «Dans le concept de Reich, le processus de sécularisation n'est jamais véritablement arrivé à ses fins: le Reich demeure une catégorie politico-théologique. Dans la notion de Reich, l'au-delà et l'en-deçà sont encore étroitement liés». Lothar PENZ: «Cela veut donc dire que nous devons retourner au Concile de Nicée!» (approbation générale) (4).
Je pense aussi que le Concile de Nicée a effectivement jeté les bases véritables d'une théologie impériale, même si, à l'Ouest et à l'Est celle-ci a été interprétée différemment sur les plans théorique et liturgique. Il n'en demeure pas moins vrai que le lien subtil entre au-delà et en-deçà demeure présent dans l'existence de l'Empire (du Reich) comme un mystère déterminé par Dieu.
Vladimir WIEDEMANN.
(texte remis lors de la “Freideutsche Sommeruniversität” en août 1995; également paru dans la revue berlinoise Sleipnir, n°5/95).
00:25 Publié dans Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 octobre 2007
Les scientifiques allemands en France après 1945

Les scientifiques allemands en France après 1945
par Helmut MÜLLER
Entre 1945 et 1950, la France a saisi comme « butin de guerre » plus de 1000 scientifiques et techniciens allemands. Tout a commencé avec l’effondrement du IIIième Reich, lorsque les troupes alliées sont entrées en Allemagne, prenant le pays en tenaille. Dans le Sud, les troupes françaises du Général de Lattre sont accompagnées d’une unité d’experts et de techniciens, dont la mission était d’examiner les installations militaires et scientifiques. Quelques agents des services spéciaux de l’armée française découvrent près d’Oberammergau 2500 documents ultra-secrets ayant appartenu au constructeur d’avions Messerschmidt. Plus tard, ces papiers inspireront les Français dans la construction de leurs avions à réaction Ouragan et Mystère.
En 1945, quelque 50.000 tonnes de matériels divers ont été acheminées d’Allemagne en France. De même, des centaines de pièces d’équipement en provenance des usines Dornier et Zeppelin. A Ötztal, les Français ont démonté une soufflerie à ultrasons, qui fonctionne encore aujourd’hui à Modane-Avrieux. Pendant plusieurs années consécutives, les Français ont profité de la remise en route des 200 fabriques de la zone d’occupation qui leur avait été accordée à Potsdam. Tout autour du Lac de Constance, dix-sept fabriques et laboratoires ont travaillé pour la marine française jusqu’en 1948, c’est-à-dire jusqu’à leur démontage. Ce fut De Gaulle lui-même qui conseilla à ses compatriotes, dès mai 1945, d’engager le maximum d’experts allemands. D’abord, pour renforcer le potentiel militaire et civil français, ensuite, pour affaiblir celui de l’Allemagne, comme le déclarait le Commandant de la zone d’occupation française, le Général Koenig.
La course pour acquérir du savoir-faire allemand a commencé très tôt, aucune puissance n’a perdu une seconde. En juillet 1945, les Américains « déménagent » Werner von Braun et 120 de ses collaborateurs de Peenemünde ; les Soviétiques, de leur côté, « pêchent » le bras droit de von Braun, Helmut Gröttrup et 200 collaborateurs de ce savant. En tout, les Américains se sont assurés le concours de 3000 spécialistes allemands, tandis que les Russes en prenaient 5000 à leur service. Les deux grandes puissances s’emparèrent également de tonnes de documents, dont des brevets de grande valeur. Au cours du mois d’octobre 1945, les Britanniques testent des fusées à Peenemünde même, mais finissent très tôt par abandonner leur programme.
Helmut Habermann et Hermann Oestrich
Après le passage des Américains et des Soviétiques, beaucoup de savants, de techniciens et de scientifiques, qui n’avaient pas été découverts, se sont retrouvés sur la rue, sans boulot. Parmi eux : Helmut Habermann. Quand celui-ci eut appris que les Français, à leur tour, s’intéressaient aux savants allemands, il se rendit dans le secteur français, accompagné de deux collègues, Weiss et Jauernick, puis ils partirent tous trois pour Paris, où on les attendait. Après qu’ils eurent signé un contrat de travail, les trois Allemands prirent la route de Cuxhaven, pour gagner d’autres collègues à la cause des Français. Parmi les centaines de candidatures, quelques hommes qui s’avérèrent ultérieurement de grands formats. On peut le dire tranquillement aujourd’hui : sans ces chercheurs et ces inventeurs, les succès ultérieurs de la France dans le domaine militaro-industriel n’auraient pas été pensables.
Sans aucun doute, les Français ont pêché un « gros poisson » en la personne de Hermann Oestrich, natif de Duisburg. Cet expert en turbines avait reçu de Hitler en 1938 la mission de développer un moteur à réaction. Son moteur BMW 003 équipera plus tard en série les chasseurs de combat Heinkel 162. En 1945, les installations de montage souterraines de Stassfurt sont occupées par les Américains. Oestrich et douze ingénieurs sont amenés à Munich pour préparer le transfert de l’usine aux Etats-Unis. Dans la capitale bavaroise, un intermédiaire français découvre Oestrich qui, dans des circonstances aventureuses, finit par atterrir en France. Dans le but de recruter du personnel compétent, il retourne en Allemagne, où il est immédiatement placé sous surveillance par les Américains et les Britanniques. Pour empêcher qu’il ne soit enlevé, un commando français rapatrie en France l’expert et ses collègues. Le 25 avril 1946, ces Allemands signent un contrat de travail avec l’Etat français. Sous la direction d’Oestrich —devenu « directeur technique »— les Français développent le moteur « Atar », qui connut un succès évident ; tous les chasseurs à réaction français en seront équipés, y compris le célèbre « Mirage ». 5000 exemplaires de ce moteur ont été vendus dans le monde entier. Oestrich n’était pas seulement un maître dans sa branche, mais il était aussi un excellent homme d’affaires. Rien que pour ses brevets élaborés dans les années 50, la « Snecma », devenue sa firme, lui a payé 180 millions de Schillings (au cours actuel). Et, chose étonnante, pour un homme considéré comme ancien « nazi », il obtint la plus haute décoration française, la « Légion d’Honneur ».
Le moteur de la fusée « Ariane »
Dans le domaine des techniques de propulsion de fusées, les Français avaient découvert une sommité en la personne de Heinz Bringer. Cet ancien collaborateur de Werner von Braun avait été un spécialiste du système de propulsion des V2. Avec ses collègues, il a construit la fusée « Véronique » pour le compte des Français. On le considère en outre comme le père du moteur « Viking » qui propulse les fusées françaises « Ariane ». Ce savant est décédé en janvier 1999, devenu citoyen français et âgé de 90 ans, dans les environs de Vernon.
On ne sait pas encore très bien quelle a été la contribution des savants allemands au développement du programme nucléaire français, car les archives ne sont pas encore toutes accessibles. Il est exact que les Américains s’étaient emparés très tôt, dès 1945, de la plupart des spécialistes allemands du nucléaire et de leurs archives. Mais il semble toutefois attesté aujourd’hui que quelques savants allemands ont collaboré au programme nucléaire français. Ainsi, outre Oskar Doehler, nous trouvons le physicien Rudi Schall, ancien membre de la NSDAP. En dépit de ce passé, il a reçu de l’Etat français une haute décoration en 1977. Aujourd’hui, âgé de 85 ans, ce Berlinois vit sur les rives du Lac de Constance.
Tous les savants allemands qui se sont mis au service de la France ne sont pas revenus en Allemagne à l’heure de leur retraite. Ainsi, Otto Krahe s’est retiré à Vernon en France. Il avait travaillé entre 1935 et 1945 à l’élaboration du V2. Sans travail en 1945, il signe un contrat avec les Français après que von Braun ait renoncé à l’appeler en Amérique, comme il l’avait pourtant promis. Avec quelques autres collègues, il a travaillé à Vernon au laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA).
SS10 et gaz de combat
Parmi les techniciens et scientifiques engagés par la France, se trouvait également Eugen Sänger qui, plus tard, a mis son savoir au service de Nasser en Egypte. Il travaillait sur plusieurs projets, de concert avec Emile Stauff, père de la première fusée tactique française. Sur bases de connaissances acquises en Allemagne avant 1945, cette équipe a élaboré, dans l’arsenal de Puteaux, des fusées sol-air et l’une des armes anti-chars françaises les plus efficaces, le missile SS10.
Tous les travaux entrepris par des savants allemands n’ont cependant pas été couronnés de succès. L’hélicoptère à deux rotors de Heinrich Focke (le FA 223), dont le développement avait déjà été commencé sous Hitler, a d’abord été perfectionné, pour devenir le SE 300, mais n’a pas satisfait les Français. Ensuite, le projet de Helmut Zborowski, ancien membre de la Waffen-SS, de fabriquer un appareil à décollage vertical dans les années 50 a été une véritable catastrophe et a rapidement dû être abandonné.
A quelques exceptions près, les services rendus à la France par les scientifiques et les techniciens allemands après 1945 ont été très profitables, notamment ceux de Hubert Schardin, expert en armement de la firme Mauser. Tout comme les Américains, les Français n’ont pas fait la fine bouche et ont accepté le concours d’hommes au passé politique national-socialiste. Outre Helmut Zborowski, qui a pu ouvrir un « bureau technique » à Paris en 1950, on retrouve la trace de Walter Reppe et de Karl Wurster, qui, pour le compte de la France, ont pu poursuivre leurs travaux dans une usine de Ludwigshafen. Ensuite, il y a eu le cas d’Otto Ambros, un des anciens directeurs d’IG Farben, spécialiste de la production de gaz de combat, dont les travaux ont intéressé ses collègues français, experts en armes chimiques. Les Français ont su apprécier les savants qui firent partie de leurs « prises de guerre ».
Les scientifiques allemands ont pu travailler correctement jusqu’en 1945, malgré les côtés répressifs du système national-socialiste et les rudes conditions de travail imposées par l’état de guerre à partir de l’automne 1939. Par rapport à leurs collègues étrangers, ils ont pu avancer grandement dans bien des domaines. Les pays qui les ont employés leur ont rendu hommage, alors que, dans leur patrie, leurs travaux sont passés sous silence. Preuve supplémentaire que l’Allemagne est toujours incapable de prendre sereinement en considération son passé récent.
Helmut MÜLLER.
(Article tiré de Aula, n°9/1999).
01:15 Publié dans Affaires européennes, Histoire, Sciences | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 octobre 2007
L'itinéraire d'Erich Wichman

Frank GOOVAERTS (†):
Sur l’itinéraire d’Erich WICHMAN (1890-1929)
Un isolé anarchisant de la “révolution conservatrice” néerlandaise
La gauche et la droite ne se combattent qu’en apparence. En réalité, elles te combattent, toi!
(Erich Wichman).
◊ 1. INTRODUCTION : esquisse d’un chaos
Si, pendant l’entre-deux-guerres, il y avait en Europe un pays où la “révolution de droite”, telle que l’a définie le sociologue allemand Hans Freyer (1887-1969), n’avait aucune chance de réussir, et même se dressait contre l’âme populaire, c’étaient bien les Pays-Bas! Ce pays tranquille de moulins et de cyclistes, de tulipes et de polders, appartenait indubitablement aux pays les plus stables du vieux continent. Cela n’implique pas que les divers défis, auxquels les démocraties libérales se voyaient confrontées, ne se manifestaient pas aux Pays-Bas. Bien au contraire! Il y avait simplement que la si célèbre “sobriété” néerlandaise (que nous pouvons désormais mettre en doute depuis les “Golden Sixties”...) générait un bourgeoisisme typique et induisait la population à réagir différemment du gros de celles des pays voisins.
Pourtant, la “révolution de droite” s’y est manifestée, notamment avec le NSB (“Nationaal-Socialistische Beweging” ou “Mouvement national-socialiste”) de l’ingénieur Antoon Mussert (1894-1946), qui est le mouvement de loin le plus connu à l’étranger. Ce qui fait la caractèristique unique des Pays-Bas, dans l’univers des fascismes ou para-fascismes d’avant 1940, c’est qu’à côté de ce parti fort structuré qu’était le NSB, il y avait là-bas encore au moins quarante petites formations fascisantes en activité, dont l’idéologie s’inspirait davantage des régimes autoritaires circum-méditerranéens que du “grand frère” allemand. Cette mosaïque politique nous donne l’impression d’une complication extrême, où règnent le chaos, l’incompétence et la dissolution, les querelles et les suspicions, si bien qu’aucune force politique ne s’est jamais dégagée d’elle. Il semble que seuls les éléments négatifs unissaient les hommes: les Pays-Bas déclinent parce qu’ils n’ont aucun réflexe national et ne veulent pas vraiment se débarrasser d’une démocratie corrompue. Si l’on examine ce conglomérat de petits partis et groupuscules, on tire la conclusion suivante: leur préoccupation principale était de concevoir des uniformes rutilants pour leurs diverses milices. Ils brûlaient aussi littéralement leurs fonds en publiant des revues ineptes. Wim Zaal notait non sans ironie et à juste titre: “Mystique, discipline, unité, figure du chef, vie dangereuse, le regard vers le futur... on peut s’imaginer ce que devenaient ces ingrédients du fascisme quand ils tombaient aux mains des Néerlandais, avec leur héritage séculaire de querelles politiques et théologiques. Ce qui aurait dû devenir une tempête ne devint qu’un vague trouble dans autant de verres d’eau; chacun avait sa doctrine sublime, son interprétation personnelle et ses propres galons à son uniforme de combat, à la facture unique. Au cours des années, nous avons vu défiler aux Pays-Bas des fascistes intellectuels en chambre, des fascistes issus du vieux libéralisme, des fascistes prolétariens, des fascistes croyants, des fascistes qui se piquaient d’aristocratisme et des fascistes synthétiques (1). Le rideau s’était levé sur ce qui aurait dû déboucher sur un drame martial; ce ne fut qu’un vaudeville...
◊ 2. Les racines du fascisme néerlandais
Certains ont défini le fascisme comme un mouvement de “rancuneux”, ce qui n’est pas entièrement faux. Mais cette idée ne peut toutefois pas être généralisée. Pour le cas des Pays-Bas, elle ne convient pas du tout. Le pays était resté neutre pendant la première guerre mondiale et n’a donc pas connu, après la fin des hostilités, le problème insoluble d’une masse de chômeurs et d’anciens soldats inadaptés à la société civile, cultivant des aspirations révolutionnaires. Le Dr. Joosten, qui est l’historien qui a examiné le plus attentivement le phénomène du fascisme chez nos voisins du Nord, conclut ses investigations en disant que des forces bien différentes se tenaient autour du berceau de la “révolution de droite” aux Pays-Bas (2). L’historien néerlandais estime que ce sont surtout des idéaux réactionnaires, conservateurs, intégristes, etc. qui ont alimenté le fascisme local. Il oublie cependant l’influence d’un leader socialiste, Troelstra (1860-1930), qui avait appelé à la révolution en 1918, une révolution qui échoua, parce que la base l’avait laissé tombé, par manque d’élan révolutionnaire, par petit-bourgeoisisme ou, mieux, par les deux à la fois.
Si l’on veut donner un nom au père spirituel du fascisme néerlandais, alors, généralement, on désigne, pour ce titre, un philosophe, professeur d’université, G. J. P. J. Bolland (1854-1922), une figure très particulière de la pensée, qui a commencé comme autodidacte pour se frayer un chemin jusqu’aux plus hauts sommets du monde universitaire néerlandais. Il estimait que la “raison pure”, corrigée par Hegel, ne s’était incarnée que dans son seul cerveau. Il s’opposait avec vigueur à la démocratie et au socialisme, parce que ces deux forces politiques ne visaient qu’à hisser les “masses de travailleurs stupides” au pouvoir. Dans les tissus d’injures qu’il débitait à l’adresses de la “juiverie” et de la franc-maçonnerie, il nous rappelle les ntionaux-socialistes ultérieurs. Pourtant, il me paraît impossible de le décrire et de le stigmatiser comme un fasciste sans plus; il était beaucoup trop réactionnaire pour mériter ce titre, beaucoup trop conservateur et bien trop peu révolutionnaire. Mais ses professions de foi hégéliennes et son anti-sémitisme ont inspirés une jeune génération d’adeptes, dont H. A. Sinclair de Rochemont (1901-1942), qui allaient plus tard se retrouver au sein du VVA (“Verbond van Actualisten” ou “Alliance actualiste”), qui fut, grosso modo, la première tentative de concentrer les forces fascistes aux Pays-Bas.
Autre foyer de mécontentement, qui allait tendre ultérieurement vers le fascisme: la loi électorale de 1894, qui effrayait certains libéraux, qui, en 1907, créent le “Bond van Vrije Liberalen” ou “Ligue des Libéraux Libres”, pour se donner une structure. De ce milieu se dégage un homme, qui fut à la fois journaliste et professeur d’université en sciences politiques, le Prof. J. H. Valckenier-Kips (1862-1942). Pendant toute une période, il fut l’étudiant de Bolland mais infléchit le futur fascisme néerlandais vers des positions idéologiques plus solides, permettant de parler véritablement de “pères fondateurs”. Pendant la première guerre mondiale, Valckenier était déjà pro-allemand et antisémite (ce qui n’était nullement une rareté dans les Pays-Bas de l’époque) mais, en plus, il se posait comme un “anti-démocrate” virulent. Le corpus d’idées qu’il défendait, allait plus loin et était bien plus vaste que celui de ses amis du départ, qui, pour l’essentiel, n’étaient que des libéraux braqués, devenus anxieux devant l’évolution de la société. Dans la revue conservatrice “De Tijdspiegel” (= “Le miroir du temps”), il esquissait, entre 1910 et 1918, l’idée d’un Etat organique, où l’individu devait être soumis au tout, sujet sur lequel il revenait sans cesse, en l’abordant de mutliples façons. Après la première guerre mondiale, il s’est quelque peu éclipsé, a quitté les feux de la rampe, pour revenir à l’avant-plan au début des années 30, d’abord dans les rangs du NSB, ensuite dans ceux du “Zwart Front” (= “Front Noir”) d’Arnold Meijer.
Mais celui qui tint véritablement le fascisme néerlandais sur les fonds baptismaux fut sans contexte le Dr. Emile Verviers (1886-?), un enseignant libre en sciences économiques à Leiden, lui aussi ancien étudiant de Bolland. Il était issu d’une famille catholique-romaine, mais cette famille politico-religieuse ne rencontrait pas son approbation, car elle s’était montrée trop paternaliste devant le danger de révolution rouge en 1918. Bien qu’il ait défendu, dans les colonnes de sa revue, “Katholieke Staatkunde” (= “Politique catholique”), des idées qui correspondaient pleinement à celles de l’aile conservatrice du “Rooms-Katholieke Staatspartij” (= “Parti Etatiste Catholique-Romain”), Verviers évolua graduellement vers l’idée d’un Etat fortement anti-démocratique et autoritaire, pour l’avènement duquel il préconisait de plus en plus souvent l’usage de la violence. Après la Marche sur Rome de Mussolini, il déclara —ce qui n’était nullement injustifié— que les Italiens suivaient ainsi une voie qu’il avait théorisée depuis plus de dix ans. Mais Verviers n’est jamais devenu un Duce néerlandais. Il n’avait pas d’adeptes, ce qui est dû, principalement, à son désir insatiable de controverses. Pourtant, ses théories n’ont pas été sans influence. Le jeune Mussert a sans doute suivi les leçons du Prof. Verviers. Celui-ci, à qui on peut sûrement reproché des tentations intégralistes, se mit à avoir de réelles difficultés avec la hiérarchie catholique de l’évêché du Brabant à partir de 1924, ce qui entraîna sa quasi disparition pendant des années. Ce n’est qu’en 1934 qu’il réémergera, devenant rédacteur-en-chef d’une revue du NSB, le mensuel “Nieuw Nederland” (“Les Pays-Bas nouveaux”). Deux années plus tard, il disparait à nouveau, quitte l’avant-plan, bien entendu après une querelle.
D’après les informations que nous avons glanées et reproduites dans la première partie de cet article, on pourrait en déduire que la “révolution de droite” aux Pays-Bas a été essentiellement l’apanage de fascistes intellectuels, de théoriciens en chambre. On remarquera dès lors que ce milieu, aux Pays-Bas, n’a pas apporté grand chose de substantiel au corpus idéologique du fascisme européen. Dans la plupart des cas, on s’est borné à emprunter aux voisins, d’abord en Italie, ensuite en Allemagne et plus tard en Flandre. Ce milieu fascisant néerlandais est donccaractérisé par une effarante absence d’inventivité, sauf si nous nous penchons sur une figure originale et unique, celle d’Erich Wichman.
◊ 3. Un vitaliste délirant !
Pol Vandromme a remarqué un jour : “Brasillach n’était pas amoureux du fascisme, mais de la poésie fasciste” (3). On peut formuler une remarque semblable à propos d’Erich Wichman, le “premier des fascistes néerlandais”, simultanément “alcoolique de principe”, comme il le disait de lui-même, lui, le”gangmaker” et la “prima donna” de la “révolution de droite”, couleur locale; disons que, chez lui, l’admiration pour l’élan fasciste vers l’action primait. Dans leur appréciation du fait fasciste, on peut tracer plus d’un parallèle entre Brasillach et Wichman: tous deux aiment l’aventure, la camaraderie, l’expression de la volonté vitale, la jeunesse. Tout comme chez Brasillach, le fascisme n’était pas davantage, chez Wichman, un programme politique, mais, écrivait-il, “une atmosphère, un ton, un rythme des sentiments, une mentalité, une attitude devant la vie; c’est briser en mille miettes les certitudes qui ont perdu tout sens, toute vitalité, c’est rendre toutes choses fluides, c’est tout recommencer à nouveau, c’est la jeunesse” (4).
Wichman n’a jamais, par exemple, pris au sérieux la forme de l’Etat corporatif; en fin de compte, il ne croyait en aucun système et le fascisme réellement existant, tel qu’il était vécu en Italie, ne lui convenait pas: “Pas un seul cheveu de mon crâne, qui devient chauve, ne songe à transplanter aux Pays-Bas le fascisme italien, tel qu’il est aujourd’hui, tel qu’il a été et tel qu’il deviendra, sans y apporter des changements” (5).
La vie d’Erich Wichman est tout, sauf une vie sans tache, est une suite ininterrompue d’actions tapageuses et d’incidents provoqués; elle est un vaudeville comique, elle révèle tous les aspects d’un drame de Sophocle. Erich Wichmann (ce n’est qu’au cours de son existence qu’il abandonna le dernier “n” de son patronyme pour lui donner un air plus néerlandais), est né le 11 août 1890 à Utrecht, une ville qu’il a toujours haïe, à cause de son petit bourgeoisisme grégaire. Sa famille était originaire d’Allemagne du Nord. Sa mère, Johanna Zeise, était issue d’une famille fortunée d’inventeurs et de pharmaciens, où l’on trouvait souvent un attrait pour la littérature. Son père, Arthur Wichmann, était professeur à l’université d’Utrecht. C’était un homme pragmatique, un géologue et un vulcanologue respecté, connu pour ses voyages outre-mer.
Ses parents lui ont légué l’intelligence, ses prédispositions pour les arts et les sciences, mais aussi ce goût de l’aventure, qui prit, plus tard, des proportions effrayantes. A peine âgé de onze ans, il perdit un oeil après une intervention chirurgicale rendue nécessaire par la présence d’un glaucome à l’oeil droit. Cette opération l’a défiguré, rendu extrêmement laid, ce qui ne l’empêcha pas de devenir plus tard un fameux bourreau des coeurs. Enfant, il utilisait son handicap pour donner libre cours à son originalité: il jetait son oeil de verre dans la piscine municipale en criant “un p’tit doublon pour celui qui le repêche!” [ndt: un doublon correspond ici à dix cents néerlandais].
Wichman disposait donc d’une intelligence phénoménale, couplée à une maturité précoce et exceptionnelle. Dès l’âge d’environ dix ans, tous s’accordait à considérer qu’il était une sorte d’enfant prodige, qui ferait parler de lui plus tard. Cependant, à l’école, il ne faisait pas grand chose de bon. Il n’étudiait qu’exceptionnellement, mais, en même temps, semblait disposer d’une inspiration inépuisable pour agacer ses condisciples et ses professeurs. Un jour, il se présente à l’école, muni d’un revolver chargé (plus tard il disait de lui-même: “Est-ce que je ressemble à un type qui circulerait avec un revolver non chargé?”). Cet incident fit qu’il fut renvoyé de l’école (6). Après en avoir fréquenté une série d’autres, où son comportement très rebelle lui créa toute sortes d’embûches, il aboutit dans un pensionnat très sévère en Thuringe. Mais là aussi, étudier sérieusement était le cadet de ses soucis, car il avait bien sûr d’autres préoccupations: il découvrait Nietzsche et Baudelaire (la lecture de ce poète français le conduisit à expérimenter toutes sortes de drogues). A cette époque, il eut une seule fois l’occasion d’écrire une petite contribution pour le célèbre hebdomadaire satirique allemand, le “Simplicissimus”.
En 1909, il arrête les frais dans son pensionnat allemand et s’en va étudier la biologie et la chimie à Utrecht. Il y étonne par son érudition. Un jour, quelqu’un s’adressa à son père pour lui dire: “Votre fils est si exceptionnel qu’il pourrait réussir dans n’importe quelle faculté”. Avec les deux pieds bien sur terre, le père Wichman répondit laconiquement : “J’aimerais qu’il soit un peu moins exceptionnel et qu’il réussisse au moins dans une seule faculté”. En effet, l’objectif d’Erich Wichman n’était pas d’obtenir des diplômes, car il n’en n’eut jamais aucun, mais d’accumuler le maximum de savoir en tous domaines. Au lieu de potasser ses cours, il peignait ou écrivait des poèmes et, au moment de passer ses examens, sa mémoiure extraordinaire lui venait en aide. Il eut ainsi un jour l’idée d’apprendre par coeur le volumineux cycle de “Mathilde” de J. Perk, uniquement pour prouver que l’art poétique de cet auteur lui plaisait!
Il était surtout une star dans la vie nocturne des étudiants. Dans les cercles de fêtards, il mit au point ses premières aspirations politiques et artistiques. A partir de 1912, il commença à s’adonner corps et âme à l’art pictural. L’expressionnisme allemand —il correspondait avec Kadinsky— et le futurisme italien suscitaient son intérêt, ce qui eu pour résultat de le faire écrire quelques articles sur l’art moderne dans les revues étudiantes.
En 1914, Wichman déménage et se fixe à Amsterdam, où il est rapidement accepté dans la bohème locale, très turbulente. C’est là qu’il devint cet “alcoolique de principe”, car, disait-il, “l’alcool est justement le contre-poison naturel contre la hollandite” (7). Ce type de déclarations témoigne de l’intense rapport amour/haine que Wichman cultivait envers son pays natal, une attitude qui lui était caractéristique. Wichman aimait la Hollande, mais à sa manière: pour lui, elle était trop petite d’esprit, trop égocentrique, trop axée sur elle-même; il en haïssait la “stopverfmentaliteit”, la “mentalité-mastic”, qu’il repérait partout. “Qu’elle s’assèche la main, qui voudra ériger ma statue plus tard en Hollande”, avait-il coutume de dire!
Wichman se plaisait énormément à Amsterdam, même s’il ne fut pas capable d’y prendre racine, vu sa nature de bohème et de juif errant. Des nuits entières, il faisait la fête avec ses copains, et, le jour, il s’adonnait comme un possédé à ses oeuvres d’art. Le temps qu’il lui restait, il l’employait à mettre la ville sens dessus dessous, avec ses amis. En plus, il se querellait avec tous les critiques d’art et l’on sait, avec certitude, qu’il en prit un jour un par le col pour le secouer. La victime eut le nez en sang, sans doute pour la première fois, et Wichman essuya sa première condamnation.
Wichman aurait aimé servir sa patrie pendant la première guerre mondiale, mais la disparition de son oeil droit l’empêcha d’être mobilisé. Libéré de ses obligations, il put consacrer tout son temps à d’autres initiatives. Dès mars 1916, il fonde avec son ami Louis Saalborn la société “De Anderen” [= “Les Autres”], une association d’artistes plastiques dont l’objectif principal était de défendre les intérêts professionnels et sociaux des artistes modernes. Du point de vue politique, cette association représentait une brochette de radicaux, de nihilistes, de communistes, de futuristes et surtout d’anarchistes. Wichman, qui publia bon nombre de brochures auprès des éditions de “De Anderen”, a reçu là le virus de l’anarchisme, dont il n’a jamais pu se débarrasser ultérieurement.
Sur le plan financier, sa situation était devenue très précaire. Il a connu des temps fort durs, il a souffert de la faim, surtout après que son père ait cessé de lui verser une somme mensuelle, pour son entretien. Qu’importe: Wichman s’est montré un virtuose dans l’art de faire des dettes. Il l’exprima un jour en vers:
“Tot tranen toe ben ik bekommerd,
nu kan ik nooit meer naar de lommerd,
omdat mijn hele inventaris
al daar is”. [“J’ai souci jusqu’aux larmes, car au mont-de-piété jamais ne pourrai plus aller, car là-bas se trouve d’ores et déjà tout mon inventaire”].
Pour échapper à ses créanciers, Wichman imaginait les idées les plus folles. Des années plus tard, il installa près de son logis, proche du “Molenpad” à Amsterdam, une série de flèches indicatrices, sur lesquelles étaient inscrits les mots suivants : “Chez Erich Wichman”. Malheur à ceux qui suivaient le chemin indiqué par l’artiste! Après tout un trajet, où il s’agissait de gravir des escaliers, puis de les redescendre, le candidat visiteur, exténué, se retrouvait à son point de départ. En 1924, après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, après avoir bamboché des nuits entières, après avoir souffert de la faim, Wichman craque physiquement, pour la première fois. Il s’effondre et on l’envoie à l’hôpital, avec, pour mention, “danger: suicidaire”. Il réagit avec cynisme: “C’est très grave n’est-ce pas? Mais crever de faim ne les émeut pas!” (8).
En septembre 1916, il épouse Leni Kampfraath, une tailleuse de diamant, avec laquelle il vivait depuis un certain temps. La légende affirme qu’Erich Wichman, qui avait été jusque là un fameux coureur de jupons, est resté fidèle après son mariage... à sa femme et à sa maîtresse... Le couple a rapidement un enfant, ce qui oblige Wichman à trouver un emploi stable: il devient d’abord chef émailleur dans une fabrique d’argenterie à Utrecht, ensuite concepteur et réalisateur de nacelles en béton insubmersibles. Dans le cadre de ce travail, il tentera en vain d’attirer l’attention d’une firme américaine!
En 1919, Wichman met en émoi la bourse du diamant à Amsterdam, en vociférant en public que la “démocratie est un mensonge”et en tentant d’expliquer “à un troupeau de deux mille ânes huant et sifflant” qu’il vaut mieux lire Goethe, son auteur favori, que d’aller voter (9). Un an auparavant, il avait écopé de trois jours de prison, parce qu’il avait circulé dans la ville en portant un écriteau sur le ventre, sur lequel il était inscrit: “Ne votez pas, lisez Goethe!”. Il incitait ainsi les Néerlandais à faire une “révolution aristocratique”.
Autre déception de grande envergure: l’échec de l’exposition et du livre, tous deux intitulés “Erich Wichman tot 1920” [= “Erich Wichman jusqu’en 1920”]. Toutes les réactions avaient été négatives, bien que le grand médiéviste et philosophe Huizinga (1872-1945) ne s’était exprimé qu’en termes critiques couverts. Le seul homme qui réagit avec un enthousiasme sans partage fut le poète expressionniste Hendrik Marsman (1899-1940), qui apporta plus tard son propre concours à certaines actions politiques.
Le coup qui fit entrer Wichman dans la légende, fut la création du “Rapaille-Partij”, du “Parti de la Canaille”. La raison qui a motivé la création de cette étonnante formation politique fut, pour être bref, le fait que les Néerlandais étaient obligé de voter sous peine de poursuites judiciaires. Cette loi était impopulaire, surtout parce que beaucoup de Néerlandais la considéraient comme coercitive. Wichman et sa bande pensaient, en revanche, que l’électeur n’était tout simplement pas capable, par définition, de choisir le moindre candidat convenable. Le 28 avril 1921, des élections municipales ont lieu à Amsterdam et la bande à Wichman saisit l’occasion pour se moquer ouvertement du système démocratique. Au départ, l’idée émanait d’un groupe d’ouvriers bateliers anarchistes, que l’on appelait les “Veelbelovers” [= “ceux qui promettent beaucoup”]. Il n’a pas fallu longtemps pour que Wichman en tire toutes les ficelles. Dans une taverne bien connue, l’”Uilenkelder”[= “La cave aux hiboux”] et dans son propre logis, le long du “Prinsengracht” [= “Le Canal des Princes”] à Amsterdam, Wichman et ses sympathisants de “De Anderen” préparèrent l’émergence d’un parti anti-tout, qui allait faire fureur (10).
Le programme du parti n’avait guère de contenu, mis à part la plantation d’arbres pour remplacer les urinoirs publics qu’il convenait de démolir, le petit verre de genièvre à cinq cents et le droit de pêcher et de chasser dans le Parc Vondel. Seuls étaient retenus les candidats qui souligneraient encore davantage le ridicule de l’entreprise. Le premier d’entre eux fut Cornelis de Gelder, alias “Had-je-me-maar” [= “Si-tu-pouvais-m’attraper”]. Ce surnom bizarre rappelait une chansonette des kermesses hollandaises. Cornelis de Gelder était un ivrogne notoire, un “idiot professionnel”, qui gagnait sa croûte en déambulant le long des terrasses des cafés de la Place Rembrandt, armé d’un lourd bâton et muni d’une boîte à cigares déguisée en instrument de musique, à l’aide de quelques cordes tendues. A certains moments, il frappait la boîte de son bâton, faisait l’idiot et terminait immanquablement ce qu’il estimait être une représentation culturelle de haut vol par le cri “Had-je-me-maar”. On raconte que ce hère original, quand il était à jeun, faisait bonne impression, était fort aimable, mais finalement peu se souviennent de lui. Le deuxième candidat était aussi un spécimen très original: Bertus Zuurbier (1880-1962), un monomane mi-anarchiste mi-bolchevique, qui avait longtemps travaillé comme ouvrier batelier, puis était devenu rinceur de bouteilles, mais demeurait surtout un chômeur permanent. Il errait ainsi dans la vie, vendant pendant toute l’année des numéros souvent fort anciens de “De vrije Socialist” [= “Le Socialiste libre”]. Quand on lui faisait remarquer que ces numéros dataient, il répondait: “Vieux, dis-tu? Mais pour toi, tout cela est bien nouveau, vilain bourgeois!”. Lorsque la Reine Wilhelmina participa au lancement d’un sous-marin de la flotte néerlandaise et plongea avec lui, Zuurbier circulait dans la ville, vendant un journal de son cru en criant : “Lisez ici combien bas a sombré Sa Majesté!”. A plusieurs reprises, il fut condamné pour trouble à l’ordre public.
Le public attendait le résultat de ces élections avec impatience, surtout que tous les partis avaient fait campagne contre le “Groep van Gelder” [= “Le Groupe de Gelder”]. Le “Kristelijk Historisch Dagblad” [= “Le Quotidien historique chrétien”] s’est voulu original et vexant tout à la fois en proposant d’appeler la nouvelle formation le “Rapaille-Partij”. Wichman accepta avec gratitude ce qui était censé être une insulte: “Exactement comme vous avez jadis repris à votre compte l’injure de “Gueux” et en avez fait un titre de gloire, nous acceptons, nous, ce nom que vous nous donnez comme une distinction honorifique”. Pour faire connaître leurs idées et leur programme à l’homme de la rue, le groupe disposait d’une revue, “De Raad” [= “Le Conseil”], qui paraissait affublé du slogan: “Gardez cette feuille, plus tard elle vaudra de l’argent”!
Le “Rapaille-Partij” fit force propagande et, rappelons-le aussi, les candidats ne furent pas en reste : Zuurbier maudissait dans ses colportages la démocratie, le suffrage universel et demandait à ceux qui l’écoutaient de voter pour lui, parce que, lui au moins, allait pouvoir bien utiliser l’argent de ses honoraires de conseiller. “Had-je-me-maar”, pour sa part, se fit photographier assis devant une table pleine de bouteilles et de verres vides, le cruchon de genièvre bien en évidence dans la main, chantant à pleine poitrine les chansons qu’il avait lui-même composées.
Wichman et ses amis voulaient démontrer que la démocratie conduisait à l’absurdité. L’entreprise était considérée comme une protestation bouffonne —quasi dadaïste— mais elle se mua en réalité bien tangible, dans la mesure où, après dépouillement des bulletins de vote, il s’avèra que 14.246 citoyens avaient voté pour les deux clochards, qui, du coup, étaient devenus des élus du peuple!
“Had-je-me-maar” posa immédiatement problème. L’hebdomadaire “Het Leven” avait mis une limousime à sa disposition après les élections. Il en profita pour se faire conduire en état d’ébriété dans toute la ville, ce qui ligua l’ensemble du collège municipal contre lui. Celui-ci décida de faire arrêter dès que possible le bambocheur, qui, à cause d’une condamnation précédente avait perdu son droit de vote. Motif: ivresse sur la voie publique. Wichman était au courant de ce projet et décida de fournir à l’ivrogne quelques gardes du corps, pour l’empêcher de faire sa tournée des bistrots. Ce dont il n’avait nulle envie. Notre fêtard roula donc ces gardes du corps dans la farine: “Had-je-me-maar” se plaignit d’avoir une soif terrible et amena sa garde prétorienne au bistrot pour s’envoyer un petit rafraichissement dans le gosier. La suite est facile à deviner : le soifard professionnel saoûla copieusement ses gardes, qui roulèrent sous les tables. Il en profita pour s’éclipser et visiter d’autres lieux. Il n’alla pas loin. La police l’arrêta et le força à signer une déclaration dans laquelle il renonçait à son poste de conseiller municipal.
Quant à Bertus Zuurbier, il s’intéressait surtout à l’argent qu’il pouvait tirer de son modeste poste et ne manquait jamais une séance du conseil. L’homme avait des talents déclamatoires avérés, mais il n’en fit pas souvent usage dans le cadre du conseil. D’après des témoins, sa seule intervention fut celle-ci: “Fermez la fenêtre car il y a un courant d’air”. Quand on lui reprocha un jour son silence, il répondit que les temps étaient durs et qu’on ne devait pas exiger de lui de prononcer de longs discours pour les cinq florins de cachet qu’il touchait.
Le résultat final de toute cette aventure fut vraiment très minime. Les autorités votèrent une petite loi, à la vitesse éclair, destinée à empêcher ultérieurement que des initiatives dans le genre du “Rapaille-Partij” participent aux élections. Wichman, qui voulait en ultime instance autre chose qu’éveiller l’appétence des Amstellodamois pour le rire et la moquerie, était très déçu. Il partit pour l’Allemagne, où, selon certaines sources, il étudia la physique nucléaire à Munich. Il se rendit ensuite en Italie, où il fit connaissance avec le fascisme et noua vraisemblablement des contacts avec le futuriste Marinetti. Sans doute découvrit-il dans le fascisme ce qu’il cherchait depuis longtemps: “Je ne me suis pas trompé, c’était ce dont j’avais besoin: être plus proche des animaux et en même temps plus proche des dieux et, à travers tout cela, la florissante luxuriance d’un pays bien gouverné. Oui, l’ami, c’était là l’oeuvre de l’homme fort” (11).
Sa situation financière demeurait précaire. Pour y remédier, il accepta un modeste poste de traducteur au consulat des Pays-Bas à Milan. Il y rencontra le prêtre et moraliste néerlandais Wouter Lutkie (1887-1968), qui jouera plus tard un rôle de premier plan dans le mouvement fasciste néerlandais, que Wichman décrit comme suit : “Son oeil unique, largement écarquillé, nous regardait fixement. Il était vêtu d’une chemise de sport, d’un veston et d’un pantalon. Sa chemise était grande ouverte, dévoilant son torse nu. Le pantalon était large, avait la forme d’un entonnoir, comme ceux des marins; il marchait sur le bas de ses pantalons qui s’effilochaient. Il y avait une ouverture dans sa manche droite, par où passait un coude. Il avait l’air d’un vagabond”. (12).
Vers la moitié de l’année 1924, Wichman revient au pays natal, ses valises pleines à craquer de chianti, de macaroni, de spaghetti et de ravioli (13). Dans la revue “Katholieke Staatkunde” du Dr. Verviers venait de paraître un appel “aux hommes du Rapaille-Partij”. Wichman y répond par la voie d’une lettre ouverte, qu’on peut désormais “disposer de sa personne, de sa plume et de son pinceau et, s’il le faut, sans phrase, de ses poings et de sa vie” (14). Cette lettre, au ton résolument martial, montre qu’il est dévoré par le feu révolutionnaire et qu’il n’hésiterait pas à passer à l’acte terroriste: “Je ne ferai pas de dégâts pour moins de cinq millions : ce n’est pas pour rien que je suis chimiste. Ils en auront une bonne avec moi! Et alors j’irai en prison pour bien bouffer à leurs frais!” (15).
Dans une collection de brochures bien connues à l’époque, intitulée “Pro en Contra” [= “Le Pour et le Contre”], Wichman fait paraître “Het fascisme in Nederland” [= “Le fascisme aux Pays-Bas”], où il polémique contre Henk Eikeboom, un ancien collaborateur du “Rapaille-Partij”: “Il n’y a plus de place en ce monde”, écrit-il, “pour l’aventure, l’imprévu, l’élasticité, la fantaisie et la ‘démonie”. Seule a droit au chapitre la raison la plus stupide. Dieu s’est mis à vivre tranquille” (16).
Il se fit ensuite membre du “Verbond van Actualisten”, une ligue que nous avons déjà citée ici, mais qui faisait de l’oeil au système démocratique et cultivait un pacifisme de principe, deux démarches qui lui déplaisaient. Pour répondre à ces lacunes, Wichman fonde alors le “Bond van Rebelsche Patriotten in een Ondergaand Volk” [= “Ligue des patriotes rebelles au sein d’un peuple en déclin”]. Dans une “lettre ouverte à S. M. Albert, Roi des Belges” [“Open brief aan Z. M. Albert, Koning der Belgen”], il remarque que les Pays-Bas pourraient parfaitement être annexés tout de suite à la Belgique, vu les réactions molles des Néerlandais vis-à-vis de certaines revendications territoriales belges. Cette lettre, empreinte d’ironie grinçante, a quasiment été le seul fait d’arme de ces “patriotes rebelles”. Wichman rédige ensuite un pamphlet anti-communiste, intitulé “Lenin stinkt” [= “Lénine pue”, ce qui signifie aussi “Lénine est corrompu”], qui critique surtout le culte de la personnalité qui s’est instauré autour du leader bolchevique. Cette critique est sans concession. Elle paraît à la fin de l’année 1924.
Apparemment, Wichman ne supportait plus, une fois de plus, sa patrie et, au début janvier 1926, on le retrouve à Paris, où il a failli crever de faim. Il passa le plus clair de son temps à étudier, dans les bibliothèques de la ville, les ouvrages qui traitaient de la vie des ascètes chrétiens et des saints mendiants, dans l’intention de rédiger un petit ouvrage, qu’il voulait d’abord intituler “De Kunst van het Armoedzaaien” [= “De l’art de répandre la pauvreté”]. Plus tard, il débaptise ce manuscrit et l’appelle “Verrekken – Een handleiding voor beginners en meer gevorderden” [= “Crever – Un vade-mecum pour débutants et pour ceux qui ont déjà fait des progrès”]. L’ouvrage est resté inachevé.
En 1927, il publie dans “De Vrije Bladen” [= “Feuilles libres”] un essai satirique très étonnant sur les habitudes de boire aux Pays-Bas. Titre de l’essai: “Het witte gevaar” [= “Le danger blanc”]. Nous avons affaire là à un écrit très peu conventionnel, où Wichman, qui, rappelons-le, est “un alcoolique de principe”, engage le combat contre les idéaux sociaux en faveur du lait et contre l’alcool, idéaux qui se manifestaient par des campagnes publicitaires dans tous les Pays-Bas, pour inciter les Néerlandais à boire du lait. Wichman: “Plus encore que pour l’absence de bouteille, ou s’il le faut, de carafe de vin rouge; plus que pour la présence de fleurs (Degas: “Les fleurs d’une table sont les bouteilles”), de la boîte ronde en fer blanc pleine de biscuits, du pot de confiture ou de sirop, du beurre de cacahuètes, de grains d’anis, de granulés, de pépites en chocolat et d’autres horreurs (brrr), la table d’un lunch hollandais est une chose si repoussante surtout à cause de ces récipiants blancs, en forme de quille renversée, faits de céramique, qui sont censés contenir un liquide trouble, une émulsion sale, oui sale, qui n’est rien d’autre qu’une sécretion de pis de vache (...). “Melk is goed voor elk” [= “le lait est bon pour chacun”, dit la publicité]. Cette phrase, qui ne compte que cinq petits mots contient:
◊1. Une faute de langue (grosse comme une vache),
◊2. Une manoeuvre , qui équivaut à un coassement, comme celle que tente le “Comité de défense contre la boisson” d’Amsterdam —quelles vaches!— [ndt: en français dans le texte] qui oeuvre en étroite coopération avec l’administration municipale pour tapisser nos voies publiques d’affiches telles “Niet drinken, niet schenken, een goede raad zou’k denken”, etc. [= “Ne trinque pas, ne verse pas, voilà le bon conseil, je crois”]. Mais tout cela n’est pas vrai, “bij de luier hoort de uier” (“pis et couche-culottes vont ensemble”), “zulke ezels praten voor kwezels” (“de tels ânes ne causent que pour les bigots”), “dat gekwek maakt iemand gek” (“ces coins-coins vous rendent fou”), je vais donc donner à ces messieurs une autre leçon: “cieder is goed voor ieder” (“le cidre est bon pour tous”), “wijn is goed voor de pijn” (“le vin est bon pour vos douleurs”), “rode is goed voor de noden” (“le gros rouge est bon pour vos misères”), “witte is goed voor de hitte” (“le blanc est bon pour la fièvre”), “oude is goed voor de koude” (“le vieux [genièvre] est bon contre le froid”) et “jonge is goed voor de longen” (“le jeune [genièvre] est bon pour les poumons”], “bieren zijn goed voor de nieren” (“les bières sont bonnes pour les reins”), “jenever is goed voor de lever” (“le genièvre est bon pour le foie”), “klare is je ware” (“le genièvre pur [le schiedam] est digne de toi”)!” (17).
En décembre 1927, eut lieu, en Hollande, un événement qui déterminera le reste de la vie de Wichman, et accélèrera aussi sa fin. C’est en effet l’année où paraît le premier numéro de “De Bezem” (“Le Balai”), qui fut vraiment la première revue fasciste “pur sang” des Pays-Bas. Wichman y apporte immédiatement sa collaboration, ainsi qu’au petit parti qui se constitue en marge de la publication. Il y fait paraître des articles et des dessins satiriques, dirige les réunions où l’on boit sec d’impressionnantes quantités de genièvre, organise des exercices de tir, de combat au gourdin et aux poings nus, afin de transformer les membres en une version locale des squadri fascistes italiens. A ce moment-là, Wichman cesse de travailler comme artiste. Il devient un agitateur, en dépit de sa santé qui ne cesse de décliner. Lorsque la radio libre de gauche, VARA, annonce le 20 avril, jour des “petits princes” en Hollande, qu’il organisera une fête du 1 mai, Wichman se rend dans ses locaux, accompagné de son “écuyer” Couveld, qui sera son camarade dans toutes ses folies, et qui se fera remarquer plus tard en tirant en l’air un coup de pistolet dans le théâtre Carré, qui faisait, ce jour-là, salle comble. Sans faire trop de façons, Wichman escalade le podium, s’empare du microphone et crie “Vive la Princesse Juliana”. Ensuite il débranche l’émetteur VARA, en le renversant. Dans la bagarre qui s’ensuivit, il eut le bras droit déboîté.
Un mois plus tard, Wichman provoque une nouvelle fois tumulte et sensation. Des annexionnistes belges venaient par bateau en rade de Hansweert pour jeter de petits drapeaux belges dans les eaux du Wielingen [bras de l’estuaire de l’Escaut, ndt], acte symbolique censé réclamer l’annexion à la Belgique de la Flandre zéelandaise. Les autorités néerlandaises n’entreprenaient rien pour contrer ces actions. Wichman décide alors de se rendre sur place avec trois ou quatre de ses équipes du “Bezem”. La Maréchaussée néerlandaise avait barricadé le port, si bien que les “Bezemers” devaient rester derrière la digue. Les Belges ne pouvaient donc pas voir leurs adversaires, mais ceux-ci firent un tintamarre de tous les diables, faisaient claquer fièrement leurs étendards orange tandis que Wichman tirait à qui mieux mieux des coups de pistolet, qu’ils s’imaginèrent qu’une masse impressionnante de contre-manifestants néerlandais se massait derrière la digue. Ils préférèrent faire demi-tour!
Il est symbolique de constater que la mort de Wichman est due à un vieil ennemi de la nation néerlandaise, une ennemi qu’elle n’a jamais cessé de combattre. En décembre 1928, Wichman devait prononcer une conférence devant une corporation étudiante de l’université d’Utrecht. Il se rend sur place et constate que ces auditeurs sont tous partis à Breukelen, pour aider la population en détresse à cause d’une digue qui était sur le point de se rompre. Sans hésiter, Wichman se porte à son tour volontaire, se rend sur place et y travaille toute la nuit pour conjurer le danger. Il y attrapa une méchante fièvre et comme sa santé était précaire, son corps n’a pu y résister et il est mort, inopinément, le matin du Nouvel An 1929 d’une pneumonie, peu de temps après avoir levé un verre de vin en l’honneur de l’an neuf... Trois jours plus tard, ces amis le portent à “son premier et dernier lieu de repos” (18), avec, sur le cercueil, le drapeau des “Princes”.
◊ 4. Conclusion:
L’itinéraire d’Erich Wichman est un exemple d’école pour nous dire comment il NE faut PAS faire de politique! Il était un individualiste accompli et donc incapable d’oeuvrer sérieusement en politique, pour quelqu’idéologie que ce soit. Nous avons déjà posé la question, mais indirectement: dans quelle mesure Wichman peut-il être considéré comme un “fasciste”? Il était depuis longtemps un “anti-démocrate”, avant qu’il ne devienne “fasciste”. Au lieu de lui coller l’étiquette, devenue infâmante, de “fasciste”, il conviendrait plutôt de le baptiser “anarcho-nationaliste” ou de l’étiqueter d’une façon différente mais similaire. Wichman était d’inspiration “grande-néerlandaise”. Il entretenait des contacts avec ce nationaliste flamand emblématique que fut le Dr. August Borms, ainsi qu’avec le poète expressioniste flamand, engagé dans le camp nationaliste, Wies Moens. Cees de Doodt remarqua un jour que le fascisme disparaissait de la scène aux Pays-Bas, chaque fois que Wichman partait à l’étranger. Cees de Doodt rend ainsi honneur, en quelque sorte, à cet homme inclassable, qui ne cessait de lutter contre tout. Bien que le NSB, plus tard, voulut revendiquer pour lui la mémoire de Wichman, nous pouvons poser la question: cet homme se serait-il senti à l’aise dans ses rangs? Car, au bout du compte, on peut dire qu’il ne se sentait nulle part chez lui...
Frank GOOVAERTS.
(Texte inédit de Frank Goovaerts, collaborateur de la revue nationaliste flamande “Dietsland-Europa”, assassiné par un voyou en septembre 1990. Sur cette figure poignante et fascinante du mouvement flamand, disparue trop tôt, lire “Adieu à Frank Goovaerts”, in “Vouloir”, n°73/75, printemps 1991).
01:50 Publié dans Biographie, Histoire, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 octobre 2007
J. Mabire: entretien sur la figure de l'Aventurier

Entretien exclusif avec Jean Mabire : Réflexions sur la figure de l'aventurier
Jean Mabire, quels que soient les domaines que vous ayez abordés dans vos 90 et quelques volumes publiés à ce jour (ndlr:170, en fait, nous confiera Jean Mabire lui-même dans la lettre accompagnant ses réponses), des SS français aux 55 jours de Pékin, d'Amundsen à l'histoire de la Normandie, toujours ressort en filigrane, sinon d'évidence, une idée récurrente, mieux, une certaine définition de l'homme, dont les valeurs pourraient se résumer par un mot: l'aventure. Jean Hohbarr ne s'y trompait pas, qui écrivait dans un numéro du Français : «Mabire l'avoue, il ne tient pas la littérature pour un genre “neutre”, mais bien comme l'expression d'une vision du monde». Sans doute le sang viking qui coule dans vos veines de Normand n'y est pas étranger. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'aventure paraît définitivement ressortir du domaine du passé, à l'heure du tout-media et de la photographie par satellite. La conquête de l'espace, le mercenariat ou l'exploit sportif (voir la lutte contre le SIDA selon certains) seraient-ils les dernières formes d'aventure ouvertes à l'homme de demain?
Jean Mabire: Quand Ernst von Salomon, cet aventurier-type de notre siècle, se vit obligé, après la défaite de son pays, de répondre à un Questionnaire, il ne fallut pas moins de 650 pages pour ce faire, ce qui lui permit d'ailleurs d'écrire son meilleur livre. On s'aperçut alors qu'il n'avait jamais cessé de se mettre en scène lui-même et qu'il avait tout au long de sa vie mélanger sa bibliographie et sa biographie. Tel n'est certes pas mon cas. Je m'intéresse bien davantage à mes personnages —imaginés ou restitués— qu'à moi-même. Et bien davantage peut-être à mes lecteurs qu'à mes personnages.
Certes, mes «héros» vivent une aventure, à commencer par le très singulier Roman Feodorovitch von Ungern-Sternberg, cas extrême s'il en fut. Je pense cependant que le terme d'aventurier ne leur convient guère. Il m'arrive de préférer celui de militant. Ou si l'on veut celui de «soldat politique», expression inventée, je crois, par Ernst Roehm, qui n'est pas le moins singulier de tous mes sujets et qui a l'avantage d'être plus véridique que romanesque, d'où le côté assez «instructif » du livre que je lui ai consacré.
Puisque vous parlez d'aventurier, je crois qu'il faut revenir à un essai (si important que j'ai consacré à son auteur une chronique entière dans Que lire?).
Il s'agit du Portrait de l’aventurier de Roger Stéphane. On sait qu'il y évoque trois hommes hors du commun: Lawrence d'Arabie, André Malraux et l'indispensable von Salomon. Ce petit livre, publié en 1950 et récemment réédité, est précédé d'une très éclairante étude de Jean-Paul Sartre. Une vingtaine de pages, mais elles me semblent capitales pour répondre à votre interrogation. Sartre distingue assez bien: «Aventurier ou militant: je ne crois pas à ce dilemme. Je sais trop qu'un acte a deux faces: la négativité, qui est aventurière, et la construction qui est discipline. Il faut rétablir la négativité, l'inquiétude et l'autocritique dans la discipline ».
Dans une fameuse querelle, vieille d'un demi-siècle, je me sens plus proche de Sartre que de ces «Hussards» qui harcelaient le lourd convoi de la littérature engagée.
Je crois, par ailleurs, qu'il y a quelque simplification abusive à opposer aventurier de l'action et aventurier du rêve. Drieu la Rochelle l'avait fort bien compris qui se refusait à enfermer l'aventure dans le carcan dérisoire de la gratuité. Si l'on parle voile, le plaisancier peut se révéler aussi «aventurier» que le navigateur de compétition. Et vice-versa. Moilessier-Tabarly.
L'opposé de l'aventurier? C'est le bourgeois. Voir Flaubert qui a tout dit là-dessus. Le champ reste vaste, infini même, y compris avec la boutade de Péguy qui prétendait que les pères de famille étaient les aventuriers de son siècle.
Sur la littérature comme «vision du monde», je voudrais encore citer Drieu. J'ai récemment découvert un article du 20 février 1932: «Il n'est donné à personne d'écrire une ligne qui, à un égard quelconque, soit neutre. Un écrit présentera toujours une signification politique aussi bien qu'une signification sexuelle ou religieuse».
Non, I'aventure n'est pas le passé. Croyez-moi, on vivra encore fort dangereusement au XXIe siècle.
Pierre Mac Orlan, dans son fameux Petit manuel du parfait aventurier (aujourd'hui réédité au Mercure de France) mettait l'accent sur le paradoxe de l'aventurier, à savoir que celui-ci n'existe pas, qu'il n'est que recréation a posteriori, minéralisation pseudo-mythologique par une société bourgeoise avide de rêves et d'exploits; et que, a contrario, ce même aventurier ne montrait dans ses actes que cruauté, nihilisme et cynisme, sinon cupidité. On est là, nous semble-t-il, à mille lieues du message que diffusent vos ouvrages, plus proches de Jack London que de Lawrence d'Arabie.
JM: Je devais avoir une douzaine d'années quand j'empruntais dans la bibliothèque de mon père ce petit manuel dont vous parlez et je me souviens d'avoir été fort déçu. Brusquement privé de mon imaginaire adolescent, nourri de L'île au trésor de Stevenson et des Corsaires du roi de t'Serstevens. D'où mon ultérieure méfiance envers Mac Orlan, maître-démystificateur. Il me retira l'envie d'être un aventurier. J'en devins, par réaction sans doute, militant.
Cela n'enlève rien à la sombre fascination des gentilshommes de fortune. Mais je m'identifiais plus facilement à Cyrano qu'à L'Olonnois ou Borgnefesse...
Il devait toujours me rester, du drame épique d'Edmond Rostand, l’opinion que c'est bien plus beau quand c'est inutile... Cette sensation fut confortée par le film La patrouille perdue de John Ford, avant de trouver son épanouissement avec Le désert des Tartares de Buzzati. J'ai été frappé du fait que les batailles fondatrices —ces aventures exemplaires— sont toujours des batailles perdues: Sidi Brahim, Camerone, El Alamo, Bazeilles, Berlin, Dien Bien Phu. Cela devait renforcer mon pessimisme foncier (toujours Flaubert, bien plus que Stendhal). Mais un pessimisme qui incite à l'action plus qu'au rêve. Voir là-dessus les sagas et Corneille.
Dans mon cas très personnel, ce qui m'a rendu assez exaltante la guerre d'Algérie en 58-59, c'est que je savais qu'elle était perdue pour l'armée dans laquelle je me battais. On retrouve ce sentiment à la puissance dix quand j'ai rejoint Philippe Héduy et l'équipe de L 'Esprit public à la fin de 1962.
A l'âge des relectures, j'ai repris La Bandera, La cavalière Elsa et même Picardie, avec un constant sentiment de malaise. Seul bouquin à surnager: L'ancre de miséricorde.
Il est de fait que le «roman d'aventure» n'est que substitution. Le lecteur vit ce qu'il n'est pas, revit même ce qu'il n'a pas vécu. Phénomène auquel la télévision donne une dimension fascinante et onirique. On «fait» la guerre ou l'amour par procuration devant le petit écran. Triomphe de l'illusion absolue.
Mac Orlan (…) me retira l'envie d'être un aventurier. J'en devins, par réaction sans doute, militant»
Le héros de votre dernier livre, Padraig Pearse (Patrick Pearse une vie pour l'Irlande, éditions Terre et Peuple) donne aussi cette impression d'osciller entre l'idéalisme révolutionnaire et le plus noir nihilisme, l'amour des hommes et la froide détermination criminelle. Un peu comme Ungern avant lui, et ce, dans une perspective très proche des Conquérants de Malraux.
JM: Ce côté nihiliste et même suicidaire de Patrick Pearse a été souvent mis en avant par ses adversaires. Si vous retirez cette impression de mon livre, c'est que j'aurais manqué ma démonstration. Car c'en est une. Ce court essai décrit une sorte de cheminement inévitable qui conduit un homme —qui est un écrivain, donc un artiste— du combat culturel à l'engagement politique et de cet engagement à la lutte armée. Une autre dimension de Pearse, et non la moindre, est son rôle d'éducateur à Saint-Enda.
Nous sommes très loin d'un aventurier, comme le sera après lui, par bien des traits de son caractère, un homme comme Michael Collins. Pearse me semble la plus haute incarnation du «soldat politique». Il va accomplir un geste fou, mais qui lui semble le seul capable de réveiller le peuple irlandais. Evoquer Les Conquérants à son sujet me paraît fort éclairant.
Ne pas oublier aussi que ce petit livre se situe dans la même ligne que mon gros ouvrage sur Les éveilleurs de peuples (Jahn, Mazzini, Mickiewicz, Petöfi et Grundtvig). Pearse se bat dans leur sillage et conjugue en lui tous les aspects de leurs diverses personnalités: poète, éducateur, militant, prophète, martyr...
Ungern, lui, échappait à cette sorte de «rationalisation de la folie». Il était à la fois plus dément et plus lucide.
Dans votre livre La Torche et le Glaive, vous écrivez ces mots, superbes: «Ecrire pour moi n'est pas un plaisir ni un privilège. C'est un service comme un autre. Rédiger un article ou distribuer des tracts sont des actes de même valeur (...) Ecrire doit être un jeu dangereux. C'est la seule noblesse de l'écrivain, sa seule manière de participer aux luttes de la vie». Or, en relisant Dominique de Roux, quelle ne fut pas notre surprise de retrouver des propos similaires, et écrits à peu près à la même époque: «Ces dernières années, j'ai compris ceci: la littérature et l'action révolutionnaire directe sont, toutes les deux, des modalités d'approche de la mort (...) C'est à travers la mort que la littérature devient action révolutionnaire, et c'est par la mort que l'action révolutionnaire rejoint la littérature». Il ne paraît pas usurpé aujourd'hui de voir en lui un aventurier des lettres.
Fort de ces confidences, et au risque de nous répéter, l’aventure du prochain siècle ne serait-elle pas davantage intérieure? Entendez par là une attitude que nous qualifierions de « Re-deviens ce que tu es». N'est-ce pas là somme toute l'objectif supérieur assigné à la littérature, tels que vos écrits nous le laissent à penser?
JM: D'abord, ne nous faisons pas trop d'illusions, nous autres écrivains, sur l'importance de ces «aventures» que sont nos livres. On ne sait trop quel usage en feront nos lecteurs. Ainsi l'influence d'un Barrès nous apparaissait hier surprenant et aujourd'hui incroyable.
Je suis d'une génération marquée au fer rouge par Montherlant et Malraux. C'est dire si Sartre et Camus m'ont paru ensuite d'une rare fadeur. On revenait à la littérature «fin de siècle» avec l'esthétisme méditerranéen et l'intellectualisme dreyfusard.
La contre-attaque des «Hussards» m'a semblé moins pertinente que celle des garçons de la fournée suivante, et notamment Dominique de Roux et Jean-Edern Hallier. On se doit d'ajouter Jean-René Huguenin et Jean de Brem, mais ils sont morts trop tôt.
Il faudrait parler de la mort. Dominique comme Jean-Edern en avait la fascination, la prescience. C'est une réflexion qui ne vient pas seulement avec l'âge. Là encore, on retrouve Malraux. L'idée tragique de la vie. Vous posez ensuite une sorte d'opposition entre «action intérieure» et «action extérieure». Il y a là une tentation: la voie royale Guénon/Evola. Elle m'intéresse, mais c'est un chemin qui ne m'attire guère. Je suis plutôt fasciné, dans le même ordre d'esprit, par la dialectique paix/guerre. Disons Giono/Malraux (toujours lui). Nietzsche avait assez bien pressenti tout cela. La tentation de la tour d'ivoire se heurte à la brutale affirmation que la rue appartient à celui qui y descend.
Il est évident que pour un écrivain, l’acte d'écrire est intérieur et l'acte de publier extérieur. Deux aventures strictement complémentaires. Il me semble que vous faites allusion à «la politique». Autant sa version politicienne et même politicarde m'est totalement étrangère, autant le sort de la cité, de ma patrie charnelle à l'Europe, n'a jamais cessé de me hanter. D'où une réflexion sur l'Etat, dont le but doit être de «fortifier » le peuple et non de servir une idéologie.
« Je suis d’une génération marquée au fer rouge par Montherlant et Malraux, c'est dire si Sartre et Camus m’ont paru ensuite d 'une rare fadeur »
Toujours dans le même registre, mais autre aventure aussi intensément vécue depuis bientôt cinquante ans, l’engagement fédéraliste, qui combine dans la même absoluité européisme passionné et défense des identités charnelles. Vous dites dans le Manifeste pour la renaissance de la culture normande que la culture française ne sera sauvée que par son ressourcement dans ses traditions régionales et son ouverture à l'Europe des lettres. Pouvez-vous préciser?
JM: L'identité d'un peuple, c'est son esprit autant que sa chair. C'est pourquoi le «culturel d'abord» me paraît plus décisif que le fameux «politique d'abord» de Maurras. Certes, je ne nie pas la vision politique. Mais je la situe hors des multiples et néfastes contingences actuelles. Pour moi, tout se résume dans la dialectique, disons plutôt la confrontation, entre ces deux entités, non contradictoires mais complémentaires, qu'est l'Empire, c'est-à-dire l'Europe, et les peuples qui ne se confondent certes pas avec les états-nations existants.
L'Europe, si elle veut préserver son identité et s'affirmer par rapport au reste du monde, c'est-à-dire en résistant d'abord et avant tout à l'impérialisme américain, doit être avant tout une et diverse.
Une politiquement, militairement, diplomatiquement, économiquement. Mais diverse culturellement. C'est pourquoi la France n'a de signification qu'en assurant d'abord ce que la Pléiade nommait «la défense et l'illustration de la langue française». En ce domaine, le rôle de la Wallonie comme de la Suisse romande est capital, même si ces deux entités excitent le mépris du parisianisme le plus stérile.
Cette culture française, incarnée dans une langue, ne pourra retrouver quelque vivacité qu'en intégrant toutes ses spécificités régionales.
Je ne parle pas ici des langues dites «minoritaires», breton, flamand, allemand, corse, catalan, basque, occitan, mais aussi des différents dialectes d'oïl, tout comme de ce qu'on nomme le «français régional», qui varie selon les pays et les usages.
L'actuelle promotion du «langage des banlieues» aboutit à un terrible appauvrissement, entre autres facteurs par l'emploi du «verlan», qui est le contraire d'une création pour devenir une mécanique.
Maintenir le langage écrit contre le langage parlé est un des aspects de la guerre culturelle. Cela se heurte certes à la modernité qui ne connaîtra bientôt plus qu'une sorte de basic French assez analogue à ce qu'est l'américain par rapport à la langue de Shakespeare.
Cette attitude implique le souci des «humanités» comme on disait autrefois, c'est-à-dire la connaissance du grec et du latin. On doit y ajouter, pour les patries charnelles concernées, une certaine connivence avec leurs racines les plus profondes. C'est-à-dire, en Normandie, par exemple, des notions élémentaires sur le mode norrois primitif qui nous permettrait de maintenir le lien avec notre plus ancienne culture.
Et parce que pour vous l'aventure continue, pouvez-vous, pour les lecteurs de Nouvelles de Synergies Européennes, nous indiquer quelques prochaines pistes de lecture...
JM: Je n'ai pas à l'heure actuelle le projet d'écrire quelque grand document sur la Seconde Guerre mondiale, même si je suis loin d'en avoir terminé avec la vaste fresque des «corps d'élite», commencée voici près de trente ans chez l'éditeur Balland. Il me reste à écrire deux volumes de l'histoire des volontaires français sur le front de l'Est: 1943 et 1944. J'attends que mon jeune ami Eric Lefèvre me fournisse, comme cela a été dans le passé, les documents nécessaires à l'évocation de cette aventure. Je laisse à d'autres le soin d'évoquer les motivations et les combats des volontaires baltes, ukrainiens ou hongrois. Cela me demanderait trop de temps en recherches et traductions.
Après Béring et Amundsen, j'aurais eu envie de faire revivre d'autres explorateurs polaires comme le Suédois Nordenskjöld et le Danois Rasmussen. Mais le marché du livre et l'incuriosité du public sont tels que je n'envisage pas de me lancer dans ces aventures. Alors, je me concentre sur mes chroniques de Que lire? Le volume 6 est terminé et devrait paraître à la fin de cette année. J'en suis à plus de 450 écrivains et il reste environ deux cents auteurs que j'estime indispensable de traiter.
J'ai aussi l'intention de consacrer un livre à ce mystère qu'est la permanence de la Normandie depuis onze siècles. Mon projet d'une gigantesque histoire des écrivains normands, en plusieurs volumes, reste pour le moment à l'état de notes et de fiches, faute d'avoir trouvé un éditeur assez entreprenant.
Quant au roman sur la dernière guerre dont j'ai l'idée depuis plus d'un demi-siècle, il sera peut-être réduit à une simple nouvelle.
De la part de la rédaction, M. Mabire, merci.
(Entretien recueilli par Laurent Schang)
01:55 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Empires océaniques des steppes et des mers ouvertes

Les empires océaniques des steppes et des mers ouvertes
Guido GIANNETTINI
L'empire qui a connu la plus grande expansion au cours de l'histoire a été celui des Mongols, qui ont proclamé leur chef Djingghis Khan (Gengis Khan), soit le “souverain océanique”. C'est dans ce sens que je vais parler, dans cet exposé, d'“empires océaniques”. Les “empires océaniques” des steppes sont originaires d'Asie Centrale, justement comme celui des Mongols. Les “empires océaniques” des mers extérieures se sont constitués à partir du 16ième siècle de notre ère sous l'impulsion des grandes puissances européennes qui se sont projetées sur les mers du globe.
Il existait toutefois, avant ces deux types d'empires “océaniques”, un type différent, anomal, qu'on pourrait attribuer au type “océanique”: c'est celui qui s'est constitué au départ de l'expansion des cavaliers arabes entre le 7ième et le 8ième siècles de notre ère et qui s'est dissous en l'espace d'un matin. Il s'agit à mes yeux d'une apparition mystérieuse et inexplicable sur la scène de l'histoire. Mais c'est un mystère que je me dois d'expliquer avant de passer à l'argument spécifique de mon exposé.
L'expansion des cavaliers arabes entre le 7ième et le 8ième siècles de notre ère est une expansion veritablement hors norme, que l'on ne pourra pas comparer à un autre exemple historique semblable, antérieur ou postérieur. D'un point de vue géopolitique, cette expansion paraît absurde.
Il n'existe aucun exemple de conquête par voie de terre partie d'une péninsule (la péninsule arabique) qui ait pénétré profondément dans la masse continentale (l'Asie occidentale) puis s'est étendue sur un littoral très long mais sans aucune profondeur (l'Afrique du Nord). Dans tout le cours de l'histoire, on n'a jamais vu quelque chose de semblable. D'un point de vue géopolitique, les conquêtes arabes présentent toutes les caractéristiques des expansions propres aux puissances navales, qui, elles, procèdent par “lignes extérieures”, sur les marges des masses continentales. Dans le cas de l'expansion arabe, nous avons une occupation d'une bande littorale, mais effectuée par voie terrestre.
Les causes de cette expansion hors norme sont au nombre de deux. Tout d'abord, il faut savoir que le désert est comme la mer: on ne peut pas l'occuper, on peut simplement tenir en son pouvoir les oasis, comme la puissance maritime occupe et tient en son pouvoir les îles de l'océan. La seconde cause doit être recherchée dans le caractère fortuit, inconsistent, inexistent des conquêtes —en langue arabe il existe un terme indiquant quelque chose qui n'existe pas, mahjas, dont dérive le mot italien mafia; c'est quelque chose d'inexistent mais qui existe tout de même. Nous avons donc affaire à un empire territorial créé à parti de ce rien qui est tout de même quelque chose.
L'expansion des Arabes au départ de leur péninsule d'origine a été rendue possible par une série inédite de facteurs fortuits, tous concentrés dans le même espace temporel. En premier lieu, l'expansion arabe a bénéficié de la faiblesse intrinsèque, à l'époque, des empires byzantin et sassanide, littéralement déchiquetés par plus de vingt années de guerres ruineuses où ils s'étaient mutuellement affrontés. Cet état de déliquescence mettait quasiment ces empires dans l'impossibilité d'armer des troupes et de les envoyer loin, à mille, à deux mille kilomètres de leur centre, où même plus loin encore, contre ce nouvel ennemi qui déboulait subitement du désert. Pire, il leur était impossible de reconstituer des armées dans des délais suffisamment brefs, si celles-ci étaient détruites. En effet, une puissante armée byzantine avait été anéantie sur le Yarmouk en 636 et une autre, sassanide, avait été écrasée par les Arabes à Nehavend en 642. La raison de cette double défaite était d'ordre climatique: le vent du désert, le simoun (de l'arabe samum), avait soufflé dans leur direction pendant plusieurs jours d'affilée, les avait immobilisés et assoiffés, tandis que leurs adversaires arabes combattaient avec le vent qui les poussait dans le dos, sans qu'ils ne fussent génés en rien par la tempête de sable.
Autre facteur qui a rendu aisée l'expansion des Arabes: les luttes intestines qui divisaient les Byzantins, d'un côté, les Wisigoths d'Espagne, de l'autre. L'empire byzantin venait de traverser une tumultueuse querelle d'ordre religieuse, assortie d'un cortège de violences et de persécutions. Pour toutes ces raisons, entre 635 et 649, les autorités religieuses et les populations ont confié spontanément aux Arabes les villes de Damas, Jérusalem, Alexandrie d'Egypte, de même que l'île de Chypre. Ensuite, à cette époque-là, les autorités musulmanes se montraient tolérantes (au contraire des fanatismes intégralistes que l'on a pu observer par la suite) et se sont empressées de souligner les traits communs unissant les fois chrétienne et islamique. Elles ont accepté que les habitants de confession chrétienne dans les cités conquises exercent librement leur culte et se sont borné à lever une taxe, modérée en regard de ce qu'exigeait auparavant le basileus byzantin.
La conquête de l'Espagne s'est déroulée dans des conditios analogues. Après le décès du roi wisigoth Wititsa, deux prétendants se sont disputé le trône: Roderich et Akila. Ce dernier a fait appel aux Arabes et leur chef, Tariq Ibn Ziyad débarque en 711 dans la péninsule ibérique en un lieu qui porte encore son nom, Gibraltar, de l'arabe Djabal Tariq, “la montagne de Tariq”. Son armée est forte de 7000 hommes, en grande partie originaires du Maghreb. Ils seront suivis par d'autres. Les Arabes et les Wisigoths partisans d'Akila finissent par avoir raison des Wisigoths partisans de Roderich. Ces derniers sont attaqués dans le dos par les Basques et par la communauté juive, qui est particulièrement nombreuse en Ibérie (elle est la plus forte diaspora d'Europe). Les Juifs se soulèvent, équipent une armée et s'emparent de plusieurs villes qu'ils livrent aux Arabes, tandis que les féaux de Roderich commencent à déserter.
Toutefois, les Arabes, malgré ce concours de circonstances favorables, ont eu du mal à briser la résistance des Wisigoths. Ils n'ont pas pu occuper toute la péninsule ibérique, parce que les montagnards du Nord et des Cantabriques ont repoussé toutes leurs tentatives de conquête. Ensuite, après avoir tenté de pénétrer en France, les Arabes sont définitivement vaincus en 732 près de Poitiers. La défaite de Poitiers, ainsi que l'échec de l'attaque contre Constantinople, mettent fin à l'expansion arabe.
Le déclin a été quasi immédiat. A peine 23 ans après avoir atteint le maximum de son expansion —à la veille de la bataille de Poitiers— le grand empire arabe de Samarcande à l'Atlantique commence à se désagréger: en 755, le Califat ommayade d'Espagne fait sécession, suivi immédiatement par d'autres Etats arabes séparatistes du Maghreb, d'Egypte et d'Orient. Mais un grand empire avait existé, pendant peu de temps, il n'a tenu que 23 ans!
Un empire rêvé, crée par un peuple de rêve et forgé par une culture imaginée: mahjas. En effet, le peuple arabe, créateur de cet empire, n'était pas un peuple selon l'acception commune, c'est-à-dire la fusion de tribus sœurs issues d'un même désert arabique; il n'allait pas le devenir non plus, mais au contraire, juxtaposer en sa communauté de combat des peuples de plus en plus différents, issus des pays conquis.
Mais la culture arabe, elle, est plus homogène. L'islamisme est une forme de syncrétisme religieux alliant des élements de judaïsme et de christianisme et reprenant à son compte des courants chrétiens considérés comme “hérétiques”. La philosophie arabe est une reprise pure et simple de la philosophie grecque, basée sur la dichotomie Platon/Aristote. Les bases des connaissances mathématiques, astronomiques, géographiques, physiques et même ésoteriques dans le monde arabe au temps de la grande conquête sont d'origines grecque et persane. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la pensée arabe est une pensée ouverte aux cultures grecque et iranienne (car l'ancienne civilisation du pays d'Aryanam n'est pas orientale). C'est patent à l'époque du Califat abasside, quand l'Islam, après la chute de l'empire sassanide, a subi directement et puissamment l'influence des peuples conquis.
L'art arabe en général, comme l'art mauresque en Espagne, est constitué de variantes de l'art roman ou byzantin. Enfin, les chiffres considérés comme “arabes” sont en fait indiens, mais les Arabes les ont transmis à l'Europe. Comme du reste d'autres faits de culture venus des régions indo-européanisées d'Asie, tel le jeu d'échecs, qui est iranien, mais nous est parvenu grâce à la médiation arabe.
En réalité, les Arabes ont surtout exporté leur langue en Afrique et en Orient. Mais comme on peut observer que les langues sémitiques sont très proches les unes des autres, et ne sont finalement que des dialectes d'une même langue, cette similitude a favorisé la diffusion de l'arabe dans de nombreuses régions.
Le grand atout de la culture arabe au temps de la grande conquête a été l'extraordinaire capacité, et même le mérite, d'appréhender sans frein tout ce qui venait d'ailleurs, de le remodeler et de le diffuser tous azimuts. Une telle capacité, même si elle peut être interprétée comme un absence de spécificité propre, a contribué à atténuer les rigidifications à l'œuvre dans le monde entourant les Arabes, rigidités qui expliquent aussi l'expansion fulgurante de ceux-ci, qui serait incompréhensible autrement.
Pendant près de 1800 ans, du début du Vième siècle ap. J.C., jusqu'à l'époque de Gengis Khan, les peuples turcs ont dominé l'Asie centrale septentrionale, puis se sont répandus dans l'Asie occidentale pour donner ensuite l'assaut à l'Europe. Cette phase d'expansion commence vers l'an 1000, quand la domination turque en Asie n'est pas encore achevée. Elle se manifeste surtout dans la longue lutte contre l'empire byzantin, qui se terminera par la chute de Constantinople (1453) et par les raids dans l'espace danubien. La phase descendante commence, elle, par l'échec du siège ottoman de Vienne (1683) et surtout par la reconquête du Sud-Est européen sous l'égide du Prince Eugène, actif dans la région de 1697 à1718, puis de ses successeurs qui guerroyèrent pendant vingt ans pour imposer aux Ottomans la Paix de Belgrade en 1739.
Même sans prendre en considération les 180 dernières années de vie de l'Empire ottoman —depuis la Paix de Belgrade jusqu'à sa fin en 1918— nous constatons que l'expansion de cette puissance turque s'étend sur un arc de treize siècles, pendant lesquels les peuples turcs, habitant à la charnière de l'Europe et de l'Asie, ont joué un rôle primordial parmi les protagonistes de l'Histoire. Il ne s'agissait certes pas d'un Etat unique et d'un peuple unique et cette histoire a connu des phases sombres et de déclin, mais cela s'observe également dans l'histoire de l'empire romain ou des empires des divers peuples de l'Iran, les Mèdes et les Perses, les Parthes et les Sassanides.
La préhistoire des peuples turcs présente encore beaucoup de zones d'ombre et d'incertitudes, comme du reste celle des peuples mongols. Malgré ces difficultés, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le peuple proto-turc le plus ancien —le nom “Turc” ne se diffusera qu'ultérieurement— apparaît sur le théâtre de l'Histoire vers l'année 400 de notre ère: c'est le peuple des Tabgha'c, originaires d'Asie septentrionale, qui, en 70 ans à peu près, domine toute la Chine septentrionale, depuis les Monts Dabie Shan (limite septentrionale des affluents de la rive gauche du fleuve Yang-Tse). Ce sont eux qui fondent la dynastie Wei.
Tandis que les Proto-Turcs Tabgha'c descendent sur la Chine du Nord, en Asie septentrionale, dans la région dont les Tabgha'c sont originaires, se rassemble le peuple des Juan-Juan, connus également sous le nom de Ju-Jan, Ju-Ju ou Jui-Jui. Certains savants les identifient aux War ou Apar ou Avars qui atteindront la Hongrie. D'autres prétendent qu'ils ne sont pas identiques mais parents. Les Juan-Juan étaient des Proto-Mongols, mais leur empire a englobé aussi des peuples proto-turcs ou turcs, paléo-asiatiques et, forcément, des tribus d'autres ethnies.
Vers 520, leur empire commence à s'affaiblir, puis tombe en déclin, à la suite d'une révolte de deux clans que les sources chinoises appellent respectivement les T'u-küeh et les Kao-kü.
Les premiers sont originaires des Monts Altaï et sont les ancêtres des Turcs, le terme chinois T'u-küeh correspondant à Türküt, pluriel mongol de Türk, c'est-à-dire “homme fort” en langue turque. Notons toutefois que quelques auteurs interprètent le terme “Türk” comme un pluriel, “Tür-k”, par analogie à “Tur-an”, pluriel de “Tur”: dans ce cas, il s'agirait d'une reprise par les Turcs d'une dénomination d'origine iranienne, désignant l'“Iran extérieur”. Ensuite, l'autre clan en révolte contre les Juan-Juan était également turc, c'était celui des Tölös, ancêtres des Ouighours.
C'est ainsi que les Turcs, sur les ruines de l'empire des Juan-Juan, ont fondé leur propre empire, s'étendant de Jehol (aux confins de la Mandchourie moderne) jusqu'à la Mer d'Aral, territoire correspondant à toute la zone méridionale du Heartland de Mackinder. Pendant 300 ans environ, l'empire turc —malgré sa division en deux Etats (quasiment depuis le début), l'un oriental, l'autre occidental— a dominé le cœur de l'Asie. Puis, vers la moitié du VIIIième siècle, sa partie orientale est absorbée par les Ouighours, eux aussi d'origine turque, tandis que la partie occidentale se fractionne en khanats indépendants.
A partir du khanat des Oghuz, situé dans un territoire au nord du Lac Balkach, se profile d'abord le clan des Seldjouks, qui amorce par la suite un mouvement vers l'Ouest, leur permettant d'abord de conquérir l'Iran oriental, puis l'Iran occidental, ce qui les rend maîtres du versant sud-occidental du Heartland. C'est après la consolidation de cette phase-là de leurs conquêtes, que les Seldjouks se mettent à attaquer l'Empire romain d'Orient (Byzance), bastion avancé de l'Europe contre les invasions venues d'Asie. D'un point de vue géopolitique, il s'agit de la même ligne d'expansion qu'avaient empruntée précédemment les empires iraniens.
Mais les Seldjouks ne sont jamais arrivés en Europe. La dynastie des Osmanli se profile au XIIIième siècle en Anatolie, prend le contrôle de la partie occidentale de l'empire seldjouk et réamorce les pressions expansives en direction de l'Occident. Les Osmanlilar —pluriel turc qui désigne ceux que les Occidentaux appellent les Ottomans— s'emparent de toute l'Anatolie et, sans tenter de conquérir l'enclave byzantine que sont Constantinople et la Thrace orientale— passent en Europe, atteignent le Danube au cours du XIVième siècle. Ce n'est qu'après avoir atteint le Danube que les Turcs lancent l'ultime assaut contre Constantinople qu'ils conquièrent en 1453.
Ensuite, une série de campagnes militaires les amènent aux portes de Vienne qu'ils assiègent en 1683. Au même moment, les Ottomans, disposant de la plus forte puissance musulmane, deviennent les protecteurs du monde islamique et imposent leur autorité aux Etats arabes d'Afrique du Nord et du Maghreb.
Pourtant, l'histoire de l'expansion ottomane nous apprend que l'on ne peut pas contrôler l'Europe seulement en contrôlant les côtes méridionales de la Méditerranée. En pénétrant par le Sud-Est, à travers les Balkans et l'espace danubien, les Ottomans atteignent la porte d'entrée du cœur de l'Europe, Vienne et Pressburg/Bratislava. Leur calcul était clair: ou bien ils franchissaient cette porte et s'emparaient de l'Europe, ou bien ils étaient refoulés. L'avancée des Trucs en direction du cœur germanique de l'Europe a été bloquée. Les Européens ont reconquis les Balkans. Les Osmanlilar sont tombés en décadence. Les Turcs, comme toutes les tribus ouralo-altaïques avant de commencer leur expansion, habitaient les steppes eurasiatiques, dans des territoires voisins de ceux qu'avaient occupés plusieurs peuples indo-européens entre le IIIième et le IIième millénaires avant J.C. Ce voisinage a provoqué des échanges, ce qui a donné, à la longue, des similitudes culturelles entre Indo-Européens et Proto-Turcs: par exemple, le caractère guerrier de leurs sociétés, l'association homme/cheval et la structure hiérarchique et patriarcale des sociétés. En matières religieuses —l'islamisation des Turcs n'aura lieu que très tard et ne concernera que les Turcs d'Asie occidentale— nous constatons une typologie céleste et solaire des divinités suprêmes.
Citons par exemple Tenggri, “le dieu bleu du Ciel“ ouralo-altaïque, ou le bi-Tenggri turc, phrase signifiant “Dieu est” que l'on a retrouvé grâce à la tradition hsiung-nu. Elle se rapproche de la racine indo-européenne du nom de Dieu, *D(e)in/Dei-(e)/Dyeu, signifiant “lumière active du jour, splendeur, ciel”. L'origine ethnique des Turcs, selon leur Tradition, présente une analogie singulière avec l'origine mythique de Rome: le totem des Turcs était le loup et leur héros éponyme aurait été alaité par une louve, exactement comme Romulus et Remus.
Enfin, à la fin des temps archaïques, la culture indo-iranienne s'est imposée à toute l'Asie centrale. Cette influence a également marqué les Turcs Seldjouks aux XIième et XIIième siècles après J.C., quand ils se sont répandus à travers le territoire iranien et ont retrouvé une sorte de familiarité avec la culture iranienne, dans la mesure où les chefs et les souverains conquérants se paraient ostentativement de noms tirés des textes épiques du Shahnameh, comme Kai Kosrau, Kai Kaus, Kai Kobad.
Plus tard, les Ottomans, surtout après la conquête de Constantinople, ont voulu montrer qu'ils assuraient la continuité de l'empire byzantin. D'abord, ils installent leur capitale dans la ville même de Constantinople, en ne changeant son nom qu'en apparence, car Istanbul dérive de “is tin pol”, prononciation turque de la désignation grecque “eis ten polis”, soit “ceux qui viennent dans la Cité”.
Dans leur bannière, les Ottomans ont repris la couleur rouge de Byzance, la frappant non pas de l'étoile et du quart de lune actuels, mais du soyombo altaïque, qui possède la même signification que le t'aeguk coréen représentant le yin et le yang, c'est-à-dire l'union du soleil et de la lune que l'on retrouve encore dans les drapeaux mongol et népalais: le soleil y est un astre à plusieurs rayons (de nombre paire), la lune y est un croissant comme dans le premier et le dernier quart de ses phases. Le soleil contenu dans le soyombo était encore bien présent au début de notre siècle: il n'a été remplacé que sous l'influence des “Jeunes Turcs” par l'étoile maçonnique à cinq branches qui, avec le quart de lune, évoque le symbolisme oriental du ciel nocturne.
L'empire ottoman et, avant lui, celui des Seldjouks, ont été en contact avec des territoires dont la valeur géopolitique est spécifique et significative: la région danubienne-anatolienne et la région iranique. Ces territoires semblent exiger de leurs maîtres d'assumer la même fonction que celle qu'assumaient avant eux les peuples qui les ont habités. Surtout dans le cas iranien, qui évoquait en un certain sens le monde de leurs origines.
Les Mongols sont le seul peuple à avoir conquis une bonne part de la World-Island, l'île du monde eurasiatique telle que la définissent les théories géopolitiques de Halford John Mackinder, étendant leur domination des côtes du Pacifique à la Mer Noire, en poussant même des pointes en direction de l'Allemagne et de l'Adriatique. La base de départ de leur expansion était la zone centrale du Heartland, selon un développement qui semblait suivre avec grande précision les lignes de la géopolitique la plus classique.
Dans ce cas, toutefois, le terme “mongol” est impropre. En fait, au début de l'“Année de la Panthère”, soit au printemps de 1206, Gengis Khan, le “souverain océanique”, dont le pouvoir s'étendait aux rives de quatre océans, qui descendait du Börte-Chino (le “Loup bleu du Ciel”) et de Qoa-Maral (la “Biche fauve”), convoque aux bouches du fleuve Onon le quriltai, la grande assemblée, réunie autour du tuk impérial (le drapeau blanc avec le gerfaut, le trident de flammes, les neuf queues bleues de yaks et les quatre queues blanches de chevaux). Y viennent les chefs d'une vaste coalition de peuples appelés à former le monghol ulus, la nouvelle grande nation mongole. Mais, outre le Kökä Monghol, c'est-à-dire les “Mongols bleus gengiskhanides”, on trouvait, au sein de ce rassemblement qu'était la nouvelle grande nation mongole, des Mongols Oirat et Bouriates, les Turco-Mongols Merkit, les Toungouzes Tatarlar (Tatars) et les Turcs Kereit, Nemba'en (ou Nayman), les Ouighours et les Kirghizes.
Pour avoir accordé à tous ces peuples la nouvelle “nationalité” mongole dans le cadre de l'empire du “souverain océanique”, le “monghol ulus” était une coalition ethnique aux composantes variées, que l'on ne définira pas comme proprement “mongole” mais plutôt comme “altaïque” ou comme “centre-asiatique”, vu que cette nation élargie comprenait des peuples importants, ainsi que des tribus et des clans paléo-asiatiques et irano-touraniques.
L'expansion des Mongols en direction de l'Occident a été jugée de manières forts différentes par les peuples qui l'ont subie ou observée. En règle générale, cette expansion a suscité la terreur, de l'Asie centrale à la Russie, de l'Allemagne à la Hongrie, surtout en raison des terribles massacres commis par les envahisseurs.
Cependant, les Francs du Levant, détenteurs des Etats croisés survivant vaille que vaille, ont, eux, accueilli les Mongols comme des libérateurs. Dans leur cas, il ne s'agissait plus du “souverain océanique” mais de son petit-fils Hülagü, Khan de Perse et grand massacreur de musulmans. Hülagü combattait sans distinction tous les peuples islamiques, tant les Arabes que les Turcs occidentaux (les Seldjouks), et cela, pour deux motifs: l'un d'ordre essentiellement stratégique, l'autre, religieux. Le motif stratégique, c'était que, de fait, les Turcs occidentaux et les Arabes constituaient un obstacle à l'expansion mongole. Quant au motif religieux, les Mongols étaient à cette époque, pour une grande partie d'entre eux, des chrétiens nestoriens ou des bouddhistes. Hülagü était bouddhiste et sa favorite, Doquz-Khatoun, était chrétienne-nestorienne. Dès lors, ils massacraient tous les musulmans et épargnaient les chrétiens.
C'est pour cette raison que les Francs du Levant ont proclamé Hülagü et Doquz-Khatoun, le “nouveau Constantin et la nouvelle Hélène, très saints souverains unis pour la libération du Sépulcre du Christ”. Mongols et Croisés frappaient tous leurs étendards de croix et égorgeaient ou décapitaient tous les musulmans qui avaient l'infortune de se trouver sur leur chemin en Syrie ou en Palestine: les anciennes chroniques parlent de 1755 pyramides de têtes tranchées.
Mais quand la terreur a cessé, la moitié septentrionale de l'empire gengiskhanide a vécu la “pax mongolica”, permettant de réouvrir la “route de la soie” et de reprendre les échanges commerciaux entre l'Europe, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient.
Plus tard, entre le XIVième et le XVième siècles, l'expansion ottomane en Europe et au Levant, de même que la turcisation et l'islamisation des khanats d'origine gengiskhanide d'Asie occidentale, ont provoqué un renversement complet de la situation: les contacts et les échanges entre l'Europe, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient sont devenus très problématiques. Cette rupture des communications ont contraint notamment le Portugal et l'Espagne à franchir l'obstacle en amorçant une expansion maritime. Cette expansion outre-mer non seulement a réussi à rouvrir la route de l'Inde, mais aussi permi la découverte du Nouveau Monde. L'enjeu a donc été bien plus important qu'on ne l'avait prévu et l'expansion maritime des deux nations ibériques a été vite imitée par de nouvelles puissances navales, telles l'Angleterre, la Hollande et la France.
L'impossibilité d'atteindre rapidement et facilement l'Asie centrale et l'Extrême-Orient par les routes terrestres a obligé les Etats européens, à partir du XVième siècle, a opté pour une approche géopolitique complètement différente et de contourner par voie maritime toute la World-Island, dans le but d'en atteindre les extrémités orientales par des voies extérieures. En d'autres termes, l'Europe, ne pouvant plus appliquer les règles découvertes cinq siècles plus tard par Mackinder, soit les règles de la géopolitique continentale, a à l'unanimité adopté celles de la géopolitique maritime, soit celles qu'allaient découvrir Mahan. L'Europe a donc abandonné son pouvoir continental pour partir à la recherche d'un pouvoir naval.
Au début, la valeur géopolitique de cette nouvelle option n'apparaissait pas très claire: il ne s'agissait pas encore d'une véritable expansion politique et stratégique, mais seulement de l'ouverture de voies commerciales. Toutefois, on est rapidement passé des comptoirs et établissements commerciaux à l'organisation de bases militaires et de points d'appui, occupés par des troupes. Ensuite, on s'est conquis des domaines coloniaux. A partir de ce moment-là, la pertinence géopolitique de l'expansion européenne d'outre-mer est dévenue très évidente.
Le Portugal établit ainsi en 1415 sa première tête de pont en Afrique, mais c'est encore en Méditerranée: il s'agit de la ville de Ceuta au Maroc, qu'il perdra par la suite à l'avantage de l'Espagne. Ensuite, les Portugais traversent l'Atlantique oriental, et commencent à contourner par voie maritime le continent noir. Ils abordent à Madère en 1417, aux Açores en 1431, au Cap Vert en 1445; ils atteignent l'embouchure du fleuve Congo en 1485, arrivent au Cap de Bonne Espérance en 1487 et, enfin, débarquent à Calicut (Kalikat/Kojikode) sur la côte sud-occidentale de la péninsule indienne. Ce n'est qu'après avoir ouvert la route des Indes que les Portugais se donnent de solides possessions coloniales le long de cette voie. Elles sont de véritables points d'appui stables pour garantir la libre circulation sur cette grande voie maritime. Ainsi, après Madère, les Açores, le Cap Vert et la Guinée, qui, de concert avec la métropole portugaise, formaient un système en soi, se sont ajoutées des colonies lointaines comme le Mozanbique (1506-07), la ville de Goa en Inde (1510) et l'Angola (1517).
Après s'être assuré de tous ces points d'appui et territoires, les Portugais complètent leur réseau de relais sur le chemin de la Chine en conquérant la partie orientale de l'île indonésienne de Timor en 1520 et en s'installant à Macao en 1553. Les Hollandais les empêchent de prendre l'ensemble de l'archipel. L'accès aux voies maritimes vers l'Orient est consolidé par la prise de possession de la côte occidentale de l'Atlantique, c'est-à-dire le Brésil, où le Portugal installe son premier point d'appui en 1526. Il achève la conquête du pays en 1680, après en avoir chassé les Hollandais.
L'Espagne évite dès lors toute tentative sur la route des Indes, déjà contrôlée par les Portugais. C'est cet état de choses qui motive la décision de la Reine Isabelle d'appuyer le projet de Colomb de trouver une autre route vers les Indes, en partant de l'Ouest au lieu de se diriger directement vers l'Est. Colomb n'a jamais atteint les Indes, mais, en revanche, il a découvert un autre continent, l'Amérique, qui s'est vite révélée très riche. L'Espagne s'est donc étendue à ce nouveau continent et en a occupé la moitié.
La découverte de l'Amérique réveille l'intérêt de l'Angleterre et de la France qui, contrairement à l'Espagne qui se projette sur la partie centrale et méridionale de ce double continent, tentent de s'emparer de sa partie septentrionale, à l'exception d'une brève parenthèse constituée par une tentative française de s'installer au Brésil entre 1555 et 1567. Anglais et Français commencent par n'assurer qu'une simple présence commerciale puis se taillent des domaines ouverts à la colonisation. Pour prospecter ce continent, les Anglais envoient en Amérique du Nord l'Italien Sebastiano Caboto (John Cabot) entre 1497 et 1498. Les Français envoient un autre Italien, Verrazzano en 1524, puis un des leurs, Cartier, en 1534. Mais toutes ces tentatives françaises et anglaises ne sont encore que des expédients: elles n'indiquent pas une ligne géopolitique spécifique et bien définie.
Le pouvoir naval anglais trouve ses origines dans les opérations conduites par l'ex-corsaire Sir Francis Drake entre 1572 et 1577. Ensuite, en 1584, Sir Walter Raleigh fonde la colonie de la Virginie, premier foyer de la future Nouvelle-Angleterre. Enfin, à partir de 1600, l'Angleterre se projette au-délà de l'Atlantique Sud et de l'Océan Indien et commence son expansion aux Indes, affrontant d'abord les Portugais, puis les Français.
Pendant une brève période de quelques décennies, le sea power anglais connaît une éclipse, causée par l'expansion outre-mer de la Hollande, qui venait d'arracher son indépendance à l'Espagne.
Les Hollandais, après l'expédition de Willem Barents dans les régions polaires, dans l'intention de trouver un passage maritime par le Nord pour atteindre la Chine, et après une guerre contre l'Angleterre au XVIIième siècle, prennent la même route que les Portugais vers les Indes, s'installent en Indonésie à partir de 1602, chassent les Portugais de Ceylan en 1609, et commencent à coloniser l'Afrique du Sud à partir de 1652. Les Boeren (Boers), terme signifiant “paysans”, sont donc les premiers habitants du pays, car ils s'y installent avant toutes les populations noires-africaines d'aujourd'hui. Toutefois les Hollandais ne renoncent pas à l'Amérique: en 1626, ils acquièrent l'île de Manhattan qu'ils achètent aux Ongwehonwe (les Iroquois) et lui donnent le nom de Nieuw Amsterdam. Les Anglais, en s'en emparant, lui donneront le nom de New York. Enfin, les Hollandais tentent de s'installer entre 1624 et 1664 dans le Nord-Est du Brésil.
Au cours de la seconde moitié du XVIIième siècle, la puissance navale anglaise renaît et la puissance navale française se forme. Toutes deux vont s'affronter. Tant la France que l'Angleterre tenteront une double expansion, vers l'Asie et vers l'Amérique du Nord.
La France en particulier tente de consolider ses possessions canadiennes, à partir de 1603. Ensuite, elle projette ses énergies vers l'Océan Indien, prend le contrôle de Madagascar entre 1643 et 1672, s'empare de l'île de la Réunion en 1654, afin de pénétrer dans le sub-continent indien. Toutefois tant l'Inde que le Canada lui échapperont, en dépit de l'acquisition de la Louisiane en 1682, qui soudait le territoire français d'Amérique du Nord, depuis la Baie de Hudson jusqu'au Golfe du Mexique. La France a dû céder le pas à l'Angleterre qui impose sa suprématie.
Après ce double échec français, l'histoire sera marquée, aux XVIIIième et XIXième siècles par l'expansion maritime de l'Angleterre et par la création de son “empire global”, basé sur le sea power. Comme l'empire britannique était fondé sur le pouvoir naval, son Kernraum n'est pas constitué du Heartland, mais par la maîtrise d'une masse océanique, l'Océan Indien, contre-partie maritime du “cœur du monde” continental.
Guido GIANNETTINI.
00:15 Publié dans Eurasisme, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 octobre 2007
Loi sur la "prohibition"

Loi sur la "prohibition"
20 octobre 1919: Le Sénat des Etats-Unis fait voter la loi sur la prohibition, proscrivant la vente et la consommation de « boissons enivrantes » sur tout le territoire de l’Union.
Cette mesure, dictée par un puritanisme indécrottable, par une volonté maladive d’améliorer l’humanité pour en faire un troupeau atone et docile, engendrera paradoxalement l’essor de la lèpre mafieuse, au départ de la diaspora sicilienne des Etats-Unis, chassée d’Italie par le renouveau apporté par le fascisme de Mussolini. La loi sur la prohibition montre que le puritanisme protestant, en voulant faire l’ange, fait en réalité la bête ; cet esprit borné, qui jette un injuste soupçon sur toutes les propensions de l’homme à s’amuser et se détendre après le travail, est simultanément la source d’une calamité qui, des années 20 à nos jours, n’a fait que s’amplifier, en passant du trafic des boissons alcoolisées, et peu dangereuses, au trafic de drogues plus dures et réellement mortelles pour l’homme, trafics multiples à l’origine de fortunes colossales, de fonds et de dépôts blanchis, etc.
Aujourd’hui, la mafia fait partie des pouvoirs occultes et achète le personnel politique véreux, toujours en quête de fonds. Armin Mohler, le théoricien germano-suisse de la véritable nouvelle droite (ses avatars français n’étant que des imitations boiteuses, dues à la pusillanimité et à l’indécision d’un Alain de Benoist), avait prédit, dès 1981, que l’avenir serait soit à l’enseigne du goulag (mais le communisme et le « goulagisme » dénoncé par Soljenitsyne n’existent plus) soit à celle de « l’agonalité » (en utilisant ce néologisme, Mohler entendait un retour à l’hellénisme d’un Thucydide ou d’un Eschyle) soit à celle de la mafia, état sur lequel nous avons effectivement débouché, les diasporas multiples de l’ère multiculturelle accentuant le tableau jusqu’au paroxysme, jusqu’à la nausée.
Au puritanisme protestant américain s’ajoute désormais le puritanisme wahhabite saoudien, véhiculé dans nos quartiers, dits « défavorisés », par les fameux « imams de garage », couverture « sublime » et religieuse des activités douteuses des mafias diasporiques musulmanes.
01:40 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sull'euro
Robert Steuckers
"L'Euro non sarà una moneta credibile se non quando l'Europa sarà forte e sovrana!"
Intervento di Robert Steuckers in occasione di un colloquio sull'Euro a Paris-Saint-Germain il 13 dicembre 2001 e nel corso di una riunione di Renaissance Européenne a Bruxelles il 20 dicembre 2001
Cari amici,
A meno di tre settimane dall¹introduzione ufficiale dell¹Euro nell'UE, con
l'eccezione del Regno Unito, della Danimarca e della Svezia, vorrei ricordare tre
gruppi di fatti che devono inquadrare ogni pensiero sulla nuova moneta unica, sia
che questa riflessione le sia ostile sia che le sia favorevole.
Io non sono un
economista e il signor Chalumeau, qui tra noi, vi presenterà l'elemento economico
dell¹introduzione dell'Euro con molta più incisività di me. Il mio proposito è
dunque quello di dare qualche idea generale e di richiamare alcuni fatti storici.
1. Innanzi tutto, l'Euro non è la prima moneta a vocazione europea o
internazionale. L'Unione latina, dalla fine del XIX secolo al 1918, introdusse una
moneta sovranazionale condivisa da Francia, Belgio, Svizzera, Grecia, in seguito
da Spagna e da Portogallo, seguite da Russia e da alcuni paesi dell¹America
Latina. La prima guerra mondiale, creando enormi disparità, mise fine a questo
progetto di unificazione monetaria, il cui motore era la Francia con il suo
franco-oro. L'Euro, in questa prospettiva, non è dunque una novità.
2. Sulla base del ricordo dell¹Unione latina e sulla base di volontà, all¹epoca
antagoniste, di creare l¹Europa economica attorno alla nuova potenza industriale
tedesca, l¹idea di creare una moneta per l¹intero continente europeo non è
malvagia a priori, anzi. Il principio è buono e potrebbe favorire le transazioni
all¹interno dell¹area della civiltà europea. Ma se il principio è buono, la realtà
politica attuale rende l¹Europa inadatta, al momento, a garantire la solidità di una
tale moneta, contrariamente all¹epoca dell¹Unione latina, in cui la posizione
militare delle nazioni europee si trovava nel mondo in posizione preponderante.
3. L'Europa è incapace di garantire la moneta che essa oggi si dà, perché essa
subisce un terribile deficit di sovranità. Nel suo insieme, l¹Europa è un gigante
economico e un nano politico: questo paragone è stato ripetuto ad oltranza ed a
giusto titolo. Quanto agli Stati nazionali, anche i due principali Stati del
sub-continente europeo membri dell¹UE, la Francia e la Germania, non possono
pretendere di esercitare una sovranità in grado di resistere o di battere la sola
potenza veramente sovrana del mondo unipolare attuale, vale a dire gli Stati Uniti
d¹America. Le dimensioni territoriali dopotutto ridotte di questi paesi, il numero
limitato della loro popolazione, non permettono di elevare imposte sufficienti per
dotarsi di elementi tecnici, tali da assicurare una tale sovranità. Perché oggi, come
ieri, è sovrano chi può decidere sullo stato di urgenza e sulla guerra, come ci ha
insegnato Carl Schmitt. Ma per essere sovrano, c¹è sempre stato bisogno di
disporre di mezzi tecnici e militari superiori (o almeno eguali) ai propri potenziali
avversari. Al momento attuale, questi mezzi sono rappresentati da un sistema di
sorveglianza elettronica planetaria, come la rete ECHELON, nata dagli accordi
UKUSA (Regno Unito e Stati Uniti) che inglobano anche il Canada, l¹Australia e
la Nuova Zelanda, antichi dominions britannici. Il dominio dello spazio
circumterrestre da parte delle potenze navali anglosassoni decolla da una strategia
lungamente sperimentata: quella che mira a controllare le "res nullius" (i « territori »
che non appartengono e non possono appartenere a nessuno, perché essi non
sono tellurici, ma marittimi o spaziali).
La prima "res nullius" dominata dall¹Impero britannico è stato il mare, dal quale
furono impietosamente eliminati i Francesi, i Russi, i Tedeschi e i Giapponesi.
Sotto l¹impulso ideologico dell¹Ammiraglio Mahan e della "Navy League"
americana, gli Stati Uniti ricevettero la staffetta. Nel 1922, il Trattato di
Washington consacra la supremazia navale anglosassone e giapponese (il
Giappone non sarà eliminato che nel 1945), riducendo al nulla la flotta tedesca
costruita da Tirpitz e ridimensionando le flotte francese e italiana. La Francia
subisce qui uno schiaffo particolarmente umiliante e scandaloso, nel senso che ha
sacrificato un milione e mezzo di soldati in una guerra dalla quale le due potenze
navali anglosassoni vanno a trarre tutti i benefici, con sacrifici in proporzione
minori. La dominazione del mare, prima res nullius, comporterà il controllo di un
altro spazio inglobante, cosa che permetterà di soffocare i continenti, secondo la
"strategia dell'anaconda" (Karl Haushofer).
Quest¹altro spazio inglobante, egualmente una res nullius, è lo spazio
circumterrestre, conquistato dalla NASA e ormai pieno di satelliti di
telecomunicazioni e di osservazione, i quali danno alle potenze che li schierano e li
pilotano una superiorità in materia di informazione e di indirizzo di tiri balistici. Le
potenze che non sono né marittime né spaziali sono allora letteralmente soffocate
e schiacciate dall¹anaconda navale e da quello satellitare. Francesi e Tedeschi
hanno sempre mal compresa l¹utilità delle « res nullius » marittima e
circumterrestre, malgrado gli avvertimenti di un Ratzel, di un Tirpitz o di un
Castex. I popoli fissi sulla terra, che badano a vivere secondo le regole di un
diritto ben solido e preciso evitando ogni ambiguità, difficilmente ammettono che
uno spazio, impalpabile come l¹acqua o come l¹etere atmosferico o stratosferico,
appartenga a qualcuno. Questa qualità contadina, questa preoccupazione del
tangibile che è fondamentalmente onesta, retaggi di Roma, si rivelano delle tare
davanti ad un approccio contrario che privilegia la mobilità incessante, la
conquista delle linee di comunicazione invisibili e non quantificabili da un geometra
o da un agrimensore.
Ecco dunque i tre gruppi di considerazioni che vorrei voi prendeste questa sera in
considerazione.
Spazio circumterrestre e sovranità militare reale
Prima di concludere, mi permetto di sottoporvi alcune considerazioni, questa voltadi ordine storico e monetario. L'Euro ci è stato presentato come la moneta che
farà concorrenza al dollaro ed eventualmente lo eclisserà. Di fronte a questo
gioco di concorrenza, l'Euro parte perdente, perché il dollaro americano dispone
di una copertura militare evidente, come è stato dimostrato dagli ultimi tre conflitti,
del Golfo, dei Balcani e dell¹Afghanistan. L'incontestabile sovranità militare
americana si vede consolidata da un apparato diplomatico ben rodato, in cui non
si tergiversa e non si discute inutilmente e si dispone di un sapere storico ben
strutturato, di una memoria viva del tempo e dello spazio, contrariamente
all¹anarchia concettuale che regna in tutti i paesi d¹Europa, vittime di istrioni
politici scervellati, nella misura in cui non si sentono più di tanto responsabili di una
continuità storica che sia nazionale-statale o continentale ; questa irresponsabilità
sfocia in tutte le fantasie di bilancio, in tutte le capitolazioni, in tutte le svendite.
Atteggiamenti che interdicono lo sbocciare di una sovranità, dunque anche il
diritto regale di battere moneta. La conquista da parte dell¹America dello spazio
circumterrestre dà un enorme vantaggio nella corsa all¹intelligence, come vedremo
tra poco. Ora, dall¹antichità cinese di Sun Tzu, qualsiasi principiante di studi
strategici, dunque di studi politici, sa che la potenza proviene dall¹abbondanza e
dalla precisione dell¹informazione: 1) Sun Tzu: "Se tu conosci il nemico e conosci
te stesso, tu non conoscerai alcun pericolo in cento battaglie". 2) Machiavelli:
"Quali sono le risorse fisiche e psichiche che io controllo, quali sono quelle che
controlla il mio concorrente?". 3) Helmuth von Moltke: "Raccogliere in modo
continuo e sfruttare tutte le informazioni disponibili su tutti gli avversari potenziali".
4) Liddell-Hart: "Osservare e verificare in maniera durevole, per sapere dove,
come e quando potrò squilibrare il mio avversario". Da 2500 anni, il pensiero
strategico è unanime; le centrali strategiche britanniche e americane ne applicano
gli assiomi; il personale politico europeo, istrionico, non ne tiene conto. Dunque
l'Euro resterà debole, fragile davanti ad un dollaro, forse economicamente meno
forte in assoluto o in linea di pura teoria economica, ma coperto da un esercito e
da un sistema di informazioni terribilmente efficace.
Il solo vantaggio dell'Euro è la quantità di scambi interni dell¹UE: 72%. Magnifica
performance economica, ma che nega i principi di autarchia o di autosufficienza,
opta dunque per un tipo di economia « penetrata » (Grjébine) e non protegge il
mercato con strumenti statali o imperiali efficaci. Tali incoerenze portano al
fallimento, al declino e alla caduta di una civiltà.
Altro aspetto della storia monetaria del dollaro: contrariamente ai paesi europei, i
cui spazi sono ridotti e densamente popolati ed esigono dunque una stretta
organizzazione razionale che implica una dose più forte di Stato, il territorio
americano, ancora largamente vergine nel XIX secolo, costituiva in sè, con la sua
semplice presenza, un capitale fondiario non trascurabile, potenzialmente
colossale. Quelle terre erano da dissodare e da organizzare: esse formavano
dunque un capitale potenziale e costituivano un richiamo naturale a degli
investimenti destinati a diventare redditizi. Per di più, con l¹afflusso di immigranti e
di nuove forze-lavoro, le esportazioni americane di tabacco, cotone e cereali non
cessarono di crescere e consolidare la moneta. Il mondo del XIX secolo non era
chiuso come quello del XX secolo e a fortiori del XXI, e consentiva del tutto
naturalmente delle continue crescite esponenziali, senza grossi rischi di riflusso.
Oggi il mondo chiuso non consente più una simile aspettativa, anche se i prodotti
europei sono perfettamente vendibili su tutti i mercati del globo. Il patrimonio
industriale europeo e la produzione che ne deriva sono indubbiamente i vantaggi
maggiori per l'Euro, ma, contrariamente agli Stati Uniti, l'Europa soffre di
un¹assenza di autarchia alimentare (solo la Francia, la Svezia e l¹Ungheria
beneficiano di una relativa autarchia alimentare). Essa è dunque estremamente
fragile a questo livello, tanto più che il suo antico « polmone cerealicolo » ucraino
è stato rovinato dalla gestione disastrosa del comunismo sovietico. Gli Americani
sono assai consapevoli di questa debolezza e l¹ex ministro Eagleburger constatava
con la soddisfazione del potente che “le derrate alimentari erano la migliore arma
dell¹arsenale americano”.
Le due truffe che hanno « fatto » il dollaro
Il dollaro, appoggiato su riserve d¹oro provenienti parzialmente dalla corsa del1848 verso i filoni della California o dell¹Alaska, si è consolidato per un
clamoroso imbroglio che non poteva essere commesso che in un mondo dove
sussistevano degli steccati. Questa truffa ebbe per vittima il Giappone. Verso la
metà del XIX secolo, desiderando aumentare le loro riserve d¹oro per avere una
copertura sufficiente per avviare il processo di investimenti nel territorio
americano dal Mid-West alla California, da poco sottratti al Messico, gli Stati
Uniti si accorgono che il Giappone, volontariamente isolato dal resto del mondo,
pratica un tasso di conversione dei metalli preziosi diverso dal resto del mondo: in
Giappone, in effetti, si cambia un lingotto d¹oro per tre lingotti d¹argento, mentre
dappertutto la regola vuole che si cambi un lingotto d¹oro per quindici d¹argento.
Gli Americani comprano la riserva d¹oro del Giappone pagandola secondo il
cambio giapponese, cioè un quinto del suo valore! L'Europa non avrà la
possibilità di commettere una tale truffa per consolidare l¹Euro. Secondo
imbroglio: la valorizzazione dell’Ovest passa attraverso la creazione di una
colossale rete ferroviaria, tra cui le famose transcontinentali. In mancanza di
abbondanti investimenti americani, ci si appella ad investitori europei,
promettendo loro dei dividendi straordinari. Una volta che le vie e le opere sono
installate, le compagnie ferroviarie si dichiarano fallite, senza rimborsare da quel
momento né dividendi né capitali. Il collegamento ferroviario Est-Ovest non è
costato niente all¹America; essa ha rovinato degli ingenui Europei ed ha fatto la
fortuna di coloro che l¹avrebbero immediatamente utilizzato.
Gli Stati Uniti hanno sempre mirato al controllo della principale fonte di energia, il
petrolio, in particolare concludendo ben presto degli accordi con l¹Arabia
Saudita. La guerra che oggi si svolge in Afghanistan non è che l¹ultimo elemento di
una guerra che dura da lungo tempo e che ha per oggetto l¹oro nero. Non mi
dilungherò sulle vicissitudini di questo annoso conflitto, ma mi limiterò a ricordare
che gli Stati Uniti possiedono sufficienti riserve petrolifere sul proprio territorio e
che il controllo dell¹Arabia Saudita non serve che a impedire alle altre potenze di
sfruttare questi giacimenti di idrocarburi. Gli Stati europei e il Giappone non
possono quasi acquistare petrolio che tramite l¹intermediazione di società
americane, americano-saudite o saudite. Questo stato di cose indica o dovrebbe
indicare la necessità assoluta di possedere un¹autonomia energetica, come voleva
De Gaulle, che scommise sul nucleare (al pari di Guillaume Faye), ma non
esclusivamente; i progetti gaulliani in materia energetica miravano alla massima
autarchia della nazione e prevedevano la diversificazione delle fonti di energia,
puntando anche su quelle eoliche, sulle installazioni maremotrici, sui pannelli solari,
sulle dighe idroelettriche, etc. Se simili progetti fossero di nuovo elaborati in
Europa su vasta scala, essi consoliderebbero l¹Euro, che, ipso facto, non sarebbe
reso fragile da costi energetici troppo elevati.
Altro vantaggio che favorisce il dollaro: l'esistenza del complesso
militare-industriale. Immediatamente prima della guerra del 1914, gli Stati Uniti
erano in debito verso gli Stati europei. Essi fornirono enormi quantità di materiali
diversi, di conserve alimentari, di camion, di cotone, di munizioni agli alleati
occidentali e costoro cedettero le loro riserve passando dallo stato di creditori a
quello di debitori. Era nata l¹industria di guerra americana. Essa dimostrerà la sua
formidabile efficacia dal 1940 al 1945 armando non solo le proprie truppe, ma
anche quelle dell¹Impero britannico, dell¹esercito mobilitato da De Gaulle in
Africa del Nord e dell¹armata sovietica. Le guerre di Corea e del Vietnam furono
delle nuove « iniezioni di congiuntura » negli anni 50, 60 e 70. La NATO, se non
è servita a sbarrare la strada all¹ipotetico invasore sovietico, è almeno servita a
vendere del materiale agli Stati europei vassalli, alla Turchia, all¹Iran e al Pakistan.
L'industria di guerra europea, senza dubbio in grado di fabbricare materiali in
teoria concorrenziali, manca di coordinazione e un buon numero di tentativi iniziati
per collegare gli sforzi europei vengono puramente e semplicemente silurati: io
ricordo che il "pool" europeo dell¹elicottero, che doveva unire la MBB
(Germania), la Dassault e la Westland (Regno Unito) è stato sabotato da Lord
Brittan.
Nel 1944, la situazione è talmente favorevole agli Stati Uniti, grandi vincitori del
conflitto, che viene stabilito un tasso fisso di cambio tra il dollaro e l¹oro: 35 $ per
un¹oncia d¹oro. Nixon metterà fine a questa parità nel 1971, provocando la
fluttuazione del dollaro, il quale, tra lui e Reagan, varierà da 28 a 70 franchi belgi
(4,80 e 11,5 franchi francesi al cambio attuale). Ma queste fluttuazioni, che alcuni
fingevano di avvertire come calamità, hanno sempre servito la politica americana,
hanno sempre creato delle situazioni favorevoli: il dollaro basso facilitava le
esportazioni e quello elevato permetteva talvolta di raddoppiare il prezzo delle
fatture emesse in dollari e di aumentare così i capitali senza colpo ferire. Si può
dubitare che l'Euro sia in grado di dedicarsi alle stesse pratiche.
Ritorniamo all¹attualità: nel 1999, all¹inizio dell¹anno tutto sembrava andare nel
miglior modo per l'Euro. L'inflazione diminuiva negli Stati membri dell¹Unione. I
deficit di bilancio nazionali si riassorbivano. La congiuntura era buona. Gli Stati
dell¹Asia annunciavano che si sarebbero serviti dell¹Euro. Con lo scoppio della
guerra dei Balcani, l'Euro passerà dal cambio di 1 Euro per 1,18 dollari, del 4
gennaio 1999, a 1 Euro per 1,05 dollari di fine aprile, in piena guerra nei cieli
serbi, e a 1 Euro per 1,04 dollari di giugno, nel momento in cui cessano i
bombardamenti sulla Yugoslavia. In tutto, l'Euro avrà perduto l¹11% del suo
valore (il 18% dicono i più pessimisti), a causa dell¹operazione contro Milosevic,
demonizzato dalle attenzioni della CNN.
La guerra del Kosovo ha reso pericolosamente fragile l'Euro
Dopo la guerra del Kosovo, l'Euro, indebolito, acquista la nomea di essere unamoneta da perdenti. L'Europa diviene un teatro di guerra, cosa che diminuisce la
fiducia nelle sue istituzioni, specialmente in Asia. Lo stop dei bombardamenti non
significa la fine delle ostilità nei Balcani e da ciò deriverà una UE impotente a
mantenere l¹ordine nella propria area geopolitica. L'economista tedesco Paul J. J.
Welfens enuncia sei ragioni concrete per spiegare la svalutazione dell¹Euro:
1. Non ci sarà più ripartenza nel Sud-Est del continente se non dopo lungo
tempo. Lo spazio balcanico, aggiungerei, è uno ³spazio di sviluppo
complementare² (Ergänzungsraum) per l'Europa occidentale e centrale, come lo
era d¹altronde già prima del 1914. Una delle ragioni principali della prima guerra
mondiale fu quella di impedire lo sviluppo di questa regione, al fine che la potenza
tedesca e sussidiariamente la potenza russa, non potessero avere « finestre » sul
Mediterraneo orientale, dove si trova il Canale di Suez, da dove i francesi erano
stati cacciati nel 1882. Nel 1934, quando Goering, senza tenere conto del
disinteresse di Hitler, giunge a creare un modus vivendi attraverso degli accordi
con i dirigenti ungheresi e rumeni e soprattutto tramite l¹intesa con il brillante
economista e ministro serbo Stojadinovic, i servizi americani evocano la creazione
de facto (e non de jure) di un "German Informal Empire" nel Sud-Est europeo,
cosa che costituisce un "casus belli". Nel 1944, Churchill perviene a frammentare i
Balcani proteggendo la Grecia, « neutralizzando » la Yugoslavia a beneficio
dell¹Occidente e lasciando tutti i paesi senza sbocco sul Mediterraneo a Stalin e ai
Sovietici, che vengono così totalmente messi nel sacco nonostante il ruolo di
³grandi spauracchi² loro affibbiato. La fine della Cortina di Ferro avrebbe potuto
permettere, a termine, di rifare dei Balcani quello « spazio di sviluppo
complementare » nell¹area europea. Costanti nella loro volontà di balcanizzare
sempre i Balcani, perché essi non divengano mai l¹appendice della Germania o
della Russia, gli Americani sono riusciti a congelare ogni sviluppo potenziale nella
regione per numerosi decenni. L'Europa non beneficerà dunque dello spazio di
sviluppo sud-orientale. Di conseguenza, questo stato di cose rallenterà la
congiuntura e le prime vittime della paralisi delle attività nei Balcani sono la
Germania (guarda caso), l¹Italia, l¹Austria (che aveva triplicato le sue esportazioni
dal 1989) e la Finlandia. L'Euro ne risentirà.
2. I "danni collaterali" della guerra aerea hanno provocato dei flussi di rifugiati in
Europa, cosa che costerà all¹UE 40 miliardi di Euro.
3. L'Europa sarà costretta a sviluppare un "Piano Marshall" per i Balcani, il che
rappresenterà un semestre del budget dell'UE!
4. Le migrazioni interne, provocate da questa guerra e dal deteriorarsi della
situazione, specialmente in Macedonia e in una Serbia privata di un buon numero
delle sue possibilità industriali, porranno un problema sul mercato del lavoro e
aumenteranno il tasso di disoccupazione nell¹UE, mentre proprio questo tasso
elevato di disoccupazione costituisce l¹inconveniente maggiore dell¹economia
dell¹UE.
4. La guerra permanente nei Balcani mobilita gli spiriti, ricorda Welfens, che non
meditano più di mettere a punto le riforme strutturali necessarie all¹insieme del
continente (riforme strutturali che vedono d¹altronde i loro budget potenziali
considerevolmente tagliati).
5. La guerra in Europa innescherà una nuova corsa agli armamenti che poterà
beneficio agli Stati Uniti, detentori del migliore complesso militare-industriale.
6. Noi vediamo dunque che la solidità di una moneta non dipende tanto da fattori
economici, come si tenta di farci credere per meglio rimbecillirci, ma dipende
essenzialmente dalla politica, dalla sovranità reale e non da quella teorica.
Questa sovranità, come ho già detto all¹inizio di questa esposizione, si
fonderebbe, se essa esistesse nella testa dell¹Europa, su un sistema per lo meno
equivalente a quello di ECHELON. Perché ECHELON non serve a guidare i
missili, come una sorta di super-AWACS, ma serve soprattutto a spiare il settore
civile. Nell¹indagine che il Parlamento europeo ha recentemente ordinato sulla rete
di ECHELON, si è potuto constatare decine di casi in cui dei grandi progetti
tecnologici europei (specialmente presso la Thomson in France o presso un
centro di ricerche eoliche in Germania) sono stati curiosamente sorpassati dai loro
concorrenti americani, grazie a ECHELON. L'eliminazione di ditte europee ha
comportato dei fallimenti, delle perdite occupazionali e dunque un arretramento
congiunturale. Come può l¹Europa in queste condizioni consolidare la sua
moneta? Peggio: il vantaggio europeo, questo famoso 72% delle transazioni
interne alla UE, rischia di essere intaccato se delle ditte americane forniscono
prodotti di alta tecnologia a prezzo basso (perché esse non ne hanno finanziato la
ricerca!).
L'Euro è una buona idea. Ma l'UE non è un¹istituzione politica in grado di
decidere. Il personale politico che la incarna è istrionico, si rivela incapace di dare
il giusto ordine alle priorità. In tali condizioni, noi corriamo verso la catastrofe.
12 dicembre 2001
Synergies Europèennes
Ufficio di Bruxelles, 3 febbraio 2002
Tratto dal sito "SYNERGON ON LINE".
01:20 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 octobre 2007
Extraits de l'autobiographie d'A. Mohler
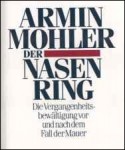
Extraits de l'autobiographie d'Armin Mohler
Pour expliquer ses positions critiques à l'égard de l'historiographie de la République Fédérale, Armin Mohler dans son ouvrage Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung (Heitz und Höffkes, Essen, 1989), évoque quelques péripéties de sa jeunesse. Pour fêter ses 80 ans, nous en donnons une toute première version française à nos lecteurs. Pour les anciens abonnés à Vouloir, cf. Willy Pieters, «Les Allemands, leur histoire et leurs névroses», n°40/42, 1987.
Mes années d'étude: Marx, Freud & Cie
Rétrospectivement, je ne regrette pas la ligne en zigzag qu'a pris mon cheminement à cette époque-là. Elle m'a permis des expériences qui m'ont préservé ultérieurement de tout encroûtement. Pendant quelque temps, je me suis défendu contre cette vision (fort juste) que la vie est faite de paradoxes. Pendant de nombreuses années, j'ai tenté de voiler, de refouler, cette vision pertinente du paradoxal de l'existence qui s'installait pourtant lentement dans mes idées, mes sentiments et mes représentations. Je me suis soumis à une doctrine sotériologique et universaliste qui promettait de liquider tous les paradoxes et de révéler le sens du Tout. Ce fut une expérience qui, au moins, me préserva de fabriquer une autre doctrine sotériologique après m'être débarrassé d'une première.
Cette expérience a commencé quand j'avais seize ou dix-sept ans. Je voulais articuler ma révolte contre l'environnement petit-bourgeois d'une façon “originale”, c'est-à-dire de “gauche”. Ce n'était pas si facile au milieu des années 30. La Suisse était déjà sur la voie de la “démocratie du consensus” (ou plus précisément: la démocratie des cartels). L'époque où la troupe avait tiré sur les ouvriers était passée, cela faisait au moins vingt ans. La couche de la population vivant dans le besoin s'amenuisait et se réduisait graduellement, pour rester confinée aux paysans des montagnes, dans les lointaines vallées alpines. Les associations et les cartels des employeurs et des travailleurs avaient décidé de se partager pacifiquement le gâteau. Sur le plan physionomique, les bosses d'un camp comme de l'autre ne se distinguaient quasiment plus. Dans une telle situation, un marxisme radical serait mort de ridicule, car chaque besoin de la classe ouvrière était satisfait par la création d'une nouvelle association. Un anarchisme radical aurait tourné à vide dans un pays, où, certes, chaque autochtone ressent un malaise, mais où aucun d'eux n'est vraiment opprimé. Personne ne pose des bombes contre soi-même.
S'introduire dans le monde des artistes
Parmi les mésaventures grotesques de mon existence: le fait que cette situation sociale, qui m'a fait fuir la Suisse, me rattrape dans ma nouvelle patrie d'adoption, l'Allemagne de l'Ouest. Des amis allemands, qui se moquent de moi, me posent malicieusement la question: «pensez-vous que certains signes permettent de dire qu'il y a “helvétisation” de la République Fédérale?». Je pense alors que peu avant la seconde guerre mondiale, seule une gauche intellectuelle avait ses chances dans ma patrie suisse. Or cette chance était limitée à un domaine vraiment réduit: la caste des intellectuels, des littérateurs, des artistes avec leurs mécènes issus des classes aisées de la société. C'est justement dans cette caste que je voulais m'introduire: elle me semblait être la porte ouverte sur le vaste monde. En 1938, je m'inscris donc à l'université de Bâle; branche principale: histoire de l'art; branches secondaires: philologie germanique et philosophie.
Juste avant cette inscription, j'avais pénétré dans un nouveau cercle de personnalités, celui des émigrés du Troisième Reich, composés surtout de nombreux Juifs. Les familles juives bien établies à Bâle n'étaient pas trop ravies de cet apport nouveau. Moi personnellement, je me passionnais pour ces Juifs non assimilés. Ils nous apportaient de Berlin un petit reflet des Roaring Twenties, de Prague l'air qu'avait respiré Kafka, de Vienne un zeste de la décadence la plus fascinante de l'histoire récente. Avec les émigrés non juifs, ils prétendaient être “la meilleure Allemagne”. Mais ce furent également des émigrés juifs qui m'ont apporté les premiers éléments philosophiques et esthétiques qui contredisaient mes options libérales. Sur ce chapitre, je m'étais contenté jusqu'alors d'étudier mon très proche compatriote, Carl Spitteler, natif du Baselbiet, le pays rural autour de la ville de Bâle. Spitteler était un poète épique, le seul Suisse qui avait reçu un Prix Nobel de littérature (sans compter Hermann Hesse, qui est un naturalisé). Mais, avec la vague d'émigrés de 1938, la communauté poétique fondée par Stefan George, installée à Bâle avant 1933, s'est trouvée renforcée numériquement, si bien que j'ai appris à connaître dans ce cercle des auteurs comme Rudolf Borchardt, Alfred Mombert, Ludwig Derleth, et même Vladimir Jabotinsky, père fondateur d'un fascisme juif.
Mes intérêts se concentrèrent d'abord sur le plat principal, mitonné par des Suisses et des étrangers, des hommes de gauche, des avant-gardistes et des libéraux, pour être servi à cette gauche culturelle. C'était un savant mélange, parfois assez pertinent, de marxisme, de psychanalyse, de peinture abstraite, de musique atonale, d'architecture du Bauhaus, de films soviétiques, le tout nappé d'une sauce sucrée faite de pathos libéral. De ce côté du front, dans la guerre civile mondiale, on trouvait ce qu'il y avait de meilleur dans les années 30, car on tentait de revalider le marxisme devenu un peu caduc en lui injectant de solides doses de psychanalyse. Wilhelm Reich n'a jamais été qu'un théoricien parmi beaucoup d'autres à avoir eu cette idée. C'était génial: faire entrer en scène de concert, Marx, le mage de la société, et Freud, le mage de l'âme, bras dessus bras dessous. Avec ce couplage, le regard devenu un peu myope que jetait la gauche sur le monde, fut renforcé comme par un effet stéréo. A l'époque aussi je croyais disposer, avec le psycho-marxisme, d'un code universel pour déchiffrer rationnellement le monde. Le tour de passe-passe scientifique, qui permit à cette doctrine sotériologique nouvelle d'entrer en scène, la rendit simultanément irrésistible. Voilà pourquoi, trois décennies plus tard, j'ai eu l'impression de voir des fantômes en République Fédérale quand les soixante-huitards se sont coiffés de ce vieux chapeau (mais, il est vrai, ils le portaient à la façon californienne et non pas à la mode zurichoise).
Nous nous prenions pour de grands réalistes…
Chez les soixante-huitards, j'ai également découvert une arrogance élitaire identique à celle qu'affichaient mes amis avant-gardistes en 1938. Nous aussi avions commencé notre quête en évoquant la “dialectique” et le “refoulement”, nous avions forgé le jargon de notre petite clique pour nous distancier des “masses”. Nous, nous savions “vraiment” ce qui se cachait “derrière” les choses. Une toile constructiviste de Piet Mondrian ne se composait pas seulement de traits droits qui formaient un angle droit, puis s'entrecoupaient, pour séparer agréablement et rythmiquement des carrés ou des rectangles rouges, bleus ou jaunes, le tout sur fond blanc (ce qui peut apaiser un individu hyper-stressé, tout comme un beau tapis). Non, non, ce n'était pas que cette simple géométrie, cela “signifiait” quelque chose. Ce que nous voyions n'était pas l'essentiel, mais ce que nous associions dans l'image. Nous nous prenions pour de grands “réalistes”, mais nous n'étions que des “réalistes des universaux” (et seulement, comme le veut la conditio humana, selon notre prétention).
Beaucoup d'entre nous pensaient avoir entre les mains la clef donnant accès aux énigmes de l'univers. En réalité, nous avions troublé notre regard sur le monde en usant d'un filtre d'abstractions. On devient ainsi la proie facile de ceux qui veulent nous faire gober que le vrai monde un jour viendra, mais dans le futur. Ou on devient la proie d'autres marchands d'illusions (moins nombreux mais plus dangereux) qui veulent nous faire croire que le vrai monde a déjà été, et qu'il est irrévocablement perdu. L'espoir existe, quand on commence à se rendre compte que l'on passe ainsi à côté de sa vraie vie, unique, spécifique et irremplaçable.
Armin MOHLER
(ex: Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung, op.cit., pp. 34-37).
Quand mes premières convictions se sont érodées…
Quand ai-je cessé d'être étudiant de gauche? Je sais du moins le jour où j'ai pris conscience que tout cela était absolument faux: le 22 juin 1941. Toutefois ma conviction que le psycho-marxisme était la clef de l'univers avait déjà été ébranlée.
Je n'étais pas le type prêt à déployer des efforts pendant toute sa vie pour réaliser les lunes de l'universalisme. Dans tous les cas de figure, on peut difficilement évaluer ce que l'on reçoit en héritage avant sa naissance. Personnellement, après ma naissance, j'ai eu de la chance. Mes parents vivaient un mariage heureux. Mon père était un homme discret, mais il possédait une autorité naturelle et incontestée. Ma mère, plus entreprenante, était son complément parfait dans la vie. La maison parentale était une maison où régnait l'ordre, mais elle n'était pas ennuyeuse. Je n'ai pas été gâté. Mes parents n'en avaient pas les moyens. Les petites misères quotidiennes, physiques ou psychiques, n'ont jamais donné lieu à des excitations ou des émotions hors de l'ordinaire: on savait qu'elles faisaient partie du lot de tous les vivants. Ainsi, j'ai hérité d'un état d'esprit que je ne qualifierais pas d'optimisme mais plutôt de “goût pour la vie” (Lebenslust).
Le mouvement frontiste en Suisse
Quand je me suis dégagé du corset des idéologies de gauche, c'est ce goût pour la vie qui a été le moteur principal. Mais ce n'était pas le seul. Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas la droite suisse de l'époque qui a constitué un moteur supplémentaire. Pour autant qu'il y ait eu des groupements qualifiables de “conservateurs” en Suisse du temps de ma jeunesse, et pour autant que ces groupements n'aient pas été édulcorés, ils étaient de nature “patricienne” et/ou catholique. Ces deux fondements m'étaient étrangers. J'étais issu de la petite bourgeoisie, je ne me suis jamais senti chrétien et, au jour de ma majorité, j'ai quitté volontairement l'église réformée, dans laquelle j'avais été éduqué. Le maurrassisme, représenté en Suisse romande, aurait pu m'attirer. Mais le Suisse alémanique a toujours été coupé de la Suisse francophone. En général, il connaît mieux Paris ou la Provence. Pour un garçon comme moi, qui tentait de trouver une voie à droite, il ne restait plus que le mouvement frontiste en Suisse alémanique (c'est-à-dire des mouvements comme le Neue Front, le Nationale Front, le Volksbund, etc.). Ce mouvement était un de ces nombreux mouvements de renouveau qui surgissaient partout en Europe à cause de la crise économique et que les politologues contemporains qualifient de “fascistoïde”.
En 1931, au moment où les fronts connaissaient leur printemps, je n'avais que onze ans, sinon je me serais facilement laisser entraîner par eux. Ce mouvement de renouveau, à ses débuts, pouvait compter sur l'assentiment de nombreuses strates de la population. Il avait été initié par des jeunes loups issus des partis établis, qui voulaient créer quelque chose pour absorber le mécontentement général et la lassitude de la population contre les partis conventionnels. Pourtant, très vite, les fronts suisses ont créé leur propre dynamique. On vit apparaître des similitudes de style avec le fascisme tel qu'il se manifestait dans toute l'Europe mais, à partir de 1933, l'ombre compromettante du Troisième Reich s'est étendue sur le mouvement frontiste. Les représentants des associations de l'établissement, qui participaient à ces fronts, ont rapidement pris leurs distances, dès 1933. Les intellectuels, qui étaient les pendants suisses de la “Révolution Conservatrice” allemande à Zurich ou à Berne, sont resté plus longtemps dans ces formations politiques et ont bénéficié de l'approbation de la Jeunesse dorée qui s'ennuyait. Cependant, lors des exécutions de la Nuit des Longs Couteaux, le 30 juin 1934, à Munich et à Berlin, plusieurs victimes étaient des représentants de la “Révolution conservatrice”; choqués, la plupart de ces intellectuels suisses conservateurs-révolutionnaires quittent la vie publique et se réfugient dans leur tour d'ivoire. Le seul siège frontiste au Parlement suisse est rapidement perdu. Ce qui a subsisté des fronts a été marginalisé par la société libérale avec tous les moyens dont elle disposait. Les chefs les plus modérés se sont repliés sur leur vie privée. Une partie des leaders les plus radicaux se sont réfugiés dans le Troisième Reich pour échapper à la police et à la justice helvétiques. Il n'est plus resté qu'une troupe sans chefs, dont le nombre ne cessait de se réduire: des petites gens, obnubilés par une seule idée fixe, que les francs-maçons et les juifs (dans cet ordre) étaient responsables de tous les maux de la Terre.
Le Major Leonhardt du Volksbund
Une théorie du complot aussi lapidaire n'était pas ce qu'il fallait pour un type comme moi, qui était sur le point de résoudre l'énigme de l'univers. Pourtant, un jour, je me suis hasardé dans l'antre du lion. J'ai assisté à un meeting du plus radical des chefs frontistes, le Major Leonhardt, chef du Volksbund, une dissidence du Nationale Front. (Comme l'armée, à l'époque, était encore une institution sacro-sainte, le fils d'un Allemand naturalisé utilisait ses galons d'officier pour faire de la propagande en faveur du Volksbund). Ce meeting a dû avoir lieu au plus tard en 1939, car j'ai lu dans une thèse de doctorat consacrée au Volskbund, que Leonhardt avait émigré en Allemagne en 1939 et qu'il y a trouvé la mort en 1945 lors d'un raid aérien allié. Extérieurement, il correspondait à son surnom: “le Julius Streicher suisse”. Effectivement, son corps était d'allure pycnique, tassée, il semblait ne pas avoir de cou; il avait le même crâne pointu que Streicher, un crâne qui semblait toujours prêt à l'attaque. Il avait aussi des talents d'orateur comparables, comme j'allais rapidement le constater à mes dépens. Après le discours du Major —sur la Suisse “souillée” par les francs-maçons et les juifs— j'ai osé formuler une remarque. Je ne sais plus aujourd'hui ce que j'ai dit alors. Mais je n'ai pas oublié que le Major Leonhardt a tout de suite repéré que j'étais étudiant. Il m'a directement attaqué ad personam. (Dans la thèse que j'évoquais tous à l'heure, j'ai lu qu'il avait justifié sa rupture et celle de ses ouailles avec le Nationale Front car celui-ci était entièrement tombé sous la coupe des universitaires). Le Major a commencé à me répondre froidement, puis m'a administré une litanie d'injures, d'une voix toujours plus élevée; les insultes successives semblaient s'enrouler autour de moi comme une spirale. Leur contenu approximatif? Le contribuable suisse fait construire des universités avec son argent et qu'en sort-il? Des universitaires étrangers au monde, qui ont appris tant de choses inutiles qu'ils ne savent même plus quels sont les véritables ennemis du peuple! Leonhardt avait bien chauffé son public: les uns me regardaient avec un air narquois, les autres me lançaient des regards haineux; quant à moi, j'étais également échaudé car que peut-on opposer à une telle avalanche d'insultes? Je n'ai revécu de situation semblable qu'à la fin des années 60 et au début des années 70 dans les “discussions” qui avaient lieu à l'époque dans les universités ouest-allemandes.
Mobilisé dans l'armée suisse en 1940
Comme les fronts n'ont nullement contribué à me faire descendre de mon petit trône de libéral de gauche, quelle est alors la force qui m'en a fait descendre? Avec la distance que procure l'âge, je dois bien constater que ma mobilisation dans les rangs de l'armée suisse en 1940 a eu sa part. Le “drill” helvétique de l'époque était encore très rude: mes compatriotes qui ont d'abord servi dans l'armée suisse puis, plus tard, dans la Waffen SS allemande, considèrent que l'instruction dans notre pays était plus dure que celle qui prévalait dans les divisions de Himmler. Avec l'état d'esprit qui était le mien en ce temps-là, j'ai endossé l'uniforme avec des sentiments anti-militaristes. Je n'ai pas été un bon soldat et, à la fin de mes classes de conscrit, mon commandant m'a demandé si je voulais devenir aspirant officier (on le demandait automatiquement à tout universitaire à l'époque). J'ai répondu “non merci!” et je suis resté simple fantassin. A ma grande surprise toutefois, je sentais que certains aspects du service me plaisaient. Ainsi la course avec paquetage d'assaut et fusil me plaisait. Je ne pouvais pas me hisser au-dessus de la barre fixe mais j'étais un bon coureur à pied. Pour un étudiant anti-militariste, ces petits plaisirs peuvent encore se justifier: c'est du sport. Mais, il y avait plus inquiétant pour un pacifiste de gauche: des plaisirs quasi ataviques m'emportaient dans un domaine strictement militaire, notamment le drill. Je ne pouvais pas réprimer une profonde satisfaction quand mon peloton, après des journées d'exercices, faisait claquer ses fusils sur le sol sans “effet de machine à écrire”. (Pour les civils, cela signifie: lorsque les crosses des fusils tombent sur le sol en ne faisant plus tAc-TaC-taC-Tac dans le désordre et sans unisson, mais avec un seul et unique TAC métallique sur les dalles de la cour de la caserne). Quinze jours auparavant, je me serais encore moqué de ces “enfantillages”.
Aller au peuple
Cependant, l'expérience la plus importante de mon service militaire est venue après l'école des recrues, quand je suis passé au service actif et quand j'ai été affecté à la garde de la frontière. On m'avait envoyé dans une compagnie de Schützen (= tirailleurs), composée d'hommes, aptes à porter les armes, issus de toutes les classes d'âge mais aussi, comme habituellement dans l'infanterie, d'hommes venus de tous les horizons de la vie civile. Dans une société hautement spécialisée, l'intellectuel éprouvera des difficultés à faire ample connaissance avec des “gens du peuple”. Il n'existe que deux institutions où il peut le faire, vingt-quatre heures sur vingt-quatre: la prison et le service militaire. Les deux ans de mon service le long de la frontière m'ont beaucoup plus apporté dans ma formation humaine que le double du temps que j'avais passé auparavant dans les universités. (…) Dans cette optique autobiographique, je me contenterai d'une citation, qui résume bien l'affaire. Elle provient de l'œuvre d'un Suisse original, Hans Albrecht Moser (1882-1978); je l'ai tirée de son journal Ich und der andere, paru à Stuttgart en 1962. La voici: «L'humain se trouve plus facilement dans l'homme normal que dans l'homme exceptionnel. C'est pourquoi cet homme normal m'attire davantage. Pour satisfaire des besoins spirituels, il existe des livres».
Découvrir Spengler
Pour ce qui concerne les livres, je m'empresse de dire ceci: j'ai continué à en dévorer, sans discontinuité, et, parmi eux, j'ai surtout lu les grands critiques du libéralisme. Ces lectures ont beaucoup contribué à faire crouler mes palais imaginaires et utopiques. J'avais déjà commencé à lire Nietzsche quand j'étais scout. Pendant mes deux ans de garde le long de la frontière, je suis passé aux autres grands anti-libéraux. L'expérience la plus originale que j'ai eue, c'est en lisant Oswald Spengler. Au sommet de ma période de gauche, j'avais tenté de lire Le Déclin de l'Occident. (Bien sûr, pour apprendre à connaître l'adversaire). Mais je n'étais pas parvenu à franchir le cap des premières pages: pour moi, le texte était absolument incompréhensible. La notoriété de cet ouvrage restait un mystère pour moi, même d'un point de vue thérapeutique. Vers la fin de ma période d'incubation, que je viens de vous esquisser —ce devait être au début de l'année 1941— les deux énormes volumes me sont tombés une nouvelle fois entre les mains. J'ai ouvert le premier à n'importe quelle page et j'ai commencé à lire, sans m'arrêter, et au bout de quelques jours, j'avais entièrement parcouru les deux tomes. Pourquoi n'avais-je pas pu faire la même expérience lors de ma première tentative? Quelque chose d'essentiel en moi avait changé, mais je n'en avais pas encore idée.
Armin MOHLER
(ex: Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung, op.cit., pp. 37-41).
01:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 octobre 2007
José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset
18 octobre 1955: Mort du grand philosophe espagnol José Ortega y Gasset, qui était né à Madrid le 9 mai 1883. Issu d’une famille de journalistes de grand talent, comme il en existait encore à son époque, José Ortega y Gasset, armé d’une solide formation classique reçue dans une école de Jésuites, est fasciné, dès son plus jeune âge, par les forces vivantes qui agissent dans le monde et génèrent l’histoire. Il étudie ensuite en Allemagne, où il apprend la dialectique hégélienne, où il se frotte au vitalisme de Dilthey et de Nietzsche.
De cette formation germanique, José Ortega y Gasset retient, dans le contexte espagnol, l’idée de rénover le pays spirituellement et intellectuellement. Cette option l’éloigne d’un certain catholicisme institutionnel ibérique et le classe dans la catégorie des auteurs et penseurs libéraux, républicains et démocratiques. Mais, à la différence des professionnels de ces obédiences, Ortega, horrifié par la montée au pouvoir du bolchevisme en Russie, demeure, comme Mosca et Pareto en Italie, un « élitiste » au bon sens du terme. La guerre civile qui éclate en 1936 le contraint à l’exil en France, en Argentine, au Portugal et en Allemagne.
Il revient à Madrid en 1945 et récupère sa chaire universitaire en 1949. Il fonde avec son disciple Julio Marias un « Instituto de Humanides », dont l’objectif est de préparer un après-franquisme reposant sur une monarchie constitutionnelle. L’ouvrage le plus connu d’Ortega est « La révolte des masses », où il pose l’opposition fondamentale, dans la sphère politique, non pas entre possédants et démunis, à la mode marxiste, mais entre « masse » et « élite », où la masse, à laquelle peuvent appartenir un banquier inculte, un industriel ignare, un prolétaire abruti ou un ivrogne du « Lumpenproletariat », est dévoreuse d’énergies mais n’en produit aucune qui soit créative. L’élite ne se mesure pas au compte en banque mais au degré élevé des aspirations culturelles et à la volonté de marquer l’histoire. Un ouvrier cultivé fait partie de l’élite. Un banquier ignare fait partie de la masse. La masse est hédoniste, hisse l’hédonisme au rang d’objectif suprême, et fait appel à la machine administrative de l’Etat pour balayer tous les désagréments de la vie.
Il s’ensuit, comme en Belgique actuellement, une hypertrophie de la machine bureaucratique. Toute opposition, tout appel à la raison et au bon sens émanant de personnalités élitaires, sont dès lors considérés comme « inacceptables », comme la manifestation d’intentions méchantes et perverses de briser la course au bonheur final et total (les « derniers hommes » de Nietzsche, « qui clignent de l’œil »). Pour s’opposer à la raison vitale des êtres d’élite, la masse recourt à la terreur, aux procès d’intention, aux condamnations scélérates, à la violence politique. Au bout du compte, nous assistons, comme aujourd’hui en Belgique sous les Verhofstadt, Di Rupo, Onkelinx et autres sinistres personnages, à la mort, à l’assassinat prémédité de la culture populaire et élitaire et de ses formes structurantes, comme les nommait Ortega.
En perdant Ortega, en cette fin octobre 1955, l’Espagne, et avec elle, l’Allemagne (qui était sa patrie spirituelle) et l’Europe, ont perdu sans nul doute l’un des plus grands esprits du siècle ; de surcroît, un esprit capable de s’exprimer, et d’exprimer les plus hautes idées philosophiques, avec un langage clair, abordable, limpide.
01:45 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Charles Quint, Empereur gibelin

Charles-Quint, Empereur gibelin
Les quelques notes qui suivent ici ne sont que les fragments d'une étude beaucoup plus vaste que nous sommes en train de préparer.
La figure et l'époque de Charles-Quint (1500-1558) ont déjà été étudiées et analysées par divers historiens espagnols, argentins, anglais et américains, dont les optiques étaient également diversifiées (libérale, progressiste, marxiste, révisionnisme argentin, traditionalisme espagnol), cependant, un aspect de son règne a été largement sous-estimé, à nos yeux, traité marginalement ou supplanté par tous les autres. C'est la perspective que nous tenterons personnellement de mettre en exergue: celle de Charles-Quint comme Empereur gibelin. Pendant les 12ième et 13ième siècles, l'Occident chrétien est secoué par ce que l'historiographie habituelle et superficielle appelle la “querelle des investitures”; mais, une bonne analyse de cette querelle nous induit à ne pas la considérer comme une simple lutte politique mais comme une guerre de nature fondamentalement spirituelle. Depuis l'époque de Charlemagne, deux pontifes sacrés se partageaient la Terre: le Pape et l'Empereur, qui devaient agir de concert. Ce qui revient à dire que Dieu avait institué deux représentants et que tous deux étaient sacrés. Non seulement l'Eglise, chapeautée par le Pape, était d'inspiration divine, mais aussi le Saint-Empire Romain, personnifié par l'Empereur. Telle était la conception gibeline. Mais à partir du 12ième siècle —avec des antécédents plus tôt dans l'histoire— se déploie la conception guelfe, où l'Eglise commence à nier le caractère sacré de l'Empire et prétend assumer seule le monopole des questions spirituelles. En conséquence, un processus de désacralisation de l'Etat s'amorce qui, par étapes successives, conduira à l'émergence d'Etats nationaux, réduits aux seules dimensions temporelles et étrangers à toute spiritualité. Ce sont les Etats qui dominent actuellement, totalement laïcisés et séculiers. Quant à l'Eglise, qui perd ipso facto le soutien du Saint-Empire Romain, devient exclusivement paulinienne et tombe sous la coupe et le contrôle des monstres qu'elle a elle-même contribué à faire naître.
Quand Charles-Quint entre en scène
Donc l'aspect du règne de Charles-Quint le moins bien traité par les historiens réside dans ses tendances gibelines. Elle se sont manifestées dans le conflit qui l'a opposé au Pape pendant tout son règne d'Empereur du Saint-Empire Romain (1519-1556) et de Roi d'Espagne, dont il hérite de la monarchie en 1517, sous le nom de Charles I. Charles-Quint, en se présentant à sa première Diète Impériale, fut très clair à ce propos. Il a dit: «Aucune monarchie n'est comparable au Saint-Empire Romain, auquel le Christ en personne à rendu honneur et obéissance, mais aujourd'hui cet Empire vit des heures sombres et n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut, mais avec l'aide des pays et des alliances que Dieu m'a donnés, j'espère le ramener à son ancienne splendeur». Le jeune Empereur, dès le début de son règne, déclare son option catholique et gibeline et gardera la même position face à l'église que ses prédécesseurs des 12ième et 13ième siècles.
L'ombre des Empereurs Frédéric
Les Papes de l'époque de Charles-Quint ont vu, sans aucun doute, derrière le nouveau Caesar les ombres de Frédéric Barberousse et de Frédéric II de Hohenstaufen. Par tous les moyens, ils essaieront de bloquer la restauration de l'universitas christiana. Pour arriver à leurs fins, ils utiliseront tantôt une diplomatie tordue, sinueuse, intrigante, traîtresse, un double langage, dans le plus pur style de la “raison d'Etat” exposée clairement par un contemporain, Nicolas Machiavel, tantôt des alliances hostiles à l'Empire et la guerre. Les Papes s'allieront avec la France, berceau du monstre étatique moderne. Dans la foulée, ils favoriseront les menées de l'Empire ottoman, vu que tant le Grand Turc que le Pape étaient les alliés de la France. Rome s'est opposée à tout action énergique de Charles-Quint contre les Turcs et les Luthériens, qui commençaient à se manifester en Allemagne. N'oublions pas que le Saint-Empire Romain à l'époque comprenait l'Espagne et les terres du Nouveau Monde, les Flandres, la Franche-Comté, l'héritage bourguignon, le Nord de l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, Naples, les Allemagnes, l'Autriche, la Bohème et la Hongrie.
Même pendant le règne de Philippe II, son fils, l'Eglise a tenté de s'allier avec les Ottomans. L'opposition du Pape Clément VII au Saint-Empire était telle que Charles-Quint a dû se résoudre à le prendre prisonnier, après l'occupation militaire de Rome par les troupes impériales. Cette capture a été suivie d'un arrangement provisoire et, dès la libération du Pape, Charles-Quint s'est fait consacrer Empereur par celui-ci, devenant de la sorte le dernier souverain du Saint-Empire à avoir été oint par l'Eglise. La politique guelfe de faire obstacle à toute restauration de l'Empire catholique a empêché toute action décisive contre les luthériens. L'Eglise était davantage préoccupée par l'éventuelle restauration politique et l'intronisation subséquente d'un nouveau César, rival potentiel du Pape, que par l'unité du monde catholique. Profitant de l'affaiblissement de l'Empire, dû aux intrigues du Pape, les Turcs ont avancé leurs troupes le long des frontières orientales de l'Empire et envahi la Hongrie, tandis que les Français, leurs alliés, ne cessaient de guerroyer contre Charles-Quint et de soutenir les luthériens, entamant l'Empire sur ses marches occidentales.
La responsabilité de l'Eglise
Charles-Quint a donc dû faire la guerre à quatre ennemis aussi funestes qu'implacables: le Pape, les Turcs, la France et les luthériens. Chacun de ces ennemis de l'Empire était allié à l'autre (la France avec les Turcs et les luthériens, le Pape avec la France, donc, implicitement avec les luthériens et les Turcs, etc.). Cependant, on peut dire que la puissance la plus responsable et la cause première de l'effondrement de l'idée impériale de Charles-Quint a été, sans aucun doute, l'Eglise catholique. S'il y avait eu un accord solide et sincère entre l'Empire et l'Eglise, renforcé par un idéal de spiritualité et de transcendance, où chacune des parties aurait reconnu le caractère sacré de l'autre, comme le voulait le catholicisme médiéval et gibelin, l'Europe (avec ses possessions américaines) aurait pu devenir un Empire catholique. Mais la politique guelfe que Rome a suivie sans discontinuer a empêché l'éclosion d'une Europe bien charpentée par l'institution impériale. Les principes supérieurs ont été sacrifiés aux passions inférieures. De tous ces maux sont issus les Etats nationaux particularistes, la réforme protestante, la perte de l'unité européenne. Quant à l'Eglise, son influence diminuera sans cesse au fil du temps parce qu'elle se sera débarrassé du bras armé de l'Empire, complément traditionnel et indispensable de la caste sacerdotale.
L'Argentine, partie intégrante du Saint-Empire Romain
Aujourd'hui, pour nous Argentins, il s'agit de récapituler cette histoire de l'idée impériale de Charles-Quint et d'en tirer les leçons pour l'Argentine contemporaine. Nous ne devons pas oublier que l'Argentine s'est incorporée à l'Occident chrétien pendant le règne de l'Empereur Charles-Quint. Notre pays est né comme une partie intégrante du Saint-Empire Romain, c'est-à-dire que nous sommes les enfants d'une vocation impériale. Rappelons que l'Empire est la forme de politie qui revendique l'universalité, qui est présidée par une idée transcendante et spirituelle, dont l'objectif est de construire une échelle qui va de la Terre au Ciel, ou, en d'autres termes, de jeter un pont entre ce monde et l'autre monde. La vocation du Saint-Empire n'a donc rien à voir avec les projets purement matériels des impérialismes modernes, fruits des appétits petits-nationalistes et résultats d'intérêts purement matériels et économiques. Pendant le règne de Charles-Quint, Solís découvre le Rio de la Plata, Alejo García entreprend ses voyages d'exploration, Magellan et Elcano font le tour du monde (et tous deux passent plusieurs mois en Patagonie), Diego Gaboto explore les terres qui deviendront celles de notre pays et fonde Sanctus Spiritus, Francisco César réalise son grand voyage, les Espagnols fondent une première fois Buenos Aires, Irala fonde Asunción, etc. Les actes fondateurs de l'Argentine sont donc posés à l'époque de Charles-Quint. Dans d'autres parties de l'Amérique ibérique, les conquistadores conquièrent les Empires aztèque et inca, découvrent la Mer du Sud (le Pacifique).
Le symbolisme de l'or et de l'argent
Nous devons encore attirer l'attention sur quelques autres faits:
La découverte du fleuve qui s'appellera par la suite le Rio de la Plata.
La recherche de la “Cité des Césars” (Ciudad de los Cesares), couverte d'or et d'argent.
Les vieilles légendes médiévales relatives à l'héritage des terres du Saint-Graal, également recouvertes d'or.
Charles-Quint était le Grand-Maître de l'Ordre de la Toison d'Or.
Rappelons ici que la Toison d'Or nous amène à une légende mythologique de la Grèce antique, selon laquelle Jason et ses compagnons partent à la recherche d'une toison d'or pour récupérer un royaume. Si nous associons toutes ses références, nous constatons que notre destin était déjà tracé, même avant la naissance de l'Argentine; il était placé sous les signes symboliques de l'or et de l'argent, métaux nobles symbolisant les âges primordiaux: l'Age d'Or et l'Age d'Argent, la noblesse, la supériorité du sacré et du divin. S'il est vrai que si l'on perd le rumb qui nous ramène à nos origines, alors notre voie est de bâtir un Empire. Le nationalisme argentin ne peut servir que de courroie de transmission pour ce projet universel. Vouloir lui donner une autre destination, c'est le condamner au néant, le conduire sur une voie de garage.
Julián Atilio RAMIREZ.
01:00 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 octobre 2007
Les 8 questions auxquelles A. de Benoist n'a jamais voulu répondre

Les huit questions auxquelles Alain de Benoist n’a jamais voulu répondre…
Fin 1990, début 1991, Alain Benoist me convoque et me soumet un projet. Il voulait que je l’interviewe pour Vouloir ou Orientations, afin de mettre en exergue, par le biais d’un tel entretien, les nouvelles pistes que la Nouvelle Droite était sur le point d’emprunter. Alain de Benoist m’explique que la situation politique et intellectuelle de la France et les mentalités en général ont considérablement changé depuis la naissance de la Nouvelle Droite, plus exactement du GRECE et de la revue Nouvelle école en 1968-69. Dès lors, ajoutait-il, le GRECE ne peut plus véhiculer certains idéologèmes, devenus obsolètes au fil du temps. En revanche, il s’avère impératif d’explorer de nouvelles pistes. Mais cette nouveauté risque de provoquer le désarroi chez d’anciens militants, encore trop prisonniers de schémas dépassés, m’a-t-il précisé. Vouloir ou Orientations sont des revues extérieures au mouvement, elles sont publiées hors de France : elles sont donc le tremplin idéal pour lancer ces nouvelles pistes.
Les arguments d’Alain de Benoist me semblaient judicieux et correspondaient effectivement à mon analyse depuis 1989, où, en juin de cette année, par ma première conférence officielle au GRECE depuis mon retour (1), j’avais réclamé (en vain !) une ouverture aux nouvelles recherches prospectives et fondamentales de la philosophie française. En réclamant cette ouverture, je suivais un conseil d’Armin Mohler, engageant les lecteurs de Criticón à lire les post-modernes français à travers l’analyse de leurs œuvres que proposait, avec un remarquable esprit de synthèse, le professeur allemand Wolfgang Welsch, spécialiste incontesté de ces problématiques. Alain de Benoist a souvent écouté Armin Mohler, recopié ce qu’il disait, béatement paraphrasé ce qu’il énonçait dans le contexte allemand, sauf en ce qui concerne les post-modernes et les synthèses de Welsch, où il n’a pas été le bon petit élève obéissant, mais plutôt le cancre, sourd à tout bon conseil.
J’ai donc, à la demande explicite de de Benoist, composé les questions ci-dessous que je lui ai faxées cinq jours plus tard. Mon objectif en posant ces questions : pouvoir expliciter les mutations idéologiques qui avaient jalonné l’itinéraire intellectuel du GRECE et de son animateur principal. Quand de Benoist a reçu ces questions, il les a tout de suite contestées en montrant une nervosité incompréhensible, il a critiqué des détails sans importance (le fait d’utiliser le terme « dada » pour désigner des engouements philosophiques), il n’a abordé aucune des thématiques de fond, soulevées par mes questions. Lors d’une entrevue quelques semaines plus tard, il a réitéré ces critiques sans me donner d’explications satisfaisantes. De Benoist était dans un état de nervosité bizarre, ses paroles étaient ponctuées de drôles de rictus, ses doigts se cramponnaient à ses longues cigarettes, dont il aspirait la fumée à grosses bouffées. Inutile de préciser qu’il n’a JAMAIS répondu à cette proposition d’entretien, qu’il avait lui-même réclamé ! Pourtant, une brochure avec des réponses claires aurait permis de clarifier les positions de la Nouvelle Droite, d’orienter les militants et les sympathisants de ce courant de pensée. Je soumets aujourd’hui ces questions aux lecteurs de Vouloir. A eux de juger comme il se doit le silence du gourou de la Nouvelle Droite. Un silence plus révélateur que tous ses discours et écrits…
HUIT QUESTIONS A ALAIN DE BENOIST
La Nouvelle Droite: histoire, destin, évolution, ruptures
1. Quand vous avez fondé avec quelques-uns de vos amis les structures qui allaient donner naissance à Nouvelle Ecole puis au GRECE et à la mouvance «Nouvelle Droite», vous étiez animé par un désir de rupture. Une rupture qui tournait le dos à l'agitation politique groupusculaire pour approfondir les fondements, non seulement des sciences politiques, mais de toutes les disciplines humaines. Près de 25 ans après, comment jugez-vous cette rupture qui a décidé de votre destin de «journaliste métapolitique», de «maître-à-penser» d'une génération hostile à bien des compromissions?
2. Il serait peut-être utile aussi que vous nous rappeliez le contexte global de cette époque où vous avez amorcé votre rupture, tant sur le plan philosophique, avec la vogue existentialiste, que sur le plan politique, avec les guerres de décolonisation et du Vietnam. En effet, les jeunes gens des années 70 et 80, a fortiori ceux qui seront la génération des années 90, ont baigné dans des atmosphères intellectuelles et politiques très différentes et certains d'entre eux m'ont déjà exprimé le souhait de connaître les motivations et les sentiments qui accompagnaient les premiers balbutiements de ce qui allait devenir la «Nouvelle Droite»?
3. Votre «démarche rupturale initiale» est contemporaine de mai '68. Dans l'université d'alors, sur le terrain politique, dans les débats intellectuels, quels ont été les facteurs qui ont déterminé vos options, quels sont les clivages qui vous semblaient incontournables et empêchaient tout dialogue avec les «contestataires d'en face». Je pose cette question en sachant très bien qu'il existe aujourd'hui chez beaucoup d'ex-soixante-huitards une volonté très nette de brûler ce qu'ils ont adoré et de dénoncer l'«anti-humanisme» de leur jeunesse. Dans certains de vos écrits récents, vous soulignez, à rebours des « renégats de 68», le grand intérêt intellectuel de certains linéaments philosophiques de cette époque contestataire. Quel jugement pose l'Alain de Benoist d'aujourd'hui?
4. Vous avez posé un pari faustien et prométhéen au début de votre aventure intellectuelle, assorti d'une critique de la sinistrose et du mythe du bon sauvage (notamment dans la forme que celui-ci prenait chez Claude Lévi-Strauss) et d'une apologie du «génie européen». De ce fait, vous avez été accusé de «racisme» par quelques adversaires manichéens, dont les héritiers sévissent encore aujourd'hui. Vous étiez sur la même longueur d'onde qu'un André Reszler lorsqu'il écrivait L'intellectuel contre l'Europe (PUF, 1976). Par la suite, votre pensée semble avoir connu une sorte de retournement: la linéarité quantitativiste du matérialisme occidental, vous avez commencé à la considérer comme un avatar matérialiste de la linéarité judéo-chrétienne. Ipso facto, cette linéarité est devenue en quelque sorte votre «ennemi principal», auquel vous opposez les essences identitaires qu'elles soient européennes ou extra-européennes. Mais dans ce cheminement philosophique, qui est le vôtre, on assiste à une mutation dans votre définition de l'identité européenne: celle-ci ne serait plus exclusivement de nature faustienne/prométhéenne mais autre, c'est-à-dire moins vectorielle, moins progressiste, moins marquée par les linéarités du judéo-christianisme et de ces avatars laïcisés. Pouvez-vous nous préciser cette nouvelle définition de l'identité européenne?
5. Des auteurs comme Robert Muchembled (avec sa distinction entre la «culture des élites» et la «culture du peuple») ou Carlo Ginzburg (avec son analyse des propos d'un meunier frioulan promis au bûcher de l'Inquisition) ont-ils joué un rôle dans l'évolution de votre pensée, partie d'un prométhéisme assez techniciste et quantitativiste?
6. Toujours dans la même optique, vous êtes passé d'un dada philosophique à un autre: en l'occurrence de l'empirisme logique anglo-saxon, introduit en France par l'un de vos maîtres-à-penser, Louis Rougier, pour aboutir à un discours anti-techniciste très marqué par Heidegger. Beaucoup de vos lecteurs n'ont pas compris cette évolution. Généralement, quand ils m'en parlent, je réponds que le «chaînon manquant» dans cette évolution, est peut-être une réflexion sur la pensée de Wittgenstein, qui, au-delà de sa logique rigoureuse, de sa critique des ambiguïtés du langage, n'est pas dépourvue de mysticisme. Réflexion qui, de surcroît, n'a pas été consignée dans un texte majeur de vous-même ou de l'un de vos collaborateurs. Quelle est votre explication? Y a-t-il un lien entre le mysticisme de Wittgenstein et votre engouement pour Heidegger?
7. La «nouvelle droite» est souvent cataloguée dans la mouvance d'un néo-paganisme. Votre critique de la linéarité judéo-chrétienne vous a induit à ouvrir une réflexion sur le temps et l'histoire. En opérant cette réflexion, vous deviez nécessairement aborder les façons non linéaires de saisir temps et histoire notamment les théories cycliques de l'histoire, propres aux cultures traditionnelles. Par ailleurs, à la suite d'Armin Mohler, vous avez parlé de la sphéricité du temps: en clair, dans cette optique, le temps est une sphère et n'est pas vectoriel mais, en revanche, le cycle qu'il parcourt n'est pas répétitif; à tout moment, une direction nouvelle peut être impulsée par la volonté d'un peuple, d'un chef, d'une personnalité charismatique, d'un génie de la pensée, etc. Aujourd'hui, dans vos écrits les plus récents, on aperçoit une influence croissante des auteurs traditionalistes comme Guénon, Evola, Schuon ou Coomaraswamy. Avez-vous renoncé à la théorie sphérique de l'histoire, abandonné l’amor fati de Nietzsche, pour retrouver le silence immobile de la tradition? Votre approche païenne, approche basée sur une option pour le devenir et non pas pour l'être, s'estompe-t-elle, passe-t-elle au second plan?
8. Sigrid Hunke, dans son célèbre ouvrage Europas andere Religion, dont vous avez patronné la traduction française aux éditions Le Labyrinthe, a démontré que l'essence de la religiosité européenne était l'unité du monde, l'unité fondamentale de toutes les choses qui s'exprime la plupart du temps par la mystique. Dans Comment peut-on être païen?, vous embrayé dans ce sens, en critiquant systématiquement les théologies et les pensées de la «césure», des dualismes qui opèrent précisément une césure, en valorisant certaines catégories de choses et de faits et en en rejetant d'autres dans une géhenne d'opprobre, instaurant de la sorte la désacralisation d'une bonne partie du monde, notamment de la vie, de la sexualité, des énergies sourdes qui irriguent les cultures de l'humanité. A la critique hunkienne du dualisme métaphysique, vous avez quelques fois ajouté des éléments très féconds puisés dans la physique non dualiste, dans la logique du tiers-inclus de Stéphane Lupasco et de son disciple Basarab Nicolescu. Aujourd'hui, Jean-Jacques Wunenburger, qui vient de collaborer à votre nouvelle revue Krisis, a élaboré une « raison contradictoire». Comment Alain de Benoist relie-t-il aujourd'hui son option païenne anti-dualiste à la logique lupascienne du tiers-inclus voire à la «raison contradictoire» de Wunenburger?
◊ ◊ ◊
Huit ans plus tard, nous attendons toujours les réponses d’Alain de Benoist…
Notes :
(1) Je ne compte pas mon intervention fortuite lors du Colloque annuel de l’association en novembre 1986, où j’ai été convoqué à mon grand étonnement, vraisemblablement parce qu’on craignait la défection de Faye, qui contestait durement la direction du GRECE, à ce moment ; après cette intervention au colloque de 86, je n’ai plus eu de contacts avec le GRECE jusqu’en mai-juin 1989, période où Charles Champetier m’a demandé de prononcer cet exposé sur la post-modernité de juin 89, à la tribune du « Cercle Héraclite ». J’avais toutefois reçu une lettre de Charles Champetier en juin 1988, me demandant une collection complète de mes publications pour ses archives personnelles. Champetier n’avait pas encore pris contact avec le GRECE. Je l’ai rencontré pour la première fois le 31 juillet 1988 en Suisse, lors d’une assemblée de la Lugnasad, organisée à l’occasion de la fête nationale helvétique. Champetier est ensuite venu à Bruxelles en septembre 88 me demander des conseils sur la voie à suivre. Il a investi la ND, où il n’y avait quasi plus personne, donnant au mouvement d’Alain de Benoist un souffle nouveau. C’est dans le cadre de ses nouvelles fonctions au GRECE que Champetier m’a invité en juin 1989, ainsi qu’en mars 1990, pour un colloque sur le futurisme, avec Jean-Marc Vivenza et Omar Vecchio. Alessandra Colla accompagnait ces exégètes du futurisme. Je n’ai en aucune façon influencé Champetier dans le choix des orateurs. C’est ainsi que j’ai fait connaissance avec la future Présidente du Bureau Européen de Synergies Européennes et avec J. M. Vivenza, grâce, je tiens encore à le préciser, à l’entremise de Charles Champetier et dans le cadre du GRECE. Mais aussitôt après cette manifestation consacrée au futurisme, derrière le dos de Champetier, une campagne de dénigrement systématique a été habilement orchestrée contre Vivenza (un « fou ») et Alessandra Colla (une « dangereuse extrémiste ») et, partiellement, contre moi-même. Champetier a fini par prendre ces ragots pour argent comptant et par perdre son indépendance d’esprit ; il a acquis les réflexes sectaires de l’apparatchik et perdu toute originalité intellectuelle. Pire : il a abandonné ses propres initiatives, le groupe de réflexion IDEE et, un peu plus tard, sa revue, modeste mais pertinente, Métapo. Charles Champetier ne s’est jamais posé de questions sur les raisons pratiques ou psychiatriques qui poussaient son « chef » à colporter des ragots infondés contre certaines personnes (surtout quand elles sont dotées d’un véritable diplôme universitaire ou, même, d’une petite peau d’âne de bachelier !). Un tel comportement empêchait à l’évidence le mouvement de se développer : un tel sabotage systématique est-il le résultat d’une défaillance comportementale ou psychique ou bien, plus subtilement, est-ce une tactique dûment réfléchie et inspirée par certains services ? Trop jeune et finalement fort naïf, Charles Champetier ne s’est apparemment jamais rendu compte de la situation… De même, en ne répondant pas aux questions que je posais (à sa propre demande ! ! !), l’animateur principal du GRECE maintenait son mouvement dans un « flou artistique », permettant toutes les manipulations. De plus, alors qu’il annonçait vouloir rompre avec certains éléments passéistes de son groupe, on constate, dix ans après, que les mêmes olibrius encombrants et ridicules (un ridicule qui tue !) continuent leurs pitreries druidico-avinées, cucu-nazies et pagano-burlesques en marge des discours doctes de de Benoist et Champetier, qui affirment, avec les trémolos de la vierge effarouchée, qu’ils n’ont rien à voir avec le IIIième Reich (ni avec David Mortimerson).
01:55 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (12) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Crise du Yom Kippour

Crise du Yom Kippour
17 octobre 1973: Début de la crise pétrolière consécutive à la guerre du Yom Kippour, où Egyptiens et Syriens avaient tenté de chasser Israël des territoires occupés depuis juin 1967.
L’OPEP, ce jour-là, décide d’exiger l’évacuation par Israël des territoires nouvellement occupés et décrète un embargo sur les livraisons de pétrole aux Etats-Unis. Ce qui est moins connu, c’est que le Shah d’Iran [Mohammad Reza Shah Pahlavi, photo], considéré comme un allié loyal des Etats-Unis, appuie les décisions de l’OPEP, notamment celle d’augmenter les prix du pétrole. Le Shah, en suivant les pays pétroliers, pour la plupart arabes, entend se doter de fonds nécessaires à la « révolution blanche », reposant essentiellement sur un système scolaire moderne, et à la constitution d’une armée perse capable de faire la décision dans la région du Golfe et ailleurs dans la périphérie. Le Shah envisage déjà le lancement d’une politique énergétique nucléaire civile.
Le Shah modernise ensuite l’aviation et surtout la marine iranienne, qui se montre réellement présente dans le Golfe. Cette modernisation de l’armée iranienne, les Etats-Unis ne peuvent l’accepter, car elle se fait à l’aide de matériaux de provenances diverses, sans contrôle possible de la part de Washington. La principale conséquence de la crise déclenchée par l’OPEP a été le changement de donne en Iran, où les Etats-Unis ont soutenu le fondamentalisme islamique contre le Shah, afin de ruiner le pays et de le plonger dans une sorte de « moyen âge » technologique ; aujourd’hui que le régime des mollahs tente de se doter de nucléaire civil, les Etats-Unis se retournent contre leur créature, leur golem de la fin des années 70.
01:50 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



