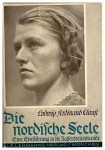L’intera vicenda della sua vita fu frutto di una serie di equivoci, a cominciare dal suo stesso nome, Knut Pedersen, che, come vuole una delle leggende che lo riguardano, a causa di un errore di stampa nella firma apposta in calce ad un articolo giornalistico, venne modificato in Knut Hamsun, da Hamsund, suo luogo d’origine.
I suoi antichi sentimenti filotedeschi (che lo avevano visto schierato con la Germania già nella prima guerra mondiale) e anglofobi («un giorno la Germania castigherà l’Inghilterra a morte, perché è una necessità della natura»), erano largamente condivisi da molti conterranei. La Norvegia era infatti un paese giovane e, come tale, animato da un diffuso nazionalismo (l’autonomia politica dalla Danimarca risaliva soltanto al 1814). Altrettanto forte era l’influenza che il romanticismo tedesco esercitava sulla letteratura europea. Non c’è da sorprendersi, pertanto, se Hamsun guardò con fiducia ad una politica di dialogo (non sempre facile) con la Germania nazista e individuò in Vidkun Quisling, il leader populista che si proponeva di portare la Norvegia all’interno di una grande confederazione germanica, e nel Nasjonal Samling, i suoi interlocutori naturali.
Sarebbe però erroneo e superficiale definire Hamsun, come è stato fatto, tout court uno scrittore fascista. E’ più corretto dire che, come altri intellettuali della sua epoca, è stato “tentato” dal fascismo. O, meglio, che il suo fascismo «non è stato un fenomeno semplicemente politico. Sul piano politico, essi non sono interamente fascisti. […] Il loro fascismo è esistito soprattutto nella loro fantasia di artisti».
Ad affermare questa tesi è stato un professore finlandese, Tarmo Kunnas, che, su tale argomento, ha scritto un bellissimo libro, La tentazione fascista (Akropolis 1981), nel quale approfondisce con scrupolosa serietà le idee di quegli scrittori come Knut Hamsun, Ezra Pound, Pierre Drieu La Rochelle, Louis Ferdinand Céline, Ernst Jünger, Gottfried Benn, Robert Brasillach e Alphonse de Châteaubriant, che guardarono con simpatia alla nascita dei fascismi europei.
Nell’opera, definita da Renzo De Felice «il più bel libro scritto su quel tema difficile e irto di trabocchetti che è il discorso sull’ideologia fascista», sostiene che è stato «l’antidemocraticismo» dei movimenti fascisti ad attrarli, pur nella diversità dei singoli approcci e nelle differenti sensibilità culturali. L’avversione alla democrazia non significa necessariamente, però, condivisione del classismo borghese o del corporativismo fascista. Al contrario «lo spirito antidemocratico di questi intellettuali non esclude comunque una simpatia per il popolo minuto, per la gente più umile».
L’adesione al fascismo di questi artisti non è dettata da contingenze ed opportunità, meno che mai da utilità personali, considerando il prezzo che ognuno di loro ha pagato alla storia scritta dai vincitori. Nella politica credono di trovare lo strumento per affermare un’etica, una concezione del mondo e della vita prefascista, diversa rispetto a quella moderna.
«L’opera letteraria di Hamsun», spiega Kunnas, «riflette una specie di ideale patriarcale della società. Le diverse classi sociali non sono ostili l’una all’altra, sono piuttosto le ideologie del XIX secolo a far nascere una tensione sociale». «Non è forse un fatto che molto, molto tempo fa, gli uomini erano più felici di esistere di adesso?», si domanda lo stesso Hamsun.
La ricerca di Kunnas si pone e pone al lettore una questione: «potevano uomini educati ad una concezione tragica ed eroica dell’esistenza, toccati dal relativismo morale nietzscheano, in rivolta contro lo spirito borghese del tempo, sottrarsi al fascino epocale di quel progetto di trasgressione dei valori meramente sociali e secolari che prometteva, nello sforzo colossale e solenne di una nazionalizzazione delle masse, cattedrali di luce e imperi per un nuovo millennio?».
Con particolare riferimento a Hamsun, ricorda, a chi sostiene che la veneranda età dello scrittore norvegese abbia, per così dire, inciso nelle sue scelte (quasi si trattasse di una patologia o fossero state determinate da un capriccio senile), che lo scrittore «già da giovane era furiosamente antidemocratico. Nel 1893 criticava severamente la democrazia americana, che rappresentava secondo lui la mediocrità e una cultura massificata. Egli pensava che un processo di democratizzazione formasse un vero e proprio pericolo per la cultura europea. Il giovane Hamsun non si entusiasma per la libertà democratica, perché a suo giudizio essa non è che una libertà astratta per la massa, e non una libertà concreta per un vero individuo».
Era convinto che, in un’Europa governata da Hitler, la Norvegia avrebbe conservato e persino rafforzato la propria identità nazionale e reagito ad una decadenza che diversamente sarebbe stata irreversibile. Come scrive Kunnas è proprio «l’idea di decadenza» ciò che è «realmente unificante fra i diversi intellettuali fascisti». «Anche se ciascuno di loro ha visto un po’ alla propria maniera la decadenza della società occidentale, sono stati d’accordo nell’essenziale. Il mondo moderno occidentale è in piena decadenza. Non si tratta semplicemente di una decadenza sociale o politica, ma anche biologica e culturale. E’ lo stesso nucleo della vita che è stato colpito. L’uomo ha perso il contatto con le forze mitiche della vita, con l’istinto, con l’intuizione. E’ interessante constatare come gli scrittori ritenuti pessimisti diventino ottimisti nel momento in cui cominciano a credere in una rigenerazione fascista della civiltà europea».
Knut Hamsun vide nel nazionalsocialismo «una manifestazione della vitalità, di una possibile rinascita della civiltà occidentale minacciata da una democrazia plutocratica e da un comunismo tirannico. Come gli altri, egli ha sognato un nuovo sentimento della vita, autentico, antimaterialistico, che sapesse rispettare anche l’irrazionale e l’istintivo. Egli ha sperato che il fascismo riuscisse a ristabilire le gerarchie naturali, un modo di vita sano, rurale, naturale».
Nelle sue opere c’è l’esaltazione del mondo contadino e della società preindustriale, ancora non corrotta dalle ideologie moderne. Ne Il risveglio della Terra, il romanzo che gli fruttò il Premio Nobel, dà vita al personaggio che rappresenta meglio di ogni altro il suo modello antropologico. Isak, prima ancora di essere un contadino, è un uomo semplice ma non sprovveduto, rude ma non freddo, ostinato e resistente di fronte alle avversità della vita, un uomo disposto a lottare per ciò in cui crede, per la sua famiglia prima di ogni altra cosa. E’ un uomo che vive in sintonia con la natura, che non ha bisogno di consumare per sentirsi appagato. Non è schiavo delle apparenze, non deve necessariamente esibire i suoi sentimenti, è un uomo tutta sostanza, spirituale. Così lo descrive Hamsun nelle prime pagine del romanzo: «Dorme la notte su un letto di legna di pino accatastata; già si sente a casa lì, con un letto di pino sotto la roccia sporgente».
«Se consideriamo l’opera di Knut Hamsun come politicamente sospetta», conclude Kunnas la sua prefazione alla traduzione italiana, «ci troviamo nello stesso momento di fronte ad una tradizione culturale che diventa sospetta» ed è, quest’osservazione dell’intelletuale finlandese, assolutamente condivisibile.
Di certo le simpatie hamsuniane per il nazionalsocialismo non furono motivate da ambizioni personali, né dall’aspettativa di alcun tornaconto, come pure qualche impudente provò ad adombrare. Lo stesso Hamsun, presentandosi davanti ai giudici, rinunciando ad avvalersi di un difensore e senza chiedere clemenza, l’affermò con forza: «Chi osa affermare che io, a quest’età, andassi alla ricerca di onori? Giovani giudici, che avete già pronunciato cinquantamila condanne per collaborazionismo, in una terra di tre milioni di abitanti, volete punire il vostro vecchio poeta nazionale?».
E il termine “punire” si dimostrerà solo un delicato eufemismo. Subì, come gli altri grandi scrittori europei accusati di collaborazionismo, l’avvilente trafila di una penosa pantomima giudiziaria: accuse generiche, processi farsa, senza riscontri, senza prove, le cui sentenze erano già scritte ben prima della conclusione dei procedimenti. «Il tribunale», come ha scritto Luigi De Anna nel “profilo” Le illusioni di un viandante (pubblicato sul numero 8 dalla rivista quadrimestrale di cultura politica Trasgressioni, diretta dal professore fiorentino Marco Tarchi), «aveva già deciso la condanna, o meglio essa era stata già emessa dalla stampa norvegese e da una parte dell’opinione pubblica».
Davanti alla Corte si difese dalle accuse, pur senza fare abiure e rinnegare se stesso, anzi rivendicando di essere sempre stato «onesto e sincero»: «Ciò che io scrivevo non era sbagliato nella sua essenza, e nemmeno era sbagliato nel momento che lo scrivevo. Era giusto ciò che scrivevo e quando lo scrivevo [...] Mi era stato detto che la Norvegia avrebbe occupato un posto eminente nella grande società mondiale germanica in gestazione; chi più, chi meno, allora tutti quanti ci credevano. E anch’io ci avevo creduto. Quindi è chiaro che, scrivendo, dicevo quello che credevo. […] Perché scrivevo? Scrivevo per impedire che la Norvegia, ossia i giovani e gli uomini adulti, si comportassero stoltamente verso la potenza occupante, che la provocassero inutilmente col solo risultato di portare se stessi alla perdizione e alla morte».
Posizione condivisa da altri intellettuali: Pierre Drieu La Rochelle auspicava: «ogni occupazione da parte della Germania doveva mutuarsi in rivoluzione nazionale, ogni rivoluzione doveva costituire un palpito della rivoluzione europea»
Hamsun avrebbe potuto uccidersi, come fece Drieu: «Si, sono un traditore. Sì, ho collaborato con il nemico. Non è colpa mia se quel nemico non era intelligente. Sì, non sono un patriota qualunque, un nazionalista con il paraocchi, sono un internazionalista. Non sono soltanto un francese, ma un europeo. Anche voi lo siete, coscientemente o incoscientemente. Ma abbiamo giocato ed io ho perduto, esigo la morte».
Ma il vecchio norvegese era uomo troppo orgoglioso per farlo e con la coscienza troppo tranquilla. Robert Brasillach venne fucilato, nonostante la mobilitazione in sua difesa di buona parte del mondo culturale francese. Ezra Pound, prima di essere scagionato da ogni accusa, subì per oltre un anno l’onta del manicomio criminale. Ferdinand Céline fu costretto alla fuga e all’esilio. Anche Hamsun avrebbe potuto scappare, «in Svezia, come hanno fatto tanti altri […] Vi avevo molti amici, vi si trovavano i miei grandi e potenti editori […] Senza poi contare che avrei potuto trovare il verso di sgaiattolarmela in Inghilterra, come facevano molti altri. I quali sono poi tornati da eroi, per il fatto che avevano abbandonato il loro paese, per il fatto che se n’erano scappati. Io non feci nulla del genere; io non mi mossi. Una simile fuga non mi sarebbe mai venuta in mente. Credetti di poter servire meglio il mio paese restando dov’ero […] La Norvegia doveva avere un posto eminente fra i paesi germanici europei. […] E mi pareva che, per quell’idea, valesse la pena di faticare, di lottare».
Rispettava «l’autorità giudiziaria» del suo paese, ma «non più in alto» di quanto rispettasse la sua «coscienza del bene e del male, di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto. Credo d’essere abbastanza vecchio per aver diritto a possedere una linea di condotta». Dagli arresti domiciliari venne tradotto in un ospedale psichiatrico e poi in un ospizio, subendo un trattamento indegno, fatto di una esecrabile violenza morale e fisica. Era ormai un uomo vecchio, quasi del tutto sordo, giunto al termine della vita, eppure furono innumerevoli le vessazioni e le umiliazioni che fu costretto a subire nei quattro anni in cui fu privato della libertà, non ultima la curiosità invadente e morbosa di alcuni medici (che si spinsero sino a pretendere informazioni dettagliate sulla sua vita sessuale con la moglie).
Contrariamente a quanto avrebbe voluto, evitò il processo penale perché le sue facoltà mentali vennero certificate come «indebolite». Hamsun si “vendicò” di questo mortificante giudizio scrivendo un ultimo capolavoro, Sui sentieri dove cresce l’erba (l’opera, che contiene tra l’altro l’autodifesa di Hamsun, venne tradotta per la prima volta in Italia nel 1962 per i tipi del Borghese, poi da Ciarrapico, con il titolo Io, traditore e con la bella prefazione di Adriano Romualdi, ed oggi è ripubblicata dall’editore Fazi).
Ma non sfuggì al procedimento civile, che quantificò i danni provocati alla Norvegia (per i suoi articoli politici, sic!) in trecentoventicinquemila corone, spogliandolo così di ogni bene.
Una persecuzione crudele, ben resa nei suoi dettagli da Thorkild Hansen nell’imponente (per documentazione) Il processo Hamsun (1978). Quest’opera è stata «il punto di partenza» del più recente Processo a Hamsun (Iperborea 1996), come ha dichiarato l’autore Per Olov Enquist. Quest’ultimo lavoro era nato come sceneggiatura per il film Hamsun di Jan Troell, interpretato da Max von Sydow e presentato con un discreto successo al Festival di Venezia nel 1996, ma possiede una certa forza letteraria. L’interpretazione dello scrittore svedese, anche se si muove da valutazioni diverse da quelle di Hansen (a differenza del quale giudica «giusto» il processo di Hamsun), è fondamentalmente onesta, sino a riconoscere la buona fede del grande norvegese quando afferma: «personalmente credette di giocare il ruolo di chi vuole salvare la patria». E’ un libro pieno di dettagli, ma mai invadente, anzi è persino delicato quando descrive gli ultimi giorni di vita dello scrittore, la ritrovata complicità con la seconda moglie Marie, condannata anche lei per collaborazionismo.
La colpa di Hamsun? Come scrive Goffredo Fofi nella prefazione, è quella di essere stato un grande scrittore, tanto da aver ottenuto il Premio Nobel per la letteratura nel 1920, e di essere stato (e rimasto) filotedesco fino alla fine dei suoi giorni: «La colpa di Hamsun fu enorme anche per questo, per la sua notorietà, per il fatto che l’autore più amato e considerato del suo paese, orgoglio e vanto della Norvegia, si fosse posto dalla parte dell’occupante».
Subì un vero «processo alle idee», come Diorama Letterario (mensile di attualità culturali e metapolitiche diretto da Marco Tarchi) titolò uno dei due numeri monotematici che ha dedicato, oltre dieci anni fa, allo scrittore norvegese: Il caso Hamsun, un processo alle idee, n. 131 del novembre 1989, e Sui sentieri di Knut Hamsun, n. 121 del dicembre 1988. Il merito di Diorama Letterario è stato proprio quello di aver affrontato con serietà, e con un approccio diremmo “scientifico”, un ampio studio della vita e delle opere di Hamsun, affiancando ad articoli “divulgativi” anche numerosi contributi di “specialisti”, senza scegliere, anzi evitando di percorrere, la scorciatoia del ricorso a facili apologie ad uso di “fedeli”, come nelle cattive abitudini della pubblicistica di destra. L’intento di Diorama non era quello, riduttivo e strumentale, di ribadire la collocazione politica di Hamsun “a destra” e magari di rivendicarne la continuità in una comune battaglia di idee, ma piuttosto di sottolinearne la complessità del pensiero, di offrire maggiori informazioni ed elementi sull’intera opera dello scrittore, al fine di costringere la cosiddetta cultura ufficiale a confrontarsi «con l’uomo, con le sue idee e le sue scelte».
Il modo più efficace per conoscere Hamsun rimane senz’altro quello di avvicinarsi ai personaggi, tutti autobiografici, delle sue opere. Nel 1890 raggiunse il successo letterario, prima ancora di compiere trent’anni di età, con Fame. Il protagonista è un giovane che, in una Oslo che ancora si chiamava Cristania, combatte per affermarsi come giornalista. Per scrivere affronta mille difficoltà di carattere pratico, facendo persino la «fame» e vivendo come un “viandante”. Lo stesso Hamsun, scrisse che così conobbe «l’infinita varietà dei movimenti della mia piccola anima, la stranezza originale della mia vita mentale, il mistero dei nervi in un corpo affamato». E’ il primo dei personaggi hamsuniani, tutti simili nel temperamento. Sono sognatori, uomini selvatici e primitivi, sinceri, imprevedibili, alteri e beffardi, impulsivi e capricciosi, sempre con i nervi scoperti, irrequieti, dispettosi, a tratti fanfaroni, lunatici, infantili, ribelli e impetuosi, dei veri vagabondi animati dalla volontà di liberarsi della civiltà moderna. Vivono a loro agio solo fuori dalla città, a contatto con una natura spesso aspra, ma mai ostile. Sono uomini che non subiscono il fascino delle illusioni moderne, pronti ad innamorarsi di un’idea, di una immagine, di una donna, mai cinici e quasi sprovveduti di fronte all’amore e alle inesorabili disillusioni che la modernità finisce per infliggergli, chiamandoli brusamente ad un’arida attualità. «Sono comete, stelle strappate alla loro orbita», annota Robert Steuckers nel suo contributo su Diorama Letterario. In Pan, il tenente Glahn, protagonista di questo straordinario romanzo (pubblicato per la prima volta nel 1894 e da poche settimane tornato nelle nostre librerie in una bella edizione Adelphi), eroe malato di nordica malinconia, sceglie di lasciare l’uniforme di ufficiale per stabilirsi in una piccola capanna del Nordland, dove la caccia rappresenta il migliore pretesto per godere una solitudine immersa in una natura che sola può donargli un po’ di sollievo, lontana com’è dalla disprezzata società mercantile e industrializzata. Però è proprio nel momento in cui Glahn cede alle lusinghe dell’amore di una ragazza del vicino villaggio, che, come ha efficacemente scritto Luigi De Anna nel richiamato Le illusioni di un viandante, finisce per «cedere alle lusinghe della civiltà. E si perde. Respinto va a cercare la morte in India». E si uccide anche Nagel, il protagonista di Misteri, uomo “tutta anima”, istintivo e intuitivo, complicato e incoerente, pronto a sfidare con il suo ostentato anticonformismo il mondo intero, a scandalizzarlo e a provocarlo. Ma è sufficiente che la dolcissima Dagny, simile a «neve purissima e spessa come seta», di cui si innamora perdutamente, lo respinga, per non trovare più alcun interesse nella vita. Il loro destino è, come ha colto Steuckers, «quello di quei vagabondi che non hanno la forza di tornare definitivamente alla terra o che, per stupidità, lasciano la foresta che li aveva accolti, come fece Hamsun all’epoca del suo breve sogno americano» (dall’esperienza statunitense trasse un saggio, fortemente critico, La vita culturale dell’America moderna, tradotto da Arianna Editrice).
Il drammatico epilogo riservato ai personaggi può essere letto anche come la metafora della vita di Hamsun, grande scrittore e magnifico interprete di una grande tradizione culturale, quale quella neoromantica germanica, fino a quando non cedette alla tentazione fascista. Sempre per rimanere alle intelligenti considerazioni di Kunnas, pagò l’errore di «aver identificato una concezione del mondo con una politica», con un marchio d’ignominia che ancora è ben impresso su ogni sua opera. Non c’è editore o critico, infatti, che al momento della pubblicazione di un romanzo di Hamsun non avverta, ancora oggi, l’esigenza di mettere in guardia l’umanità della “stranezza politica” di cui si ammalò in vecchiaia lo scrittore.
Eppure basterebbe leggere meglio le sue opere, osservare con attenzione i protagonisti dei suoi romanzi muoversi a loro agio nelle foreste del Nord, ascoltare le loro anime insofferenti, per comprendere come Hamsun abbia solo voluto «recare testimonianza a una precisa scala di valori», irrinunciabili per lui.
«La mia unica amica era la foresta», in queste parole di Thomas Glahn, si evince la personalità dell’autore, di questo scrittore norvegese romantico e irrazionalista. «Il poeta dell’irremovibile forza», lo definì Ernest Hemingway. Non può esserci migliore omaggio a questo grandissimo scrittore, di quello che gli rivolse Thomas Mann, suo devoto ammiratore, per “festeggiarne” il settantesimo compleanno: «Lo ho sempre amato, sin dalla mia gioventù […] Gli incanti incomparabili dei suoi mezzi artistici mi ammaliavano già quando avevo diciannove anni e non dimenticherò mai quello che hanno significato allora per la mia recettività di giovanotto Fame, Misteri, Pan, Victoria, le sue novelle e il diario dei suoi viaggi. La gloria mondiale che è ricaduta sul suo nome con l’attribuzione del premio Nobel mi ha riempito di una soddisfazione veramente personale; trovavo che mai esso fosse capitato ad un poeta più degno di averlo […] E’, dicevo, uno di quegli autori la cui lettura fa nascere un riso solitario, scaturito dalle profondità».
E’ alla terra che Hamsun apparteneva intimamente: «Io sono della terra e del bosco con tutte le mie radici. Nelle città vivo solo una vita artistica con Caffè, spiritosaggini e fantasticherie d’ogni specie, ma appartengo alla terra». Quando scrive il libro-testamento Sui sentieri dove cresce l’erba è un uomo sfinito, consumato, eppure non ha smesso di amare la natura, tanto da scrivere: «Quando mi sono stancato di me stesso e sono vuoto, e mi sento inutile, vado nei boschi. Non aiuta, ma nemmeno rende la situazione peggiore. Non posso più, ormai, ascoltare il mormorio degli alberi, ma posso vedere i rami che dondolano, e anche questo è qualcosa di cui essere grati».
E noi che non ci siamo stancati di leggerlo e amarlo e che gli siamo riconoscenti per le splendide pagine di letteratura che ci ha lasciato, lo salutiamo con affetto. Knut Hamsun, lo scrittore contadino, l’uomo che alla terra è tornato, cinquanta anni fa, la sera del 19 febbraio 1952.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg