lundi, 26 septembre 2016
Le journaliste l’ignore, mais les mots ont un sens

Le journaliste l’ignore, mais les mots ont un sens
Dans un essai consacré à la «langue des médias», Ingrid Riocreux s’attaque au langage tel que le pratiquent quotidiennement les journalistes. En analysant les propos tenus et les commentaires, elle parvient à une triste conclusion: faute de maîtriser le langage, les journalistes s’intéressent peu aux faits, ils préfèrent promouvoir des idées.
La Langue des médias est un essai stimulant qui s’attaque résolument au quatrième pouvoir en analysant ce qui fait sa force et sa faiblesse: le verbe. Le langage des journalistes y est disséqué avec précision. Chercheuse associée à la Sorbonne, son auteure, Ingrid Riocreux, s’intéresse d’abord aux mots, à leur contextualisation ainsi qu’à l’énoncé, à la prononciation et aux fautes. Le correcteur qui sommeille chez tout auditeur lui saura gré d’avoir relevé (sa cible préférée est France Info) des «gouvernomon», «Ôrope» et «cor d’heure», sans oublier le «pople palestinien» et le délicieux «rrocourr rrochté». Certaines fois, cette prononciation hasardeuse induit d’admirables lapsus: ainsi, après le référendum sur l’Indépendance de l’Ecosse, on entend que «David Cameron s’est adressé aux cons du oui» (camp).
Elle pointe le mimétisme des journalistes, leurs tics de langage, ce «parler spécifique (vocabulaire, phraséologie, oui, mais aussi prononciation)» étant qualifié de «sociolecte». Certains de ces tics ne nous surprennent même plus:
«On se dirige vers un forfait de Mamadou Sakho.»
«Les frondeurs semblent se diriger vers une abstention.»
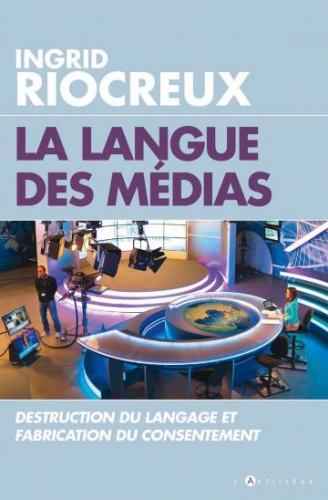 Désormais, une manif ne se disperse plus mais se disloque. Le verbe générer a remplacé susciter, tandis qu’impacter (avoir un impact sur) s’est imposé. On parle de déroulé (et non de déroulement) ou de ressenti (sentiment). Or, regrette-t-elle, cet appauvrissement du vocabulaire conduit parfois à des erreurs. Ainsi des violences qui se font désormais «en marge» des manifestations, alors qu’elles les accompagnent. «En marge» également, les agressions sexuelles de la place Tahrir en Égypte? Pourtant, les violeurs étaient aussi des manifestants.
Désormais, une manif ne se disperse plus mais se disloque. Le verbe générer a remplacé susciter, tandis qu’impacter (avoir un impact sur) s’est imposé. On parle de déroulé (et non de déroulement) ou de ressenti (sentiment). Or, regrette-t-elle, cet appauvrissement du vocabulaire conduit parfois à des erreurs. Ainsi des violences qui se font désormais «en marge» des manifestations, alors qu’elles les accompagnent. «En marge» également, les agressions sexuelles de la place Tahrir en Égypte? Pourtant, les violeurs étaient aussi des manifestants.
On aborde ici l’enjeu politique du langage: «De l’adoption du mot à celle de l’idée, il n’y a qu’un pas.» Ingrid Riocreux note que les journalistes s’approprient aisément des mots et expressions d’origine militante, comme le terme de «sans-papiers», forgé par la «gauche radicale altermondialiste pour en finir avec la force péjorative du mot clandestins». Terme, s’amuse-t-elle, utilisé sans sourciller par… Valeurs actuelles, tout comme ceux de «migrants» ou d’«islamo-fascisme». Le journaliste n’analyse pas les mots mais les reprend à son compte. Il court alors le risque de se tromper:
«On ne parle presque plus de romanichels, de gens du voyage, de bohémiens, de tziganes, de nomades ou de gitans, mais de Roms (même quand ce ne sont pas des Roms).»
Sans doute de manière inconsciente, le journaliste recourt aisément à des qualificatifs qui discréditent celui qu’ils désignent. Invariablement, les médias opposent climatologues et climato-sceptiques. Or, ce dernier terme renvoie à une forme d’incompétence donc d’illégitimité –comme s’il était inconcevable qu’il y ait des climatologues sceptiques.
Des convictions en forme d’évidence
Si l’«eurosceptique» est admis, il en va tout autrement pour l’europhobe. On signifie à la fois qu’un «parti est europhobe (et) qu’il a tort», estime Ingrid Riocreux, pour qui les journalistes distinguent ici «un anti-européisme toléré (Nicolas Dupont-Aignan par exemple) et un anti-européisme nauséabond, qu’on se doit de détester (le Front national)».
Après tout, cette nuance pourrait être légitime si elle était à l’œuvre pour désigner également les partisans de l’Europe. Mais les journalistes se contentent des «europhiles» et ignorent les «eurobéats», considérant que cette dernière tournure est «née dans la bouche des anti-Européens». En fait, les journalistes sont eux-mêmes europhiles (que l’on se souvienne des débats de 2005) car il s’agit pour eux de «la seule posture moralement acceptable.» C’est une «conviction en forme d’évidence» (Alain Minc parlait ainsi du passage à l’euro).
Inconscients ou non, les choix partisans sont multiples. Tandis que le terme «islamophobe» est entré dans le langage courant, celui de «christianophobe» reste marginal. Ou alors fortement nuancé: «Les catholiques espèrent une forte mobilisation contre ce qu’ils appellent un acte christianophobe.» «Madiba», surnom affectueux donné par ses partisans à Nelson Mandela, est utilisé sans la moindre précaution de langage alors qu’il ne viendrait l’idée à personne de parler de Kadhafi comme du «frère guide.»
Des précautions oratoires qui induisent le soupçon
Les précautions de langage s’observent dans tout ce qui touche à l’islam. Evoquant deux faits divers, Ingrid Riocreux analyse les étranges choix rédactionnels qui conduisirent à oblitérer les noms des meurtriers, mais pas ceux de leurs victimes.
En janvier 2010, Hakim est poignardé dans un lycée. Pour désigner le meurtrier, les journalistes recourent à la périphrase: un camarade, l’agresseur, un jeune homme, le suspect… Son prénom, Islam, est révélé par la réinfosphère ou fachosphère –selon le camp dans lequel on se situe. «Le journaliste, en s’évertuant à dissimuler le nom de l’agresseur, n’est ni méchant ni mauvais: il croit bien faire.» En fait, poursuit-elle, il anticipe «constamment la réception de son discours et, partant, l’interprétation qu’en fera l’auditeur».
 Deux ans après, un assassinat similaire survient (le meurtre du jeune Kilian, en juin 2012). Le Monde choisit de désigner le suspect comme un… Vladimir avant de préciser que «le prénom a été changé». S’ensuit un courrier des lecteurs auquel répond le médiateur: il s’agissait de respecter l’anonymat du suspect «conformément à la loi» – argument fallacieux tant cette précaution est rarement respectée par ailleurs.
Deux ans après, un assassinat similaire survient (le meurtre du jeune Kilian, en juin 2012). Le Monde choisit de désigner le suspect comme un… Vladimir avant de préciser que «le prénom a été changé». S’ensuit un courrier des lecteurs auquel répond le médiateur: il s’agissait de respecter l’anonymat du suspect «conformément à la loi» – argument fallacieux tant cette précaution est rarement respectée par ailleurs.
Pour Ingrid Riocreux, ces scrupules sont contreproductifs: «En se refusant à donner une information qu’il estime dangereuse, le journaliste pousse son auditeur à chercher par lui-même et à trouver, non seulement l’information en question, mais un faisceau d’éléments supplémentaires qui vont dans le sens opposé à la position défendue par les médias de masse». D’où la perte de confiance et le discrédit de la profession, régulièrement mesurés dans les sondages.
Le camp du bien
Le langage résulte donc d’un choix politique qui est en général celui que le journaliste estime être le camp du progrès ou du bien. Ingrid Riocreux se refuse à établir une opposition droite-gauche, préférant parler d’une adhésion au sens de l’histoire. «Le journaliste est un croyant (et) sa raison lui dit qu’on ne peut pas aller contre l’histoire.» En témoignent l’utilisation fréquente d’adverbes temporels: déjà, encore, pas encore. Ainsi, le «mariage homosexuel est déjà autorisé dans dix pays» tandis que la peine de mort «est encore légale dans une centaine de pays.» Ce faisant, le journaliste n’informe pas le lecteur ou l’auditeur mais lui dit plutôt «ce qu’il doit comprendre.»
Ni droite ni gauche? Interrogée par Slate.fr, Ingrid Riocreux préfère parler d’un «bain lexical et idéologique: nous sommes tous amenés à prendre position en utilisant tel ou tel mot». Il s’agit de dénoncer «le mythe de la neutralité. Le choix des mots n’est jamais innocent. C’est très bien d’être engagé politiquement mais il faut l’assumer. Ce qui m’embête beaucoup, c’est quand le journaliste prétend ne pas l’être, comme lorsqu’il défend le mythe de la neutralité de la radio du service public».
Employant le terme «manipulation» avec précaution, elle estime que le journaliste est davantage manipulé que manipulateur et lui préfère celui d’«orientation». Le journaliste n’a pas les outils pour décrypter les discours et la rhétorique. L’aisance avec laquelle des personnages politiques se jouent d’interviews mal préparées ou trop révérencieuses le montre aisément.
Le choix d’accompagner ce qu’il est convenu d’appeler le «politiquement correct», dans des domaines aussi différents que l’écologie, l’art contemporain, la politique vaccinale ou éducative, montre également la difficulté d’appréhender ces sujets, voire de les maîtriser suffisamment pour pouvoir bien informer. Pour réhabiliter la méthode syllabique, «trop idéologiquement marquée», il suffit de lui donner son autre nom, moins connu, de méthode explicite. Les journalistes s’en satisferont.
Enfin, le journaliste «n’enquête que sur les gens à qui il veut nuire»: un groupe d’opposants à l’IVG est un sujet à traiter, mais on ne fera jamais d’«infiltration dans un centre du Planning familial». Tout comme on évitera de montrer certaines images trop violentes afin d’en protéger le spectateur: l’IVG, relève-t-elle, est invisible et, comme le foie gras, les «détracteurs seuls (en) montrent les images.» Paresse sélective de l’enquêteur? Certains sujets sont soumis à un «silence médiatique obligatoire», qui irrigue jusqu’au «monde universitaire où il est pourtant de bon ton de critiquer les médias».
«Il ne s’agit pas ici de prétendre qu’enquêter sur les réseaux islamistes ou les groupuscules néonazis soit sans intérêt. La question n’est pas là; ce qu’il faut regretter, c’est le panel restreint et répétitif des sujets traités.»
Les médias en font-ils trop ou pas assez?
A la question, récurrente sur beaucoup de sujets, sorte de marronnier nombriliste, «les médias en font-ils trop?», elle oppose cette assertion: «le journaliste ne se demande jamais s’il n’en fait pas assez».
Décodant un article des Décodeurs consacré à la photo du petit Aylan («Mensonges, manipulations et vérités»), elle montre comment, faute d’une contre-enquête, il en vient à donner du crédit aux rumeurs qu’il entend démonter. Les enfants avaient-ils des gilets de sauvetage? La rumeur prétend que non. Réponse du Monde: «On ne sait pas si les enfants portaient les gilets.»
«Autre argument des complotistes», poursuit le quotidien du soir : «la famille d’Aylan n’était pas une famille de réfugiés politiques mais de réfugiés économiques car ils ne vivaient plus dans une zone de guerre (en Syrie) mais dans un pays en paix (la Turquie). C’est oublier un peu vite que la famille a vécu pendant une longue période en Syrie (native de Kobané, dans le nord de la Syrie, elle vivait depuis quelques années à Damas, avant de fuir les combats)…» Cette réponse, observe Ingrid Riocreux, ne fait que confirmer ce que disent les complotistes, en reformulant leur argumentation de manière positive.
Etablissant un parallèle (osé, pour le moins) avec les enfants noyés dans les piscines où nul cadavre n’est jamais montré, elle affirme que «la photo d’un enfant mort n’est pas informative, elle est injonctive». En fait, la contre-enquête n’en est pas une. Pour les médias, la photo en soi devrait suffire.
La perte de crédit de la profession est sans doute là, dans cet exercice insatisfaisant du métier de journaliste. L’émergence des réseaux sociaux et, surtout, de sources d’information alternatives est pourtant un signal alarmant.
«Faute d’avoir les moyens d’analyser les techniques du discours, nous ne croyons plus rien ni personne. Ni le journaliste ni celui qu’il interroge. […]. Nous accordons une vertu excessive aux sources d’information alternatives. Elles ne racontent pas forcément autre chose mais elles le racontent autrement.» Or, met-elle en garde, «la réinfosphère recourt […] volontiers aux méthodes des désinformateurs qu’elle prétend dénoncer.»
Analyse et polémique
En lisant cet ouvrage, je m’attendais à le voir analysé, critiqué, encensé ou démoli. Il a été étrangement peu commenté. «Je critique les grands médias; il est normal qu’ils ne se précipitent pas pour parler du livre», explique l’auteur à Slate, se disant «plutôt agréablement surprise» de sa réception. A l’exception d’un article à charge de L’Obs (ici, avec réponse d’Ingrid Riocreux ici), d'une critique, intelligente et honnête, dans Vice, c’est plutôt la droite qui s’en empare (Atlantico, Éric Zemmour…). Tenant désormais un blog sur Causeur, Ingrid Riocreux n’écarte pas le risque d’une politisation facile de ses écrits.
À tort. D’abord, la compétence universitaire est indiscutable (agrégation et doctorat), tout autant que la capacité à aligner, donc à décrypter, des phrases incompréhensibles (qu’on lise le résumé de sa thèse), sans négliger un plaisir évident à la joute intellectuelle.
La Langue des médias laisse pourtant une étrange impression. Elle y pose d’excellentes questions, apporte de bonnes réponses mais s’appuie sur des exemples pour le moins polémiques. IVG, climato-scepticisme, mariage homosexuel, l’affaire Méric, islam, migrants…: les sujets qu’elle choisit sont sensibles, ce qu’elle ne peut ignorer. Montrant quel camp choisissent les journalistes (en faveur de l’IVG par exemple), elle décrypte leur discours et observe qu’il tient à déprécier ceux qui s’y opposent.
Est-ce pour Ingrid Riocreux une manière de se protéger en choisissant un angle d’attaque qui, de facto, l’expose à des réactions indignées des journalistes? Lesquels s’exonéreraient alors d’une lecture attentive de son livre? Elle confie à Slate avoir écarté des sujets qu’elle connaît mal (l’économie, par exemple[1]), pour privilégier des «thèmes que tout le monde maîtrise à peu près, ceux dont il est question dans les dîners en famille et qui créent des frictions».
Soutenir une manière d’équité dans le traitement des informations appelle d’importantes réserves. On se souvient de la phrase de Jean-Luc Godard: «L’objectivité, ce n’est pas cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les juifs». Cet apparent équilibre de l’information n’en est pas un. N’est-il pas normal que les médias accordent plus d’intérêt ou de bienveillance à des sujets qui sont devenus la norme, notamment sous une forme législative, même si le débat resurgit parfois?
C’est prendre le risque que le journaliste du «camp du bien» ignore cet ouvrage, alors qu’il devrait le lire, ne serait-ce que pour interroger sa manière de restituer des informations (qu’Arrêt sur images ne l’ait pas même évoqué me laisse pantois). Et ne plus jamais dire à un interviewé cette phrase péremptoire, «Je ne peux pas vous laisser dire cela», alors que, justement, son rôle est de lui faire dire cela.
1 — Et c’est dommage, car il y a aussi matière à étude. Exemple: chaque été, à quelques jours d'intervalle, sont publiées deux études similaires dans leur approche. L'une conclut à un jour de «libération fiscale», l'autre calcule le jour où la planète commence à «vivre à crédit». Dans Le Monde, la première étude est jugée «non sérieuse», avec une longue analyse des Décodeurs, rubrique censée en revenir aux faits. Suffisamment «non sérieuse» pour que le journal y consacre deux articles (en 2014 et 2016), un tweet en 2015 renvoyant à l'article de l'année précédente. En parallèle, l'étude consacrée à la planète trouve un écho favorable, avec un article chaque année (2014, 2015, 2016) qui en retrace les conclusions, avec force schémas. Dans un cas, le calcul n'est pas pris au sérieux; dans l'autre il l'est. Sans autre explication possible qu'un choix éditorial, ou moral. Retourner à l'article
00:05 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalisme, langage des médias, ingrid riocreux, medias, presse, france, manipulations médiatiques, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



