 Critique littéraire et écrivain, Bruno de Cessole a dirigé pendant vingt ans le service culturel de Valeurs Actuelles et, pendant 5 ans, La Revue des deux Mondes. Il a notamment publié L’Heure de la fermeture dans les jardins d’Occident (La Différence, prix des Deux Magots en 2009) et Ben Laden et le salut de l’Occident (La Différence, 2002). Nous l’avons interrogé sur sa conception de la littérature en nous appuyant sur deux de ses essais : Le Défilé des réfractaires (L’Éditeur, 2011) et L’Internationale des francs-tireurs (L’Éditeur, 2014).
Critique littéraire et écrivain, Bruno de Cessole a dirigé pendant vingt ans le service culturel de Valeurs Actuelles et, pendant 5 ans, La Revue des deux Mondes. Il a notamment publié L’Heure de la fermeture dans les jardins d’Occident (La Différence, prix des Deux Magots en 2009) et Ben Laden et le salut de l’Occident (La Différence, 2002). Nous l’avons interrogé sur sa conception de la littérature en nous appuyant sur deux de ses essais : Le Défilé des réfractaires (L’Éditeur, 2011) et L’Internationale des francs-tireurs (L’Éditeur, 2014).
Bruno de Cessole a obtenu le prix Henri Gal de l’Académie française en 2015 pour l’ensemble de son œuvre
PHILITT : Dans votre préface au Défilé des réfractaires, vous tordez le cou, en vous appuyant sur Oscar Wilde, à un lieu commun qui fait du critique d’art un homme incapable de création. Si donc création il y a chez le critique, en quoi consiste-t-elle ?
Bruno de Cessole : C’est en effet un lieu commun et qui a la vie dure que de prétendre que le critique, faute d’être un créateur, se contente de juger la création d’autrui. Ce truisme conserve « toute la vitalité de l’erreur, et le manque de nouveauté d’un vieil ami » pour citer Wilde. L’assertion a été maintes fois répétée, notamment depuis Victor Hugo et Balzac dans le procès intenté par eux contre Sainte-Beuve. À les en croire, le critique serait à l’art ce que l’eunuque est à l’amour… À l’encontre, Oscar Wilde, dans La Critique et l’art et La Vérité des masques soutient, avec un goût de la provocation et du paradoxe qui n’est que le paravent de l’intelligence et de la raison, que l’antithèse entre faculté créatrice et faculté critique est purement arbitraire. À la source de toute création artistique se trouve l’esprit critique, sa faculté de compréhension et de discernement, son intuition de l’omission salvatrice. La création est le plus souvent répétitive ; d’où surgissent, depuis les Grecs, les formes nouvelles si ce n’est de l’esprit critique ? Avec une délicieuse mauvaise foi, Wilde va même jusqu’à assurer que la critique est supérieure à la création puisqu’elle exige infiniment plus de culture, qu’elle suppose la connaissance intime des grandes œuvres du passé. Et qu’il est beaucoup plus difficile de parler d’une chose que de la faire…
En quoi la haute critique – je ne parle pas de la critique journalistique et de la critique professorale, mais de la plus rare, la critique des artistes – est-elle créative ? En ce qu’elle ne se borne pas à analyser l’objet de son étude, à signaler ses défauts ou ses qualités, mais qu’elle cherche à percer le secret même de la création, à mettre en parallèle l’objet d’art et le concept universel de beauté. Le véritable critique comble les vides que l’artiste a laissé dans son œuvre, y perçoit ce dont celui-ci n’avait pas même conscience, et la refait ou la complète. Il doit être à la fois subjectif et partial, et d’un tempérament suffisamment plastique pour entrer en empathie avec les artistes sur lesquels il se penche. Vous m’objecterez peut-être que je trace un portrait idéal du critique, tel qu’il s’est rarement incarné. À quoi je répondrai par des exemples : Diderot, Baudelaire, Sainte-Beuve, Charles du Bos, Rémy de Gourmont, Wilde, Ruskin, Walter Benjamin, Albert Thibaudet, Roger Nimier, Jean Starobinki, George Steiner, Philippe Sollers et, bien sûr, Julien Gracq, qui ont illustré la conception wildienne de la critique : « une création dans la création ». Si la littérature française actuelle se caractérise par un étiage faible, la faute en est au dépérissement de l’esprit critique, vertu autrefois éminemment française et tombée en quenouille.
Vous engagez également une réflexion – cette fois en vous basant sur une boutade d’Antoine Blondin – afin de savoir si la littérature est de droite. Lire l’art à travers le prisme du politique n’est-il pas un écueil très français ?
Antoine Blondin ironisait à propos des maitres censeurs des Temps Modernes qui stigmatisaient les écrivains – en l’occurrence le groupe des Hussards – qui ne croyaient pas au sens de l’Histoire et au devoir de l’engagement, en disant : « ils nous qualifient d’écrivains de droite pour faire croire qu’il existe des écrivains de gauche ! » C’était une boutade, mais elle n’était pas seulement impertinente… Durant l’entre-deux-guerres le critique Albert Thibaudet, qui penchait du côté du radical-socialisme, écrivait dans sa très subjective et savoureuse Histoire de la littérature française que, depuis la Révolution, la pente politique de la France et de la province inclinait à gauche tandis que la littérature et Paris étaient à droite, presque le contraire de la situation actuelle… Thibaudet soutenait même que les plus grands écrivains français, à quelques exceptions près, comme Michelet, Hugo, Vallès et Zola, se situaient à droite voire à l’extrême droite. Sur le plan sociologique et économique, il est vrai que la littérature a longtemps été l’apanage des classes privilégiées, qui n’écrivaient pas pour vivre. Il n’est pas nécessaire, d’autre part, d’exprimer des idées ou un engagement déterminés pour être un écrivain de droite. C’est un tempérament, un style, une sensibilité, plus que des convictions, qui classent un écrivain à droite. Sans généraliser, les écrivains d’idées sont plutôt des écrivains de gauche et les écrivains à style plutôt à droite. À mes yeux, la littérature est le deuil des illusions politiques perdues, la revanche des vaincus de l’histoire, des perdants de la modernité. Elle représente le parti permanent de l’opposition. Le clivage gauche-droite structure la politique et la société françaises depuis la Révolution et c’est une illusion, entretenue par la mondialisation, que de croire qu’il est devenu caduc. Ce n’est pas un écueil mais une singularité française que d’interpréter la littérature à travers le prisme politique. Parce que la France est avant tout une nation littéraire, que son identité politique s’est forgée à travers sa langue et sa littérature, que ses grands écrivains ont exprimé, plus que les politiques, sa vocation et son destin. En ce sens, le déclin politique de la France est inséparable de son déclin littéraire.
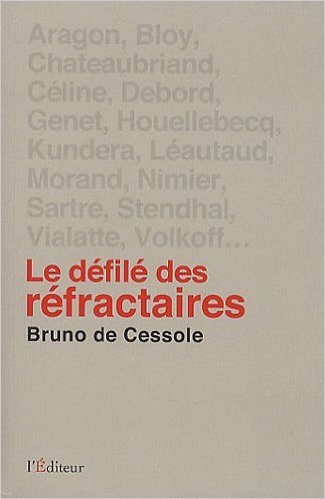 Qu’est-ce qui caractérise les « réfractaires » et les « franc-tireurs » ? Qu’est-ce qui rapproche des écrivains aussi différents les uns des autres ?
Qu’est-ce qui caractérise les « réfractaires » et les « franc-tireurs » ? Qu’est-ce qui rapproche des écrivains aussi différents les uns des autres ?
Dans Le Défilé des réfractaires, portraits choisis d’écrivains français du XIXe et du XXe siècle, j’ai tâché d’appliquer la notion de réfractaire, substantif et adjectif qui s’entend à la fois au sens matériel (un matériau réfractaire est celui qui combine une haute dureté, une faible vitesse d’évaporation et une forte résistance à la corrosion) et au sens psychologique et moral (l’inclination à l’insoumission, la réticence à ployer l’échine ou le genou devant les puissances, la résilience aux consensus…) à une famille d’écrivains que réunissent l’indépendance de l’esprit, du jugement et du comportement. Ce sont des individualistes, plus soucieux de cultiver leur différence que d’approfondir leur communion, qui ont en partage des rejets, des refus et des dégoûts. Hétérodoxes ou hérétiques, ils suivent leur propre voie, quel que soit le prix à payer. Indifférents à l’esprit du temps ou en rébellion contre lui, ils ne cherchent pas à faire école, ne s’adonnent pas au prosélytisme, mais cultivent, à l’écart, une sagesse désabusée ou l’ivresse de la lucidité. Les réunit enfin et surtout le style, cette prérogative des perdants magnifiques. Les francs-tireurs rassemblés dans un second livre, L’Internationale des francs-tireurs, appartiennent à la même famille, mais ce sont des écrivains étrangers, et c’est pour ne pas faire doublon avec le précédent livre que j’ai utilisé le mot de franc-tireur au lieu de réfractaire.
La confusion actuelle entre ce qui relève véritablement de la littérature et le reste est-elle spécifique à notre époque ? Comment se fait-il que nombre de livres ne soient plus, à proprement parler, « écrits » ?
Non, cette confusion existait déjà au XIXe siècle, je vous renvoie aux attaques de Sainte-Beuve contre ce qu’il appelait « la littérature industrielle », une « infralittérature » commerciale, destinée au divertissement du grand public et soutenue par la publicité. Cette tendance s’est développée et accrue au XXe siècle et de nos jours au point que l’on ne sait plus vraiment ce qui relève de la littérature ou des produits du marketing éditorial. Pour ma part, je suis convaincu que le nombre de connaisseurs et d’amateurs de littérature est resté inchangé depuis le Second Empire : un noyau dur entre 3 000 et 8 000 personnes. Au-delà de ce nombre, nous avons affaire à un malentendu. Le problème est que la production littéraire actuelle est dix fois plus élevée qu’à cette époque, si bien que les véritables écrivains peinent à se faire reconnaître et que triomphent les « écrivants », producteurs de livres vite lus et vite oubliés. La pente la plus commode est la pente qui descend, c’est aussi la raison du succès des livres non « écrits ». De cet appauvrissement de la langue, de la réduction du français à un basic french exportable et traduisible partout, la dégradation de l’école et de l’enseignement, le déclassement des « humanités » classiques, sont évidemment les premiers responsables. Avec la volonté politique de tout réduire au plus petit dénominateur commun, d’éradiquer la notion d’héritage et de culture, ces obscènes survivances bourgeoises. Il suffit d’écouter parler nos hommes politiques pour constater le degré d’avilissement de la langue française, que reflète une bonne part de notre littérature.
Croyez-vous à la légende selon laquelle des auteurs à succès comme Guillaume Musso ou Marc Lévy amènent les lecteurs à découvrir de véritables écrivains ?
Il est facile de jeter la pierre aux écrivains qui ont la faveur du grand public, comme ceux que vous citez. La jalousie et le ressentiment sont les sentiments les plus répandus parmi les « mains à plume », et je m’efforce de m’en préserver… Il n’y a pas de succès sans raisons, ils répondent sans aucun doute à une attente des lecteurs. Après avoir lu Musso et Lévy, ceux-ci iront-ils découvrir des écrivains plus exigeants ? Une minorité, peut-être… Mais enfin, toute lecture est encourageante et doit être encouragée. C’est en lisant toutes sortes de livres – y compris des médiocres et même des mauvais – qu’un lecteur forge son goût.
 Pierre-Guillaume de Roux, que nous avions interviewé, évoquait une stratégie d’édition équilibrée. D’un côté, les auteurs à succès, qui permettent de faire tourner la machine et, de l’autre, les auteurs qu’on publie par conviction en sachant qu’ils ne feront pas gagner d’argent. Cette tradition éditoriale est-elle perdue ? Dans quelle mesure les éditeurs sont-ils responsables de l’état actuel de la littérature ?
Pierre-Guillaume de Roux, que nous avions interviewé, évoquait une stratégie d’édition équilibrée. D’un côté, les auteurs à succès, qui permettent de faire tourner la machine et, de l’autre, les auteurs qu’on publie par conviction en sachant qu’ils ne feront pas gagner d’argent. Cette tradition éditoriale est-elle perdue ? Dans quelle mesure les éditeurs sont-ils responsables de l’état actuel de la littérature ?
Le modèle économique de l’édition française explique et justifie cette production double : d’un côté la publication de livres dont l’éditeur peut attendre des ventes significatives mais qui ne relèvent pas de la littérature, de l’autre, la publication d’auteurs qui, pour reprendre la distinction de Gracq, ont un public et peu d’audience, mais qui contribuent à l’image littéraire de la maison. La vocation d’un éditeur digne de ce nom est d’être un passeur, dont l’ambition est de participer à l’élaboration d’un patrimoine littéraire durable, de révéler des talents qui, sans lui, seraient restés inaperçus ou inaboutis. D’un autre côté, il lui faut assurer le rôti de veau mensuel, et donc faire preuve d’opportunisme voire de cynisme, s’il entend poursuivre son activité. En quelques décennies j’ai pu constater que le niveau d’exigence par rapport aux manuscrits avait sensiblement baissé. Il se publie aujourd’hui des livres qui n’auraient pas connu l’honneur d’une publication il y a trente ans, et qui, souvent, n’ont pas fait l’objet d’un véritable travail éditorial. Travail qui, paradoxe, se maintient chez de petits éditeurs qui publient peu et avec discernement.
Les mots « littérature » et « écrivain » sont dévoyés. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’ils signifient pour vous ? En somme, nous rappeler leur noblesse ?
L’imposture étant la reine de notre merveilleuse époque, et la confusion des valeurs étant générale, ces mots glorieux, à force d’être employés à toutes les sauces, et de désigner l’inverse de ce qu’ils sont censés représenter, se sont dévalorisés. Cette dévalorisation est plus sensible en France, nation la plus littéraire de l’Europe, où le prestige de l’écrivain a longtemps été suréminent, et le reste encore un peu. Regardez l’appétence que suscite l’Académie française, chaque fois qu’un fauteuil se libère ; regardez l’envie que provoquent la collection de la Pléiade et la perspective, pour un écrivain, d’être « pléiadisé » de son vivant ; regardez l’importance qui s’attache aux prix littéraires, et notamment au prix Goncourt ; regardez même nos hommes politiques qui rêvent d’ajouter à la légitimité issue des urnes le sacre suprême de la littérature, soit qu’ils signent des livres écrits par des ghost-writers, soit qu’ils s’entourent d’écrivains susceptibles de faire passer leurs actions à la postérité ! Dans le reste de l’Europe et aux États-Unis un écrivain n’est pas davantage considéré qu’un bon plombier ou qu’un honnête employé de banque, sauf s’il gagne beaucoup d’argent, ce qui n’est pas le critère principal de la littérature ni la pierre de touche d’un bon écrivain…
Je vais essayer de résumer en une formule ce que signifie la littérature à mes yeux : la métamorphose d’une expérience individuelle en vérité universelle par le biais d’une écriture qui n’appartient qu’à son auteur. Quant à ce qu’est ou devrait être un écrivain, les noms de Balzac, de Flaubert, de Bloy, de Larbaud, de London, de Proust et de Céline, me viennent spontanément aux lèvres. En quelque sorte, des saints et martyrs de la littérature qui ont sacrifié la vie à l’impératif de l’œuvre. L’écrivain autrichien Thomas Bernhard a magnifiquement dressé le portrait de l’écrivain absolu et dressé l’inventaire des exigences auxquelles il doit répondre : « Ce dont vous avez besoin c’est tout simplement de la vie même, de la beauté et de la flétrissure du monde, du combat intérieur auquel doivent vous mener votre propre faim et votre propre flétrissure […] ce qu’il vous faut ce n’est pas des prix d’encouragement, des bourses ou des assurances sociales ; c’est le déracinement de votre âme et de votre chair, la désolation, la déréliction quotidienne, le gel quotidien, l’impasse quotidienne, le pain pas plus que quotidien, qui ont engendré autrefois des créatures aussi magnifiques et misérables que Thomas Wolfe, Dylan Thomas et Walt Whitman… » Tout est dit…
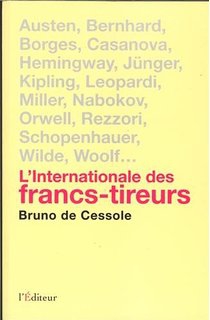 Y-a-t-il une forme littéraire particulière qui vous touche plus que les autres (poésie, théâtre, roman, épopée) ?
Y-a-t-il une forme littéraire particulière qui vous touche plus que les autres (poésie, théâtre, roman, épopée) ?
Tout dépend du moment et, parfois, du lieu. Il est des heures où ma préférence va à la poésie, d’autres où le roman s’impose, certaines où j’ai envie de théâtre. La littérature est un banquet qui excède l’appétit du lecteur le plus vorace. Cela dit, j’aime particulièrement les livres inclassables, qui transgressent les genres et les catégories usuelles de la littérature, comme les Vies imaginaires de Marcel Schwob, les recueils d’aphorismes de Lichtenberg ou de Cioran, les Papiers collés de George Perros, les Petits traités de Pascal Quignard, les livres de W. Sebald, les journaux-essais de Jean Clair…
Y-a-t-il encore aujourd’hui des écrivains qui trouvent grâce à vos yeux ? Pouvez-vous en évoquer un ou deux et dire pourquoi ils retiennent votre attention ?
Prétendre que le paysage littéraire actuel est un désert relève d’une vision partiale ou fausse. Comme tout phénomène vivant, la littérature passe par des phases de vitalité et de stagnation. Nous ne sommes pas dans une période d’apogée, certes, comme durant l’entre-deux-guerres ; nous ne pouvons même pas nous flatter d’un renouvellement des formes littéraires, même s’il fut formaliste et finalement stérile, comme dans les années 1960 avec l’école du « Nouveau Roman ». Cela dit, les bons écrivains ne manquent pas, qui expriment dans une langue à nulle autre pareille un univers à eux. Je me contenterai de citer, Milan Kundera, Pascal Quignard et Richard Millet, au risque d’être injuste envers d’autres.




 Passer des écrits d’Ernst Jünger sur la Première Guerre mondiale à la lecture de son journal parisien, tenu entre 1940 et 1944, peut surprendre. Que reste-t-il alors de l’officier héroïque de 1918 ? Que reste-t-il de celui qui célébrait avec une dimension mystique sa plongée dans la fureur de la guerre des tranchées ? Que reste-t-il encore de cette expérience combattante qui fit de lui un des officiers les plus décorés de l’armée allemande ? Au cours de ces 20 années, l’homme a incontestablement changé. De son Journal parisien, ce n’est plus l’ivresse du combat qui saisit mais, tout au contraire, l’atonie confortable de la douceur de vie parisienne. S’y exprime la sensibilité d’un homme qui ne semble avoir conservé du soldat que l’uniforme. La guerre y semble lointaine, étonnamment étrangère, alors que le monde s’embrase. L’homme enivré par le combat, le brave des troupes de choc a désormais disparu. L’écrivain semble traverser ce terrible conflit éloigné de toute ambition belliqueuse, porté par cet esprit contemplatif qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie. Celui du poète mais aussi de l’entomologiste, l’homme des « chasses subtiles » comme il appelle lui-même ses recherches d’insectes rares. Et c’est encore, non pas en soldat, mais en naturaliste qu’il semble percevoir, dans le ciel de la capitale occupée, les immersions subites et meurtrières de la guerre. Ainsi, quand il observe, une flûte de champagne à la main, les escadrilles de bombardiers britanniques, la description qu’il en fait prend davantage la forme de celle d’un vol de coléoptères que de l’intrusion soudaine d’engins de morts, prêts à lâcher leurs bombes sur la ville.
Passer des écrits d’Ernst Jünger sur la Première Guerre mondiale à la lecture de son journal parisien, tenu entre 1940 et 1944, peut surprendre. Que reste-t-il alors de l’officier héroïque de 1918 ? Que reste-t-il de celui qui célébrait avec une dimension mystique sa plongée dans la fureur de la guerre des tranchées ? Que reste-t-il encore de cette expérience combattante qui fit de lui un des officiers les plus décorés de l’armée allemande ? Au cours de ces 20 années, l’homme a incontestablement changé. De son Journal parisien, ce n’est plus l’ivresse du combat qui saisit mais, tout au contraire, l’atonie confortable de la douceur de vie parisienne. S’y exprime la sensibilité d’un homme qui ne semble avoir conservé du soldat que l’uniforme. La guerre y semble lointaine, étonnamment étrangère, alors que le monde s’embrase. L’homme enivré par le combat, le brave des troupes de choc a désormais disparu. L’écrivain semble traverser ce terrible conflit éloigné de toute ambition belliqueuse, porté par cet esprit contemplatif qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie. Celui du poète mais aussi de l’entomologiste, l’homme des « chasses subtiles » comme il appelle lui-même ses recherches d’insectes rares. Et c’est encore, non pas en soldat, mais en naturaliste qu’il semble percevoir, dans le ciel de la capitale occupée, les immersions subites et meurtrières de la guerre. Ainsi, quand il observe, une flûte de champagne à la main, les escadrilles de bombardiers britanniques, la description qu’il en fait prend davantage la forme de celle d’un vol de coléoptères que de l’intrusion soudaine d’engins de morts, prêts à lâcher leurs bombes sur la ville.


 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg