
samedi, 14 février 2026
Dresde 1945 : Quand la gauche pouvait encore pleurer

Dresde 1945 : Quand la gauche pouvait encore pleurer
Par Karel Meissner
(12 février 2026)
Source: https://www.compact-online.de/dresden-1945-als-linke-noch-trauern-konnten-2/
Ce fut précisément Ulrike Meinhof (photo) qui écrivit en 1965, avant de devenir une criminelle dans les rangs de la RAF, un essai étonnant pour la revue marxiste/gauchiste Konkret sur le bombardement de Dresde. Ses successeurs d’aujourd’hui le qualifieraient probablement sans hésiter de diffamatoire et d’extrême droite. Avec le récit publié par COMPACT « Dresde 1945. Les morts, les coupables et les minimisateurs », nous commémorons les victimes et combattons les mensonges. En savoir plus ici: https://www.compact-shop.de/shop/kriegsende/dresden-1945/...
Ulrike Meinhof commence son texte, intitulé « Dresde », de manière très factuelle et sobre:
« Il y a vingt ans, le 13 et 14 février 1945, dans la nuit du Mardi Gras au Mercredi des Cendres, le plus grand bombardement aérien de la Seconde Guerre mondiale sur une ville allemande fut effectué: l’attaque contre Dresde. La ville fut bombardée trois fois en 14 heures ».
Pour donner au lecteur une petite impression de cette horreur:
«Lors du départ des bombardiers anglais, ils ont laissé derrière eux une mer de flammes qui a fait briller le ciel sur plus de 80 kilomètres».
Sans qu'on ne puisse la soupçonner de manipulation, la rédactrice de Konkret à l’époque écrit:
«Plus de 200 000 personnes ont péri dans les flammes de Dresde».
Aujourd’hui, écrire cela serait considéré comme un sacrilège, mais à l’époque, de tels propos étaient encore tout à fait innocents, et, pire, Meinhof cite l’historien britannique qui était encore très respecté à l’époque, David Irving: «Pour la première fois dans l’histoire de la guerre, une attaque aérienne a détruit une cible de façon si dévastatrice qu’il n’y avait pas assez de survivants indemnes pour enterrer les morts».
Meinhof est extrêmement prudente concernant le nombre d’habitants au moment au moment du bombatfrmrny, touit comme le nouvel essai qui vient de paraître dans COMPACT et s'intitule «Dresde 1945. Les morts, les coupables et les minimisateurs»:
«Lorsqu’elle a été détruite, cette ville comptait plus d’un million d’habitants. On estime qu'elle avait une population variant entre 1,2 et 1,4 million. Il y avait en outre des réfugiés de Silésie, de Poméranie et de Prusse orientale, des évacués de Berlin et de la Rhénanie, des transports d’enfants, des prisonniers de guerre et des travailleurs étrangers. »
Meinhof poursuit: «Dresde était considérée dans toute l’Allemagne comme une ville qui ne serait pas bombardée. Elle a été déclarée ville-hôpital pour les soldats blessés et marquée par d’énormes symboles de la Croix-Rouge sur les toits».

Le manteau du mensonge
Harris et ses compagnons, commanditaires des bombardements, devaient avoir pressenti que quelque chose de terrible allait se produire. Ils ont donné l’ordre de tuer délibérément. Meinhof:
«On n’a pas dit la vérité aux soldats anglais qui ont effectué les attaques. On a dit: votre flotte attaque le commandement suprême de l’armée à Dresde. On a dit que Dresde était un centre de ravitaillement important pour le front de l’Est. On a dit qu'une des cibles de l’attaque était un quartier général de la Gestapo situé dans le centre-ville, une usine de munitions importante, une grande usine de gaz toxique».
Et elle va plus loin. Meinhof dévoile la supercherie. La rumeur dit que le poisson pourrit par la tête :
«C’est le gouvernement britannique, sous son Premier ministre Sir Winston Churchill, qui, jusqu’à la fin de la guerre, en mars ’45, a réussi à garder secret le véritable caractère intentionnel et planifié des bombardements britanniques sur les villes allemandes. Dresde était le point culminant de cette politique».
Alors que, lors de chaque occasion, des chefs d’État allemands s'agenouillent dans la poussière devant des étrangers pour s’excuser des injustices faites à leur peuple, il n’y a toujours pas d’excuses du côté britannique. Même la reine, qui cache pudiquement ses ancêtres allemands – les Battenberg ex-allemands sont devenus les Mountbatten (*) –, n’a pas prononcé un mot de repentance envers le peuple allemand.
Meinhof en parlait déjà en 1965: «Le fait que le mot Dresde n’ait pas été prononcé lors des funérailles de Sir Winston Churchill suggère que Dresde devrait encore être imputée au peuple qui a été trompé lui-même».
(*) Et les Saxe-Cobourg (Sachsen-Coburg) sont devenus les "Windsor".

21:37 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hisoite, dresde, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, ulrike meinhof |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 août 2025
Le plus grand vol de tous les temps: les brevets allemands tombent entre les mains des États-Unis

Le plus grand vol de tous les temps: les brevets allemands tombent entre les mains des États-Unis
Stephanie Eckhardt
Source: https://dissident.one/de-grootste-roofoverval-aller-tijde...
"Après la guerre, les États-Unis ont volé des centaines de milliers de brevets allemands, sans lesquels leur ascension au rang de puissance mondiale aurait été pratiquement impossible, et ont kidnappé nos meilleurs inventeurs. L'un d'entre eux en particulier est entré dans l'histoire", écrit Stephanie Eckhardt.
Des réalisations scientifiques et des inventions techniques qui ont changé le monde : les Américains étaient eux aussi conscients du génie allemand et ont commis en 1945 l'un des plus grands vols de leur histoire en s'emparant de la propriété intellectuelle de chercheurs et de penseurs allemands.
Des milliers de techniciens ont dû traverser l'océan
Le Reich allemand était de loin supérieur à tous les autres pays dans les domaines scientifique et technologique. Entre 1900 et 1945, il a reçu pas moins de 47 prix Nobel, dont la plupart en physique, chimie et médecine (parmi lesquels Max Planck, Werner Heisenberg, Robert Koch et Wilhelm Conrad Röntgen). Il disposait en outre d'une incroyable richesse en matière de recherche innovante et de procédés industriels.
La nuit et dans le brouillard
Décembre 1943: dans l'obscurité et la neige mouillée, des soldats de la Wehrmacht aident le Bureau des brevets du Reich à cacher des dossiers secrets à Heringen, en Hesse. Ils conservent les documents dans un puits de mine de sel de plus de 500 mètres de profondeur et empilent d'innombrables fûts de produits chimiques dessus. Ce trésor contenait au moins 250.000, voire 320.000 inventions ; les hommes transportèrent 180.000 documents supplémentaires en Basse-Silésie, au monastère de Striegau et dans la ville de Jauer.
Avril 1945: des milliers de soldats américains et de spécialistes américains fouillèrent les usines allemandes à la recherche de machines et d'inventions techniques et confisquèrent les trésors cachés à Heringen. Par mesure de précaution, une équipe américaine microfilma les brevets : le papier risquait de se désagréger et il y avait des centaines de milliers de pages qui ne pouvaient pas être transportées rapidement. Ils chargèrent ensuite les dossiers dans des wagons de marchandises et les expédièrent aux États-Unis, avec plus de 145.000 dossiers de brevets incomplets provenant de l'autorité centrale de Berlin. Enlèvements : les Américains emmenèrent des milliers d'ingénieurs et de scientifiques allemands outre-Atlantique afin qu'ils utilisent les machines, pour la plupart inconnues, et poursuivent leurs recherches.

Ce fut le pillage d'une nation vaincue
Ce pillage comprenait également des développements militaires allemands tels que des armes nucléaires, des missiles, des avions à réaction et des sous-marins. Comble de l'audace, le président américain Truman s'est attribué le mérite du travail d'autrui : « Nous avons inventé la bombe atomique », a-t-il menti dans un discours télévisé après les attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, passant sous silence les travaux fondamentaux d'Otto Hahn (photo). Le lauréat du prix Nobel de 1944 a été qualifié de « père de la chimie nucléaire » et est l'un des scientifiques les plus importants du 20ème siècle.
Un butin considérable
Les pillards américains ont fouillé des centaines de milliers de documents secrets précieux, dont voici quelques exemples :
- Contrairement aux ampoules américaines, les tubes en fibre de porcelaine dite « lourde » sont indestructibles et peuvent produire mille watts.
- Des bandes magnétiques en plastique, métallisées à l'oxyde de fer, avaient déjà remplacé les disques gramophone en Allemagne.
- Des appareils de vision infrarouge permettant aux voitures de rouler dans l'obscurité à n'importe quelle vitesse. Ils pouvaient détecter tout obstacle à 200 mètres, les chars pouvaient repérer des cibles lointaines et les tireurs embusqués pouvaient viser dans l'obscurité totale.
- Des condensateurs électriques sophistiqués, dont des millions étaient nécessaires pour l'industrie du radar et de la radio : les Allemands les avaient fabriqués à partir de papier recouvert de zinc vaporisé, ce qui les rendait 40 % plus petits et 20 % moins chers que ceux de la concurrence, et en outre pratiquement indestructibles. En cas de panne, le revêtement s'évaporait et isolait le papier. Le condensateur se réparait ainsi tout seul et fonctionnait, même en cas de dysfonctionnement, à une tension 50 % supérieure à celle de tout autre appareil disponible sur le marché mondial. Pour les experts américains, cette invention allemande semblait relever de la magie.
- Une longue série de processus chimiques pour la production de carburants synthétiques, de caoutchouc, de textiles et de cuir synthétique, ainsi qu'un procédé révolutionnaire de traitement des métaux, appelé « procédé d'éjection à froid », utilisé par exemple pour les cadres de radio. Auparavant, les Américains devaient les produire en plusieurs étapes à l'aide d'une machine à découper, perforer des trous et les ajuster, tandis que les Allemands réduisaient le temps de production de mille fois avec une seule presse. Ce petit secret de fabrication a à lui seul révolutionné l'industrie métallurgique aux États-Unis.
- Une multitude d'instruments de précision et de brevets dans les domaines de la chimie, de la physique et de l'électronique ont fait entrer les Américains dans la course au dollar, à l'instar de Picsou. Jamais auparavant ni depuis lors ils n'avaient vu une telle collection de spécifications de fabrication secrètes pour les combustibles liquides et solides, la métallurgie, les produits chimiques, les plastiques et les peintures.
- Les découvertes dans les domaines de la médecine et de l'alimentation n'étaient pas moins révolutionnaires. Les Allemands avaient déjà mis au point une technologie avancée de conservation et de congélation pour nourrir les équipages de leurs sous-marins, qui allait rapporter des milliards à l'industrie alimentaire. Les pillards américains ont également exploité les secrets des pharmacologues et des médecins allemands pour produire du plasma sanguin synthétique et de nouveaux médicaments.
Les hommes d'affaires américains se sont jetés comme des vautours sur les brevets après que le président Truman les ait rendus publics. La Bendix Corporation, dans l'Indiana, a racheté le changeur automatique de disques, Pillsbury a mis la main sur toute la production allemande de farine et de pain, la Kendall Manufacturing Company s'est enthousiasmée pour nos insecticides et une société pionnière de l'Iowa, la Hi-Bred Corn Company, voulait tout ce que les chercheurs de l'université agricole de Hohenheim avaient découvert. Pacific Mills a réclamé le produit d'IG Farben, qui peut être utilisé pour rendre le rayonne imperméable et infroissable, et la Polaroid Company a repris les inventions de Zeiss. En bref, les inventions allemandes ont rapporté des profits incommensurables aux fabricants américains. À titre de comparaison, les dommages considérables subis par l'Allemagne ne peuvent être quantifiés à ce jour.


La Lune est allemande
Les voleurs de Truman s'intéressaient toutefois surtout à la technologie aéronautique et spatiale allemande, en particulier à son leader, Wernher von Braun. « La fusée V2 qui a bombardé Londres », selon une publication de l'Army Air Force, « n'était qu'un jouet comparé à ce que les Allemands avaient encore dans leur sac ». À la fin de la guerre, l'Allemagne avait 138 types de fusées en cours de développement et de production. La fusée A-4 de Wernher von Braun (photo), qui devait être produite en série, mesurait 14 mètres de long, pesait plus de douze tonnes, pouvait atteindre une altitude de 100 kilomètres et une vitesse maximale de plus de 5000 kilomètres à l'heure. Son secret résidait dans un moteur à oxygène liquide. En d'autres termes, un bombardier à longue portée capable de voler de l'Allemagne à New York en 40 minutes, ce qui aurait permis à l'armée de l'air d'attaquer Moscou à l'avenir.


À la fin de la guerre, les Allemands avaient mis au point 138 missiles.
Mai 1945 : les experts allemands sont interrogés par les Américains à Garmisch-Partenkirchen – ces derniers s'intéressent exclusivement à la technologie des missiles, et non au passé nazi des experts. Wernher von Braun lui-même ne vint toutefois pas en Haute-Bavière et fut emmené en juin 1945 à Witzenhausen, dans le nord de la Hesse, où les Américains avaient également transféré les ingénieurs en fusées de Thuringe avant que cette région ne tombe sous occupation soviétique, comme convenu lors de la conférence de Yalta. Von Braun resta sous étroite surveillance avec Walter Dornberger et d'autres ingénieurs jusqu'à ce qu'ils soient tous emmenés par les Yankees aux États-Unis en septembre 1945 (opération connue sous le nom d'Opération Overcast).
Au Texas, ils étaient sous la surveillance de l'armée américaine. Au début de l'année 1946, plus d'une centaine d'ingénieurs en fusées avaient été amenés par avion pour transmettre leurs connaissances aux Américains. Lorsque Wernher von Braun a voulu rendre visite à sa famille en Allemagne en 1947 et s'y marier avec sa fiancée, il a été placé sous surveillance militaire permanente. Il se maria dans son pays natal en mars 1947, mais lui et sa femme durent ensuite retourner outre-Atlantique.
 Von Braun resta aux États-Unis ; il n'y avait pas de retour possible. Il fit considérablement progresser le programme spatial américain et la technologie des fusées, était responsable de plus de 1000 employés en 1953 et obtint la nationalité américaine en 1955. Il développa d'autres fusées, telles que la fusée Jupiter (photo, ci-contre) à moyenne portée avec des munitions à guidage de précision et une portée de 2410 km.
Von Braun resta aux États-Unis ; il n'y avait pas de retour possible. Il fit considérablement progresser le programme spatial américain et la technologie des fusées, était responsable de plus de 1000 employés en 1953 et obtint la nationalité américaine en 1955. Il développa d'autres fusées, telles que la fusée Jupiter (photo, ci-contre) à moyenne portée avec des munitions à guidage de précision et une portée de 2410 km.
En juillet 1958, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a été fondée sous la direction de von Braun et de son équipe. Ils ont permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois un astronaute dans l'espace. Wernher von Braun a convaincu le président américain John F. Kennedy de travailler à un alunissage et a construit pour lui la fusée Saturn V, le lanceur nécessaire à cette fin. En juillet 1969, la mission Apollo 11 a permis aux premiers hommes de voler vers la Lune. « La Lune est américaine », titrait alors le journal Bild. Mais, en réalité, elle est allemande !
14:56 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, brevets allemands, wernher von braun |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 septembre 2024
Tucker Carlson et le syndrome Churchill

Tucker Carlson et le syndrome Churchill
Nicolas Bonnal
Tucker Carlson discutant avec Darryl Cooper a dit courageusement que les conséquences de la victoire anglo-saxonne en 1945 ont été mauvaises pour nous – et pour les peules anglo-saxons, grand-remplacés et soumis à la tyrannie mondialiste-néo-communiste-antiraciste-écologiste ; et en même temps il a découvert le syndrome Churchill (voir le texte de McDonald sur Unz.com): c’est la rage d’anéantir le monde « pour en faire un lieu sûr pour la démocratie ». On a vu les résultats de l’intervention de Wilson en 1917-18: destruction de l’Europe encore chrétienne, impériale ou traditionnelle, avènement non des cosaques et du Saint-Esprit mais des bolchéviques et du communisme, et surtout préparation de la guerre suivante comme le devina Bainville (qui avait aussi pressenti «l’incendie à venir lié au sionisme», voyez mes textes). Un auteur italien traduit par notre ami Robert Steuckers, parlant de la nuisance anglaise, a parlé de retour de Grand Jeu dans ces préparatifs de guerre terminale contre la Russie. Je dirais qu’on a plutôt affaire au syndrome Churchill.
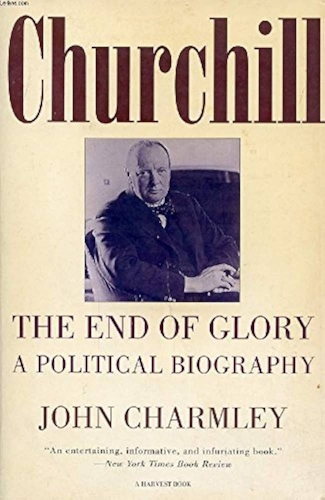
Churchill est l’homme politique le plus nul possible (voir le livre de John Charmley) sur le plan pratique, et qui ne se sentait à l’aise que dans des guerres totales et d’extermination contre les Allemands, qui étaient la cible de l’époque. Or sur ordre des néo-cons, beaucoup plus inspirés par Churchill que par Strauss, les hommes politiques nuls ou même obscènes que nous avons en Occident veulent se lancer dans une guerre éternelle de type orwellien contre la Russie ; dans l’espoir que ces chefs de guerre insensés seront célébrés par des foules toujours plus abruties. Ils oublient que Churchill fut jeté dehors par ses électeurs british en 1945, preuve sans doute que la satisfaction n’était pas à la hauteur des aspirations du chéri des journalistes.On va citer le capitaine Grenfell, auteur de Haine inconditionnelle, ami du romancier à clefs John Buchan, sur les buts aberrants de Churchill, car ce pseudo-conservateur se mit à déifier le stalinisme pour écraser l’hitlérisme (qui lui avait proposé dix fois la paix).
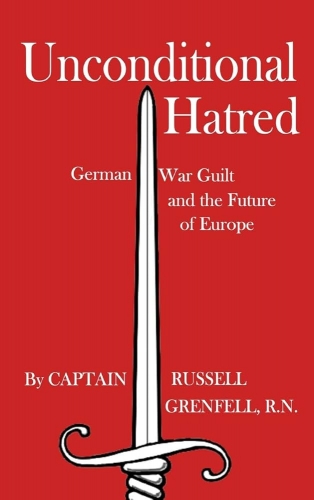
Je cite la traduction de mes amis du Saker francophone :
« Mais, en supposant que la suppression par la force des tyrannies dans des pays étrangers constituât le devoir des Britanniques, pourquoi trouvait-on une autre tyrannie, partenaire des Britanniques dans ce processus? La tyrannie communiste, en Russie, était pire que la tyrannie nazie en Allemagne ; les conditions générales de vie du peuple russe étaient largement inférieures à celles des Allemands ; le travail de forçat en Russie était employé à grande échelle, en comparaison à la même pratique sur le sol allemand, la cruauté n’y avait rien à envier à celle du côté allemand, et de nombreux observateurs la décrivent même comme bien plus importante.
La technique répugnante des purges, des interrogatoires brutaux amenant à “confession”, et l’espionnage domestique généralisé était déjà à l’œuvre en Russie depuis des années avant qu’Hitler n’introduise ces mêmes méthodes en Allemagne, qu’il copia probablement de l’exemple russe. Mais M. Churchill encensait la Russie comme allié des plus bienvenus, quand elle se trouva embarquée dans la guerre. »

Plus loin Grenfell souligne le bilan effrayant et ruineux de cette guerre pour l’Angleterre :
« Il s’était montré prêt à tout sacrifier pour parvenir à cette victoire, et les sacrifices consentis par lui laissèrent ses co-vainqueurs britanniques à moitié ruinés, rationnés, emprisonnés financièrement dans le camp de concentration de leur île, assistant à la désintégration de leur Empire, leur propre pays occupé par des soldats américains, et leur économie nationale dépendant de la charité étasunienne. Tout cela pour quoi ? Pour que les Allemands se vissent désarmés de manière permanente? À peine trois ou quatre années passées, nous suppliions les Allemands de se réarmer aussi rapidement que possible. »
C’est l’ambiance de 1984. Avec une guerre interminable à venir.
Grenfell a tout résumé : on a détruit le pays et l’Europe pour rien, pour se retrouver avec une URSS plus forte que jamais. Puis avec une Europe « anglo-américaine » (ils ont bon dos les Anglo-Saxons parfois…) plus belliciste que jamais…
Ce n’est pas un hasard si Orwell a écrit son 1984 pendant cette triste époque. Voyez l’enfant aux cheveux verts de Losey ; on est passé de l’Angleterre edwardienne maîtresse du monde vers 1900 à un pays prolétarisé et clochardisé y compris sur le plan culturel et sociétal. Et c’est Churchill et sa rage guerrière qui ont précipité tout cela. Mais puisqu’on vous dit qu’il a sauvé le monde et la paix…
Les nazis volaient des territoires ? Grenfell, qui n’est pas russophile pour un sou, remarque justement (et cela explique la claque de Kaliningrad…) :
« Pourtant, à Yalta, il accepta que des centaines de milliers de kilomètres carrés de territoire polonais (sans parler des territoires lettons, lituaniens ou estoniens) fussent accordés, sans l’aval des habitants, aux gâteurs d’âme, en désaccord flagrant de la Charte Atlantique que lui-même et le président des USA avaient claironné au monde au cours de la même guerre, et en déni flagrant de la déclaration de guerre britannique contre l’Allemagne de 1939, qui précisément garantissait l’inviolabilité du territoire polonais. En outre, les compensations accordées aux Polonais sous forme de territoire d’Allemagne orientale, et l’allocation de la moitié du reste de l’Allemagne à une occupation russe, eurent pour effet de supprimer la zone tampon historique entre Moscou et les pays bordant l’Atlantique. »
Et Grenfell d’ajouter justement :
« Aucune raison réaliste n’existait de considérer l’alliance de la Russie comme loyale et digne de confiance. »

Sur Roosevelt, Grenfell rejoint les libertariens américains :
« On peut également admettre que le président Roosevelt, à cette époque, était dans un état d’hallucination fascinée quant à la pureté virginale des motivations du maréchal Staline… »
Revenons à la situation présente : nos élites s’inspirent et se réclament d’un homme politique opportuniste, belliqueux et corrompu, aussi incapable en temps de guerre qu’en temps de paix, et qui fut prêt à tout pour gagner une guerre déshonorante (un million de civils allemands carbonisés sous les bombes, quatorze millions de déplacés, etc.) et déplorable sur le plan des résultats (shoah, massacres, ruine, etc.).
Comprenez donc qu’ils vous affameront, vous priveront d’eau, d’électricité, de bagnole, de liberté (mais pas d’infos ou de vaccin…), mais qu’ils continueront dans leur aberration guerrière jusqu’au bout. Tout sera bon pour exterminer la Russie (ennemi de certains sur le long terme, revoir notre texte sur Emmanuel Todd et sur Nietzsche) qui a fièrement retrouvé sa place, une fois l’Allemagne écrasée.
Sources :
https://www.dedefensa.org/article/emmanuel-todd-et-le-con...
https://www.unz.com/article/the-carlson-cooper-podcast-a-...
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/09/16/l...
https://www.revuemethode.org/sf021722.html
https://www.amazon.fr/HITLER-VERSAILLES-PETITS-ESSAIS-HIS...
19:03 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tucker carlson, winston churchill, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, royaume-uni, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 septembre 2024
Juin 1944, les Marocchinate sur l'île d'Elbe. Le drame d'Olimpia Mibelli Ferrini

Crimes de guerre
Juin 1944, les Marocchinate sur l'île d'Elbe. Le drame d'Olimpia Mibelli Ferrini
par Eugenio Pasquinucci
Source: https://www.destra.it/home/storie-italiane-giugno-1944-le-marocchinate-dellisola-delba/
Je suis en vacances sur l'île d'Elbe et un jour je demande à une connaissance locale si je pourrais avoir des nouvelles de la vie d'Olimpia Mibelli Ferrini, dont on a décidé de donner le nom à une rue de Portoferraio.
« Nous savons tous qui était Olimpia et quelle était son histoire. Je connais l'un de ses fils, mais il n'est pas là ».
Olimpia était la figure féminine emblématique des tragiques journées de l'île d'Elbe en juin 1944, au cours desquelles s'est déroulée l'opération Brassard. À l'époque, plusieurs milliers de soldats des troupes coloniales françaises, sénégalais et nord-africains, marocains, tunisiens et algériens, débarquent le 17 juin 1944 sur les plages minées de Marina di Campo, sur l'île d'Elbe. Les 500 premiers sautent sur les mines, car ils sont considérés par les Alliés comme de la simple chair à canon, mais les autres se jettent sur les lieux de l'île en faisant usage du permis de viol et de pillage délivré aux troupes par le commandement français. Après avoir vaincu la résistance des quelques défenseurs italiens et allemands, les assaillants n'hésitent pas à s'emparer de tout ce qui leur tombe sous la main.

Les maisons des insulaires furent dévalisées, les femmes presque toutes violées. De nombreuses femmes furent tuées suite aux violences subies par plusieurs soldats, certains hommes tentèrent de les défendre et furent tués à leur tour, dans certains cas également violés. Certaines femmes ont été sauvées parce qu'elles se sont échappées vers l'arrière-pays où elles ont été emmurées vivantes à l'intérieur de certaines maisons, avec une fissure dans le plafond qui leur permettait de respirer et d'obtenir de la nourriture.

Olimpia était une blanchisseuse de Portoferraio, mariée à un soldat de la République Sociale Italienne, qui, face à la convoitise débridée de certains soldats nord-africains, leur a offert son corps à condition qu'ils laissent tranquilles des jeunes filles qui avaient été prises pour cible.
Son sacrifice a permis de préserver certaines de ces jeunes filles, dont certaines étaient encore des enfants, et cela est devenu un acte symbolique digne d'être rappelé jusqu'à aujourd'hui, alors que la tradition orale n'a jamais manqué de faire connaître cette tragédie.
Ainsi, au milieu des rues de Portoferraio, lieu consacré à la mémoire de Cosimo de' Medici et de Napoléon Bonaparte, il y aura un espace dédié à Olimpia Mibelli Ferrini.
L'opération Brassard fut un débarquement inutile dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, voulu par les Français dans l'espoir d'annexer plus tard l'île d'Elbe en même temps que la Corse. Les habitants de l'île d'Elbe, qui auraient dû accueillir les troupes alliées en libérateurs, étaient impatients de s'en débarrasser, au prix de plus de 200 viols, auxquels s'ajoutent les morts et les suicides, les avortements et les infections vénériennes qui s'ensuivirent.
Dans les mois qui suivirent, plusieurs enfants naquirent, dont les traits somatiques rappelaient indubitablement les viols de l'époque, mais que les habitants de l'île d'Elbe accueillirent dans leur communauté avec le même amour que celui qu'ils réservaient aux autres.
La consécration du sacrifice d'Olimpia se veut non seulement le souvenir d'une femme courageuse, mais aussi une sorte de réparation pour la mémoire qui a trop souvent été refusée à ces événements, auxquels il semble que les présidents de la République aient été particulièrement insensibles au cours des 80 dernières années.
19:14 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, île d'elbe, deuxième guerre mondiale, crimes de guerre, seconde guerre mondiale, armée française, italie, troupes coloniales françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 janvier 2024
L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique

L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique
Les éditions "Passaggio al Bosco" rééditent en Italie l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe" avec des textes d'Adriano Romualdi
par Andrea Scarano
Source: https://www.barbadillo.it/95823-leuropeismo-di-drieu-tra-filosofia-letteratura-e-politica/
Le mythe de l'Europe par Drieu La Rochelle
Quelle vision du monde caractérise l'un des principaux littérateurs français du 20ème siècle, à la personnalité complexe et solitaire, incompris, mal à l'aise et dépassé, longtemps ignoré même par la droite, y compris la droite italienne? La maison d'édition "Passaggio al bosco" propose la réédition de l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe", publié pour la première fois en 1965 avec des contributions d'Adriano Romualdi, Mario Prisco et Guido Giannettini.
 Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.
Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.
Aristocrate et attaché à ses origines normandes, Drieu participe activement à la Première Guerre mondiale, qu'il salue comme une véritable libération, dont il souligne à la fois les aspects mystiques et héroïques et l'ivresse d'un rêve de puissance capable de lui révéler l'unité absolue des binômes vie/mort et douleur/joie, lui faisant espérer des possibilités de renaissance, contrariées ensuite par le recul des Français, envers lesquels il ne cache pas son vif ressentiment; leur médiocrité face aux puissances émergentes était le signe que l'expérience républicaine commencée en 1789 pouvait être considérée comme irrémédiablement terminée.
L'objectif de détruire les mythes de la civilisation décadente, y compris les mythes éculés du conservatisme, l'amène à adhérer au mouvement Dada; la confluence de ses principaux animateurs dans le surréalisme et le communisme - dont l'écrivain a toujours reconnu les militants comme ayant une prédisposition au sacrifice et à la lutte - décrète bientôt son éloignement de ses anciens amis et le début de son engagement dans la construction de la patrie et de l'idée européenne. L'unité politique, le dépassement des nationalismes dans une forme de fédération d'États, alternative au capitalisme comme au communisme, auraient également évité le spectre de la subordination coloniale à la Russie ou aux États-Unis.
Sa prise de conscience progressive que seul le fascisme compris comme un phénomène européen pouvait s'imposer comme une révolution intégrale, une synthèse des intérêts politiques et spirituels, des valeurs de la liberté et de l'autorité, du travail et du capital, a commencé avec les émeutes parisiennes de février 1934; la chronique de ces événements, reprise dans le roman "Gilles", lui a fait croire pendant un court laps de temps que l'insurrection des fascistes et des communistes pourrait renverser le gouvernement radical-socialiste.
L'analyse de l'échec de l'action rénovatrice des partis de droite et de gauche contenue dans "Le socialisme fasciste" incite Drieu à appeler à la constitution d'un nouveau parti, plaçant l'espoir éphémère de l'instauration du socialisme - "pas celui des négateurs de l'esprit, un socialisme non fondé sur l'envie", précise Romualdi - et du fascisme dans le militantisme au sein des rangs du Parti populaire français, formation d'anciens communistes (dont son fondateur, Jacques Doriot), de radicaux et de fascistes.
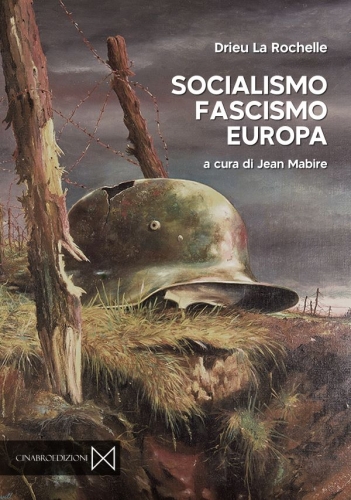 Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.
Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.
Une fois disparus les nationalismes traditionnels et les anciennes patries, l'échiquier international se composerait de trois empires: l'Amérique, la Russie et l'Europe unie - malgré la malheureuse guerre fratricide anglo-allemande - contre les francs-maçons et les jésuites, les progressistes et les radicaux, la bourgeoisie et le prolétariat. Partant d'une critique du concept de progrès et de civilisation qui impliquait également le catholicisme moderne et décadent, Drieu développa une éthique fasciste qui, poursuivant l'objectif de la "civilisation du héros", des mythes du sang et de l'homme nouveau, disciplinait l'âme - conçue comme éternelle - et le corps, en recourant à la fois aux vertus guerrières et monastiques; il attribue donc à la spiritualité non pas le sens respectable et sentimental de l'amour du prochain, mais celui de la force intérieure qui se traduit par la sévérité et l'âpreté de l'essentiel.
Sa conception religieuse tente de concilier le christianisme héroïque de la vision médiévale du Christ royal et viril et le paganisme, conçu comme une reprise des orientations métaphysiques préchrétiennes - qui admettent l'existence d'autres divinités en dessous de Dieu ("profondeurs du monde") - et comme la négation qu'un Dieu "personnel" exprime le sentiment authentique de la divinité.
Sens du sacrifice, sens de la résurrection, guerre perdue, rêve brisé de l'Europe sont des thèmes récurrents dans sa production littéraire, ainsi que celui de la mort. À la veille de l'invasion et des bombardements alliés, Constant - le protagoniste du roman "Chien de paille" - est le spectateur amer et détaché des événements, prêt à faire le geste extrême comme l'alter ego de Drieu qui - trahi par le choix des Allemands de répudier son rôle révolutionnaire pour poursuivre des politiques d'annexion déstabilisant l'unité du vieux continent - a planifié et consommé, en pleine cohérence et conscience, son suicide.
Andrea Scarano.
18:50 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, littérature française, lettres, lettres françaises, pierre drieu la rochelle, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 mai 2023
René Baert: esthétique et éthique

René Baert : esthétique et éthique
C’est la réédition d’une rare pépite des éditions nationales-socialistes belges de La Roue solaire que nous annonce également le Cercle. L’épreuve du feu, à la recherche d’une éthique fut publié en mars 1944 par René Baert, critique littéraire et artistique du Pays réel, aux éditions qu’il cofonda, un an plus tôt.
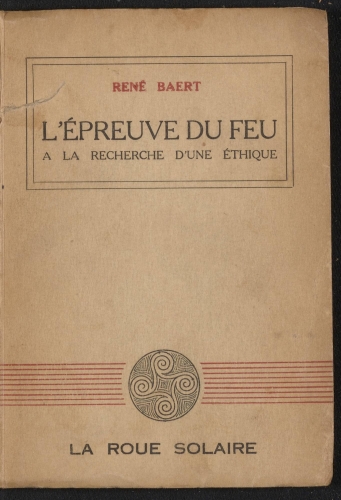
A sa sortie, ce livre fut présenté élogieusement dans la presse d’Ordre Nouveau, notamment par Le Nouveau Journal dont Robert Poulet fut le rédacteur en chef : « C’est à [la révolution nationale et sociale] que se consacre René Baert dans son livre L’épreuve du feu, qui porte en sous-titre : à la recherche d’une éthique.
Il s’agit d’une suite de courts essais dont le lien et l’unité sont évidents. Livre un peu aride, sans doute, –mais la facilité n’est plus de mise en ces temps de fer, et puisque, justement, c’est contre l’esprit de facilité qu’il faut d’abord lutter. Livre d’utile mise au point. L’essentiel de notre combat sur le plan de la pensée et de l’éthique, se trouve condensé dans de brefs chapitres qui s’intitulent notamment : La mesure du monde, Liberté chérie, Apprendre à servir, Le salut est en soi, Mystique de l’action, L’homme totalitaire, Le sens révolutionnaire.
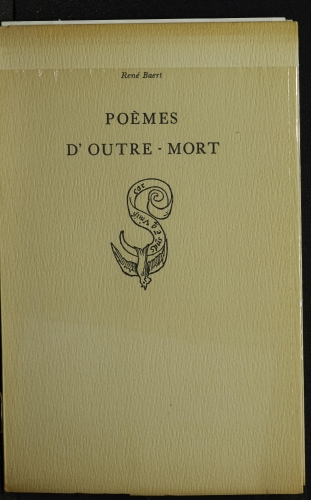
On n’entreprendra pas ici de résumer un message qui se trouve déjà fortement condensé dans ces pages, et dont la signification essentielle tient peut-être dans ces quelques lignes :
“Le révolutionnaire est celui qui lutte pour que nous ne connaissions plus jamais un temps comme celui que nous avons connu avant cette guerre… Ah ! combien à ce temps exécrable préférons-nous celui que nous vivons aujourd’hui ! Ce n’est pas que nous soyons heureux d’avoir fait les frais d’une aventure qui ne nous concernait pas, ce n’est pas que nous bénissions l’épreuve qui nous condamne à étaler toutes nos misères aux yeux d’autrui, –mais ce qui nous enchante, c’est d’être entrés de plain-pied dans la lutte, c’est de participer dans la faible mesure de nos moyens au gigantesque travail de l’avènement de l’Europe… Le sens révolutionnaire de notre époque extraordinaire se traduit précisément dans l’immense besoin de quelques-uns de sauver leur patrie malgré elle… La tâche, plus que jamais, doit appartenir aux révolutionnaires. C’est toujours à la minorité combattante qu’appartient l’initiative de la lutte. Mais qu’on n’oublie pas que seuls pourront y participer ceux qui n’auront pas préféré leurs petites aises au risque qui fait l’homme.”
Cette tâche, elle est politique et sociale, mais elle est aussi spirituelle, éthique. Aussi bien est-ce à la recherche d’une éthique révolutionnaire que s’applique l’auteur de L’épreuve du feu. Il ne le fait pas sans se référer à de hauts maîtres, tels que Nietzsche ou, plus près de nous, l’Allemand Ernst Jünger (dont René Baert analyse lucidement l’œuvre et l’enseignement dans un chapitre intitulé Le travailleur), les Français Drieu la Rochelle ou Montherlant (entre lesquels il établit un remarquable parallèle). » (Le Nouveau Journal, 6 avril 1944).
René Baert, réfugié en Allemagne en 1945 où il tentait de se préserver des générosités assassines de la Libération, est arrêté et fusillé sans autre forme de procès par des militaires belges. On ne dispose que de peu d’éléments biographiques sur lui bien qu’il existe un site modeste qui lui est consacré (cliquez ici: https://renebaert.wordpress.com/biographie/).
L’épreuve du feu, de René Baert, est ressorti aux éditions du Lore et est disponible directement chez l'éditeur: http://www.ladiffusiondulore.fr/index.php?id_product=1031&controller=product

22:06 Publié dans Belgicana, Histoire, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, belgique, belgicana, lettres, littérature, lettres belges, littérature belge, deuxième guerre mondiale, livre, rené baert |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 janvier 2023
John Charmley et l’effarant bilan de Winston Churchill

John Charmley et l’effarant bilan de Winston Churchill
Nicolas Bonnal
Brute impériale, raciste humaniste, boutefeu impertinent, affameur et bombardier de civils, phraseur creux et politicien incapable en temps de paix, américanophile pathétique, Winston Churchill est naturellement le modèle de cette époque eschatologique et de ses néocons russophobes (Churchill recommanda l’usage de la bombe atomique contre les Russes à Truman). On laisse de côté cette fois Ralph Raico et on évoque cette fois le brillant historien John Charmley qui l’analysa d’un point de vue British traditionnel: Churchill anéantit l’empire, choisit le pire et la guerre, varia d’Hitler (le moustachu puis Staline) et humilia l’Angleterre transformée en brillant troisième des USA. Autant dire que Charmley n’est pas bien vu en bas lieu. Il écrit en effet que l’Angleterre ruina deux fois l’Europe pour abattre une Allemagne qui finit par la dominer économiquement ! Niall Ferguson a reconnu aussi les responsabilités britanniques dans la Première Guerre mondiale.

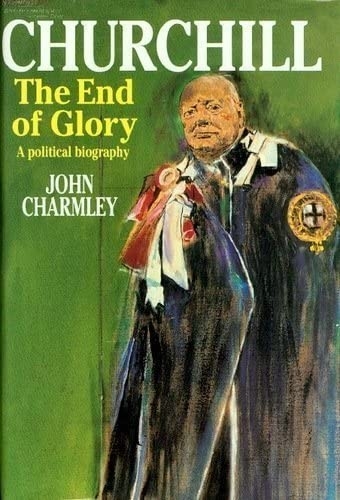
Coup de chance pour nous, un autre livre de Charmley a été traduit par Philippe Grasset pour les éditions Mols il y a quelques années. Dans Grande alliance, Charmley notre historien montre le progressif abaissement matériel et moral de l’Angleterre – menée au suicide de civilisation par le boutefeu préféré de notre presse au rabais. Et cela donne:
« Les Britanniques voulaient-ils un geste montrant qu’on se préoccupait d’eux? Roosevelt leur livrait cinquante vieux destroyers, pour lesquels les Britanniques payeraient avec la cession de leurs bases des Caraïbes. Churchill pouvait voir ce qui lui plaisait dans ce geste mais l’échange fut décrit de façon plus précise par le secrétaire au Foreign Office, Anthony Eden, comme « un sérieux coup porté à notre autorité et, finalement... à notre souveraineté ». Le fait qu’en janvier 1941, l’Angleterre n’avait reçu que deux des fameux cinquante destroyers faisait, pensait-il, qu’« on pouvait raisonnablement regarder ce marché comme un marché de dupes ».
Très vite, pendant la Guerre, on sent que l’empire britannique va, grâce à Churchill, changer de mains :
« Un commentateur dit justement qu’ « aucun officiel américain n’aurait jamais proclamé grossièrement que l’un des buts essentiels de notre politique extérieure serait l’acquisition de l’empire britannique »; mais Cordell Hull déclara tout de même qu’il utiliserait « l’aide américaine comme un canif pour ouvrir cette huître obstinément fermé, l’Empire ».
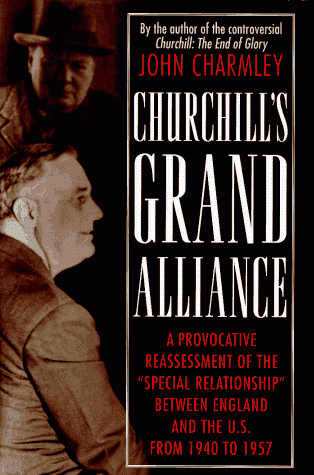
Parfois le gros homme devenait lucide :
« La version finale de la requête britannique, transmise le 7 décembre 1940, mettait en évidence le sérieux de la situation économique du pays. Le ton de la lettre de Churchill était grave et d’une prescience inattendue. Il dit à Roosevelt qu’il croyait que son interlocuteur « accepterait l’idée qu’il serait faux dans les principes et mutuellement désavantageux dans les effets si, au plus haut de cette bataille, la Grande Bretagne devait être privée de toutes ses possessions dans une mesure où, après avoir vaincu grâce à notre sang... nous nous retrouverions dépouillés jusqu’aux os ». C’était une affirmation superbe et émouvante mais elle ne détourna en rien les Américains dans leur détermination d’utiliser la situation dramatique de l’Angleterre pour obtenir des concessions qui garantiraient qu’elle ne se trouverait pas sur la voie de la paix qu’ils voulaient. »
Les Britanniques devaient livrer leur or eux-mêmes :
« Le 23 décembre, FDR dit à l’amiral Stark, le chef de la Navy, qu’il voulait un navire de guerre « pour récupérer les [réserves] d’or [britanniques] en Afrique »; non seulement Roosevelt entendait se payer sur les vastes avoirs britanniques d’outre-mer mais il entendait également que les Britanniques assurent le paiement du transport… La première réaction de Churchill fut de dire à FDR que ce marché lui rappelait « un sheriff qui saisit les derniers biens du débiteur sans protection »
En vain Lord Beaverbrook se réveille et houspille :
« Dans une lettre furieuse à Churchill, à la fin décembre, il accusa les Américains de « n’avoir rien concédé » et d’avoir « obtenu un gain maximum de tout ce qu’ils ont fait pour nous. Ils ont pris nos bases sans autres considérations. Ils prennent notre or ». Les livraisons américaines étaient rares, contrairement aux promesses faites.
Charmley en conclut logiquement une chose :
« Rien ne dit que FDR ait jamais considéré l’Angleterre comme son principal allié…façon dont Churchill traça le portrait de FDR : si la réalité de l’accord sur les destroyers et sur le lend-lease avait été révélée et la réalité des ambitions de FDR pour l’Amérique mise en lumière, Churchill aurait passé pour une dupe de plus du Président. »

Pour une fois Lord Cherwell (photo), réfugié juif allemand (Lindemann) chargé des bombardements de la population civile allemande (un million de morts sous les bombes contre 17.000 à l’Angleterre), a raison :
« Comme son conseiller scientifique nouvellement ennobli Lord Cherwell le dit à Churchill, « les fruits de la victoire que Roosevelt nous prépare semble se résumer à la sauvegarde de l’Amérique et la famine virtuelle pour nous ». Ce n’était pas « une nouvelle très enthousiasmante à annoncer au peuple anglais ». Bien que le Chancelier jugeât les prévisions de Cherwell pessimistes, le fait est que, dans l’après-guerre, l’Angleterre allait être confrontée à un choix que ses hommes politiques jugeraient insupportable. »
On fait le maigre bilan de cette guerre que ne voulait pas Hitler (lisez Liddell Hart ou Preparata pour savoir pourquoi) :
« Alors, qu’avait donc obtenu l’Angleterre ? Elle avait acquis l’admiration de larges tranches du public américain et avait gagné leur respect. Elle s’était battue pour son indépendance mais elle avait été capable de le faire seulement avec l’aide américaine et, en fait, comme un satellite de l’Amérique. Son avenir était endetté, son économie pressée jusqu’à un point de rupture, ses villes bombardées et sa population soumise à un rationnement radical. Ce superbe et héroïque effort ne fut nullement récompensé pendant dix-huit mois. »
Le bellicisme churchillien s’accompagne d’une grosse paresse des soldats (lisez mon maître Masson, qui en parlait très bien) :
« Le féroce assaut japonais et la résistance indolente des Britanniques à Singapour montrèrent que la puissance impériale était au-delà de ses capacités ; le spectacle des 100.000 soldats se rendant à une puissance asiatique à la chute de Singapour était une de ces images à laquelle le prestige impérial ne pourrait pas survivre. »
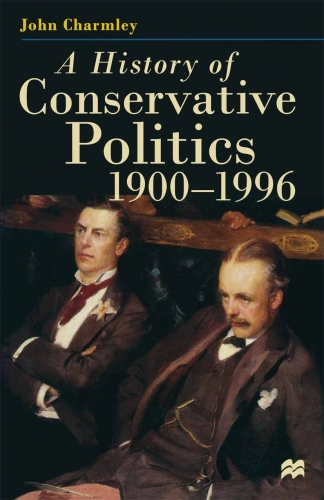
Churchill a multiplié les mauvais conseils et les mauvaises décisions, rappelle Charmley :
« C’est Churchill qui mit son veto à l’idée de garantir à Staline ses frontières de 1941; c’est Churchill qui refusa de reconnaître l’organisation gaulliste comme gouvernement provisoire de la France; c’est Churchill qui, par-dessus tout, montra un jugement si mauvais qu’il rejeta à la fin de 1944 l’idée d’une alliance européenne occidentale avec le commentaire méprisant qu’on n’y trouverait rien « sinon de la faiblesse ». Dans l’attitude de Churchill, on trouve le thème obsédant de l’Amérique. »
Nous évoquions Preparata qui s’inspira pour sa vision de Veblen. Litvinov (découvrez aussi Nicolas Starikov) confirme alors que le but de guerre était d’abord la destruction mutuelle de l’Allemagne et de la Russie :
« Maxim Litvinov, qui était marié à une Britannique et qui n’était en aucune façon anglophobe, avait dit à Davies que les Britanniques « repoussaient l’idée d’un second front de façon à ce que la Russie “soit vidée de son sang en affrontant seule les Allemands”. Après la guerre, le Royaume-Uni pourrait ainsi “contrôler et dominer l’Europe” ».
On y arriva mais bien après, avec les Américains…la destruction de l’Europe est encore au programme sous domination anglo-saxonne (on ignorera la France renégate).
A l’époque, rappelle Charmley, l’opinion publique n’est pas trop hostile à l’U.R.S.S. Elle voit d’un mauvais œil le maintien des empires coloniaux (nous aussi, il fallait les liquider en 45):
« L’opinion publique américaine n’était pas prête à lier son avenir à une alliance exclusivement anglo-américaine. Elle tendait plutôt à partager l’opinion de Josephus Daniels, du Raleigh News & Observer, selon lequel il importait d’inclure dans l’alliance générale « la Russie et la Chine » parce que « les espoirs d’une paix permanente basés sur une alliances serrée entre grandes puissances suscite la frustration en inspirant la peur et la jalousie dans les zones hors de celle que couvre l’alliance » ; la sécurité doit être « collective » pour être effective. »

Après, cerise sur le bonbon. John Charmley se défoule :
« Derrière la politique américaine de Churchill, on trouve la proposition que le crédit moral de l’action du Royaume-Uni en 1940-41 pouvait être converti en influence sur la politique américaine. Comme nombre d’américanophiles, Churchill imaginait que l’Amérique survenant sur la scène mondiale aurait besoin d’un guide sage et avisé, et il se voyait fort bien lui-même, avec le Royaume-Uni, dans ce rôle. Cela paraît aujourd’hui une curieuse fantaisie mais c’est bien le principe qui guida la diplomatie britannique à l’égard de l’Amérique pendant la période que nous étudions dans ces pages. »
La naïveté britannique a une pointe d’arrogance :
« En tentant d’exposer « l’essence d’une politique américaine » en 1944, un diplomate définit parfaitement cette attitude. La politique traditionnelle du Royaume-Uni de chercher à empêcher qu’une puissance exerça une position dominante était écartée : « Notre but ne doit pas être de chercher à équilibrer notre puissance contre celle des États- Unis, mais d’utiliser la puissance américaine pour des objectifs que nous considérons comme bénéfiques ». La politique britannique devrait être désormais considérée comme un moyen d’ « orienter cette énorme péniche maladroite [les USA] vers le port qui convient ».
Charmley ironise alors (que peut-on faire d’autre ?) :
« L’idée d’utiliser « la puissance américaine pour protéger le Commonwealth et l’Empire » avait beaucoup de charme en soi, en fonction de ce que l’on sait des attitudes de Roosevelt concernant l’Europe. Elle était également un parfait exemple de la façon dont les Britanniques parvenaient à se tromper eux-mêmes à propos de l’Amérique. On la retrouve avec la fameuse remarque de MacMillan, en 1943, selon laquelle les Britanniques devraient se considérer eux-mêmes comme « les Grecs de ce nouvel Empire romain ». »
Un peu d’antiquité alors ? Charmley :
« L’image de la subtile intelligence des Britanniques guidant l’Amérique avec sa formidable musculature et son cerveau de gringalet était flatteuse pour l’élite dirigeante britannique ; après l’horrible gâchis qu’elle avait réalisé à tenter de préserver son propre imperium, elle avait l’arrogance de croire qu’elle pourrait s’occuper de celui de l’Amérique. Même un Béotien aurait pu se rappeler que, dans l’empire romain, les Grecs étaient des esclaves. »

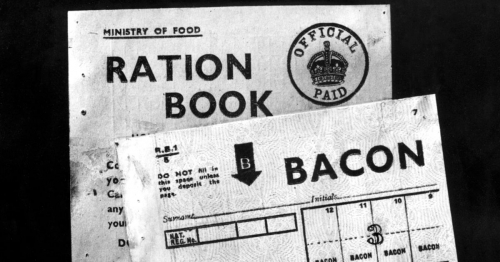
La banqueroute britannique se rapproche (l’Angleterre est broke) :
« Les besoins britanniques pour l’après-guerre étaient aussi simples à définir qu’ils étaient difficiles à obtenir: une balance commerciale favorable et une balance des paiements excédentaire.
L’absence de ces deux facteurs signifiait la banqueroute et la fin du Royaume-Uni comme grande puissance.
Keynes en est conscient :
« Comme observait Keynes dans une lettre à Stettinius en 1944, ce dernier « avait non seulement omis de noter que l’administration US prenait toutes les mesures pour que le Royaume-Uni soit le plus près possible de la banqueroute avant qu’une aide lui soit apportée »…
C’était le prix de l’alliance américaine… »
J.J. Annaud me disait un jour que même affaiblie la critique de cinéma gardait son pouvoir de nuisance. De même pour l’Angleterre, qui toute à son obsession de diriger le monde avec son compère américain casse l’union sacrée antifasciste de l’après-guerre. On va citer le vice-président Wallace, humaniste progressiste et homme éminent, cité du reste par Bernanos dans sa France contre les robots :
« Pour autant, on ne dira pas que les Américains « tombaient » d’une certaine façon dans ce que Wallace dénonçait comme « les intrigues » britanniques ; ce serait plutôt à ce point que la nature pyrrhique des relations spéciales anglo-américaines deviendrait évidente. Pragmatique jusqu’au tréfonds de l’âme, la diplomatie britannique avait comme objectif de convaincre les Américains que ses batailles dans la Méditerranée orientale et la zone autour des Détroits s’appuyait sur la cause de la démocratie. »
Puis l’Amérique prend la rage antirusse (lisez Raico pour comprendre comment il fallut se faire réélire !) :
« En cherchant à susciter le soutien américain, les Britanniques fabriquaient leur propre Frankenstein. Une fois que les Américains furent convaincus que les Soviétiques ne coopéreraient pas dans leur proposition de nouvel ordre mondial, la voie était ouverte pour un conflit idéologique qui écarterait les objectifs des Britanniques et les enchaînerait dans un conflit manichéen… »
Chose intéressante, Charmley confirme que l’UE est une création 100% américaine destinée à servir les intérêts de l’amère patrie !
« L’aide américaine avait été sollicitée pour préserver la place du Royaume-Uni parmi les grandes puissances mais elle ne fit rien pour préserver l’Empire et, rapidement, les Américains exigèrent impatiemment que les Britanniques prennent la tête d’une fédération européenne. »
Pré carré américain, l’Europe devait être colonisée froidement (il était recommandé au soldat de ne pas sympathiser avec la population – cela n’excluait pas les viols qui inspirèrent le classique Orange mécanique). D’ailleurs la France :
« Les ministres n’étaient guère séduits par les conceptions de FDR selon lesquelles la France devrait être dirigée pendant un an après sa libération par un général allié. »

Le Plan Marshall ? Parlons du plan Marshall :
« Le Plan Marshall allait se révéler également un puissant instrument pour ce dessein. George Kennan écrit dans ses mémoires : « Nous espérions forcer les Européens à penser en Européens et non en nationalistes » ; évidemment, le « nationalisme » n’était acceptable que lorsqu’il était américain. Le Plan Marshall projeta le système d’organisation industrielle et fédéraliste américain en Europe, son objectif ultime était de créer une Europe convenant aux Américains. »
Un crochet par Eisenhower, personnage plus falot que prévu ici, mais qui va dénoncer comme on sait le lobby militaro-industriel :
« Malgré son engagement dans l’Alliance atlantique, Eisenhower ne pouvait pas ne pas s’inquiéter de l’augmentation des dépenses de défense, de leur poids sur l’économie et sur l’American way of life en cas d’aggravation de la Guerre froide. Comme il le dit en mars 1953 à un vieil ami de Churchill, Bernie Baruch, « accoutumer notre population à vivre indéfiniment sous un tel contrôle [gouvernemental] conduira graduellement à de nouvelles relations entre l’individu et l’Etat – une conception qui changerait d’une façon révolutionnaire le type de gouvernement sous lequel nous vivons ». Le Président était un vrai républicain dans le sens où il pensait que, « en permettant la croissance incontrôlée du gouvernement fédéral, nous nous sommes d’ores et déjà largement éloigné de la philosophie de Jefferson… »
Encore un clou à enfoncer pour la construction européenne :
« Dulles voulait cet élément supranational qui aurait donné un nouvel élan à l’union européenne, dont les Américains trouvaient les progrès désespérément lents. »
On en restera là. Vous pouvez lire la suite ailleurs… On aura appris grâce à John Charmley que l’histoire moderne en Occident, si elle pleine de bruit et de fureur, est racontée non par un, mais beaucoup d’idiots dont le Nobel modèle reste Churchill. Car les idiots sont aussi dans le public.
Source:
Churchill’s Grand Alliance ou La Passion de Churchill, troisième volet d’une trilogie de l’historien britannique John Charmley, publié en 1995, décrit la fondation (1941) des “relations spéciales” (special relationships) entre les USA et le Royaume-Uni et leur développement jusqu’au tournant décisif de 1956 (crise de Suez).
http://www.editions-mols.eu/publication.php?id_pub=41
Auteur: John Charmley
Format: 155 x 230, 522 pages, ISBN: 2-87402-071-0
Prix: 15 Euros
21:31 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john charmley, winston churchill, royaume-uni, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 avril 2021
SYRIE 1941 - La guerre occultée - Vichyste contre Gaullistes

SYRIE 1941 - La guerre occultée - Vichyste contre Gaullistes
Source: le compte vk de Jean-Claude Cariou
Recension:
SYRIE 1941 - La guerre occultée - Vichyste contre Gaullistes
Par Henri DE WAILLY
Editions Perrin, 2006, 504 pages.
Avec cet ouvrage consacré à la campagne de Syrie durant l’été 1941, Henri de Wailly livre un travail historique à bien des égards exemplaire.
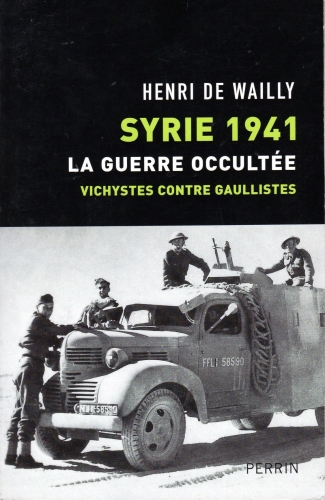
Se plaçant sous quatre angles différents (Français de Vichy, Français Libres de De Gaulle, Anglais et Australiens), il propose une analyse fine de la géopolitique du Levant français, des enjeux provoqués par la défaite de la France et des événements diplomatiques et militaires de cette campagne.
A la défaite, lourde, des armées françaises en 1940, la convention d’Armistice prévoit le maintien d’une armée française réduite, la préservation de la flotte française et le maintien de troupes en Afrique du Nord et au Levant (Syrie et Liban), ces dernières sous le contrôle plus ou moins strict de commissions de contrôle italo-allemandes.
Au Levant, 35.000 hommes constitués, pour l’essentiel, de troupes locales et de régiments de l’Armée d’Afrique encadrés par des sous-officiers et officiers métropolitains.

Le sort du Levant va être scellé par la géopolitique régionale: besoin des Allemands de soutenir l’insurrection en Irak, besoin des Français libres de lever des troupes et d’affirmer la légitimité du mouvement sur l’Empire français, besoin des Anglais de protéger à la fois l’Irak et l’Egypte attaquée à l’ouest par l’Afrika Korps d’Erwin Rommel.
Les Allemands souhaitant venir en aide aux nationalistes irakiens de Rachid Ali en révolte contre la présence britannique sollicitent du gouvernement de l'amiral Darlan des facilités aéroportuaires pour faire transiter du matériel et des armes par la Syrie. Celui-ci, -cornaqué par le très collaborationniste secrétaire du gouvernement Benoist-Mechin- et croyant jouer au plus fin et en échange d'hypothétiques contreparties assouplissant les conditions d'occupation, met le doigt dans l'engrenage d'une collaboration militaire avec les Allemands pouvant rapidement entraîner la France vichyste dans une co-belligerance avec la Wehrmacht contre l'Angleterre. Se rendant compte de son erreur et face à l'opposition de Weygand, Darlan tente de limiter les concessions données aux Allemands mais il est trop tard et, sur ordre, le général Dentz commandant de l'Armée du Levant, est contraint de s'exécuter en offrant aux avions de la Luftwaffe certaines facilités de transit sur les aérodromes de Syrie et en livrant aux insurgés à la frontière irakienne des armes, du carburant et des moyens de transport, des camions essentiellement prélevés sur les stocks de la commission d'armistice. A sa décharge ces matériels et armement livrés étant pour la plupart obsolètes ou hors d'usage .



C'est le casus belli rêvé par Winston Churchill !
Poussé également par le général de Gaulle, Churchill va décider de l’invasion du Levant au grand dam du commandement militaire en Égypte le général Wawell qui a déjà fort à faire en Lybie avec les Germano-Italiens qui menacent le Nil et le canal de Suez.
Engagée avec de trop faibles moyens mais avec la 1ère division des Français Libres (1ère DFL), l’offensive va piétiner face à une armée française du Levant qui, dopé par l'invasion des Britanniques et surtout très remontée contre les "traîtres " gaullistes reste fidèle à Vichy et se bat farouchement. Il faudra des renforts importants des troupes du Commonwealth et l’invasion de la Russie par Hitler (fermant définitivement la porte à une opération allemande d'envergure en Méditerranée orientale vers la Syrie et l'Irak) pour faire basculer définitivement le sort des armes dans le camp des Alliés en montrant toute l'inanité de cette guerre fratricide entre alliés d'hier et de demain et entre Français.
Si la victoire fut acquise aux Alliés, les gaullistes perdirent l’un de leurs objectifs: la grande majorité des soldats de l’armée du Levant, traumatisée par cet affrontement resta fidèle à Vichy (au Maréchal Pétain leur chef plus exactement) et furent rapatriés en France. Il faudra attendre le débarquement des alliés anglo-américains en Afrique du Nord pour que la France Libre, devenue France Combattante, puisse de nouveau accéder à des troupes françaises: celles de l’Armée d’Afrique qui reprendront sous le même drapeau le combat commun contre l'ennemi allemand dès la campagne de Tunisie.
L’ouvrage de Henri Wailly est très bien écrit et servi de 40 pages de notes très utiles. L’ensemble des différentes thèses et angles de vue, y compris celui de l'Armée du Levant, est présenté de manière équilibrée. Cet ouvrage est utile pour mieux comprendre le contexte difficile que connaîtront les gaullistes dans les événements en Afrique du Nord en 1942.
Syrie 1941, Guerre occultée certes car Anglais et Français ne souhaitèrent pas s’étendre sur ce conflit entre anciens et futurs alliés. Par contre, la dimension franco-française, hors la dimension morale qui fut traumatisante et laissa des traces indélébiles chez les participants, est remise en cause par le poids des effectifs français engagés du côté allié: 15% des effectifs au début de la campagne – 8% dans la deuxième partie de l’offensive. Par contre, il est vrai que la présence des « Free French » dont beaucoup étaient vus (effet de la propagande et de la méconnaissance des enjeux réels de l'armistice et de la collaboration d'une France vichyste très lointaine du Moyen Orient) non comme des frères égarés mais comme des "traîtres" a sûrement impactée et durcie la résistance des forces vichystes dans le sens d'un bien plus grand engagement dans des combats menés le plus souvent " jusqu'au bout et sans esprit de recul" aussi bien contre les Britanniques, (Australiens et Indiens pour la grande majorité), que contre les FFL.
13:52 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, syrie, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, levant, proche-orient, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 16 avril 2021
La guerre italo-grecque (1940-1941)
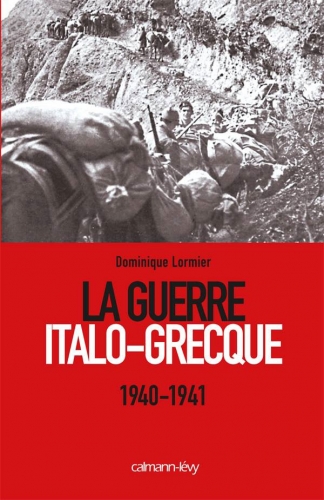
La guerre italo-grecque (1940-1941)
Par Dominique LORMIER
Editions Calmann-Levy, 2008, 224 pages.
Cartes. Photos.
Source: Compte vk de Jean-Claude Cariou
Au début de 1939, l'Italie occupa l'Albanie, depuis longtemps sous influence italienne. L'Italie posséda alors une frontière directe avec la Grèce. Cette occupation modifia les plans grecs déclenchant alors les préparatifs contre une invasion italienne. Alors que la guerre éclate en Europe centrale, Metaxas essaie de conserver la neutralité de la Grèce ; mais au fur et à mesure que le conflit s'étend, Métaxas se rapproche de la Grande-Bretagne encouragé par l'anglophile Georges II de Grèce, et ce, bien que Metaxas ait été germanophile et entretenu de bonnes relations avec l'Allemagne d'Hitler.
Une campagne de propagande contre la Grèce commença en Italie au milieu de 1940, et des actes répétés de provocation, tels que le survol du territoire grec, atteignirent leur apogée avec le torpillage par un sous-marin du navire Elli dans le port de l'île de Tinos le 15 août 1940. Bien que la responsabilité italienne fût évidente, le gouvernement grec annonça que le sous-marin était de « nationalité inconnue ».
Le soir du 27 octobre 1940, l'ambassadeur italien à Athènes, Grazzi, apporta un ultimatum de Mussolini à Metaxas. L’Italie avait concentré son armée dans l’Albanie voisine et le Duce demanda le libre passage de ses troupes afin d’occuper des points stratégiques sur le sol grec.

Ioannis Metaxas.
La Grèce avait eu un comportement amical envers l’Allemagne nazie, profitant notamment d’accords commerciaux mutuels, mais désormais l’Italie, alliée de l’Allemagne, était sur le point d’envahir la Grèce, sans qu’Hitler ne soit au courant, en partie pour prouver que l’Italie pouvait imiter les succès allemands en Pologne et en France.
Metaxas rejeta l’ultimatum le 28 octobre, faisant écho à la volonté du peuple grec de résister, exprimée selon la légende en disant Okhi (Non en grec). En réalité, Metaxas avait dit en français: « Alors, c'est la guerre ». Quelques heures plus tard, l’Italie envahit la Grèce.
Le front, s'étalant sur 150 km, était un terrain extrêmement montagneux avec peu de routes. La chaîne des monts du Pinde divisait pratiquement la région en deux théâtres d'opérations : l'Épire et la Macédoine de l'ouest.
Le plan italien, au nom de code Emergenza G (Urgence Grèce), prévoyait une occupation du pays en trois phases : d'abord une occupation de l'Épire et des îles Ioniennes, puis une percée en Macédoine de l'Ouest vers Thessalonique afin de contrôler le nord de la Grèce. Dans un troisième temps, le reste de la Grèce aurait été occupé.
Le haut commandement italien mit en place un corps d'armée sur chaque théâtre d'opération. Le XXVe corps d'armée "Ciamura" en Épire (les 23e et 51e divisions d'infanterie Ferrara et Sienna, la 101e division blindée Centauro) devait avancer vers Ioannina et le long de la côte vers Prévéza. Le XXVIe corps d'armée Corizza se trouvait dans le secteur macédonien (les 19e, 29e, 49e divisions d'infanterie Venezia, Piemonte, Parma) et devait initialement observer une position passive, pendant que la division alpine Julia s'avançait entre les deux corps d'armée à travers les monts du Pinde. Au total, les forces italiennes étaient de 85 000 hommes.
Après l'occupation italienne de l'Albanie, le commandement général grec anticipa une attaque combinée de l'Italie et de la Bulgarie. Le plan prévoyait différentes options, selon la situation, mais prévoyait essentiellement une position défensive en Épire, ainsi que de maintenir une possibilité d'offensive en Macédoine occidentale.
Les principales forces armées grecques présentes sur zone à la veille du conflit étaient : la 8e division d'infanterie en Épire, sous les ordres du général Charalambos Katsimitros. En Macédoine de l'ouest, le corps d'armée TSDM (ΤΣΔΜ, Section de la Macédoine occidentale), sous le commandement du lieutenant général Ioannis Pitsikas, incluant le "détachement du Pinde" (Απόσπασμα Πίνδου) de la taille d'un régiment ; la 9e division d'infanterie et la 4e brigade d'infanterie. Les forces grecques s'élevaient à environ 35 000 hommes.

L'offensive italienne (28 octobre 1940 - 13 novembre 1940)
Les Italiens attaquèrent dans des conditions météorologiques épouvantables, pluies diluviennes, froid glacial et neige en altitude rendant les itinéraires quasiment impraticables, avec une préparation inadéquate, une logistique complètement défaillante et malgré leurs attaques répétées et de multiples actes de bravoures, ne réussirent pas à percer.
Sur la côte, les chars d'assaut italiens CV-33 et M11/39 rencontrèrent des difficultés sur le terrain montagneux et les défenses anti-chars grecques se révélèrent terriblement efficaces. Les attaques italiennes, mal organisées et mal coordonnées, ne parvinrent pas à déborder les forces grecques bien positionnées, et ce malgré l'importante supériorité numérique.
Dans le secteur de l'Épire, l'offensive italienne s'arrêta le 9 novembre. Une plus grande menace fut celle de l'avancée de la division "Julia", mais celle-ci fut mise en échec par les troupes du IIe corps d'armée grec. Les Grecs réussirent à encercler et à pratiquement détruire "Julia" le 13 novembre.
En Macédoine occidentale, face à une inactivité italienne et dans le but de soulager le front de l'Épire, le Haut Commandement grec déplaça le 3e corps d'armée le 31 octobre vers l'Épire et ordonna de passer à l'attaque en Albanie avec le TSDM. Pour des raisons logistiques, cette attaque fut successivement retardée jusqu'au 14 novembre.
Cette résistance grecque inattendue surprit les Italiens. Plusieurs divisions furent dépêchées en renfort en Albanie, dont la 47e division « Bari », prévue initialement pour l'invasion de Corfou.
Mussolini remplaça Prasca par le général Umbaldo Soddu, son ancien vice-ministre de la guerre. Dès son arrivée, Soddu ordonna à ses forces de se placer sur la défensive. Il était alors clair que l'invasion italienne avait échoué.
 Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)
Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)
Les réservistes grecs commencèrent à rejoindre le front au début du mois de novembre, et procédant à la mobilisation, le commandant en chef grec, le lieutenant général Papágos eut suffisamment de troupes pour lancer une contre-offensive.
La TSDM et le IIIe corps d'armée, renforcés continuellement par des unités venues de tout le nord de la Grèce, passèrent à l'offensive le 14 novembre en direction de Korytsa.
Après d'intenses combats sur les lignes fortifiées, les Grecs firent une percée le 17 et entrèrent dans Korytsa le 22 novembre. Cependant, des indécisions au sein du commandement grec permirent un regroupement aux Italiens, leur évitant ainsi une débâcle complète. Quelques unités albanaises échelonnées dans les divisions « Venice » et « Julia » furent liquidées par les Grecs car employées comme bouclier pour protéger la retraite italienne. Le colonel Pervizi (représentant du commandement albanais) décida alors de soustraire le bataillon « Tomorri » au risque d'un second massacre, en abandonnant par surprise le champ de bataille. Cela coûta une grande défaite aux Italiens. Le maréchal Badoglio parla de « trahison des Albanais » et décida le retrait de leur armée, qui fut cantonnée dans les montagnes du nord d’Albanie.
L'attaque depuis la Macédoine occidentale fut combinée à une offensive générale sur tout le front. Les Ier et IIe corps d'armée avancèrent en Épire et capturèrent Moschopolis (29 novembre) Saranda (6 décembre), Argyrokastron (8 décembre) et Himara début décembre, occupant pratiquement la région que les Grecs appelaient « Épire du Nord ». Cette région faisait partie des régions considérées comme grecques par la population grecque et revendiquées par l'irrédentisme de la Grande Idée. Cela explique le refus dans les mois qui suivirent de les évacuer. Un dernier succès grec fut la prise de la très stratégique et fortifiée passe de Klissoura (Këlcyrë) le 10 janvier par le IIe corps d'armée. Mais l'hiver rigoureux, la supériorité italienne retrouvée par l'envoi de très nombreux renfort venus d'Italie et la mauvaise situation logistique des Grecs créèrent une impasse à la fin du mois de janvier.
Seconde offensive italienne et offensive allemande (mars 1941 - 23 avril 1941)
Il n'y avait alors en Europe que deux pays qui s'opposaient aux forces de l'Axe : le Royaume-Uni et la Grèce qui étaient alliés. Les Britanniques avaient réussi à fournir à la Grèce une aide aérienne limitée. Churchill avait à de nombreuses reprises proposé à Métaxas de lui envoyer des renforts d'infanterie, ce que le chef du gouvernement grec avait refusé : il craignait que cela provoquât l'Allemagne. À la fin de janvier 1941, après le décès de Metaxas, son successeur, Alexandros Korizis accepta l'aide d'un corps expéditionnaire composé principalement d'Australiens et Néo-Zélandais. Des mésententes entre les états-majors britannique et grec retardèrent le déploiement du corps expéditionnaire.

Malgré quelques actions locales, l'impasse continua étant donné que les deux ennemis étaient trop faibles pour lancer une attaque majeure. Malgré leurs victoires, les Grecs étaient dans une situation précaire du fait qu'ils avaient enlevé de leur frontière septentrionale des armes et des hommes afin de consolider le front albanais. Ils étaient alors trop faibles pour résister à une éventuelle attaque allemande qui se produirait à partir de la Yougoslavie.
Les Italiens, souhaitant obtenir un succès avant l'intervention de l'Allemagne, rassemblèrent leurs forces afin de lancer une nouvelle offensive au nom de code "Primavera" (Printemps). Dix-sept divisions furent rassemblées, opposées aux treize divisions grecques, et sous la supervision personnelle de Mussolini attaquèrent la passe de Klisura. L'offensive, s'enlisant à nouveau dans la boue et dans le sang, dura du 6 au 19 mars mais ne parvint pas à déloger les Grecs solidement retranchés.
À partir de ce moment, et jusqu'à l'intervention allemande, le statu quo s'installa, et les opérations diminuèrent des deux côtés.
Anticipant l'attaque allemande, les Britanniques et quelques Grecs préconisèrent un retrait de l'Armée d'Épire afin de ménager troupes et équipement en vue de pouvoir repousser les Allemands. Cependant, le sentiment national n'admettait pas que des positions si durement gagnées fussent abandonnées et une retraite face aux Italiens défaits eût été vécue comme une disgrâce. Ainsi, le gros des troupes grecques fut laissé loin dans les terres albanaises alors que les troupes allemandes approchaient. Finalement, avec l'avance rapide des Allemands, l'Armée d'Épire dut se retirer le 12 avril mais sa retraite fut coupée par les troupes allemandes et elle se rendit le 20. Le 23 avril, sur l'insistance de Mussolini, la cérémonie de reddition fut répétée afin d'y inclure des représentants italiens.
En six mois de combats contre les Grecs, l'armée italienne compta 154.172 soldats hors de combat dont 38.800 tués ou disparus et 115.000 blessés, gelés ou gravement malades. Face aux Italiens l'armée grecque déplora 120.000 pertes, dont 17.000 tués ou disparus et 102.000 blessés, gelés ou gravement malades ...

Pour les Italiens, l'occupation des Balkans par leurs troupes allait nécessiter la présence permanente d'une trentaine de divisions qui auraient été bienvenues sur d'autres fronts, comme en Afrique ou en Russie. L'échec de Mussolini contre la Grèce en octobre-novembre 1940 plaçait l'Italie sous la totale dépendance de l'Allemagne. Pour Mussolini, le rêve d'une "guerre parallèle" à celle de l'Allemagne s'était définitivement dissipé dans les montagnes d'Albanie !
L'auteur Dominique Lormier, comme dans la plupart de ses autres livres, à tendance à se laisser emporter dans des morceaux de bravoure qui trouvent plus leur place dans une collection d'ouvrages style "troupes de choc" que dans une étude historique dépassionnée et rigoureuse. Ses références se limitent à trois indications de sources, assez imprécises il faut l'avouer: Archives militaires italiennes Rome, Archives militaires allemandes Fribourg en Brisgau, Archives militaires grecques Athènes. Il cite cependant avec justesse le travail de David Zambon, Lignes de front 1900-2000, un siècle de guerre terrestre, mais oublie (volontairement ?) l'ouvrage du grec Costa de Loverdo. La Grèce au combat : De l'attaque italienne à la chute de la Crète, 1940-1941, dont il se sert pourtant à l'évidence !
00:11 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, italie, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, histoire, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 avril 2021
La dernière reddition: le 30 juin 1951, un groupe de soldats japonais dépose les armes sur l'île d'Anatahan

La dernière reddition: le 30 juin 1951, un groupe de soldats japonais dépose les armes sur l'île d'Anatahan
par Mirko Tassone
Ex : https://www.barbadillo.it/
Un portrait des Zanryū nipponhei, les résistants japonais, les retardataires, les stragglers, les Ghost Soldiers ou simplement les Resistors.
Ils les appelaient Zanryū nipponhei, les ultimes résistants japonais, les Stragglers, les Retarders, les Ghost Soldiers ou simplement les Résistants. De nombreux noms pour désigner un seul phénomène: celui des soldats japonais qui ont refusé de déposer les armes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le représentant le plus connu d'un groupe qui était tout sauf petit est sans doute Hiro Onoda, le lieutenant qui s'est rendu le 5 mars 1974 sur l'île philippine de Lubang. L'histoire de l'officier qui est resté "en service", malgré la fin de la guerre, n'est pas un cas isolé. Les précédents sont nombreux, mais l’un d’eux, en particulier, mérite d'être raconté pour au moins trois raisons. Premièrement, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul soldat, mais d'un groupe; deuxièmement, parce que c'est la seule occasion où les Zanryū japonais incluent également une femme; troisièmement, parce qu'il représente la dernière reddition de la Seconde Guerre mondiale. Le cadre de l'histoire que nous allons raconter est Anatahan, une île de l'archipel des Mariannes passée sous contrôle japonais à la fin de la Première Guerre mondiale.

Vue aérienne de l'île d'Anatahan.
C'est sur cette bande de terre, perdue dans l'immensité de l'océan, que se réfugie, en juin 1944, un groupe de soldats du Soleil Levant qui ont survécu au naufrage de trois navires à destination de Truk, en Micronésie, où se trouve la principale base navale de l'empire du Tenno dans le Pacifique Sud. Touchant terre, leurs vêtements déchirés et leurs âmes en émoi, la poignée de survivants se rend compte qu'ils ont atterri dans un endroit plutôt inhospitalier. Situé à 75 miles nautiques au nord de Saipan, en raison de la forte activité volcanique, Anatahan était et est toujours inhabité. Légèrement plus petite qu'Ischia, caractérisée par des plages escarpées et des pentes raides sillonnées de gorges profondes couvertes de végétation, l'île ne possède qu’une petite plage dans sa partie sud. À leur arrivée, les naufragés ont trouvé une femme, Hika Kazuko, originaire d'Okinawa, et un compatriote travaillant pour une entreprise qui récolte du coprah pour la production de beurre de coco. La femme était prisonnière sur l'île depuis quelques jours, ainsi que le collègue de son mari, qui, avec l'avancée des troupes américaines, n'avait pas pu revenir de Saipan, où il s'était rendu dans l'espoir de sauver sa sœur. Une fois débarqués sur ce petit bout de terre, les naufragés ont fait une reconnaissance et se sont rassemblés non loin de l'unique plage, confiants qu'ils seraient secourus quelques jours plus tard. Cet espoir fut déçu lorsque leurs compatriotes furent vaincus lors de la bataille des îles Mariannes. Cependant, la petite communauté ne se découragea pas et, comme elle ne vit pas arriver d'aide, elle commença à s'organiser du mieux qu'elle put: elle construisit des huttes avec des feuilles de palmier et se nourrit de noix de coco, de taro, de canne à sucre sauvage, de poissons et de lézards.
Ayant compris que leur séjour sur l'île ne serait pas bref, les soldats japonais ont décidé de s'offrir une sorte de réconfort. Ils ont donc commencé à produire du tuba, un distillat de noix de coco typique des Mariannes, semblable au Lambanóg des Philippines. Tout était nécessairement autosuffisant, du moins jusqu'au 3 janvier 1945, lorsqu'un B29 américain s'est écrasé sur l'île au retour d'un raid de bombardement sur Nagoya, au Japon. Le crash n'a laissé aucune chance aux 11 membres de l'équipage, mais s'est avéré être une véritable bénédiction pour les Japonais. L'épave devient une mine inattendue: les tôles sont moulées pour fabriquer des outils ou des couvertures de cabanes, les parachutes sont transformés en vêtements, les fils du système électrique deviennent des lignes de pêche.

Extrait d'un film de 1953.
Après avoir récupéré les armes de l'équipage et retiré les mitrailleuses et les canons de l'avion, les Japonais, menés par leur officier, construisent des positions défensives rudimentaires. L'existence de ces Robinson Crusoë serait restée inconnue si, en février 1945, une expédition de chamorros (indigènes des Mariannes) n'était pas arrivée sur l'île, envoyée par le commandement américain stationné à Saipan pour récupérer les corps des aviateurs qui s'étaient écrasés avec le B-29. De retour à la base, les chamorros font un rapport détaillé et communiquent qu'ils ont repéré un groupe de soldats ennemis. Les commandants américains qui, avec la tactique dite "jumping the frog", s'occupent, île par île, de se rapprocher du territoire métropolitain de l'ancien Yamato, n'accordent pas beaucoup d'importance à cette poignée d'hommes qui, comme beaucoup d'autres, ont été piégés sur une île lointaine. Entre-temps, la vie de la communauté se déroule parmi de nombreuses vicissitudes.

Hika peu après sa reddition.
Aux inconvénients compréhensibles causés par une situation limite, s'ajoute un élément exceptionnel: la présence d'Hika. Le fait qu'il n'y ait qu'une femme, sur une île habitée uniquement par des hommes, souvent en proie à l'euphorie provoquée par le tuba, génère d'inévitables frictions; à tel point que cinq des onze décès enregistrés au cours des sept années de séjour des naufragés sur Anatahan sont des maris d'Hika, dont quatre sont officiellement morts à la suite d'accidents de pêche. Évidemment, cette circonstance n'a pas échappé aux journaux qui, au retour de la femme dans son pays, ne se sont pas contentés de dépeindre la femme "Robinson" chargée de fabriquer des vêtements avec des parachutes, tandis que les hommes fournissaient la nourriture. La plupart de la presse, en fait, se concentrera sur les décès survenus dans des "circonstances mystérieuses".

Vision romancée...
Pour certains magazines, l'île était même un "foyer de passion et de meurtre". Cependant, la version des faits fournie par la protagoniste est tout autre. Hika, en effet, tout en affirmant avoir été contrainte au mariage par le supérieur du groupe, qui s'inquiétait de sa discipline et de celle des hommes, a toujours prétendu avec force que ses maris n'avaient pas été assassinés, mais étaient morts de maladie ou d'accident. Quoi qu'il en soit, tandis que se joue sur l'île une dynamique qui, pour la presse à sensation, allie héroïsme et érotisme, le temps passe et, avec une certaine régularité, les autorités américaines envoient des navires pour tenter de convaincre les Japonais de quitter l'île.
Fidèles au précepte du Bushidō, qui considère la reddition comme un déshonneur, les soldats japonais refusent de déposer les armes, persuadés que la guerre n'est pas encore terminée. La situation se prolonge jusqu'en juillet 1950, lorsque Hika elle-même brise le mur obstiné érigé par ses compatriotes: elle repère un navire américain - le Miss Susie - et demande à être évacuée de l'île. À son arrivée à Saipan, la femme informe les commandants américains que tout le monde à Anatahan croit que le Japon et les États-Unis se battent toujours. Les Américains signalent alors l'affaire aux autorités de Tokyo, qui retrouvent les membres des familles des Zanryū japonais, les invitant à écrire à leurs proches pour les convaincre de se rendre. Les lettres sont larguées sur l'île, mais les naufragés pensent qu'il s'agit d'une supercherie orchestrée par la propagande de l'Oncle Sam.
Ainsi, en janvier 1951, le gouverneur de la préfecture de Kanagawa s'adresse aux survivants, et dans un autre message encore, il les informe de la défaite du Japon et des bonnes relations établies entre-temps avec les États-Unis. Le gouverneur écrit également que tous les soldats ont été rapatriés et conclut: "Maintenant, il n'y a plus d'autres soldats japonais dans le Pacifique, sauf vous’’. Évidemment, toutes les lettres ne sont pas parvenues à leurs destinataires, si bien que la distribution a été répétée plusieurs fois, jusqu'au 26 juin 1951, date à laquelle les naufragés d'Anatahan ont décidé de se rendre. Quelques jours plus tard, le 30 juin, l'opération "Déménagement" a commencé. De Saipan part le remorqueur océanique USS Cocopa.
Une fois arrivé à destination, un canot pneumatique est descendu du navire, amenant sur l’île l'interprète Ken Akatani et le lieutenant commandant James B. Johnson, devant lesquels les 19 soldats survivants déposent les armes. Ils montent à bord du navire et, avec leurs quelques affaires rangées dans un pandanus tressé, ils sont emmenés à Guam où, en une semaine, un avion de la marine américaine les emmène à Tokyo. Il est étrange que la dernière garnison japonaise ait quitté les Mariannes le jour même où la gestion de l'administration américaine des îles du Pacifique est passée des militaires aux civils. C'est le signe que la Seconde Guerre mondiale est définitivement terminée, même si des Zanryū nippons isolés continueront à se battre jusqu'au début des années 1980.
Mirko Tassone.
18:28 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, japon, anatahan, océan pacifique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 mars 2021
Les Carnets secrets du Général Huntziger - 1938-1941
Editions Pierre de Taillac, 2019, 350 pages.
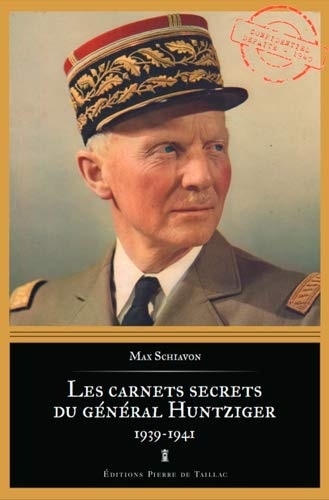 Ancienne cheville ouvrière de la victoire majeure de l’armée d’Orient en 1918 et favori bien placé pour la succession de Gamelin au poste de généralissime, le général Charles Huntziger était en 1939 l’un des grands talents du haut commandement de l’armée française. Chef de la IIe armée lors de la percée allemande décisive des Ardennes en mai 1940, il est chargé d’assumer le rôle peu enviable de principal signataire français de l’armistice de Rethondes. Il devient ensuite un des hiérarques du régime de Vichy, d’abord à la Commission d’armistice de Wiesbaden puis en tant que Ministre de la Guerre. Il meurt dans un accident d’avion en novembre 1941, laissant pour l’Histoire le renom controversé d’un protagoniste clé des débuts de la Collaboration d’État.
Ancienne cheville ouvrière de la victoire majeure de l’armée d’Orient en 1918 et favori bien placé pour la succession de Gamelin au poste de généralissime, le général Charles Huntziger était en 1939 l’un des grands talents du haut commandement de l’armée française. Chef de la IIe armée lors de la percée allemande décisive des Ardennes en mai 1940, il est chargé d’assumer le rôle peu enviable de principal signataire français de l’armistice de Rethondes. Il devient ensuite un des hiérarques du régime de Vichy, d’abord à la Commission d’armistice de Wiesbaden puis en tant que Ministre de la Guerre. Il meurt dans un accident d’avion en novembre 1941, laissant pour l’Histoire le renom controversé d’un protagoniste clé des débuts de la Collaboration d’État. Ces traits biographiques soulignent l’intérêt historique des carnets personnels rédigés par le général Huntziger durant ces années critiques. L’accord donné par sa famille à la publication de ces textes inédits, demeurés dans l’état où les avait laissés la disparition brutale de leur auteur, permet d’enrichir d’un éclairage nouveau les événements auxquels il a participé de 1938 à 1941, vus depuis les sphères haut placées au sein desquelles il évoluait.
Le texte est divisé en cinq parties de format inégal. Les deux premières portent sur les mois de l’immédiat avant-guerre et ceux de la Drôle de guerre. Elles permettent de brosser les traits de personnalité de Huntziger, homme de droite frayant avec des notables de l’Action française, antisémite avéré et chef militaire animé par la hantise d’une trahison de l’intérieur de la part des communistes. Il n’en formule pas moins un saisissant tableau du climat d’intrigues et des dysfonctionnements structurels qui dérèglent les organes supérieurs de décision. L’incurie de Gamelin est à la fois l’expression déplorable de sa personnalité et le reflet du caractère incroyablement brouillon du pouvoir politico-militaire, où les décisions des dirigeants politiques et les conceptions des chefs militaires sont aussi flottantes les unes que les autres. Dans cet incertain bouillon de culture, Huntziger nourrit le sentiment peu rassurant que leurs actes respectifs ont plus pour boussole les calculs individuels que les urgences du pays. En guise de grain de sel, quelques anecdotes absurdes donnent un ton décalé au climat de crise morale dans lequel la guerre s’amorce : ainsi des mésaventures bovines de la belle-sœur du président Lebrun !
Le carnet consignant les notes de Huntziger sur la bataille de France révèle un chef déstabilisé par la débâcle de mai 1940, où il se montre défaillant et peu lucide face à la percée blindée allemande qui enfonce son propre front à Sedan. Assez passif devant ce revers majeur, il semble sur le moment plus soucieux de la cohésion tactique de son dispositif que de l’urgence stratégique de contrer à tout prix l’assaut ennemi. Il parvient néanmoins à minimiser adroitement sa propre responsabilité dans cette catastrophe. Au sein du drame collectif qui s’ensuit, il ne mesure pas bien l’effondrement de ses propres troupes, mais son képi étoilé prend acte assez lucidement que sa science de la guerre est dépassée et que son univers de chef a perdu tous ses cadres de référence. Entre ingénierie de la déroute et capharnaüm de fin d’un monde, ses appréciations combinent lucidité, impuissance et pessimisme. Mais même dans cet infernal tourbillon, l’ego ne s’efface jamais tout à fait : au fond du pire, Huntziger continue à ruminer des spéculations sur ses possibilités d’accession au poste de généralissime…
La séquence se clôt par l’amère mission sacrificielle de diriger les délégations françaises chargées de signer les deux conventions d’armistice avec l’Allemagne et l’Italie. On prend connaissance avec intérêt des impressions personnelles de l’intéressé sur les discussions de Rethondes. Puis Huntziger occupe pendant les deux mois et demi suivants les fonctions de chef de la délégation française à la commission de Wiesbaden.
Il accepte pourtant ensuite d’intégrer le gouvernement du maréchal Pétain au poste clé de Ministre secrétaire d’État à la Guerre. Cette période couvre l’ultime tranche de ses carnets secrets. Le voilà parvenu au sommet, mais au sommet de quoi sinon une dérisoire armée-croupion, dans un régime de la défaite dont la marge de manœuvre est insignifiante ? Ses réactions le situent comme à la fois Maréchaliste et Lavalophobe. Conscient des pressions et du rapport de force arbitraire imposés par les Allemands, Huntziger adhère néanmoins à la Collaboration. Tout en travaillant souterrainement au renforcement des troupes des colonies et en se positionnant comme un ferme soutien de Weygand, il se montre un adversaire sans équivoque des dissidents gaullistes. On suit avec curiosité la chronique tourbillonnante qu’il donne des révolutions de palais à la cour thermale de Vichy. Après la disgrâce de Laval, il témoigne de très peu d’affinités, entre guerre des boutons entre marins et terriens et divergence politique de fond, envers le nouvel homme fort du régime, l’amiral Darlan. Dans les derniers mois qui précèdent sa disparition accidentelle en novembre 1941, Huntziger perd toute illusion sur les intentions allemandes et marque une volonté croissante de céder le moins possible à leurs exigences. Cette attitude semble prendre le caractère d’une forme de Collaboration réticente motivée par la résignation. Même s’il n’en fait aucune mention dans ses écrits intimes, il est par ailleurs attesté que le général commence alors à couvrir certaines opérations secrètes de renseignement et de camouflage des matériels.
Le mérite de l’édition scientifique scrupuleuse de ces carnets revient à Max Schiavon, auteur de biographies de référence sur d’autres chefs marquants de 1940 (Weygand, Corap, Georges, etc.). La transcription du texte courant noté de façon parfois télégraphique par Huntziger est attentive et accompagnée par un appareil critique minutieux et documenté, qui éclaire sans complaisance les prises de position de son sujet. Des pièces annexes et un index (pas tout à fait exhaustif, si l’on en juge par le cas du général Bührer, rival putatif de Huntziger, dont trois mentions ne sont pas répertoriées) font de cette publication un outil de travail solide. Les carnets secrets du général Huntziger s’avèrent donc une source documentaire de premier ordre, dont la contribution enrichit indéniablement le dossier du grand effondrement français de 1940 et ses conséquences. Avec l’impression vertigineuse, pour le lecteur en apnée dans ces pages, d’y assister à une pathétique course de canards sans tête au fond d’un panier de crabes bien glauque…
00:05 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, livre, général huntziger, huntziger, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, vichy |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 janvier 2021
America First: 1939–1941

America First: 1939–1941
By Morris V. de Camp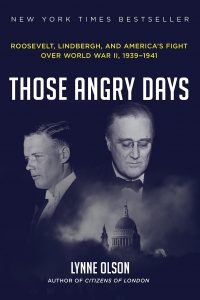 Lynne Olson
Lynne Olson
Those Angry Days: Roosevelt, Lindbergh, and America’s Fight over World War II, 1939–1941
New York: Random House, 2013
The idea of America First policy is back after a long hiatus. The first proponent for such a policy was none other than George Washington. He endorsed the idea in his farewell address [2], stating:
The nation which indulges towards another a habitual hatred or a habitual fondness is in some degree a slave . . . which is sufficient to lead it astray from its duty and its interest. Antipathy in one nation against another disposes each more readily to offer insult and injury, to lay hold of slight causes of umbrage…when accidental or trifling occasions of dispute occur. Hence, frequent collisions, obstinate, envenomed, and bloody contests.”
The president who took an opposing view [3] was John F. Kennedy:
“Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty.” (My emphasis.)
How the standard wisdom went from Washington’s concern for entangling foreign alliances to Kennedy’s declaration that he’ll bet the farm on the liberty of an ally occurred in the years between 1939 and 1941. The great issue was whether or not the United States should become involved in World War II.
How that debate occurred is documented by Lynne Olson’s [4] book Those Angry Days: Roosevelt, Lindbergh, and America’s Fight over World War II, 1939–1941. The book is highly illuminating. The controversy was hot and heavy from the start of World War II in 1939 until the attack on Pearl Harbor. The quarrel split families, caused fistfights in Congress, and led to deplatforming and other forms of nastiness. When reading about the conflict, there is a raw sense of current events to it also.

For example, how far does America go to protect an ally? If an ally is spying on one’s citizens, are they really an ally? Are “dictators” an automatic evil or are they a rational response to a nation’s foreign and domestic threats? How big should the military be in a time of peace? Are Jews full citizens or a separate people pursuing their own interests?
To Fight or Not to Fight
The two men that personified the struggle are Charles A. Lindbergh and Franklin Delano Roosevelt. Lindbergh, the first man to cross the Atlantic solo in an airplane, believed the United States should keep out of the war in Europe. Roosevelt was the chief interventionist. Or, more accurately, Roosevelt’s passionate supporters caused him to be an interventionist.
Lindbergh’s and Roosevelt’s mutual dislike went back to a controversy in 1934. Roosevelt wanted to end any appearance of impropriety involving airmail contracts to private aviation firms by using Army Air Corps aircraft to deliver the mail. Lindbergh argued that the Army’s aircraft were not suited to the role for technical reasons. After several crashes, Roosevelt went back to contracted aircraft. Lindbergh won his first round against the President.
In September 1939, the antipathy between the two men intensified when the British declared war on Germany for invading Poland. Lindbergh and the isolationists felt that the United States should stay out of the war. They were motivated by the unsavory end to the First World War.

In brief, the United States had lent money to various Allied powers. Thus Americans were drawn into the conflict to protect their investments, then weren’t paid back anyway. World War I killed 500 Americans per day during the Meuse-Argonne Offensive, so the price for involvement was steep. The British also loaded armaments on passenger ships and flew the US Flag on these ships to deceive German U-Boats. When those passenger ships were sunk, Americans understood they were being manipulated by the British. Additionally, British propaganda about “The Hun” had been proven false before the 1920s were finished. Furthermore, there was a sense that the British were not an innocent party in the war — they were an imperialist power.
Shortly after the start of hostilities, Lindbergh argued for [5] an American policy along the following lines:
- An embargo on offensive weapons and munitions.
- The unrestricted sale of purely defensive armaments.
- The prohibition of American shipping from the belligerent countries of Europe and their danger zones.
- The refusal of credit to belligerent nations or their agents.
He further argued that the United States had an important racial connection to all of Europe that should not be forgotten in a time of increasing Japanese belligerence and other problems with non-whites.
Since Lindbergh was already a national hero, people took notice.
Meanwhile, there was a highly active pro-intervention group consisting of different factions with different backgrounds and motivations. Olson mentions Jewish pressure in Hollywood, but she doesn’t say much about Jewish influence in the Roosevelt administration. Olson also mentions “anti-Semites,” but puts them in the category of kooks rather than the serious thinkers that they were. Of that, Wilmot Robertson says,
Instead of submitting anti-Semitism to the free play of ideas, instead of making it a topic for debate in which all can join, Jews and their liberal supporters have managed to organize an inquisition in which all acts, writings, and even thoughts critical of Jewry are treated as a threat to the moral order of mankind. The pro-Semite has consequently made himself the mirror image of the anti-Semite . . . the Jewish intellectual who believes passionately in the rights of free speech and peaceful assembly for all, but rejoices when permits are refused for anti-Semitic meetings and rocks crack against the skulls of anti-Semitic speakers. [1] [6]
In addition to the organized Jewish community, several other groups supported American involvement in the conflict. Some were American Anglophiles who were prominent in New England. There was also a sub-set of men who can be called the Plattsburg graduates.

The Plattsburg graduates were upper-class Americans who had attended military training in Plattsburg, New York in 1915. These men went on to become officers during the First World War. They were not isolationists so much as men wishing the nation be prepared for conflict should it come. Although they had some training, many of their enlisted soldiers were rushed into battle with only two days’ training. Since they were prominent men as well as veterans, people took notice of their ideas. They pushed for enlarging the armed forces in 1940.
A First Look at the Isolationists’ Problems
The isolationists’ main problem was that the German point of view was never well-received by Americans. The fact that Hitler was greeted with flowers in Austria, the Sudetenland, and other parts of German-speaking Europe just didn’t register. Instead, the public felt that Nazi Germany was an enormous threat. The German American Bund, a pro-Nazi group based in New York City, were painted as “fifth columnists” in the media. German books and publications that stated their case didn’t sell.
Fascist optics have never worked in America.
Interventionist Dirty Tricks and Metapolitics
The pro-interventionist faction had two things going for them: dirty tricks and great metapolitics. The British government focused on intelligence gathering on isolationists, German diplomats in the US, and German sympathizers. This included wiretapping as well as infiltration of spies by the British, the FBI, and private groups like the Jewish Anti-Defamation League (ADL). The ADL didn’t use Jews as spies; they found whites to do the job.

Other than a few exceptions, most isolationists had no connection to any foreign government and they weren’t able to draw upon organizational resources or any government to do the same to their enemies.
The dirty tricks weren’t as important as metapolitics:

One of the best metapolitical leaders for intervention was Robert E. Sherwin [9], a playwright who came to believe that America should enter the war. Many of his plays were made into influential pro-intervention movies. Some of the outstanding movies based on Sherwin’s work were:
- Waterloo Bridge [10] (1940): This is a fallen woman/romance story that made the British look cool.
- Abe Lincoln in Illinois [11] (1940): “The implied comparison of America’s dilemma in the 1850s to that in the late 1930s was clearly understood by the play’s audiences. Heywood Broun of the New York World called Abe Lincoln in Illinois “the finest piece of propaganda ever to come into our theater. . . . To the satisfied and the smug, it will seem subversive to its very core. And they will be right. . . . It is the very battle cry of freedom.” [2] [12]
 Other pro-intervention movies were:
Other pro-intervention movies were:
- Pastor Hall [13](1940): This film tells the story of a Christian minister put in a Nazi prison camp. It is probably more fiction than fact.
- That Hamilton Woman [14] (1941): Starring Vivian Leigh, it compares Hitler to Napoleon and endorses war against dictators.
- Mrs. Miniver [15] (1942): This film follows the life of a happy upper-middle-class English family that participates in the Dunkirk evacuation and the following Battle of Britain. It is the best of the pro-war films of the early 1940s.
No Hollywood movies were portraying the Communists in Europe during the 1920s and 30s in a poor light. There was nothing about Germans stranded in dysfunctional new Eastern European nations following the collapse of the Austro-Hungarian Empire. There was nothing about Bela Kun, Soviet atrocities, or Gulags. The pro-intervention movies were “propaganda with a very thick coating of sugar.” [3] [16]
An Incident Was Inevitable . . .
By late 1941, the Battle of Britain was over, but the Roosevelt administration had drafted many young men into the armed forces where they trained with wooden rifles or trucks labeled “tank.” Morale was low, and the economy had not shifted to producing war equipment. Meanwhile, Roosevelt also adopted the Lend-Lease Policy. This allowed the British to get American aid, and it effectively made America a British ally, albeit a non-belligerent one.
By this point, Lindbergh felt that war was inevitable. It was only a matter of time before some incident would draw the United States into the fray. On September 11, 1941, Lindbergh decided to deliver a speech [17] explaining which factions had pushed America into a corner. He identified the three factions as the British, the Roosevelt administration, and the Jews. The Des Moines speech was entirely true, and it led to an explosion in the national conversation. Any criticism of Jewish interests carries the charge of anti-Semitism. [4] [18] Olson argues that the speech caused the American public to focus on Jewish issues rather than avoiding entry into the conflict.
The incidents were already on the way, though, so it hardly mattered. The US Navy was escorting merchant ships to Britain as far as Iceland, and the USS Greer had already fired shots at a German U-Boat.
Between September and December 1941, the isolationists retained a solid grip on the public mind and confined pro-war activists a great deal. Wrinkles from the USS Greer incident could be smoothed over. Then isolationist newspaper, the Chicago Tribune, owned by the isolationist Robert R. McCormick, published a leaked War Department plan to fight Germany. Ironically, the plan was created by a pro-German American army officer, Albert Coady Wedemeyer, and it was used when war came. The leak was probably made by US Army Air Forces General “Hap” Arnold.

Then came Pearl Harbor.
In the wake of the devastation in Hawaii, the isolationists admitted that the United States had to go to war — with Japan. And the President agreed with them. The US only declared war on Japan. It was Hitler who declared war on the United States following the attack. Had that not occurred, it is highly likely that America would have cut aid to England and Russia and focused on the Pacific. The conflict in Europe would have played out far differently.
Charles Lindbergh spent the war as an industry consultant. He ceased criticism of Roosevelt and became a test pilot and aircraft developer. The pro-German Wedemeyer helped the invasion of Normandy and became a general officer. Other prominent America First activists joined the war effort and did heroic service. One of them, Gerald Ford, eventually became president. Another isolationist who became president was John Kennedy. Indeed nearly all the isolationists turned out to be heroes later, but most had to “disavow,” to a degree, their previous activism.
The far-Right of the isolationists, William Dudley Pelley and Laura Ingalls [19] (the aviator, not the girl from Little House on the Prairie) (photo) were sent to jail for a time under trumped-up charges.
 America First and isolationism still matter. Indeed, the isolationists were not proved wrong. They could claim that they had kept America neutral until it was attacked by a treacherous foe. They did, however, make mistakes that can be discussed in retrospect.
America First and isolationism still matter. Indeed, the isolationists were not proved wrong. They could claim that they had kept America neutral until it was attacked by a treacherous foe. They did, however, make mistakes that can be discussed in retrospect.
Isolationist Failings
The Second World War was not caused by Hitler, it was caused by the reaction to his rise to power. Hitler was greeted with the same hysteria by the same sorts of people that got hysterical over Trump. Hitler’s movement could have been tempered by the ordinary workings of the representative government, but an Antifa mattoid burned down the Reichstag, allowing Hitler to assume emergency powers.
Additionally, the British drew the red line against Hitler in the wrong place. It should have been drawn between Germany and France and Germany and the Low Countries. Instead, it was drawn at Poland. Once the British and French drew the line in Poland, it was only a matter of time before the United States was involved due to the many ties between the two nations. In the end, isolationism came apart when the Japanese attacked Pearl Harbor.
There was also never creative output on the part of the isolationists that matched the pro-war effort. Anne Lindbergh’s book that supported America First ideas, The Wave of the Future, was difficult to understand. Futurist books are always iffy. In addition to good movies, the interventionists had Dr. Seuss as a cartoonist who portrayed isolationists as ostriches with their heads in the sand. There were also many pro-intervention newspaper editors and reporters.

America’s Yankee elite was terribly divided. Yankees from the Mid-West tended to support isolationism. Those in New England wanted preparedness, if not outright interventionism. Meanwhile, the hostile organized Jewish community was united in pushing for war. Therefore, criticism of Jews as war agitators could be balanced by many examples of blue-blooded Northeastern WASPs who were members of Jew-free country clubs that supported interventionism.
Epilogue
The isolationists did shape policy to such a degree that the British paid a dear price for World War II. To get the Lend-Lease Act passed, Roosevelt pressured the British government to sell large British holdings in the United States. [5] [20] This action was repeated enough times that by the end of the conflict, Britain had debts and no assets to generate income to pay the debts. Additionally, the Labour Party made several poor economic decisions after they came to power at the end of the war. The British were the richest and most powerful people in the world in 1914. By the winter of 1946, the British were on food rations and they were suffering a coal shortage.
The isolationists were also not wrong about Jewish and Communist influence on American policy. In the aftermath of World War II, the political Right in Hollywood organized a blacklist and removed the worst of the lot. American cultural products flourished afterward. The music, movies, and television of the 1950s remain the gold standard. Consider that there are TV channels devoted to shows from the 50s and early 60s, but none replay the 1980s sitcom Head of the Class or the late 1970s’ Welcome Back Kotter. The America First Right also used the various tools — anti-subversion acts, anti-totalitarianism measures, et cetera that were designed for use against American “Nazis” — against Communists.
The interventionists were right about other things too. It became standard wisdom that “dictators” were always a threat, and Hitler could have been “stopped at Munich” before the war. Events in Iraq, Egypt, and Libya during the Arab Spring have proven that anarchy is far worse than “dictators.” Furthermore, stopping “aggression” at some figurative “Munich” is not always a viable option. Those who escalated the Vietnam War genuinely believed they were stopping a “Hitler” at the “Munich” of South Vietnam.
The questions raised by the America First and isolationist movements remain valid today. How far should America go to support an ally? How can we take sides in far-off wars involving nations with vastly different cultures than our own? How big should America’s military be? When is the right time to get involved?
Notes
[1] [21] Wilmot Robertson, The Dispossessed Majority (Cape Canaveral, Florida: Howard Allen Press, 1981), p. 187.
[2] [22] Ibid., 109.
[3] [23] Ibid., 409.
[4] [24] One of Lindbergh’s supporters during this time was Kurt Vonnegut. He would go on to serve in the Battle of the Bulge and was a prisoner of war in Dresden when it was firebombed in 1945. Vonnegut would go on to write Slaughter House Five, perhaps one of the greatest anti-war works of literature.
[5] [25] For further reading on this matter, I suggest The Last Thousand Days of the British Empire (2009).
00:16 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, états-unis, america first, isolationnisme, charles lindbergh, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 09 août 2020
Julius Evola: The Philosopher & Magician in War: 1943-1945
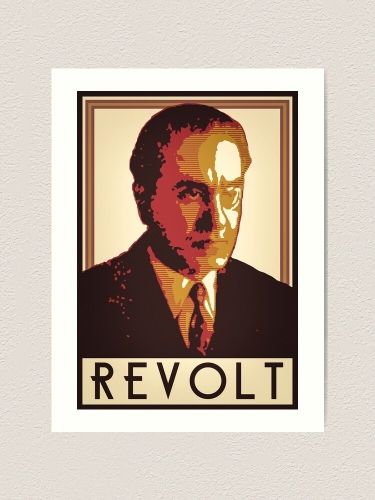
Julius Evola:
The Philosopher & Magician in War: 1943-1945
By Collin Cleary ex: http://www.counter-currents.com
Gianfranco de Turris
Julius Evola: The Philosopher and Magician in War: 1943–1945
Rochester, VT: Inner Traditions, 2020
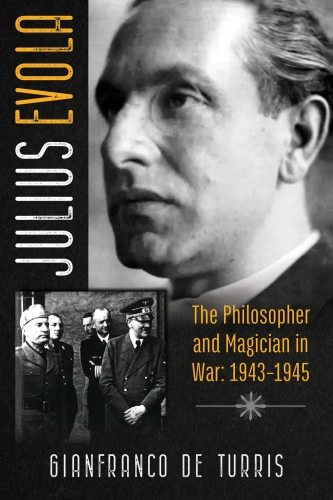 This English translation of Gianfranco de Turris’s Julius Evola: Un filosofo in guerra 1943–1945 has come along at just the right time, for it shows us how a great man coped both with societal collapse and with personal tragedy. As the title implies, the book focuses on Evola’s activities during the last two years of the Second World War. However, de Turris goes considerably beyond that time frame, dealing with much that happened to Evola after the war, up until about 1950.
This English translation of Gianfranco de Turris’s Julius Evola: Un filosofo in guerra 1943–1945 has come along at just the right time, for it shows us how a great man coped both with societal collapse and with personal tragedy. As the title implies, the book focuses on Evola’s activities during the last two years of the Second World War. However, de Turris goes considerably beyond that time frame, dealing with much that happened to Evola after the war, up until about 1950.
De Turris’s main objectives in this work are to solve a number of mysteries about Evola’s activities at the end of the war, and in the post-war years, and to respond to the philosopher’s critics. Because, until now, so little has been known about these years in Evola’s life, they have been the object of a great deal of speculation, especially on the part of hostile, Left-wing writers. De Turris has uncovered fascinating new information about Evola’s activities and provided definitive answers to a great many lingering questions.
The book begins with an episode that will doubtless be the focus of most critical reviews: Evola’s journey to Hitler’s headquarters in August–September 1943. As the war dragged on, public opinion in Italy had begun to turn against Mussolini, especially after Rome was bombed by the Allies for the first time on the 19th of July. Several members of the government had turned against Mussolini, and the Duce felt compelled to summon the Fascist Grand Council for the first time since the beginning of the war. This turned out to be a mistake, for it passed a motion of no confidence in Mussolini, effectively giving King Victor Emmanuel the power to dismiss him. Mussolini, however, behaved as if nothing of significance had occurred. He appeared for an audience at the royal palace the next day, prepared to brief the King on recent events. Instead, the King had Mussolini arrested and imprisoned in a hotel atop Gran Sasso mountain, the highest peak in the Apennines.
The story of Mussolini’s daring rescue (on the 12th of September) by German commandos flying gliders, led by the legendary Otto Skorzeny, is one of the most famous episodes of the war. Mussolini was immediately flown to Munich and then to Hitler’s HQ (“Wolf’s Lair”) in East Prussia. When he arrived on the 14th of September, Julius Evola had already been there for several days. The philosopher was part of a delegation chosen by the Germans to help advise them on what course to take in Italy. The delegation also included the Duce’s son, Vittorio.
Their journey from Italy was undertaken at considerable risk. The plane carrying Evola narrowly escaped interception by Allied aircraft. On the ground, Evola and others were disguised for part of their journey in Waffen SS caps and coats. Once the philosopher had arrived at Wolf’s Lair, he and the other members of the delegation were received by Joachim von Ribbentrop who communicated to them Hitler’s wish that “the Fascists who remained faithful to their belief and to the Duce were to immediately initiate an appeal to the Italian people announcing the constitution of a counter-government that confirmed loyalty to the Axis according to the commitment first declared and then not maintained by the King” (quoting Evola’s account, p. 20).
Believe it or not, this is one of the less interesting parts of de Turris’s book. Far more interesting is what happens to Evola later. Those already familiar with the details of Evola’s life will know what is coming: his flight from Rome, his injury in Vienna, and his long recovery in the years immediately following the war. This part of the book is more interesting not just because it fills in many blanks in Evola’s biography, but because it reveals a more “human” side to the philosopher. I apologize if this seems a somewhat maudlin way to speak of a man like Evola, but I can think of no alternative.
Those who have read Evola extensively know that the philosopher can often seem as remote as the peaks he climbed in his youth. In de Turris’s account, however, we find an Evola who is initially depressed and dispirited by the outcome of the war, and by his injury. He struggles to make sense out of why these things have occurred, and he struggles to define what his mission must be in the post-war situation. Eventually, he emerges triumphant, but it is instructive to see not only how he overcomes his struggles, but that he struggles. In facing our current situation, in which the Western world (especially the US) seems to be falling down around our ears, Evola’s example gives us strength. We see that even Evola, even this “differentiated type” (to use his terminology) had to struggle with adversity — but that he overcame.

On June 4, 1944, the Allies captured Rome. One of the first things their agents did, just hours after entering the city, was to pay Julius Evola a call. Allied intelligence had learned that Evola’s name was on a list of intended agents of a German-led “Post-Occupational Network” for espionage and sabotage (his codename was “Maria”). They showed up at Evola’s apartment, no doubt with the intention of arresting and interrogating him. However, Evola’s elderly mother detained them at the entrance, while the philosopher slipped unnoticed out a side door. The one thing he took with him was a suitcase containing the materials that would eventually become the three-volume Introduction to Magic (Introduzione alla magia).
Evola then embarked on a long and arduous journey. On foot, he made his way out of the city and located the retreating German troops. They gave him shelter, and eventually, he wound up in Vienna, where he lived under an assumed name. Exactly why Evola headed for Vienna has been something of a mystery, and de Turris spends a good deal of time on it. Incredibly, it appears that Evola went to Vienna to undertake research on Freemasonry at the request of the SD (Sicherheitsdienst; the “Security Service” of the SS)! The SD’s “Office VII” had been engaged in Freemasonic studies, and they were not going to interrupt it for a small thing like the apocalypse.
Evola later told an associate that the SD had assigned him the task of “a purification work and ‘return to the origin’ of the Freemasonic rituals found during the war by the German troops in various countries” (p. 158). Evola was not sure exactly why the SD was interested in this. Had they sent him in search of the Ark of the Covenant, it would hardly be more surprising. In case it is not obvious what Freemasonry had to be “purified” of, Evola actually makes this clear in his autobiography The Path of Cinnabar (Il cammino del cinabro): “[Freemasonry] initially had an initiatic character but later, in parallel with its politicization, had moved to obey and subject itself to anti-traditional influences. The final outcome was to act out the part as one of the main secret forces of world subversion, even before the French Revolution, and then in general solidarity with the revolution of the Third State [sic]” (quoted in de Turris, p. 159; The translator means “Third Estate,” which, in the French Ancien Régime, was made up of the peasants and bourgeoisie).
 On January 21, 1945, Evola decided to take a walk through the streets of Vienna during an aerial bombardment by the Americans (and not the Soviets, as has been erroneously claimed). While he was in the vicinity of Schwarzenbergplatz, a bomb fell nearby, throwing Evola several feet and knocking him unconscious. He was found and taken to a military hospital. When the philosopher awoke hours later, the first thing he did was to ask what had become of his monocle. Once the doctors had finished looking him over, the news was not good. Evola was found to have a contusion of the spinal cord which left him with complete paralysis from the waist down. As Mircea Eliade notoriously said, the injury was roughly at the level of “the third chakra.” It resulted in Evola being categorized as a “100-percent war invalid,” which afforded him the small pension he received for the rest of his life.
On January 21, 1945, Evola decided to take a walk through the streets of Vienna during an aerial bombardment by the Americans (and not the Soviets, as has been erroneously claimed). While he was in the vicinity of Schwarzenbergplatz, a bomb fell nearby, throwing Evola several feet and knocking him unconscious. He was found and taken to a military hospital. When the philosopher awoke hours later, the first thing he did was to ask what had become of his monocle. Once the doctors had finished looking him over, the news was not good. Evola was found to have a contusion of the spinal cord which left him with complete paralysis from the waist down. As Mircea Eliade notoriously said, the injury was roughly at the level of “the third chakra.” It resulted in Evola being categorized as a “100-percent war invalid,” which afforded him the small pension he received for the rest of his life.
Why did Evola go for a walk during a bombing raid? Eliade erroneously claimed that Evola “went to fight on the barricades against the Soviet Russian advance on Vienna” (p. 128). Evola provides an answer himself, in a hitherto unpublished letter to the wife of the Austrian conservative philosopher Othmar Spann:
. . . I would always challenge destiny, so to speak. And from here originate my acts of folly on the glaciers and mountains: hence the principle of my not caring or having any concern about the aerial bombardments. And the same goes for when I was in Vienna when the situation had exacerbated to the point of severe danger. . . . In the end I was caught by a carpet bombing in Schwarzenberg. [p. 125]
But when Evola went out walking that fateful day, he had expected that his destiny would be either to live or to die. He was not expecting that he might be destined to live out the rest of his days as a cripple. This turn of events seems to have utterly perplexed the philosopher, and he struggled to make sense of why this had happened to him, and at that point in his life. Matters were complicated by Evola’s belief, stated years later in The Path of Cinnabar, that “there is no significant event in existence that was not wanted by us before birth” (quoted in de Turris, p. 169).
In the same letter to Erika Spann, Evola writes: “What is not clear to me is the purpose of the whole thing: I had in fact the idea — the belief if you want to call it, naïve — that one either dies or reawakens. The meaning of what has happened to me is one of confusion: neither one nor the other motive” (p. 170). De Turris refers to the “incomprehension and disillusionment” Evola experienced “at the outcome and aftermath of the war” (p. 54). The philosopher had been struggling to understand the cataclysm that had engulfed Europe and destroyed Fascism and National Socialism, concerning which he had cautiously nurtured certain hopes. Now, additionally, he had to make sense of why fate had chosen to permanently cripple this Western kshatriya, this man of action. It is difficult to imagine the desolation and inner turmoil Evola had to endure in the years immediately following the war. Again quoting the letter to Frau Spann: “In this world today — in this world of ruins — I have nothing to do or look for. Even if tomorrow everything magically returns to its place, I would be here without a goal in life, empty. All the more so in this condition and in this clinic” (pp. 199-200).
 Evola was eventually transferred to a hospital in Bad Ischl, where he received better treatment. De Turris offers a rather harrowing account of the various operations and therapies used to treat Evola, mostly without success. Despite his condition, while at Bad Ischl, Evola actually traveled to Budapest, where he remained for a couple of months before returning to Austria. Little is known about what Evola was doing in Budapest or who helped him get there (though we now know the address at which he was living). De Turris argues persuasively that Evola went there to be treated by the famous Hungarian neurologist, András Pető, who had some success in the treatment of paralysis using unconventional methods. Unfortunately, he was not able to help Evola.
Evola was eventually transferred to a hospital in Bad Ischl, where he received better treatment. De Turris offers a rather harrowing account of the various operations and therapies used to treat Evola, mostly without success. Despite his condition, while at Bad Ischl, Evola actually traveled to Budapest, where he remained for a couple of months before returning to Austria. Little is known about what Evola was doing in Budapest or who helped him get there (though we now know the address at which he was living). De Turris argues persuasively that Evola went there to be treated by the famous Hungarian neurologist, András Pető, who had some success in the treatment of paralysis using unconventional methods. Unfortunately, he was not able to help Evola.
From the beginning, Evola had entertained the possibility that his paralysis was “psychic” in nature. He was encouraged in this belief by René Guénon, with whom he continued to correspond from his hospital bed in Bad Ischl. Guénon wrote to him:
According to what you tell me, it would seem that what really prevents you from recovering is more of a psychic nature than physical; if this is so the only solution without doubt would be to provoke a contrary reaction that comes forth from your own self. . . . Besides, it isn’t at all impossible that something might have taken advantage of the opportunity provided by the lesion to act against you; but it’s not at all clear by whom and why this may have occurred. [p. 148]
In fact, there does seem to be something mysterious about Evola’s condition. In 1952, he was visited in his apartment by several associates, including the anthroposophists Massimo Scaligero and Giovanni Colazza. During this visit, the men saw Evola move his legs – something that, given his paralysis, should have been completely impossible. After leaving Evola’s presence, they were naturally eager to discuss this. It was reported that Colazza said to Scaligero, “Of course he could! But he doesn’t! He does not want to do it” (p. 197).
Setting this mystery aside, Evola appears to have become reconciled to his condition by reminding himself that, after all, the body is but a temporary vehicle for the spirit. In a letter to a friend, he states that “in regard to my situation — even if I had to remain forever like this, which is not excluded — it spiritually does not signify anything more for me than if my car had a flat tire” (p. 168). Another friend, a Catholic priest, naïvely suggested that Evola travel to Lourdes in hopes of a miracle cure at the Sanctuary of our Lady. Evola responded with kindness and patience, saying, “I have already told you how little this thing means to me . . . The basic premise, which is that of an ardent desire for a healing, is first of all lacking. If grace were to be asked for, it would rather be to understand the spiritual meaning as to why this has happened — whether it remains this way or not; even more so, to understand the reason for my continuing to live” (pp. 168-69).
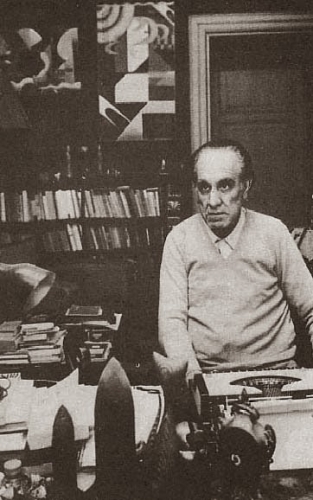 And, in time, Evola does seem to have come to some understanding of why fate had dealt him this hand, though he never made public these very personal reflections. On the eve of the philosopher’s return to Italy in August 1948, his doctor at Bad Ischl reported that “the general state of the patient has improved considerably in these last days, the initial depressions have become lighter, the irascibility and the problems of relationship with the nursing staff and patients have declined markedly” (p. 176). Indeed, one imagines that Evola was not an ideal patient. He wrote to Erika Spann of the “spirit-infested atmosphere of the diseases of these patients” (p. 193; italics in original).
And, in time, Evola does seem to have come to some understanding of why fate had dealt him this hand, though he never made public these very personal reflections. On the eve of the philosopher’s return to Italy in August 1948, his doctor at Bad Ischl reported that “the general state of the patient has improved considerably in these last days, the initial depressions have become lighter, the irascibility and the problems of relationship with the nursing staff and patients have declined markedly” (p. 176). Indeed, one imagines that Evola was not an ideal patient. He wrote to Erika Spann of the “spirit-infested atmosphere of the diseases of these patients” (p. 193; italics in original).
What undoubtedly lifted Evola’s spirits is that he had at last defined what was to be his post-war mission. In The Path of Cinnabar, he writes that
The movement in the post-war period should have taken the form of a party and performed a function analogous to that which the Italian Social Movement [MSI] had conceived for itself, but with a more precise traditional orientation, belonging to the Right, without unilateral references to Fascism and with a precise discrimination between the positive aspects of Fascism and the negative ones. [Quoted in de Turris, p. 54]
Concerning this, de Turris comments that “all of his [post-war] publishing activities and book-writing projects were specifically oriented in this direction” (p. 54). In 1949, Evola began writing again, initially under the penname “Arthos.” He wrote in bed, in pencil, with a lap desk placed before him, or he used a typewriter, seated at his desk in front of the window. His French biographer, Jean-Paul Lippi, referred to him as “an immobile warrior.”
Around this time, Evola learned that he had become an idol of Right-wing youth in Italy. In September 1950, he addressed the National Youth Assembly of the MSI in Bologna. The inclusion of Evola seems to have been last-minute. The organizers heard that the philosopher was staying at a nearby hospital and paid him an impromptu visit. One of the men present offers this moving account of what happened next:
We introduced ourselves and invited him to attend the assembly. He made himself immediately available and expressed great interest. He asked us if he could have the time only to change and shave. I remember that in his haste he had a small cut on his cheek. We carried him in our arms and placed him in the German military truck. Upon entering the assembly hall he was warmly welcomed by our group and since Evola was unknown to me as a thinker, Enzo Erra introduced him as a heroic invalid of the Italian Social Republic. On stage, while I was supporting him, I noticed that he was pleasantly surprised and moved by the welcome of hundreds of young people. He silently fixed his attention and listened intently to the various interventions, and at the end of the proceedings we took him back to the hospital. It was at that moment that we had the idea of asking him to write a booklet that would be a guide, and that was how the Orientamenti was born. The next day we accompanied him to a small mountain hotel in the Apennines. [p. 207]
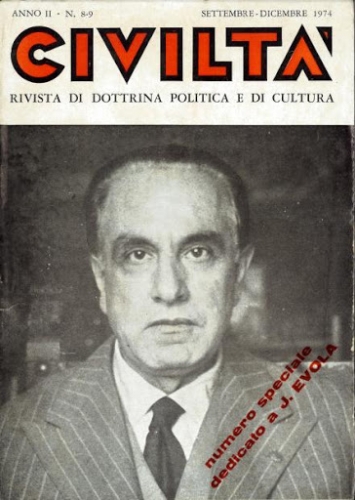 Julius Evola was back. Indeed, he wrote some of his most important books in the post-war years: Men Among the Ruins, The Metaphysics of Sex, Ride the Tiger, The Path of Cinnabar, Meditations on the Peaks, and others. Arguably, he enjoyed far more influence after the war than he ever did before. Disturbed by his influence on the youth, Italian authorities arrested Evola in May 1951 and put him on trial for “glorifying Fascism.” He was acquitted — something that would be unimaginable in today’s world, given its unironic concern with “social justice.”
Julius Evola was back. Indeed, he wrote some of his most important books in the post-war years: Men Among the Ruins, The Metaphysics of Sex, Ride the Tiger, The Path of Cinnabar, Meditations on the Peaks, and others. Arguably, he enjoyed far more influence after the war than he ever did before. Disturbed by his influence on the youth, Italian authorities arrested Evola in May 1951 and put him on trial for “glorifying Fascism.” He was acquitted — something that would be unimaginable in today’s world, given its unironic concern with “social justice.”
This book is required reading for admirers of Evola, and students of traditionalism generally. It should also be read by Leftist critics of Evola — though it will not be, or, if it is, the contents will be distorted and misrepresented. You see, de Turris does almost too thorough a job of demolishing Evola’s detractors. One wishes, in fact, that he had spent a little less time jousting with these people, as they all come off as dishonest lightweights. Still, I suppose it is necessary. And “jousting” is an appropriate term, as de Turris’s defense of his mentor is gallant and virile in the best tradition of the “aristocrats of the soul.” He has learned from a master, and in his voice we sometimes hear an echo of Evola’s own. De Turris is well-qualified to tell Evola’s story: he knew the philosopher personally, and is the executor of his estate.
Among the fine features of this volume are two interesting appendices. The first consists of illustrations, some of which are fascinating. One is a reproduction of the top of a cigar box signed by the men present at Wolf’s Lair, including Evola, Vittorio Mussolini, and others. The second appendix consists of hitherto-unpublished translations of several articles Evola wrote in 1943 for La Stampa, the daily newspaper in Turin. I will close with a quote from one of these, which is not only prescient, given Evola’s fate after 1943, but also particularly relevant to the situation in which we now find ourselves:
From one day to another, and even from one hour to another, an individual can lose his home to a bombardment: that which has been loved the most and to which one was most attached, the very object of one’s most spontaneous feelings. . . . It has become blatantly clear . . . as a living fact accompanied with a feeling of liberation: all that is destructive and tragic can have value to inspire. This is not about sensitivity or badly understood Stoicism. Quite the contrary: it is a question of knowing and nurturing a sense of detachment from oneself, people, and things, which should instill calm, unparalleled security, and even . . . indomitability. . . . A radical breakdown of the “bourgeois” that exists in every person is possible in these devastating times. . . . [To] make once more essential and important what should always be in a normal existence: the relationship between life and more than life . . . During these hours of trials and tribulations the discovery of the path, where these values are positively experienced and translated into pure strength for as many people as possible, is undoubtedly one of the main tasks of the political-spiritual elite of our nation. [pp. 261–62]
If you want to support our work, please send us a donation by going to our Entropy page [3] and selecting “send paid chat.” Entropy allows you to donate any amount from $3 and up. All comments will be read and discussed in the next episode of Counter-Currents Radio, which airs every Friday.
Don’t forget to sign up [4] for the twice-monthly email Counter-Currents Newsletter for exclusive content, offers, and news.
13:22 Publié dans Histoire, Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, histoire, livre, italie, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, gianfranco de turris, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 juin 2020
Eric Vanneufville : « L’abbé Gantois appréciait les qualités humaines de l’abbé Perrot »

Flandres/Bretagne:
Eric Vanneufville : « L’abbé Gantois appréciait les qualités humaines de l’abbé Perrot »
[Interview]
11:21 Publié dans Entretiens, Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abbé gantois, flandre, flandre française, bretagne, abbé perrot, entretien, livre, histoire, deuxième guerre mondiale, autonomismes, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 juin 2020
Comment des «samouraïs russes» se sont battus pour le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale

Comment des «samouraïs russes» se sont battus pour le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale
Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr
La victoire des bolcheviks lors de la guerre civile russe a contraint des centaines de milliers de Russes à quitter le pays. Avec leurs enfants, ils ne cessaient d'espérer qu'ils pourraient un jour rentrer chez eux et renverser ce pouvoir soviétique qu'ils détestaient tant.
Mais si de nombreux émigrants russes en Europe ont parié sur Hitler pour leur lutte contre l'URSS, ceux qui se sont installés en Extrême-Orient ont choisi de s'allier à l'Empire du Japon.
Alliés
À partir des années 20, les Japonais ont tissé des liens avec les Russes blancs s'étant installés dans le Nord-Est de la Chine, dans la région de Mandchourie. Lorsque l'armée japonaise du Guandong a occupé la région en 1931, une grande partie de la population l'a donc soutenue dans sa lutte contre les troupes chinoises.


Soldats de l'armée blanche en Chine.
L'État fantoche de Mandchoukouo a été proclamé sur les territoires de Mandchourie et de Mongolie intérieure et Puyi, dernier empereur de Chine, a été placé à sa tête. Cependant, le réel pouvoir était entre les mains des conseillers japonais et du commandement de l'armée du Guandong.
Les Japonais et les Russes se sont alors unis sur la base de leur rejet commun du communisme. Ils avaient besoin les uns des autres dans la guerre de « libération » contre l'Union soviétique qui s'annonçait.
>>> Rouges vs. blancs: le jour où les ennemis jurés sont devenus alliés
Les « samouraïs russes »
Comme le proclamait l'idéologie officielle du Mandchoukouo, les Russes étaient l'un des cinq peuples « indigènes » du pays, et avaient les mêmes droits que les Japonais, Chinois, Mongols et Coréens qui y vivaient.
Démontrant leur attitude bienveillante envers les Russes blancs émigrés, les Japonais les ont activement impliqués dans leur bureau de renseignement en Mandchourie, l'Agence Spéciale de Harbin. Comme l'a noté Michitarō Komatsubara, son dirigeant : « Ils sont prêts à n'importe quel sacrifice matériel, et acceptent avec joie toute entreprise dangereuse pouvant mener à la destruction du communisme ».
En outre, des détachements militaires russes ont été créés pour protéger les principales infrastructures de transport contre les attaques des Honghuzi, des bandits locaux. Plus tard, ces détachements seront impliqués dans des opérations contre les partisans chinois et coréens.
Les « samouraïs russes », comme le général Genzo Yanagita appelait les Russes blancs qui collaboraient avec les Japonais, ont reçu une formation à la fois militaire et idéologique.Généralement, ils étaient indifférents, voire favorables, à l'idée de construire la Grande Asie orientale sous l'égide du Japon, mais leur projet d'annexer toutes les terres russes jusqu'en Oural les irritait grandement, ce qu'ils devaient soigneusement cacher.
« Nous avons filtré tout ce que les orateurs nous disaient, et nous ne gardions pas en tête tout ce qui avait un esprit trop nippon qui ne correspondait pas à notre esprit russe »,a témoigné l’un des cadets, un certain Goloubenko.


Le détachement Asano
Le plus important des détachements militaires russes créés par les Japonais était le détachement Asano, nommé en l'honneur de son commandant, le major Asano Makoto. Selon les époques, il comptait entre 400 et 3 500 soldats.
>>> Harbin, étonnante ville chinoise construite par les Russes et refuge des tsaristes
Fondé le jour de l'anniversaire de l'empereur Hirohito, le 29 avril 1938, le détachement comprenait des unités d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. Basés à Mandchoukouo, les soldats du détachement Asano étaient toutefois entièrement supervisés par l'armée japonaise.
Les soldats de cette unité secrète se préparaient à mener des opérations de sabotage et de surveillance sur les terres de l'Extrême-Orient soviétique lors de la guerre à venir contre l'URSS. Les soldats d'Asano devaient en effet prendre ou détruire les ponts et nœuds de communication importants, s'infiltrer dans les camps d'unités soviétiques et y empoisonner la nourriture et les sources d'eau.
L'Empire du Japon a par deux fois pu se confronter au potentiel militaire de l'Armée rouge : d'abord en 1938, lors de la bataille du lac Khassan, puis en 1939 lors de la bataille de Khalkhin Gol. Les soldats d'Asano ont été envoyés dans les zones de combats, où ils s'occupaient principalement des interrogatoires des prisonniers de guerre.
On peut trouver des informations sur des heurts militaires entre les soldats du détachement et leurs adversaires. Ainsi, lors de la bataille de Khalkhin Gol, un détachement de cavalerie de la République populaire mongole a rencontré les cavaliers du détachement Asano, mais les soldats mongols les ont d'abord pris pour les leurs ; cette erreur leur a presque à tous coûté la vie.
>>> Portraits de descendants d’émigrés blancs en France
Un nouveau rôle
Fin 1941, les dirigeants japonais ont abandonné l'idée d'une « guerre éclair » contre l'URSS, connue sous le nom de « plan Kantokuen ». En 1943, il devenait clair que les incursions japonaises en Extrême-Orient soviétique n’auraient lieu sous aucune forme.

Les Japonais ont par conséquent procédé à la réforme des unités russes. Les soldats russes sont passés de leur détachement spécial dédié à la surveillance et au sabotage, à l'armée générale. Ainsi, le détachement Asano, qui avait perdu son statut de détachement secret, est devenu subordonné au 162e régiment des fusiliers des forces armées de Mandchoukouo.

Drapeau de l'empereur du Mandchoukouo.
Cependant, les soldats russes étaient encore très appréciés à Tokyo. En mai 1944, Takahito de Mikasa, frère cadet de l'empereur Hirohito, est venu sur les lieux où se trouvaient les soldats d'Asano. Il a prononcé un discours, dans lequel il souhaitait renforcer l'esprit et la formation militaire des peuples japonais et russe.
L’effondrement
La lutte difficile et héroïque de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie a provoqué la croissance rapide des sentiments patriotiques et antijaponais au sein des populations russes de Mandchourie. De nombreux officiers ont alors commencé à coopérer avec les services de renseignements soviétiques. Il s'est d'ailleurs avéré que l'un des dirigeants du détachement Asano, Gourgen Nagolian, était en fait un agent du NKVD.
>>> Comment le dernier empereur chinois est tombé entre les mains de l'Armée rouge
Quand l'Armée rouge a envahi la Mandchourie, le 9 août 1945, les détachements de soldats russes ont réagi différemment : une petite partie d'entre eux a résisté, mais est rapidement tombée avec les troupes de Mandchoukouo. Le major soviétique Piotr Melnikov se souvenait que les soldats du côté japonais criaient souvent en russe pour perturber les soldats soviétiques, afin qu'ils ne puissent pas distinguer leurs ennemis de leurs alliés.

Arrivée des troupes soviétiques en Mandchourie.
La majorité des Russes a choisi de changer de camp. Ils ont arrêté leurs commandants nippons, organisé des détachements de partisans pour combattre les Japonais, et pris le contrôle de villages pour les livrer aux troupes soviétiques qui arrivaient. Il est même arrivé que les relations entre les soldats de l'Armée rouge et les Russes blancs émigrés soient amicales, et ces derniers étaient autorisés à assurer la garde de certains sites.
Mais cela a pris fin lorsque les officiers de l'organisation de contre-espionnage de l'Armée rouge SMERCH sont arrivés à la suite des soldats. Moscou disposait en Mandchourie d'un vaste réseau de renseignement et était bien au courant des activités des Russes blancs émigrés lors des années précédentes. Ces derniers ont été massivement déportés en URSS, où les figures les plus importantes ont été exécutées, pendant que les autres ont écopé de jusqu'à 15 ans de détention dans les camps.
Dans cet autre article, découvrez le mystérieux peuple des Aïnous, à cheval entre Japon et Russie.
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
00:30 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, urss, russie, russes blancs, japon, mandchourie, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 juin 2020
Pierre Laval. Une biographie par Renaud Meltz

Pierre Laval. Une biographie par Renaud Meltz
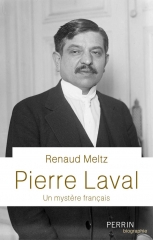 Renaud Meltz vient de livrer, avec les Éditions Perrin, une monumentale et phénoménale biographie de Pierre Laval, l'homme le plus détesté de l'histoire de France. Pacifiste forcené, partant de l’extrême gauche, maire d'Aubervilliers, sénateur, président du Conseil, il bascule vers le centre droit tout en s'enrichissant de façon troublante. Acteur clé de la mort de la République en juillet 40, il invente la Collaboration avec l'Allemagne nazie pensant qu'il "roulera Hitler" et qu'il sera la sauveur de la France. Il finira par céder à tout, à aider au pillage du pays, et à livrer les juifs à la déportation. Renaud Meltz grâce à des archives neuves ou peu exploitées renouvelle profondément la vision que nous avions de Pierre Laval dans ce livre remarquablement écrit et subtilement construit par un mariage réussi de chapitres thématiques et chronologiques. Abonnez vous aux Voix de l'histoire et partagez si vous avez aimé. Merci.
Renaud Meltz vient de livrer, avec les Éditions Perrin, une monumentale et phénoménale biographie de Pierre Laval, l'homme le plus détesté de l'histoire de France. Pacifiste forcené, partant de l’extrême gauche, maire d'Aubervilliers, sénateur, président du Conseil, il bascule vers le centre droit tout en s'enrichissant de façon troublante. Acteur clé de la mort de la République en juillet 40, il invente la Collaboration avec l'Allemagne nazie pensant qu'il "roulera Hitler" et qu'il sera la sauveur de la France. Il finira par céder à tout, à aider au pillage du pays, et à livrer les juifs à la déportation. Renaud Meltz grâce à des archives neuves ou peu exploitées renouvelle profondément la vision que nous avions de Pierre Laval dans ce livre remarquablement écrit et subtilement construit par un mariage réussi de chapitres thématiques et chronologiques. Abonnez vous aux Voix de l'histoire et partagez si vous avez aimé. Merci.
18:53 Publié dans Biographie, Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, pierre laval, biographie, histoire, livre, collaboration, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 mai 2020
Anton Mussert, fasciste batave

Anton Mussert, fasciste batave
par Christophe Dolbeau
Au nombre des leaders fascistes qui ont essaimé dans l’Europe des années 1930, le Néerlandais Anton Mussert est certainement l’un des moins connus du grand public. Chef du Mouvement national-socialiste des Pays-Bas (Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden ou NSB), il est le plus souvent présenté, fort succintement, comme un pâle imitateur d’Adolf Hitler et une piteuse créature des nazis, mais peut-être mérite-t-il mieux que ce portrait sommaire et affligeant.
Un brillant ingénieur
Fils de Johannes Leonardus Mussert (1856-1913), instituteur et directeur d’école, et de Frederika Witlam (1856), Anton Adriaan Mussert – que ses parents nomment couramment « Adje » – vient au monde le 11 mai 1894 à Werkendam, une petite commune du Brabant-Septentrional. Il est le cinquième enfant de la famille (1). D’abord scolarisé dans l’école de son père, il fréquente ensuite le lycée de Gorinchem (Gorkum) où il obtient plutôt facilement son baccalauréat en 1912. Attiré par les voyages et les navires, le jeune homme (qui appartient à l’association Onze Vloot ou Notre Flotte) souhaiterait endosser l’uniforme de la Marine et faire une carrière d’officier, mais sa petite taille (moins d’un mètre soixante-cinq) et une vue déficiente lui barrent irrémédiablement cette voie. Sur les conseils de son père, il décide donc d’entreprendre des études de génie civil. C’est alors qu’éclate la Première Guerre mondiale, ce qui l’incite à se porter volontaire dans l’armée, toujours dans l’espoir d’y faire carrière, à l’instar de son frère aîné Jo. Une fois encore, ses espérances vont être déçues : affecté dans l’artillerie de forteresse, il n’atteint en effet que le modeste grade de caporal, avant d’être réformé (1915) pour un grave problème rénal. Cette fois, le jeune homme se résoud à suivre une voie civile et rejoint l’École Polytechnique de Delft.
Étudiant brillant, Anton Mussert est également un élément particulièrement sérieux qui ne participe jamais aux fêtes étudiantes, ne fume et ne boit pas. Solitaire, on ne lui connaît que deux amis, Willem Schermerhorn (1894-1977), qui sera plus tard Premier ministre, et le Juif Jacob Josephus Jitta (1893-1991) qui restera longtemps l’un de ses proches… Sa formation s’achève le 5 juillet 1918, date à laquelle il décroche, cum laude, son diplôme d’ingénieur. Entre-temps, l’étudiant s’est marié, le 19 septembre 1917, ce qui a soulevé pas mal de vagues au sein de la famille. Âgé de 23 ans, Mussert a en effet épousé, grâce à une dispense royale et malgré l’opposition de sa mère, sa tante Maria Witlam (1876-1951) qui a tout de même 18 ans de plus que lui. [Bien qu’il soit membre de l’Église Réformée et réputé plutôt strict, Anton Mussert aura tout au long de son existence une vie sentimentale agitée. On lui connaît plusieurs liaisons extra-conjugales, notamment avec Jadwiga Rosenblatt (1886-1950), une Juive d’origine polonaise, et avec Marietje (Miep) Mijnlieff, la fille (1923-2016) de sa cousine Helena Mijnlieff-Verburg (1889-1951)]
 Fraîchement diplômé, Mussert entre en 1918 au Service national des eaux (Rijkswaterstaat) puis deux ans plus tard, il intègre le Service provincial des eaux d’Utrecht qui offre une meilleure rémunération. Il passe alors pour un technicien remarquable, doublé d’un homme de qualité « dont la personnalité résultait d’une pensée droite et opiniâtre et qui avait un sens profond de l’ordre, de la règle et des convenances bourgeoises »(2). Remarqué pour son zèle et son efficience, il est d’ailleurs rapidement promu et devient, le 1er novembre 1927, à 33 ans, le plus jeune ingénieur en chef du pays. Son premier véritable engagement politique est lié à sa profession puisqu’il a trait au projet de construction d’un canal reliant le Rhin au port d’Anvers. Jugeant ce plan trop favorable à la Belgique et contraire aux intérêts de Rotterdam, de nombreux patriotes néerlandais s’y opposent. Ils se regroupent au sein d’un Comité d’action (Nationaal Comité van Actie) dont Mussert est le secrétaire, et font campagne contre le traité belgo-hollandais que le gouvernement a signé en 1925. Au final, cette mobilisation porte ses fruits : en 1927, l’accord est rejeté par le Sénat et le ministre des Affaires Étrangères, Herman van Karnebeek, contraint de démissionner. À compter de cette époque, Mussert s’implique de plus en plus dans le débat politique. Probablement influencé par les succès de Mussolini, il se rapproche du Dietsche Bond, la Ligue Thioise, qui milite pour la création de Grands Pays-Bas. On le retrouve aussi dans les rangs de la Nationale Unie ou Union nationale, le mouvement nationaliste et corporatiste du professeur F. C. Gerretson (3).
Fraîchement diplômé, Mussert entre en 1918 au Service national des eaux (Rijkswaterstaat) puis deux ans plus tard, il intègre le Service provincial des eaux d’Utrecht qui offre une meilleure rémunération. Il passe alors pour un technicien remarquable, doublé d’un homme de qualité « dont la personnalité résultait d’une pensée droite et opiniâtre et qui avait un sens profond de l’ordre, de la règle et des convenances bourgeoises »(2). Remarqué pour son zèle et son efficience, il est d’ailleurs rapidement promu et devient, le 1er novembre 1927, à 33 ans, le plus jeune ingénieur en chef du pays. Son premier véritable engagement politique est lié à sa profession puisqu’il a trait au projet de construction d’un canal reliant le Rhin au port d’Anvers. Jugeant ce plan trop favorable à la Belgique et contraire aux intérêts de Rotterdam, de nombreux patriotes néerlandais s’y opposent. Ils se regroupent au sein d’un Comité d’action (Nationaal Comité van Actie) dont Mussert est le secrétaire, et font campagne contre le traité belgo-hollandais que le gouvernement a signé en 1925. Au final, cette mobilisation porte ses fruits : en 1927, l’accord est rejeté par le Sénat et le ministre des Affaires Étrangères, Herman van Karnebeek, contraint de démissionner. À compter de cette époque, Mussert s’implique de plus en plus dans le débat politique. Probablement influencé par les succès de Mussolini, il se rapproche du Dietsche Bond, la Ligue Thioise, qui milite pour la création de Grands Pays-Bas. On le retrouve aussi dans les rangs de la Nationale Unie ou Union nationale, le mouvement nationaliste et corporatiste du professeur F. C. Gerretson (3).
Le national-socialisme néerlandais
À la fin des années 1920 et au début des années 1930, les Pays-Bas n’échappent pas à la récession mondiale : un très fort chômage s’instaure, de nombreuses faillites surviennent, d’innombrables boutiquiers subissent une forte paupérisation, et le climat général du pays s’en ressent. Le Parti social-démocrate et les partis confessionnels se montrent incapables de juguler la crise qui finit même par ébranler les forces armées. Le 5 février 1933, aux Indes orientales néerlandaises, les marins du croiseur De Zeven Provinciën se mutinent et il faudra bombarder le navire pour ramener son équipage à la raison. Dans ce contexte délétère, nombre de Néerlandais espèrent un sursaut national et en viennent à souhaiter un pouvoir fort, capable de prendre des mesures radicales. L’exemple italien impressionne. C’est dans cette perspective que le 14 décembre 1931, Anton Mussert et Cornelis van Geelkerken (1901-1976) fondent, à Utrecht, le Mouvement national-socialiste des Pays-Bas (NSB). Le chef suprême ou Leider en sera Mussert. Contrairement à ce que l’on pourrait croire à la vue de sa dénomination, le nouveau mouvement s’inspire beaucoup plus du fascisme que du national-socialisme allemand. Mussert se vante d’ailleurs de n’avoir jamais lu Mein Kampf et de n’avoir aucune intention de le faire. Admirateur de Mussolini, il se déclare hostile à la démocratie et favorable à un gouvernement fort, mais ne préconise ni racisme ni antisémitisme. Le mouvement comptera d’ailleurs dans ses rangs et parmi ses bailleurs de fonds un certain nombre de Juifs. « Le NSB n’était pas foncièrement antisémite », remarque Anthony Anderson (4), « et certains Juifs hollandais adhérèrent au mouvement ». « Mussert », ajoute Francis Bertin (5), « ne songea pas, du moins pendant les années précédant la Seconde Guerre mondiale, à assumer les options idéologiques nationales-socialistes allemandes : les idées de primauté raciale, de valeur du sang, de Lebensraum, de conception du monde fondée sur un dynamisme du devenir, ne figurèrent nullement dans les idées du NSB ». Le programme du NSB repose avant tout sur quatre valeurs fondamentales : la croyance en Dieu, l’amour de la Patrie, le service et la solidarité. Favorable à l’instauration d’un État corporatif et chrétien, il prône la lutte contre le libéralisme et le marxisme, réclame l’ordre et la vertu, garantit la propriété privée, invoque le nationalisme néerlandais et la fierté nationale, affirme le primat des intérêts nationaux et proclame son attachement à l’empire colonial. En 1937, un document du mouvement précise encore que « le national-socialisme veut instaurer un esprit de volonté, de fierté, de sentiment du devoir, de foi en sa propre force, de droit à l’existence, de sens national, de sentiment de solidarité, de volonté de coopération, de générosité, pour qu’il en résulte une nation florissante et rénovée qui offre la possibilité d’un bien-être moral et physique à ses fils de toutes conditions et de tous métiers » (6). Jusque là, on ne peut pas vraiment dire que la nouvelle formation se montre particulièrement transgressive et subversive.
 Dirigée avec talent et sincérité, elle rencontre en tout cas un indéniable succès. De 1000 adhérents à peine, à ses débuts, elle recrute vite et regroupe déjà 33 000 membres en 1934, puis 52 000 en 1936. Une grande manifestation qu’elle organise à Amsterdam, en 1934, réunit plus de 25 000 personnes. S’inspirant beaucoup de ce qui se fait en Italie et en Allemagne, l’appareil du mouvement est assez complexe. Les militants portent un uniforme noir et saluent à la romaine en prononçant les mots de « Hou Zee » (héritée du langage des marins, cette expression signifie quelque chose comme « Garde le cap ! » ou « Bonne navigation ! »). Le swastika n’a pas cours au NSB, mais le mouvement de Mussert utilise souvent la rune du loup ou crampon (Wolfsangel) qui figure sur certains fanions et oriflammes. Il utilise par ailleurs les anciennes couleurs nationales – orange, blanc et bleu – ou « Prinsenvlag ». À partir de 1936, le drapeau du mouvement se composera, quant à lui, de deux bandes horizontales, noire et rouge, avec au centre un triangle (symbolisant le delta du Rhin) renfermant un écusson aux couleurs orange-blanc-bleu, frappé d’un lion avec flèches et épée et encadré des lettres NSB. Le siège central du NSB est à Utrecht et la formation s’articule en dix-sept districts qui se divisent eux-mêmes en groupes et blocs. Le mouvement dispose d’un hebdomadaire, Volk en Vaderland, d’un quotidien, Het Nationale Dagblad, et d’un mensuel, Nieuw Nederland, qui tous trois atteignent un vaste public (certains numéros spéciaux de Volk en Vaderland seront tirés à 800 000 et même un million d’exemplaires durant la campagne électorale de 1935). Au fil du temps, le NSB se dote d’une organisation féminine, la Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (7) qui édite son propre journal, De Nationaal-Socialistische Vrouw. Il se dote également d’une organisation de jeunesse ou Nationale Jeugdstorm, ainsi que d’une association étudiante ou Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfederatie (NNSS) qui publie le journal De Wig (le groupe prendra en 1940 le nom de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfront). Il existe aussi un Front Paysan ou Boeren Front qui attirera jusqu’à 50 000 agriculteurs. Comme il sied à tout mouvement fasciste de l’époque, le NSB crée en outre un service d’ordre ou Weer Afdeeling (d’abord nommé Weerbaarheids Afdelingen). Composé de douze brigades (avec un effectif global atteignant parfois 15 000 hommes), ce corps de défense possède un hymne spécifique, WA marscheerd (sur l’air du Horst Wessel Lied) et son propre journal, De Zwart Soldaat. Il se double d’un discret service de renseignement ou Centrale Inlichtingen Dienst.
Dirigée avec talent et sincérité, elle rencontre en tout cas un indéniable succès. De 1000 adhérents à peine, à ses débuts, elle recrute vite et regroupe déjà 33 000 membres en 1934, puis 52 000 en 1936. Une grande manifestation qu’elle organise à Amsterdam, en 1934, réunit plus de 25 000 personnes. S’inspirant beaucoup de ce qui se fait en Italie et en Allemagne, l’appareil du mouvement est assez complexe. Les militants portent un uniforme noir et saluent à la romaine en prononçant les mots de « Hou Zee » (héritée du langage des marins, cette expression signifie quelque chose comme « Garde le cap ! » ou « Bonne navigation ! »). Le swastika n’a pas cours au NSB, mais le mouvement de Mussert utilise souvent la rune du loup ou crampon (Wolfsangel) qui figure sur certains fanions et oriflammes. Il utilise par ailleurs les anciennes couleurs nationales – orange, blanc et bleu – ou « Prinsenvlag ». À partir de 1936, le drapeau du mouvement se composera, quant à lui, de deux bandes horizontales, noire et rouge, avec au centre un triangle (symbolisant le delta du Rhin) renfermant un écusson aux couleurs orange-blanc-bleu, frappé d’un lion avec flèches et épée et encadré des lettres NSB. Le siège central du NSB est à Utrecht et la formation s’articule en dix-sept districts qui se divisent eux-mêmes en groupes et blocs. Le mouvement dispose d’un hebdomadaire, Volk en Vaderland, d’un quotidien, Het Nationale Dagblad, et d’un mensuel, Nieuw Nederland, qui tous trois atteignent un vaste public (certains numéros spéciaux de Volk en Vaderland seront tirés à 800 000 et même un million d’exemplaires durant la campagne électorale de 1935). Au fil du temps, le NSB se dote d’une organisation féminine, la Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (7) qui édite son propre journal, De Nationaal-Socialistische Vrouw. Il se dote également d’une organisation de jeunesse ou Nationale Jeugdstorm, ainsi que d’une association étudiante ou Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfederatie (NNSS) qui publie le journal De Wig (le groupe prendra en 1940 le nom de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfront). Il existe aussi un Front Paysan ou Boeren Front qui attirera jusqu’à 50 000 agriculteurs. Comme il sied à tout mouvement fasciste de l’époque, le NSB crée en outre un service d’ordre ou Weer Afdeeling (d’abord nommé Weerbaarheids Afdelingen). Composé de douze brigades (avec un effectif global atteignant parfois 15 000 hommes), ce corps de défense possède un hymne spécifique, WA marscheerd (sur l’air du Horst Wessel Lied) et son propre journal, De Zwart Soldaat. Il se double d’un discret service de renseignement ou Centrale Inlichtingen Dienst.
Dynamique, le NSB effectue une percée significative lors des élections d’avril 1935 où il attire au moins 300 000 électeurs, soit un score encourageant de 7,94% qui lui assure 44 sièges (sur 535) à la Chambre. Joint au décorum menaçant dont s’entoure le mouvement, ce succès électoral inquiète désormais sérieusement les partis traditionnels qui s’accordent tous sur l’impérative nécessité de barrer la route à la formation de Mussert. Dès avril 1934, ce dernier a dû abandonner son emploi suite à la promulgation par le gouvernement d’un décret interdisant à tous les fonctionnaires d’adhérer au NSB. En riposte à cette mesure, le mouvement créera la qualité de « membre secret ». Ces péripéties n’empêchent pas le chef du mouvement d’effectuer une tournée triomphale d’un mois à Java et Sumatra où il compte de nombreux partisans et où le gouverneur général Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958), un sympathisant, le reçoit à deux reprises avec tous les égards. La répression ne cesse pourtant de se durcir : une seconde loi vient interdire aux civils de porter des uniformes, et une troisème prohibe l’usage de drapeaux et insignes politiques. Même les églises s’en mêlent : la hiérarchie calviniste interdit aux fidèles d’adhérer au NSB, tandis que l’Église Catholique menace de priver de sacrements les militants de ce mouvement. Plusieurs lettres pastorales condament explicitement le national-socialisme et adjurent les croyants de s’en tenir éloignés. En juin 1936, Mussert tentera, avec l’aide de Mussolini, de convaincre le Vatican de faire lever ces interdits, mais sa démarche demeurera sans effet.

Germanophilie et répression
Le dénigrement systématique dont le NSB fait l’objet constitue un gros obstacle à son développement car il entretient un hallo négatif autour du mouvement et finit par faire naître des craintes à son sujet. Le phénomène, il faut bien le dire, est facilité par la radicalisation du NSB, au sein duquel l’attraction du nazisme allemand se fait de plus en plus sentir. Le 7 août 1936, le mouvement a reçu l’adhésion de Meinoud Marinus Rost van Tonningen (1894-1945), un ancien haut fonctionnaire de la SDN (8), qui se pose vite en rival de Mussert et en germanophile avéré. Compétent, diligent et efficace, le nouveau venu stimule indubitablement le militantisme, mais il entraîne aussi le NSB dans une direction qui n’était pas initialement celle de ses fondateurs. Des notions nouvelles, le Sang et le Sol (Blut und Erde), l’antisémitisme et la suprématie de l’État intègrent désormais la rhétorique du mouvement et s’affichent à la une de son journal (dont Van Tonningen devient rédacteur en chef). La conséquence de cette réorientation et de la campagne antifasciste est immédiate : les effectifs baissent et aux élections de mai 1937, le score du NSB n’est plus que de 4,22%, ce qui ne lui assure plus que quatre députés et deux sénateurs. Le 16 novembre 1936, Anton Mussert est reçu par Hitler (et à cette occasion, Herman Gœring lui affirme que jamais le Reich ne revendiquera un mètre carré de territoire néerlandais…). À compter de cette époque, et peut-être simplement pour ne pas se laisser déborder par Van Tonningen, il change de ton vis-à-vis des Juifs. Dans une interview qu’il accorde, le 6 octobre 1937, au journaliste américain (et marxiste) Barrie Stavis, Mussert rappelle que les « bons Juifs » peuvent adhérer au NSB (où ils seraient une cinquantaine), mais il ajoute que s’il y a désormais un problème juif aux Pays-Bas, c’est de la propre faute des Israélites : « Moi, je n’ai jamais parlé d’eux avant qu’ils me désignent comme leur ennemi. Mais oui, je suis leur ennemi. Ils constituent une menace pour la civilisation – comme les communistes. Je suis leur ennemi et le resterai » (9). Peu de temps après cette déclaration, le NSB annonce que dorénavant, les Juifs ne pourront plus adhérer au mouvement. En 1938 toujours, Mussert propose officiellement de réunir la Guyane anglaise, la Guyane française et le Surinam pour en faire un foyer national juif. En compensation pour la perte du Surinam, les Pays-bas recevraient une partie du Mozambique portugais. Soumis au Parlement, le projet sera discuté et largement rejeté. Dans la fameuse interview accordée à Stavis, Mussert ne se cache pas non plus d’avoir plus de sympathie pour le Reich que pour le Royaume-Uni : « Avec une flotte pour protéger nos Indes Orientales, je m’allierais à l’Allemagne », déclare-t-il. « Nous appartenons à la même souche germanique et les gens de même race doivent marcher ensemble. De plus, le fascisme doit conquérir le monde » (10).

L'armée néerlandaise pendant la "drôle de guerre".
En septembre 1939, lorsque la guerre éclate entre l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, les Pays-Bas restent neutres, en espérant bien, comme en 1914-18, être épargnés par le conflit. Pour sa part, le NSB (surtout les éléments proches de Rost van Tonningen) ne se cache pas d’être favorable au Reich. Mussert lui-même demeure cependant circonspect. En janvier 1940, il déclare à deux agents allemands qui l’ont approché que ses militants ne se battront jamais contre leurs compatriotes, mais en avril, il affirme à une journaliste américaine de CBS qu’en cas de guerre, les gens du NSB se contenteront d’attendre les Allemands « les bras croisés » (11). Ce positionnement ambigu rend le mouvement suspect et l’expose à toutes sortes de rumeurs malveillantes. Au mois d’avril 1940, le célèbre journaliste Vladimir Poliakoff (« Augur ») annonce, par exemple, dans le New York Times, que le NSB s’apprête à enlever la reine Wilhelmine, ce qui entraîne aussitôt la proclamation de l’état de siège aux Pays-Bas. Le 19 avril, une vingtaine de cadres du NSB sont arrêtés sur soupçon d’appartenance à la 5e colonne. Mussert échappe à la rafle mais il doit désormais se cacher dans une ferme. Les autorités ont la main particulièrement lourde puisque ce sont bientôt 10 000 membres et sympathisants du NSB qui sont arbitrairement internés. Parfois victimes de violences, certains y laisseront la vie : « Sept d’entre eux », écrit A. H. Paape, « trouvèrent la mort dans des fusillades provoquées par la nervosité de leurs gardiens » (12) Finalement, le 10 mai 1940, la Wehrmacht lance une offensive contre les Pays-Bas afin de couper l’herbe sous les pieds des Britanniques qui auraient pu tenter de passer par là pour attaquer le Reich. Puissant et techniquement impeccable, l’assaut ne laisse aucune chance à la petite armée néerlandaise dont le commandant en chef, le général H. G. Winkelman (1876-1952) capitule le 15 mai. Dès le 13, la reine et le gouvernement ont quitté le territoire, confié le pouvoir à des secrétaires généraux, et gagné Londres d’où ils vont diriger la résistance. Durant les brefs combats, le NSB ne fait rigoureusement rien pour aider l’ennemi et les quelque 100 à 200 Hollandais qui assistent les troupes d’invasion proviennent pour la plupart du Parti national-socialiste hollandais des travailleurs ou NSNAP (13), une formation rivale de celle de Mussert. « Après la guerre », précise F. Bertin (14), « les enquêtes menées pour découvrir une complicité pratique du NSB dans l’attaque allemande ne découvrirent rien de positif en ce sens ». À titre personnel, Anton Mussert perd à cette époque son frère Jo. Lieutenant-colonel d’active, ce dernier est abattu, le 14 mai, par deux subalternes égarés qui le soupçonnent, à tort, de vouloir trahir. Il sera totalement réhabilité après-guerre.

Jeu de dupes
À la cessation des hostilités, Anton Mussert pense que les Allemands vont lui confier les rênes du pays et débute alors un grand jeu de dupes qui va durer cinq ans. Le 16 mai 1940, interdiction est faite au Néerlandais de s’exprimer à la radio comme il en avait l’intention. Berlin a d’autres plans. Le 18 mai, le ministre Arthur Seyss-Inquart (15) est nommé Commissaire du Reich aux Pays-Bas (Reichskommissar für die Niederlande) où il entre officiellement en fonction le 29. Outre ce plénipotentiaire, les autorités comprennent le général d’aviation Friedrich Christiansen (1879-1972), commandant en chef de la Wehrmacht, le Brigadeführer SS Hanns Albin Rauter (1895-1949), responsable des services de sécurité et de la police, et l’Oberdienstleiter Fritz Schmidt (1903-1943), délégué du parti nazi. Mussert a bien mandaté le comte d’Ansembourg (16) pour le représenter auprès des occupants mais ceux-ci n’ont a priori aucun désir de coopérer avec le NSB. En fait, Seyss-Inquart s’efforce, dans un premier temps, d’obtenir la coopération de formations moins marquées. C’est dans cette perspective que se constituent un Comité National puis, le 24 juillet 1940, une Union Néerlandaise (Nederlandsche Unie). Approuvée par les secrétaires généraux, cette Union Néerlandaise – qui n’a rien à voir avec le NSB – est en phase avec les ex-Présidents du Conseil Hendrikus Colijn et Dirk Jan de Geer (17) qui reconnaissent la primauté de l’Allemagne et prônent tous deux une collaboration dans la dignité. Le nouveau groupement est bien accueilli par la population et recrute près de 400 000 membres en deux mois ; en février 1941, il compte déjà 800 000 adhérents et montera même jusqu’au million. Rappelons au passage que les Pays-bas n’ont alors que 8,7 millions d’habitants. Prête à collaborer, l’Union Néerlandaise se montre néanmoins rétive à toute tentative de germanisation et de nazification, ce qui contrarie le Reichskommissar et finit par entraîner, en décembre 1941, la dissolution de l’association. Autre groupe à subir les foudres de Seyss-Inquart, le parti social-démocrate qui est interdit en juin 1941. Durant un an, l’occupant a essayé, en vain, de prendre le contrôle de ce parti, ainsi que des syndicats, mais ils ont préféré se saborder plutôt que de se soumettre…
 À ce stade, il ne reste plus pour « collaborer » que les partis et mouvements qui se réclament d’une idéologie proche du nazisme, à savoir le NSB, le NSNAP et le Zwart Front. À l’instar des anciens Présidents du Conseil que nous avons déjà mentionnés (et de nombreux autres politiciens européens), Anton Mussert pense que l’Allemagne a définitivement gagné la partie, et que la collaboration est « l’unique chance qui reste à la Hollande de préserver son indépendance dans la future Europe hitlérienne » (18). Le 5 juin 1940, il rencontre donc Seyss-Inquart qui ne possède pas une très haute opinion du chef fasciste. « Le Leider du NSB », note F. Bertin, « restait attaché à l’autonomie de la Hollande et l’esprit profond du national-socialisme lui restait étranger » (19). Mussert multiplie cependant les gestes de bonne volonté, dont tous ne sont d’ailleurs pas très habiles : ainsi, le 22 juin 1940, lors d’une étrange « fête de la Libération », offre-t-il une cloche en bronze de trois tonnes à Herman Gœring, alors qu’un mois plus tôt, le 14 mai, la Luftwaffe a bombardé Rotterdam, tué un millier de civils et fait 80 000 sans abri…
À ce stade, il ne reste plus pour « collaborer » que les partis et mouvements qui se réclament d’une idéologie proche du nazisme, à savoir le NSB, le NSNAP et le Zwart Front. À l’instar des anciens Présidents du Conseil que nous avons déjà mentionnés (et de nombreux autres politiciens européens), Anton Mussert pense que l’Allemagne a définitivement gagné la partie, et que la collaboration est « l’unique chance qui reste à la Hollande de préserver son indépendance dans la future Europe hitlérienne » (18). Le 5 juin 1940, il rencontre donc Seyss-Inquart qui ne possède pas une très haute opinion du chef fasciste. « Le Leider du NSB », note F. Bertin, « restait attaché à l’autonomie de la Hollande et l’esprit profond du national-socialisme lui restait étranger » (19). Mussert multiplie cependant les gestes de bonne volonté, dont tous ne sont d’ailleurs pas très habiles : ainsi, le 22 juin 1940, lors d’une étrange « fête de la Libération », offre-t-il une cloche en bronze de trois tonnes à Herman Gœring, alors qu’un mois plus tôt, le 14 mai, la Luftwaffe a bombardé Rotterdam, tué un millier de civils et fait 80 000 sans abri…
Quiproquo
Le problème majeur auquel Mussert ne va cesser de se heurter, c’est que les Allemands ne partagent absolument pas sa vision des choses. Lorsqu’il envisage une alliance avec le Reich, ses interlocuteurs songent à une annexion pure et simple. « À sa façon », remarque justement A. Anderson (20), « Mussert était un ardent patriote. Pour lui, il était tout simplement impensable que la Hollande devînt un territoire allemand ». Afin de sauver les apparences, au plan constitutionnel, le juriste Johan Herman Carp (1893-1979) suggère de placer Mussert à la tête du Conseil d’État, ce qui ferait un peu de lui le régent du royaume et l’autoriserait à conclure la paix avec l’Allemagne. Cette astucieuse solution permettrait d’officialiser l’alliance avec l’Allemagne et reconnaîtrait implicitement l’indépendance des Pays-Bas. Le 16 août 1940, c’est sans surprise que le Commissaire du Reich refuse ce plan. La survie des Pays-Bas ne figure décidément pas à l’agenda nazi. En témoigne encore l’attitude de la censure qui empêche la publication d’un article où Mussert affirme : « Nous n’avons jamais demandé et nous ne demanderons jamais à devenir Allemands, pas plus que nous ne demanderons jamais à un Allemand de devenir Néerlandais. Nous aimons notre pays et notre drapeau, tout comme ils aiment les leurs » (21). Le chef du NSB pourrait s’en tenir là et se retirer du jeu mais tel n’est pas son choix. À la fin août 1940, il signe une « Note sur l’union des peuples germaniques » (Bond van Germaansche volkeren) et se rend, le 23 septembre suivant, à Berlin pour y soumettre son projet à Hitler. Mussert souhaite non seulement sauver l’indépendance de sa patrie, mais propose aussi de créer de Grands Pays-Bas qui comprendraient la Hollande, la Frise, les Flandres et une partie du nord de la France, et s’appuieraient sur les colonies néerlandaises, le Congo et la communauté sud-africaine des Afrikaans (22). Cet « empire thiois » serait bien sûr le vassal et l’obligé du Reich. Plus tard, il évoquera à nouveau une union nordique – avec respect des langues vernaculaires, des religions, des fiertés nationales, des coutumes et des cultures – seule capable, selon lui, de tenir tête aux USA, au Japon et à l’URSS. Il va sans dire que le Führer ne se prononce pas…
Parallèlement à leurs manœuvres avec l’Union Néerlandaise, les Allemands s’efforcent d’instrumentaliser Mussert et le NSB sans leur accorder rien de concret. Le 30 juin 1941, Seyss-Inquart supprime tous les partis politiques sauf le NSB, ce qui a pour conséquence d’attirer dans le mouvement la plupart des militants du NSNAP et du Zwart Front. Cet afflux d’éléments pro-nazis vient sensiblement renforcer Rost van Tonningen et l’aile germanophile du NSB. Le mouvement avoisine dès lors les 100 000 adhérents. Les occupants ne prennent pas Mussert au sérieux et préfèrent de toute évidence travailler avec Van Tonningen qui prône ouvertement l’absorption des Pays-Bas par le Reich. Hostile à cette ligne, Mussert ne possède visiblement ni l’énergie ni le tempérament de s’y opposer fermement. « En faisant de la surenchère », notent P. Milza et M. Benteli, « les partisans de Van Tonningen vont obliger Mussert à s’engager plus loin dans la voie de la collaboration mais sans qu’il se soit jamais rallié à leurs vues pangermanistes » (23). « Sa force et son caractère », renchérit A. H. Paape (24), « étaient insuffisants pour en faire autre chose qu’un jouet aux mains des Allemands ; il fit de plus en plus de concessions importantes, et il se laissa récompenser par des promesses qui ne se concrétisèrent qu’à peine ».
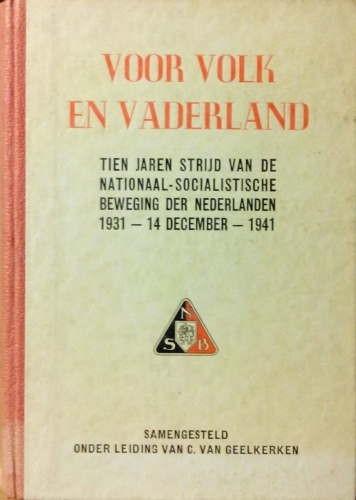 Un chef impuissant
Un chef impuissant
Au nombre des déficiences de Mussert, il faut tout d’abord mentionner son incapacité à garder le contrôle de ses troupes. Défavorable au recrutement de SS au sein de son mouvement, il finit cependant, dès juin 1940, par céder aux pressions de Gotlob Berger et Hanns Albin Rauter. De jeunes militants rejoignent donc le régiment “Westland“ puis la 5e division blindée “Wiking“. Le 11 septembre 1940, Mussert charge même Johan Hendrikus Feldmeijer (1910-1945) de créer une SS Générale néerlandaise (Nederlandsche SS, puis, à partir du 1er novembre 1942, Germaansche SS in Nederland). Théoriquement indépendante des Allemands, cette organisation (7000 hommes, répartis en 5 régiments territoriaux) se présente comme la garde du Leider, mais en pratique, elle échappe largement à son emprise et servira de vivier à la Waffen-SS. Les relations de Mussert avec l’institution SS seront toujours exécrables. Venu inspecter, en décembre 1940, la SS Générale néerlandaise, le Dr Joseph Grohmann accuse le NSB de n’être qu’un « repaire de Juifs et de francs-maçons » (25). Quant au chef du NSB, c’est à son corps défendant qu’il finit par autoriser l’enrôlement de ses adhérents dans la Waffen-SS. Ce faisant, il perd toute autorité sur eux. En juin 1941, peu après l’annonce de l’attaque contre l’URSS, Arnold Meijer (1905-1965), chef du Nationaal Front, lance un appel à la constitution d’une légion de volontaires ou Vrijwilligerslegioen Nederland. Relayée par Mussert et le général Hendrik Alexander Seyffardt (1872-1943), ancien chef d’état-major de l’armée royale, l’idée fait vite son chemin : le 27 juillet, les premières recrues, largement issues du NSB, défilent à La Haye, avant de partir pour Debica, en Pologne. Chapeautés par la Waffen-SS, ce qui n’était pas prévu, ces hommes vont se battre dans le secteur de Leningrad, puis en Croatie, avant d’intégrer la 4e brigade SS “Nederland“ (1943) et de constituer enfin la 23e division SS “Nederland“. Tout ce que Mussert obtient de Berlin, c’est que ces soldats puissent porter sur le bras un écusson aux couleurs du Prinsenvlag (orange-blanc-bleu). Il aurait bien voulu en outre qu’ils ne prêtent pas serment à Hitler mais il ne pourra l’éviter. Lui-même sera d’ailleurs appelé, le 12 décembre 1941, à prouver sa loyauté au Reich en prêtant serment au Führer, en présence de Martin Bormann et du ministre Hans Lammers. Au total, près de 30 000 Néerlandais passeront par la Waffen-SS, quelque 8000 par le NSKK et 14 000 par l’Organisation Todt. Ajoutons qu’outre ces formations militaires ou paramilitaires, il existe également, aux Pays-Bas, un Front du Travail (NAF), avec près de 600 000 membres, et un Service du Travail (NAD) de 20 000 recrues. Sur tous ces gens, Mussert n’a aucun pouvoir.
Quels que soient les efforts de Mussert, ses relations avec la SS restent mauvaises. Réticent à l’égard de la personnalité même du Néerlandais (dont il considère notamment le mariage comme un inceste) et très hostile aux idées « européistes » du Leider, Himmler favorise ostensiblement Rost van Tonningen et les tenants de la Grande Allemagne. Ses adjoints ne sont pas plus tendres : dans une lettre en date du 14 novembre 1942, le Brigadeführer Rauter juge que « Mussert est un petit-bourgeois, intérieurement ennemi des Allemands et Hollandais cent pour cent », avant de préconiser carrément « d’anéantir le NSB » (26). Cyniques, les Allemands continuent toutefois à se servir du mouvement néerlandais, mais sans offrir grand chose en contrepartie. Le 10 décembre 1942, Hitler reçoit Mussert auquel il octroie officiellement le titre de Leider van het Nederlandsche volk ou Guide du peuple néerlandais. Il ne s’agit néanmoins que d’un titre purement honorifique et le pouvoir réel demeure aux mains de Seyss-Inquart. Cette « promotion » est annoncée avec un certain éclat aux Hollandais, le 13 décembre, à l’occasion du 11e anniversaire du NSB. Elle incite Mussert à constituer (janvier 1943), autour de Johan Herman Carp, une espèce de cabinet fantôme (Gemachtigden van den Leider) de neuf secrétaires d’État (dont ses rivaux Rost van Tonningen et Cornelis van Geelkerken). Ces hommes n’ont qu’un rôle consultatif, ce qui n’empêche pas la résistance d’abattre rapidement trois d’entre eux ! De plus en plus audacieuse, cette résistance (en l’occurrence le groupe communiste CS-6) s’en prend aussi au vieux général Hendrik Seyffardt qui est abattu sur le pas de sa porte, le 5 février 1943 (il mourra le lendemain), ainsi qu’au président de la Chambre de Culture, Hermannus Reydon, qui est assassiné le 23 août suivant. Suite à cette multiplication d’actes hostiles, les Allemands déclenchent – contre l’avis de Mussert – une vaste campagne de représailles, l’opération « Silbertanne », qui coûtera la vie à plus de 50 otages. Ils créent aussi une police auxiliaire (Hulppolitie) et exigent que les militants du NSB se muent désormais en supplétifs de leurs services de sécurité. Le général Hanns Albin Rauter place d’ailleurs le service de renseignement du NSB sous son autorité directe, tandis que l’on procède (mars 1943) au recrutement d’une Garde Nationale ou Landwacht que commanderont Van Geelkerken et Arie Johan Zondervan. Il y aura encore, en 1945, la constitution d’une seconde unité SS, la 34e division “Landstorm Nederland“, grâce à l’enrôlement de miliciens NSB. Ces mesures ne relèvent aucunement de Mussert qui se trouve placé au pied du mur et ne peut que cautionner ou s’effacer.
Un autre sujet de friction entre le Leider et les Allemands concerne la politique antisémite de ces derniers. Quoiqu’il ait tenu, à partir de 1938, des propos très hostiles à la communauté israélite, Anton Mussert n’a jamais été un antisémite fanatique. Entraînés par plus extrémistes que lui, nombre de membres du NSB prêtent cependant la main aux rafles qu’organise la police nazie, quand ils n’opèrent pas, de leur propre chef et pour leur propre compte, quelques exactions. Plus de 105 000 Juifs sont alors arrêtés et déportés. Dans les camps de transit situés aux Pays-Bas (Westerbork, Bois-le-Duc, Amersfoort), ils sont souvent gardés par des policiers ou des SS hollandais. Pusillanime, Mussert ne proteste pas mais s’associe discrètement au plan du secrétaire général à l’Intérieur K. J. Frederiks qui entreprend de « sécuriser » certains Juifs (artistes, intellectuels, anciens combattants).
 Ceux-ci sont placés dans deux résidences protégées, De Schaffelaar et Huize de Briezen, à Barneveld, ou encore à la Villa Bouchina, à Doetinchem. Dans ce dernier lieu séjournent notamment neuf Juifs (27), dont l’illustrateur Jo Spier (photo), un ami personnel de Mussert (28). Cette protection ne suffira malheureusement pas à empêcher la déportation des intéressés qui finiront tout de même par être expédiés vers le ghetto de Theresienstadt. La répression ne vise pas que les Juifs mais frappe toute la population néerlandaise. Après l‘échec de l’opération « Market Garden » (parachutage de troupes alliées près d’Arnhem) qui s’est accompagnée d’une grève générale des chemins de fer, Seyss-Inquart riposte en bloquant, de novembre 1944 à février 1945, l’approvisionnement des grandes villes. On parlera d’hiver de la faim (hongerwinter) et le manque de nourriture fera au moins 18 000 morts. Là encore, Mussert se tait. Il est d’autant plus impuissant que le 5 septembre 1944 (le mardi fou ou « Dolle Dinsdag »), ses partisans, pris de panique, se sont massivement enfuis en Allemagne avec femmes et enfants. Près de 65 000 d’entre eux campent près de Lunebourg, en Basse-Saxe. Ceux qui sont restés, les plus décidés, se rangent désormais derrière les Allemands et abandonnent le Leider à son sort ; Van Tonningen et Van Geelkerken ayant été démis de leurs fonctions de vice-présidents du NSB, Mussert se trouve dans un grand isolement. Comme l’écrit A. H. Paape, « son parti, son mouvement n’avaient pas besoin d’être liquidés à l’heure de la libération du territoire ; ils étaient morts depuis longtemps » (29).
Ceux-ci sont placés dans deux résidences protégées, De Schaffelaar et Huize de Briezen, à Barneveld, ou encore à la Villa Bouchina, à Doetinchem. Dans ce dernier lieu séjournent notamment neuf Juifs (27), dont l’illustrateur Jo Spier (photo), un ami personnel de Mussert (28). Cette protection ne suffira malheureusement pas à empêcher la déportation des intéressés qui finiront tout de même par être expédiés vers le ghetto de Theresienstadt. La répression ne vise pas que les Juifs mais frappe toute la population néerlandaise. Après l‘échec de l’opération « Market Garden » (parachutage de troupes alliées près d’Arnhem) qui s’est accompagnée d’une grève générale des chemins de fer, Seyss-Inquart riposte en bloquant, de novembre 1944 à février 1945, l’approvisionnement des grandes villes. On parlera d’hiver de la faim (hongerwinter) et le manque de nourriture fera au moins 18 000 morts. Là encore, Mussert se tait. Il est d’autant plus impuissant que le 5 septembre 1944 (le mardi fou ou « Dolle Dinsdag »), ses partisans, pris de panique, se sont massivement enfuis en Allemagne avec femmes et enfants. Près de 65 000 d’entre eux campent près de Lunebourg, en Basse-Saxe. Ceux qui sont restés, les plus décidés, se rangent désormais derrière les Allemands et abandonnent le Leider à son sort ; Van Tonningen et Van Geelkerken ayant été démis de leurs fonctions de vice-présidents du NSB, Mussert se trouve dans un grand isolement. Comme l’écrit A. H. Paape, « son parti, son mouvement n’avaient pas besoin d’être liquidés à l’heure de la libération du territoire ; ils étaient morts depuis longtemps » (29).
Une triste fin
La situation militaire semblant définitivement compromise, Anton Mussert envisage de rejoindre le NSKK en qualité de simple chauffeur de camion, mais il n’aura pas le temps de mettre ce plan à exécution. Victime, le 25 avril 1945, d’un accident de voiture, il se retrouve à l’hôpital Maria Stichting, à Haarlem – où il échappe de justesse à un enlèvement par des résistants – puis à l’hôpital Bronovo de La Haye. Sorti le 4 mai et rentré à Utrecht, au siège du NSB, il y apprend la capitulation des troupes allemandes du secteur et prend dès lors ses dispositions pour se rendre aux nouvelles autorités. Le 7 mai 1945, il avertit la police locale qu’il se tient à sa disposition : aussitôt appréhendé, il est incarcéré à Scheveningen. C’est la fin du NSB.

L'arrestation de Mussert.
L’épuration qui débute alors est extrêmement rigoureuse puisqu’elle entraîne le placement en détention de 150 000 à 200 000 personnes. Toutes ne restent pas incarcérées, mais selon Paul Sérant (30), il y a encore, en octobre 1945, 96 000 prisonniers politiques, dont 24 000 femmes. Même les enfants paient le prix fort puisque 12 000 d’entre eux sont placés dans des foyers provisoires et 8000 dans des camps spéciaux. En ce qui le concerne, le Leider est jugé les 27 et 28 novembre 1945 à La Haye, dans la salle de bal du Palais Kneuterdijk. Accusé de collaboration avec l’ennemi, de violation de la Constitution et de haute trahison, Mussert soutient que son seul but fut d’éviter l’annexion, de sauver la souveraineté néerlandaise, et de garantir la place du royaume dans la future Europe de Hitler. Reconnu coupable, il est condamné à mort le 12 décembre. Son appel ayant été rejeté (20 mars 1946), le condamné rédige une lettre d’adieu au peuple néerlandais. Dans ce document, daté du 28 mars 1946, il justifie son engagement politique, met en parallèle son action et celle de la résistance, et compare enfin son sort à celui de Johan van Oldenbarnevelt et Johan de Witt, qui furent tous deux injustement condamnés à mort au XVIIe siècle (31). Le 5 mai 1946, la reine Wilhelmine rejette son recours en grâce, ce qui scelle définitivement le sort de l’ex-Leider. Deux jours plus tard, le 7 mai 1946, Anton Mussert est extrait de sa cellule vers 6h du matin. Accompagné de son beau-frère, Willem Torpstra, du révérend Sijbrandij et de deux gardiens, il gagne, en voiture, le Waalsdorpvlakte, un site où 250 résistants ont été passés par les armes durant l’Occupation. Le peloton d’exécution est déjà en place et à 6h 30, tout est terminé. « La mort de tout homme, même celle de Mussert, mérite le respect », écrit sobrement le journal socialiste Het Vritje Volk.
La saga du Leider néerlandais ne s’arrête pas tout à fait là. Inhumée anonymement dans un carré particulier du cimetière central de La Haye, sa dépouille mortelle ne va pas y rester. Dans la nuit du 16 au 17 juin 1956, un commando de vétérans du Front de l’Est et de militants flamands du Vlaams Militanten Orde enlève en effet le cercueil et va le réenterrer dans un lieu secret, probablement en Flandre. Dirigée par le nationaliste flamand Bert Eriksson (1931-2005), il s’agit de l’opération « Wolfsangel ». Fort marries, les autorités néerlandaises prétendront par la suite que le commando s’est trompé de cercueil et que les restes de Mussert ont été ensevelis dans une fosse commune et mélangés à d’autres… Le mystère demeure.

Mussert dans sa cellule.
Soixante-quinze ans après l’exécution d’Anton Mussert, il est permis de s’interroger sur l’équité de la peine qui l’a frappé. Sincère et apparemment désintéressé (32), le chef du NSB ne fut probablement pas le pire des protagonistes de cette tragique époque. On peut certes lui reprocher d’avoir volontairement collaboré avec l’occupant et ce faisant cautionné les excès de ce dernier. On peut également regretter la consternante docilité dont il s’obstina à faire preuve durant cinq ans. Il faut cependant tenir compte du fait que ses choix, ou ses silences, n’eurent jamais pour but de servir « méchamment » (33) les intérêts de l’ennemi ni de desservir ses compatriotes. Mussert pensait, naïvement sans aucun doute, défendre son pays et en assurer la survie. Lorsque des crimes furent commis, ce fut le plus souvent à l’initiative d’individus qui prétendaient agir en son nom, mais qui opéraient en fait pour le compte de la police nazie. Si l’on compare enfin la sanction maximale qui lui fut infligée à celles qui frappèrent d’autres collaborationnistes de premier plan, force est de conclure que sa condamnation fut plus emblématique que vraiment appropriée. Il fallait exorciser une collaboration qui n’avait pas été que purement symbolique et permettre aux Pays-Bas de figurer dignement dans le cortège des vainqueurs antifascistes. Il fallait donc un symbole, un archétype de traître à châtier, et ce fut assez logiquement le fondateur et Leider du NSB. À côté de cela, Jan Eduard de Quay (1901-1985), qui avait dirigé l’Union Néerlandaise, sera anobli et deviendra même Premier ministre (1959). Vice-président du NSB, chef des jeunesses, inspecteur de la Landwacht et SS-Oberführer, Cornelis van Geelkerken (1901-1979) sortira de prison en 1959. L’ancien ministre-président Dirk Jan de Geer (1870-1960) s’en tirera avec un an de détention et une amende de 2000 florins ; le chef du Front du Travail, Hendrik van Woudenberg (1891-1967) sera libéré en 1956 ; Arie Johan Zondervan (1910), inspecteur de la Landwacht et vétéran du Front de l’Est, sera libéré en 1951, et Jacobus Schrieke, patron de la police, en 1955… Incarnation désignée de la trahison et bouc émissaire de toutes les frustrations de la défaite et de l’occupation, personne n’aurait compris, en 1946, que Mussert ne fût pas fusillé. Pour les Néerlandais, son procès et sa fin ne furent pas tant une question de justice qu’un exutoire collectif.
Christophe Dolbeau
Notes:
(1) Au total, il y a eu sept enfants, à savoir Josephus (Jo) Adrianus (1880-1940), Maarten (Max) Johan (1882-1941), Jacobus Frederik (1884-1884), Helena (Leni) Arnolda Frederika (1887-1954), Anton Adriaan (1894-1946), Frederika Johanna (1899-1900) et Jakoba (Coby) Maria (1898-1981).
(2) Voy. A. H. Paape, « Le mouvement national-socialiste en Hollande – Aspects politiques et historiques », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 17e année, n° 66, p. 35.
(3) Le Dr Frederik Carel Gerretson (1884-1958) était professeur d’histoire coloniale à l’Université d’Utrecht. Co-fondateur en 1925 de l’Union Nationale, il fut aussi l’un des dirigeants de l’Union Historique Chrétienne (calviniste). Défenseur de la Royal Dutch et de l’empire, il fut sénateur en 1951.
(4) Voy. Anthony Anderson, « A Forgotten Chapter. Holland Under the Third Reich », conférence donnée le 17 octobre 1995 à l’Université de Californie du Sud.
(5) Voy. F. Bertin, L’Europe de Hitler, vol. 1, Paris, Librairie Française, 1976, p. 185.
(6) Ibid, p. 186.
(7) dirigée notamment par A. M. van Hoey Smith-van Stolk, Olga de Ruiter-van Lankeren Matthes (1902-1982), Elisabeth Keers-Laseur (1890-1997) et Julia op ten Noort (1910-1994).
(8) Né en Indonésie et fils de général, Meinoud Marinus van Tonningen fut durant dix ans le représentant de la SDN à Vienne où il se lia au chancelier Dollfuss. Chargé par Seyss-Inquart de la liquidation des partis de gauche néerlandais, il fut également président de la Banque Nationale des Pays-Bas (et fut peut-être tué, le 6 juin 1945, car il en savait trop long sur certaines transactions financières ayant eu lieu sous l’Occupation).
(9) Voy. Barrie Stavis, « Holland Has a Führer Too », New Masses du 4 janvier 1938, p. 17-18. [Les propos que Stavis (1906-2007) met dans la bouche de Mussert semblent sujets à caution car ce journaliste (et futur dramaturge) ne fait pas montre à l’égard du chef du NSB d’une grande objectivité. Dans le même texte, il parle en effet « de sa bestialité, de son opportunisme, de son fanatisme barbare, de sa vanité de paon et de son peu de compassion et d’humanité » (sic). Il existe de nombreuses photographies de Mussert et chacun peut y constater que le Néerlandais possédait un physique assez banal, bréviligne et bien découplé. Or Stavis le décrit comme « petit, avec un ventre rond et bien nourri, une paire de bajoues et un double menton » ; plus loin, il évoque « ses yeux bleus, froids, et bordés de rouge », ainsi que « sa bouche mauvaise et cruellement mince, semblable à une fente » (p. 17). Après l’avoir encore comparé à une grenouille, il conclut en affirmant que c’est un piêtre orateur, peu convaincant et dépourvu de charisme (p. 18). Il semble que l’on soit donc bien fondé à douter des propos qu’il rapporte…]
(10) Ibid, p. 17.
(11) Cité par F. Bertin, op. cit., p. 192.
(12) Voy. A. H. Paape, op. cit., p. 47.
(13) Fondé en 1931, le Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij est une petite formation, très antisémite, dirigée par l’économiste Ernst Herman van Rappard (1899-1953).
(14) Voy. F. Bertin, op. cit., p. 195.
(15) Avocat de formation, l’Autrichien Arthur Seyss-Inquart (1892-1946) a été chancelier puis gouverneur (Reichstatthalter) d’Autriche et vice-gouverneur de Pologne occupée, avant d’être nommé Commissaire du Reich aux Pays-Bas. Condamné à mort à Nuremberg, il a été exécuté par pendaison le 16 octobre 1946.
(16) Ancien maire d’Amstenrade et sénateur du Limbourg, le comte Maximilianus Victor Eugène Hubertus Josef Maria de Marchant et d’Ansembourg (1894-1975) sera Commissaire du Limbourg durant l’Occupation. Condamné en 1946 à 15 ans de détention, il sera libéré en 1954.
(17) Avocat et deux fois président du Conseil des ministres, Dirk Jan de Geer (1870-1960) a d’abord émigré à Londres en mai 1940, avant de rentrer aux Pays-Bas et d’y publier une brochure conseillant aux habitants de coopérer avec les Allemands.
(18) Voy. Pierre Milza et Marianne Benteli, Le Fascisme au XXe siècle, Paris, Éditions Richelieu, 1973, p. 318.
(19) F. Bertin, op. cit., p. 208.
(20) Voy. A. Anderson, op. cité.
(21) Voy. Paul Sérant, Les vaincus de la Libération, Paris, Robert Laffont, 1964, p. 335.
(22) Dans le même esprit, Mussert et Van Tonningen demanderont à Alfred Rosenberg (1893-1946), le ministre des Territoires de l’Est, d’octroyer aux Pays-Bas des zones de colonisation en Russie [où existent d’ailleurs, près d’Irkoutsk, des villages de « Hollænders » ayant conservé leurs traditions néerlandaises]. Entre 1941 et 1944, quelques centaines de Néerlandais partiront effectivement s’établir en Biélorussie et en Russie – Voy. Geraldien von Frijtag, « Le projet colonial hollandais pendant la Seconde Guerre mondiale », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe [en ligne].
(23) Voy. P. Milza et M. Benteli, op. cit., p. 318.
(24) Voy. A. H. Paape, op. cit., p. 54.
(25) Voy. F. Bertin, op. cit., p. 216.
(26) Ibid, p. 214.
(27) Il était prévu à l’origine d’en accueillir 63…
(28) Dessinateur humoristique et publicitaire, Joseph Eduard Adolf Spier (1900-1978) fut par la suite déporté à Theresienstadt où il collabora, en 1944, au tournage d’un film (Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet). Émigré aux USA après la guerre, il y poursuivit sa carrière d’illustrateur.
(29) Voy. A. H. Paape, op. cit., p. 59.
(30) Voy. P. Sérant, op. cit., p. 338.
(31) Voy. Franz W. Seidler, Die Kollaboration, Munich-Berlin, Herbig, 1999, p. 397.
(32) Nous disons « probablement » car une chercheuse, le Dr Tessel Pollmann, soutient que Anton Mussert aurait possédé cinq maisons, une imprimerie, une maison d’édition, une villa, ainsi que des antiquités dérobés à des Juifs, soit une fortune évaluée à un million de florins de 1945 (ou 5 millions d’euros actuels) – voy. Haaretz du 8 avril 2009 (« Researcher : Dutch Nazi Collaborator Stole Millions »). Cette affirmation paraît bien étonnante et bien tardive. S’agissant pour la plupart de biens immobiliers difficiles à dissimuler, on peut s’étonner qu’il n’en ait jamais été fait état lors de la procédure engagée contre Mussert en 1945…
(33) Ce furent les Belges qui introduisirent cette notion très subjective dans leur Code pénal, après la Première Guerre mondiale. Elle était destinée à souligner le caractère malveillant de certains actes délictuels.
 Bibliographie
Bibliographie
– Paul Sérant, Les vaincus de la Libération, Paris, Robert Laffont, 1964.
– A. H. Paape, « Le mouvement national-socialiste en Hollande – Aspects politiques et historiques », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 17e année, n° 66 (avril 1967).
– Lawrence D. Stokes, « Anton Mussert and the NSB : 1931-45 », History, vol. 56, n° 188 (octobre 1971).
– Pierre Milza et Marianne Benteli, Le Fascisme au XXe siècle, Paris, Éditions Richelieu, 1973.
– Francis Bertin, L’Europe de Hitler, vol. 1, Paris, Librairie Française, 1976.
– Franz W. Seidler, Die Kollaboration, Munich-Berlin, Herbig, 1999.
– Jan Meyers, Mussert, een politiek leven, Soesterberg, Aspekt, 2005.
– Tessel Pollmann, Mussert and Co, Amsterdam, Boom, 2012.
11:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoon mussert, pays-bas, deuxième guerre mondiale, collaboration, seconde guerre mondiale, histoire, hollande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 avril 2020
Un Anglais chez Mussolini: James Strachey Barnes

Un Anglais chez Mussolini: James Strachey Barnes
par Christophe Dolbeau
À propos du fascisme britannique, on connaît surtout la célèbre British Union of Fascists ainsi que la figure majeure de son chef, Sir Oswald Mosley (1896-1980)-(1). On connaît beaucoup moins, en revanche, le personnage de James Strachey Barnes, un intellectuel anglais qui joua un certain rôle dans l’Italie fasciste. Beaucoup plus discret et moins scabreux que John Amery (2) ou William Joyce (3), Barnes fut, dès la fin des années 1920 et jusqu’au milieu des années 1950, l’un des grands thuriféraires anglo-saxons du fascisme et de Mussolini, ce qui mérite bien un petit coup de projecteur.
Un gentleman complet
Fils de Sir Hugh Shakespear Barnes (1853-1940), haut-commissaire britannique au Baloutchistan, et de Winifred Strachey, James (ou Jim) Strachey Barnes voit le jour le 7 septembre 1890 à Shimla, dans le nord-ouest de l’Inde. Il a une sœur aînée, Mary, et il est le cousin du futur grand écrivain et critique Giles Lytton Strachey (1880-1932). Très tôt orphelins de mère, les enfants Barnes ne restent pas longtemps dans le Raj : en 1892, ils partent en effet pour Florence où résident leurs grands-parents qui vont les élever. À l’issue de cette première phase italienne, Jim est envoyé en Angleterre pour y être scolarisé. Il fréquente d’abord l’école préparatoire St Aubyns, à Rottingdean, puis entre, en 1904, au très chic collège de Eton. De là, il rejoint ensuite l’académie militaire de Sandhurst (1909), avant de voyager un peu (dans les Balkans notamment) et d’intégrer King’s College, à Cambridge, pour y étudier l’arabe. En fait, son père souhaiterait le voir faire carrière dans l’administration anglo-égyptienne, alors que Jim s’intéresse bien plus à l’économie et à la philosophie…
De toute manière, ce cursus incertain s’interrompt brutalement en août 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. D’abord mobilisé dans un régiment de cavalerie de la Garde, Jim rejoint peu après le Royal Flying Corps, ancêtre de la RAF, où il sert comme pilote. C’est en cette qualité qu’il prend part à la bataille de la Somme (juillet-novembre 1916), puis à la bataille de Passchendaele (juillet-novembre 1917), et enfin à celle de Vittorio Veneto (octobre-novembre 1918). Vers la fin du conflit, il est commandant et assure la liaison entre les aviations britannique et italienne ; efficace et parfaitement bilingue, ses services sont appréciés, au point que l’ambassadeur d’Italie à Londres suggère même que lui soit décerné l’Ordre de la Couronne d’Italie. De ces quatre ans de guerre, qui furent pour lui « une grande aventure chevaleresque et individuelle », Barnes conserve, en tout cas, un souvenir plutôt positif. Dans le premier volume de ses Mémoires (4), il parle d’une vie quelque peu dissolue, ponctuée de blagues, de libations, de parties de cartes et de grivoiseries. Il raconte aussi qu’en guise de porte-bonheur, il emmenait toujours avec lui un bouchon de Veuve Cliquot 1904, et qu’au terme de certaines missions réussies, il arrivait à son copilote et observateur, Munro, de faire le vol de retour, allongé tout nu sur une aile de leur aéronef ! (5)
Au lendemain de l’armistice, Jim s’intéresse sérieusement à la politique étrangère, notamment à la zone des Balkans et à l’Albanie. Il donne quelques conférences sur ce pays à la Royal Geographical Society, ce qui lui vaut d’intégrer la délégation du Foreign Office qui participe à la Conférence de la Paix (Paris, 1919). Son intérêt pour le pays des aigles ne se dément pas ; au début des années 1920, il s’implique d’ailleurs activement dans le développement économique du petit État dont il devient l’un des conseillers officiels. À l’en croire, on lui en aurait même offert le trône… (6) Grâce à sa sœur, Mary Hutchinson (7), proche du groupe de Bloomsbury, il fréquente aussi, durant un temps, l’avant-garde littéraire : en 1909, il rencontre Virginia Woolf, puis, en janvier 1914, D. H. Lawrence auquel il rend visite à Viareggio, en compagnie d’Edward Marsh (8). À la fin des années 1920, il se lie également avec T. S. Eliot (9), Max Beerbohm (1872-1956) et le peintre gallois Augustus John (1878-1961).
Catho-fascisme
Rien de particulier ne le retenant en Grande-Bretagne, Jim repart en Italie, en 1924 : il y est à la fois employé de l’Anglo-Persian Oil Company (dont son père est l’un des dirigeants) et correspondant du Financial Times. Lorsqu’il arrive, Mussolini est au pouvoir depuis deux ans (30 octobre 1922) et le jeune Anglais s’enthousiasme pour le nouveau régime. Malgré la fâcheuse affaire Matteoti (10 juin 1924), il se fait dès lors l’éloquent avocat du fascisme. À vrai dire, il n’est pas le seul Britannique à subir la séduction du Duce. Dès le mois de mai 1923, le général Blakeney (10) et Miss Rotha Lintorn-Orman (11) ont fondé le mouvement des British Fascisti qui attire pas mal de beau monde (12). Chez les intellectuels, notamment catholiques, le fascisme suscite également un vif engouement. Apôtre du distributisme, Hilaire Belloc (1870-1953) ne se cache pas d’y être favorable, tout comme Sir Charles Petrie (1895-1977)-(13) ou encore Douglas Francis Jerrold (1893-1964)-(14), Christopher Hollis (1902-1977)-(15), Michael de la Bédoyère (1900-1973)-(16) et Douglas Woodruff (1897-1978)-(17). Le 25 novembre 1924, Jim publie, dans les colonnes du Times, une longue apologie du fascisme qui ne passe pas inaperçue (« The Fascist Regime : Aims and Achievements »). Deux ans plus tard, en janvier 1926, c’est à la tribune du Royal Institute of International Affairs et sous un angle fort bienveillant qu’il présente la doctrine fasciste, dans une conférence dont le texte (« The Doctrines and Aims of Fascism ») sera ultérieurement publié par la National Review (18).
Issu d’une famille anglicane mais converti au catholicisme en juin 1914, Jim restera sa vie durant très attaché aux valeurs spirituelles chrétiennes. En 1925-26, il suit d’ailleurs certains enseignements dispensés par le Pontificio Collegio Beda, une institution du Vatican qui accueille les anciens clercs de l’Église d’Angleterre. Promu camérier de cape et d’épée du Pape Pie XI, il se veut proche de la hiérarchie ecclésiastique, au point même de demander la permission explicite du cardinal Francis Bourne avant de continuer à lire l’Action française que le Saint-Office vient de mettre à l’index. À la même époque (1927), il devient également membre honoraire du Parti national fasciste et accède au poste de secrétaire-général du Centre international d’études sur le fascisme (CINEF). Basé à Lausanne et fondé par le paléographe helvético-néerlandais Herman de Vries de Heekelingen (19), ce centre est surtout un véhicule de propagande. On y croise diverses personnalités européennes telles que le philosophe Giovanni Gentile (20), le comte Pál Teleki (21), les professeurs Walter Starkie (22) et Edmund Gardner (23), Lord Sydenham of Combe (24) et l’écrivain français Marcel Boulenger (25). Déjà associé à la rédaction des annuaires du CINEF, Barnes se lance alors dans un ambitieux projet d’exégèse de la pensée mussolinienne. En 1928, il publie The Universal Aspects of Fascism (Londres, William & Norgate Ltd), un ouvrage qui a pour but « d’offrir un exposé précis de la doctrine fasciste telle que la prônent les créateurs et les chefs du mouvement en Italie » (p. 239-240). Dédié à Sir John Barnes, le grand-père de Jim, le livre bénéficie d’une préface de Mussolini lui-même. Laudatif, ce dernier y qualifie l’auteur de « penseur anglais avisé, qui connaît parfaitement l’Italie et les Italiens, et tout aussi bien le fascisme » (p. XVII). Ce mouvement, précise ensuite le Duce, « est un phénomène purement italien dans son expression, mais dont les postulats doctrinaux possèdent un caractère universel » (p. XIX) – affirmation bien faite pour plaire à un Jim Barnes très imprégné d’universalisme chrétien. Pour l’Anglais, le fascisme – « seule idéologie politique capable de vaincre les forces de l’’agnosticisme’ libéral et de l’’athéisme’ communiste » (p. 7) – vient restaurer ou renforcer l’autorité sacrée de l’Église. « En règle général », affirme-t-il, « on peut définir le fascisme comme un mouvement politique et social qui a pour but de restaurer un ordre politique et social basé sur le principal courant des traditions qui ont façonné notre civilisation européenne, traditions créées par Rome, d’abord par l’Empire, puis par l’Église Catholique » (p. 35). En guise d’épilogue, Barnes adresse aux sympathisants fascistes du monde entier un pertinent conseil que nombre d’entre eux auront beaucoup de mal à suivre : « Ceux qui adhèrent à cette doctrine », écrit-il, « doivent trouver leur propre voie afin d’être en harmonie avec les conditions du pays dont ils sont les citoyens ; et dans un vieux pays comme la Grande-Bretagne, doté d’une longue histoire et tradition nationale, la voie constitutionnelle est incontestablement celle qu’ils doivent suivre (…) Les fascistes de chaque pays doivent faire du fascisme leur propre mouvement national, en adoptant des symboles et des tactiques qui correspondent aux traditions, à la psychologie et aux inclinations de leur propre nation » (p. 239-240). Le livre obtiendra une bonne critique de T. S. Eliot dans The Criterion (26).
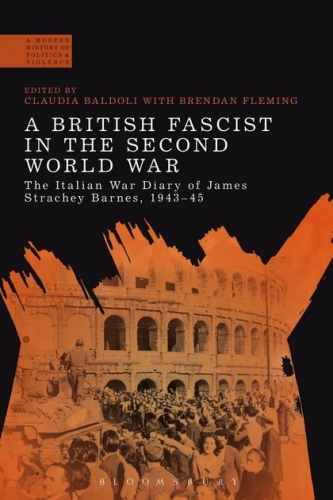 Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !
Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !
Propagandiste zélé
En 1933, Barnes est embauché par l’agence Reuters pour couvrir l’actualité sur le sous-continent indien. La famille embarque donc pour Delhi, mais avant de partir, Jim prend tout de même le temps de faire paraître Half a Life (Londres, Eyre & Spottiswoode), le premier volume de ses Mémoires (le second, Half a Life Left, suivra quatre ans plus tard, chez le même éditeur). À côté de multiples anecdotes sur sa jeunesse, il y exprime une vive nostalgie du passé : « Tout ce que j’aimais en Angleterre », avoue-t-il, « semblait appartenir à une époque antérieure – les jolis villages d’antan qui incarnaient une prospère économie rurale, les belles cathédrales anciennes et les antiques temples du savoir que les catholiques avaient édifiés avant la Réforme, les élégantes demeures d’une aristocratie qui florissait avant l’avènement des nouveaux riches, tout ce qu’il subsistait d’un artisanat raffiné, dans le délicat mobilier et les ustensiles domestiques des siècles ayant précédé l’ère industrielle » (p. 42). Le séjour indien des Barnes sera relativement bref car en octobre 1935, Jim est mandaté par Reuters pour suivre les troupes italiennes qui se battent en Abyssinie. La famille regagne par conséquent l’Italie, tandis que lui-même rejoint l’Éthiopie. Il recevra plus tard (1938) la médaille d’argent de la valeur militaire pour sa belle conduite durant cette campagne. Ses reportages ayant toutefois été jugés trop partiaux et ouvertement favorables à l’Italie, l’agence Reuters mettra un terme à son contrat en 1937.
Pour Jim, cette rupture n’est pas un drame puisqu’il se voit aussitôt chargé par le gouvernement fasciste d’entreprendre une tournée de promotion aux Etats-Unis. Il va y rester un peu plus d’un an, multipliant conférences et interviews dans la plupart des grandes métropoles du pays. À titre personnel, ce long séjour lui permet de prendre langue avec la National Union for Social Justice, le mouvement crypto-fasciste du père Charles Edward Coughlin (28). Rentré en Italie en 1939, c’est d’ailleurs dans les colonnes de Social Justice (un journal qui tire à un million d’exemplaires) que Jim va désormais s’exprimer. En accord avec les nouvelles orientations de Rome, il y prône un certain antisémitisme (29) et suggère notamment qu’il faudrait expulser tous les Juifs d’Europe. Selon lui, c’est à la Grande-Bretagne qu’il incombe de leur trouver un foyer : pas en Palestine, mais en Rhodésie du Nord (actuelle Zambie). Ce transfert, assure-t-il, « serait une gloire pour notre civilisation et une réalisation qui nous apporterait de nouveaux espoirs et nous redonnerait confiance en l’avenir du monde civilisé » (30). Dans un autre article, il accuse carrément les Juifs de vouloir construire, sur les ruines de la Chrétienté, une nouvelle Jérusalem, « un ordre universel dominé par leur propre communauté internationale, compacte, raciale et ésotérique » (31). Sur un tout autre plan, il souligne par ailleurs l’incompatibilité existant entre libéralisme (« une vile perversion » selon le Pape Léon XIII) et catholicisme, et rappelle aux chrétiens qu’il n’est d’autre choix pour eux que celui du fascisme. À l’occasion, il vante aussi les attraits du corporatisme, solution catholique au conflit capital-travail. Convaincu que les régimes italien, espagnol et portugais sont supérieurs au nazisme car clairement catholiques, il explique ensuite aux Yankees que l’influence de Mussolini finira bientôt par amener l’Allemagne à se corriger. Dans l’immédiat, et malgré sa sympathie pour la Pologne catholique, il lui paraît que le nazisme est néanmoins un instrument efficace pour défendre l’Europe contre le bolchevisme. Considérant que la guerre qui s’annonce doit se percevoir comme un conflit entre « l’Église du Christ (…) et les loges de Lucifer en révolte contre Dieu » (32), il estime enfin que l’avenir du continent repose sur une renaissance de l’Europe catholique. « L’Italie », déclare-t-il à ses lecteurs d’outre-Atlantique, « est l’espoir de l’Europe – c’est à dire de l’Europe civilisée et chrétienne. Et l’Espagne catholique agit en étroite coopération avec elle. Par conséquent, de cette guerre naîtra peut-être une ère nouvelle et plus glorieuse. Si tel est le cas, cela viendra d’un regain de vitalité de la conception romaine de la religion et de l’État que l’Italie, terre des Césars et patrie des Papes, aura rendu possible » (33). Cette ère nouvelle sera celle des États-Unis d’Europe – parmi lesquels il inclut aussi l’Irlande, la France, la Pologne et la Hongrie – qui seront enfin délivrés à jamais de la finance, de l’usure et de l’esprit néo-judaïque (34).
Un ami loyal
Fidèle au fascisme, Jim Barnes est également très attaché à sa patrie d’adoption, comme il en témoigne noir sur blanc dans Io amo l’Italia : memorie di un giornalista inglese (Milan, Garzanti), un petit livre qu’il publie en 1939, à son retour d’Amérique. À la même époque, il rejoint le Ministère de la Culture Populaire (MinCulPop) où on lui offre un poste de speaker à la radio nationale. Avec l’entrée en guerre de l’Italie (juin 1940), cet emploi de propagandiste est tout sauf anodin. Habile causeur et possédant un gros réseau de relations qui lui fournissent de précieuses informations, Jim se fait vite apprécier de ses employeurs. On lui confie souvent le micro car il se révèle percutant dans ses caricatures de Churchill et Eden. C’est ainsi qu’entre décembre 1940 et septembre 1941, soit en neuf mois à peine, il ne réalise pas moins de 170 émissions (35). Cette activité radiophonique l’amène à faire la connaissance d’un autre speaker de prestige, le poète américain Ezra Loomis Pound (36), avec lequel il sympathise tout de suite. Les deux hommes collaborent sur divers projets communs, et lorsque Pound séjourne à Rome, il est souvent reçu chez les Barnes. Jim et le poète sont également passionnés d’économie : tous deux partagent le même intérêt pour le distributisme et le créditisme, ainsi qu’une même haine de l’usure. En 1943, c’est Jim qui s’efforcera de procurer un faux passeport à Ezra Pound, et c’est encore lui qui convaincra l’Américain de reprendre ses causeries à la radio de la République Sociale Italienne.
En ce qui le concerne, Jim se trouve dans une situation tout aussi délicate que celle de Pound. Il a demandé la nationalité italienne en 1940, mais les choses ont traîné ; en 1943, il a enfin obtenu une réponse favorable mais le débarquement des Alliés (juillet-août) et l’armistice (8 septembre) sont venus à nouveau perturber le processus, et il n’a pu prêter serment dans les délais impartis. Il est donc encore britannique et figure en tête de la liste des traîtres, ce qui pourrait lui valoir la potence… Inquiet, il a rencontré le Pape Pie XII qui a confié au cardinal Montini (futur Paul VI) le soin de veiller à la sécurité de la famille. Le 12 septembre, il obtient des faux papiers grace auxquels il envisage de trouver asile en Suisse ; sur les conseils de ses amis Raimundo Fernández Cuesta (37), ambassadeur d’Espagne à Rome, et Luigi Lojacono, ambassadeur d’Italie à Madrid, il a un temps songé à émigrer en Espagne. De leur côté, les Allemands voudraient bien le récupérer pour la Reichsrundfunk, ce qui achèverait de le compromettre. Au final, les Barnes quittent la capitale le 21 septembre en direction de Venise où ils arrivent le 7 octobre. De là, Jim rallie son ministère qui s’est replié à Salò, sur le lac de Garde.

Rita Zucca
Libéré par les Allemands (12 septembre 1943) et réinstallé au pouvoir, Mussolini réorganise ses forces. À compter du 1er décembre, son centre de propagande radiophonique est à nouveau opérationnel et Jim reprend ses interventions, depuis les studios de Milan. Avec Ezra Pound et la célèbre Rita Zucca (38), il animera notamment, en 1944, l’émission « Jerry’s Front Calling ». Outre cette présence sur les ondes, il signe une brochure, Giustizia Sociale : attraverso la riforma monetaria (La justice sociale : grâce à la réforme monétaire) qui paraît à Venise (39). « Il ne suffit pas », y affirme-t-il, « de sauver l’indépendance économique de l’Europe, mais encore faut-il aussi, à l’intérieur de cette Europe, éradiquer le système financier, monétaire et bancaire de type anglo-saxon et hébraïque, car tant qu’il persistera (et entre nous, il est encore loin d’être détruit), il rendra impossible l’instauration d’un véritable régime de justice sociale » (p. 11). Plutôt favorable aux ultras du régime (dont le fort peu clérical Farinacci), il donne régulièrement des articles à Croaciata Italica, le journal catho-fasciste que rédigent, entre autres, les prêtres Don Tullio Calcagno (40), Don Edmondo De Amicis (41), Don Antonio Padoan (42) et le capucin Fra Ginepro da Pompeiana (43). Loyal jusqu’au bout au régime qu’il sert depuis vingt ans, il s’entretient une dernière fois avec Mussolini le 9 avril 1945, avant de prendre, avec les siens, le chemin de Mérano.
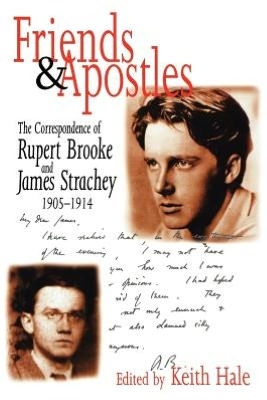 C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».
C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».
Christophe Dolbeau
Notes:
(1) Voy. R. Skidelsky, Oswald Mosley, Londres, Macmillan, 1975 ; C. Dolbeau, Les Parias, Lyon, Irminsul, 2001, pp. 93-110 ; R. Tremblay, Oswald Mosley – L’Union fasciste britannique, Paris, Synthèse nationale, Cahiers d’histoire du nationalisme, n° 14, 2018.
(2) Voy. Adrian Weale, Patriot Traitors, Londres, Viking, 2001 ; Josh Ireland, The Traitors, Londres, John Murray, 2017.
(3) Voy. W. Cole, Lord Haw-Haw and William Joyce, Londres, Faber & Faber, 1964 ; F. Selwyn, Hitler’s Englishman, Londres, Routledge & Kegan, 1987 ; C. Dolbeau, op. cit., pp. 81-91.
(4) J. S. Barnes, Half a Life, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1933, pp. 230, 233, 234.
(5) Voy. T. Villis, British Catholics and Fascism : Religious Identity and Political Extremism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, p. 21.
(6) Ce pays avait bien eu pour monarque, en 1914, le prince allemand Guillaume de Wied, alias Vilhelm Vidi (1876-1945)…
(7) Nouvelliste de talent, Mary Hutchinson (1889-1977) fut la grande amie du critique Clive Bell, de Aldous Huxley, Georges Duthuit, Samuel Becket et Virgina Woolf.
(8) Edward Marsh (1872-1953) était un célèbre traducteur et protecteur des arts. Il fut en outre le chef de cabinet de W. Churchill et de Lord Asquith.
(9) qui parle de lui à son frère aîné, Henry Ware Eliot (1879-1947), en 1937, et le qualifie à cette occasion de « drôle d’oiseau » ou queer bird…
(10) R. B. D. Blakeney (1872-1952) est un officier du génie qui a servi au Soudan et en Afrique du Sud, avant de diriger les chemins de fer égyptiens (1906-1923).
(11) Rotha Lintorn-Orman (1895-1935) est la petite-fille du maréchal Lintorn Simmons. Infirmière durant la Première Guerre mondiale et décorée deux fois de la Croix de la Charité pour son rôle au cours du grand incendie de Salonique (1917), elle dirige après-guerre l’auto-école de la Croix Rouge britannique. Voy. R. Thurlow, Fascism in Britain – A History, 1918-1985, Oxford, Basil Blackwell, 1987, pp. 51-57.
(12) Notamment les généraux Sir Ormonde Winter (ancien directeur adjoint de la police et du renseignement en Irlande) et T. Erskine Tulloch, le colonel et député Sir Charles Burn, l’amiral John Armstrong, ainsi que plusieurs membres de l’aristocratie terrienne, comme Lord Garvagh, Lord Ernest Hamilton, le marquis de Ailesbury et Sir Arthur Hardinge, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Espagne. Voy. Martin Pugh, ‘Hurrah for the Blackshirts !’, Londres, Pimlico, 2006, p. 52.
(13) Historien, Sir Charles Petrie signe en 1931 Mussolini (Londres, Holme Press), une biographie très flatteuse du Duce. Il sera l’un des principaux soutiens du général Franco au Royaume-Uni.
(14) Éditeur de l’English Review, Douglas Francis Jerrold sera mêlé de très près, en juillet 1936, à l’envoi d’un avion et de deux pilotes pour transporter le général Franco des Canaries au Maroc. En 1930, il avait publié Storm Over Europe (Londres, Ernest Benn), un roman très favorable à l’idéologie fasciste où il se référait à une conception catholique et traditionaliste de l’histoire.
(15) En 1941, Christopher Hollis publiera un ouvrage, Italy in Africa (Londres, Hamish Hamilton), très favorable à l’action de l’Italie fasciste en Afrique.
(16) Entre 1934 et 1962, Michael de la Bédoyère sera le rédacteur en chef du Catholic Herald.
(17) Entre 1936 et 1967, Douglas Woodruff sera le rédacteur en chef de l’hebdomadaire catholique The Tablet.
(18) N° 87 (1926), pp. 568-586.
(19) Néerlandais de naissance mais naturalisé suisse, Herman de Vries de Heekelingen (1880-1942) fut professeur de paléographie à l’Université de Nimègue. Fondateur du Centre International d’Études sur le Fascisme (CINEF), il a également créé le Centre International de Documentation sur les Organisations Politiques. Admirateur du national-socialisme, il a écrit plusieurs ouvrages antisémites dont Israël. Son passé. Son avenir (1937), L’orgueil juif (1938), Le Talmud et le non-juif (1938) et L’Antisémitisme italien (1940), livres ayant tous connu de nombreuses traductions.
(20) Philosophe et pédagogue, Giovanni Gentile (1875-1944) sera président de l’Institut National fasciste de Culture et de l’Académie d’Italie ; ministre de l’Instruction publique (1922-1924), il sera également directeur scientifique de l’Encyclopédie Italienne (1925-1938). Il sera assassiné, le 15 avril 1944, à Florence, par des partisans communistes.
(21) Géographe et membre de l’Académie hongroise des sciences, Pál Teleki (1879-1941) a été à deux reprises Premier ministre du Royaume de Hongrie.
(22) Walter Starkie (1894-1976) est un hispaniste irlandais, musicien et spécialiste du peuple rom. Il sera le fondateur et premier directeur de l’Institut Britannique de Madrid.
(23) Edmund G. Gardner (1869-1935) est professeur de langue et littérature italienne, spécialiste de Dante. Membre des universités de Londres et Manchester, il siège à l’Académie britannique.
(24) Ancien colonel du génie, Lord Sydenham of Combe (1848-1933) a été gouverneur de l’État de Victoria (1901-1903), en Australie, puis gouverneur de Bombay (1907-1913).
(25) Ancien escrimeur olympique et romancier, Marcel Boulenger (1873-1932) est également un collaborateur de l’Action française et de la Revue des deux Mondes.
(26) The Criterion, n° 8 (1928), pp. 280-290 (« The Literature of Fascism »)
(27) Il décèdera en 1987.
(28) Américano-canadien, Charles Edward Coughlin (1891-1979) est un prêtre catholique et animateur de radio. Favorable à une réforme monétaire, antisémite et favorable au fascisme, il se verra contraint par sa hiérarchie, en 1942, de mettre fin à son action politique.
(29) À la fin de l’été et à l’automne 1938, Mussolini prend une série de lois raciales et antisémites.
(30) Voy. « The Jewish Problem – and a Solution », Social Justice du 17 avril 1939.
(31) Social Justice du 14 août 1939.
(32) Social Justice du 24 juillet 1939 (« Tragedy of Chamberlain »).
(33) Social Justice du 11 décembre 1939.
(34) On retrouve là les thèmes chers à son ami Ezra Pound.
(35) Dont voici certains titres : « Glané dans la presse britannique », « Merci mon Dieu pour les erreurs de nos ennemis », « Les vrais maîtres de l’Inde », « La ploutocratie britannique », « Le salut de la civilisation européenne », « Résister ou mourir », « La réponse au traître De Gaulle », « Une réplique à Churchill », etc.
(36) Sur Ezra Loomis Pound (1885-1972), voy. Les Cahiers de l’Herne, n° 6 et 7, 1965 (Ezra Pound 1 et 2) ; Noel Stock, The Life of Ezra Pound, Harmondsworth, 1970 ; John Tytell, Ezra Pound – Le volcan solitaire, Paris, Seghers, 1990 ; C. Dolbeau, op. cit., pp. 259-267.
(37) Raimundo Fernández Cuesta (1896-1992) était l’un des fondateurs de la Phalange dont il fut longtemps le secrétaire général. Après la Seconde Guerre mondiale, il sera ministre de la Justice.
(38) Rita Zucca (1912-1998) était une Italo-Américaine, originaire de New York, qui s’exprimait sur les ondes de la radio italienne. Naturalisé italienne, elle ne fut pas poursuivie par la justice américaine mais écopa néanmoins, devant un tribunal militaire italien, de quelques mois de prison.
(39) Cette brochure a été rééditée en 1995 par Barbarossa (Milan).
(40) Excommunié (24 mars 1945), Don Tullio Calcagno (1899-1945) sera arrêté, à Crema, par des partisans communistes (24 avril 1945), transféré à Milan, condamné à mort et exécuté, en compagnie de l’aveugle de guerre et médaille d’or de la valeur militaire Carlo Borsani. D’abord jetés dans une benne à ordures, leurs corps seront ensuite inhumés dans une tombe anonyme.
(41) Aumônier militaire et vétéran des campagnes d’Afrique, Don Edmondo de Amicis (1885-1945) s’exprimait régulièrement au micro de la radio fasciste. Victime le 24 avril 1945 d’un attentat communiste, il décède de ses blessures deux jours plus tard.
(42) Curé de Castelvittorio, Don Antonio Padoan sera assassiné le 8 mai 1944 par des partisans communistes. Son nom sera donné à la XXXIIe Brigade noire.
(43) Aumônier militaire et vétéran des campagnes d’Ethiopie et d’Albanie, le capucin Ginepro da Pompeiana (1903-1962) sera incarcéré à Gênes en 1945.
Bibliographie:
– James S. Barnes, The Universal Aspects of Fascism, Londres, William & Norgate Ltd, 1928 ; id., Fascism, Londres, Thornton Buttersworth Limited, 1931 ; id., Half a Life, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1933 ; id., Io amo l’Italia : memorie di un giornalista inglese, Milan, Garzanti, 1939 ; id. A British Fascist in the Second World War – The Italian War Diary of James Strachey Barnes, 1943-45, Londres, Bloomsbury Academic, 2014.
– Giacomo Barnes, Giustizia Sociale : attraverso la riforma monetaria, Milan, Barbarossa, 1995.
– R. Thurlow, Fascism in Britain – A History, 1918-1985, Oxford, Basil Blackwell, 1987.
– T. Linehan, British Fascism, 1918-39 : Parties, Ideology and Culture, Manchester, Manchester University Press, 2000.
– Martin Pugh, ‘Hurrah for the Blackshirts !’ – Fascists and Fascism in Britain between the Wars, Londres, Pimlico, 2006.
– David Bradshaw et James Smith, « Ezra Pound, James Strachey Barnes (‘The Italian Lord Haw-Haw’) and Italian Fascism », Review of English Studies, n° 64 (266), 2013, pp. 672-693.
– T. Villis, British Catholics and Fascism : Religious Identity and Political Extremism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.
– Paul Jackson, « James Strachey Barnes and the Fascist Revolution : Catholicism, Anti-Semitism and the International New order », dans Modernism, Christianity and Apocalypse (sous la direction de Erik Tonning), Leyde, Brill, 2014, pp. 187-205.
00:05 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biographie, histoire, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, fascisme, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 mars 2020
Four French Collaborationists: Châteaubriant, Céline, Drieu, Brasillach
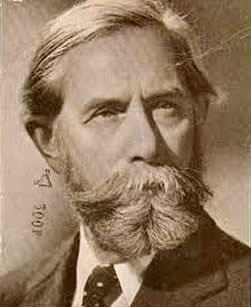
Counter-Currents Radio Podcast No. 264
Four French Collaborationists:
Châteaubriant, Céline, Drieu, Brasillach
To listen in a player, click here.
To download the mp3, right-click here and choose “save link as” or “save target as.”
This is a lost London Forum talk by Michael Walker on four French artists of the Right: Alphonse de Châteaubriant, Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle, and Robert Brasillach. If anyone has details about when this talk was given, please post a comment below.

“Homage to Robert Brassilach”
Michael Walker
Comme le temps passe
Robert Brasillach
My homage is for the way you lived to die
That I a coward cannot emulate
You knew and wrote
Reason turns malevolent
after childhood disperses
And slumps into mature consideration
You could not have lived with yourself after failing.
So the leaden sentence was a gift
Better to die as you died
In the fluency and grace of certainty and light
Like poor Pucelle
Than grapple with compromise and penance
To win years in retirement and shame
Dying defiant
Sin pañuelo
The Castilian way.
Happiness a bagatelle
To a fascist
Dying well essential
Dying well redeems
The quintessence
Not delaying
Nor complaining
Nor dreading
Unbitter witness
The theatrical end
Many shrink and strive to safety
Delay complain and dread
And run away and hide
And sacrifice their pride for a
Doubtful grace
Not you a thief or cheat
Perhaps a busy undertaker
Coffins lined in neatly ordered rows
“The Bubonic East has
Broken out” –the facts
Every issue packed and bracketed
Childhood spoilt and spilled
Venom packed away in lofts or cellars
Then taken out and filmed
Nothing like that within you
So they held their tryst with you
Many shrink and strive to safety
They show their heads
Where they fear no censure
The dumb speak no treason
The illiterate pen no error
They called you traitor and acolyte to murder
But no betrayal was within you
Those
Who mattered to you
Will wait and wait
Carlists on horseback
Ragamuffin Spain
The islands of childhood
You walk to them
Punctual formal and correct
In the fields of your Great Faith
Le paradis terrestre
Martyr’s etiquette at the shore
Running and returning
Your last breath faithful
Hear the sea roar
Comme le temps passe
Robert Brasillach
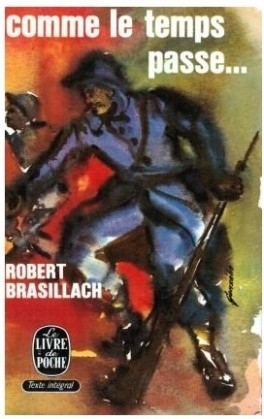
00:09 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, collaboration, châteaubriant, brasillach, céline, drieu la rochelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 mai 2019
The War of Nihilisms

The War of Nihilisms
The first English translation of Ernst Jünger’s journals from the Second World War is a cause for celebration. The journals were like treasures stashed away in an old castle, behind a door that could be unlocked only if one learned to read German. It’s open now, and what’s inside are literary gems on every page.
Jünger’s war journals were written in six parts. The first, Gardens and Streets, covering 1940, and last, A Cottage in the Vineyard, covering 1945 to 1948, are not included in this volume. It deals with the middle four, covering the years 1941 to 1945, published in 1949 under the title Strahlungen. It’s a word difficult to render into English, but most commonly translated as “emanations” or “radiations,” which convey the power of Jünger’s highly visual and allusive prose, which glows with immense erudition and culture.
 In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”
In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”
Borges is relevant because he and Jünger read and admired each other’s work. There is a wonderful photo of an aged Borges visiting Jünger at his home in Wilflingen, Germany, in Julien Hervier’s The Details of Time: Conversations With Ernst Jünger (1995).
Jünger’s literary gifts were evident from the beginning. His Storm of Steel (1920, In Stahlgewittern) is still considered by many to be the best combat memoir from the Great War. Its successor, Copse 125 (1925), is excellent as well, although not as well-known. It recounts his experience as a stormtrooper officer during the summer of 1918. Between battles, he read Laurence Sterne’s Tristram Shandy, which he carried in his map case.
Jünger was also a war hero. In September 1918, he was awarded the Pour le Mérite, the highest honor of the Prussian military. He became a nationalist after the war “under French influence” through reading the writer Maurice Barrès. Jünger would remain a Francophile through the next war. In the 1920’s he wrote for nationalist journals, and even briefly served as a volunteer officer in the Freikorps. In 1926, he sent a copy of his third combat memoir, Fire and Blood (1925), to Hitler with the inscription, “To the Nationalist Führer, Adolph Hitler.” Yet Jünger never joined the Nazi Party nor any party-controlled organizations, and beginning in the 1930’s he was suspected of political dissidence. Yet Hitler protected him, reportedly saying on more than one occasion, “Nothing happens to Jünger.”
 Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”
Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”
Jünger took no part in the Stauffenberg plot to assassinate Hitler, but he knew about it, and was actually briefed on it by Lieutenant Colonel von Hofacker, with whom he argued that the Führer should be arrested, not killed. Jünger believed that political assassinations only make things worse. Yet his writings certainly inspired the aristocratic conspirators, whom he considered among “the last chivalric men.” One of them was the commander-in-chief of the German forces in France, General Carl-Heinrich von Stülpnagel, who was not only Jünger’s superior officer but a friend. Another was General Erwin Rommel, who read Jünger’s Peace in manuscript in May 1944 and reportedly said, “This is a text one can work with.”
During the previous year, the Wehr macht had actually printed 20,000 copies of Jünger’s allegorical critique of the Nazi regime, On the Marble Cliffs (Auf den Marmorklippen, 1939). It was avidly read on the Eastern Front. Jünger received a letter from a lieutenant who claimed the whole regimental staff was reading it. “At night . . .we went to our tents, where, in the Marble Cliffs, we read about what we had actually experienced.”
Jünger served as an infantry officer during the German conquest of France in the spring of 1940. The next year he was promoted to captain and assigned to German headquarters in Paris as an intelligence officer. There is surprisingly little in this first Paris journal about his work or about the general military situation, although what is there is packed with meaning.
For instance, on October 11, he recorded that “snow has already fallen in the central area of the eastern front.” Later that month, Rudolf Hess crash-landed in Scotland on his quixotic peace mission to England. Jünger was certain Hitler authorized the mission. In January he had a conversation with a lieutenant returning from Russia who told him that his battalion lost a third of its men to the cold.
Jünger himself visited the Eastern Front in November 1942. The several months he spent there form the second part of the journal, which is full of beautiful descriptive passages of the forests and mountains and fascinating insights into the military situation. He arrived in southeastern Russia just days before the Sixth Army was surrounded at Stalingrad. He recalled that a fellow officer and confidante had predicted in the spring that a Caucasus offensive would end in disaster: “He said it would open an umbrella, meaning that it would lead to the construction of huge fronts with narrow points of access.”
Yet, despite the encirclement, the German army continued to fight in the Caucasus Mountains for another month. Jünger was still there when the general retreat was ordered. The German commander in the Caucasus, General Rudolf Konrad, told Jünger that the German High Command had forgotten the most fundamental teachings of Clausewitz, especially the strategic importance of the concentration of forces: “He said that we could attack the Caucasus, Egypt, Leningrad, and Stalingrad—just not all at once, especially while we were still caught up in secondary objectives.” That, in one sentence, is why the Germans lost the war.

The third part of Strahlungen begins upon Jünger’s return to Paris in February 1943. He was increasingly horrified by reports reaching him of the destruction wrought by the Anglo-American aerial bombardment. He recorded five different ways people die from the bombs: some by the blast itself; some by the collapse of structures; others by being burned alive; still more by suffocation or asphyxiation when the raging fires consumed all the oxygen. What especially appalled him was the dropping of molten phosphorus:
The images are becoming apocalyptic; people are seeing fire raining down from Heaven. This is actually an incendiary compound of rubber and phosphorus that is inextinguishable and inescapable as it engulfs all forms of life. There are stories of mothers who have been seen flinging their children into rivers.
His wife had remained at their home in Kirchhorst, outside the city of Hannover. During one phosphorus attack, “she watched as the phosphorus poured down on the city like molten silver.” A month later, he visited the city and found it reduced “to a heap of rubble. The places where I had lived as a child, as a schoolboy, as a young officer—all had been leveled.” The same was true for all the cities of western Germany. In three years of bombing, the allies destroyed them all.
By then, Jünger was well aware of the horrors of the concentration camps, which he called “charnel houses.” He believed both sides had succumbed to various forms of nihilism. He understood nihilism precisely as Nietszche had done: as the denial of the legitimacy of all historical standards, and of the tyranny of means that had become their own ends.
He wrote of Hitler’s war on “the nomos, which guides him infallibly,” by which Jünger meant Hitler’s disregard for the inherited norms of Western Christian civilization. He believed the allies were guilty of the same crime, as exemplifed by their demand for unconditional surrender and their murderous bombing campaign. “We see the will to destroy, even at the cost of one’s own destruction,” he wrote. “This is a demonic trait.”
He saw the obliteration of ancient structures, such as libraries, cathedrals, monuments, museums, and beautiful old homes, as “one of the stepping stones to Americanism.” America was for him a symbol of the technocratic, materialistic, soulless civilization of the future. He found some support for this view in American writers like Melville, Poe, and Faulkner, whose Pylon (1935) he reread because “it describes the abstract hell of the world of technology with such precision.” He and German jurist Carl Schmitt together read the conclusion of the second volume of Tocqueville’s Democracy in America (1838), which predicts what Schmitt describes elsewhere as “the return of the structures of the absolute state, but without aristocracy,” making “catastrophes of unimaginable dimensions possible.”
Jünger rejoiced that Paris, “the city of cities,” was spared. Paris represented to Jünger the opposite set of values to those being everywhere imposed by force. She stood for culture, refinement, and permanence. She was “like an ark, heavily laden to the gunwales with ancient treasure.” Paris thus symbolized hope to Jünger. So did the German Fronde, in which the French nobility rose up in the 17th century to try to stave off the advent of the absolutist state. Just as the Prussian aristocracy in the Wehrmacht had tried to rid their country of a destructive tyrant.
Jünger believed that “the fate of Germany is hopeless if a new chivalric order does not emerge from its youth.” Chivalry, as Jünger understood it, represented a fusion of the Germanic warrior ethic with Christianity and classical culture. Western Civilization could not and would not survive unless all three flourished together. Jünger, who read the Bible daily during the war, more than once asserted that theology needed to be restored to its rightful place as the queen of the sciences.
Sitting across from him on a train in the spring of 1944 sat a young German paratrooper (a lieutenant) engrossed in a book. Jünger saw a younger version of himself, and the three qualities he values: courage, intellect, and honor. Jünger understood these to be the essence of aristocracy and the glory of European culture. These three were necessary to save her. It remains true today.

[A German Officer in Occupied Paris: The War Journals, 1941-1945, by Ernst Jünger (New York: Columbia University Press) 496 pp., $40.00]
00:48 Publié dans Histoire, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, histoire, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, guerre, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 mai 2019
„Die Städte sind weiblich und nur dem Sieger hold.“

„Die Städte sind weiblich und nur dem Sieger hold.“
00:42 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, paris, occupation, france, allemagne, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 février 2019
France. Les camps de concentration de la République

France. Les camps de concentration de la République
Retirada
Fin janvier 1939, le front républicain de Catalogne cède et un demi-million de personnes fuient vers la France. « Lors de cet exode, désormais appelé “Retirada”, l’internement a été pour la majorité des hommes et des femmes la porte d’entrée en France. À la mi-février, après l’arrivée des troupes franquistes le long de la frontière, ils ont été un peu plus de 325 000 à être regroupés dans la douzaine de camps créés en quelques jours dans les Pyrénées-Orientales. Ces exilés de la guerre d’Espagne – qui se termine officiellement le 1er avril 1939 – sont issus de l’Armée populaire de la République et de la société civile. Ils sont officiers, soldats, anciens miliciens, requis, volontaires internationaux… Des paysans, des ouvriers, des intellectuels, des artistes qui, dans le pays des droits de l’homme s’apprêtant à fêter le 150e anniversaire de la Révolution française, sont les premiers étrangers « indésirables » à subir à la fin des années 1930 des coercitions prises à l’échelle d’un groupe, et non plus seulement à celle d’individus. »
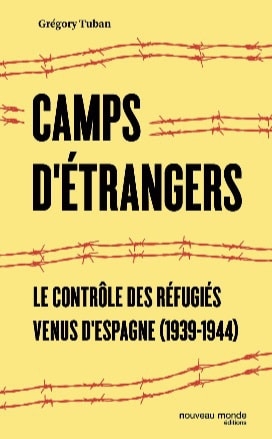 Prévisions
Prévisions Le 29 avril 1938, le ministre de la Guerre envoie une note secrète aux commandants de deux régions militaires demandant de prévoir « l’installation de camps de circonstance pour certaines catégories de réfugiés espagnols » tout en précisant que « l’évolution des opérations militaires en Espagne rend possible, dans un délai rapproché, l’éventualité du franchissement de la frontière par des réfugiés en nombre élevé ayant appartenu aux forces armées gouvernementales, et dont le séjour pendant un temps plus ou moins long sur notre territoire doit être maintenant prévu ».
Le premier camp est installé le 30 janvier 1939 sur la plage d’Argelès-sur-Mer. Les autres suivent.
Selon le préfet du département des Pyrénées-Orientales, 480 000 réfugiés seraient, au total, passés, lors de la Retirada, par le territoire qu’il a sous son autorité (1) (2). Soit 305 000 internés dans des camps, 5 000 placés dans des hébergements privés et 170.000 civils transférés hors du département. Ces chiffres doivent être traités avec prudence et font encore de nos jours débat. Ajoutons que des personnes sont entrées clandestinement en France et que d’autres ont rapidement retraversé la frontière en direction de l’Espagne.
Grégory Tuban écrit que « Les camps de concentration de février 1939 jouent un rôle central dans le dispositif de contrôle de la Retirada. Ils contiennent une partie des réfugiés hors de l’espace public et permettent ainsi aux autorités d’exercer une surveillance resserrée sur ces derniers. C’est ce que précise Albert Sarraut au journal La Dépêche le 1er février 1939 sur la plage d’Argelès-sur-Mer : “Le camp d’Argelès-sur-Mer ne sera pas un camp pénitentiaire mais un camp de concentration. Les asilés [sic] qui y prendront séjour n’y resteront guère que le temps nécessaire pour préparer leur refoulement ou sur leur option leur libre passage de retour en Espagne” (3). Le vœu du ministre de l’Intérieur de voir massivement s’opérer le retour en Espagne des réfugiés ne va toutefois pas se réaliser dans les proportions souhaitées. Le temporaire va se prolonger et les hommes qui se retrouvent littéralement parqués dans les contreforts des Pyrénées ou sur le sable du Roussillon vont devoir apprendre à vivre dans un quasi-dénuement, alors que l’hiver est des plus rigoureux dans cette partie de la France battue par la Tramontane glaciale de février. »
« Si les camps d’Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien ont ouvert dans l’urgence de l’exode, un deuxième réseau de camps “catégoriels” voit le jour à partir de la mi-février afin de mieux gérer les flux des réfugiés. La construction de ce premier camp, dit “de seconde génération”, débute le 6 février 1939 à Bram dans l’Aude. Il a été conçu dès le 3 février par André Cazes, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de l’Aude, selon un modèle militaire. Le camp est ainsi divisé en 10 quartiers délimités par des doubles clôtures en fil de fer barbelé de 2,5 m de haut, isolés les unes des autres par des rues et allées perpendiculaires de 20, 15, 10 m de large. Le camp cerclé d’un chemin de ronde pour les patrouilles dispose en son centre d’un mirador. Chaque quartier possède ses cuisines et ses lavabos. Conçu pour héberger 15 000 réfugiés, Bram reçoit à la fin du mois de février 1939 jusqu’à 16 300 internés qui sont regroupés dans 170 baraquements d’une capacité de 90 à 100 places. »
70 km de fil de fer barbelé sont nécessaires pour le camp de Bram et 250 km pour celui de Barcarès. « Le camp de Barcarès compte, fin mars, près de 50 000 internés et devient le troisième camp le plus important des Pyrénées-Orientales ». Dans l’Hérault, à Agde, un camp est construit. Il est divisé en trois camps distincts numérotés de 1 à 3.« Chacun possède son poste de police, son intendance et son infirmerie. Derrière une double ceinture de barbelés, les trois camps sont identiques avec un alignement de baraques de type génie, qui mesurent 40 m de longueur sur 6,5 m de largeur, couvertes de bois avec des toits en tôle ondulée. À l’intérieur, on trouve une double rangée de couchettes à deux étages, séparées par un couloir central. L’accès se fait de chaque côté de la baraque. Au mois de mai, les trois camps regroupent 24 000 réfugiés, majoritairement catalans ». À Septfonds, dans le Tarn-et-Garonne, la construction d’un camp débute fin février 1939. « L’armée y déploie 50 km de fil de fer barbelé pour clôturer les 50 ha du camp cerclé par un chemin de ronde, jalonné de miradors à guérites et de 50 projecteurs. […] Le camp de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, va, quant à lui, recevoir les brigadistes internationaux internés sur les plages du Roussillon, les réfugiés basques et les membres de l’aviation. Sa construction débute le 15 mars et se termine le 25 avril 1939. Il est alors le plus grand des camps français, avec une superficie de 125 ha et compte 428 baraques. Enfin, dans l’Ariège, le camp militaire du Vernet est aménagé à partir de la fin du mois de février pour recevoir majoritairement des réfugiés venus des camps de Cerdagne, […]. »
Des mesures et des installations disciplinaires sont mises en place pour les prisonniers récalcitrants.
L’ouvrage décrit ensuite les dispositions prises en vue d’obtenir, sur base volontaire ou forcée, un retour vers leur pays d’origine d’une partie des Espagnols résidant en France ainsi que la volonté des autorités, suite à la montée des tensions en Europe, de mettre au travail ceux restant en France.
IIe Guerre mondiale
Au début de la IIe Guerre mondiale, le pouvoir instaure des mesures d’exception visant à contrôler la population française ainsi que les étrangers vivant en France.
Si le nombre de femmes et d’enfants séjournant dans ces camps est extrêmement minoritaire par rapport à celui des hommes en mars et avril 1939, puis est quasi égal à zéro dans les camps des Pyrénées-Orientales dès le mois de mai, il remonte en septembre. En octobre, le nombre de femmes et d’enfants augmente. « Ce sont souvent des familles entières qui sont envoyées dans les camps depuis toute la France. » À partir du début de la guerre, en septembre 1939, alors qu’auparavant les camps contenaient des Espagnols ou des membres des Brigades internationales, des personnes de différentes nationalités sont expédiées vers ceux-ci : des Allemands, des Italiens… souvent antifascistes, des juifs. Parmi les prisonniers figurent également des personnes originaires de différents pays de l’Est. En août 1940, le camp du Vernet compte près de 4 000 internés issus de 58 nationalités.
« La IIIe République sombre définitivement le 10 juillet 1940 au casino de Vichy, quand 569 des 649 parlementaires présents votent les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Le vieux maréchal constitue le 16 juillet son premier gouvernement en tant que chef de l’État et nomme Pierre Laval comme président du Conseil. Gouvernement qui hérite de facto de la gestion des camps pour étrangers par les ministères de la Guerre, de l’Intérieur et du Travail. »
L’auteur consacre la dernière partie de l’ouvrage au fonctionnement de ces camps sous le régime de Vichy, à la déportation vers l’Allemagne de plus de 10 000 « Espagnols rouges » et à l’engagement d’Espagnols de gauche dans des organisations de la Résistance.
Conclusion
Grégory Tuban conclut : « Pour l’armée comme pour l’Intérieur, la discipline censée contenir les velléités révolutionnaires de certains réfugiés et maintenir l’ordre public dans des espaces clos devient un outil répressif, opérant hors du champ pénal. »L’auteur estime que l’existence de ces camps dits « de concentration » au sein desquels des mesures et des espaces disciplinaires sont utilisés à l’encontre des réfugiés en dehors du circuit judiciaire du droit français conduit, dès février 1939, dans ces endroits, à « une politique de plus en plus arbitraire, renforcée par l’état de siège, par la guerre, puis par le gouvernement de Vichy. »
Ce livre, tiré d’une thèse de doctorat, présente la particularité d’être compréhensible par tout le monde et constitue donc à la fois une porte d’entrée vers le sujet pour les lecteurs qui ne s’y sont pas encore intéressés, tout en apportant aux spécialistes de la question de nouveaux éléments basés sur des recherches.
Lionel Baland (via Eurolibertés)
Notes
(1) Rapport du préfet Raoul Didkowski, Perpignan, le 30 juin 1939.
(2) La très grande majorité des fugitifs est passée par ce département.
(3) La Dépêche, 2 février 1939.
00:37 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, camps de concentration, univers concentrationnaire, france, guerre d'espagne, guerre civile espagnole, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 19 décembre 2018
1941 : le viol de la neutralité iranienne

1941 : le viol de la neutralité iranienne
Les Britanniques et les Soviétiques ont envahi l’Iran pour s’emparer des champs pétrolifères
Par Klaus Gröbig
Les frontières de l’Iran actuel ont une importance géostratégique remarquable. Leur tracé barrait hier la route de l’Union Soviétique vers tout accès direct à l’Océan Indien ; il empêchait également la liaison territoriale que les Britanniques voulaient établir entre l’Inde, leur principale colonie, et les émirats du Golfe arabique, qu’ils dominaient.
L’Iran, contrairement aux Arabes, avec qui il partage la religion islamique, abrita un très vieux peuple de culture. Déjà en 600 avant J.C., existait un vaste empire persan, qui cherchait à s’étendre. Lors des guerres contre les Perses, les Européens, en l’occurrence les Grecs, firent pour la première fois connaissance avec cette puissance asiatique montante. A Salamis, en 480 avant J.C., les Perses sont battus sur mer par Thémistocle ; un an plus tard, Pausanias les bat sur terre à Platée. Les Perses ne reviendront plus jamais en Europe. La caractéristique la plus remarquable de cet empire antique fut sa tolérance. Lorsque Thémistocle fut chassé d’Athènes, les Perses lui offrirent l’asile, à lui, leur vainqueur.
Le Shah Reza Pahlavi, père du dernier empereur d’Iran, avait compris que seule une armée puissance pouvait garantir la souveraineté de l’Iran. Sous son règne, l’Iran a orienté sa politique sur les réformes préconisées par Mustafa Kemal Atatürk en Turquie. Comme l’ « Anglo-Persian Oil Company » (l’APOC), pillait sans vergogne les richesses minières de l’Iran et ne payait que de bien chiches dividendes, les moyens financiers du Shah étaient réduits. Il a fallu attendre le 15 mars 1951 pour que l’APOC soit nationalisé.
En 1925, l’Iran était quasiment en faillite parce que les recettes fiscales s’étaient avérées insuffisantes. En 1926, le Shah décrète que le service militaire sera une obligation pour tous les Iraniens. En 1927, le Shah Reza ordonne la création d’une marine de guerre. Le 20 mars 1928, le Parlement approuve ce plan. Dès 1928, des firmes allemandes participent à la construction du chemin de fer transiranien. Les relations entre l’Allemagne et l’Iran étaient bonnes, même cordiales.
Sans avoir été provoqués d’aucune façon, les Britanniques et les Soviétiques envahissent l’Iran en août 1941. Quelques temps auparavant, les Britanniques et les Français avaient déjà envisagé de violer la neutralité iranienne pour pouvoir attaquer l’Union Soviétique ou lui nuire. En effet, l’Union Soviétique s’était de facto alliée à l’Allemagne nationale-socialiste en août 1939. Mais suite à des discussions orageuses avec le ministre soviétique des affaires étrangères, Molotov, le 12 novembre 1940 à Berlin, les protagonistes de l’alliance germano-soviétique entrent virtuellement en conflit, ce qui amènera les Allemands à attaquer l’Union Soviétique le 22 juin 1941.
Jusqu’à ce moment-là, l’intégrité territoriale et la neutralité de l’Iran reposait sur le simple fait que les deux agresseurs d’août 1941 étaient des adversaires : ce facteur disparaît en juin 1941.
Lorsque le Shah Reza Pahlavi s’est rendu compte que les Britanniques préparaient l’invasion de l’Iran, il s’est adressé par écrit, le 25 août 1941 au Président américain Franklin D. Roosevelt. On y trouve ces mots : « …. En concordance avec la déclaration de Votre Excellence quant à la nécessité de défendre les principes du droit international et du droit des peuples à la liberté, je demande à Votre Excellence d’entreprendre incessamment et en urgence les mesures d’ordre humanitaires qui s’imposent, pour mettre un terme à cet acte d’agression. Le cas qui nous préoccupe entraîne un pays pacifique et neutre dans une guerre alors que ce pays ne veut pas autre chose que le maintien de la paix pour pouvoir poursuivre les réformes entamées ».

Roosevelt répondit avec un cynisme consommé : « Si l’on examine la problématique dans son ensemble, on ne peut pas seulement tenir compte des question qu’évoque Votre Majesté impériale, il faut aussi poser des questions quant aux ambitions de Hitler, lesquelles entendent conquérir le monde. Il faut donc partir du principe que l’Allemagne voudra poursuivre ses campagnes conquérantes, au-delà même des frontières européennes, en Asie, en Afrique et même en Amérique, sauf si on l’empêche par la force des armes. Il est certain aussi que les pays, qui entendent conserver leur indépendance, devraient unir leurs forces dans un effort commun, s’ils ne veulent pas tomber les uns après les autres, comme cela s’est déjà passé pour un grand nombre de pays en Europe. Au vu de tous ces faits, le gouvernement et la population des Etats-Unis d’Amérique intensifient, comme cela est notoirement connu, non seulement les efforts défensifs voulus de leur propre pays mais participent également à des programmes d’aide de grande ampleur, destinés aux pays qui s’opposent activement aux orgueilleux buts de guerre des Allemands qui veulent dominer le monde ».
Et Roosevelt ajoutait que l’attaque contre l’Iran ne visait pas son indépendance ou son intégrité territoriale. Les réticences à l’égard des Etats-Unis, qui sont vivaces en Iran aujourd’hui, s’expliquent pour partie par l’attitude qu’adopta jadis Roosevelt. De tels faits ont un impact sur le très long terme. Les peuples ont la mémoire parfois très longue.
Le même jour, le 25 août 1941, les armées rouge et britannique entrent en Iran. Il n’y eu qu’une résistance sporadique. L’objectif avéré des alliés, dans ce viol de la neutralité iranienne, était de sécuriser une voie non exposée aux coups des Allemands ou des Italiens pour livrer des armes et du matériel américains à l’Union Soviétique.
La Royal Navy n’a pu aligner que des unités de seconde classe, très faibles sur le plan militaires, lorsqu’elle attaqua les ports iraniens d’Abadan et Khorramshar. La guerre en Méditerranée contre les Italiens et dans l’Atlantique contre les Allemands ne lui laissait, à ce moment-là, qu’une marge de manœuvre très réduite.
Le Premier Ministre britannique Winston Churchill voulait, immédiatement après l’occupation du territoire iranien, exciter le mécontentement populaire et le tourner contre le Shah. Il a noté dans son journal : « Comme nous l’avons fait à l’époque, nous pouvons aujourd’hui le chasser ». Le 17 septembre 1941, les Britanniques obligent le Shah à abdiquer en faveur de son fils.
Klaus Gröbig.
(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°36/2018, http://www.zurzeit.at ).

L’Axe anglo-soviétique
L’invasion de l’Iran par les forces armées soviétiques et britanniques conjointes lors de la seconde guerre mondiale a duré du 25 août au 17 septembre 1941. Elle se déroula sous le nom de code « Operation Coutenance ». L’objectif de l’invasion était de sécuriser les champs pétrolifères iraniens et de créer une ligne d’approvisionnement logistique au bénéfice de l’Union Soviétique, qui était en guerre avec l’Allemagne depuis le 22 juin 1941. L’état-major britannique, cependant, a concocté son plan d’invasion de l’Iran dès le 11 juin 1941, onze jours avant l’Opération Barbarossa. Le général iranien Haj Ali Razmara voulaient défendre toute la partie septentrionale de l’Iran dans les régions frontalières et bloquer les troupes soviétiques à la frontière.
18:18 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, perse, moyen orient, histoire, opération countenance, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 29 novembre 2018
Julius Evola dans la guerre et au-delà...
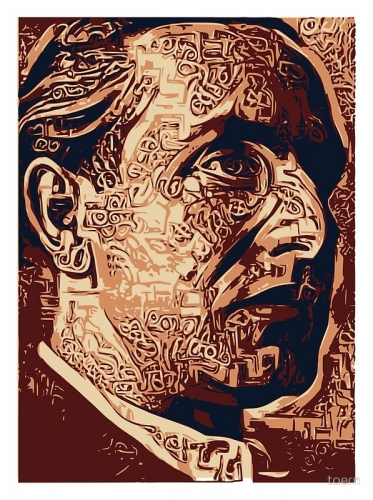
Julius Evola dans la guerre et au-delà...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Les éditions Akribéia viennent de publier un essai de Gianfranco de Turris intitulé Julius Evola dans la guerre et au-delà 1943-1951. Journaliste et intellectuel italien, Gianfranco de Turris est un spécialiste de l’œuvre d'Evola, et également de celle de Tolkien.
 " Malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées, une période cruciale de la vie de Julius Evola restait encore dans l’ombre, d’autant plus que l’intéressé, discret jusqu’à la réticence au sujet de lui-même, en avait très peu parlé : les années 1943-1951, qui furent celles de l’attitude à adopter face à la grande crise du régime fasciste et à la fondation de la République sociale italienne (rsi), puis de l’accident survenu à Vienne début 1945 qui le laissa paralysé des membres inférieurs, du véritable « chemin de croix » médical qui suivit entre l’Autriche, la Hongrie et l’Italie, enfin du retour définitif à Rome au printemps de 1951.
" Malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées, une période cruciale de la vie de Julius Evola restait encore dans l’ombre, d’autant plus que l’intéressé, discret jusqu’à la réticence au sujet de lui-même, en avait très peu parlé : les années 1943-1951, qui furent celles de l’attitude à adopter face à la grande crise du régime fasciste et à la fondation de la République sociale italienne (rsi), puis de l’accident survenu à Vienne début 1945 qui le laissa paralysé des membres inférieurs, du véritable « chemin de croix » médical qui suivit entre l’Autriche, la Hongrie et l’Italie, enfin du retour définitif à Rome au printemps de 1951.
Avec une passion de la vérité et de la précision qui force l’admiration, l’auteur fait défiler, sur un rythme qui évoque souvent celui du roman policier, rencontres, personnages et initiatives. Qu’il s’agisse de la présence d’Evola au quartier général de Hitler aussitôt après la libération de Mussolini, de sa collaboration avec le sd, de sa fuite rocambolesque de Rome le 4 juin 1944 pour échapper aux services secrets américains, de ses liens étroits, à Vienne, avec le philosophe Othmar Spann et son cercle, du projet d’écrire un grand ouvrage antimaçonnique, des conditions exactes du bombardement dont il sortit victime –, les pages remplies d’informations souvent inédites se succèdent pour réduire à néant toutes les « légendes urbaines » accumulées au fil des ans autour d’un personnage très controversé.
Peu à peu émergent la figure d’un homme étonnamment actif, d’abord désireux de rassembler les forces éparses du conservatisme aristocratique en un réseau secret paneuropéen, puis, après son accident, celle d’un « guerrier immobile » dont l’enseignement va influencer durablement plusieurs générations de néofascistes habités par l’idée d’une Droite traditionnelle d’orientation « gibeline ».
Un livre strictement indispensable à quiconque entend accéder à une connaissance authentique de l’homme Evola et de son œuvre. "
10:42 Publié dans Histoire, Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, diplomatie, italie, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 novembre 2018
Father Coughlin, Ralph Ingersoll, & the War Against Social Justice

Father Coughlin, Ralph Ingersoll, & the War Against Social Justice
By Margot MetrolandThe public career of Rev. Charles E. Coughlin during the 1930s and early ‘40s is massively documented. Newsreels, publications, speeches, and broadcast recordings are all at your fingertips online. Yet the historical significance of this Canadian-American prelate (1891-1979) is maddeningly elusive. You may have read that he was an immensely popular but controversial “radio priest” with a decidedly populist-nationalist bent, or that he published a weekly magazine called Social Justice (1936-1942), whose contributors included future architect Philip Johnson and philosopher-to-be Francis Parker Yockey.
You may also know that his broadcasting and publishing endeavors were suspended in 1942, soon after American entry into the Second World War. Knowing nothing else, one would assume this was part of the same anti-sedition roundup that netted Lawrence Dennis, George Sylvester Viereck, and others. But in fact the anti-Coughlin campaign was much more focused and sustained, and it originated not from the Justice Department or any other government agency, but from an oddball Left-wing New York newspaper led by one of the most notable editors of the era: Ralph Ingersoll.
 The paper was PM, and for the first two years of its existence (1940-42), it exulted in damning Father Coughlin as a seditionist, a yellow-journalist, a Nazi mouthpiece, and an impious opponent of democracy. PM began with a long series of articles in the summer of 1940. “Nazi Propagandist Coughlin Faithless to Church and Country: Hatred and Bigotry Spread Throughout the Nation by Priest,” screamed one headline. After American entry into the war, histrionic, full-page editorials by Editor Ingersoll became a regular feature; e.g., one titled “Has Charles Coughlin Lied Again?”
The paper was PM, and for the first two years of its existence (1940-42), it exulted in damning Father Coughlin as a seditionist, a yellow-journalist, a Nazi mouthpiece, and an impious opponent of democracy. PM began with a long series of articles in the summer of 1940. “Nazi Propagandist Coughlin Faithless to Church and Country: Hatred and Bigotry Spread Throughout the Nation by Priest,” screamed one headline. After American entry into the war, histrionic, full-page editorials by Editor Ingersoll became a regular feature; e.g., one titled “Has Charles Coughlin Lied Again?”
Time and our mental institutions will take care of his unhappy and misguided followers. But these leaders who have served the purpose of the murderous Adolf Hitler must go . . . Hitler and Coughlin – their lies have been the same . . . (PM, May 7, 1942)
In March ’42, PM started to print tear-out-and-mail questionnaires addressed to Attorney General Biddle, demanding that the government immediately investigate Coughlin and ban Social Justice from the US postal system. Forty-three thousand of these were mailed in by loyal readers, the paper reported, and soon enough Biddle lowered the boom. PM was cock-a-hoop:
The Post Office Dept. invoked the 1917 Sedition Act last night to ban from the mail Social Justice, founded in 1936 by Charles E. Coughlin.
Postmaster General Walker acted on a recommendation from Attorney General Biddle, who informed him that since the war [sic] Social Justice “has made a substantial contribution to a systematic and unscrupulous attack upon the war effort of our Nation, both civilian and military.” (PM, April 15, 1942)
Coughlin was threatened with a Grand Jury investigation for sending seditious propaganda to military personnel and munitions workers. Eventually, an agreement was reached between Justice and the bishop of Detroit, whereby Coughlin would cease publishing and public speaking and slip off quietly to his rectory. Which, as it happens, he did.
Anyone familiar with the rhetoric of the time will recognize PM‘s hysterical tone as classic Communist cant of the Stalin era. (We will put them in mental hospitals!) Surprisingly enough, though, Ralph Ingersoll was not himself a straight-up commie. A Fellow Traveler, yes; one who sought favor with the Reds and sometimes aped the party line. But this was standard behavior among writers and editors of his time – one thinks offhand of Ernest Hemingway, Dwight MacDonald, Edmund Wilson, Mary McCarthy, and even James Burnham and George Orwell. Ingersoll readily admitted having spent a year in a Communist Party study group during the 1930s, but that was mainly because he was having an affair with Lillian Hellman and she dragged him along. That last fact is alarming enough by itself, but Ingersoll was a dilettante. He never understood the rules of political engagement. From Ingersoll’s standpoint, he was a centrist kind of guy, the sort who would explain unironically that he was opposed to totalitarianism in all forms.
After he died in 1985, Ingersoll’s obituarists and biographers would write that the hardest part of his job at PM was maintaining peace between the two extreme factions: the “pro-Communist” staffers and the “anti-Communists.” Today, we would probably judge the feud as one of Stalinists vs. Trotskyites. PM‘s Washington correspondent, I. F. (“Izzy”) Stone, certainly would fall into the first camp. And it’s hard to believe an actual conservative would have found a warm berth at PM. He’d probably be tarred as a fascist Coughlinite.
PM lasted only eight years (1940-48), mainly because it didn’t run advertising, and the millions invested by department store heir Marshall Field III eventually ran out. And perhaps the late 1940s were not a boom time for flaky, pro-Communist evening newspapers. But PM had some good points, and was a landmark paper in many ways. Its editorial cartoonist was Dr. Seuss himself, who until now had earned his keep mainly by drawing ads for a Standard Oil bug spray. (His cartoons, with their extreme racial caricatures of the Japanese, wouldn’t pass muster today; more than anything else, they remind one of over-the-top Twitter memes.) Crockett Johnson’s classic Barnaby comic strip was launched in PM, and so was Walt Kelly’s Pogo. In its news reportage, PM was quite unlike any daily paper before or since. Its news stories were often written as highly personal, investigative features that went on for many hundreds of words. This basic style would later mature as the “New Journalism” of the 1960s and ‘70s.
 From the start, PM was renowned for its crankiness and an eagerness to print facts and speculation side-by-side, journalistic taste be damned. For example, in 1941 New Yorker editor Harold Ross discovered that his male secretary had embezzled about a hundred thousand dollars from him over the years. Ross wanted to keep the story hushed up, especially after the greedy amanuensis gassed himself in his Brooklyn apartment and was revealed to be a homosexual who squandered the dough on boyfriends, the turf club, and maybe a blackmailer. This was Harold Ross’ nightmare idea of a scandal. Most of his friends in the press were happy to help him bury the lurid tale. Not PM, though, which printed the murky details of the kitchen suicide, as well as the disarray of Ross’ personal finances.
From the start, PM was renowned for its crankiness and an eagerness to print facts and speculation side-by-side, journalistic taste be damned. For example, in 1941 New Yorker editor Harold Ross discovered that his male secretary had embezzled about a hundred thousand dollars from him over the years. Ross wanted to keep the story hushed up, especially after the greedy amanuensis gassed himself in his Brooklyn apartment and was revealed to be a homosexual who squandered the dough on boyfriends, the turf club, and maybe a blackmailer. This was Harold Ross’ nightmare idea of a scandal. Most of his friends in the press were happy to help him bury the lurid tale. Not PM, though, which printed the murky details of the kitchen suicide, as well as the disarray of Ross’ personal finances.
Coincidentally enough, Ralph Ingersoll had been one of The New Yorker‘s first managing editors. He knew all about Harold Ross’ financial messiness. After Henry Luce hired him to edit the new Fortune magazine, Ingersoll turned in a long unsigned exposé (1934) of The New Yorker, in which he talked about salaries, advertising revenue, and other piquant details that Ross wanted to keep under lock and key. (Ross soon took his revenge with a satirical Wolcott Gibbs profile of the Luce enterprise, written entirely in 1930s Timese and famously ending, “Where it all will end, knows God!”)
Ingersoll then became managing editor of Time, where Luce thought him the best helmsman ever. Ingersoll filled the editorial ranks with high-class Lefties like himself. Republican Luce didn’t seem to mind. (“Goddamn Republicans can’t write.”) Luce was accordingly miffed when Ingersoll left in 1939 to launch his brainchild of a progressive evening paper. But just as Ingersoll was going out the door, in came portly, gloom-laden ex-Communist Whittaker Chambers, who started out by writing movie reviews, and wound up as senior editor. On his way up, Chambers had a heart attack and endless feuds with the other “Timeditors.” They’d been hired by Ingersoll and were of a decidedly anti-Chambers political stripe.
Ingersoll thus has an offstage presence in the Hiss-Chambers case. When Alger Hiss’ attorneys wanted to dig up dirt on Whittaker Chambers in 1948, they went to his enemies at Time, who dutifully reported that Chambers was delusional and often displayed signs of mental illness. These were Ralph’s boys.
Both Chambers and Coughlin were the targets of far-Left smear campaigns, but so were many other conservatives in the 1940s. What is missing in the Coughlin case is Ingersoll’s motive. It cannot have been personal. Ingersoll may have crossed paths with Whittaker Chambers, but Social Justice and Coughlin supporters were on a different planet entirely. Nor could he seriously have believed Fr. Coughlin was leading a vast and powerful Nazi underground.

So we have to make some educated guesses here. PM‘s “angel,” Marshall Field III, was a patron of Leftist and Communist causes. The same year PM began publishing, Field endowed Saul Alinsky’s radical-training school in Chicago (Industrial Areas Foundation). PM needed to be a far-Left paper to please its patron. And lacking advertising, it needed to make a big noise to survive on subscriptions and newsstand copies. Thus it needed a “safe” cause, one that could be sensationalized. Fr. Coughlin, of the Shrine of the Little Flower in Royal Oak, Michigan, fit the bill perfectly. Not many too people in New York City were going to complain. Moreover, Coughlin as Villain satisfied a Left-wing craving for anti-Catholicism, something badly needed since early 1939, when the Leftists lost the Spanish Civil War.
Ingersoll’s life post-PM continued in an industrious, dilettantish, rather apolitical key. He ended up owning a chain of newspapers in the Northeast and Midwest (The New Haven Register, The Trentonian, etc.). When The New York Times reviewed a biography of him in 1985, the headline was “Crusading Editor Dies Rich.”
As for Fr. Coughlin, from 1942 he entered a period of “radio silence,” figuratively and literally, spending the rest of his life as a parish priest in Michigan. He was more obscure than you can imagine today, given his current notoriety. I’ve known parishioners of his from the 1950s and ‘60s. They told me that while they were aware their pastor had once been famous on the radio, they didn’t know much about that, or why it all ended. So it seems Fr. Coughlin sought obscurity, and he got it: receding into the newsreel past, a fuzzy, half-forgotten figure like Huey Long and Hamilton Fish.
 Fr. Coughlin lived until 1979, seldom remarked upon or remembered. Since that time, the smear campaign has begun anew, as though taken straight from the pages of the 1942 PM. All the trite pejoratives get leveled at him: fascist, pro-Nazi, conspiracy-thinker. And, of course, “anti-Semite.” The website of Washington, DC’s Holocaust Museum even has a page dedicated to him, and it’s filled with every sort of twist and innuendo in the cliché barrel. For example, after Germany’s Kristallnacht made the headlines in November 1938, the priest gave a radio talk explaining the background to the news. This is spun as Coughlin “defend[ing] the state-sponsored violence of the Nazi regime,” although he did not, in fact, endorse violence, window-breaking, or persecution of Jews. From sites such as this, you might get the impression that Fr. Coughlin was a sort of Julius Streicher in a Roman collar.
Fr. Coughlin lived until 1979, seldom remarked upon or remembered. Since that time, the smear campaign has begun anew, as though taken straight from the pages of the 1942 PM. All the trite pejoratives get leveled at him: fascist, pro-Nazi, conspiracy-thinker. And, of course, “anti-Semite.” The website of Washington, DC’s Holocaust Museum even has a page dedicated to him, and it’s filled with every sort of twist and innuendo in the cliché barrel. For example, after Germany’s Kristallnacht made the headlines in November 1938, the priest gave a radio talk explaining the background to the news. This is spun as Coughlin “defend[ing] the state-sponsored violence of the Nazi regime,” although he did not, in fact, endorse violence, window-breaking, or persecution of Jews. From sites such as this, you might get the impression that Fr. Coughlin was a sort of Julius Streicher in a Roman collar.
But the ultimate target of such smears really isn’t the long-dead Fr. Coughlin himself. Rather it is conservatives, Christians, and the image of a vanished America, here vandalized into a dystopia of hate and horror.
00:41 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pacifisme américain, états-unis, father coughlin, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





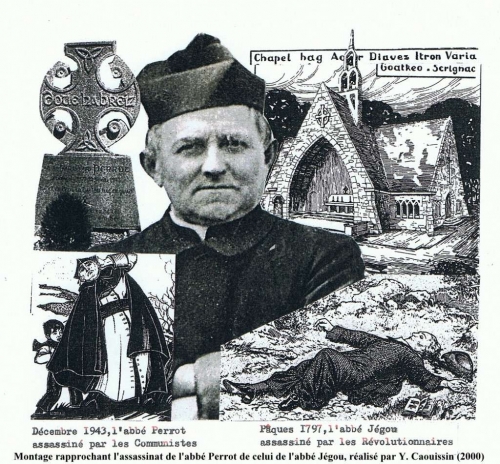
Vor gut 80 Jahren begann Ernst Jünger sein Tagebuch zum Zweiten Weltkrieg.
Sein Kriegstagebuch über den Ersten Weltkrieg, In Stahlgewittern, ist zumindest vom Titel und groben Inhalt her sehr vielen bekannt. Dieses Erstlingswerk ist bis heute ohne Frage eines der erschütterndsten Zeugnisse über den Frontalltag des Grabenkrieges, welchen Jünger vier Jahre lang erlebte. Weitaus unbeachteter blieben hingegen seine Notizen über den Zweiten Weltkrieg, die Strahlungen.
Davon abgesehen, erschien die Erstausgabe bereits 1949 mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren und zählt für viele Jünger-Kenner mit zum Besten, was der Literat je zu Papier brachte. Die geringere Bekanntheit mag heute dadurch zu erklären sein, daß Jünger während des Zweiten Weltkrieges hauptsächlich in der Verwaltung tätig war, und nicht an der Front kämpfte, was bei einigen potentiellen Lesern sicherlich die „Action“ vermissen lässt. Ganz gefahrlos waren jedoch auch für Jünger die Jahre 1939 bis 1945 nicht.
Die von April 1939 bis Dezember 1948 reichenden Strahlungen, welche – je nach Auflage – über 1.000 Seiten umfassen, setzen zunächst mit dem Buch Gärten und Straßen an. In diesem schildert Jünger seine Erlebnisse aus dem Frankreichfeldzug, an welchem er als Hauptmann teilnahm. Prägten während des Ersten Weltkrieges buchstäbliche „Stahlgewitter“ seinen Kriegsalltag, bekam der Hauptmann der Infanterie nun nur noch „Gärten und Straßen“ zu sehen. Der Feldzug im Mai und Juni 1940 war bereits zu Ende, noch bevor seine stets zu Fuß vorwärts marschierende Truppe in das Kriegsgeschehen eingreifen konnte.
Die Jahre an der Seine
Dieser bereits 1942 veröffentlichte erste Teil ist dabei deutlich zurückhaltender geschrieben als der nach dem Krieg veröffentlichte Rest seines Tagebuches, was man insbesondere an den politischen Beurteilungen der Zeit erkennt. Den ergiebigeren Kern bilden daher die beiden aus den Jahren 1941-44 geschriebenen „Pariser Tagebücher“, die im besetzten Paris vom Leben in der Etappe erzählen.
Hier unterhielt Jünger auch Beziehungen zu unterschiedlichen Größen der Zeit, wie Pablo Picasso, Louise Ferdinand Céline und auch Carl Schmitt, der ihn in Paris besuchen kam. Aber auch zu den in Paris aktiv arbeitenden Verschwörern des 20. Juli, wie Speidel, Stülpnagel und Hofacker, unterhielt Jünger regen Kontakt.
Im Gegensatz zu den drei genannten blieb Jüngers Mitwisserschaft am Umsturzversuch jedoch unentdeckt. Seinen Beitrag am Widerstand lieferte er in Form der 1942 verfassten Friedensschrift, die nach dem Krieg gesondert veröffentlicht wurde. Eine noch spätere Veröffentlichung fand gar seine Schrift Zur Geiselfrage, in welcher er die Umstände der aus Berlin befohlenen Hinrichtungen inhaftierter Franzosen schildert, die 1941 als Racheakt durchgeführt werden mussten. Auf Grundlage dieser Schrift spielt zudem der 2011 erschienene Film vom Volker Schlöndorff Das Meer am Morgen.
Die innere Freiheit bewahren
Diese und viele weitere Themen sind es, welche gerade die beiden Pariser Tagebücher als den wertvollsten Teil der Strahlungen erscheinen lassen. Die öffentliche Beschäftigung mit ihnen beschränkt sich jedoch für gewöhnlich leider recht oberflächlich auf die immer gleichen Aspekte. So auf seine verschiedenen Liaisons in Paris oder auf seinen angeblich rein elitären Blick, der ihn das Leid um sich herum vergessen ließ.
Paris, 14. März 1943
Wenn alle Gebäude zerstört sein werden, bleibt doch die Sprache bestehen, als Zauberschloß mit Türmen und Zinnen und mit uralten Gewölben und Gängen, die niemand je erforschen wird. Dort, in den Schächten, Oublietten und Bergwerken, wird man noch weilen können und dieser Welt verlorengehen.
Derlei Sentenzen bilden den eigentlichen Gewinn seiner Schriften. Sie sind zeitlich ungebunden. „Das Ordnen der Geschehnisse als Akt der Selbstbehauptung“, wie es in einem Vorwort des Verlages heißt.
„Wenn ein Pulverturm in die Luft fliegt, überschätzt man die Bedeutung der Streichhölzer.“
Nach dem Rückzug aus Paris vor den Invasionstruppen der Alliierten wird Jünger schließlich aus der Wehrmacht entlassen und kehrt zurück in das niedersächsische Kirchhorst, wo er das Kriegsende erlebt. Festgehalten wird diese Zeit in den beiden letzten Büchern Kirchhorster Blätter und Die Hütte im Weinberg (Jahre der Okkupation). Wie bereits 1940 in Frankreich, beschreibt Jünger den Einbruch einer gewaltigen Übermacht in eine bereits besiegte Region.
Kirchhorst, 11. April 1945
Von einer solchen Niederlage erholt man sich nicht wieder wie einst nach Jena oder nach Sedan. Sie deutet eine Wende im Leben der Völker an, und nicht nur zahllose Menschen müssen sterben, sondern auch vieles, was uns im Innersten bewegte, geht unter bei diesem Übergang. Man kann das Notwendige sehen, begreifen, wollen und sogar lieben und doch zugleich von ungeheurem Schmerz durchdrungen sein.
Nun braucht es keinen Weltkrieg, um zu vielen Einsichten zu gelangen, die Jünger in seinem Tagebuch niederschrieb. Diese Erkenntnis schließt denn auch wiederum den Bogen zu uns heutigen Lesern, die gerade in dieser Schrift Jüngers weitaus mehr finden als nur zeitbezogene Singularitäten. „Hinsichtlich der Wahrnehmung der historischen Realitäten bin ich vorgeschaltet – das heißt, ich nehme sie etwas eher, etwas vor ihrem Erscheinen wahr. Für meine praktische Existenz ist das nicht günstig, da es mich zu den jeweils waltenden Mächten in Widerspruch bringt.“