jeudi, 09 octobre 2025
Orages d'acier, une expérience littéraire
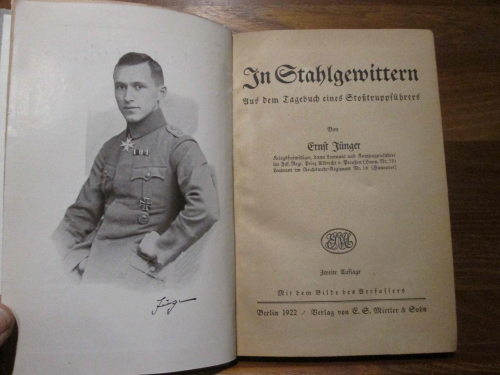
Orages d'acier, une expérience littéraire
Claude Bourrinet
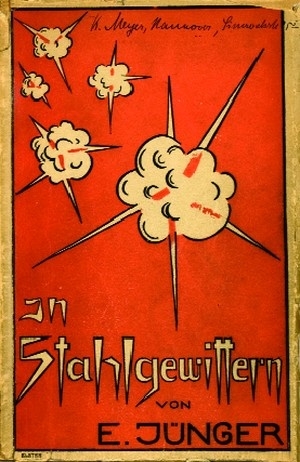 A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »
A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »
Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année. Dans les années soixante, il avait répliqué à Moravia, reprenant un mot de Marx : « Une Iliade serait-elle possible avec de la poudre et du plomb ? »
C’est pourquoi il est nécessaire d’interpréter Orages d’acier non comme un document, mais comme un monument. Comme « document », nous avons ses carnets de guerre, bruts, elliptiques, dont la rédaction est chaotique, parfois allusive, tant la situation était dépendante de l’urgence du moment. Le « monument » fut la réfection qu’en fit Jünger, et qu’il publia sur le conseil de son père. L’écriture y est celle d’un écrivain talentueux, et la fascination qu’elle exerce tient à son intensité et à l’esthétisation d’une expérience qui transcende les mots. Jünger y a sacralisé la guerre, comme « expérience intérieure », en en rendant toute la puissance nihiliste. Mais la séduction qui nous captive provient surtout du regard impassible qu’il jette sur une apocalypse.
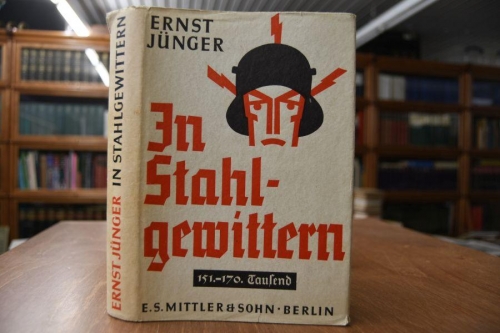
Or, il semble que le récit fictionnel, Lieutenant Sturm, publié dans le Hannoverscher Kurier. Zeitung für Norddeutschland, du 11 au 27 avril 1923, et redécouvert au début des années 60, sonne de manière plus authentique, du fait même de son caractère « inabouti », comme s’il s’agissait d’ébauches mêlant témoignage, bribes de romans, rêves… L’exaltation presque « mystique » qu’on trouve dans Orage d’acier peut bien s’y rencontrer, mais corrigé par des réflexions plus désabusées.
16:52 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, première guerre mondiale, livre, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 septembre 2025
Ernst Jünger et l'Iranien Jalal Al-e Ahmad: deux critiques de la modernité technique et de l'occidentose

Ernst Jünger et l'Iranien Jalal Al-e Ahmad: deux critiques de la modernité technique et de l'occidentose
Alessandra Colla : Entre Ernst Jünger et Jalal Al-e Ahmad, il existe davantage une « convergence critique » qu'une « alliance intellectuelle » fondée sur une critique de la modernité
Entretien avec Alessandra Colla
Propos recueillis par Eren Yeşilyurt
Source: https://erenyesilyurt.com/index.php/2025/08/29/alessandra...
Lorsque je suis tombé sur cette phrase de Jalal Al-e Ahmad à propos d'Ernst Jünger, j'ai été profondément marqué : « Jünger et moi étudiions plus ou moins le même sujet, mais sous deux angles différents. Nous abordions la même question, mais dans deux langues différentes ». Partant de cette affirmation, nous avons discuté avec Alessandra Colla, de la revue Eurasia, de la manière dont les deux penseurs ont abordé des questions communes issues de contextes culturels et intellectuels différents, dans le cadre de la révolution conservatrice et du Gharbzadegi.
Jalal Al-e Ahmad reste un penseur dont les œuvres et les concepts font encore aujourd'hui l'objet de débats. Pourriez-vous nous parler de sa vie et des transformations de son univers intellectuel ? Quels facteurs ont déclenché ces changements ?
En Italie, Jalal Al-e Ahmad (portrait, ci-dessous) est pratiquement inconnu en dehors des milieux spécialisés. Pourtant, ce penseur est une figure centrale de l'histoire intellectuelle iranienne du 20ème siècle, au point d'être considéré comme l'un des inspirateurs de la révolution de 1979.
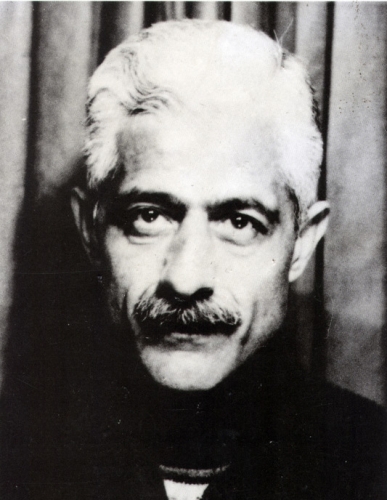
Sa vie est profondément liée à l'histoire mouvementée de l'Iran du 20ème siècle : il est difficile de la raconter de manière exhaustive dans une interview, je me contenterai donc d'en esquisser les grandes lignes.
Né à Téhéran en décembre 1923 dans une famille chiite de tradition cléricale depuis trois générations, il ressent très tôt la tension entre la vision religieuse du monde et la transformation radicale de la société iranienne sous Reza Pahlavi, le shah au pouvoir depuis 1925. Après avoir commencé des études de théologie, il les abandonne au bout de trois mois et rompt avec sa famille, refusant ses valeurs religieuses. En 1944, il adhère au Tudeh, le parti communiste iranien d'orientation marxiste (fondé en 1941) et en 1946, il obtient une licence en littérature persane au Tehran Teachers College, décidé à se consacrer à l'enseignement.
 Entre-temps, sa carrière politique décolle, le conduisant en quelques années à devenir membre du Comité central, puis délégué au congrès national et enfin directeur de la maison d'édition du parti. À ce titre, il commence à publier ses recueils de nouvelles jusqu'à ce qu'il obtienne, en 1947, son habilitation à enseigner ; la même année, il quitte le Tudeh, auquel il reproche son dogmatisme stalinien. Son exemple est suivi par d'autres et, sous l'inspiration de Khalil Maleki (photo, ci-contre), intellectuel et homme politique de la gauche iranienne, les dissidents créent le Parti iranien des travailleurs.
Entre-temps, sa carrière politique décolle, le conduisant en quelques années à devenir membre du Comité central, puis délégué au congrès national et enfin directeur de la maison d'édition du parti. À ce titre, il commence à publier ses recueils de nouvelles jusqu'à ce qu'il obtienne, en 1947, son habilitation à enseigner ; la même année, il quitte le Tudeh, auquel il reproche son dogmatisme stalinien. Son exemple est suivi par d'autres et, sous l'inspiration de Khalil Maleki (photo, ci-contre), intellectuel et homme politique de la gauche iranienne, les dissidents créent le Parti iranien des travailleurs.
Mais en 1948, le Tudeh connaît une nouvelle scission, qui donne naissance à la Troisième Force: un mouvement politique pour le développement indépendant de l'Iran, qui se propose de conjuguer le nationalisme avec une forme de socialisme démocratique et de centrisme marxiste, se distanciant ainsi tant de l'influence occidentale que de l'influence soviétique. Al-e Ahmad y adhère immédiatement après avoir quitté le Parti iranien des travailleurs, mais le mouvement se dissout en 1953 avec le coup d'État – orchestré par les États-Unis (CIA) et la Grande-Bretagne (MI6) – qui ramène au pouvoir Mohammad Reza Pahlavi, sur le trône depuis 1941 et momentanément en exil à Rome. La même année, Al-e Ahmad se retire définitivement de la militance et se consacre, au cours de la décennie suivante, à l'enseignement, à la littérature (en tant qu'auteur et traducteur du français d'œuvres de Camus, Gide, Ionesco et Sartre) et à la recherche ethnographique dans le nord de l'Iran et dans le golfe Persique. Il y découvre le monde, jusqu'alors inconnu pour lui, du sous-prolétariat paysan, riche en valeurs reconnues comme archaïques mais largement supérieures à celles, fictives, imposées par la modernité : cette expérience le marque profondément et contribue de manière décisive au dernier tournant intellectuel de sa vie, comme nous le verrons.
Jusqu'en 1968, il voyage beaucoup (États-Unis, URSS, Israël, Arabie saoudite) et publie des comptes rendus précis et critiques de ses expériences. Son voyage à La Mecque, effectué en 1966, est d'une importance capitale. À la suite de celui-ci, Al-e Ahmad proclame le retour aux origines en réévaluant pleinement l'islam en général et le chiisme en particulier, désormais considéré comme le seul remède possible contre « l'infection occidentale » qui afflige l'Iran. Il écrit un dernier ouvrage, publié à titre posthume en 1978 : « Sur le service et la trahison des intellectuels » (Dar khedmat va khianat roshanfekran), une dénonciation virulente du désengagement des intellectuels iraniens : la référence à La trahison des clercs. Le rôle de l'intellectuel dans la société contemporaine de Julien Benda, publié en 1927, est évidente.
Al-e Ahmad meurt en septembre 1969 chez lui, d'une crise cardiaque, mais une rumeur (encore infondée) commence bientôt à circuler selon laquelle il aurait été éliminé par la Savak, la police secrète du shah.
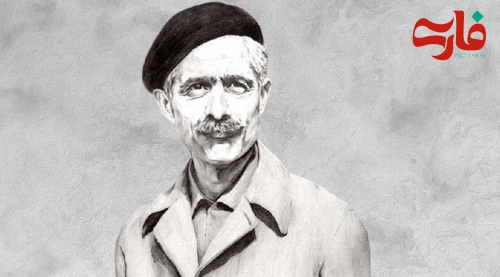

Le premier concept qui vient à l'esprit quand on pense à Jalal Al-i Ahmad est celui d'« occidentalisation » (Gharbzadegi). Pourriez-vous en expliquer la signification et le contexte ?
Al-e Ahmad écrit Gharbzadegi en 1961 et le fait circuler clandestinement. Le livre, publié en 1962, est immédiatement censuré et retiré des librairies. Le titre est très particulier : il est généralement traduit par Occidentose, plus correct que Occidentite. En médecine, en effet, le suffixe « -ite » désigne l'inflammation qui touche un organe ou un appareil : mais Al-e Ahmad ne veut pas parler des maux dont souffre l'Occident. Au contraire, il veut stigmatiser l'Occident comme un mal qui afflige le non-Occident, et c'est pourquoi Occidentose est une traduction plus appropriée : en médecine, le suffixe « -ose » indique « une affection dégénérative » ou « une condition ou un état », et en effet, l'auteur veut dire que l'Iran – et plus généralement le monde non occidental – est « malade de l'Occident ».


Il convient de préciser que le terme gharbzadegi n'est pas une invention originale d'Al-e Ahmad, qui l'emprunte au philosophe Seyed Ahmad Fardid (1909-1994) (photo, ci-dessous), spécialiste de Heidegger et considéré comme l'un des inspirateurs du gouvernement islamique arrivé au pouvoir en 1979. Fardid formule sa critique de l'Occident sur un plan purement philosophique et notamment ontologique : il dénonce explicitement la domination exercée depuis 2500 ans par la tradition philosophique occidentale sur la pensée métaphysique, qui a conduit à l'oubli de la dimension intuitive et spirituelle au profit de la raison pure, détachée de la vérité de l'être.
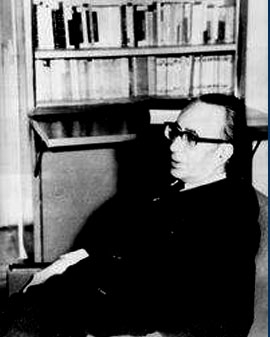
Al-e Ahmad, en revanche, adopte le terme mais lui attribue une valeur différente. Plus précisément, il compare l'Occident à une infestation de mites qui ronge de l'intérieur un tapis persan : la forme reste intacte, mais la substance est appauvrie et vidée, rendant le tapis fragile et sans valeur. L'Occident pèse sur l'identité iranienne non pas comme un simple colonialisme politique (avec tous ses maux), mais comme une colonisation de conquête et d'exploitation qui détruit les mentalités, les coutumes, la culture et l'économie, asservissant tout un peuple et transformant une nation en une coquille vide. Comment en est-on arrivé là ? La réponse est aussi simple que douloureuse : la responsabilité incombe à la classe dirigeante iranienne – le shah et les intellectuels –, qui s'est servilement pliée à la « civilisation » occidentale. Dans une vaine tentative de l'imiter, elle a accepté la destruction de l'artisanat local, l'aliénation culturelle, la perte des valeurs traditionnelles : la conséquence a été une dépendance économique et technologique catastrophique et humiliante qui a relégué l'Iran dans la catégorie du tiers-monde.
C'est précisément cette interprétation que Fardid reproche à Al-e Ahmad, l'accusant de banaliser un phénomène ayant un impact civilisationnel profond. En réalité, en déplaçant le concept d'« occidentisation » du plan de la critique ontologique à celui du diagnostic politique et socio-économique, Al-e Ahmad a réussi à rendre ce concept accessible à un public plus large, le transformant en un puissant vecteur anticolonial capable de galvaniser la dissidence et d'influencer de manière significative l'opposition qui allait conduire à la révolution de 1979.
Mais Al-e Ahmad ne se contente pas de dénoncer le problème, il suggère également une solution, qu'il identifie dans une « troisième voie » capable d'affronter la modernité technologique sans y céder ni la nier : l'Iran peut et doit acquérir le contrôle de la technologie et devenir lui-même un producteur actif plutôt qu'un simple consommateur passif. Bien sûr, cette option n'est pas non plus sans problèmes : une fois l'« occidentisation » surmontée, le risque majeur est ce que l'on pourrait appeler la « machinisation », c'est-à-dire une « intoxication par les machines ». C'est pourquoi, selon Al-e Ahmad, il est essentiel de considérer la machine (la technique) comme un moyen et non comme une fin : le moyen de préserver la liberté et la dignité de l'Iran et de son peuple.
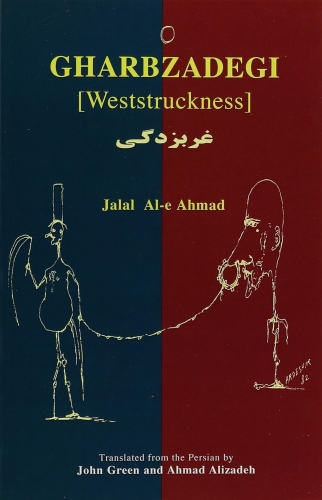
À ce stade, une autre question se pose : qui sera le sujet idéal capable d'entreprendre la « troisième voie » ? Étonnamment, Al-e Ahmad identifie ce sujet dans l'islam chiite duodécimain, seul élément non affecté par l'« occidentose » et même gardien jaloux de la tradition iranienne. Profondément convaincu de l'inadéquation des intellectuels, Al-e Ahmad estime au contraire que le clergé chiite, fort de son intégrité, peut mobiliser avec succès les masses pour les appeler à redécouvrir l'identité perse-islamique la plus authentique.
Comme on pouvait s'y attendre, cette prise de position a suscité à l'époque des polémiques et des critiques : au-delà des accusations de trahison, il est indéniable que la vision de la souveraineté nationale et de l'autosuffisance proposée par Al-e Ahmad semble manquer de rigueur philosophique et de lignes directrices pour sa mise en œuvre pratique. En fait, cette ambiguïté involontaire allait ensuite favoriser l'émergence incontrôlée d'un islamisme et d'un anti-impérialisme fins en eux-mêmes et non canalisés dans le cadre d'une action politique structurée.
Dans son livre Occidentosis, Jalal Al-i Ahmad cite Ernst Jünger en disant : « Jünger et moi explorions tous deux plus ou moins le même sujet, mais sous deux angles différents. Nous abordions la même question, mais dans deux langues différentes. » Comment Ahmad et Jünger se sont-ils croisés intellectuellement ? Pourquoi Ahmad se sentait-il proche de Jünger ?
Nous savons que le lien intellectuel entre Al-e Ahmad et Jünger n'était pas direct, mais médiatisé par la pensée de Martin Heidegger, elle-même transmise en Iran par Fardid. Heidegger (qui a également consacré un séminaire à Jünger en 1939-40) voyait en Jünger le critique le plus perspicace de l'époque moderne, le penseur qui, mieux que quiconque, avait su analyser et diagnostiquer cliniquement l'essence de la technique, sans toutefois en saisir le fondement métaphysique. Heidegger s'était notamment intéressé à deux textes majeurs de Jünger, La mobilisation totale (Die totale Mobilmachung, 1930) et Le Travailleur. Domination et forme (Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, 1932).


Je les rappelle brièvement. Pour Jünger, après l'expérience radicale de la Première Guerre mondiale, la « mobilisation totale » ne concerne plus seulement la sphère économique et militaire, mais touche l'ensemble de la société, devenant le principe organisationnel fondamental du monde moderne, dans lequel toutes les énergies, les ressources, les technologies et les êtres humains eux-mêmes sont précisément « mobilisés », c'est-à-dire organisés et encadrés au service d'un seul et même processus de production gigantesque, identique en temps de paix comme en temps de guerre. Le Travailleur, dans sa double dimension de travailleur-soldat, incarne le nouveau type humain issu de l'expérience de la guerre en tant que protagoniste-instrument de la volonté de puissance exprimée par la technique : en temps de paix, il est chargé du fonctionnement de la machine, comme en temps de guerre il était le serviteur de sa pièce d'artillerie. Je souligne qu'en italien, on a choisi de traduire le mot allemand Arbeiter par « ouvrier » et non par « travailleur », car « ouvrier » identifie immédiatement celui qui travaille dans l'usine, symbole même de la modernité industrielle et capitaliste. Je conserve également la majuscule initiale car, dans le discours de Jünger, « Ouvrier » et « Technique » sont des figures métaphysiques.


L'étude des textes de Jünger a permis à Heidegger d'élaborer le concept fondamental de Gestell, « installation », identifié comme l'essence de la technique moderne. Le Gestell n'est pas une machine ou un appareil unique, mais la manière dont les choses et la réalité (êtres humains, animaux, nature) sont disposées à notre époque, les privant de sens ou de valeur ontologique et en faisant un simple Bestand, une « ressource » pour les besoins de la technique. Ainsi, par exemple, une rivière ou un lac sont une ressource pour la centrale hydroélectrique, une forêt est une ressource pour l'industrie du bois, un être humain est une ressource pour l'entreprise.
Comme Jünger, Al-e Ahmad identifie donc dans la technique – la possession et le contrôle de la machine – comme la caractéristique distinctive de la modernité, qui dépersonnalise l'être humain en le vidant de toute spiritualité et en ouvrant grand les portes au nihilisme. La dépendance de l'Iran à l'égard des machines est précisément l'« occidentisation », qui menace l'existence même de l'individu et du peuple, anéantissant leur identité en parfaite conformité avec le projet colonialiste.
Existe-t-il des parallèles entre le concept d'« occidentisation » et la perspective de la Révolution conservatrice en matière de guerre, de technologie, de culture, etc. ? Peut-on parler d'une alliance intellectuelle dans ce cas ?
Je reprends la phrase d'Al-e Ahmad citée plus haut : « Jünger et moi explorions tous deux plus ou moins le même sujet, mais sous deux angles différents. Nous abordions la même question, mais dans deux langues ». À mon avis, l'expression « dans deux langues » doit être interprétée comme « dans deux langages » différents.
Il existe sans aucun doute une convergence, plus ou moins marquée, entre Jünger et Al-e Ahmad dans leur perception de la technique comme force destructrice : pour l'Allemand, il s'agit d'une instance autonome et planétaire qui anéantit l'individu en tant que personne en le transformant en ouvrier, c'est-à-dire en un type humain standardisé et interchangeable, sans visage, qui a perdu le contact avec la nature et la tradition ; pour l'Iranien, la technique est un instrument de colonisation culturelle et économique qui détruit les identités locales en transformant les personnes en individus sans racines, qui méprisent leur propre culture traditionnelle mais qui, en même temps, ne parviennent pas à s'intégrer dans la culture occidentale dominante.
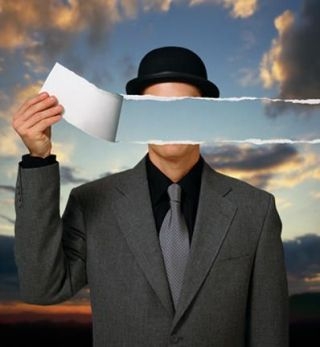
La situation est toutefois différente en ce qui concerne la vision globale de l'histoire et la proposition de solution (à supposer qu'il y en ait une).
Jünger, comme nous le savons, est un représentant éminent de la Révolution conservatrice : dans sa vision élitiste et anti-bourgeoise, l'histoire est un processus métaphysique d'affirmation de la volonté de puissance, qui aboutit au 20ème siècle à la domination de la technique. La conception d'Al-e Ahmad est très différente : tiers-mondiste et anticolonialiste, il interprète l'histoire comme une lutte du peuple pour son émancipation de la domination occidentale.
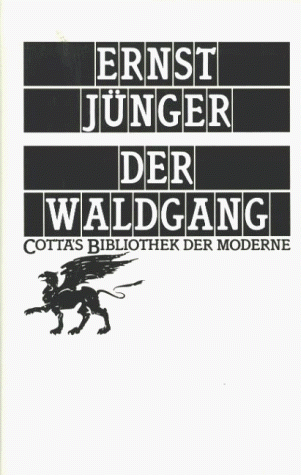
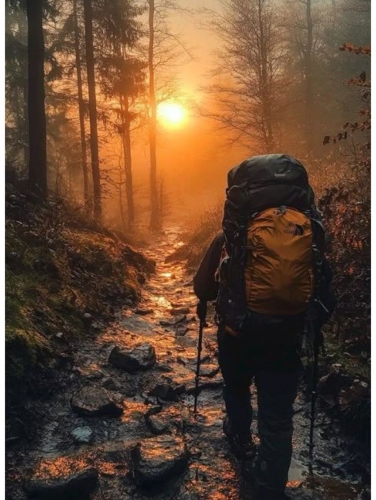
À partir de ces prémisses, les deux penseurs développent un projet cohérent pour échapper à la modernité. Pour Jünger, qui cultive une vision individualiste, la solution réside dans ce qu'il appelle lui-même le « passage à la forêt » (Waldgang) : une résistance intérieure, aristocratique et solitaire – nihiliste –, qui ne prévoit pas l'organisation de mouvements ou de structures articulées mais, tout au plus, la « reconnaissance » entre semblables, en refusant catégoriquement tout engagement collectif. Al-e Ahmad, au contraire, préfigure précisément un retour collectif – spirituel et identitaire – à l'islam chiite, élément central immunisé contre l'« occidentalisation » et donc seul rempart culturel et politique à fonction anti-occidentale ; ces idées contribueront en effet de manière significative à l'idéologie de la Révolution iranienne de 1979.
À la lumière de ces considérations, il me semble donc correct de parler non pas tant d'« alliance intellectuelle » que de « convergence critique » sur le terrain de la critique de la modernité. Pour les deux penseurs, l'Occident du 20ème siècle est un anti-modèle à tous égards, en particulier en ce qui concerne la technique, sorte de hachoir métaphorique qui engloutit la personne dotée de spécificités pour la restituer sous la forme d'un amas organique indifférencié. Mais les projets idéologiques défendus par l'Allemand et l'Iranien divergent radicalement, notamment parce que le contexte dans lequel ils évoluent est radicalement différent : tous deux portent un regard critique sur la modernité et les problèmes qui y sont liés, mais Jünger le fait d'un point de vue interne à l'Occident, tandis qu'Al-e Ahmad le fait d'un point de vue externe, en tant que colonisé.
En conclusion, je pense que l'on peut dire qu'Al-e Ahmad accueille cette partie de la pensée complexe de Jünger comme un outil précieux, utile pour le développement d'une critique de la modernité – avec ses corollaires de libéralisme et de rationalisme – bien structurée et orientée vers la récupération de l'authenticité culturelle de tout un peuple.
Vous écrivez également pour « Eurasia Rivista ». Comment se développe la pensée géopolitique en Italie ? Quelles figures ou courants se distinguent dans ce domaine ? En particulier, quels sont les noms les plus importants dans les études géopolitiques italiennes de ces dernières années ?
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie – contrairement à d'autres pays comme la France ou le Royaume-Uni, par exemple – n'a pas eu d'école géopolitique universitaire autonome forte : cette discipline était en effet associée au fascisme (époque à laquelle d'éminents chercheurs comme Ernesto Massi (photo) et Giorgio Roletto consacraient leur attention à la Méditerranée) et donc stigmatisée. Aujourd'hui encore, elle est souvent enseignée dans le cadre des facultés de sciences politiques, de relations internationales ou d'histoire.

En Italie, le débat le plus animé – très influencé par les appartenances politiques et idéologiques – se déroule généralement en dehors des universités, dans des think tanks ou dans des revues et journaux ; les protagonistes sont très souvent des journalistes, des analystes et d'anciens diplomates.
On peut distinguer, dans les grandes lignes, quatre courants.
Le premier, dominant, est celui des atlantistes-européistes, alignée sur la position officielle italienne au sein de l'OTAN et de l'UE. Elle prévaut au ministère des Affaires étrangères, dans les milieux militaires et financiers, ainsi que dans les partis modérés de centre-droit et de centre-gauche. Elle considère l'OTAN comme un pilier fondamental de la sécurité nationale et européenne, soutient l'intégration européenne, appuie le partenariat transatlantique et envisage un interventionnisme humanitaire ou de stabilisation prudent. Elle est représentée par l'Institut des affaires internationales (IAI) et l'Institut d'études politiques internationales (ISPI). Parmi les noms les plus connus, citons le général Carlo Jean et Andrea Margelletti, président du Centre d'études internationales (CeSI) et conseiller du gouvernement.
Le deuxième courant est celui des souverainistes/nationalistes conservateurs. Apparu avec la montée en puissance des deux partis Lega (dirigé par Matteo Salvini) et Fratelli d'Italia (dirigé par Giorgia Meloni), elle visait à rétablir la souveraineté nationale et les intérêts italiens avant tout, critiquant l'UE bureaucratique et fédéraliste, prônant un réalisme poussé dans les intérêts nationaux, manifestant un scepticisme concret à l'égard de l'OTAN en tant qu'instrument de l'hégémonie américaine et déclarant son ouverture au dialogue avec la Russie et la Chine. J'ai utilisé l'imparfait car ces idées appartiennent à la période où la Ligue et Fratelli d'Italia étaient dans l'opposition : maintenant qu'ils sont au gouvernement, ils se sont alignés sur la ligne dominante, se montrant en fait encore plus atlantistes et liés aux États-Unis et à leurs intérêts, au détriment des intérêts nationaux. La revue de référence est « Analisi Difesa » et parmi les noms, celui de son directeur, Gianandrea Gaiani, mérite d'être mentionné.

Il y a ensuite le courant que l'on pourrait qualifier de réaliste (ou néo-réaliste): plus académique et analytique, il reconnaît l'anarchie fondamentale du système international et examine les relations internationales sur la base des rapports de force (économiques et militaires). Lucidement critique à l'égard de l'atlantisme, il ne le rejette pas mais soutient néanmoins la primauté des intérêts nationaux ; il nourrit un certain scepticisme à l'égard des interventions humanitaires et estime nécessaire que l'Italie se dote d'une « grande stratégie » à long terme (objectif à mon avis irréalisable tant que l'Italie restera sous l'égide de l'OTAN/UE). Le magazine de référence est l'influente « Limes », fondé et dirigé par Lucio Caracciolo ; Dario Fabbri et Giulio Sapelli sont d'autres noms importants.

Quatrième courant, que l'on pourrait qualifier de tiers-mondiste/anti-impérialiste et anticolonialiste, enraciné dans la gauche communiste et anti-américaine, fortement critique à l'égard de l'hégémonie occidentale et de l'OTAN en tant qu'instrument agressif des États-Unis ; il soutient les mouvements de libération nationale et la cause palestinienne. Ses principaux représentants sont Manlio Dinucci et Alberto Negri : le premier est journaliste au quotidien « Il Manifesto », le second y collabore.
Enfin, le magazine « Eurasia » constitue une réalité à part, difficile à classer d'un point de vue idéologique : sa ligne explicitement anti-atlantiste, anti-mondialiste, anticolonialiste et antisioniste est en effet, comme nous l'avons vu, partagée par d'autres courants géopolitiques ; un autre de ses points forts est l'attention qu'il accorde au Sud du monde et aujourd'hui aux BRICS, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient (la question palestinienne en premier lieu) et l'Asie centrale.
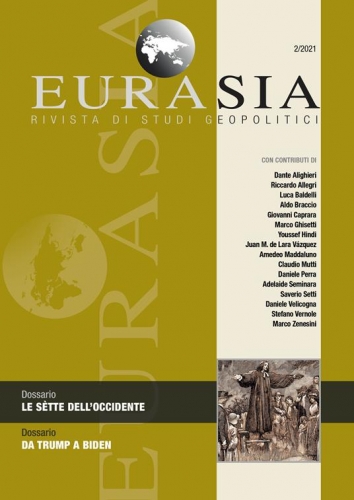
Fondée en 2004 par Claudio Mutti et Carlo Terracciano (l'un des premiers et des plus brillants spécialistes de la géopolitique de l'après-guerre, décédé prématurément il y a vingt ans, en septembre 2005), « Eurasia » se propose à la fois de promouvoir les études et la recherche en géopolitique au niveau universitaire et de sensibiliser le public (spécialisé ou non) aux questions eurasiennes, l'Eurasie étant entendue comme le continent eurasien s'étendant du Groenland (à l'ouest) au Japon (à l'est).
La redécouverte de l'unité spirituelle de l'Eurasie – telle qu'elle s'est exprimée au fil du temps sous de multiples formes culturelles – représente non seulement un facteur novateur dans le panorama des études géopolitiques, mais constitue également une alternative valable aux théories désormais obsolètes de la « fin de l'histoire » et du « choc des civilisations » élaborées respectivement par Francis Fukuyama et Samuel Huntington à la fin du 20ème siècle. Bien que la revue ne soit qu'une "petite niche", « Eurasia » peut compter sur un public fidèle et un cercle de collaborateurs qualifiés.
12:26 Publié dans Entretiens, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, allemagne, ernst jünger, alessandra colla, jalal al-e ahmad, révolution conservatrice, occidentose, philosophie, entretien |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 juin 2025
Un antidote au nihilisme contemporain - Les incessants petits miracles poétiques de Ernst Jünger !
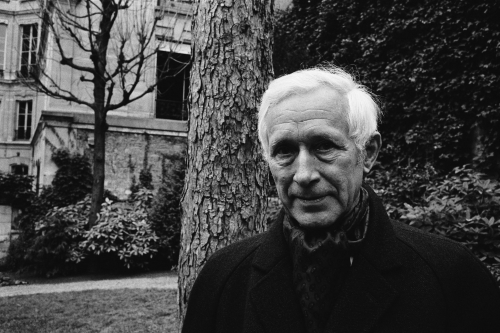
Un antidote au nihilisme contemporain
Les incessants petits miracles poétiques de Ernst Jünger !
Frédéric Andreu
L’imaginaire est le seul espace qui ne soit pas mécanisable; c’est par lui que la vie peut retrouver sens et saveur. Le regard « micro-cosmique » qui hante les pages du journal et des romans allégoriques d'Ernst Jünger (cf. Les Affiches n°101/102, déc. 2023) contribue à nous faire comprendre les grandes choses par les petites. Entre les échelles, l’œuvre de Jünger est puissance vibratoire; elle poétise aussi bien les êtres que les enjeux philosophiques. Penché sur l’irisation d’une aile de Cicindèle, le balancement d’un arbre au vent ou la réverbération d’un rêve, Jünger explore les prismes du visible que le scientifique rejette par procédure ou aveuglement. « La lune s’était levé et dans sa clarté je m’abandonnais aux pensées qui nous assaillent quand nous nous enfonçons dans l’incertain » écrit-il dans les Falaises de Marbre. Éloge de la rêverie associative !
L’œil de Jünger est celui d’un aigle quand sa prose est une maraude d’abeilles qui investit sans cesse les mondes contenus dans le monde; l’univers visible, mais aussi les ultraviolets et les infrarouges que la distanciation intérieure rend palpable, cette forêt où seules les abeilles poétiques peuvent s’aventurer. On comprend dès lors pourquoi certaines phrases de Jünger vous grimpent dessus, parfois à votre insu, pour voyager avec vous comme des insectes sur votre veston et devenir autant de broches d’or de la pensée. La prose de Jünger peut être qualifiée de « magnétique ».
Enchanté et enchanteur, Ernst Jünger n’en est pas moins lucide son temps. Le patriote, le soldat, l’écrivain et le voyageur sont d’une extrême lucidité. La technophilie exacerbée de Jünger laisse peu à peu place au retrait souverain. En effet, Jünger comprend que la technique, loin de servir l’homme, se sert en réalité de lui. Jünger n’est donc pas un « doux rêveur ». Quand il prend conscience que l’homme moderne est arrivé après la bataille, il prend recours dans les « forêts ». Ce retrait peut prendre des formes diverses, le voyage, l’imaginaire, la lecture, la méditation. « Nous nous absorbions de plus ne plus profondément dans le mystère des fleurs et leurs calices nous apparaissaient plus grands, plus radieux que jamais ».
En fait, la modernité réduit l’homme a être un ouvrier spécialisé de forces qui le dépassent. « Nous vivons en des temps qui ne sont pas dignes de l’œuvre d‘art » (Le Problème d’Aladin). « Le tissu des peuples est devenu fragile ». En effet, « des forces titanesques, sous un déguisement technicien, sont ici à l’œuvre. Où Zeus ne trône plus, les couronnes, les sceptres et les frontières n’ont plus de sens » s’écrit-il encore.

Comme le rêve qu’il habite et la beauté qu‘il courtise, Jünger est parfois un auteur mystérieux et insaisissable. Militaire exalté de la Première Guerre Mondiale, il est anti-nazi dès l’arrivée de Hitler et « sa bande » au pouvoir. Au cours d’une mission dans le Caucase, il apprend l’existence des meurtres de masse de civil, il écrit dans son journal : « Je n’éprouve alors plus que dégoût pour les uniformes et les décorations dont j’avais tant aimé l’éclat ».
Son amitié avec les mythes anciens pourrait faire de lui un « païen », pourtant, au temps le plus oppressant de la guerre, il ne quitte pas la Bible des yeux; sur le tard, il se convertira même au catholicisme. Mais ne devient pas pour autant une grenouille de bénitier: « Mon église », c’est l’œuvre d’art et ses « suprêmes trouvailles ». En fait, le nihilisme (la tristesse de nos âmes faites pour la joie) lui apparaît comme l’effet d’une guerre métaphysique, celle que livrent les titans aux dieux.

Jünger constate que nos libertés et nos arts sont devenus carcéraux. A l’endroit des titans et des cyclopes, il parle de « déguisement ». Ces derniers occupent le sacré, le vivant et l’espace quotidien des hommes. La mythologie grecque les décrit comme des entités primales, brutales et mécaniques échappés du Tatare où les avaient enfermé les dieux, d’où la guerre qu’ils livrent contre toute présence divine.
Grâce à Jünger, on prend donc conscience du pouvoir technocratique des titans quand on mesure l’entrisme de l’Art Conceptuel dans les instances officielles du pouvoir. Les « installations » d’œuvres bidulaires et logotypiques, basées sur le slogan, la sidération et la confusion cognitive, prennent d’assaut nos places publiques et transforment certains de nos musées, « temples des muses », en gymnases pour titans déchaînés. Les lois de l’harmonie et de la raison, les limites naturelles, sont clairement ciblées, investies, retournées. Le terme de « déguisement » parodique n’est pas usurpé quant à ces artefacts subversifs qui n’ont d’art que le nom. « Là où même Aphrodite pâlit, on tombe à des mélanges sans foi ni raison »...
13:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 mars 2025
Jünger dans les orages d’acier
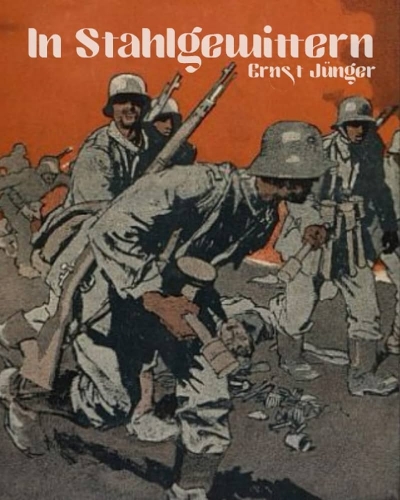
Jünger dans les orages d’acier
Un recueil documentaire et photographique de Nils Fabiansson pour Italia Storica
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/119340-junger-nelle-tempeste-da...
Ernst Jünger est, au-delà des jugements politiques portés sur son œuvre, l’un des grands noms de la littérature européenne du 20ème siècle. Un illustre « fils du 20ème siècle », période de contradictions et de tragédies, riche d’élans idéaux. Dans la vaste production jüngerienne, le livre qui l’a rendu célèbre auprès du grand public occupe une place centrale: Orages d’acier. Cet ouvrage est consacré à la narration, en prise directe, de la participation de l’écrivain à la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Un nouveau volume de Nils Fabiansson, Ernst Jünger dans les tempêtes d’acier de la Grande Guerre, vient d’être mis à disposition du lecteur italien. Il est publié dans le catalogue d’Italia Storica Edizioni, et son titre explicite son contenu: un recueil documentaire et photographique sur l’expérience de guerre du lieutenant Ernst Jünger durant le premier conflit mondial (184 pages, 25,00 euros). L’ouvrage a été patronné par Andrea Lombardi et traduit par Vincenzo Valentini. Son auteur, un historien et archéologue suédois, a notamment écrit un guide de voyage sur le front occidental de la guerre qui inaugura le « siècle bref ».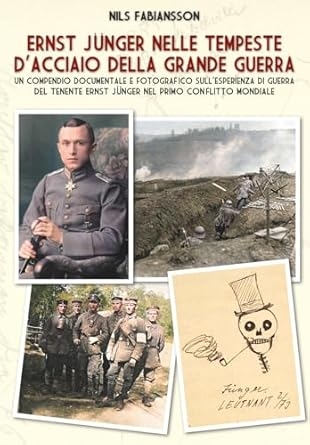

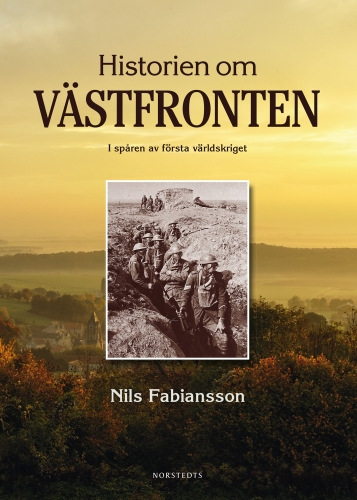
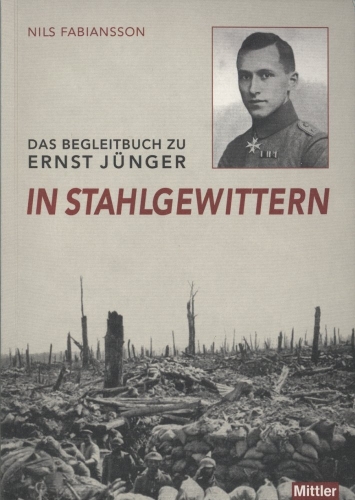
Pour comprendre les intentions du chercheur suédois, il est pertinent de partir des réflexions de Christopher Tilley, professeur d’histoire matérielle, qui a souligné que « les lieux ont toujours été bien plus que de simples points de localisation, car ils portent des significations et des valeurs distinctives pour les individus » (p.7). Jünger lui-même a affirmé à plusieurs reprises être magnétiquement attiré par certains « lieux ». C’est pour cette raison que Fabiansson emmène le lecteur sur les champs de bataille décrits par Jünger dans Orages d’acier, non seulement en analysant les multiples révisions que l’auteur a apportées à son œuvre, mais aussi en s’appuyant sur un riche appareil iconographique. Celui-ci comprend des photographies issues d’archives publiques et privées (notamment des images en noir et blanc particulièrement évocatrices de « l’atmosphère » et du « climat spirituel » qui régnait alors dans les tranchées), des pages des journaux de l’écrivain allemand, des cartes dessinées par lui dans ses carnets et des images des lieux de bataille tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Il convient de noter que Fabiansson ne cherche pas à faire du « tourisme bellico-littéraire », ce que Jünger lui-même aurait désapprouvé, mais reste fidèle au regard stéréoscopique et glacial de l’écrivain. Les textes de Jünger sur la guerre reposent sur ce qu’il appelait ses « pouvoirs perceptifs spéciaux », qui lui permettaient d’observer la douleur et la mort avec un regard exempt « de sentimentalismes, avec sécheresse et froide précision » (p. 9).

Le récit se structure en cinq chapitres analysant les différentes phases du conflit, depuis août 1914 jusqu’aux événements tragiques de novembre 1918. Au cœur de ce récit se dresse la figure de l’homme Jünger. Le livre se conclut par un épilogue où l’auteur recense les nombreuses traductions étrangères d'Orages d’acier. Trop souvent, on a présenté ce livre comme un simple témoignage de l’héroïsme de l’auteur au combat. Or, la lecture de Fabiansson nous dévoile un Jünger complexe, profondément humain, qui raconte à plusieurs reprises dans son livre que « à diverses occasions, il avait abandonné ses camarades à la merci de l’ennemi » (p. 9). Le fait qu’il mentionne ces échecs personnels est un élément significatif. Comme le montre cette étude, l’écrivain allemand a affronté la mort avec bravoure à de nombreuses reprises, subissant des blessures aux jambes et à la tête (il conserva d’ailleurs son casque transpercé par une balle), ce qui lui valut les plus hautes distinctions militaires. Pourtant, en 1972, il déclara que « ses souvenirs d’écolier étaient plus vivaces que ceux du combattant de guerre » (p. 10). Il se plaignait en effet que, malgré sa nouvelle vision de la vie, bien analysée par Evola, les lecteurs s’attardent encore, des décennies après leur publication, sur ses écrits de guerre, qu’il considérait désormais comme un « Ancien Testament » (p. 10).

Ce ne fut pas seulement son « cœur aventureux » qui poussa Jünger à s’engager volontairement, mais aussi une volonté précise de s’émerveiller et de comprendre en profondeur le sens de la guerre. Il se demanda si, au-delà des massacres imposés par la « guerre des matériaux », elle pouvait encore offrir, pour ceux qui la vivaient, une possibilité de réalisation personnelle. Sa réponse fut positive. Le combat permettait de dépasser la routine bourgeoise et plaçait l’homme face à la potestas qui l’anime et qui imprègne toute la nature. La guerre destructrice semble tout engloutir. Mais les descriptions des champs de bataille de Jünger nous plongent dans la réalité brute du paysage de guerre et nous confrontent à sa transformation cyclique et éternelle. Comme l’a relevé le philosophe Karl Löwith, Jünger comprenait que seul le dépassement de soi dans la nature conférait une permanence à l’existence humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il nota que la Picardie, avec « ses douces ondulations, ses villages enchâssés dans les vergers, ses pâturages bordés de peupliers élancés […] » (p. 22), lui procurait une joie intense. Ce n’est pas un hasard si, durant son séjour à Monchy et à Douchy, comme il le raconte dans Jardins et routes, il se consacra à la « chasse subtile » des insectes dans les tranchées. Ainsi, même dans les circonstances dramatiques de la guerre, sa passion pour l’entomologie ne l’abandonna pas, convaincu que dans le « particulier » réside le principe universel. Il répertoria pas moins de 143 espèces d’insectes.

Le pouvoir d’Éros ne fut pas non plus effacé par l’omniprésence de la mort, car, dans une perspective grecque, Éros et Thanatos ne font qu’un. Ainsi, le 5 juin 1916, il nota laconiquement : « Jeanne à Cambrai » (p. 25), évoquant un amour fugace en temps de guerre. De même, il n’oublia jamais ses proches. Fabiansson relate avec émotion les rencontres de Jünger avec son frère Friedrich Georg, où les deux hommes savouraient les effets apaisants du vin de Bourgogne et fumaient du tabac Navycut anglais dans leurs pipes en écume de mer (durant la guerre, Jünger expérimenta également l’éther et d’autres substances psychotropes pour soulager ses blessures). L’écrivain nous a aussi laissé des souvenirs poignants de ses compagnons d’armes, officiers ou simples soldats, qui sacrifièrent leur vie pour lui.
L’ouvrage de l’historien suédois n’est donc pas un simple « recueil » pour lire Orages d’acier, mais un livre essentiel pour comprendre l’ensemble de l’œuvre d’Ernst Jünger.
14:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 février 2025
Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle
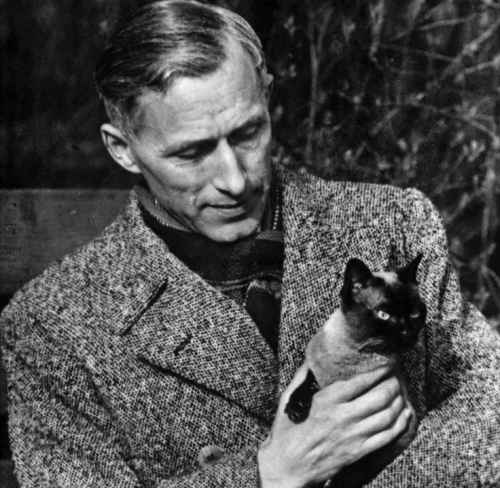
Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle
127 ans après sa naissance, son essai “La paix” offre des réflexions d’une actualité extraordinaire pour une “restructuration” de la civilisation européenne
Par Luca Siniscalco
(article du 29 mars 2022)
Source: https://www.ilsole24ore.com/art/ernst-junger-pace-e-forza...
« Afin que la lutte contre le nihilisme soit couronnée de succès, elle doit s’accomplir au cœur de l’individu. Tous sont impliqués, et nul ne peut se passer du remède préparé par le monde de la douleur. » C’est ainsi qu’Ernst Jünger s’exprimait dans La paix (1945), contemplatif solitaire de ce « siècle bref » qui s’est pourtant révélé si durable, chargé du lourd fardeau des idéologies et des récits dont notre époque contemporaine peine à se défaire, préférant les recycler sous des formes postmodernes de pastiche et de collage.
Aujourd’hui, 127 ans après la naissance de ce dandy aux multiples facettes, capable d’affronter les tempêtes d’acier et la mobilisation totale avec le même regard profond et détaché qu’il portait sur la contemplation du sacré et l’analyse du nihilisme, son œuvre continue d’offrir des perspectives d’une actualité saisissante.
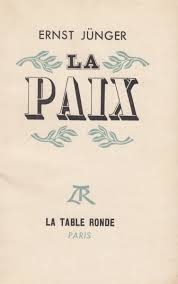
La paix
Il nous semble particulièrement pertinent, dans le contexte géopolitique actuel, d’évoquer certaines idées développées dans La paix, un essai désormais introuvable en Italie, à tort considéré comme mineur, alors qu’il condense de nombreuses grandes intuitions de la pensée jüngerienne. Écrit au milieu des ruines d’une Europe déchirée par un affrontement fratricide, La paix constitue un véritable chantier d’intuitions utopiques – mais non utopistes – en vue d’une “restructuration” de la civilisation européenne. Pour Jünger, le point de départ d’un tel projet ne réside pas dans l’équilibre des puissances, mais dans la substance même de l’individu: c’est en l’homme différencié, capable de vaincre le nihilisme en le formant et en le soumettant à sa propre disposition intérieure, que réside la possibilité de fonder une Europe issue du « mariage de ses peuples », orientée vers une « liberté supérieure » par un « acte spirituel ».
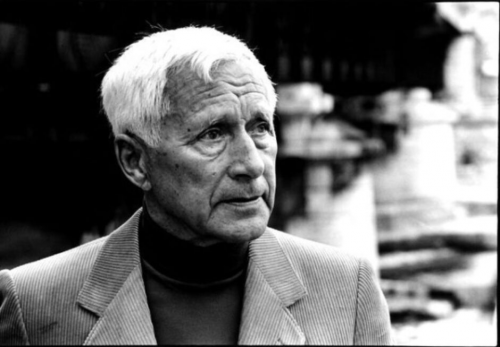
La critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir”
Un tel projet ne peut aboutir « que si les hommes se renforcent d’un point de vue métaphysique » : c’est pourquoi la critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir” ne laisse pas non plus indemne la perspective libérale – « dans leur polémique contre les nihilistes, les libéraux ressemblent à des pères qui se plaignent de leurs enfants ratés, sans se rendre compte que la faute en revient à une éducation défaillante ». Autrement dit, aucune forme politique de la modernité n’échappe au nihilisme.
La victoire contre cet « hôte inquiétant » de l’Europe surviendra lorsque la décision souveraine de l’individu entrera en résonance avec l’émergence d’une « Nouvelle Théologie », capable d’une re-symbolisation organique de la réalité. C’est uniquement parmi ces « esprits qui vivent dans la totalité de la création » que la paix peut exister. Une paix imposée par le droit, la coercition ou la menace n’est qu’extérieure; la paix authentique est un exercice “intérieur”, plus courageux encore que la guerre. Elle ne sera atteinte, prophétise Jünger, que si « nous savons nous affranchir de la haine et de ses divisions. L’individu est semblable à la lumière qui, en flamboyant, contraint les ténèbres à reculer ».
À 127 ans, Jünger est plus vivant que bien des morts-vivants.
20:11 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, paix, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 novembre 2024
Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger
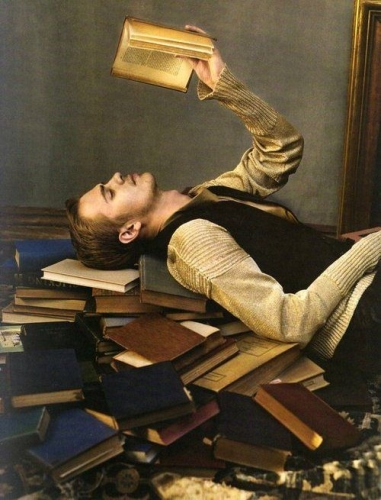
Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger
par Manuel Fernández Espinosa
Source: https://culturatransversal.wordpress.com/2016/01/12/hugo-...
Le magister Nigromontanus
Lors de la préparation de l'excursus à l'« Élucidation de la tradition », consacré en deux parties (Partie I et Partie II [L'ouvrage complet peut être consulté dans Página Transversal]) à la réflexion sur la notion de « tradition » chez Ernst Jünger, nous avons été frappés par un sujet qui nous préoccupait depuis un certain temps: la figure de l'un des maîtres qui a le plus influencé la pensée d'Ernst Jünger et qui, dans la bibliographie espagnole sur Jünger, n'a pratiquement pas été abordée. Il s'agit d'Ernst Hugo Fischer.
Jünger s'y réfère abondamment, mais de manière dispersée. Dans ses journaux, il le désigne presque toujours sous le pseudonyme de «Magister», bien qu'il le mentionne également par son prénom et son nom. Dans les romans « Sur les falaises de marbre » et « Héliopolis », il le désigne par le surnom de « Nigromontanus », dans « Visite à Godenholm », Jünger germanise « Nigromontanus », et on peut l'identifier au personnage de «Schwarzenberg» (Montenegro, comme on dirait en espagnol). Il y a autour de Hugo Fischer un halo de mystère que Jünger lui-même contribue à créer et qui plane sur toute l'œuvre de Jünger dans la figure du maître (bien que tous les personnages ne soient pas identifiables à lui en chair et en os) qui nous initie aux secrets d'une sagesse capable de vaincre le nihilisme.
Ernst Hugo Fischer est né à Halle an der Saale le 17 octobre 1897. La Première Guerre mondiale l'a rendu infirme et, après avoir obtenu son diplôme d'invalidité, il s'est consacré à partir de 1918 à des études consciencieuses et pluridisciplinaires à l'université de Leipzig, où Jünger le rencontrera des années plus tard. Les intérêts « scientifiques » de Fischer sont multiples: il étudie l'histoire, la philosophie, la sociologie, la psychologie et devient un orientaliste renommé. Il obtient son doctorat en 1921 avec une thèse intitulée « Das Prinzip der bei Gegensätzlichkeit Jakob Böhme » (Le principe d'opposition chez Jakob Böhme).
Il est curieux qu'Ernst Jünger, qui avait quelques années de plus que Fischer (Jünger est né en 1895 et Fischer en 1897), l'ait appelé « Maître » jusqu'à la fin de ses jours, mais il faut garder à l'esprit que Jünger est arrivé à l'université alors que Fischer avait quelques années d'avance sur lui. Lorsque Jünger arrive à Leipzig, Fischer est déjà l'un des polygraphes les plus importants d'Europe, mais toujours dans l'ombre, avec une discrétion proche du secret, étudiant et voyageant sans cesse et exerçant son magistère à la manière d'un maître occulte du type de ceux dont parlent les traditions orientales comme le taoïsme.

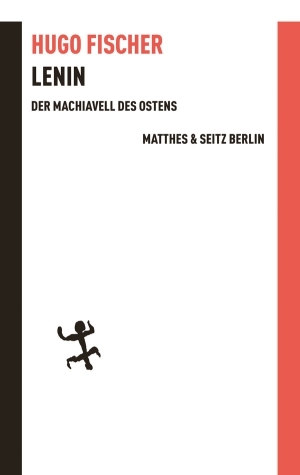
En 1921, il se rend en Inde, en 1923 en Espagne. De 1925 à 1938, il enseigne à la faculté de philosophie de l'université de Leipzig, où il est associé à Arnold Gehlen. Son nationalisme allemand est une constante dans sa vie et il est actif dans les cercles nationaux-révolutionnaires, y compris dans ceux animés par le national-bolchevique Ernst Niekisch, un ami de Jünger. Il émigre d'Allemagne en 1938, car les nazis le trouvent suspect pour ses analyses philosophiques du marxisme, exprimées dans « Karl Marx und sein Verhältnis zum Staat » (Karl Marx et son rapport à l'État) et « Lénine : Machiavel de l'Est », et il finit par s'installer en Norvège, où il devient directeur de l'Institut de recherche pour la sociologie et l'enseignement d'Oslo. Il s'installe ensuite en Angleterre. Il continue à voyager en Inde, où il donne notamment des cours à l'université de Varanasi, et retourne en Allemagne en 1956, où il occupe la chaire de philosophie de la civilisation à l'université de Munich. Il continue d'étudier, d'écrire et de publier, sans toutefois connaître un succès retentissant qui placerait sa figure philosophique au premier plan dans le monde. Son dernier livre est publié en 1971 sous le titre « Vernunft und Zivilisation » (Raison et civilisation) et il meurt le 11 mai 1975 à Ohlstadt (Bavière).
Sa pensée a évolué, mais il est toujours resté hypercritique à l'égard de la modernité et anticapitaliste, étant l'un des maîtres d'œuvre de la révolution conservatrice allemande et testant tous les moyens possibles de combattre ce qu'il considérait comme le mal absolu: la modernité et le capitalisme, afin d'instaurer un nouvel ordre. L'un de ceux qui ont le plus contribué à le faire connaître est, comme on l'a vu plus haut, Ernst Jünger.
Plus qu'une traque exhaustive des abondantes citations que Jünger consacre à Fischer tout au long de son œuvre, il convient de noter le caractère nettement métaphysique (on pourrait même dire mystique) qu'il a imprimé à la vision du monde de Jünger. Dans « Héliopolis », le protagoniste révèle que l'un des enseignements qu'il a reçus de son maître « Nigromontanus » était « que la nature intérieure de l'homme doit devenir visible à la surface, comme la fleur qui jaillit du germe ». Cette idée est répétée à la fin du roman : « Nous croyons que son intention [celle de Nigromontanus/Fischer] est de saturer la surface de profondeur, de sorte que les choses soient à la fois symboliques et réelles ».
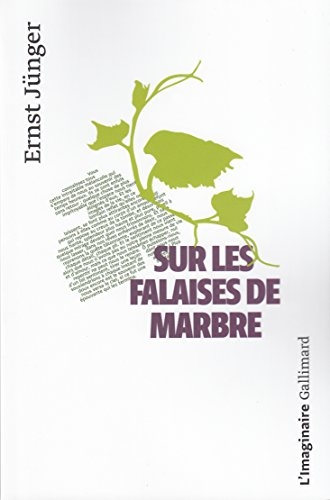 Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.
Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.
Etant donné que « Sur les falaises de marbre » est un roman que l'on pourrait bien qualifier de « réalisme magique », sans pour autant lui dénier son statut de « dystopie », on serait en droit de penser que plutôt qu'un artefact, le « miroir de Nigromontanus » serait quelque chose comme une possible technique de méditation inspirée des connaissances occultes de l'Extrême-Orient (je me demande, non sans prévenir que je risque de me tromper : s'agirait-il d'un mandala?).
Dans cette optique, il convient de rappeler les mots énigmatiques que Jünger écrit dans « Le cœur aventureux. Figures et caprices »: "Parmi les arcanes que m'a révélés Nigromontanus, il y a la certitude qu'il y a parmi nous une troupe choisie qui s'est retirée depuis longtemps des bibliothèques et de la poussière des sables pour se consacrer à son travail dans le monastère le plus intime et dans le Tibet le plus sombre. Il parlait d'hommes assis solitairement dans des chambres nocturnes, imperturbables comme des rochers, dans les cavités desquels scintille le courant qui, à l'extérieur, fait tourner toutes les roues des moulins et maintient en mouvement l'armée des machines ; mais l'énergie de ces hommes reste étrangère à toute fin et est rassemblée dans leur cœur qui, en tant que matrice chaude et vibrante de toute force et de tout pouvoir, est à jamais soustrait à toute lumière extérieure".
Quoi qu'il en soit, la relation entre Ernst Jünger et ce philosophe inconnu était très étroite, et Jünger fait même allusion à des voyages qu'ils ont effectués ensemble, par exemple en traversant le golfe de Gascogne sur le bateau « Iris ». Nous savons, grâce aux journaux de Jünger, que le philosophe Fischer s'est encore rendu à Majorque en 1968, mais nous aimerions connaître les lieux qu'il a visités lors de son voyage en Espagne en 1923 ou lors d'autres visites. Nous sommes convaincus qu'en Hugo Fischer, cet inconnu de la philosophie et de la culture espagnoles, nous avons affaire à un maître caché dont l'œuvre scientifique n'a pas encore, pour quelque raison que ce soit, été suffisamment diffusée.
BIBLIOGRAPHIE :
Jünger, Ernst, «Visite à Godenholm».
Jünger, Ernst, «Heliopolis».
Jünger, Ernst, Diarios: Radiaciones I y II, Pasados los Setenta I, II, III, IV, V.
Jünger, Ernst, «Sobre los acantilados de mármol».
Jünger, Ernst, «El corazón aventurero».
Liens intéressants:
Berger, Tiana, «Hugo Fischer: le maître-à-penser d’Ernst Jünger»
Gajek, Bernhard, «Magister-Nigromontan-Schwarzenberg: Ernst Jünger und Hugo Fischer». Revue de littérature comparée. 1997.
13:18 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo fischer, ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 août 2024
Un voyage à travers la parole

Un voyage à travers la parole
Frédéric Andreu
Louis-Ferdinand Céline fustigeait les écrivains sans style, ces "cafouilleux" qui "choisissent une bonne histoire" et "rampent dans les phrases". Philippe Barthelet et Éric Heitz, son compère alsacien, en sont le contraire même. En effet, Le voyage d'Allemagne, leur ouvrage commun, est premièrement un style - c'est à dire un voyage à travers la Parole - et secondairement un voyage vers et dans un pays, l'Allemagne.
Ce double voyage fait à la fois preuve d'abandon à la poésie et de grande rigueur rhétorique. Les étymologies, nombreuses, qui émaillent ce textus, jouent le rôle de panneaux indicateurs le long de la route. Nous voyageons à travers le Luxembourg, Bâle, Fribourg et la Souabe ; quand c'est un "faune" qui indique le chemin, on a même l'impression que le voyage emprunte au rêve ou à la légende !
Mais où nous mène ce double voyage ? Devant la demeure d'un autre grand écrivain, Ernst Jünger, à Wilflingen. Philippe Barthelet, qui a rencontré le « Waldgänger » plusieurs fois au cours des dix dernières années de sa vie dans ce village « sans gare, ni poste », lui rend hommage à la mode du « Weggänger », celui qui a recourt aux chemins. Avec ce grammairien de haute volée pour qui « les mots savent mieux que nous ce qu'ils veulent dire », chaque virgule compte. Il n'a donc pas choisi d'intituler son livre Le voyage d'Allemagne - et non Un voyage en ou vers Allemagne - par hasard. Ici la préposition "de" est celle des formules héraldiques comme dans "De Gueule" ou "D'Azur" dans la description des blasons. L'auteur décrit « les oriflammes qui enjolivent l'héraldique de la plus neutre des réalités ». Les anecdotes de voyage rayonnent dans ce texte comme autant de blasons. Sous la plume d'aigle de l'auteur, les villages redeviennent des miniatures, des « objets » mythologiques. Robert Brasillach voyait dans les villages de Bavière, des jouets.

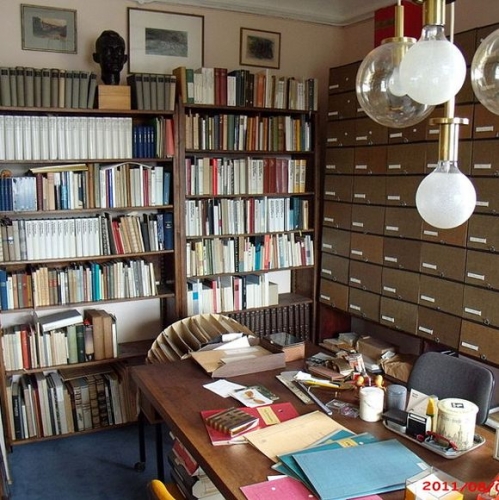

La maison de Wilflingen, où Helmut Kohl et François Mitterrand se rendaient en pèlerinage, est elle aussi un cabinet de curiosités ouvert sinon pour tous, du moins pour chacun.
Elle abrite en effet des souvenirs des deux guerres mondiales, des objets de voyages, et une fascinante collection d'insectes, toutes les cicindèles d'Europe notamment, que Jünger considérait lui aussi comme autant d'héraldiques à déchiffrer. Grâce à ce livre-voyage, Philippe Barthelet et Éric Heitz se révèlent être de véritables disciples - c'est à dire des « jünger » - sans pour autant être de « sérieux » disciples, des « ernst » jünger.
Le premier, ancien producteur et chroniqueur à France Culture de 1985 à 2006, s'est fait connaître par sa plume érudite et son goût pour les grands auteurs ; quant au second, Eric Heitz, il reste plus mystérieux. Il paraît même qu'« il ne veut plus voir personne ». Serait-il parvenu au stade ultime du renonçant lucide au monde moderne que Ernst Jünger désigne sous le nom d'« Anarque » ?
En tout cas, cet ouvrage d'amitié tire un coin de voile sur le secret des Allemagnes situées des deux côtés du Rhin. Pour ce faire, la littérature y est présente. "La littérature est un mystère d'évidence qui a besoin de couverture, d'ombre, de faune mousse, de jardins aux douze portes et de librairie toujours ensoleillée". Comment mieux poser les jalons pour nous conduire, sans jamais nous contraindre, à cet obscur secret qui pourtant nous éclaire de toutes parts et de toute éternité ?
* * *
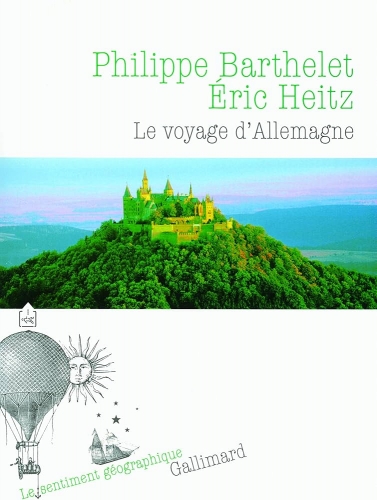
Philippe Barthelet et Éric Heitz, Le voyage d'Allemagne, Paris, Gallimard, coll. « le sentiment géographique », 240 p.
Ernst Jünger Stiftung : Stauffenbergstrasse 11, 88515 Wilflingen - juenger-haus.de / +4973761333
13:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, allemagne, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, ernst jünger, wilflingen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 juillet 2024
"Le totalitarisme doux a gagné"

"Le totalitarisme doux a gagné"
par Klaus Kunze
Source: http://klauskunze.com/blog/2024/07/13/der-sanfte-totalitarismus-hat-gesiegt/
Nécrologie pour la démocratie libérale
C'est à cette conclusion accablante pour "l'Occident libre" que parviennent les auteurs Kolja Zydatiss et Mark Feldon dans leur nouvel ouvrage Interregnum - Was kommt nach der liberalen Demokratie? (Langen-Müller 2024, ISBN 978-3-7844-3706-4). Dans leur condamnation cinglante de l'hyperlibéralisme, ils rejoignent les critiques de la droite (Klaus Kunze, Staatsfeind Liberalismus, 2022), mais les dépassent encore dans leurs sombres prévisions pour l'avenir: ils ne donnent plus aucune chance d'avenir à la réelle "pathologie du libéralisme de gauche" (p.307) et s'interrogent à haute voix sur l'après.
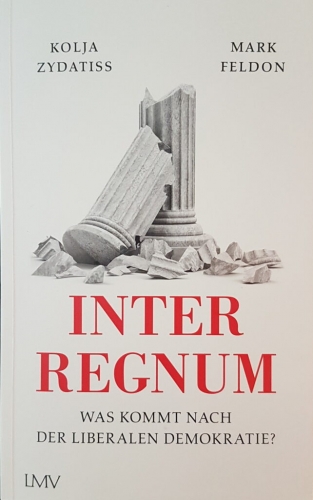
Ce qui est le plus remarquable dans leur livre, c'est que les auteurs ne sont pas du tout de droite. Zydatiss est porte-parole sociopolitique de l'institut de débat libéral "Freiblick-Institut". Ils ne laissent planer aucun doute sur leur sympathie pour la pensée d'un libéralisme "idéal". Leur horreur provient d'un amour déçu: "Libéralisme - que t'est-il arrivé ?
Les auteurs commencent par dresser avec complaisance une image idéalisée du libéralisme, avant de la mettre impitoyablement en pièces à l'aide de la "démocratie libérale réellement existante" (p. 15). Sous le titre "histoire du déclin", ils se réfèrent à Norbert Bolz et Arnold Gehlen. Selon la bibliographie, ils connaissent également le traité de Panajotis Kondylis sur le "conservatisme". Ils disposent ainsi d'outils suffisants pour identifier les raisons profondes qui ont permis aux "parasciences telles que les mathématiques antiracistes", la "philosophie queer", les "sciences climatiques anticapitalistes" ou les "sciences juridiques critiques" d'arriver jusqu'à nos ministères (p.18 et suivantes).
Pathologie du libéralisme incurable
Ils tracent un parcours du libéralisme "de l'utopie à la décadence" et n'omettent aucun symptôme. Leur diagnostic est accablant: incurable ! Les héritiers entourent déjà le lit de mort: les socialo-autoritaires, les néofascistes et, dans les starting-blocks, la nouvelle élite de "spécialistes" et de bureaucrates qui n'ont plus de légitimité démocratique.
Les auteurs décrivent certes de manière détaillée l'histoire du libéralisme. Mais leur analyse des raisons pour lesquelles les idées de liberté personnelle et d'égalité civile ont pu évoluer vers un régime de plus en plus déresponsabilisant est nettement insuffisante.
Il est de plus en plus douteux que les instruments politiques traditionnels - protestations ou élections - permettent encore d'obtenir des changements tangibles. En particulier sur les questions du climat, de l'islam et de l'immigration, il semble qu'il ne reste plus qu'une seule voie à suivre, rejetée pourtant par la grande majorité de la population. Les livres critiques sur l'immigration se vendent à des millions d'exemplaires, les partis et les hommes politiques populistes remportent les élections et forment des gouvernements, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue - et rien ne change. Même si certaines choses changent. Par exemple, la marge de ce que l'on peut encore dire sans être viré, banni, condamné ou même emprisonné.
Zydatiss / Feldon, Interregnum, p.300 et suivantes.
La bureaucratie de l'UE travaille sur des monstruosités hyper-réglementées toujours plus nombreuse, comme le Digital Services Act - inacceptable par excellence et "totalitaire par essence" de notre point de vue constitutionnel.

La "loi sur l'autodétermination", la "loi sur l'application des réseaux" et d'autres réglementations remplacent la liberté d'expression libérale autrefois garantie de manière inviolable. Les auteurs mentionnent bien les différents phénomènes, mais sans aller jusqu'à leurs raisons structurelles. Ils reconnaissent à juste titre que le mot ambigu de libéralisme n'est pas seulement synonyme de la forme de société dite pluraliste et de son système de gouvernement, la "démocratie parlementaire". Mais tout d'abord,
le libéralisme désigne malgré sa longue hégémonie incontestée, une idéologie comme le communisme ou le fascisme [et n'est] pas nécessairement le point final naturel de l'évolution sociale et politique humaine.
Zydatiss / Feldon, p.334 et s.
Sa "forme d'accroissement" est l'hyperlibéralisme. Il conduit à
un libéralisme utopique sans limites, qui dissout ses propres présupposés et ouvre ainsi la voie au déclin final de la civilisation occidentale, à un nouveau totalitarisme ou à tout autre chose. Il y a beaucoup en jeu".
Zydatiss / Feldon, p.334 et s.
Le livre aurait ici gagné à approfondir sa réflexion sur les raisons pour lesquelles un hyperlibéralisme extrémiste a pu se développer à partir de l'inoffensif concept axiologique de "libéral", tout comme un socialisme inhumain s'était formé à partir de l'adjectif bien nommé "social". Tout concept de valeur absolu conduit en effet à une domination forcée si on l'érige en critère unique d'une idée utopique. Toute notion de valeur (axiologique) et tout principe de valeur (axiologique) sont nés avec la prétention à l'exclusivité. Si l'on ne traite pas les principes de manière pragmatique et qu'on ne les met pas en balance avec d'autres, le totalitarisme est inévitable.
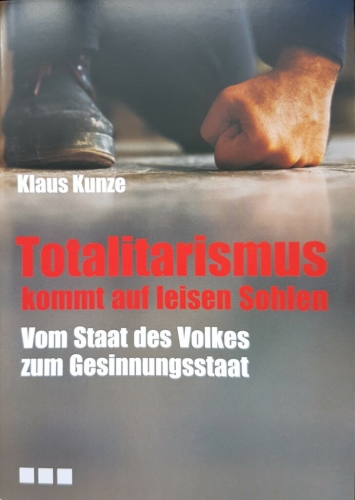
Le passage de l'État de la Loi fondamentale à un nouveau totalitarisme d'opinion a déjà fait l'objet de nombreuses analyses. Ici :
Totalitarismus kommt auf leisen Sohlen - Vom Staat des Volkes zum Gesinnungsstaat (= Le totalitarisme arrive à pas feutrés, De l'État du peuple à l'État de conviction), ISBN 978-3-98987-001-7, éditeur: Die Deutschen Konservativen, Hambourg).
Contrairement à la vieille légende libérale selon laquelle le libéralisme est précisément l'absence d'idéologie, l'idéologie libérale a été étudiée et analysée en profondeur par différents auteurs. Le fait que le slogan "Pas de liberté pour les ennemis de la liberté (libérale)" ouvre la porte du camp dit libéral à l'absence totale de liberté et montre déjà en soi la contradiction de la dogmatique libérale.
La répression inhérente au libéralisme
La répression à l'intérieur est inhérente à l'État libéral. S'il ne trouve pas d'ennemi à l'extérieur, il le cherche à l'intérieur, et si cela ne suffit pas, il agit de manière agressive à l'extérieur. Zydatiss et Feldon décrivent sur de nombreuses pages la phénoménologie de la répression croissante des opinions divergentes.
Si l'hyperlibéralisme continue à être hégémonique, il n'y parviendra qu'en renforçant les tendances répressives.
Zydatiss / Feldon, p.330.
Les auteurs ne présentent pas de manière cohérente les raisons structurelles pour lesquelles la "démocratie libérale" devient de plus en plus répressive. Le lecteur peut se faire une idée par lui-même à partir d'approches éparses: les sociétés d'immigration libérales dans les anciens pays industriels prospères exercent une forte attraction sur les candidats à la déchéance de tous les pays. Mais leur pluralisme interne à tendance chaotique les rend instables : "Contrairement à ce que veut le mantra central, les sociétés diversifiées ne sont pas "fortes". Elles sont plutôt tribales et instables (Zydatiss / Feldon, p.117).
C'est pourquoi, plus un État accueille d'éléments hétérogènes qui le rejettent par principe, plus la répression doit augmenter de manière légale.
En déconstruisant de plus en plus les sources classiques et chrétiennes, le libéralisme crée l'état originel de Hobbes, l'ensemble d'individus inconditionnels auquel il voulait en fait échapper. Et dans une dernière ironie amère, l'homme du libéralisme doit reconnaître qu'il faut toujours plus de lois, d'autorités et de répression pour piloter un système qui, à l'origine, se proposait de limiter le pouvoir de l'Etat, de le lier par la séparation des pouvoirs et la constitution.
Zydatiss / Feldon, p.71.
Perspectives
Les auteurs consacrent la moitié de leur ouvrage aux "antipodes de l'hyperlibéralisme", principalement des formes de gouvernement autoritaires à la légitimité démocratique douteuse. Ainsi, des États comme Singapour sont aujourd'hui dirigés de manière semi-dictatoriale. Une autorité régissant tous les aspects de la vie sait ce qui est le mieux pour les Singapouriens. Ceux-ci se laissent faire parce qu'ils y trouvent leur compte.
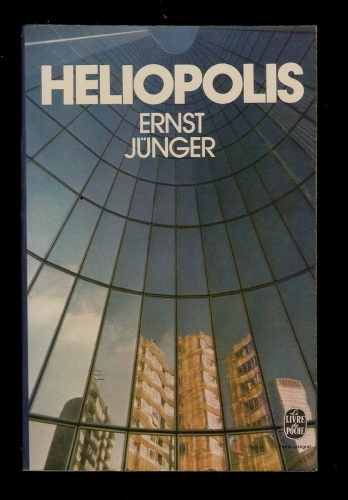
Pour les auteurs, il ne fait aucun doute que le libéralisme détruit de plus en plus rapidement les conditions mentales dont il se nourrit: des citoyens responsables et autonomes. Dans le "monstrum sui generis" (c'est ainsi que Pufendorf avait appelé le Saint Empire romain germanique) qu'est l'Union européenne, la majeure partie des réglementations et des décisions n'est déjà plus liée à la démocratie. Aucune chaîne de légitimation démocratique ne remonte jusqu'à la bureaucratie européenne. En se projetant dans l'avenir et en décrivant les héritiers potentiels du socialisme, les auteurs auraient pu se tourner vers Ernst Jünger :
Nous vivons dans un état où les anciens liens ont été perdus depuis longtemps, bref, dans un état d'anarchie. Il ne fait aucun doute que cet état exige un changement. En revanche, les avis divergent sur les moyens à mettre en œuvre pour créer une nouvelle stabilité. Si nous laissons de côté les Mauritaniens, qui développent une pratique selon laquelle on doit prospérer dans et par l'anarchie, il reste deux grandes écoles, l'une voulant orienter la vie vers le bas, l'autre vers le haut.
Ernst Jünger, Héliopolis, 1950, p.175.
Jünger insérait ses prévisions dans une intrigue romanesque avec des lieux et des noms fictifs. Dans sa clairvoyance, il mentionnait déjà dans le manuscrit achevé en 1949 l'"Etat insecte" total et non démocratique comme l'une des deux possibilités d'avenir :
La première, qui se rassemble à Héliopolis autour du bailli et de son bureau central, s'appuie sur les ruines et les hypothèses des anciens partis populaires et prévoit le règne d'une bureaucratie absolue. La vacuité est simple: elle voit l'homme comme un être zoologique et conçoit la technique comme le moyen de donner forme et pouvoir à cet être, mais aussi de le tenir en bride. C'est un instinct poussé jusqu'au rationnel. Par conséquent, son objectif est de créer des États insectes intelligents. Le vide est bien fondé à la fois dans l'élémentaire et dans le rationnel, et c'est là que réside sa puissance.
Ernst Jünger, Héliopolis, 1950, p.175.
Jünger a décrit ainsi l'autre possibilité et une issue possible :
La deuxième école est la nôtre ; elle se fonde sur les débris de l'ancienne aristocratie et du parti sénatorial et est représentée par le proconsul et le palais. Le prévôt veut, en dehors de l'histoire, élever une collectivité au rang d'État; nous aspirons à un ordre historique. Nous voulons la liberté de l'homme, de son être, de son esprit et de ses biens, et l'État seulement dans la mesure où ces biens doivent être protégés. D'où la différence entre nos moyens et nos méthodes et ceux du bailli. Celui-ci est tributaire du nivellement, de l'atomisation et de l'uniformisation du stock humain, dans lequel doit régner un ordre abstrait. Chez nous, au contraire, c'est l'homme qui doit être le maître. Le bailli aspire à la perfection de la technique, nous aspirons à la perfection de l'homme.
Ernst Jünger, Héliopolis, 1950, p.176.
Il est vrai qu'en prononçant ces mots, Jünger se montrait lui-même un peu - libéral : urliberal, libéral des origines immémoriales.
12:19 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, philosophie politique, libéralisme, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 juin 2024
Syndrome du Titanic et radeau de la méduse
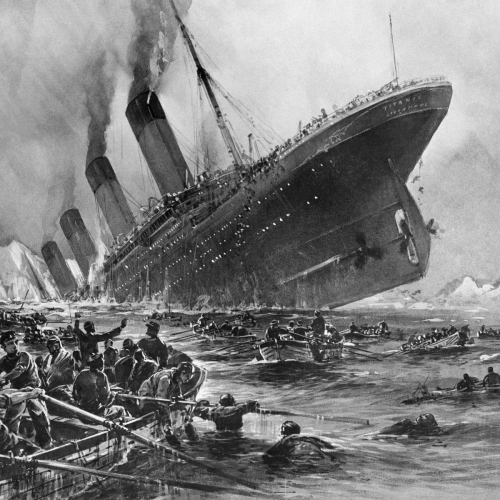
Syndrome du Titanic et radeau de la méduse
Nicolas Bonnal
Nous sommes dirigés par des fous motivés et (aussi) d’efficaces incapables qui nous mènent au désastre. Ils organisent la faillite, détruisent, gaspillent, remplacent et dépeuplent, désirant enfin une guerre nucléaire, tout à leur rage messianique. Sinon c’est le totalitarisme au code QR et le camp de concentration numérique. Mais attention : il y a une élite autoproclamée (les 1% les plus riches et les hauts fonctionnaires) et elle veut se préserver. Stéphane Mallarmé pour mémoire :
« Cette foule hagarde ! elle annonce : Nous sommes
La triste opacité de nos spectres futurs ! »
Ces poètes, quels voyants tout de même…
J’avais écrit un texte sur Ernst Jünger et le syndrome du Titanic (http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/16/syndrome-du-titanic-ernst-junger-et-la-culture-de-la-panique.html ), qui m’avait été inspiré par le fameux mais oublié Traité du rebelle, suite de notes contre le monde totalitaire, étatique et automatisé à venir (et déjà présent…).

Et je repensais à un blog de lecteur qui a modifié ma réflexion pour expliquer ce que deviennent la France et l’Amérique sous leurs présidents respectifs: si nous nous dirigions vers le modèle du radeau de la méduse (revoyez l’émission d’Alain Decaux…) plutôt que de celui du Titanic ? Le Titanic ce n’était qu'un accident malchanceux couronné du respect de la morale chrétienne: les femmes et les enfants d’abord, et des milliardaires comme Guggenheim qui y passèrent héroïquement. Le radeau de la méduse c’était bien pire, et c’est le modèle des dernières guerres et du Grand Reset actuel. On sacrifie les plus pauvres, les sans-grades.
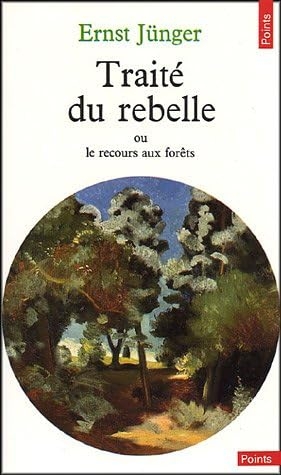 Mais citons Jünger et les extraits de son inépuisable Traité du rebelle écrit après la « guerre de quarante » quand le grand homme comprend que nous allons vers un monde simultanément automatisé et apocalyptique.
Mais citons Jünger et les extraits de son inépuisable Traité du rebelle écrit après la « guerre de quarante » quand le grand homme comprend que nous allons vers un monde simultanément automatisé et apocalyptique.
Le système automatisé génère une culture et une psychologie de la panique (voir et revoir les films-catastrophe et ceux de Kubrick…) :
« La panique va s’appesantir, là où l’automatisme gagne sans cesse du terrain et touche à ses formes parfaites, comme en Amérique. Elle y trouve son terrain d’élection ; elle se répand à travers des réseaux dont la promptitude rivalise avec celle de l’éclair. Le seul besoin de prendre les nouvelles plusieurs fois par jour est un signe d’angoisse ; l’imagination s’échauffe, et se paralyse de son accélération même. »
On poursuit :
« Il est certain que l’Est n’échappe pas à la règle. L’Occident vit dans la peur de l’Est, et l’Est dans la peur de l’Occident. En tous les points du globe, on passe son existence dans l’attente d’horribles agressions. Nombreux sont ceux où la crainte de la guerre civile l’aggrave encore. »
On cherche vainement des sauveurs :
« La machine politique, dans ses rouages élémentaires, n’est pas le seul objet de cette crainte. Il s’y joint d’innombrables angoisses. Elles provoquent cette incertitude qui met toute son espérance en la personne des médecins, des sauveurs, des thaumaturges. Signe avant-coureur du naufrage, plus lisible que tout danger matériel. »

Enfin la catastrophe sera universelle :
« Car nous ne sommes pas impliqués dans notre seule débâcle nationale ; nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle, où l’on ne peut guère dire, et moins encore prophétiser, quels sont les vrais vainqueurs, et quels sont les vaincus. »

Jünger a raison sur tout naturellement : il décrit l’aboutissement catastrophique du progrès matériel et technique (voyez ces robots que l’on dresse à tuer tout le monde maintenant sous les acclamations des esclaves de You Tube).
Mais je maintiens que le radeau de la méduse explique mieux que le Titanic ce qui se passe en ce moment : les petits sur le radeau, les élites incompétentes dans les chaloupes. Et un jugement qui pardonne à tout le monde (il n’aurait plus manqué que ça !).
Jünger évoque justement le Titanic ; on se souvient du succès effarant de ce film répugnant. Il écrit donc :
« Comment ce passage s’est-il produit ? Si l’on voulait nommer l’instant fatal, aucun, sans doute, ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l’ombre s’y heurtent brutalement : l’hybris du progrès y rencontre la panique, le suprême confort se brise contre le néant, l’automatisme contre la catastrophe, qui prend l’aspect d’un accident de circulation. »
Donc en réfléchissant et surtout en lisant le blog d’un lecteur (le blog c’est « guerre civile et yaourt allégé » ; le lecteur c’est « Philippe de nulle part »…), je suis arrivé à la conclusion que nous allons au radeau de la méduse. En effet :
- Nous sommes dirigés par des imbéciles/sagouins qui vont/aiment nous échouer.
- Ces imbéciles vont nous sacrifier, des plus pauvres ou plus moyens.
- Et rappel : les pauvres ne sont descendus sur le radeau que sous la menace des armes.
Mais même sur le radeau de la méduse les choses ne se passaient que d’une certaine manière.
Extrait du yaourt allégé donc :
« Sur le radeau de La Méduse les officiers et des notables s’étaient réservé l’endroit le moins exposé aux vagues et avaient pris soin d’enlever leurs armes aux soldats et de garder les leurs. Très rapidement devant le manque de nourriture et les risques de naufrage ils réduisirent par plusieurs tueries la population du radeau afin de « réprimer des mutineries ». Les rares rescapés à être finalement secourus furent bien évidemment des officiers et des notables. Il ne reste plus qu’à transposer cette sinistre histoire à l’échelle planétaire. »
On n’y mangea pas d’insectes mais des hommes.
De la Méduse à Macron-Davos-Gates, toute leur apocalypse postmoderne est expliquée là. On écrabouille la classe moyenne pauvre et on maintient l’illusion en désignant des soi-disant privilégiés (retraités repus, journalistes, farces de l’ordre, armée, etc.).
Et je rappellerai la phrase de l’idole télé de mon enfance :
« Les puissants ont été mis sur des canots, la piétaille (menacée au fusil) sur le radeau (l’Immortel Alain Decaux). »
NDLR : renseignements pris, sur le Titanic aussi ce furent les riches qui survécurent massivement. CQFD… Le lien littéraire (médiocre) est mis sur le récit/témoignage de ce désastre.
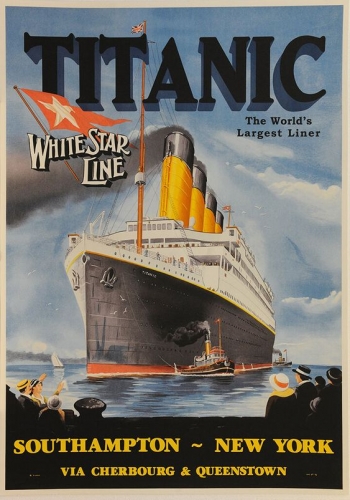
Sources :
https://www.dedefensa.org/article/ernst-juenger-et-le-syn...
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9duse_(navire)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850111v#
http://guerrecivileetyaourtallege3.hautetfort.com/archive...
20:04 Publié dans Actualité, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, nicolas bonnal, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 avril 2024
"La beauté éternelle et intemporelle est préfigurée par l'éphémère". Jünger et les insectes
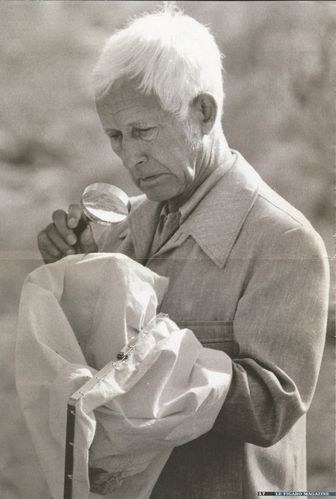
"La beauté éternelle et intemporelle est préfigurée par l'éphémère". Jünger et les insectes
par Michele (Blocco Studentesco)
Source: https://www.bloccostudentesco.org/2024/03/21/bs-eterna-bellezza-senza-tempo-junger/
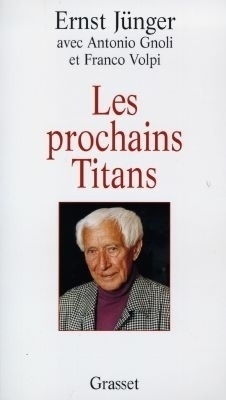 "Observer la vie de la nature, dans le petit comme dans le grand, est un spectacle incomparable, une occupation qui me procure de la sérénité". C'est ainsi qu'Ernst Jünger a expliqué sa passion pour l'entomologie aux journalistes italiens Antonio Gnoli et Franco Volpi lors d'une série de conversations datant de 1995, qui ont ensuite été rassemblées et publiées sous le titre Les prochains Titans. Un intérêt qui est bien plus qu'une curiosité, mais que l'auteur allemand considère comme égal à celui pour la littérature : "D'habitude, tout le monde me considère comme un écrivain et considère mes intérêts entomologiques comme une extravagance. Pour moi, ce sont deux passions tout aussi épanouissantes l'une que l'autre, et je ne les sépare pas".
"Observer la vie de la nature, dans le petit comme dans le grand, est un spectacle incomparable, une occupation qui me procure de la sérénité". C'est ainsi qu'Ernst Jünger a expliqué sa passion pour l'entomologie aux journalistes italiens Antonio Gnoli et Franco Volpi lors d'une série de conversations datant de 1995, qui ont ensuite été rassemblées et publiées sous le titre Les prochains Titans. Un intérêt qui est bien plus qu'une curiosité, mais que l'auteur allemand considère comme égal à celui pour la littérature : "D'habitude, tout le monde me considère comme un écrivain et considère mes intérêts entomologiques comme une extravagance. Pour moi, ce sont deux passions tout aussi épanouissantes l'une que l'autre, et je ne les sépare pas".
L'entomologie est une branche de la zoologie qui étudie les insectes. Jünger a été attiré par cette discipline dès son plus jeune âge, lorsque son père lui a donné, ainsi qu'à ses frères, le matériel nécessaire pour les capturer et les classer. Cette passion l'accompagnera tout au long de sa vie, des journées oisives à la campagne après avoir fait l'école buissonnière, aux brefs moments de répit pendant la guerre juste à côté des tranchées, en passant par les longs voyages autour du monde, en Asie comme en Méditerranée. L'intérêt de Jünger n'était pas seulement celui d'un amateur ou le résultat d'une improvisation, mais pouvait s'appuyer sur des bases scientifiques solides et lui valut plusieurs satisfactions, dont celle d'avoir donné son propre nom à deux nouvelles espèces qu'il avait découvertes : le Carabus saphyrinus juengeri et le Cicindela juengeri juengerorum.
Parmi les nombreuses variétés d'insectes, Jünger s'est surtout consacré aux coléoptères et en particulier aux cicindèles. Une prédilection qu'il justifie ainsi dans Chasses subtiles (1967), en la comparant à celle, plus courante, pour les papillons : "Les coléoptères ne s'offrent pas à l'œil avec autant de grâce. Ils sont plus matériels, plus durs et, en tant que joyaux de la terre, plus proches des fruits que des fleurs, plus proches des coquillages et des cristaux que des oiseaux. Ils ne déploient pas leur beauté d'un coup d'aile. Il est donc facile de comprendre pourquoi ceux qui les aiment sont plus constants que les "amateurs de papillons".
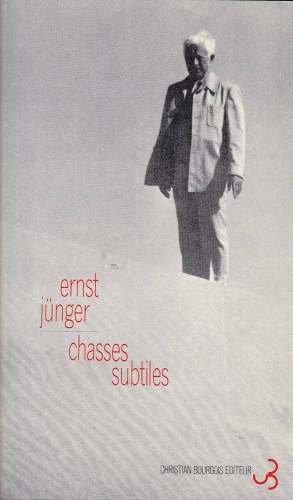

C'est précisément dans Chasses subtiles que l'auteur allemand s'engage davantage dans ces thèmes, en évoquant ses souvenirs et ses expériences personnelles et en les entremêlant de réflexions plus profondes. L'observation de la nature est pour Jünger bien plus qu'un passe-temps. C'est un viatique pour accéder aux couches les plus profondes de la réalité, là où se trouve le domaine de la forme, là où l'éternel se cache derrière le visible, là où, pendant de brefs instants, l'être resplendit : "Ces passions ne dépendent pas du rang des créatures, mais du choix de leur adorateur et de l'endroit où il se trouve. C'est précisément de là qu'il peut apercevoir, dans la mer des phénomènes, l'éclat d'une vague sur laquelle se brise la lumière, et c'est par cette petite fenêtre qu'il peut jeter un regard sur la magnificence de l'univers".
20:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, entomologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 23 février 2024
La résistance de l'anarque jüngerien face au dieu algorithme

La résistance de l'anarque jüngerien face au dieu algorithme
La réponse du rebelle : il prépare un lieu de résistance physique (qui est bien sûr aussi ultra-physique), concret. Jünger parle clairement d'armes, d'autorité, d'une délimitation concrète de l'espace où la souveraineté redevient une évidence.
par Giacomo Petrella
Source: https://www.barbadillo.it/113048-heliopolis-18-la-resistenza-dellanarca-jungeriano-davanti-al-dio-algoritmo/
La question de l'évasion, pour fuir l'algorithme, n'est pas une question de liberté ; en fait, ce n'est jamais qu'une question de liberté, qui est un concept très vendable et difficilement utilisable. Il s'agit clairement toujours d'une question de relations de pouvoir. Ce qui, pour nous Occidentaux du troisième millénaire, élevés dans le relativisme totalitaire protestant, signifie tenter une conversion de l'âme et du corps qui est difficile à réaliser. Même l'Anarque, vous le savez, nous l'avons mentionné à maintes reprises, n'aspire pas à une liberté indistincte: il prépare un lieu de résistance physique (qui est certainement aussi ultra-physique), concret. Jünger parle clairement des armes, du chef de famille, d'une délimitation concrète de l'espace où la souveraineté redevient une donnée : collective dans le cas du Travailleur, individuelle dans le cas du Rebelle.

Quand on re-propose la volonté d'un monde mal construit, on n'utilise donc pas un langage moral, pas une coexistence religieuse avec le péché, mais un discours héraclitéen: la vérité naît du polemos, c'est le conflit entre les parties qui indique la réalité du Logos.
Qu'est-ce que la tyrannie de l'algorithme? Tout simplement la victoire toujours plus concrète de l'anéantissement du devenir. Il ne s'agit pas, bien sûr, de la fin de l'histoire, concept aussi vendable et inutile que celui de liberté. Non. Il s'agit de l'anéantissement de tout flux, de tout cycle, de toute diversité concrète. C'est le remplacement du Logos, de la Providence, si vous voulez, par une ligne virtuelle et imposée de production infinie. Que le capitalisme soit tyrannique, personne ne le dit plus. Qu'il soit voué à l'anéantissement de la planète et des êtres humains, on le dit à travers des concepts qui, une fois de plus, sont aussi vendables qu'inutiles. Le pauvre homme regarde ces jeunes gens moyens rabaisser une œuvre d'art en se disant "au diable la planète, ma vie est déjà morte".

L'algorithme tend à créer deux factions, réconciliables au sein de son système de vente sur des bases moralisatrices. Sur chacun d'entre eux. Ce qu'il ne tolère pas, c'est l'usage de la violence au sens communautaire. De Fleximan à la victoire tactique russe, la violence héraclitéenne est immédiatement condamnée, censurée, et pas sur la base de la vérité. Mais sur des discours fidéistes. Le bien, le mal. Sainte civilisation. La violence est tolérée et même souhaitée, appliquée, défendue et sanctifiée si elle est utilitaire: si elle vise à renouveler la domination relativiste du modèle de production capitaliste.

Si elle sort de ce schéma, la reductio ad hitlerum est, comme toujours, immédiate; ainsi, le massacre de Gaza prend une connotation biblique plus que cohérente pour nous, Occidentaux puritains. Sodome et Gomorrhe méritent le châtiment du peuple élu. Un peuple qui, face au terrorisme du Hamas, est légitimé dans un sens économique, utilitaire, à commettre l'extermination: il fut un temps où l'économie et la crématique étaient séparées et où la vérité était un concept concret de la vie communautaire, on construisait des tours, des murs défensifs, parfois des ponts. À l'ère du capitalisme technocratique, tout comme on imprime de l'argent à l'infini pour les copains de BlackRock, il est normal de bombarder jusqu'à l'anéantissement.
L'homme moyen a donc raison de penser "au diable la planète, je ne vois rien de bon ici" ; certainement pour ceux d'entre nous qui luttent pour se rendre, au moins intellectuellement, la frustration s'accroît de voir nos propres intuitions marxiennes et nietzschéennes devenir tristement de plus en plus évidentes.
Nous supplions Polemos de revenir: démon de la guerre, probablement de la guerre civile, père d'Alalà, personnification du cri de guerre.
Giacomo Petrella
20:18 Publié dans Actualité, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, anarque, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 février 2024
Les peurs humaines face aux pharaons de la technologie comme Musk et Gates

Les peurs humaines face aux pharaons de la technologie comme Musk et Gates
La crainte est fondée. Jünger a bien compris que l'irréductibilité de l'être humain réside dans son implacable soif d'erreur.
par Giacomo Petrella
Source: https://www.barbadillo.it/112729-heliopolis-18-i-timori-umani-davanti-ai-faraoni-della-tecnica-come-musk-e-gates/
Il y a une terrible dissonance entre les sourires avec lesquels les institutions accueillent des figures exceptionnelles et formidables comme Bill Gates ou Elon Musk, et la peur intime de l'homme moyen face à ces pharaons de la technologie. Certains intellectuels se moquent de cette peur, la jugeant hâtivement "néo-luddite". Eux, en tant qu'intellectuels, imaginent qu'ils recevront un billet tout prêt pour le vaisseau spatial qui les emmènera en sécurité, sur Mars. Leur ironie est la même que celle qui a accompagné toutes les terribles dévastations historiques. Et peut-être que pour certains d'entre eux, il en est ainsi. Il ne nous est pas donné de le savoir.
La crainte de l'homme moyen est cependant bien fondée. Dans Les abeilles de verre, notre bon maître Ernst Jünger nous avertissait avec une froideur toute germanique que "la perfection humaine et la perfection technique ne sont pas conciliables. Si nous voulons l'une, nous devons sacrifier l'autre; à ce stade, les chemins se séparent. Celui qui en est convaincu sait ce qu'il fait d'une manière ou d'une autre".
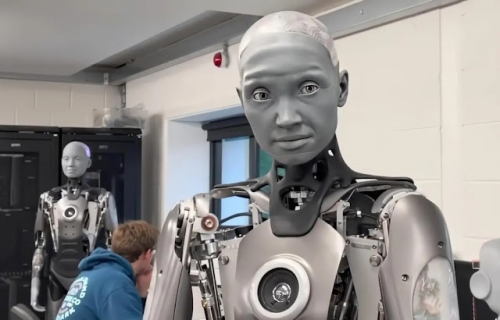
La cabane dans la forêt
Ici, ce qui est un peu rageant, c'est que nous n'avons toujours pas le temps ni l'argent pour construire notre cabane dans les bois. Ce qui, on s'en rend compte, représente une angoisse typiquement américaine: les cours de prepping, de survie, etc. fleurissent. Mais il serait un peu idiot de psychanalyser tout cela sans observer d'en haut comment les choses évoluent. La cabane dans la forêt représente en fait la contre-ironie intellectuelle : il serait amusant de voir les fusées exploser vers le ciel lorsque la guerre civile atteindra, par un miracle divin, sa phase de pacification.
La peur
Mais nous disions: la peur est fondée. Jünger avait bien saisi combien l'irréductibilité de l'être humain réside dans son implacable soif d'erreur. L'homme se trompe. Il ne serait pas à la fois arbitre et victime du Devenir s'il n'en était pas ainsi. Il ne serait pas libre. "Nous ne voulons pas d'un monde bien construit...". Il est donc tout à fait naturel que celui qui se sent encore lié à l'Univers soit terrifié par la perfection de la Technique apportée sur la table, avec la Tg; le morceau reste évidemment indigeste. La main glisserait vers la garde de l'épée, si nous étions dans d'autres temps.
En effet, la Technique n'admet pas l'erreur. Le calcul a commencé. Inéluctable. Celui qui salue le Pharaon sourit d'un sourire désespéré. Combien d'emplois vais-je pouvoir sauver? pense-t-il. Combien de familles? Combien de lits? Il n'y a pas d'ironie ici. Il y a la peur de l'insubstantialité totale de son effort. Comme Don Quichotte sans folie, l'homme sans erreur est un être effrayé, brisé, anéanti. Son seul mantra "ne pas faire le mal - ne pas faire le mal" l'enferme bien plus que le pauvre Prométhée.
Oui, parce que si notre bon Titan a agi par arrogance, vilenie et liberté, le reste d'entre nous agit par simple instinct de conservation. C'est ici que le parallèle jüngerien entre l'État mondial et le monde des insectes trouve son déploiement effectif: sans liberté, nous agissons par une action aussi conditionnée que parfaite, cohérente, a-historique. Sain d'esprit.
Peut-être est-ce notre fils qui le verra, cet État mondial. Ou peut-être, s'il en a la force, ce sera son petit-fils. Il y avait dans le Maître un optimisme prudent, une sorte d'espoir marxien et héraclitéen. La fourmilière pourrait devenir, après tout, le nouvel âge d'or. Nous aussi, nous espérons un peu.
En attendant, préparons-nous à un carnage sans précédent. Gaza multiplié par mille. La technique n'admet aucun dysfonctionnement.
Giacomo Petrella
14:18 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ernst jünger, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 janvier 2024
La forêt jüngerienne à l'heure de l'IA et de l'argent sans emploi

La forêt jüngerienne à l'heure de l'IA et de l'argent sans emploi
Dans tous les cas, la technologie continue d'être introjectée et expliquée comme le sujet dominant ; l'homme reste une sorte de démiurge passif de la technologie.
par Giacomo Petrella
Source: https://www.barbadillo.it/112451-heliopolis-17-il-bosco-jungheriano-al-tempo-di-ai-e-moneta-senza-lavoro/
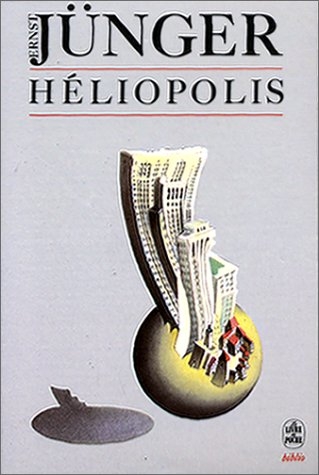 Lorsque nous lisons ou écoutons les débats sur l'IA, nous nous souvenons de la raison pour laquelle nous avons intitulé notre recueil de réflexions Héliopolis de commun accord avec le directeur. Ernst Jünger a écrit ce roman de même nom en 1949. On y trouve encore un optimisme spirituel certain: construire une aristocratie née dans la douleur. La technique est encore un courant sous-jacent mais qui va crescendo et qui domine. Jünger imagine, une fois passé le moment triomphal de la démagogie populiste, le retour, bien que caché, condamné et combattu, du modèle aristocratique classique: le Soldat entendu comme Guerrier, la voie de l'action, la voie du personnage De Geer, élevé vers Dieu par le monachisme germanique, par le Père Félix, la voie de la contemplation, au service d'un Régent juste, le principe retrouvé de l'Autorité. Le thème de la technologie n'est pas sujet, il est encore objet. Le bateau du pilote bleu est un instrument pour construire un ailleurs archétypal renouvelé.
Lorsque nous lisons ou écoutons les débats sur l'IA, nous nous souvenons de la raison pour laquelle nous avons intitulé notre recueil de réflexions Héliopolis de commun accord avec le directeur. Ernst Jünger a écrit ce roman de même nom en 1949. On y trouve encore un optimisme spirituel certain: construire une aristocratie née dans la douleur. La technique est encore un courant sous-jacent mais qui va crescendo et qui domine. Jünger imagine, une fois passé le moment triomphal de la démagogie populiste, le retour, bien que caché, condamné et combattu, du modèle aristocratique classique: le Soldat entendu comme Guerrier, la voie de l'action, la voie du personnage De Geer, élevé vers Dieu par le monachisme germanique, par le Père Félix, la voie de la contemplation, au service d'un Régent juste, le principe retrouvé de l'Autorité. Le thème de la technologie n'est pas sujet, il est encore objet. Le bateau du pilote bleu est un instrument pour construire un ailleurs archétypal renouvelé.
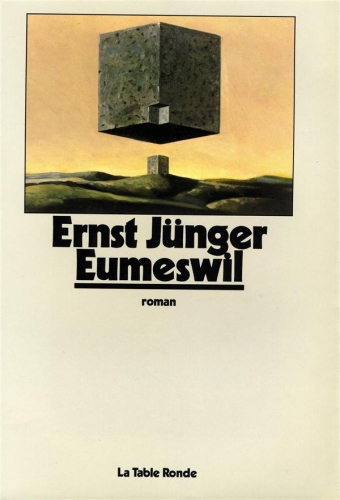 Dans les années suivantes, notre auteur fera l'expérience d'un pessimisme beaucoup plus aigu; d'abord dans Les Abeilles de verre, un roman d'une actualité frappante si on le compare au climat actuel de ce qu'on appelle le "capitalisme de surveillance". Eumeswil arrive une décennie plus tard, nous amenant déjà vers la fin des années 70: le nihilisme a gagné, l'Église, la politique, les corps intermédiaires ont tous plié devant le relativisme dévastateur de 68. Nietzsche, le maître, a été renversé par le triomphe de la pensée faible: le père philosophique est désormais l'arme de l'ennemi. Il ne reste plus qu'à vivre en Anarque, en préparant, si possible, une cabane dans la forêt.
Dans les années suivantes, notre auteur fera l'expérience d'un pessimisme beaucoup plus aigu; d'abord dans Les Abeilles de verre, un roman d'une actualité frappante si on le compare au climat actuel de ce qu'on appelle le "capitalisme de surveillance". Eumeswil arrive une décennie plus tard, nous amenant déjà vers la fin des années 70: le nihilisme a gagné, l'Église, la politique, les corps intermédiaires ont tous plié devant le relativisme dévastateur de 68. Nietzsche, le maître, a été renversé par le triomphe de la pensée faible: le père philosophique est désormais l'arme de l'ennemi. Il ne reste plus qu'à vivre en Anarque, en préparant, si possible, une cabane dans la forêt.
L'optimisme de la Technique dans le Le Mur du temps (1959), déjà à l'époque une sorte d'espoir post-religieux renouvelé, est abandonné pour faire place à une certitude spirituelle incertaine, bien mieux interprétée, à notre avis, par les livres plus récents de Marcello Veneziani (La Cappa, surtout).
Ici, du débat entre nouveaux Titans, nouvelles fantaisies prométhéennes, néo-luddites et grands pharaons du capitalisme de surveillance craignant de ne pas gérer la nouvelle chaîne de vapeur, nous ne ressentons que très peu d'attirance.
Dans tous les cas, la Technique continue d'être introjectée et expliquée comme le sujet dominant; l'homme en reste une sorte de démiurge passif, incapable d'échapper à la catastrophe spirituelle, philosophique et morale qu'a été 68. La grande différence heideggérienne entre la poièsis, le faire inséré dans la nature ordonnée du cosmos, et la teknè, le dévoilement de la nature pour son utilisation dans la volonté de puissance, reste ignorée. Aucune théorie politique ne remet aujourd'hui en cause le capitalisme comme objectivation de la Technique. Nous restons passifs, dominés, et donc promis à une catastrophe providentielle.
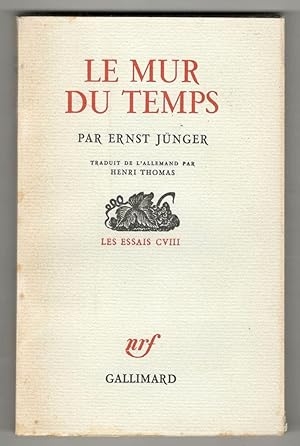 Nous disons cela sans esprit apocalyptique, plutôt dans une tonalité stoïcienne, comme l'a si bien fait Alain de Benoist au début des années 2000 dans son essai Sull'Orlo del Baratro. Et sur ce point, nous persistons, comme tant d'autres, à souligner l'absence totale de passion publique pour le thème central de la Technique, à savoir la monnaie. C'est la monnaie entendue comme Technique, la monnaie fiduciaire, l'instrument illimité créé à partir de rien, qui a définitivement détaché l'être humain de toutes ses limites, faisant de cette terre l'enfer faustien que nous connaissons et que nous continuons si hypocritement à appeler le meilleur des mondes possibles.
Nous disons cela sans esprit apocalyptique, plutôt dans une tonalité stoïcienne, comme l'a si bien fait Alain de Benoist au début des années 2000 dans son essai Sull'Orlo del Baratro. Et sur ce point, nous persistons, comme tant d'autres, à souligner l'absence totale de passion publique pour le thème central de la Technique, à savoir la monnaie. C'est la monnaie entendue comme Technique, la monnaie fiduciaire, l'instrument illimité créé à partir de rien, qui a définitivement détaché l'être humain de toutes ses limites, faisant de cette terre l'enfer faustien que nous connaissons et que nous continuons si hypocritement à appeler le meilleur des mondes possibles.
Ce n'est pas un hasard si, dans les années qui ont suivi les grands bouleversements nihilistes des années 60, du Concile Vatican II au Mai parisien, c'est en 1971, à Camp David, qu'a été décrétée la fin de Bretton Woods et la naissance de l'argent sans limites, de l'argent infini, délié de toute réalité physique. Domination du dollar, domination de l'ère libérale.
Gardez donc ce passage à l'esprit lorsque la société sera confrontée aux changements de l'intelligence artificielle dans les années à venir: l'argent sans travail, l'argent sans or, en était l'exemple premier, la cause première. Ceux qui continuent à parler d'"outils neutres", d'usage et de finalité, vous mentent comme ils vous ont toujours menti. Préparer la cabane dans la forêt.
Giacomo Petrella
21:01 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 janvier 2024
Ernst Jünger et le «Merveilleux Retour»

Ernst Jünger et le «Merveilleux Retour»
par Frédéric Andreu
L’indifférenciation contemporaine à l'endroit de la poésie en général et envers le Magnum Opus de Ernst Jünger en particulier, est emblématique de notre relation au "Merveilleux Retour". Ne laissons pas des controverses revanchardes à l'endroit du soldat au «quatorze blessures» jeter le trouble voile de la suspicion sur le pionnier de l'écologie, le poète, l'homme de paix et surtout, l'homme à la fois simple et profondément spirituel qu'était Ernst Jünger.
Qu'est-ce que des termites de faux-plafond peuvent comprendre au vol souverain d'un faucon ? Peut-être de puissants cris dont ils ne comprennent pas le sens. Ce qui intéressent un certain nombre de critiques dans une œuvre - qu'ils n'ont d'ailleurs généralement pas lu - c'est la possibilité de l'utiliser comme bannière de ralliement ou d'éventail idéologique. Bref, ils passent à côté de la littérature.
Certes, un poète comme Jünger a pu s'enflammer pour un passé glorieux, mais l'aurait-il vécu lui-même qu'il ne s'y serait jamais aligné. Jünger (perquisitionné deux fois à son domicile par le régime nazi) ne fut pas plus dupe du National-Socialisme de «festival» dont il vécut l'inexorable ascension, que du miroir inversé de celui-ci, l'International-Libéralisme qui règne sur tout l'Occident depuis la chute du Troisième Reich.
Témoin direct de cette chute tout aussi inexorable, il décrit dès septembre 1945, avec une prescience qui force le respect, le type macronoïde d'homme parvenu de nos jours au pouvoir :
«Ils ne connaissent ni les mythes grecs ni l'éthique chrétienne. Ce sont des titans et des cyclopes, esprits de l'obscurité, négateurs et ennemis de toutes forces créatrices […].
Ils sont loin des poèmes, du vin, du rêve, des jeux, empêtrés sans espoir dans des doctrines fallacieuses, énoncées à la façon des instituteurs prétentieux».
Imbu de sa personne, cet «ennemi des forces créatrices» n'a aucun pressentiment du Merveilleux Retour ni a fortiori de la Chute. Il ne connaît de fascination que pour les doubles parodiques de ce monde dans lesquels la littérature se réduit au rôle de marqueur mondain. Plein de griserie puérile à l'endroit de la technique, il n'entend pas dans le bruit du moteur de sa grosse cylindrée le ricanement victorieux des titans et des cyclopes contre les dieux.

Cependant, il peut arriver qu'une page de cette œuvre jünguérienne - si phréatiquement poétique - vienne fissurer la surface asphaltée de leurs croyances athées. Lors, quelque chose qui est dans le lecteur et dans la société tout entière, se met à voir le monde comme à travers l'aile d'une libellule... La pensée symbolique de Jünger est en effet de celles qui peuvent ajouter au réel quelque chose comme l'auréole couronnée du songe, la transparence diaprée, propices à transformer nos attentes inquiètes en insatiables appels intérieurs. La littérature se découvre alors sous le jour qu'elle n'a jamais cesser d'être, une liturgie, voire une théologie du dévoilement. Pourquoi la chute de l'âme ? pourquoi cette existence temporaire, sinon pour remonter, avec les beaux textes qui nous y aident, les échelons merveilleux et transfigurateurs vers le royaume qui n'est pas ce monde. Dans les recoins les plus sombres de son œuvre, Jünger se fait le témoin du «voile d'Isis de ce monde» que la beauté soulève mystérieusement.
Si la littérature éclaire les ruines de nos vies, elle montre aussi que ces ruines sont celle d'un temple. «Dans aucune de ces marches, cependant, nous ne négligions les fleurs. Elles nous indiquaient la direction, comme la boussole montre le chemin à travers des mers inconnues».
Si les poètes ont donc assurément «mission» d'hâter ce dévoilement «sacré», les «ennemis des forces créatrices» dont parle Jünger ont assurément la leur. Drapés dans le vernis démocratique, leur but est aujourd'hui de s’affairer par les moyens légaux - aspersion de glyphosate, pilules abortives, immigration massive – à la destruction des jardins, champs, nappes phréatiques, cellules familiales, bref, tout ce qui constituent les membranes protectrices de la vie.

Ernst Jünger mais aussi Dominique de Roux, Luc-Olivier d'Algange entre autres veilleurs, répondent, chacun à sa manière propre, à l'appel du Merveilleux Retour bordé de fleurs, mythique et impérial. Dès lors que l'insatiable nostalgie en l'Homme s'oriente non vers le regret et le ressentiment, mais vers les spirales rédemptrices de l'âme, le règne de la machine est déjà vaincu ! L'aigle a terrassé le drone !
On se croyait perdus, consommateurs interchangeables au milieu de la tranchée du monde ; on se découvre pèlerins sur la terre ferme ! Comme dans le chant ancien des Lansquenets :
Vi gå över daggstänkta berg, «Nous allons par la montagne couverte de rosée»...
Dès lors, nous avons le pressentiment que «quelqu'un» nous attend à Ithaque !
19:22 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 août 2023
Jünger et Schmitt, trop grands pour le panthéon de la droite fluide et pro-américaine

Jünger et Schmitt, trop grands pour le panthéon de la droite fluide et pro-américaine
Gennaro Malgieri
Source: https://electomagazine.it/junger-e-schmitt-troppo-grandi-per-il-pantheon-della-destra-fluida-e-filoamericana/
Parmi les intellectuels allemands de la première moitié du 20ème siècle, Ernst Jünger et Carl Schmitt occupent des positions centrales reconnues même à notre époque, ce qui semble témoigner de leurs diagnostics politiques et métapolitiques. Tous deux ont exprimé le malaise de la modernité face à l'avancée du nihilisme (pour le premier) et aux convulsions du pouvoir (pour le second).
Il ne fait aucun doute que ces deux positions se complètent de manière exemplaire pour comprendre les contradictions dramatiques du 20ème siècle qui nous ont amenés au nouveau siècle. Jünger et Schmitt, qui étaient d'ailleurs liés par une profonde estime qui n'a cependant jamais abouti à un lien idéologico-politique comme on aurait pu s'y attendre, ont tous deux tenté une voie "rebelle" à l'égard de la culture et de la vision du monde qui étaient en train de s'imposer. Tant en ce qui concerne les involutions de la démocratie que les résultats de la crise spirituelle européenne.
L'éblouissant totalitarisme matérialiste, déterministe et relativiste les a opposés, même si leur implication dans les événements qui ont marqué la première moitié du siècle dernier les a fait passer, stupidement et superficiellement, pour des apologistes de ce qu'ils tentaient d'endiguer: travailler de l'intérieur (Schmitt) dans la mesure du possible; imaginer une manière aristocratique et impersonnelle, explicitement individualiste (Jünger), de donner un sens à la pratique aristocratique de surmonter les "valeurs bourgeoises" qui minent la stabilité et l'ordre européens.
Parmi les intellectuels révolutionnaires-conservateurs, Carl Schmitt (1888-1985) occupe une place cruciale en tant qu'idéologue qui, plus que tout autre, a posé le problème du pouvoir, de ses transformations et de son impact sur la formation des nouveaux agrégats politiques issus de la Grande Guerre. Il a "travaillé" autant qu'il le pouvait au sein des institutions, apportant non seulement des contributions théoriques à la construction d'un nouvel État allemand dans les années 1930, mais aussi concrétisant un système de légitimité qui surmonte les tendances totalitaires, ce qu'il n'a pas réussi à faire, ce qui lui a valu d'être marginalisé par les milieux les plus radicaux du Troisième Reich, détail qui n'a heureusement pas échappé aux juges de Nuremberg qui l'ont acquitté avec un "permis de ne plus agir".
Un peu plus de trente ans après sa mort, l'itinéraire intellectuel de Schmitt est reproposé en Italie par la publication de deux livres. Le premier, un syllogue de certains de ses écrits, publié par Adelphi, Stato, grande spazio, nomos, édité par l'un de ses élèves les plus attentifs, Günter Maschke. Dans ce livre, qui résume certains des principaux concepts du savant, on peut retrouver les idées de Schmitt sur la "mondialisation". En effet, Schmitt avait vu, avec une clairvoyance exceptionnelle, comment "l'universalisme de l'hégémonie anglo-américaine" était destiné à effacer toutes les distinctions et la pluralité spatiale dans un "monde unitaire" totalement subjugué par la technologie et la financiarisation globale de l'économie et soumis à une sorte de "police internationale".
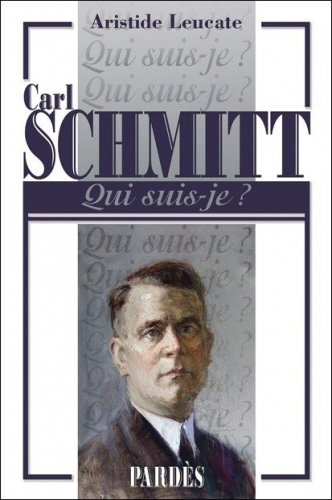
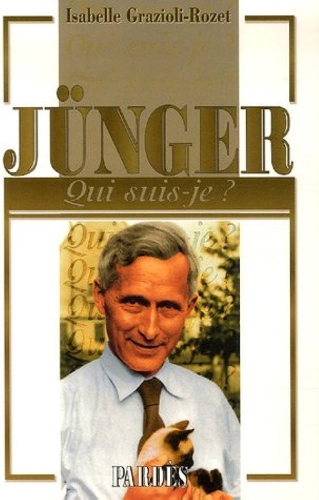
Un monde spatialement neutre, sans cloisons et sans contrastes - donc sans politique, comme nous l'avons noté dans l'introduction. Pour Schmitt, au contraire, il ne peut y avoir d'Ordnung (ordonnancement) sans Ortung (localisation, ancrage en un lieu), c'est-à-dire sans une subdivision adéquate et différenciée de l'espace terrestre. Une subdivision qui, toutefois, dépasse l'étroitesse territoriale des anciens États nationaux fermés, pour aboutir au "principe des grands espaces" : le seul capable de créer un nouveau jus gentium, au centre idéal duquel devrait se trouver à nouveau l'ancienne terre d'Europe, un authentique katechon face à l'Antéchrist de l'uniformisation planétaire sous le signe d'un unique "seigneur du monde". Ce qui est certain, c'est que la perspective de Schmitt, notée dans l'édition des écrits, déjà esquissée il y a quatre-vingts ans, apparaît aujourd'hui plus pertinente que jamais, et sa pensée se confirme comme fondamentale pour comprendre notre époque.
Le second est un long entretien, au titre évocateur d'Imperium proposé par l'éditeur Quodlibet, qui se présente comme une véritable autobiographie, réalisée à l'âge de quatre-vingt-trois ans, en 1971, par l'historien Dieter Groh et le journaliste Klauss Figge pour la radio allemande, soutenu par un puissant appareil de notes préparé par les éditeurs qui rend la parabole de Schmitt encore plus compréhensible. Le long récit de sa vie montre que le savant n'a jamais cherché à s'éloigner du contexte historique dans lequel son travail théorique a pris forme dans la définition des catégories de la politique, de la critique de la nouvelle géopolitique qui a souffert de la fin du traité de Westphalie et de la décadence conséquente du Vieux Continent après l'annulation du jus publicum europaeum (le droit interétatique qui délimitait l'ordonnancement spatial de la res publica chrétienne médiévale). Et comment le problème de la souveraineté a été posé par un raisonnement autour de la figure du "décideur". Des thèmes aujourd'hui partagés par l'ensemble de la science politique la plus avancée, sans préjugés d'aucune sorte. Dans l'entretien biographique, truffé de détails extraordinairement intéressants sur son éducation et son environnement familial, il expose sans réticence les moments les plus problématiques de sa vie et notamment comment il est devenu malgré lui "juriste du Reich", une fonction qui lui permettrait de juger les hommes et les événements avec une grande lucidité, tout comme il avoue avec une sincérité éblouissante sa critique du progrès des Lumières et sa foi catholique soutenue par sa fréquentation des penseurs contre-révolutionnaires.
Vie publique et vie privée s'entremêlent dans cette intense "confession" d'où se dégage le sens d'une longue vie consacrée à la découverte des fondements réels de la politique et de la centralité de l'État comme "ordonnateur des ordres". D'où son "inimitié" totale à l'égard de la modernité, le révélateur de tous les principes régulateurs de l'existence humaine. Et l'aversion, jamais cachée, pour l'irréalisme utopique destructeur des structures "naturelles" qui a souvent ensemencé le sol sur lequel la graine totalitaire a germé.
 Il en va de même - et cela les unit - pour Jünger (1895-1998) qui, un peu plus de cent vingt ans après sa naissance et dix-huit ans après sa mort, ne cesse de nous interpeller sur les questions posées par la catastrophe existentielle dans laquelle nous sommes plongés, rappelée par le dense volume Ernst Jünger, publié par Solfanelli, conçu et édité par Luigi Iannone, dans lequel pas moins de trente auteurs abordent les "nœuds" du dernier grand écrivain allemand que personne n'a jamais songé à nommer pour le prix Nobel (ce qui, comme l'a dit Alain de Benoist, qualifie d'une certaine manière le 20ème siècle).
Il en va de même - et cela les unit - pour Jünger (1895-1998) qui, un peu plus de cent vingt ans après sa naissance et dix-huit ans après sa mort, ne cesse de nous interpeller sur les questions posées par la catastrophe existentielle dans laquelle nous sommes plongés, rappelée par le dense volume Ernst Jünger, publié par Solfanelli, conçu et édité par Luigi Iannone, dans lequel pas moins de trente auteurs abordent les "nœuds" du dernier grand écrivain allemand que personne n'a jamais songé à nommer pour le prix Nobel (ce qui, comme l'a dit Alain de Benoist, qualifie d'une certaine manière le 20ème siècle).
Le parcours "rebelle" entrepris par Jünger dès son plus jeune âge et poussé à ses extrêmes conséquences dans sa maturité, pour aboutir à la définition de la figure existentielle, mais aussi mythopoétique, de l'Anarque, est aujourd'hui la ligne de partage des eaux entre ceux qui adhèrent à la névrose de la globalisation de la pensée et ceux qui, apparemment reclus, revendiquent la primauté de la diversité en adhérant à des valeurs qui s'écartent de l'homologation culturelle et la soumettent à une stricte dévalorisation. C'est ce que révèlent les contributions que Iannone a rassemblées et qui donnent à Jünger une connotation très actuelle. Et cela est d'autant plus vrai si on le met en relation avec les involutions de la démocratie et avec les résultats de la crise spirituelle européenne. L'éblouissant totalitarisme matérialiste, déterministe et relativiste auquel l'écrivain allemand s'est toujours opposé s'estompe à la lumière des fulgurantes intuitions de Jünger: de la conception du Travailleur à cette "mobilisation totale" qui a modifié substantiellement la considération de l'intervention existentielle, politique, métapolitique, guerrière et intellectuelle, de la classification de la guerre comme exaltation de l'esprit à la réinvention de la paix (dans un sens tout sauf kantien), des constructions oniriques de la décadence aux "radiations" (Strahlungen) qui illuminent son long travail et constituent les métaphores du dépassement de l'égalitarisme massifiant.
Iannone, à juste titre, rappelle la définition qui représente le mieux Jünger : "sismographe de l'âge de la technologie", dans la mesure où elle est liée à l'interprétation de la modernité dont il rejette les fantasmagories déclenchées par une "pensée négative" qui a liquidé les libertés substantielles pour les homologuer à un universalisme dans lequel les différences ont disparu et où se sont dissoutes les "formes", comme les appelait Gottfried Benn, qui enferment le concept décomposé d'"humanité" : le sacré, l'honneur, le courage, la communauté et ainsi de suite. La figure de l'Anarque, représentation extrême du refus de la modernité selon Jünger, est la seule habilitée à "traverser les bois", c'est-à-dire la crise.
Mais une préparation spirituelle adéquate est nécessaire. Jünger s'est fait passer pour elle. Et cela suffit à le considérer comme le partisan le plus lucide d'une renaissance possible, quel que soit le désespoir induit par le contexte.
19:46 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, carl schmitt, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 juillet 2023
Hoffmann et Jünger: la nature perturbatrice de la technologie

Hoffmann et Jünger: la nature perturbatrice de la technologie
par Marco Zonetti
Source: https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=49112
En lisant la nouvelle Le marchand de sable (ou: L'homme au sable) d'Ernst Theodor Hoffmann et le court roman dystopique Abeilles de verre d'Ernst Jünger, nous pourrions découvrir que les deux auteurs ne partagent pas seulement un prénom et une nationalité, mais aussi une méfiance particulière et clairvoyante à l'égard de la technologie, ou du moins de son pouvoir de manipulation et de déshumanisation.


Dans le conte d'Hoffmann, écrit en 1815, le jeune Nathanaël est obsédé par la figure d'un homme mystérieux, Coppelius, qu'il assimile iconographiquement dès l'enfance au Marchand de sable, sorte de croquemitaine du folklore qui jette du sable dans les yeux des enfants, les arrache et les emporte dans sa hutte du "croissant de lune" pour les donner à manger à ses "petits becs".
Coppelius est introduit dans l'histoire comme un vieil ami avocat du père de Nathanaël, mais il s'avère être une sorte de savant alchimiste fou, complice d'un fabricant d'automates italien, Lazzaro Spalanzani, qui se fait passer pour un inoffensif professeur de physique. Nathanaël rencontre la fille de ce dernier, Olympia, en réalité un automate construit par Spalanzani avec l'aide de Coppelius, et en tombe éperdument amoureux, ce qui le plonge dans un tourbillon de folie. Après un bref intermède de sérénité, sous les soins affectueux de sa fiancée Clara et de son ami Lothar, qui représentent le foyer domestique et l'affection sincère non contaminée par l'Unheimlichkeit représentée par la "diablerie" de la technologie incarnée par Coppelius et Spalanzani, Nathanael semble avoir brièvement retrouvé la raison, pour sombrer à nouveau dans ses anciennes obsessions - réveillées par une lorgnette fabriquée par Coppelius - qui le conduiront au suicide.
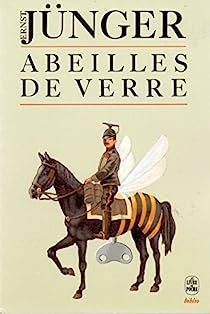 La même approche de la science et de la technologie considérées comme "dérangeantes" transparaît dans le court roman d'Ernst Jünger, Abeilles de verre, paru en 1957. Des abeilles de verre, c'est-à-dire de minuscules automates intelligents, peuplent les jardins de l'industriel Zapparoni (un autre Italien) où le protagoniste Richard - un vétéran de guerre issu d'un monde simple aux traditions axées sur l'honneur et aux valeurs perdues - s'est retrouvé à la recherche d'un emploi. Dans les jardins de Zapparoni, enrichis par la conception et la construction de machines technologiquement avancées, telles celles qui dominent aujourd'hui le monde, Richard observe la "symétrie effrayante", pour citer William Blake, des abeilles de verre et de leur physiologie hypertechnologique qui, loin d'améliorer ou de perfectionner la nature (imparfaite en soi, comme le souligne Jünger dans nombre de ses œuvres), nous rappelle que plus la technologie progresse, plus elle devient efficace, et que plus la technologie progresse, plus l'humanité involue et vice versa), elles l'appauvrissent, et finalement la dévastent - les fleurs touchées par les "abeilles de verre" sont en effet destinées à périr car elles sont privées de pollinisation croisée.
La même approche de la science et de la technologie considérées comme "dérangeantes" transparaît dans le court roman d'Ernst Jünger, Abeilles de verre, paru en 1957. Des abeilles de verre, c'est-à-dire de minuscules automates intelligents, peuplent les jardins de l'industriel Zapparoni (un autre Italien) où le protagoniste Richard - un vétéran de guerre issu d'un monde simple aux traditions axées sur l'honneur et aux valeurs perdues - s'est retrouvé à la recherche d'un emploi. Dans les jardins de Zapparoni, enrichis par la conception et la construction de machines technologiquement avancées, telles celles qui dominent aujourd'hui le monde, Richard observe la "symétrie effrayante", pour citer William Blake, des abeilles de verre et de leur physiologie hypertechnologique qui, loin d'améliorer ou de perfectionner la nature (imparfaite en soi, comme le souligne Jünger dans nombre de ses œuvres), nous rappelle que plus la technologie progresse, plus elle devient efficace, et que plus la technologie progresse, plus l'humanité involue et vice versa), elles l'appauvrissent, et finalement la dévastent - les fleurs touchées par les "abeilles de verre" sont en effet destinées à périr car elles sont privées de pollinisation croisée.
Bien que conçus à deux époques différentes, Olympia et les abeilles de verre représentent l'élément perturbateur d'un monde obsédé par la science, et dans une course folle vers un futur ultra-technologique où hommes et machines deviennent de plus en plus interchangeables au détriment des premiers. Où la poésie de l'idéal romantique et de l'amour sincère, comme celui de Nathanaël pour Clara, est gâchée par l'obsession suscitée par la froide et contre-naturelle Olympia, mécanisme parfait mais inhumain, à l'image des "automates de Neuchâtel" qui ont dû inspirer Hoffmann pour créer son personnage. Dans lequel les hommes et les animaux sont progressivement remplacés de manière dystopique par des machines et des automates, et où la naissance même, l'acte d'amour même qui conduit à la conception d'un être humain est remplacé par un alambic, une éprouvette, un mélange concocté en laboratoire, dans une sorte de "chaîne de montage" de la reproduction, de "fordisme" appliqué aux naissances comme dans le "meilleur des mondes" d'Aldous Huxley, "un excellent nouveau monde" dans lequel Olympia et les abeilles de verre seraient des citoyens d'honneur et des habitants privilégiés.

Une autre affinité particulière entre les deux œuvres est la récurrence de l'élément "yeux" et "verre". Dans le conte d'Hoffmann, on retrouve par exemple le leitmotiv des télescopes ("yeux" en verre comme ceux des abeilles) construits par Coppelius sous les traits de l'Italien Coppola. Des lorgnettes qui nous renvoient immédiatement à Galileo Galilei, représentant suprême de l'ambition scientifique de l'homme, ambition qui, dans le conte d'Hoffmann, est néanmoins faussée par les visées ambiguës de Coppelius, désireux de priver Nathanaël de ses yeux, d'en faire un automate aveugle à l'instar d'Olympia elle-même. Paradoxalement, au lieu de lui donner une vision amplifiée de la réalité, de le rendre plus "clairvoyant", le télescope que Nathanaël acquiert de Coppelius le plonge dans une folie primitiviste qui ne reconnaît ni l'affection, ni l'amour, ni l'amitié, ni même les connotations humaines, le conduisant finalement à l'autodestruction, ou au suicide.
Comme Richard lui-même, le protagoniste des Abeilles de verre, Nathanaël perd peu à peu son humanité et son attachement à ses traditions et à ses valeurs, submergé par la technologie maléfique de deux êtres voués à la création de marionnettes et de clowns destinés à amuser les foules, des monstres comme Olympia, ou comme les automates de Zapparoni qui en sont venus à remplacer les acteurs en chair et en os dans les films, tels que Jünger les décrit dans son roman.
Pour en revenir aux yeux, le protagoniste des Abeilles de verre comprendra peu à peu que, pour la tâche qu'il entend entreprendre, il a besoin d'yeux déshumanisés, aseptisés, (des yeux de verre ?) qui doivent voir sans regarder, sans discerner, afin de passer outre les atrocités perpétrées dans le jardin (et la société) d'horreurs technologiques de Zapparoni. Pour survivre dans le monde hyper-technologique et inhumain instauré par la perte des valeurs et de la tradition, Richard réalisera donc qu'il faut se laisser métaphoriquement crever les yeux par le marchand de sable représenté par l'ambition et l'arrogance de l'homme.
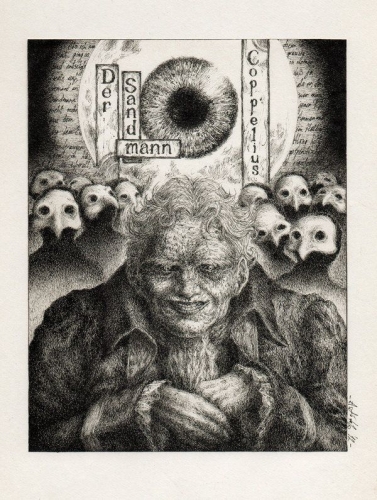
Avec les dérives de la technologie, avec le sacrifice de l'éthique sur l'autel d'Hybris, avec la course effrénée pour plier la nature à notre volonté, Hoffmann et Jünger semblent ainsi le prévoir, l'être humain devient un simulacre de lui-même, un automate (faussement) parfait, une "abeille de verre" sans âme, sans cœur, sans sexe. Transgenre et ultragender construits en série comme une marionnette, au point que - dans notre réalité la plus proche - les parents sont tellement dépersonnalisés qu'ils abdiquent même les noms de père et de mère pour devenir "parent 1" et "parent 2", des expressions qui plairaient non seulement à l'ambigu Zapparoni - qui doit son succès au déclin de l'éthique et de la tradition - mais aussi au perfide Coppelius, sorte de "tourment du chef de famille" kafkaïen, non moins inquiétant que la "bobine de fil" Odradek, figure du célèbre conte de l'écrivain pragois. Mais surtout au monstrueux marchand de sable qui, depuis son repaire du "croissant de lune", ne pouvait que se réjouir de notre ambition aveugle qui nous empêche de voir la réalité dystopique dans laquelle, hautains et arrogants, nous nous jetons à corps perdu à la poursuite des dérives de la technologie et du génie génétique.

L'Hybris démiurgique de la technique représenté par Coppelius et Zapparoni, c'est-à-dire l'aspiration à reproduire la puissance créatrice divine, englobe nécessairement l'anéantissement de soi et de l'humanité, c'est pourquoi le Nathanaël d'Hoffmann ne peut que se suicider et le Richard de Jünger trahir ses propres principes pour se soumettre au nouveau statu quo et au nouveau régime de dépersonnalisation de l'homme.
Privés des yeux de l'éthique, des valeurs et du respect sacré de la nature, aveuglés par notre arrogance, nous ne sommes que des enfants désemparés destinés à devenir pitance pour la progéniture des "hommes des sables" occultes ou les esclaves de "Zapparoni" rusés et impitoyables.
Plus d'informations sur www.ariannaeditrice.it
23:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e.t.a. hoffmann, ernst jünger, marchande sable, abeilles de verre, technologie, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 19 juillet 2023
Ernst Jünger, méditateur en uniforme et maître de la liberté
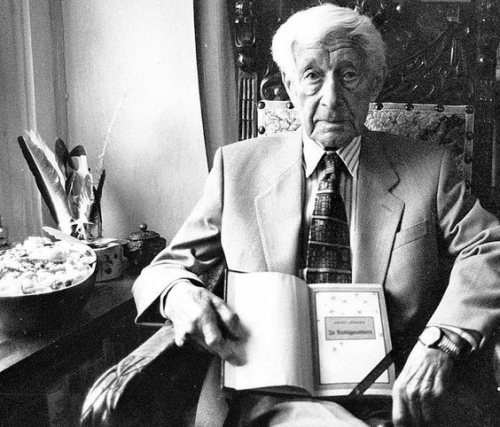
Ernst Jünger, méditateur en uniforme et maître de la liberté
Ernst Jünger fut un maître inégalé de la contemplation, un mémorable exemple d'action, un théologien des temps nouveaux, un platonicien morose, un entomologiste compétent, un pédagogue de la liberté. Enfin, un amoureux de l'Italie, de la Dalmatie irrédente à la Sicile ensoleillée, de Naples à la plus aimée de toutes, cette Sardaigne à la "terre rouge, amère, virile, tissée d'un tapis d'étoiles, de tout temps fleurie à chaque printemps, berceau primordial".
par Alessio Mulas
Ex : http://www.lintelletualedissidente.it
Nous sommes en 1895. Röntgen est sur le point de découvrir les rayons X; l'affaire Dreyfus éclate en France. Ernst Jünger aimait évoquer ces deux événements. Ils ont tacitement traversé sa vie et ses réflexions, qui ne sont rien d'autre que le miroir d'un siècle: ce vingtième siècle aussi rapide et puissant que l'éclair d'Héraclite, cet éclair qui "gouverne toutes choses", comme il était écrit au-dessus du seuil de la cabane de Heidegger dans la Forêt-Noire. La découverte de Röntgen a ouvert le siècle de la technologie, permettant à l'homme de "voir l'invisible", d'observer ce qui était encore interdit par le microscope, de développer la recherche sur l'atome et la fission nucléaire. Cinquante ans séparent la découverte aussi fortuite qu'heureuse de 1895 du lancement de Little Boy, doux artifice américain, dont Hiroshima se souvient comme d'un feu céleste: moins modeste que le lumineux bagherino giottesque de saint François, plus furieux que le char enflammé du Livre des Rois, peint par Roerich dans de chaudes nuances de rouge. La bombe atomique n'a rien laissé derrière elle, pas plus que le manteau tombé sur Elie lors de l'ascension. Ceux qui ont vécu le 20ème siècle craignent plus l'homme que Dieu, dont les destructions racontées dans l'Ancien Testament semblent des grâces comparées aux massacres des deux guerres mondiales. L'affaire Dreyfus, en revanche, a inauguré la meilleure arme des démocraties occidentales: l'opinion publique, lame munie de la critique la plus acérée, a augmenté le degré d'incertitude politique, profitant d'une victoire sur les forces conservatrices "moustachues et poussiéreuses". Le siècle dernier a été aussi changeant que l'eau, aussi terrible que la foudre.
Ernst Jünger est né ainsi : avec une invitation à réfléchir sur la technologie et la politique, mais sans tomber dans la spirale de la simple contemplation. Le temps de l'homme est limité, l'éducation coûteuse. Il a combiné la contemplation et l'action, mais il l'a fait d'une manière plus harmonieuse et plus constante que le Japonais Mishima, autre équilibriste à mi-chemin entre la lumière nocturne de la pensée et la lumière diurne de l'action sans but. La beauté, nous rappelle-t-on, est un coucher de soleil : le moment où les forces lunaires et solaires divisent le champ, et où la contemplation et l'action ne font plus qu'un, dans l'ascension d'un pilote vers l'étoile la plus proche, sur une lame tranchante des cieux. Dans Soleil et acier, Mishima enseigne que "le corps et l'esprit ne se confondent jamais".
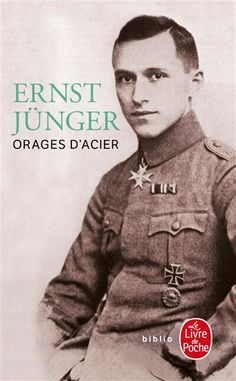
Jünger s'est battu contre de l'acier, celui de l'artillerie britannique et française, sur le front occidental. Et, comme le dit un adage militaire moqueur, le petit-déjeuner ne suffit pas à garder le corps et l'esprit unis: il faut plus que cela. Dès 1913, dès qu'il est majeur et qu'il s'échappe de l'environnement bourgeois de la maison familiale, il s'engage dans la Légion étrangère, un repaire d'aventuriers et de délinquants plutôt que de soldats disciplinés. L'expérience algérienne à Sidi-bel-Abbès, qu'il qualifie d'"événement bizarre comme un fantasme", est publiée sous la forme d'une confession fictive en 1936, sous le titre Afrikanische Spiele (Jeux africains). Mais Jünger est alors déjà connu pour ses exploits lors de la Première Guerre mondiale. Rapatrié d'Afrique grâce à l'intervention de son père Ernst Georg Jünger, un pharmacien plus familier avec la verrerie des laboratoires qu'avec les balles, il a volontiers accepté l'invitation de l'année 1914 et s'est engagé comme volontaire dans l'armée de l'empereur Guillaume II. Il vient de découvrir sur le papier ce qu'il s'apprête à voir sur le front. Les lectures de Friedrich Nietzsche l'ont jeté dans les bras de la guerre comme un veau qui, conduit à l'abattoir, se sent dans un palais royal. Mais la viande de Jünger n'était pas aussi tendre que celle d'un veau, et il survécut avec une extrême bravoure à pas moins de quatorze blessures, dont la dernière très grave, passant du statut de simple fantassin à celui de Strosstruppfüher (chef de commando d'assaut), à l'honneur de porter deux Croix de Fer sur la poitrine, une Croix de Chevalier de l'Ordre de Hohenzollern et une croix de l'Ordre Pour le Mérite, reconnaissance d'une volonté aussi dure que le fer de la médaille, privilège que seuls douze officiers subalternes de l'armée impériale avaient pu obtenir.
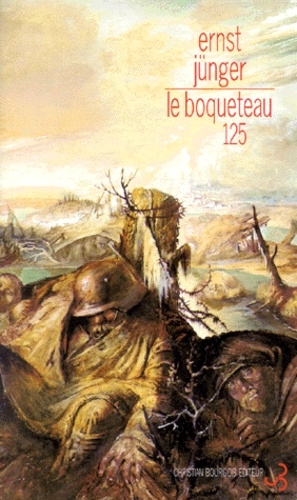
Dans une caserne de la Reichswehr (ancêtre de la Wehrmacht), entre 1918 et 1923, il écrit ses premiers livres, dont un titre incontournable pour ceux qui ont subi (et subissent) la fascination de la Grande Guerre : In Stahlgewittern (Orages d'acier), fruit du remaniement de notes de tranchées sous forme de mémoires de guerre, publié en 1920. Le destin de l'œuvre est différent de celui d'autres récits de guerre. Il ne s'agit pas du Feu de Barbusse, paru en plein conflit, mais pas non plus du célèbre A l'Ouest rien de nouveau de Remarque. Si le succès de ce dernier fut rapide et universel, In Stahlgewittern - publié assez tard en traduction italienne (1961) - circula dans les milieux de droite, parmi les cercles militaires, les associations d'anciens combattants, les groupes nationalistes et conservateurs, qui n'en comprirent que partiellement l'esprit. L'expérience de la guerre - décrite plus tard dans d'autres mémoires comme Le combat comme expérience intérieure (récemment publié par Piano B), Lieutenant Sturm, Le boqueteau 125, Feu et sang - avait non seulement capturé la jeunesse "comme une ivresse" et émancipé les nouvelles générations d'Allemands du "moindre doute que la guerre nous offrirait la grandeur, la force, la dignité", mais avait la saveur d'une "initiation qui non seulement ouvrait les chambres ardentes de la terreur, mais les traversait". Les explosions incessantes des shrapnels, anges du ciel qui, plus que de nouvelles billes de plomb, déchirent les chairs, ne sont qu'un des aspects les plus terribles de cette guerre technique et matérielle. Ce n'est pas la France peinte par les impressionnistes, la France des taches et des coups de pinceau juxtaposés, mais c'est le pays de la mutilation, des corps ensanglantés recouverts de neige fondue, d'un ciel de balles. C'est la guerre des tranchées. C'est le soldat "chantant sans souci sous une voûte ininterrompue de shrapnels", comme l'imaginait Marinetti avec une excitation futuriste. Et le jeune Jünger saisit tout cela avec un nihilisme esthétisant, cristallisé dans une prose magistrale. Le soldat et l'artiste célèbrent ici leur parenté intime, puisque la guerre est un art et vice versa.
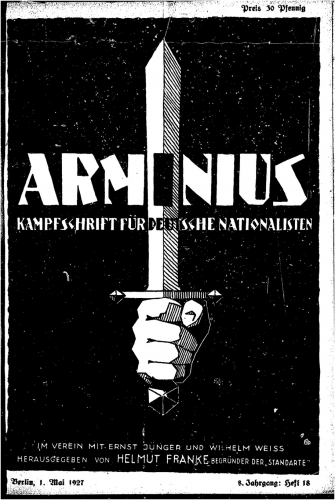
Les mots concernant Aschenbach, le protagoniste de Mort à Venise de Thomas Mann, s'appliquent : "Lui aussi avait été un soldat et un homme de guerre comme certains de ses pairs ; car l'art est une guerre, c'est une bataille épuisante". Dans Stahlgewittern, on trouve une splendide glose de Novalis, esprit européen et chrétien, dans son exaltation du dynamisme poétique de la guerre. La notoriété que lui apporte le livre permet à Jünger de participer activement à des mouvements nationalistes et antidémocratiques et de collaborer à des journaux tels que Arminius, Der Vormarsch et Widerstand, une revue politique de son ami national bolchevique Ernst Niekisch. C'est au début de la période d'après-guerre qu'il a commencé à produire des ouvrages non romanesques, La mobilisation totale, Sur la douleur, Le Travailleur. Hans Blumenberg n'a pas tort lorsqu'il affirme que Jünger est le seul auteur allemand à nous avoir laissé la trace d'une confrontation longue de plusieurs décennies avec le nihilisme.
L'inévitabilité de cette confrontation et le défi qu'elle représente sont très présents dans son œuvre. Il a cherché le néant, l'anéantissement du vieux monde des bourgeois, des savants et des porteurs de perruques; il l'a poursuivi, inlassablement, dans le désert (Jeux africains), dans le mépris de la vie face à la guerre (Orages d'acier), dans l'ivresse (Approches. Drogues et ivresse), dans la douleur (Sur la douleur), "l'équivalent métaphysique du monde éclairé-hygiénique du bien-être" (Blumenberg, Der Mann vom Mond. Über Ernst Jünger). L'anéantissement de l'homme passe par son élévation, par la planification totale de la société "mobilisée" dans le travail et l'étude, par la réduction finale de la personne à la monade techno-biologique envisagée dans la métaphysique du Travailleur, livre fondamental dans les étapes de l'évolution intellectuelle du penseur allemand, texte étudié par deux grands philosophes comme Martin Heidegger, qui organisa des séminaires privés sur le sujet dans les années 1930, et Julius Evola, qui en fit un commentaire (Le Travailleur dans la pensée d'Ernst Jünger).
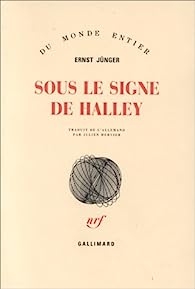 Mais il y a un événement au milieu du nôtre, aussi lumineux que cette comète de Halley que Jünger a contemplée à deux reprises (Sous le signe de Halley). Alors que l'état total de l'œuvre qu'il envisageait se réalisait, voici un "tournant imprévu, qui doit être compté parmi les événements les plus importants de l'histoire spirituelle allemande" (Blumenberg à nouveau) : Sur les falaises de marbre, le diamant précieux parmi les petites lames scintillantes de l'asphalte. Il est indispensable de s'y attarder. L'arrière-plan biographique du livre rend le tournant plus clair. Comme l'a dit Goebbels, ministre de la Propagande du Troisième Reich, "nous avons offert à Jünger des ponts d'or, mais il n'a pas voulu les franchir". L'intolérance de l'écrivain à l'égard des manières d'agir et de la vulgarité du parti national-socialiste lui vaut l'antipathie des hiérarques: la presse ne parle plus de ses livres et la Gestapo perquisitionne chez lui. Dans ce roman décisif pour sa vie, il décrit un pays - la Marina, où tous les éléments sociaux et politiques sont en harmonie - menacé par un peuple dangereux massé aux frontières, un peuple barbare, porteur de violence et de destruction, au style terrible et plébéien, dirigé par les Forestiers (une figure que beaucoup identifient à Hitler, d'autres à Staline).
Mais il y a un événement au milieu du nôtre, aussi lumineux que cette comète de Halley que Jünger a contemplée à deux reprises (Sous le signe de Halley). Alors que l'état total de l'œuvre qu'il envisageait se réalisait, voici un "tournant imprévu, qui doit être compté parmi les événements les plus importants de l'histoire spirituelle allemande" (Blumenberg à nouveau) : Sur les falaises de marbre, le diamant précieux parmi les petites lames scintillantes de l'asphalte. Il est indispensable de s'y attarder. L'arrière-plan biographique du livre rend le tournant plus clair. Comme l'a dit Goebbels, ministre de la Propagande du Troisième Reich, "nous avons offert à Jünger des ponts d'or, mais il n'a pas voulu les franchir". L'intolérance de l'écrivain à l'égard des manières d'agir et de la vulgarité du parti national-socialiste lui vaut l'antipathie des hiérarques: la presse ne parle plus de ses livres et la Gestapo perquisitionne chez lui. Dans ce roman décisif pour sa vie, il décrit un pays - la Marina, où tous les éléments sociaux et politiques sont en harmonie - menacé par un peuple dangereux massé aux frontières, un peuple barbare, porteur de violence et de destruction, au style terrible et plébéien, dirigé par les Forestiers (une figure que beaucoup identifient à Hitler, d'autres à Staline).
Le marginal de la forêt s'oppose à la civilisation, l'anarchie nihiliste aux forces de la Tradition. Les deux protagonistes, deux frères (allusion à l'auteur lui-même et à son frère Friedrich Georg), sont soutenus par quatre personnages: le père Lampros, derrière lequel on peut entrevoir l'Église, ou du moins la force spirituelle de la religion; Belovar, un brave vieux barbu représentant l'ancien monde rural; de noble lignée, d'autre part, le prince Sunmyra, dont la tête coupée après un exploit héroïque est récupérée par le protagoniste et devient l'objet de rituels; enfin, Braquemart, compagnon belliqueux du prince et effigie de l'intellectuel nihiliste noble, qui interprète la vie comme un mécanisme dont les rouages sont la violence et la terreur, un homme à "l'intelligence froide, déracinée et encline à l'utopie".

Les familiers de la littérature jüngerienne se souviennent des mots qui ouvrent Sur les falaises de marbre: "Vous connaissez tous la tristesse sauvage que suscite le souvenir d'un temps heureux: il est irrémédiablement passé, et nous sommes plus impitoyablement divisés par lui que par l'éloignement des lieux". La recherche de la belle mort dans la guerre laisse place à "la vie dans nos petites communautés, dans un foyer où règne la paix, au milieu de bonnes conversations, accueillies par un salut affectueux le matin et le soir". Ceux qui vivent l'existence comme une poésie n'ont d'autre choix que de chercher asile dans les manoirs de leur propre intériorité, en faisant confiance à la résistance du noble contre le néant, à la sublimation de tout dans le feu cathartique du miroir nigromontanien.
C'est Hitler qui a sauvé Jünger d'une mort certaine. Il a apprécié la plume qui a saisi la guerre qu'il avait faite, lui aussi. Il l'a aussi sauvé après le 20 juillet 1944, date de la fameuse tentative d'assassinat du Führer. S'il est vrai qu'aucune preuve n'a été trouvée d'une collaboration entre les poseurs de bombe et Jünger (qui était responsable du bureau de la censure à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale en tant qu'officier de l'état-major général), il est tout aussi vrai que les soupçons qui pesaient sur lui étaient plus que suffisants pour qu'il soit expulsé de l'armée pour Wehrunwürdigkeit (indignité militaire). Le temps du héros de guerre est définitivement révolu, celui du contemplateur solitaire commence.
Soumis à la censure pendant l'occupation alliée, sort qu'il partage avec ses amis Martin Heidegger et Carl Schmitt (qui fut, entre autres, le parrain du second fils d'Ernst, Alexander Jünger), il se retire dans le village de Wilflingen, d'abord dans le château des Stauffenberg (la famille de Claus Schenk von Stauffenberg, organisateur de l'attentat manqué contre Hitler), puis dans la maison du conservateur des eaux et forêts de la famille, bâtiment qui sera sa demeure jusqu'à sa mort. L'œuvre de ce grand écrivain allemand est vaste. Il fut le mémorialiste du 20ème siècle, l'interprète de son esprit. La constance avec laquelle il consignait faits et réflexions dans ses journaux est bien connue. Même dans son écriture, Ernst Jünger a fait preuve de courage : le journal est plus que toute autre forme stylistique par laquelle un penseur ou un écrivain se montre dans sa faiblesse intérieure d'homme, se soumettant à une dilapidation de la crédibilité ; le renoncement extrême à la plasticité de l'artiste en échange de l'authenticité de l'origine de sa pensée.
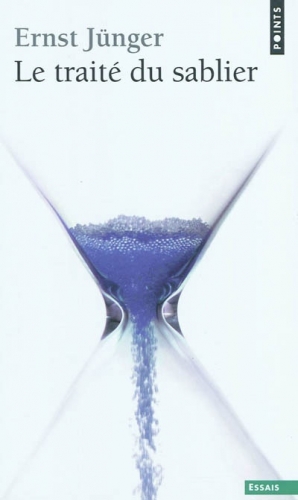

Les journaux intimes complètent les autres écrits, montrant que Jünger n'offrait pas des produits finis, mais indiquait des chemins. Il l'a fait dans toute la littérature qui a suivi Sur les falaises de marbre, d'Héliopolis à Eumeswil, du Traité du sablier au Mur du temps, du Nœud gordien (dialogue à deux voix avec Carl Schmitt) à Passage de la ligne (avec Martin Heidegger). C'est précisément dans ce dernier texte, composé de deux écrits qui rendent hommage au soixantième anniversaire de leur interlocuteur respectif, qu'a lieu l'affrontement sur le thème du nihilisme entre deux dioscures symboliques du crépuscule, vivants en une époque donnée, un duel où chacun, ça va sans dire, se complaît dans la maîtrise de l'autre. S'interroger sur le nihilisme, c'est, après la Seconde Guerre mondiale, chercher une réponse à la question : quelle poésie après Auschwitz?
Nous ne sommes pas d'accord avec l'évaluation qu'Evola fait du second Jünger. Ce n'était pas un "normalisé et rééduqué", comme le philosophe romain l'a marmonné lors d'une conversation avec Gianfranco de Turris, mais un penseur capable de réflexions profondes, d'analyses et de prédictions qui se sont révélées aussi justes que dérangeantes. Il est l'un des rares à avoir réussi à dévoiler, avec une tranquillité tourmentée, le vernis idéologique qui recouvre la réalité. Ici, les idéologies. Il ne les aimait pas, car "une erreur ne devient une faute que lorsqu'on persiste" (Sur les falaises de marbre) ; il rejetait tous les ismes, mais il revendiquait le droit de vivre la vie comme une expérience, et non comme un processus soumis à une logique contraignante. "Le suffixe isme a un sens restrictif : il valorise la volonté au détriment de la substance" (Eumeswil). Son écriture est "l'expression de ce qui est problématique, de l'ici et de l'ailleurs, du oui et du non", comme l'exprime Thomas Mann dans Considérations d'un apolitique. Ernst Jünger fut un maître inégalé de la contemplation, un mémorable exemple d'action, un théologien des temps nouveaux, un platonicien morose, un entomologiste compétent, un pédagogue de la liberté. Enfin, un amoureux de l'Italie, de la Dalmatie irrédente à la Sicile ensoleillée, de celle de Naples à la plus aimée de toutes, cette Sardaigne à la "terre rouge, âpre, virile, tissée d'un tapis d'étoiles, de tout temps fleurie à chaque printemps, berceau primordial". "Les îles, enseigne-t-il, sont des patries au sens le plus profond du terme, les derniers lieux terrestres avant l'envol vers le cosmos. Ce n'est pas le langage qui leur convient, mais plutôt le chant du destin qui se répercute sur la mer. Alors le marin laisse tomber la main de la barre ; on atterrit volontiers au hasard sur ces rivages" (Terra sarda). Et son œuvre fut un îlot de lumière loin de la bagarre littéraire du 20ème siècle, une oasis pour les esprits assoiffés de liberté.
22:50 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 mai 2023
Ernst Jünger et la créature des tranchées

Ernst Jünger et la créature des tranchées
Constantin von Hoffmeister
Source: https://eurosiberia.substack.com/p/ernst-junger-and-the-trench-creature?utm_source=post-email-title&publication_id=1305515&post_id=122083085&isFreemail=true&utm_medium=email
Alors que la folie de la Grande Guerre engloutit l'Europe, Ernst Jünger se retrouve dans les tranchées gorgées d'eau, l'odeur de la mort et de la boue se mêlant à l'air. C'est là, dans ces paysages cauchemardesques, qu'il affronte un adversaire d'origine nettement cosmique, une manifestation des horreurs indicibles de Lovecraft. Dans "L'appel de Cthulhu", Lovecraft écrit : "Nous vivons sur une île placide d'ignorance au milieu des mers noires de l'infini, et il n'était pas prévu que nous voyagions loin". Mais Jünger, en pleine bataille, était déjà à la dérive dans ces mers noires. "Nous venions de salles de cours, nous avions quitté nos bancs d'écoliers et nos établis d'usines et, au cours des brèves semaines d'entraînement, nous nous étions soudés en un groupe nombreux et enthousiaste", écrit-il dans Orages d'acier.

Une nuit glaciale, à la lueur fantomatique de la lune, il se retrouve engagé dans une lutte brutale avec un soldat français. Mais ce n'était pas un homme ordinaire. Au fur et à mesure que Jünger luttait contre son ennemi, le visage du soldat s'effaçait, révélant une créature qui faisait écho à l'effroi grotesque de l'Innsmouth de Lovecraft - un homme-grenouille, dont le corps était un mélange impie d'homme et d'amphibien, et dont les yeux ronds et globuleux scintillaient dans la faible luminosité. "Partout, la vie était vécue dans sa forme la plus extrême", se souvient Jünger.
Les mains de Jünger, enduites de la boue des tranchées et recouvertes des sécrétions gluantes de la bête, luttent pour maintenir leur prise autour de la gorge de la créature. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, la terreur de sa situation se disputant à l'adrénaline du combat. Il pouvait sentir le pouls frénétique de la créature sous ses doigts, ses tortillements désespérés, ses croassements gutturaux de détresse se répercutant dans l'étroitesse de la tranchée. "Ici, dans les tranchées, c'est le camp qui se rétablit le premier qui l'emporte", se dit Jünger.
Ses doigts se crispent, les muscles de ses bras se tendent sous l'effet de l'effort. Les yeux de la créature commencèrent à s'écarter encore plus grotesquement de son visage, et le bruit humide et écœurant qu'ils firent en sortant de leurs orbites résonna aux oreilles de Jünger. Un liquide visqueux, d'encre, se répandit, coulant sur le visage de la créature comme des larmes de goudron. "La mort avait montré son visage ; il n'y avait pas d'échappatoire, et le calme de la nuit renforçait l'horreur de notre situation".

L'homme-grenouille se débat, ses griffes agrippent les bras de Jünger dans une tentative futile de se libérer. Mais Jünger tient bon, sa détermination étant alimentée par l'abomination qu'est son adversaire. La créature perdait de sa vitalité, ses efforts ralentissaient, ses croassements s'estompaient, jusqu'à ce qu'enfin, dans un dernier frémissement, elle tomba mollement. "Ironiquement, c'est notre expérience commune d'une telle inhumanité qui nous a permis de rester sains d'esprit au milieu du chaos", commente Jünger.
Dans la foulée, le corps de l'homme-grenouille se décompose rapidement, se fondant dans la boue de la tranchée, comme si la terre elle-même cherchait à cacher les preuves de cette monstruosité cosmique. Le seul témoignage de cette effroyable bataille est la puanteur persistante de la décomposition et le souvenir indélébile gravé dans l'esprit de Jünger, un rappel sinistre des horreurs indicibles cachées dans le chaos de la guerre. Il confie dans Orages d'acier : "La guerre nous a appris la diversité de la mort".
Merci d'avoir lu Eurosiberia !
Abonnez-vous gratuitement pour recevoir les nouveaux articles et soutenir mon travail.
On retrouvera Constantin sur Twitter, Telegram et Substack. Songez à la suivre et à vous abonner !
Twitter: @constantinvonh
Telegram: https://t.me/eurosiberia1
Substack: https://eurosiberia.substack.com
Eurosiberia
19:15 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 14 mars 2023
La discordante concordance Jünger-Schmitt

La discordante concordance Jünger-Schmitt
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/la-discorde-concordia-junger-schmitt-giovanni-sessa/
La nouvelle version Adelphi du Nœud gordien
Un livre crucial et très actuel, Il nodo di Gordio (Le nœud gordien) d'Ernst Jünger et Carl Schmitt (pp. 238, euro 14.00), vient d'être réédité chez Adelphi, sous la houlette de Giovanni Gurisatti. Le livre réunit l'écrit de Jünger, publié pour la première fois en 1953, et la réponse du philosophe et juriste allemand, parue deux ans plus tard, en 1955. Le livre est donc un moment central de l'intense et longue conversation entre les deux penseurs. Le débat avait également un autre deutéragoniste, du moins en ce qui concerne le problème de la technique: Martin Heidegger. L'éditeur rappelle, à cet égard, que depuis la publication, dans les années 1930, du Travailleur de Jünger, Schmitt avait élaboré sa propre exégèse de la transformation de l'État libéral en un État "potentiellement total", se comparant, en "accord discordant", aux intuitions de Jünger. Ce dernier avait clairement indiqué que les changements introduits par la mobilisation totale poussaient à la constitution d'un espace mondial planétaire.
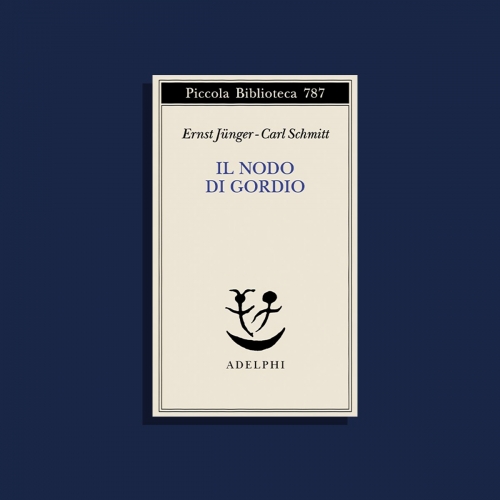
En arrière-plan, dans l'univers conceptuel de Jünger, l'idée de l'inévitabilité du Weltstaat, de l'État mondial, commençait à faire son chemin, puisque, explique Gurisatti: "C'est seulement en lui que se trouve l'unité de mesure d'une sécurité supérieure qui investit toutes les phases du travail en guerre et en paix" (p. 217). Le problème soulevé par Jünger était, à ce moment-là de l'histoire, au centre des réflexions de Schmitt. Schmitt lit l'État planétaire comme un organisme irrespectueux, note l'éditeur, "de la concrétude spatiale [...] l'ennemi principal du politique tout court" (p. 218). Un véritable destructeur des différences, du pluralisme et de la dimension polémologique qui caractérise le politique en tant que catégorie. En substance, le philosophe du droit juge la position de l'écrivain comme étant "naïvement dépolitisante" (p. 219). Au début des années 1940, Schmitt, s'opposant aux universalismes politiques du capitalisme occidental et du bolchevisme oriental réunis, s'est fait le porte-parole de la nécessité de défendre la substantialité politique de l'Europe, afin qu'elle devienne le propagateur d'un nouveau nomos de la terre, dans la contingence historique qui s'annonce avec la fin de la Seconde Guerre mondiale.
A l'unité mondiale, il commence à opposer l'idée d'un monde multipolaire, articulé dans une pluralité d'espaces concrets, chargés de sens, construits sur la tradition. Le nœud gordien, pour Schmitt, avait en son centre le binôme Europe-Allemagne (et continuait de l'avoir même après l'effondrement du Troisième Reich). Dans cette conjoncture, Jünger a également remis en question l'Europe. Le Vieux Continent devrait se refondre en termes d'unité géopolitique de multiples patries. Ce n'est qu'à cette condition que les Européens pourraient s'élever au rôle de garants des équilibres Est-Ouest. En tout état de cause, selon lui, l'État mondial restait le telos vers lequel tendait le destin de l'histoire. Cette thèse a été réitérée dans Über die Linie (= Passage de la ligne), qui a provoqué la réaction du juriste. De plus, Jünger interprétait la relation Est-Ouest de manière impolitique, la déroutant comme une polarité archétypale, élémentaire, marquant l'histoire et la conscience des individus ab initio. Ainsi, pour l'écrivain, ce n'est pas tant l'histoire et le politique qui comptent, mais la dimension destinale.
C'est là que réside la divergence la plus profonde entre les deux : Schmitt, contrairement à son ami, lit le nœud Est-Ouest en termes concrets, historico-dialectiques, comme l'opposition de la terre et de la mer. Cette dichotomie n'a rien à voir avec le "naturalisme" de Jünger. Pour Jünger, en effet, au pôle Est correspond le mythos. L'Orient est ainsi porteur de l'idée de la Terre-Mère, du destin et, dans la sphère politique, du prince-dieu. A l'inverse, l'Occident est éminemment ethos, liberté, histoire, prince-dieu. Hitler, dans cette perspective, était une figure marquée dans un sens "oriental". Pour Schmitt, du côté de la terre se tenait le monde continental, la Russie et l'Asie, du côté de la mer, au contraire, il plaçait l'Occident mercantile et libéral. Au milieu, entre les deux, se trouvait l'Europe. Au cours des siècles allant du XVIe au XIXe siècle, l'histoire européenne a oscillé entre deux configurations géopolitiques différentes : la première comprenait la France, l'Espagne et l'Allemagne "telluriques", la seconde était représentée par l'Angleterre, qui avait exprimé, de toute évidence, l'esprit maritime.
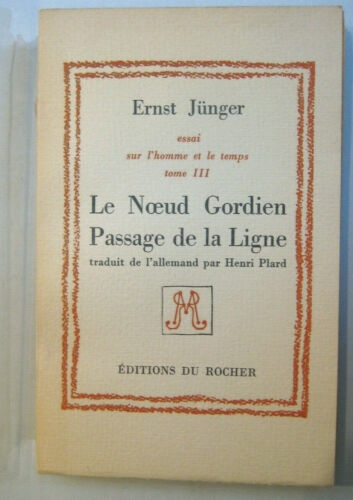
La Première Guerre mondiale a mis en échec le jus publicum europaeum. L'option entre les deux pôles constitue donc le véritable nœud gordien de la modernité. La terre est nomos, l'enracinement, les frontières et les traditions, la mer est techne, le déracinement errant. L'Europe est donc "prise entre le "foyer" et le "navire"" (p. 228). Trancher le nœud implique, aujourd'hui encore, de tenter de soumettre la techne, afin de réaffirmer le nomos : "La soumission de la techne déchaînée : ce serait [...] l'action d'un nouvel Hercule ! [...] le défi du présent" (p. 229).
Pour Jünger, seule l'éthique occidentale de la liberté aurait pu réussir une entreprise aussi titanesque. Le nœud, dans sa perspective, ne doit pas être tranché, mais dénoué par le "pacte" entre les prétendants. Au contraire, selon Schmitt, la solution se trouve dans l'affirmation historique de différents "grands espaces", capables de réaliser un équilibre géopolitique entre eux. Dans ce contexte, il assigne à l'Europe un rôle moteur, en s'appuyant sur l'émergence d'un patriotisme continental, centré sur la substance spirituelle des peuples qui l'habitent. Les positions des deux hommes sont discordantes car, malgré la référence au Weltstaat, l'écrivain allemand n'exclut pas la constitution de l'Europe en tant que patrie fondée sur un ethos : "En Europe, nous avons la capacité de respecter quelque chose qui se trouve en dehors de l'homme et qui détermine sa dignité" (p. 86), une sorte d'équivalent de la substance spirituelle dont Schmitt a parlé. Si cela est vrai, l'approche jüngerienne "archétypale" du problème montre son inadéquation en ayant dépolitisé le nœud, la relation Est-Ouest.
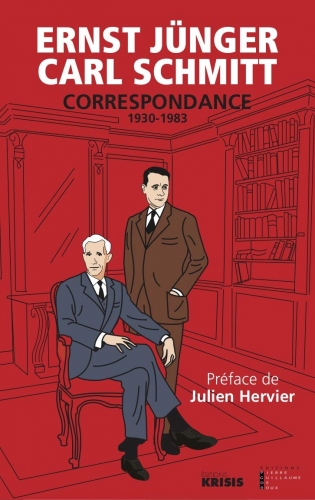
La situation actuelle le montre clairement : ce qui est en jeu pour nous, Européens, n'est pas seulement politique, mais historique. La prise en charge de la fonction de "grand espace" est la seule qui puisse garantir la survie du Vieux Continent. C'est seulement à cette condition, comme le souligne Gurisatti, qu'il sera encore possible de parler d'une Europe possible. La possibilité est le pouvoir, la récupération de la vocation politique et civile originelle de notre culture.
12:04 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, carl schmitt, allemagne, europe, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, théorie politique, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 15 septembre 2022
Syndrome du Titanic : Ernst Jünger et la culture de la panique

Syndrome du Titanic : Ernst Jünger et la culture de la panique
par Nicolas Bonnal
A la fois prophète olympien et descripteur de la débâcle, Jünger prévoit notre anéantissement économique et anthropologique. Dans Soixante-dix s’efface, alors qu’il raconte des petits voyages (Maroc, Canaries) souvent décevants, le maître soudain catastrophé écrit :
« Les autos ruinent les villes ; le séjour devient une « saison en enfer » - les bruits, les gaz d’échappement, les dangers de mort. Quand on ne se fait pas écraser, on dépérit lentement. Même les îles lointaines en sont inondées. Sur les plages, les hôtels poussent comme des champignons, non isolément, mais par chaînes entières. Ils sont identiques, jusqu’à leurs trous de serrure ; leur modèle se trouve quelque part à New York ou à Tokyo. On estime par conséquent que le nombre des voyageurs va constamment croître, et qu’il faut, dans cette perspective, engager de plus en plus de personnel. Dans les îles, l’eau va aussi se raréfier. Fièvre du boom commercial. Qu’arrivera-t-il en cas de restrictions, de crise économique, de guerre ? L’évolution est irréversible. Un hôtel vide se change bientôt en ruine ; d’un garçon de restaurant, on ne refera jamais un berger. Viennent alors des paysages spectraux (p. 534).»

L’effondrement qui nous arrive dans les années 2020, et qui est autant subi que provoqué via le Reset, devient chez Jünger un syndrome du Titanic. Vingt ans avant, dans son livre le plus important pour les survivalistes, le Traité du rebelle donc, Jünger écrit :
« La peur est l’un des symptômes de notre temps. Elle nous désarme d’autant plus qu’elle succède à une époque de grande liberté individuelle, où la misère même, telle que la décrit Dickens, par exemple, était presque oubliée. »
Jünger évoque justement le Titanic ; on se souvient du succès effarant de ce film répugnant. Il écrit donc :
« Comment ce passage s’est-il produit ? Si l’on voulait nommer l’instant fatal, aucun, sans doute, ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l’ombre s’y heurtent brutalement : l’hybris du progrès y rencontre la panique, le suprême confort se brise contre le néant, l’automatisme contre la catastrophe, qui prend l’aspect d’un accident de la circulation. »
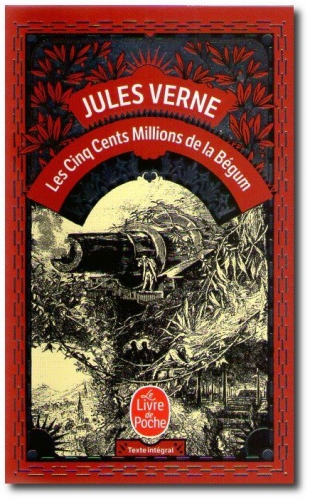
Jules Verne a bien montré que l’automatisme (la civilisation mécanique) croissait avec la peur. Voyez les 500 millions de la Bégum qui montre la montée du péril allemand sur fond de grosse industrialisation. Il y a une grosse promesse, raconte Jünger, mais elle croît avec un grand risque et une grosse trouille :
« Il est de fait que les progrès de l’automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés, en ce que l’homme, pour prix d’allègements techniques, limite sa capacité de décision. Il y gagne toutes sortes de commodités. Mais, en contrepartie, la perte de sa liberté ne peut que s’aggraver. La personne n’est plus dans la société comme un arbre dans la forêt ; elle ressemble au passager d’un navire rapide, qui porte le nom de Titanic, ou encore de Léviathan. Tant que le ciel demeure serein et la vue agréable, il ne remarque guère l’état de moindre liberté dans lequel il est tombé. Au contraire : l’optimisme éclate, la conscience d’une toute-puissance que procure la vitesse. Tout change lorsqu’on signale des îles qui crachent des flammes, ou des icebergs. Alors, ce n’est pas seulement la technique qui passe du confort à d’autres domaines : le manque de liberté se fait sentir, soit que triomphent les pouvoirs élémentaires, soit que des solitaires, ayant gardé leur force, exercent une autorité absolue. »
Jünger a vu le lien entre les mythes grecs et le progrès technique, comme Anouilh, Giraudoux, Domenach, Cocteau et quelques autres pendant et après la Guerre. Le Titanic n’est pas seul en cause. C’est aussi le syndrome du radeau de la méduse, épisode affreux de notre histoire et qui rappelle que la méduse nous transforme en pierres (en cœurs de pierre).
Jünger ajoute :
« Et nous finissons comme des bougies dans un tableau de Bosch :
On pourrait élever une objection : d’autres ères de crainte, de panique, d’Apocalypse ont suivi leur cours, sans que ce caractère d’automatisme vînt les renforcer, leur servir d’accompagnement.

Laissons ce point : car l’automatisme ne prend ce caractère terrifiant que s’il s’avère être l’une des formes, le style même de la fatalité, dont Jérôme Bosch donnait déjà une représentation incomparable. »
Mais Jünger souligne l’essentiel. Nous crevons de trouille et c’est la marque du monde moderne (la vie aurait dû rester un « risque à courir, pas un problème à résoudre », comme disait un Bernanos écœuré) :
« On constatera que presque tous, hommes ou femmes, sont en proie à une panique telle qu’on n’en avait plus vu dans nos contrées depuis le début du Moyen Age. On les verra se jeter avec une sorte de rage dans leur terreur, en exhiber sans pudeur ni retenue les symptômes. »
Umberto Eco dans un bel essai sur le moyen âge avait parlé du retour impromptu de ces grandes peurs. Flaubert avait déjà souligné dans sa correspondance la trouille liée à un simple épisode météo (voyez mon texte) ; et c’est aujourd’hui sur fond de paniques climatiques que nos élites et gouvernements veulent nous anéantir. On veut alors se cacher (collapsologues, catastrophistes, apocalyptiques, à vos bateaux, à votre or, à vos cavernes !) et Jünger ajoute presque humoristiquement :
« On assiste à des enchères où l’on dispute s’il vaut mieux fuir, se cacher ou recourir au suicide, et l’on voit des esprits qui, gardant encore toute leur liberté, cherchent déjà par quelles méthodes et quelles ruses ils achèteront la faveur de la crapule, quand elle aura pris le pouvoir. »
L’automatisme progresse évidemment avec la panique, et dans le pays qui reste le plus avancé, l’Amérique :
« La culture de panique va s’appesantir, là où l’automatisme gagne sans cesse du terrain et touche à ses formes parfaites, comme en Amérique. Elle y trouve son terrain d’élection ; elle se répand à travers des réseaux dont la promptitude rivalise avec celle de l’éclair. Le seul besoin de prendre les nouvelles plusieurs fois par jour est un signe d’angoisse ; l’imagination s’échauffe, et se paralyse de son accélération même. »
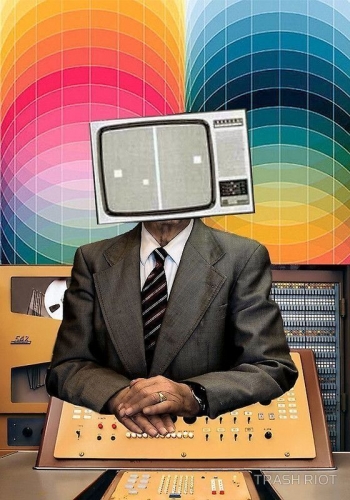
Jünger va même plus loin en dénonçant l'horreur télévisuelle qui crée péril russe, virus, Reset, dictature et pénurie (voyez mon texte "De Platon à Cnn"):
« Toutes ces antennes des villes géantes ressemblent à des cheveux qui se dressent sur une tête. Elles appellent des contacts démoniaques. »
Nous avons parlé du rôle narcotique de l’info dans un texte ici-même, en citant Platon, Théophraste, Fichte et Thoreau. Reprenons Thoreau :
« À peine un homme fait-il un somme d’une demi-heure après dîner, qu’en s’éveillant il dresse la tête et demande : « Quelles nouvelles ? » comme si le reste de l’humanité s’était tenu en faction près de lui. Il en est qui donnent l’ordre de les réveiller toutes les demi-heures, certes sans autre but ; sur quoi en guise de paiement ils racontent ce qu’ils ont rêvé. Après une nuit de sommeil, les nouvelles sont aussi indispensables que le premier déjeuner.
Dites-moi, je vous prie, qu’importe ce qui a pu encore arriver à quelqu’un, n’importe où sur ce globe ? »
Nous risquons toujours la guerre avec la Chine et la Russie, comme durant la Guerre Froide. Jünger remarque :
« Il est certain que l’Est n’échappe pas à la règle. L’Occident vit dans la peur de l’Est, et l’Est dans la peur de l’Occident. En tous les points du globe, on passe son existence dans l’attente d’horribles agressions. Nombreux sont ceux où la crainte de la guerre civile l’aggrave encore.
La machine politique, dans ses rouages élémentaires, n’est pas le seul objet de cette crainte. Il s’y joint d’innombrables angoisses. Elles provoquent cette incertitude qui met toute son espérance en la personne des médecins, des sauveurs, des thaumaturges. Signe avant-coureur du naufrage, plus lisible que tout danger matériel. »
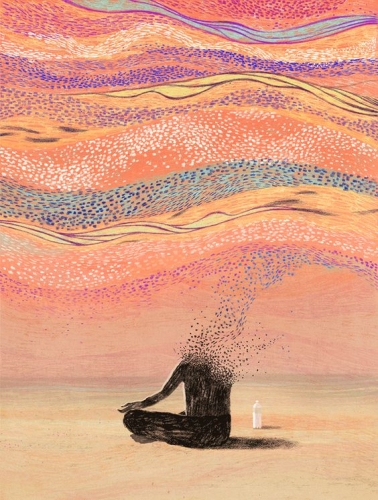
Ce naufrage n’est pas très prometteur d’autant que la solution semble impossible : on combat pour la forme le minotaure au milieu des zombis. Jünger envoie promener le yoga, pourtant recommandé avec la Kabbale dans Sex and the City :
« Mais notre temps exige autre chose que la fondation d’écoles de yoga. Tel est pourtant le but, non seulement de nombreuses sectes, mais d’un certain style de nihilisme chrétien, qui se rend la tâche trop facile. On ne peut se contenter de connaître à l’étage supérieur le vrai et le bon, tandis que dans les caves, on écorche vifs vos frères humains. »
Reconnaissons que nous avons progressé. On les écorche moins vifs, on les bourre vifs et on les sur-informe vifs. Mais passons. Jünger encore pour conclure (si c’est encore possible) :
« Car nous ne sommes pas impliqués dans notre seule débâcle nationale ; nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle, où l’on ne peut guère dire, et moins encore prophétiser, quels sont les vrais vainqueurs, et quels sont les vaincus. »
Ici il rejoint Mgr Gaume : pour ce dernier l’Apocalypse aurait lieu quand le monde serait unifié. Comme dira Guy Debord : « dans un monde unifié on ne peut s’exiler ». Les démons de Davos peuvent alors se rassembler comme à la fin du chant I de Milton et entamer l’œuvre de destruction et de dépeuplement.
Ernst Jünger défendait le recours aux forêts. Comme on sait aussi les montagnes-parcs nationaux sont bourrées de parkings payants et nous venons d’apprendre que dans les Pyrénées, la balade sera payante. On paiera un automate. Mais ne paniquons pas...
Sources:
Jünger – Traité du rebelle, le recours aux forêts – archive.org
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/06/27/de-platon-au...
https://lesakerfrancophone.fr/monseigneur-gaume-et-le-car...
https://www.dedefensa.org/article/flaubert-et-notre-abrut...
21:52 Publié dans Actualité, Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, nicolas bonnal, panique, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 septembre 2022
Ernst Jünger en tant que psychonaute
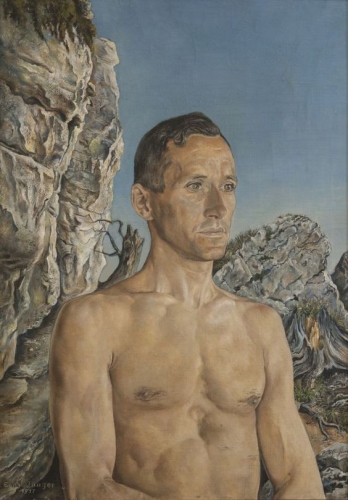
Ernst Jünger en tant que psychonaute
Par Fernando Trujillo
Quelle : https://guerradelasideas.blogspot.com/2022/06/junger-como-psiconauta.html?spref=tw
Des états de conscience altérés
Soldat, voyageur, intellectuel, homme d'action, mystique, la figure d'Ernst Jünger combine tant de nuances contradictoires qui font de lui l'un des hommes les plus intéressants de la littérature du 20ème siècle.
Dès son plus jeune âge, il a ressenti en lui un rejet de la vie bourgeoise, choisissant la voie de l'action, ce qui l'a conduit à s'engager dans la Légion étrangère, puis à faire son baptême du feu pendant la Première Guerre mondiale, une expérience qu'il a retranscrite dans des œuvres telles que Orages d'acier.
Cependant, des auteurs tels que José Luis Ontiveros et Armin Mohler ont parlé de sa facette de penseur, de guerrier et d'anarque, cependant, une facette presque totalement ignorée, à mon avis, est sa facette de psychonaute.
Le terme psychonaute signifie étymologiquement "navigateur de l'âme" et s'applique aux personnes qui, grâce à certaines drogues, peuvent entrer dans un état de perception où elles peuvent accéder à une gnose ou entrevoir les mystères de l'Univers dans lequel nous vivons. Il convient de préciser que le terme ne définit pas seulement un consommateur d'hallucinogènes, mais que ces états peuvent également être atteints par la solitude ou la méditation.
Avant de poursuivre, il convient de préciser que ce texte, ici, ne vise pas une apologie de la consommation de drogues ; la manière irresponsable dont la civilisation occidentale utilise les drogues comme moyen de "s'amuser" est une parodie de l'utilisation des drogues chez les Amérindiens et les sages orientaux. Jünger lui-même, dans ses Approches, affirme que la possession de drogues crée des formes d'esclavage et de servitude démoniaque dans lesquelles aucun geôlier n'est nécessaire et compare les trafiquants de drogues qui partagent gratuitement leur marchandise avec des adolescents à une version maléfique du joueur de flûte de Hamelin.
Cela montre clairement que, bien que Jünger ait été un consommateur de LSD et d'autres substances, il ne les utilisait pas pour "passer un bon moment", mais pour en ressentir les effets et les étudier en profondeur.
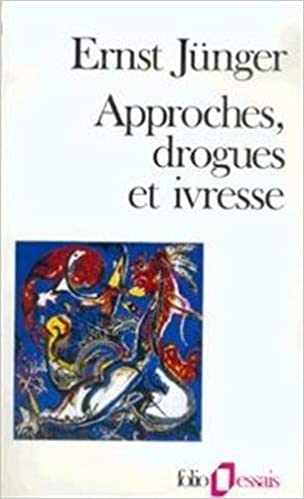 Dans son ouvrage Approches, drogues et ivresse, Junger se penche sur ses expériences avec différents types de drogues telles que le LSD, l'opium, la cocaïne, ainsi que sur les effets de l'ivresse tout en nous parlant des auteurs qui l'ont précédé sur cette voie tels que Poe, Baudelaire et Quincey et de la fascination que les stupéfiants ont exercée sur l'humanité. L'auteur écrit : Depuis les temps primordiaux, les chamans et les devins, les magiciens et les mystagogues connaissent l'étroite relation entre l'ivresse et l'extase. C'est pourquoi les drogues ont toujours joué un rôle dans leurs consécrations, initiations et mystères. C'est un véhicule d'ouverture parmi d'autres : comme la méditation, le jeûne, la danse, la musique, la contemplation égocentrique d'œuvres d'art ou d'émotions violentes. Son rôle ne doit donc pas être surestimé. En outre, elle ouvre également les portes sombres ; Hassan Ibn Al Sabbah avec ses assassins nous offre son exemple".
Dans son ouvrage Approches, drogues et ivresse, Junger se penche sur ses expériences avec différents types de drogues telles que le LSD, l'opium, la cocaïne, ainsi que sur les effets de l'ivresse tout en nous parlant des auteurs qui l'ont précédé sur cette voie tels que Poe, Baudelaire et Quincey et de la fascination que les stupéfiants ont exercée sur l'humanité. L'auteur écrit : Depuis les temps primordiaux, les chamans et les devins, les magiciens et les mystagogues connaissent l'étroite relation entre l'ivresse et l'extase. C'est pourquoi les drogues ont toujours joué un rôle dans leurs consécrations, initiations et mystères. C'est un véhicule d'ouverture parmi d'autres : comme la méditation, le jeûne, la danse, la musique, la contemplation égocentrique d'œuvres d'art ou d'émotions violentes. Son rôle ne doit donc pas être surestimé. En outre, elle ouvre également les portes sombres ; Hassan Ibn Al Sabbah avec ses assassins nous offre son exemple".
Dans ces mots, nous voyons comment Jünger donne à ces drogues un rôle de clés pour ce que Blake définirait comme les portes de la perception et comment diverses cultures anciennes les ont utilisées comme moyen de contacter leurs dieux et leurs esprits.
Tout au long de son ouvrage Approches, l'auteur fait l'expérience de ces états altérés, décrivant ses moments et les comparant à des expériences similaires vécues par d'autres auteurs. Ainsi, dans un chapitre, Jünger raconte ses expériences avec l'opium après son séjour dans la Première Guerre mondiale et fait référence à l'écrivain britannique Thomas de Quincey (illustration), avec lequel il établit des comparaisons dans ses expériences avec l'opium.

Après la défaite allemande, l'auteur raconte son retour chez lui, épuisé et blessé, et dans son introduction à la consommation d'opium, il nous montre l'état de l'Europe après la guerre.
Pendant la République de Weimar, le peuple allemand s'est adonné au nihilisme, à la toxicomanie, aux bordels, au matérialisme et à l'hédonisme. Une situation similaire s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, qui a tué tout vitalisme et tout romantisme, laissant un vide que la jeunesse a tenté de combler avec les drogues, la "révolution hippie" et le sexe libre.
Jünger n'était pas un décadent comme on pourrait le penser, mais un explorateur de ces états de conscience altérés. Pendant cette décadence de l'Allemagne, l'auteur faisait partie du mouvement dit de la "Révolution conservatrice", né pour contrer le libéralisme et le marxisme.
Son penchant pour l'opium durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quand il occupait un poste militaire dans la France de Vichy où il fréquentait les salons littéraires avec leurs fumeurs d'opium, rencontrant des artistes et des intellectuels tels que Jean Cocteau, Pablo Picasso et Henri de Montherlant.
La frontière est mince entre un décadent et un psychonaute, tout comme entre un toxicomane et un chaman indien, pour ne citer que ces exemples-là. L'exploration du cosmos par les drogues, l'atteinte de ces états altérés comme un but supérieur et non comme une fuite éphémère hors de la réalité. Jünger se situait quelque part entre les deux, entre un homme en quête d'évasion et un explorateur de la psyché, subissant une métamorphose qui le fit passé de l'escapiste potentiel au chaman contemporain.
LSD et autres hallucinogènes
En 1945, Jünger se lie d'amitié avec Albert Hoffman (photo, ci-dessous), le créateur du LSD, alors qu'ils avaient correspondu quelques années auparavant en raison de l'admiration que vouait Hoffman au travail de l'auteur. Jünger s'est intéressé à la relation pouvant exister entre la nouvelle drogue et la création artistique. À cette époque, l'auteur travaillait sur son roman dystopique Heliopolis, dont le protagoniste Antonio Peri est un expérimentateur de drogues que l'on pourrait qualifier de psychonaute littéraire.

Au printemps 1951, Jünger, avec Hoffman et le pharmacologue Heribert Konzett, a réalisé une expérience en prenant une petite dose de LSD qui, bien qu'elle n'ait pas eu les effets désirés, a ouvert à notre auteur les portes de la perception mystique.
"Ce n'est pas plus qu'un chat domestique comparé au vrai tigre, à la mescaline, ou tout au plus à un léopard", a affirmé Jünger après cette première expérience. Bien que cela ne soit pas suffisant, à d'autres moments, Jünger a réussi à franchir ces portes de la perception. Son initiation au LSD a eu lieu au moment où Huxley avait écrit le livre The Doors of Perception dans lequel il raconte l'utilisation du LSD à des fins mystiques.
Jünger a ensuite expérimenté les effets du peyotl, à base de champignons hallucinogènes, lors de son voyage au Mexique dans le cadre de son exploration du royaume des rêves.
La culture de la drogue compte de nombreux charlatans tels que Timothy Leary, un agent de la CIA que Hoffman a lui-même accusé de ne vouloir qu'attirer l'attention de la galerie sur sa propre personne, et Carlos Castañeda, soupçonné d'avoir inventé une grande partie de ce qui est exposé dans ses livres et qu'Alejandro Jodorowsky, un autre charlatan, qu'il a accusé d'être un opportuniste. L'intention de Jünger n'est pas de promouvoir une culture de la drogue au niveau des masses, des livres comme Approches ne doivent pas être considérés de cette façon.
Pour Jünger, ces drogues doivent être utilisées avec prudence et retenue, le psychonaute ne peut pas rester tout le temps dans cet espace intérieur, il doit sortir dans le monde sobre, banal et quotidien pour raconter ce qu'il a appris et ce qu'il a vu.
À cet égard, le point de vue de Jünger sur certains hallucinogènes est similaire à celui de l'anthropologue mexicain Fernando Benítez qui, dans son ouvrage En la tierra mágica del peyote, parle de l'utilisation cérémonielle du peyotl chez les Indiens Huichol dans le cadre d'un pèlerinage religieux annuel. Benítez établit une comparaison entre l'utilisation du peyotl par les Huichols pour des motifs sacrés et l'utilisation du LSD dans la civilisation occidentale, dépourvue de toute voie mystique et utilisée dans le but d'améliorer l'amusement et l'expérience sexuelle.


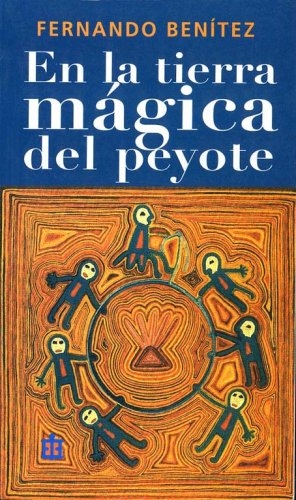
Pour Jünger, l'utilisation du LSD nous offre une possibilité de connaissance de soi, d'apprentissage de notre relation au soi et au monde dans lequel nous vivons. En ce sens, l'utilisation du LSD et d'autres hallucinogènes conduit à ces portes de la perception, à condition qu'ils soient utilisés avec parcimonie et à des fins dépassant le divertissement banal.
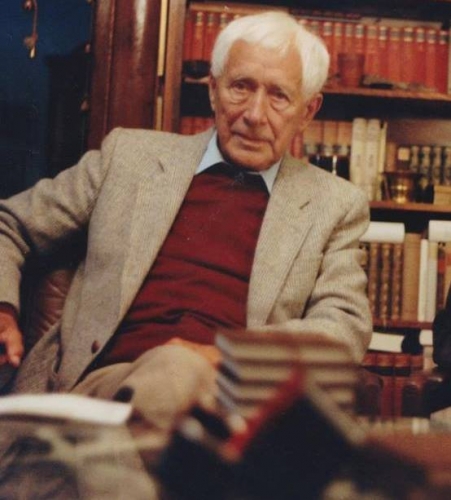
Ivresse
Jünger écrit : "le buveur ivre est souvent considéré avec bienveillance comme l'ennemi de l'ennui et du découragement. Un messager de Dionysos fait irruption pour ouvrir la porte du monde carnavalesque. Elle a même un effet contagieux sur les personnes sobres".
Jünger raconte dans Approches ses expériences avec le vin et la bière, depuis sa jeunesse jusqu'à ses expériences dans l'armée. Pour l'auteur, l'ivresse est une clé qui ouvre les portes de la perception, grâce à laquelle nous pouvons accéder ou voir la réalité d'une manière différente. Jünger raconte comment le vin et la bière ont fait partie de la culture européenne en tant que boissons sacrées.
Les peuples germaniques et leur relation à l'ivresse sont visibles dans la boisson mythique qu'est l'hydromel bu par les guerriers tombés au Valhalla, les banquets et les rituels sacrés tels que le Blot où la bière était consacrée pour leurs rituels. Wotan est un buveur d'hydromel modéré tandis que son fils Thor est un gros buveur, ce que raconte Jünger en montrant le caractère sacré de l'ivresse chez les Allemands.
Dans l'ivresse, la figure de Dionysos, le dieu grec du vin, est essentielle. Elle représente son pouvoir toxique, ses influences sociales et bénéfiques, et révèle les traits clairs et sombres de l'ivrogne. Dionysos est le libérateur, celui qui fait tomber les masques révélant les aspects sombres de la personnalité du buveur. Tout au long d'Approches, Jünger le mentionne souvent.
Mais Dionysos n'est pas seulement le dieu du vin, mais aussi du théâtre, de la joie de vivre, de l'extase, de la folie, des instincts sains et sombres de l'homme. Jünger était un homme dionysiaque, un homme qui a goûté aux excès de l'ivresse mais qui était aussi animé par le désir de vivre, de se battre.
Pour Jünger, la guerre est une expérience intérieure telle qu'il la définira dans Orages d'acier, ce coup porté au matérialisme et au conformisme de la paix bourgeoise, une notion dionysiaque qui rompt avec un ordre établi pour provoquer une régénération. Sans chaos, il ne peut y avoir d'ordre et vice versa. Jünger, Marinetti et D'Annunzio ont tous parlé de la guerre comme d'un fait indiscutable de l'histoire tout en considérant la paix comme une utopie.
Dionysos est le dieu des pulsions violentes, il est le chaos et l'ivresse apporte ce sentiment de rupture avec le monde et d'entrée dans un monde différent. Sur ce terrain, Dionysos est un dieu dangereux et à ne pas prendre à la légère, l'ivresse peut ouvrir les portes de la perception mais aussi détruire celui qui la porte en lui.
Dans l'ivresse, on peut percevoir les choses d'une manière différente de celle de la sobriété, mais cela peut aussi conduire à des moments de violence irrationnelle, réveillant les instincts les plus sombres du porteur et provoquant tout, des situations embarrassantes aux tragédies.
La venue de Dionysos et les effets de l'ivresse sur les individus et les peuples entraînent ce que Jünger définirait comme un Grand Passage (Übergang).

Que signifie "Grand Passage" ?
Jünger fait la distinction entre le Grand Passage et le Petit Passage, le premier étant une sortie de l'espace historique, un saut par-dessus le mur du temps ou une approche extrême. Les éphémérides historiques sont elles-mêmes de petits passages, tandis que la naissance et la mort d'une personne seraient un Grand Passage.
Un exemple donné par l'auteur d'un Grand Passage serait la musique de Wagner, l'opéra wagnérien est venu briser les schémas musicaux de son époque, pour créer une œuvre au-delà de l'histoire, les Grands Passages sont liés à la destruction des formes, les masses d'énergie qu'ils emmagasinent déclenchent choc et violence.
Ainsi, les deux guerres mondiales seraient des Grands Passages de l'histoire et Jünger fut le témoin des deux.
C'est là que l'ivresse prend son rôle, non seulement une simple ivresse due à l'alcool mais une ivresse pour la guerre, pour l'art, un excès de vie qui change constamment l'histoire.
Nous pouvons alors définir l'ivresse dans ce cadre comme étant le chaos, le changement constant et dionysiaque, par opposition à la sobriété du type passif, ordonné et apollinien. L'un est un destructeur de mondes et l'autre est la préservation d'un statut, tous deux complémentaires. Il ne peut y avoir de nouveau monde sans détruire l'ancien, tout comme il ne peut y avoir de chaos perpétuel. La sobriété a besoin de l'ivresse et vice versa comme une dualité de l'Univers.
Conclusion
Blake a dit dans ses Proverbes sur l'enfer que le chemin de l'excès mène au Palais de la sagesse. Comme nous l'avons vu, Jünger et les psychonautes ont parcouru ce chemin, certains ont survécu, d'autres sont morts jeunes et d'autres encore ont sombré dans la folie.
La leçon d'Approches, à la fin, est de fouler le chemin de l'excès, d'atteindre la sagesse et de vivre avec modération. Jünger a appris, après ses excès, à avoir de la retenue, à être capable de contrôler ses impulsions et à ne pas sombrer dans le vice.
Finalement, après avoir expérimenté tous ces excès, Jünger a choisi la voie de la sobriété, de la maîtrise de soi, il a eu ses excès dans sa jeunesse afin d'atteindre la vieillesse en homme sage. Ainsi, la jeunesse est faite pour les excès, pour apprendre et faire des erreurs, et la vieillesse est faite pour la sagesse et la contemplation.
Si un homme n'a jamais foulé le chemin de l'excès, comment peut-il voir la sagesse ? Il est nécessaire de traverser l'enfer pour aboutir au paradis, tout comme Dante dans sa Divine Comédie. Jünger a vécu jusqu'à l'âge avancé de 103 ans, a écrit de nombreux mémoires, romans et essais tout en regardant passer sous ses yeux l'ensemble du vingtième siècle, voyant se dérouler les petits et les grands passages, les captant dans ses livres.
Un homme qui a cherché la guerre et a survécu, qui a voyagé à la recherche de cette sagesse éternelle et a eu une vie des plus intéressantes.
Cette ivresse de vivre finalement, c'est ce qu'il a gardé tout au long de son existence dans ce monde, ce désir de savoir, d'expérimenter et d'écrire. Dans les drogues, on peut trouver ce chemin vers la sagesse, mais la modération et la préparation mentale sont indispensables pour ne pas vivre une expérience banale. Jünger l'a vécu et a vécu pour pouvoir raconter ce qu'il a découvert.
Notre monde moderne et technicisé manque d'une ivresse de vivre, de sortir des schémas, de quitter l'apathie et de marcher sur le chemin de la connaissance de soi et de la sagesse, nous péchons par trop de sobriété et nous écartons l'idée d'aventure.
La leçon de toute l'œuvre d'Ernst Jünger est l'ivresse de la vie, de quitter la vie bourgeoise et de pouvoir être aventureux, être un connaisseur, commettre des excès et chercher la voie de l'action dans ce monde étouffant et conformiste.
Avril 2016
Bibliographie:
1) Junger, Ernst, Approches, drogues et ivresse (1978). Enrique Ocaña (trans.) Tusquets. Barcelone (2000).
2) Auteur inconnu "Ernst Junger" (S.F) Cannabis Magazine [En ligne] Récupéré sur http://www.cannabismagazine.es/digital/ernst-juenger
3) Publié à l'origine dans l'anthologie Jünger : After War and Peace, quatrième volume de la collection Pensamientos y perspectivas de Editorial Eas https://editorialeas.com/producto/junger-tras-la-guerra-y-la-paz/.
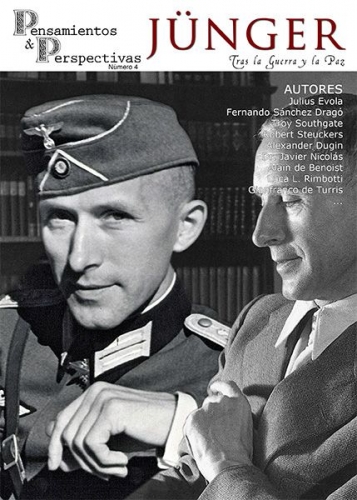
21:55 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : allemagne, ernst jünger, philosophie, drogues, lsd, révolution conservatrice, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 août 2022
Ernst Jünger et la technique

Ernst Jünger et la technique
"Ernst Jünger. Le visage de la technique" de Michele Iozzino analyse les réflexions de l'écrivain allemand sur les dynamiques qui sont en train de changer l'humanité
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/105696-ernst-junger-e-la-tecnica/
Ernst Jünger était, pour reprendre une expression que Giuseppe Prezzolini a inventée pour lui-même, un "fils du siècle", un fils du vingtième siècle. Il l'était, non seulement en termes d'âge, mais aussi en tant que sismographe attentif des bouleversements existentiels et spirituels de l'homme européen au siècle dernier. En particulier, son iter théorique complexe est profondément marqué par l'exégèse de la technologie. C'est un jeune universitaire, Michele Iozzino, qui le rappelle, avec un texte organique et persuasif, dans le volume Ernst Jünger. Il volto della tecnica, récemment mis en librairie grâce à la maison Altaforte Edizioni (pour toute commande : info@altafortedizioni.it, pp. 195, euro 15,00). Le livre est agrémenté de la préface de Luca Siniscalco, non seulement un exégète des textes jüngeriens, mais aussi un connaisseur attentif de la pensée allemande du vingtième siècle.
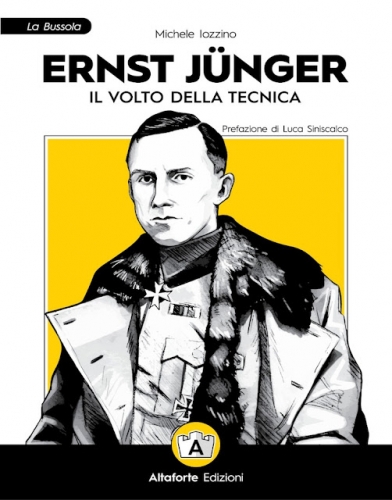
Il va sans dire que le penseur a eu sa première rencontre avec la technologie moderne dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les pages dramatiques et passionnantes de ses journaux de guerre en témoignent admirablement. Le thème de la mobilisation totale, caractéristique des modernes, a été pleinement saisi et présenté par Jünger dans Der Arbeiter, en 1932. Depuis lors, ce thème est réapparu plus d'une fois, dans les phases ultérieures de la production littéraire de cet Allemand hors du commun. Siniscalco note que l'intention d'Iozzino est de présenter "un recueil utile et complet des premières thèses de Jünger [...] en dialogue avec la phase plus mature de sa pensée et sa théorie de la subjectivité" (p. 10). L'auteur fait ressortir, dans ces pages, tant le moment déconstructif des thèses du penseur analysé que leur pars construens. En bref, chez le Travailleur, l'esprit de la technique se forge une seconde nature, qui lui permet de contrôler tous les aspects de l'appareil technique. Pour cette raison, la tâche primordiale de ce sujet de l'histoire est de "façonner" le monde. Son trait constitutif, la "magie" démiurgique.
Le long du parcours jüngerien, le Travailleur donnera naissance à d'autres "figures", modifications profondes de cette première incarnation d'une nouvelle typologie humaine, toujours, selon Iozzino, en continuité avec elle. Deux d'entre eux sont d'une importance absolue: le Rebelle, celui qui se retire dans les forêts, et l'Anarque, capable de pratiquer, face à l'irruption du pouvoir technique soutenu par l'appareil de l'État Léviathan, un apolitisme métaphysique en vertu de la liberté que garde et maintient son "cœur aventureux". Ces trois "figures" sont, de différentes manières, ancrées dans la dimension de l'élémentaire. Le primordial rend les références anthropologiques de l'écrivain totalement étrangères à l'individu de la société bourgeoise. Cet individu-là a fait taire en lui la voix de la physis, des puissances qui l'habitent. Son temps est une linéarité progressive, oublieuse du "destin stellaire", à la recherche duquel se déplacent les trois "figures" évoquées, qui ne peut être fondé que sur une récursivité cyclique. Le même, rappelle Siniscalco, que Jünger a vécu sur sa propre personne lorsqu'à Kuala Lampur, il a assisté, pour la deuxième fois de sa vie, au passage de la comète de Halley. Une temporalité qui préfigure un possible Nouveau Départ, sous le signe du mythe et de l'astrologie traditionnelle, à laquelle Jünger fait allusion de manière exemplaire dans les pages de Au mur du temps.
Après tout, comme le montre l'ensemble de sa production, l'Allemand voulait montrer à l'homme contemporain une issue au désastre de la modernité et le ramener à la dimension cosmique. L'expérience de la revue Antaios, visant à reproposer aux hommes la loyauté ancestrale à la Terre, doit également être lue dans ce sens. Seule la rencontre avec l'élémentaire est capable de faire ressortir en l'homme la dimension profonde, le Soi, le lien holistique avec le Tout. Chez l'Arbeiter, cette rencontre est induite par la mobilisation: la puissance de l'Implant, si elle est contrôlée par un type humain ouvert à la "transcendance immanente", à la destructivité nihiliste montrée sur les champs de bataille, peut se transformer en force plastique, en ouverture à la "forme": "étant donné que ce qui manque aujourd'hui "c'est précisément la forme" [...] c'est cette vraie grandeur qui ne s'obtient pas par l'effort, ni par la volonté de puissance" (p. 14). Cet aspect sera également propre au Rebelle et à l'Anarque, qui tenteront d'affirmer l'être dans le devenir.

Les trois figures jüngeriennes sont des compossibles, qui peuvent se manifester sous l'impulsion de tendances spirituelles données ou de différentes contingences historiques. Iozzino s'attarde, en développant une riche exégèse, sur le texte Maxima-minima, dans lequel le penseur affronte, trente ans plus tard, les thèses du Travailleur, en constatant comment son essence est réductible à la recherche d' "une autre puissance" (p. 15). Une puissance capable de réconcilier Prométhée avec Orphée, afin de limiter les excès d'imposition du premier envers le réel. À ce moment de l'histoire, il fallait trouver, dans la catastrophe apocalyptique conjuguée à l'utilisation prométhéenne de la technologie, une "force ordonnatrice" capable d'accorder les hommes et l'origine. Aujourd'hui, cette question a pris le trait de l'inéluctabilité. La technique a une nature ambiguë, d'une part elle se réfère à l'Indistinct, d'autre part elle peut conduire à l'Ineffable du Néo-Platonisme.
Il nous semble qu'une continuité entre les figures et les phases de l'écrivain, comme le note l'auteur, est évidente, par contre entre l'Arbeiter, le Rebelle et l'Anarque il y a aussi une différence substantielle. Les deuxième et troisième figures ont dilué, dans une sorte de philosophie de la conscience, la volonté d'action historico-politique qui a émergé des pages de l'Arbeiter. Cela s'est produit parce que la référence jüngerienne, plutôt que sur la "transcendance immanente", profitait maintenant d'une position "religieuse". Evola l'avait bien compris et, pour cette raison, il appréciait surtout le premier Jünger.
Giovanni Sessa
20:49 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature allemande, philosophie, lettres allemandes, lettres, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 juillet 2022
Les ciseaux de Jünger, un livre qui arrête le train en marche des faux dieux prométhéens
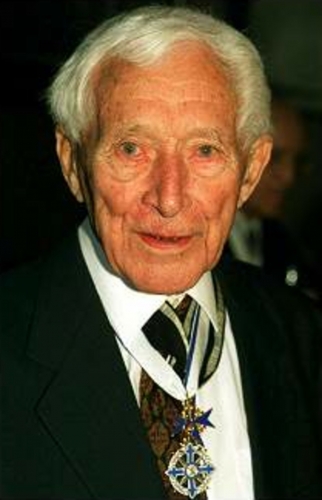
Les ciseaux de Jünger, un livre qui arrête le train en marche des faux dieux prométhéens
Par Francesco Marotta
Source: https://www.grece-it.com/2022/07/15/la-forbice-di-junger-ferma-il-treno-in-corsa-dei-falsi-dei-di-prometeo/?fbclid=IwAR0dfDlYMPbu-2QTPZCI83Ik201aXbUIrmcPZtTwBKD1fcx4y-5vYyDWD64
Les souvenirs s'effacent et réapparaissent souvent simultanément à la relecture. On ne sait pas pourquoi les lectures qui nous ont le plus impressionnés sont recouvertes de "ce voile fin tissé, en règle générale, par le temps qui passe". C'est le cas de la surprise d'un cadeau inattendu, "Les ciseaux" - Die Schere - d'Ernst Jünger, dans la réédition de Guanda Editore du 17 mars 2022, traduite par Alessandra Iadicicco et avec une stimulante postface de Quirino Principe.
Soudain, le temps semble faire un bond en arrière jusqu'à cette lointaine année 1996, lorsque j'ai lu le livre pour la première fois. Ce qui change, en revanche, c'est toute une perspective : l'imaginaire collectif est complètement bouleversé. Dans ces aphorismes de Jünger, il était facile de reconnaître l'essence d'une vision horizontale des choses. Le génie de Heidelberg les avait écrites à l'âge avancé de quatre-vingt-quinze ans à la fin des années 1980 et, dans cette nouvelle publication, plusieurs années après la publication de la première édition en Italie, il est encore plus facile de discerner toutes leurs gradations.
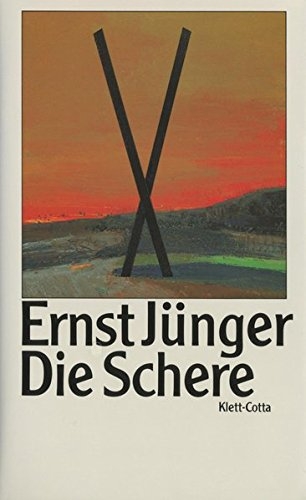
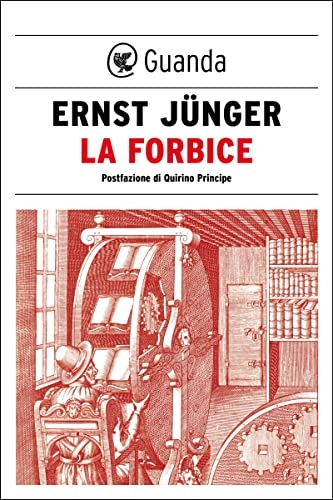
Quirino Principe met très bien en évidence le "Jünger attentif à la cosmologie cyclique de cette fin de siècle" et encore mieux lorsqu'il souligne ce qui pour Paolo Isotta aurait certainement pu être un tabou : "Le regard tardif de Jünger n'est pas chrétien". Il crée l'angle d'observation entre le païen Hölderlin et l'antichrétien Nietzsche, entre la gnose et l'Umwertung aller Werte - entre la gnose et la transvaluation de toutes les valeurs -, exigeant avec le plus grand respect des confirmations illustres et décoratives dans le panthéisme sceptique de Goethe et sa religio esthétique". Cependant, cette interminable recherche subtile (disquisizione) d'années sur le premier Jünger "païen" et le dernier Jünger, quelque part entre le polythéiste et le chrétien, laisse du temps au temps.
La prouesse de Jünger ne se comprend pas par la simple identification du finalisme chrétien, qui est maintenant clair pour tous. C'est plutôt dans le moment où il a pu traverser le temps d'une époque à l'autre, faire l'expérience de la véhémence née de la fin de la modernité, pénétrer les bruyères complexes du postmodernisme : sachant pertinemment que "le temps avancé sous l'influence de la fumée est volé aux dieux". La fumée dans les yeux de ceux qui refusent la rencontre avec eux-mêmes et sont habitués aux sauts temporels, suivant un procéduralisme grossier où "en principe il n'y a rien de prodigieux" mais une grande partie du drame de Faust. À cet égard, si l'on veut faire une comparaison, on pense au décor du train en fuite dans Snowpiercer, le film du réalisateur et scénographe sud-coréen Bong Joon-ho.
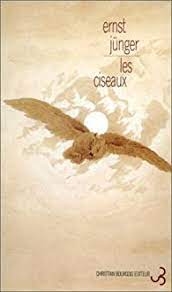 Qui, en 2013, a eu l'heureuse intuition de verser dans ce train brise-glace traversant le globe, une intrigue en partie seulement surréaliste, miroir de certaines prérogatives inavouables de la société actuelle. Attention à ne pas risquer une comparaison avec "Les ciseaux" de Jünger et avec le passage de l'observateur et du voyant au Selbstdenker, celui qui est un libre penseur et qui est capable de "penser par lui-même", le destin du Nostro était déjà accompli depuis longtemps. Cependant, le film rappelle fortement ces wagons de train, où la fiction et le jeu d'acteur pactisent avec la tangibilité pas du tout onirique des faits, où les misérables sont assis à l'arrière et les privilégiés sont en tête du train. La société de la forme capitale, le déploiement de la Technique et de la Science désengagées de l'égide de l'homme, l'annulation du paradigme classique, étaient pour Jünger, et seraient 23 ans plus tard dans la même mesure pour le réalisateur Bong Joon-ho, des notions déjà largement discutées.
Qui, en 2013, a eu l'heureuse intuition de verser dans ce train brise-glace traversant le globe, une intrigue en partie seulement surréaliste, miroir de certaines prérogatives inavouables de la société actuelle. Attention à ne pas risquer une comparaison avec "Les ciseaux" de Jünger et avec le passage de l'observateur et du voyant au Selbstdenker, celui qui est un libre penseur et qui est capable de "penser par lui-même", le destin du Nostro était déjà accompli depuis longtemps. Cependant, le film rappelle fortement ces wagons de train, où la fiction et le jeu d'acteur pactisent avec la tangibilité pas du tout onirique des faits, où les misérables sont assis à l'arrière et les privilégiés sont en tête du train. La société de la forme capitale, le déploiement de la Technique et de la Science désengagées de l'égide de l'homme, l'annulation du paradigme classique, étaient pour Jünger, et seraient 23 ans plus tard dans la même mesure pour le réalisateur Bong Joon-ho, des notions déjà largement discutées.

Mais Jünger avait déjà eu l'intuition de quelque chose en rapport avec la machination, le calcul, une idéologie et sa doctrine, indiquant l'exact opposé de ce qui pourrait lui être opposé. En cela, sa pensée n'est pas si différente de celle de Heidegger. Les questions que nous trouvons dans "La question de la technique", en particulier dans la réponse sur le dévoilement qui régit la technique moderne, étaient les mêmes pour les deux : "Le dévoilement qui régit la technique moderne, cependant, ne se déploie pas dans une pro-duction au sens de ποίησις. Le dévoilement qui prévaut dans la technologie moderne est une pro-vocation (Herausfordern) qui exige de la nature qu'elle fournisse de l'énergie qui peut en tant que telle être extraite (herausgefördert) et accumulée". Une énergie transformée en une autre forme : en un dispositif, une structure de réseau, un mécanisme, un protocole, un appareil et un système, d'un "pouvoir qui n'est ni humain ni non-humain". Ce totalitarisme qui montre le visage du spectacle dans le spectacle de la Technique en politique, remplacé par un appareil administratif et gestionnaire, dont le but ultime est la perpétuation de sa propre domination et de son autosatisfaction.
Le mérite de Bong Joon-ho est de mettre l'accent sur le protagoniste principal, Curtis, qui attend le moment opportun pour reprendre la tête du train, ainsi que toute la communauté des outsiders. Celle de Jünger, en revanche, est d'avoir compris à l'avance combien il est important de rétablir un ordre des choses, contre tout ce qui anéantit, désertifiant la volonté et l'esprit : l'écrasante démesure qui a supplanté la physis en dépassant toutes les limites, pour la raison que "la spirale appartient à l'espace, les ciseaux au temps". Le leitmotiv des "Ciseaux" de Jünger est l'homogénéisation qui n'épargne rien, plus cet étrange surréalisme qui voudrait faire passer le néo-alchimisme du "Progrès" et la nouvelle forme de prométhéisme pour irréversibles, alors que tout nous pousse à penser à une alternative.

En fait, "aujourd'hui, il semble plutôt que le progrès doive être arrêté", même si les gourous dévoués au technomorphisme bizarre disent le contraire. On ne peut que se demander si, "maintenant que les roues tournent à fond" et que le train de Snowpiercer roule à toute vitesse vers le désastre, il est encore possible de l'arrêter. Selon le testament de Curtis, celui que nous devrions tous avoir, le dernier arrêt est proche. Il est clair que pour Jünger, la pensée et l'écriture aidant, l'ensemble des choses ne représentait pas une descente en avant dans un ravin qui assimile une pandémie mondiale à une nouvelle guerre au cœur de l'Europe, sans parler de la restauration d'une mondialisation 2.0. En fin de compte, le fossé temporel entre le philosophe et le cinéaste est large.
Le génie de Heidelberg, contrairement au réalisateur Bong Joon-ho, nous invite à redécouvrir non pas l'âme et/ou le succès qui naît du complexe d'activités industrielles et techniques : le Sud-Coréen n'a pas échappé à l'attrait du gadget productiviste de la cinématographie scintillante. Pour Jünger, en revanche, l'esprit et l'enchantement du monde étaient de première importance, ce qui n'avait rien à voir avec l'abandon d'une Kultur sympathique aux forces vitales de la Terre et du Cosmos, en étroite relation les unes avec les autres. De nos jours, la ruée vers un film de science-fiction, post-apocalyptique, au box-office hollywoodien, importe peu.
Le désir d'oublier ce que signifie être dans le monde et faire partie d'une communauté a fait de l'homme un être voué au calcul, au profit, au seul intérêt de veiller à ses intérêts particuliers. Notre Seigneur connaissait bien les chimères des titans, générateurs de "figures devenues étrangères à la conscience historique", comme les alchimistes modernes, les inquisiteurs, les deamhains gaéliques ; donnons un nom à ces démons qui ont traversé les siècles et toutes les conceptions du "Sacré". Mettez-nous en garde contre la vénération de l'individualisme qui sévit partout, la spectacularisation des médias, le bureaucratisme et le technicisme qui sont descendus en politique : "de ces crétins qui osent se présenter", parce qu'ils sont "d'excellents spécialistes", on ne peut rien attendre de bon.
Une tyrannie du "bien" que Jünger, qui a vécu longtemps, décrit méticuleusement dans "Les ciseaux", obsédé par le désir de battre tous les records possibles. Penser, en outre, à parvenir même à vaincre la mort : une chose qui, pour nos prédécesseurs, était considérée comme inviolable, pour la raison que le temps n'était pas perçu de manière uniforme et linéaire comme il l'est devenu à notre époque. En ce sens, les paragraphes consacrés à la vie et à la mort, à la "technique capable de prolonger considérablement le temps nécessaire pour mourir", à une médecine qui se moque du serment d'Hippocrate, alors que tout autour "le nombre d'accidents mortels" ne cesse d'augmenter, y compris la menace de petites et grandes catastrophes. L'hyperbole descendante d'une société déjà en partie compromise dès 1901, au point d'amener Léon Bloy à écrire sa fameuse "Exégèse des lieux communs", s'indignant de ces rengaines hypocrites et faussement moralisatrices, de ces faux "principes" que l'on exhibe à toute occasion : "La bicyclette et l'automobile sont dépassées, car les principes sont encore plus rapides, et écrasent mieux, de façon plus satisfaisante, plus irrémédiable". Un hymne à la lâcheté conformiste qui ferait pâlir certains des "non-conformistes" d'aujourd'hui, si trompeurs.
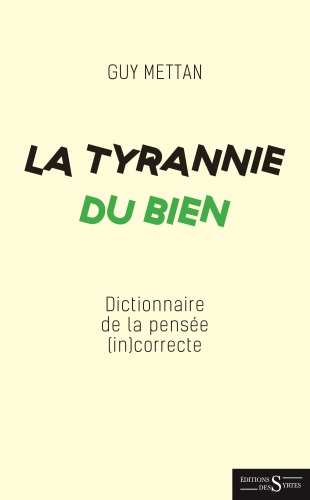
On ne peut s'empêcher de se rappeler ce que Guy Mettan, journaliste et historien genevois, a écrit dans son essai "La Tyrannie du Bien. Dictionnaire de la pensée (in)correcte" : "la recherche effrénée de la vertu est devenue une obsession universelle qui ne se limite pas aux cercles d'éveil et aux ONG moralistes". Après tout, elle est pratiquée dans ces salles de conseil feutrées, dans les bureaux à aire ouverte des managers, dans les antichambres inclusives des ministères, dans les salles de classe aseptisées des universités et sur les réseaux sociaux. Des lieux où la tyrannie du "Bien" décide, administre, gère, planifie et assiste : légiférer, confiner, condamner les idées non conformes, souvent bombarder et tuer. Du faux mythe de l'Empire, le "Bien" montre son visage, celui d'une des tyrannies les plus pernicieuses de l'histoire humaine.
La métaphore des "Ciseaux" conduit le lecteur vers la fin d'une société, en montrant tous ses dysfonctionnements. La forme chaotique, dédiée au catastrophisme qui ne contemple pas les autres êtres, les différences qui existent et les relations qui existent entre eux, croyant qu'il suffit d'universaliser ce qui convient grâce à la domination de la rationalité. Pointer du doigt quiconque ne pense pas de cette façon, comme un primate en voie de disparition, tendant à résoudre les problèmes depuis l'intérieur d'une bulle autoréférentielle, totalement incontrôlable et aléatoire, éloignant la vérité et la réalité. Ce qui en fait une exception, un mystère. Et c'est Jünger lui-même qui nous ouvre la voie, en traçant le seul chemin à suivre, qui est de combattre et de gagner la bataille des idées, contre l'indistinction et l'atomisation de nos peuples.
Ernst Jünger, La forbice, traduction par Alessandra Iadiccicco, postface par Quirino Principe, Gaunda Editore, 17/03/2022, pp. 204, euro 18.00.
18:37 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, livre, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mai 2022
Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur
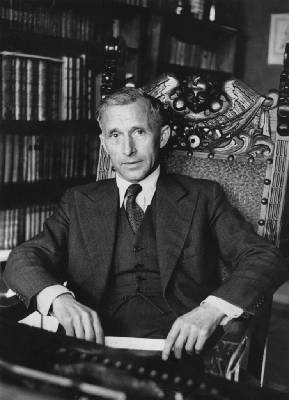
Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur
par Günter Maschke
Source: https://wir-selbst.com/2022/05/07/gun/
Le discours suivant a été écrit en 1982 à l'occasion de la remise du prix Goethe à Hilmar Hoffmann, un fonctionnaire de premier plan de la ville de Francfort-sur-le-Main, qui se consacrait à la culture et avait approuvé l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger et s'était ensuite vu confronté à de vives critiques de la part de ses amis au sein de son parti. Les chances, minimes dès le départ, que ce discours soit prononcé n'ont pas pu être exploitées. Si le ghost-writer de l'époque, Günter Maschke, l'avait prononcé de sa propre initiative, il aurait sans doute été plus clair en bien des points et aurait moins cherché à susciter la compréhension. Le lecteur d'aujourd'hui doit donc garder à l'esprit les circonstances ainsi que la vieille phrase de Georg Lukacs : "Un discours n'est pas une écriture". Cet hommage à Ernst Jünger a été publié pour la première fois sous la plume de Günter Maschke dans la très recommandable revue Etappe - Magazin für drakonisches Denken.
Günter Maschke
(* 15 janvier 1943 à Erfurt ; † 7 février 2022 à Francfort-sur-le-Main)
***
En décernant le prix Goethe à Ernst Jünger, la ville de Francfort rend hommage au dernier grand survivant de la génération de Gottfried Benn et Bertold Brecht, d'Alfred Döblin et Hans Henny Jahnn, de Heinrich et Thomas Mann. La vie littéraire et intellectuelle contemporaine n'est guère plus féconde, ni plus débordante de talents, pour que l'on puisse passer à côté de l'un des représentants les plus importants de l'époque héroïque de notre littérature sans lui rendre hommage. Cela vaut même si de nombreuses pensées de Jünger nous apparaissent désormais incompréhensibles ou nous semblent insupportables. Nous devrions nous rendre compte que le prétendu "précurseur du national-socialisme" et le "glorificateur de la guerre" est considéré sereinement comme le "plus grand écrivain allemand" de notre époque en France, un pays que nous avons attaquée deux fois - et les deux fois, le soldat Jünger était impliqué. In Stahlgewittern - aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers est paru en 1920, et depuis lors, Ernst Jünger est un auteur controversé, toujours contraint à la polémique et à la controverse.
"Il existe aujourd'hui peu de penseurs avec l'œuvre desquels on entretient pendant des années une relation qui alterne sans cesse entre l'approbation spontanée et le rejet déterminé... Nous avons besoin d'Ernst Jünger. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une erreur, si elle est compréhensible et honnêtement acquise à la vie, est plus à même de nous aider que la constatation d'une vérité à laquelle manque le pouvoir de conviction", écrivait Eugen Gottlob Winkler. "La querelle autour d'Ernst Jünger", tel pourrait être le titre d'une documentation à éditer en plusieurs volumes, et la protestation des Verts et du SPD contre l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger fait également partie de cette querelle. Alors que dans les années 1960, l'auteur semblait entrer dans un panthéon sans danger, cette querelle semblait toucher à sa fin, elle s'enflamme à nouveau aujourd'hui. Ces intervalles de plus d'un demi-siècle dans la querelle, me semblent être un indice certain du rang de cet homme.
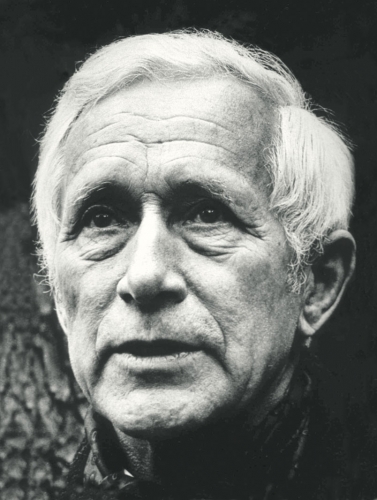
On peut objecter beaucoup de choses à Jünger, selon son point de vue idéologique, mais il me semble impossible de nier son importance comme essayiste et mémorialiste, comme descripteur et penseur de la nature, comme diagnostiqueur des guerres, des guerres civiles et du travail industriel. On peut douter que ses romans et ses récits aient une importance similaire. Un prix tel que le Goethe Preis ne peut être décerné qu'en raison d'une réalisation intellectuelle et/ou artistique. C'est précisément lorsqu'un auteur est à ce point controversé que la preuve de sa performance est apportée. Un lauréat qui satisferait tout le monde serait également celui dont le travail ne nous interpellerait en rien - il serait récompensé pour ses propos édifiants, généralement acceptés et généralement ennuyeux. Le prix Goethe n'aurait aucun sens s'il était l'hommage à une médiocrité qui ne passionne personne. Dans quelques réflexions intitulées Autor und Autorschaft, Jünger écrit en 1980: "Mon jugement ne doit pas se fonder sur le fait qu'un auteur pense différemment de moi - mais sur le fait qu'il pense même et peut-être mieux que moi. Je dois le placer dans son système. Mais je peux le rejeter. Encore une fois, cela n'exclut pas l'estime". Je pense que ces mots doivent nous servir de guide et je suis sûr que les membres du jury, qu'ils aient ou non le passage cité sous la main, pensaient de la même manière.
La vie intellectuelle en République fédérale souffre d'une crispation très idéologisée et policée. Ce que l'on dit et pense est en permanence interrogé: d'où cela vient-il? Puis vient régulièrement la question: où cela peut-il mener? Pour finir, nous entendons le jugement de condamnation déjà standardisé: c'est dangereux ! - ce qui revient à dire qu'une pensée inoffensive pourrait être intéressante. Vous avez le choix: la chute du monde libre ou l'esclavage impérialiste, la monotonie mortelle de l'égalité ou le retour des prédateurs (c'est-à-dire le "fascisme"), Vorkhuta ou Auschwitz. La question de savoir d'où l'on vient - par exemple de Marx (comme Lukacs, également lauréat du prix Goethe) ou de Nietzsche (comme Jünger, lui aussi lauréat du prix Goethe) - ne peut bien sûr pas être écartée et la question de savoir à quelles conséquences une pensée peut conduire (mieux encore: à quoi elle peut être utilisée) est non seulement permise, mais aussi utile. Cependant, il doit y avoir un espace au-delà de ces discussions, l'espace réel de la pensée et de la discussion. Et ici, la question est: qu'a-t-il remarqué? Qu'a-t-il vu? L'essentiel est ici, comme le dit très justement la justification du prix décerné à Jünger, dans "l'indépendance de la perception". Ce qui est décisif, c'est de savoir si nous apprenons quelque chose sur l'homme, si notre regard est aiguisé pour les domaines problématiques. Que signifie la Première Guerre mondiale en tant que première guerre des machines? Nous savons qu'il s'agissait d'une boucherie, et que l'officier de première ligne Jünger le sait aussi, c'est certain. Mais que révèlent ces paysages de feu et de sang? Et qu'est-ce qui s'exprime dans la technique industrielle moderne, qu'est-ce qui se cache derrière elle? C'est la question que pose Jünger dans Der Arbeiter. Il y a un domaine d'observation, de constatation des faits ou, en ce qui me concerne, d'affirmation des faits - et il y a un autre domaine où l'on essaie de tirer des conclusions et de trouver des instructions pour agir. Les deux domaines sont souvent difficiles à séparer, mais le lecteur, plus encore que l'auteur, doit toujours essayer de le faire. Si l'on nie l'existence d'un tel terrain neutre de la connaissance, du constat, de la constatation, alors on est également incapable de mener des discussions encore fructueuses par-delà les fronts idéologiques et politiques. Un tel boycott des discussions est régulièrement payé par une augmentation de la stupidité au sein de tous les partis: on ne peut même plus se mettre les arguments de l'adversaire dans sa propre poche. Karl Marx, par exemple, a critiqué le système industriel naissant avec les arguments des idéologues conservateurs semi-féodaux et il a critiqué leur glorification de l'époque préindustrielle avec les arguments des théoriciens enthousiastes du jeune capitalisme. Ce n'est là qu'un exemple. Comme pour tous les auteurs vraiment importants, l'œuvre de Jünger possède une force qui transcende les frontières et les camps, et on peut tout à fait identifier une gauche jüngerienne, comme Alfred Andersch. Il faut également se souvenir que deux des amis les plus proches de Jünger, qui l'ont accompagné toute sa vie, étaient presque homonymes Carlo Schmid et Carl Schmitt. Carlo Schmid, lui aussi lauréat du prix Goethe, l'un des pères de la Constitution de la deuxième République allemande, et Carl Schmitt, le critique sarcastique et incisif de Weimar, le pourfendeur implacable des illusions démocratiques, libérales et pacifistes, un homme dont les démocrates ont beaucoup à apprendre s'ils veulent se défendre. Cette amitié étroite avec deux hommes aussi opposés politiquement, qui travaillaient en outre dans le même domaine, en tant que penseurs de la politique, ne prouve pas que Jünger était un opportuniste à la langue de vipère, mais que des hommes d'esprit et d'horizons totalement différents trouvent notre lauréat stimulant et fructueux. Dans les années 1920, la vie littéraire berlinoise était polarisée par Bert Brecht et Ernst Jünger. Mais à l'époque, Brecht défendait toujours Jünger en disant : "Laissez le Jünger tranquille !".
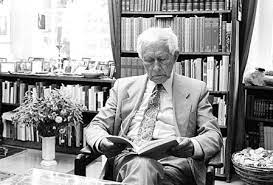
Le rang intellectuel d'une personne ne se prête donc que de manière limitée à l'excitation morale. Il ne s'agit pas d'un problème démocratique. Pour le dire en termes crus, Goethe n'était pas non plus un démocrate, ne serait-ce que parce qu'il s'intéressait avant tout au perfectionnement de sa propre personne. Les lauréats du prix Goethe, Georg Lukács et Arno Schmidt, ne l'étaient pas non plus. Georg Lukács a certes été l'un des plus grands critiques marxistes du stalinisme, mais il a aussi été longtemps stalinien, ou du moins son collaborateur pendant longtemps. Sa distance vis-à-vis du stalinisme a sans doute toujours été inférieure à celle d'Ernst Jünger vis-à-vis des nationaux-socialistes et c'est à Lukács que l'on doit, une fois qu'il n'y a plus eu de doute sur les crimes du stalinisme, cette phrase horrible dans ses implications : "Le pire des socialismes est toujours meilleur que le meilleur des capitalismes". Arno Schmidt, cependant, dont l'affront au jury du prix Goethe est encore frais dans les mémoires, s'est montré non démocrate d'une manière plus inoffensive, mais sans doute plus provocante: en proclamant la primauté de l'esthétique sur la morale, de l'artistique sur le social, et en mettant en avant le grand écrivain, d'une manière qui semble aujourd'hui audacieuse, sur les nombreux (trop nombreux ?) qui font le travail normal dans une société. La démocratie n'est qu'un principe d'organisation politique - mais la question de savoir si le principe démocratique doit s'appliquer à d'autres domaines de la pratique humaine doit être posée, en particulier aux démocrates.
Au cours de ses plus de soixante années d'écriture, Ernst Jünger a fait l'objet d'appréciations très diverses. L'auteur d'écrits tels que In Stahlgewittern, Der Kampf als inneres Erlebnis, Das Wäldchen 125 a été considéré comme un militariste, voire un va-t-en-guerre. L'auteur de Der Friede, écrit en 1941 et diffusé en copies à partir de 1943, était considéré comme un pacifiste. Après le livre Der Arbeiter (1932), Jünger apparaît comme un technocrate sans conscience. Avec Am Sarazenenturm (1959), avec ses innombrables essais sur les pierres, les papillons, la capture de coléoptères, l'horticulture ou avec ses œuvres allant dans le sens d'une philosophie de la nature comme Subtile Jagden (1967), enfin sa collaboration à la revue Scheidewege fondée par son frère défunt Friedrich Georg, il était considéré comme un écologiste. Le fait que Jünger soit un pionnier du mouvement vert peut être prouvé avec une extraordinaire facilité.
L'harmonie entre l'homme et le cosmos est un thème récurrent chez Jünger, au moins depuis le milieu de son œuvre. Son aversion pour toute science naturelle simplement quantifiante et pour la maîtrise de la nature est tout aussi constante. Le soldat nationaliste Jünger, qui - comme tout le monde doit l'admettre - a lutté à juste titre contre le traité de Versailles, semble être l'ennemi du bon Européen qui, en 1941, avec La Paix, fait ses adieux au nationalisme et appelle à la réconciliation, afin que les efforts et l'héroïsme de la guerre, ces "premières œuvres communes de l'humanité", ne soient pas vains; afin que la haine se transforme en solidarité. Enfin, il y a aussi "l'anarchiste conservateur", comme le politologue Hans-Peter Schwarz a appelé notre lauréat en 1962 dans un livre qu'il convient de lire (H.-P. Schwarz: Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jünger). Et c'est ce Jünger qui nous apprend non seulement comment se soustraire à un pouvoir totalitaire en "marchant dans les bois", en contournant, en esquivant et en sabotant, et comment préserver ainsi sa propre souveraineté, - c'est aussi le Jünger qui est en contact étroit avec des résistants comme Ernst Niekisch, Speidel et von Stülpnagel, et qui est renvoyé de l'armée de manière déshonorante après le 20 juillet 1944. Il ne fait guère de doute que Jünger s'en est sorti à l'époque parce qu'il était déjà devenu un mythe de la génération des combattants de la Première Guerre mondiale. Cet "anarchiste conservateur" qu'est Jünger est aussi celui qui a un organe réceptif pour les représentants de la sous-culture, pour les marginaux et les hippies, en général pour le déviant et son importance, voire sa nécessité. Les aspects souvent déroutants, voire contradictoires, de Jünger s'expliquent notamment par le fait que les décennies, avec leur lot d'expériences, travaillent sur les textes et en font ressortir sans cesse de nouvelles facettes. Mais en même temps, Jünger n'a cessé de se transformer et d'orienter son intérêt vers de nouvelles questions. Même parmi les auteurs les plus importants du siècle, il est l'un des rares à évoluer jusqu'à un âge avancé, une caractéristique qui rappelle Goethe. Le roman Eumeswil, paru en 1977, en est la preuve évidente. Il dépasse de loin, du moins en pensée, la plupart de la prose allemande des années 1970.
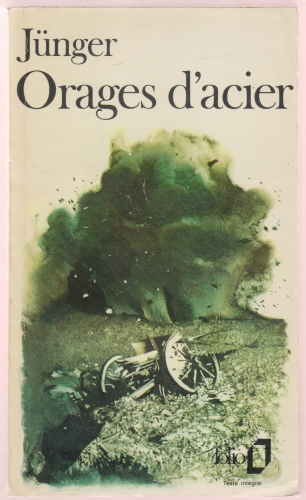
On entend souvent dire que Jünger a toujours été un porte-parole de l'esprit du temps. En réalité, c'est l'esprit du temps qui s'exprimait à travers lui, alors qu'il était également considéré comme intempestif. Les moments de son influence ont coïncidé avec les moments de conscience critique de l'histoire allemande. Hans-Peter Schwarz écrit à ce sujet: "En 1920 ... lorsque le lieutenant de la Reichswehr ... publia son journal de guerre In Stahlgewittern, il fut l'un des premiers à donner une forme littéraire complète à l'expérience de la guerre mondiale du combattant des tranchées. Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) procédait déjà à l'approfondissement du diagnostic de l'époque sur la rencontre avec la guerre. L'expérience marquante de Jünger - la bataille de matériel sur le front occidental - était aussi celle de nombreux membres de la génération de la guerre... Un avant-gardiste de l'âge de fer, un porte-parole de la jeunesse activiste, un représentant de la génération qui allait prendre le pouvoir - c'est ainsi qu'il était compris par un nombre sans cesse croissant de lecteurs fidèles...
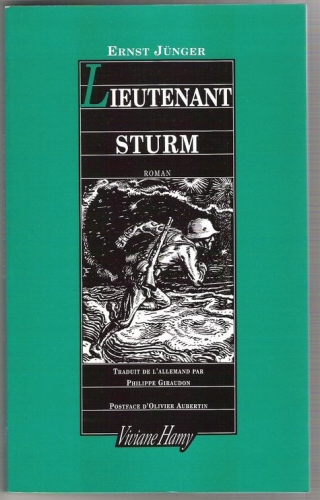
En 1932, la crise de l'Etat et de la société est entrée dans sa phase décisive, personne ne sait où l'on va; le besoin de faire des prévisions est d'autant plus vif. C'est à ce moment-là que parut Der Arbeiter. Il devint la sensation littéraire des mois d'octobre et de novembre 1932 et, comme certains s'en souviennent encore aujourd'hui, l'ouvrage décisif de l'année pour plus d'un. Il s'agissait d'un homme dont les propos, par la magie de son style, pouvaient être considérés comme crédibles et qui annonçait, sur un ton qui n'admettait aucune contradiction, la fin de l'ère bourgeoise libérale et l'avènement d'un État national, socialiste et impérialiste. Les courbes rouges de l'époque et de l'existence de l'auteur avaient convergé au cours de ces années.
1939 - l'année du début de la guerre - et 1942, celle de la plus grande extension de la sphère d'influence allemande, mais en même temps annonciatrice de la catastrophe qui se profilait déjà, ont à nouveau apporté deux livres qui ont rapidement gagné un grand nombre de lecteurs, en particulier auprès de la Wehrmacht: Sur les falaises de marbre et le journal de guerre Jardins et routes. Il trouva à nouveau le mot de l'heure ; mais cette fois-ci pour ceux qui recherchaient la possibilité d'une existence juste, décente et saine. En 1945, il publie Der Friede (La Paix), conçu en 1941, et en 1949 Strahlungen: ces deux ouvrages interviennent directement dans le débat sur l'attitude des Allemands vis-à-vis du Troisième Reich et sur les principes de la politique future. En l'étudiant a posteriori, on a l'impression que, pour certains, la confrontation avec leur destin personnel s'est faite quasiment en confrontation avec l'évolution intérieure de cet homme". - Cette longue citation donne une idée à la fois de l'étendue et de l'actualité sans cesse renouvelée de l'écriture de Jünger, comme nous l'avons déjà évoqué.
Considérons quelques-uns des écrits les plus importants d'Ernst Jünger, et en particulier ceux de ses débuts, dans lesquels on ne peut nier un barbarisme militariste, un romantisme sanguinaire dissuasif, voire un lansquenettisme malveillant - tout comme on ne peut nier la glorification critiquée de la guerre. "Le sang gicle dans les veines en étincelles divines, lorsque l'on s'élance au combat avec la conscience claire de sa propre audace. Sous le pas qui rythment l'assaut, toutes les valeurs du monde s'envolent comme des feuilles d'automne. Sur de tels sommets de la personnalité, on éprouve du respect pour soi-même... Certes, le combat est sanctifié par sa cause, mais plus encore, une cause est sanctifiée par le combat". On rencontre régulièrement ce genre de kitsch d'acier dans les premières œuvres, mais il reste périphérique. Néanmoins, l'indifférence totale à l'égard de toute problématique morale de la guerre fait peur. Mais cette indifférence a au moins un avantage: c'est grâce à elle - au-delà d'hystéries comme celle citée - que le regard froid de Jünger est possible, qui se pose sur la réalité de la bataille de matériel qui menace de dépasser l'homme en tant qu'homme et donc aussi en tant que héros.
Alors que d'autres chroniqueurs littéraires de la Première Guerre mondiale comme Erich Maria Remarque et Ludwig Renn, avec des romans comme A l'ouest rien de nouveau et Guerre, n'ont pas grand chose à nous dire de plus, même si leur récit et leur morale sont saisissants, si ce n'est que la guerre est quelque chose d'horrible, Jünger essaie de comprendre la loi de la guerre des machines, son sens métaphysique et se demande en outre comment les sociétés industrielles européennes évolueront après une telle guerre. Dans les batailles de matériel de la Somme, de Cambrai, des Flandres, une nouvelle époque naît et le monde de la sécularité bourgeoise s'enfonce. Et pourtant, cette guerre avait commencé de manière si romantique: "Nous avions quitté les amphithéâtres, les bancs de l'école et les établis et nous nous étions fondus en un grand corps enthousiaste pendant les courtes semaines de formation. Ayant grandi dans une ère de sécurité, nous ressentions tous la nostalgie de l'inhabituel, du grand danger. La guerre nous avait alors saisis comme une ivresse. Nous étions sortis sous une pluie de fleurs, dans une ambiance d'ivresse de roses et de sang".
Ce début est connu: la guerre a été accueillie avec soulagement dans toute l'Europe. Et bien que la réalité de la guerre décrite par Ernst Jünger, faite de boue, de jours de pilonnage et de combats épuisants, se soit ensuite imposée, nous nous heurtons à chaque page à cette question qui nous paraît aujourd'hui monstrueuse: l'homme a-t-il besoin de la guerre? La nostalgie de l'époque, bientôt si terriblement comblée, le beuverie au bistrot des années plus tard ne doivent-ils pas être compris comme la critique la plus acerbe et la plus désespérée de la paix et de la vie quotidienne, avec sa routine, ses chaînes forgées dans du papier de chancellerie, ses luttes dérisoires et pourtant si épuisantes pour l'influence et le prestige, ses préoccupations mornes entre la fiche de rappel, la facture d'électricité et la revendication juridique ? On ne peut comprendre ni ici ni plus tard la pensée de Jünger, qui n'est souvent qu'une pensée sous le coup d'affects violents, si l'on ne comprend pas la haine du monde de la rentabilité et de l'utilité bourgeoises et bureaucratiques, de l'angoissant "renoncement au monde", que Jünger fuit d'abord dans la guerre, puis dans la nature, enfin dans le mysticisme ou dans l'isolement stylé, souvent trop prétentieux. Il faut prendre en compte le sentiment de vie d'une grande partie de la génération soldatesque de 1914. Celui qui ne veut pas pardonner devrait au moins pouvoir comprendre.

La guerre est pour Jünger un événement élémentaire et l'élémentaire ne lui semble finalement pas touché par le fait de la bataille matérielle. Il assume une envie primitive de combattre et de tuer et les soldats qu'il décrit, assourdis par le tonnerre des machines de destruction, par le "mur de feu flamboyant, haut comme une tour ..., baptisé dans un brouillard rouge, dans la soif de sang, la rage et l'ivresse, vivent dans un monde qui, en tant que réalité extrême, semble aussi onirique que choquant. C'est là que s'enracine "l'esthétique de l'horreur" de Jünger (selon son interprète Karl-Heinz Bohrer dans le livre du même nom), avec des effets artistiques qui font de lui peut-être le seul surréaliste de la littérature allemande. Le moment dangereux que l'homme vit de manière aussi somnambule que tranchante et surlignée, et que Jünger a raconté et étudié comme aucun autre, confère à ces œuvres, souvent insupportables dans leur vision du monde, un rang artistique si élevé qu'elles doivent être considérées comme ses plus importantes. La bataille matérielle est exaltée métaphysiquement, considérée par Jünger comme "l'expression d'un élémentaire", comme "un jeu somptueux et sanglant", comme "le besoin du sang de fête, de joie et de célébration" et l'héroïsme, que l'on croyait perdu, devient possible d'une nouvelle manière grâce à la maîtrise parfaite de l'appareil technique de destruction. C'est dans la guerre, dans la proximité de la mort, que la vie s'exprime avec intensité, tandis qu'en même temps la guerre consume les hommes comme le matériau d'une grande idée. C'est la guerre qui crée un Homme Nouveau, une nouvelle aristocratie, celle des tranchées, qui doit remplacer l'élite bourgeoise et ses idéaux éclairés datant du temps des perruques, sa confiance joufflue dans le progrès, le développement et l'humanité, une élite bourgeoise qui se prolonge dans le personnel dirigeant du mouvement ouvrier devenu pacifiste et bourgeois. Une telle esthétisation de l'horreur est du pur nihilisme, mais elle s'enracine tout naturellement dans le sentiment de vie d'une génération qui ne peut plus croire aux idées générales, à la vérité et à la justice des Lumières bourgeoises et du socialisme. Seule la lutte en soi, le fait que l'on lutte et la manière dont on le fait, confère le rang.
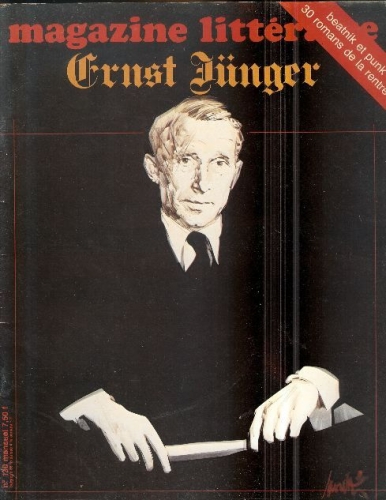
Avant de nous indigner, nous devrions nous pencher sur cette génération qui avait perdu toutes ses illusions, y compris celles que nous nourrissions déjà à nouveau, pour devenir la victime d'une nouvelle et plus terrible illusion, celle de la violence libératrice, purificatrice et fortifiante. De là, on peut tracer des lignes vers Georges Sorel et Benito Mussolini, vers Adolf Hitler comme vers Che Guevara et Frantz Fanon. Le sacrifice, la lutte, la souffrance, l'endurance ennoblissent une cause - mais une telle attitude semble être le dernier recours dans un monde désenchanté, banal, organisé, où la soif d'excitation la plus forte augmente de manière totalement inéluctable. Les œuvres du fasciste Pierre Drieu la Rochelle, du conservateur Henry de Montherlant, du socialiste André Malraux ou du sympathisant franquiste et hitlérien Wyndham Lewis montrent que cet enthousiasme a touché de nombreux hommes en Europe à cette époque. Ce sentiment de vie se retrouve au moins jusqu'à la fin de la guerre civile espagnole, à droite comme à gauche. La religion, la convention morale, le progrès, la réconciliation des peuples - ces idées sont devenues de vaines bulles d'air et la stabilisation du moi n'est plus possible que dans le groupe combattant, dans l'endurance fraternelle de monstrueuses épreuves, dans l'action concrète. L'idéologie, toujours défendue, devient alors périphérique. C'est dans l'action que les choses deviennent claires et exigeantes, que la décision est prise, que prend fin la discussion épuisante, le pour et le contre angoissant, le bavardage intellectuel où chaque argument trouve un contre-argument aussi évident que douteux.
Il faut comprendre la confusion, la profonde perplexité, l'ampleur du désenchantement de la génération de Jünger pour ainsi dire sur le plan de l'histoire culturelle: "Casca il mondo ! Le monde s'écroule !". Puis vint la mort avec la machine, dans laquelle la société européenne avait placé de tout autres espoirs, une société dans laquelle, du monarque au dernier chômeur, on avait cru que, peu à peu, l'humanité progressait quand même. De ce point de vue, la Première Guerre mondiale a été un événement bien plus important que la Seconde, qui n'en a été qu'une copie agrandie et déformée. Au-delà de toute idéologie qui nous fait peur, c'est Jünger qui a enregistré le plus laconiquement à l'époque, quasiment comme un graveur à la pointe sèche, ces bouleversements dans lesquels beaucoup ne trouvaient de soutien que dans une existence de soldat. Il était l'un des rares à trouver le courage de le faire ; après l'enthousiasme général, c'est un flot de paroles pacifistes confuses qui prévalait. On pourrait ici se placer sur le plan purement artistique et louer le niveau stylistique élevé de ces textes, à quelques dérapages près. Mais deux choses sont décisives. Premièrement, nous sommes ici conduits vers les abîmes de l'âme humaine (peu importe que Jünger le fasse avec presque autant d'enthousiasme), que nous ne pouvons pas nier, surtout si nous voulons la paix. Cette thèse selon laquelle il existe un besoin d'action guerrière et que ce besoin ne peut pas être expliqué comme le résultat d'intérêts économico-militaires et de manipulation - cette thèse ne mérite pas l'indignation, mais l'examen. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, les premiers écrits de Jünger soulèvent la question de savoir si la condition humaine n'est pas encore pire que ce que croit l'amoureux de la paix effrayé par la guerre. Deuxièmement, dans l'horreur de la première guerre industrielle, Jünger parvient à découvrir les structures et les forces motrices de la société industrielle "pacifique". Là encore, l'affirmation de la cause par l'auteur ne change rien à la force d'ouverture des phénomènes de travaux tels que le court essai de 1930 Die totale Mobilmachung. Bien sûr, entre les premiers écrits sur la guerre, la "Mobilisation totale" et le "Travailleur", il y a un livre comme Das abenteuerliche Herz (1929), dans lequel Jünger anticipe sa pensée de promeneur que l'on trouve dans ses derniers journaux et essais, notant sa pensée sur la nature, la société et le quotidien. L'attente au bureau de poste, le shopping, la contemplation des animaux et des plantes, les rêves, les descriptions oppressantes de machines de torture que nous ne connaissons que de Kafka - ce qui caractérise ce recueil, ce n'est pas seulement la certitude du caractère symbolique de tous les phénomènes, mais aussi la volonté de récupérer la réalité la plus fugitive au moyen des sens de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût. Dans la littérature allemande de notre siècle, seul Walter Benjamin y est peut-être parvenu de manière similaire. Un tel comportement esthétique, dans lequel le fragment de conscience et de perception devient en un éclair le miroir de l'époque, n'est possible qu'en des temps où le sol vacille, où, comme l'a dit un jour Jacob Burckhardt en 1876, en se référant davantage à la politique, "toute certitude a une fin".
Jünger a souvent dit de lui-même: "Après le tremblement de terre, on frappe sur les sismographes". Et si, pour beaucoup, cette expression traduit l'intention de minimiser son propre travail, elle rend compte en grande partie de la situation. Tous ceux qui ont contribué à détruire les illusions de l'optimisme du progrès au début de notre siècle ne pouvaient le faire sans sarcasme, voire avec une joie malveillante. Les opposants à l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger l'ont qualifié de chantre de la "mobilisation totale" avec une indignation vraiment infatigable. Mais le fait qu'Adolf Hitler aimait utiliser ce terme (c'est pourquoi Jünger l'évitait pendant le Troisième Reich) et que Jünger ne regrettait pas seulement la défaite allemande de 1918, mais espérait une revanche, n'est pas une raison pour nier la valeur diagnostique de cet essai. Il montre que les Etats à structure corporative ou féodale comme la Turquie ou la Russie n'étaient guère à la hauteur de la guerre et que l'Allemagne, qui présentait jusqu'à la fin de la guerre de fortes structures traditionnelles, a également perdu la partie pour cette raison. Les pays qui ont gagné la guerre sont ceux qui possédaient une classe dirigeante métropolitaine et technicisée et qui ont réussi - sur la base de l'égalité civique - à exploiter toutes les réserves de matériel et d'hommes. L'Allemagne n'a réussi qu'une mobilisation partielle et n'avait même pas d'idéologie unifiée. Désormais, tous les pays développés devaient, s'ils voulaient se maintenir dans le monde, orienter toute leur économie et leur technique vers la possibilité d'une guerre totale. Ils devraient aussi, pour assurer l'unité idéologique de la nation, se préoccuper de manipuler une opinion publique favorable aux objectifs du pouvoir. Rarement la tendance de la machine à faire la guerre et l'avenir de la propagande auront été vus avec autant d'acuité. Jünger voyait dans les chars, les canons, les sous-marins, les avions et les mitrailleuses des machines en réalité parfaites. Et comme Nietzsche avant lui, il était clair pour notre auteur que la technique et la science "voulaient" la destruction du monde, tout en croyant encore que la technique ouvrait de nouvelles possibilités d'héroïsme et donc d'humanité. Mais ce n'est que parce qu'il voyait dans les machines la volonté de destruction qu'il affirmait alors, qu'il a pu se lancer plus tard dans une critique aussi convaincante de l'ère technique. L'opposition entre "gauche" et "droite" n'était déjà plus pertinente pour Jünger. Il était convaincu qu'elle avait été dépassée par la bureaucratie et la technocratie qui se servaient alternativement des mots "gauche" et "droite" et des luttes correspondantes entre les camps pour contraindre l'individu à s'adapter. La lutte entre les camps n'était qu'un tour de vis ...
Le caractère inéluctable de ce monde, Jünger le voyait sans doute de la même manière que Max Weber, qui était certes trop prompt à croire que l'on pouvait être "humainement à la hauteur". Dans "La mobilisation totale", Jünger écrivait : "L'abstraction, donc aussi la cruauté de toutes les conditions humaines, augmente sans cesse. Le patriotisme est remplacé par un nouveau nationalisme fortement imprégné d'éléments de conscience. Dans le fascisme, dans le bolchevisme, dans l'américanisme, dans le sionisme, dans les mouvements des peuples de couleur, le progrès fait des avancées que l'on aurait crues impensables jusqu'ici ; il se précipite pour ainsi dire, pour continuer son mouvement sur un plan très simple, après un cercle de dialectique artificielle. Il commence à se soumettre les peuples dans des formules qui ne se distinguent déjà plus guère de celles d'un régime absolu, si l'on veut bien faire abstraction du degré bien moindre de liberté et de convivialité. En de nombreux endroits, le masque humanitaire est déjà tombé, mais un fétichisme mi-grotesque, mi-barbare de la machine, un culte naïf de la technique, apparaissent, précisément dans les lieux où l'on n'a pas de rapport direct, productif, avec les énergies dynamiques dont les canons à longue portée et les escadrons de combat armés de bombes ne sont que l'expression guerrière. En même temps, l'appréciation des masses augmente; le degré d'adhésion, le degré de publicité devient le facteur décisif de l'idée. En particulier, le socialisme et le nationalisme sont les deux grandes meules entre lesquelles le progrès écrase les restes de l'ancien monde et finalement lui-même.
Pendant plus d'un siècle, la "droite" et la "gauche" se sont renvoyé comme des balles les masses aveuglées par l'illusion optique du droit de vote; il semblait toujours y avoir chez l'un des adversaires un refuge contre les prétentions de l'autre. Aujourd'hui, dans tous les pays, le fait de leur identité se révèle de plus en plus clairement, et même le rêve de liberté s'évanouit comme sous la poigne de fer d'une pince. C'est un spectacle grandiose et terrible que de voir les mouvements des masses de plus en plus uniformément formées, auxquelles l'esprit du monde tend ses filets de pêche. Chacun de ces mouvements contribue à une capture plus aiguë et plus impitoyable; et il y a là des sortes de contraintes plus fortes que la torture: si fortes que l'homme les accueille avec jubilation. Derrière chaque issue dessinée avec les symboles du bonheur se cachent la douleur et la mort. Heureux celui qui entre dans ces espaces équipé".

"La mobilisation totale": c'était aussi la nouvelle annoncée de l'enterrement de l'individu, une évolution qui semblait totalement inéluctable à Jünger, et qu'il affirmait donc avec un pessimisme héroïque. Ce thème est développé plus en détail dans Le Travailleur. Le monde est entré dans l'ère du "grand aménagement de l'espace", où la rationalisation du travail devient parfaite; les moyens techniques déterminent de plus en plus l'homme sur le plan social, psychique et physique. Sous la dictée de la technique, la guerre et le travail industriel se ressemblent de plus en plus. Le soldat devient un technicien de l'extermination, le technicien "civil" agit dans le paysage planifié du nouvel État total comme un soldat de la production: "La tâche de la mobilisation totale est la transformation de la vie en énergie, telle qu'elle se manifeste dans l'économie, la technique et les transports dans le vrombissement des roues ou sur le champ de bataille comme feu et mouvement". Sausen, Blitz, Brausen, Fliegen, Schwirren, Donnern - nous trouvons une accumulation de tels mots dans le livre de Jünger, dans lequel une fascination pour la technique est clairement visible, comme elle l'est par exemple dans la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) à la même époque. Et pourtant, le fait d'être livré à l'appareil technique est très clair, même si Jünger le salue comme une fatalité à laquelle il faut adhérer. Le mythe de l'ouvrier, qui est le mythe d'une société planifiée et industrielle disciplinée, une sorte de bolchevisme sous des auspices nationalistes, ce mythe est pour Jünger lié à un système autoritaire qui abolit l'inefficacité et la convivialité de l'ère libérale. Les figures du Waldgänger et de l'Anarque qu'il dessinera plus tard, toutes deux ennemies de la technique, se réfèrent au "travailleur". Jünger est un homme des extrêmes et il voit les phénomènes de l'intérieur. C'est ce qui rend cette pensée séduisante, mais c'est aussi ce qui fait sa force : l'exagération qui amplifie les phénomènes en fait ressortir la tendance. Et la déclaration suivante s'applique également à Der Arbeiter: "Notre tâche ... consiste à voir, mais pas à faire de la publicité".
1933-1945. Il ne fait aucun doute que Jünger n'aimait pas la République de Weimar et qu'il espérait un autre système. Mais qui la défendait encore dans sa phase finale, qui l'aimait même? Avec ses chômeurs, son désespoir à peine imaginable aujourd'hui, sa large acceptation du Traité de Versailles, considéré à juste titre comme un diktat insupportable, son (auto-)humiliation nationale? Et: pour comprendre Jünger, il faut au moins considérer comme discutable la thèse selon laquelle, à partir de 1930, après la démission du gouvernement Hermann Müller, la question n'était plus: démocratie ou dictature? - mais seulement: quelle dictature et de qui? C'est un simple fait qu'une grande partie de la population, jusque dans l'électorat des partis démocratiques, n'était pas démocrate et que, si elle voulait le devenir, l'évolution de Weimar ne lui facilitait pas la tâche. The proof of the pudding is in the eating. La démocratie est quelque chose de difficile à faire et nous ne devons pas oublier que Reinhold Maier et Theodor Heuß ont voté en faveur des lois d'habilitation - alors qu'Ernst Jünger et Carl Schmitt n'ont pas eu cette chance...
Certes, il y avait une certaine proximité de Jünger avec le national-socialisme. Mais cette proximité était à l'époque aussi normale que compréhensible. Il suffit de penser à un Ernst Niekisch, dont la résistance, aujourd'hui louée, s'enracinait surtout dans l'opinion qu'Hitler n'était pas assez radical, qu'il était une marionnette de l'"Occident". Cette proximité n'est pas non plus disqualifiante en soi, comme le prouvent les hommes du 20 juillet, qu'il est impossible de maquiller en démocrates et qui ont opposé la résistance qui faisait généralement défaut aux démocrates convaincus. Sous le troisième Reich, Jünger s'est comporté de manière tout à fait irréprochable. Il a refusé d'être admis à l'Académie prussienne de littérature, il a interdit aux journaux nationaux-socialistes de publier ses œuvres, il a immédiatement refusé un mandat au Reichstag qui lui avait été proposé par la NSDAP, il a écrit Auf den Marmorklippen (Sur les falaises de marbre), une œuvre qui a été lue par beaucoup comme une attaque téméraire contre le régime hitlérien, il a fait preuve d'une rare solidarité avec les persécutés (par exemple avec Niekisch), il entretient des contacts étroits et amicaux avec Speidel et von Stülpnagel, il confie à son journal des commentaires sur la situation qui étaient plus que dangereux, si l'on considère que les perquisitions de la Gestapo chez lui ne comptaient pas parmi les raretés. Nous avons déjà évoqué sa démobilisation après le 20 juillet 1944. Si l'on lit dans les Strahlungen les passages concernant Hitler et Goebbels, il est impossible de considérer cet homme comme un ami des nationaux-socialistes. Gärten und Straße, paru en 1942, a été indexé parce que Jünger note le 29 mars 1940 : "Ensuite, je me suis habillé et j'ai lu le psaume 73 à la fenêtre ouverte".
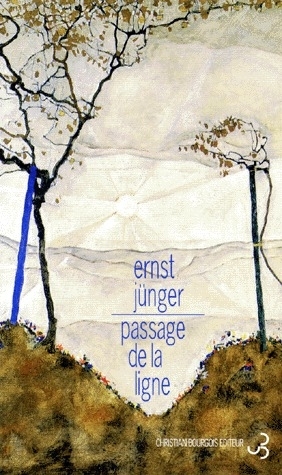
Les possibilités de résistance d'un capitaine, qui avait en outre l'intelligence de voir en Hitler l'homme providentiel, étaient modestes. Jünger n'a même pas été en mesure de résoudre le problème central: "Comment puis-je entrer dans le cercle d'exclusion 1 avec la bombe?" - On lui a reproché, à partir de ses écrits Le travailleur et La mobilisation totale, de défendre l'idéologie de l'État total et on a ensuite construit, notamment dans le document de protestation des Verts, une ligne Jünger-Hitler. L'"État total", que Jünger a parfois voulu, était pourtant le concept opposé à celui d'Hitler. Il voulait dire la dictature de la Reichswehr contre la combinaison négative NSDAP/KPD, telle que l'ancien chancelier Kurt von Schleicher, assassiné par les nazis en 1934, l'avait imaginée dans son idée de "front transversal" incluant les syndicats. Le NSDAP ne voulait pas d'un "Etat total" - il voulait une communauté populaire volontaire, car l'Etat total exprimait à la fois la contrainte, qui n'était plus nécessaire entre les heureux membres du peuple, et le caractère légal de la forme politique souhaitée. La polémique contre l'"État total" est presque la caractéristique unificatrice de toutes les théories nationales-socialistes. Il est tout aussi absurde de reprocher à Jünger de constater la tendance à une "caractérologie mathématique et scientifique", par exemple "sur une recherche raciale qui s'étend jusqu'au comptage des globules sanguins". Sa conclusion selon laquelle "ce n'est qu'avec l'apparition de ces phénomènes ... que l'art d'État et la domination à grande échelle, c'est-à-dire la domination mondiale, seront possibles", est tout à fait plausible ; de même que le fait que Jünger constate ici aussi la "renumérotation du monde". Et lorsqu'il écrit en 1920: "L'intégration de tous les Allemands dans le grand peuple de cent millions de personnes de l'avenir, voilà le but pour lequel il vaut bien la peine de mourir et d'écraser toute résistance", ce sont les mots d'un nationaliste déçu, dont la nostalgie est compréhensible même aujourd'hui...
Il est indéniable que Jünger a tenu quelques propos antisémites. Mais avant 1933, de telles prises de position étaient très répandues et les Juifs étaient considérés comme des représentants de la modernité et de l'abstraction, des partisans du système de Weimar en faillite, des organisateurs d'une industrie culturelle décadente. Il faut toujours tenir compte du contexte de telles déclarations, il faut distinguer si elles veulent quelque chose ou si elles ne font que constater quelque chose et il faut enfin accorder ceci ou cela à un homme qui n'a pas seulement écrit quelques livres importants, mais qui a fait preuve de courage, de courage civique et de galanterie à d'innombrables reprises. On ne peut pas non plus attendre d'un homme qui a grandi dans la tradition militaire de l'Empire qu'il devienne un libéral-démocrate enthousiaste. De plus, la critique de la démocratie n'est pas forcément fausse, la sociologie politique en fournit suffisamment de preuves, il suffit de penser à Michels, Pareto, Sorel, Mosca, Ostrogorski et même Schumpeter.
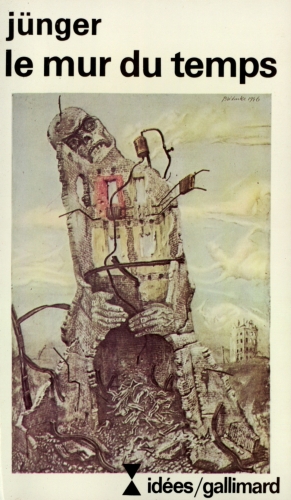
Dans le cadre de cet article, il n'est pas possible d'aborder de nombreux écrits, comme la magnifique étude An der Zeitmauer (1959), dans laquelle Jünger éclaire les raisons de la fascination pour l'astrologie, ou l'essai Der gordische Knoten (1953), dans lequel il retrace les racines historiques du conflit Est-Ouest. Il faut également passer sous silence son activité d'éditeur de la revue Antaios (en collaboration avec Mircea Eliade), son œuvre narrative, ainsi que ses derniers carnets de voyage Soixante-dix s'effacent. "Là où l'on met la main, c'est intéressant", disait Goethe à propos de la vie. C'est aussi une maxime de Jünger, dont l'universalité des intérêts rappelle autant Goethe que son talent pour l'aventure de l'étonnement. Certes, tous les écrits du lauréat ne sont pas réussis, et il va de soi que beaucoup d'entre nous n'aiment pas son message, ou du moins pas toujours. Mais qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'œuvre d'un grand passeur de frontière entre la poésie, la contemplation et la science, d'un homme avec lequel il vaut toujours la peine de se confronter - même si ce n'est pas de la manière la plus insipide des protestataires contre l'attribution du prix? Avec le Waldgänger dans Der Waldgang (1951) et avec l'Anarchen dans Eumeswil (1977), Jünger nous a esquissé deux types de résistance à la domination. Certes, le Waldgänger qui attend, se tient prêt, frappe de temps en temps, et dont les moyens de lutte sont avant tout le sabotage et le refus, n'est pas quelqu'un qui se jette dans la gueule du loup du pouvoir en place. Mais ce n'est pas le sens de la résistance. Mais il nous est donné ici une suggestion décisive sur la manière dont un système totalitaire pourrait peut-être être contraint de battre en retraite. Certaines phrases de ce travail font l'effet d'une illustration de ce qui se passe aujourd'hui en Pologne et la quintessence de Jünger est donc la suivante: "Là où un peuple se prépare à marcher dans la forêt, il doit devenir une puissance redoutable". La marche en forêt n'est ni plus ni moins qu'une théorie sur l'érosion de l'appareil de domination par les réactions imprévisibles de nombreux individus déterminés. A l'opposé, l'"anarque" (qui ne veut pas, comme l'anarchiste, abolir la domination, car celle qui est combattue à chaque fois ne serait que remplacée par une autre) est une figure plus désespérée. L'anarque comprend que sa résistance est sans espoir et ne se préoccupe que de sa propre liberté de mouvement et de pensée. Il se bat égoïstement pour sa liberté: contre ses parents, contre la "société", contre l'opinion publique, contre les "idées", contre son propre confort. Ce sont deux modèles de liberté qui sont presque toujours négligés dans les discussions sur le grand sujet. On peut reprocher à ces approches de se concentrer trop fortement sur la fuite, l'évitement, la survie. Il n'y a pas ici de guerre d'agression fraîche et joyeuse contre la très grande et la très authentique liberté, mais le "manque d'optimisme" n'est guère un reproche au vu des expériences de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, en particulier dans les sociétés où la domination des hommes est organisée par des moyens psychiques et intellectuels plutôt que par l'usage classique de la force, la capacité de résistance individuelle et consciente de l'individu est plus nécessaire que celle des groupes sociaux qui, la plupart du temps, ne veulent que participer à l'oppression subtile et lutter pour leur quota légal de possession du pouvoir. C'est parce que Jünger, à ses débuts, a saisi de manière radicale la menace qui pèse sur la liberté individuelle, que le dernier Jünger a pu devenir un partisan de cette liberté. Il est impossible de voir en lui un agent de l'absence de liberté organisée ; nous pouvons encore lire le premier comme un diagnostic, même si nous rejetons ses conséquences - les conseils du dernier peuvent nous être utiles. Dans un écrit comme La Paix - que Rommel a salué comme le fondement éthique de la résistance - Jünger montre un net éloignement de son militarisme antérieur et nomme très clairement les "meurtres sacrilèges" dans les camps de concentration. Les grands efforts de la guerre, avec leurs sacrifices et leur héroïsme, sont pour lui "la semence" d'où doit germer le fruit: la paix. "On peut bien dire que cette guerre a été la première œuvre générale de l'humanité. La paix qui la termine doit être la seconde". Peut-être que seul un vieux soldat comme Jünger pouvait dire le 24 juin 1979 devant les anciens combattants allemands et français à Verdun: "Ne devrions-nous pas, désormais à l'échelle de la planète, commencer tout de suite là où tant de détours de tant de victimes nous ont conduits ?"
Chaque nouvelle lecture prouve à quel point l'œuvre de cet aventurier intellectuel et pisteur est riche en facettes, complexe et même contradictoire. Nul doute qu'il s'agit là d'une œuvre majeure et durable, d'un homme qui a franchi bien des frontières, qui a célébré le pouvoir et qui lui a résisté, qui a exalté la voix du sang et qui, sans doute pour cela, a redécouvert le geste de la fraternité, ce geste si simple et si lourd ; d'un homme qui a souvent été un sismographe et souvent un oiseau d'orage ; d'un homme, enfin, dans l'œuvre duquel se reflètent la tension, le tourment, le cœur des conflits de l'époque qui déchirent les individus. Ernst Jünger est un lauréat digne de ce nom.
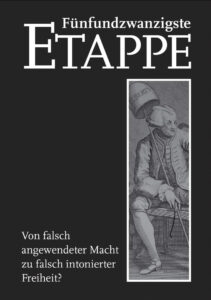
25. Etappe
L'article de Günter Maschke est d'abord paru dans: Fünfundzwanzigste Etappe, mai 1990. Nous remercions l'éditeur, le Dr Theo Homann, pour l'autorisation de publication. Des exemplaires individuels peuvent être commandés ici: https://etappe.org/25-etappe/
20:55 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, histoire, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 25 janvier 2022
L'anarchisme spirituel chez l'Anarque de Jünger
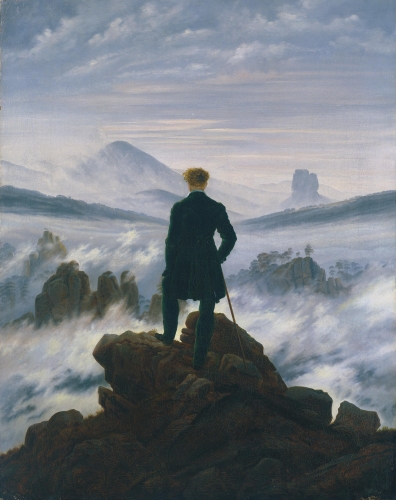
L'anarchisme spirituel chez l'Anarque de Jünger
par Urside
Source: https://www.liberecomunita.org/index.php/spiritualita/84-l-anarchismo-spirituale-nell-anarca
L'Anarque est cet individu souverain issu d'une mentalité hors du commun qui puise dans le puits sans limite de l'histoire, de la philosophie et de l'art.
Il est au-delà de la gauche ou de la droite, se déplaçant sans cesse de manière nomade avec une liberté de mouvement par la pensée, synthétisant des idées contradictoires. Mais toujours fermement ancré dans le nihilisme. Voilà le véritable anarchiste. C'est l'anarchie qui a produit (et produit encore) une vaste sous-culture hermétique et littéraire souterraine.
Depuis les romans noirs de Baudelaire, Gide, Mallarmé, le Blanc (et d'autres), en passant par l'avant-garde du futurisme jusqu'à Breton et Tzara, du surréalisme (et ses alentours), jusqu'à la nouvelle avant-garde de Barthes, Bataille et des "post-modernistes", dans les nouveaux romans noirs d'Abellio, Parvulesco, Onfray et Bey... La liste est continue, nomade et délirante. C'est l'anarchie du Mouvement Anarchiste, partie du Réseau Synarchique, qui s'est développé à partir d'un engagement politique au sein des cercles hermétiques et littéraires en France.
L'Anarque doit, dans son essence, être un nihiliste. Il ne s'agit pas d'une position négative. C'est un point de départ libre et nomade pour l'exploration. Si l'anarque est dogmatique, les points de départ sont limités et il n'y a pas d'anarchie. L'anarchisme et le nihilisme vont de pair. Le nihilisme a un bel héritage, des modes classiques et russes à la pensée actuelle de Michel Onfray (enracinée dans l'individualisme aristocratique de Georges Palante). Un parallèle transatlantique avec l'aristocratie radicale de Hakim Bey et son TAZ. Aujourd'hui, le nihilisme anarchiste est une force croissante.
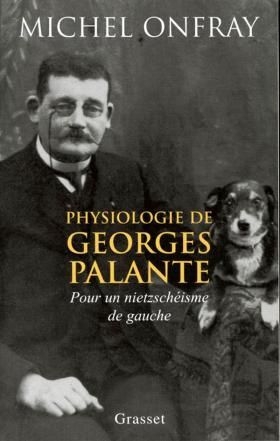
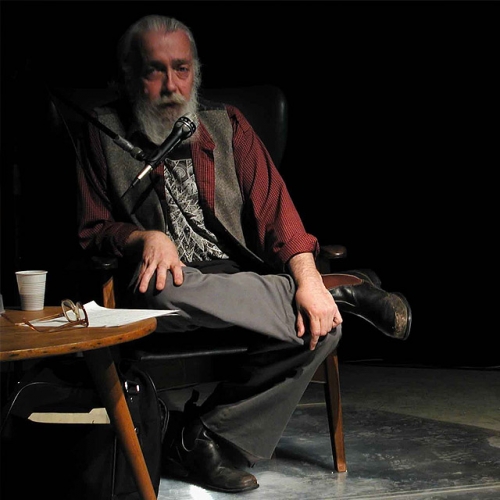
Le livre que Michel Onfray a consacré à Georges Palante; Hakim Bey.
L'Anarque, étant un nihiliste, est libre d'explorer et de synthétiser. Un monde ouvert à cette mentalité est la Décadence. Une autre manifestation évolutive depuis le début du siècle, avec sa fusion de l'art, de la philosophie et de l'occulte, dans le monde de Bohème. De nombreux écrivains ont porté le titre de décadents : Baudelaire, Gide, Peladan, Mallarmé, Breton, Barthes, Bataille, Bonnefoy, Palante, Onfray et bien d'autres encore... La décadence est la capacité de rechercher la poétique et l'esthétique dans chaque situation et de traverser la vie avec un détachement actif.
Le réseau Synarchique appartient aux cercles hermétiques et littéraires, centrés en France, dont il est issu. L'hermétisme utilise les clés de la philosophie occulte (et aujourd'hui du surréalisme) non seulement pour ouvrir le flux intérieur de l'anarchiste, mais aussi dans la politique pragmatique et hermétique, l'interaction entre l'occulte et le surréel en action. Cette interaction est née (à l'époque moderne) dans les années 1890 au sein de l'underground anarchiste, et continue aujourd'hui. Nous sommes sa manifestation actuelle. C'est la véritable anarchie - la révolution gothique. Comme l'ont exploré des gens comme Marinetti, Tzara, Breton, Lautréamont et leurs compagnons de route. Nous travaillons avec eux vers une société hermétique et anarchique.
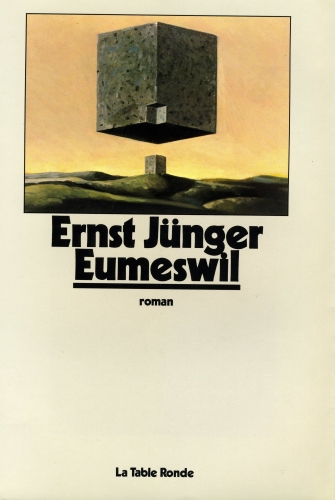
L'anarque - terme composé du grec an (ἀν) " sans " et -árchìs, de árchein (ἄρχειν), " gouverner, commander " - est une figure qui apparaît dans le roman Eumeswil d'Ernst Jünger, publié en 1977. L'anarchiste reprend des traits caractéristiques de L'Unique de Max Stirner : souveraineté absolue de l'individu, mais dans le refus du pouvoir ; absence de soumission aux lois de la société, mais recherche d'une loi naturelle ou cosmique ; désir d'une forme de maîtrise héroïque de soi ; recherche de la liberté comme but ultime de toute action ; absence d'esprit d'appartenance à un drapeau ou à une idéologie.
Bien qu'il considère l'anarchie comme l'élément premier de l'existence, dans la mesure où, dans le roman de Jünger, l'anarchie devient le véritable motif de l'histoire du monde, l'auteur allemand distingue l'anarque de l'anarchiste (bien qu'il définisse également le premier comme un "anarchiste radical"). L'anarchiste, en effet, vivant dans l'obsession d'une opposition constante au pouvoir, en reste prisonnier, et est donc voué à une existence qui n'est pas vraiment libre. L'anarque, au contraire, à travers une forme d'indifférence, non loin de l'ataraxie stoïcienne, se distancie de la société et du temps historique, pour s'ouvrir à une dimension libre de l'existence au sein d'un cycle cosmique qui le domine. En ce sens, la figure de l'anarque reprend, au sein de la tradition anarcho-individualiste, les modèles classiques, également développés par la tradition romantique et Nietzsche, dans lesquels l'individu est configuré comme un point d'équilibre entre la dimension libre de la volonté et la nécessité de la nature ou du destin.

L'anarque peut être lu comme une continuation ou une évolution de la figure du Waldgänger, que Jünger avait décrite dans les années 50.
L'anarque est celui qui parvient à briser les liens de ces positions morales et politiques dogmatiques et inamovibles ; il est cet individu qui a réussi à gagner la souveraineté sur lui-même en s'émancipant de la pensée de masse - à laquelle il échappe en se jetant dans l'infini de l'histoire, de la philosophie et/ou de l'art.
Il évolue en dehors du cadre de tout jeu politique actuel. Pour lui, des concepts tels que la gauche ou la droite, le progressisme ou le conservatisme, n'ont aucune signification au-delà de leur valeur manipulatrice. Sa pensée ignore toutes ces limites et classifications qui font de l'homme un menteur et un mesquin : pour lui, la vérité se construit à partir de tout et de rien.
L'Anarque n'a pas d'idéal bien défini, il ne peut être catalogué. C'est un nomade des idées et de la pensée en éternel conflit qui se déplace entre différents points, souvent apparemment contradictoires, mais qui en même temps cherche la vérité et voit des liens profonds que les autres ne voient nulle part, ces liens si fermes qu'ils constituent pour lui un modus vivendi.
La recherche de ces liens indissolubles est dans son combat intérieur, car l'anarque, face à la politique de masse et au consensus électro, avec sa rhétorique mensongère et trop souvent cruelle, ne peut s'empêcher de se rebeller contre l'éternel jeu que jouent les politiciens et les partis : celui de manipuler les imprudents et de faire de fausses promesses aux non-informés qui voient dans la classe politique un salut... mais qui en réalité ne sauvent personne : l'anarque est donc un nihiliste absolu. En tant qu'être émancipé.

Celui qui réussit à s'élever à un tel être est au-dessus de toute intention matérialiste de transformer la société, et aussi au-dessus de toute idéologie collective.
Être un anarque est une façon d'être : il n'est pas un réformateur, encore moins un "révolutionnaire" au sens habituel du terme. Il est absolument vrai que la figure de l'Anarque coïncide avec celle de l'anarchiste, il souhaite ardemment lutter pour l'Anarchisme, puisque la véritable Anarchie vit en lui. Elle commence par la pensée et se manifeste ensuite par l'action. Jamais l'inverse. Il ne s'agit pas d'un "positionnement" (qui est généralement toujours avant quelque chose), et encore moins d'une "pose" apparente (comme c'est généralement le cas), mais d'une manière intime et éternelle d'être.
Malgré son individualisme farouche, consciemment ou inconsciemment, l'Anarque appartient inévitablement à ce que l'on pourrait appeler le "Mouvement Anarchiste Mondial", quelque chose comme un réseau de syn-anarchies formées par d'innombrables individus influençant des cercles socialement, artistiquement ou culturellement plus ou moins importants.
L'Anarque, dans son aspect le plus fondamental, est toujours un nihiliste. Il ne s'agit pas d'une position négative. Il s'agit simplement d'un point de départ libre et nomade pour l'exploration de son environnement. Un anarchiste dogmatique se serait limité et serait donc sorti de l'anarchie. Le nihilisme a un héritage délicat, depuis les voies de la Russie classique jusqu'à la pensée actuelle de Michel Onfray.
En 1978, à l'âge de 83 ans, Ernst Jünger fait émerger la figure de l'Anarque dans la ville d'Eumeswil, une ville sans espace et sans temps et pour cette raison même le lieu idéal de l'Anarque. Eumeswil est l'un des fruits tardifs de l'État mondial après la dissolution des États-nations qui ont disparu dans le cataclysme des "grandes conflagrations", c'est-à-dire du mondialisme et du globalisme qui détruisent la diversité et la spécificité. C'est peut-être aussi pour cela qu'Eumeswil est polymorphe : tantôt elle nous est présentée comme une ville, tantôt comme un village dominé par le palais du Condor. Même la localisation spatiale échappe à toute détermination précise : Eumeswil est bordée par la mer - tantôt la Méditerranée, tantôt l'océan Atlantique -, par le désert du Khan jaune, mais aussi par des forêts vierges. Même dans le temps, Eumeswil n'a pas d'âge, notamment parce que le Luminar - un instrument réservé à quelques privilégiés - permet de se souvenir et de vivre chaque époque du passé, en la rendant présente.
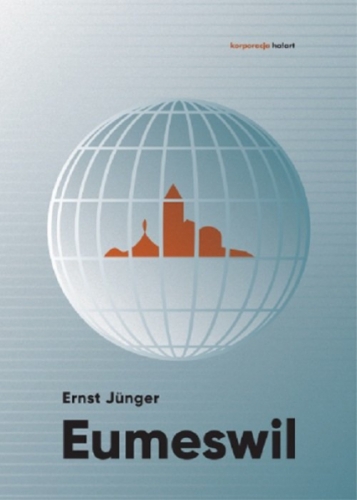
Dans cette ville-état, pendant du terrible Metropolis de Fritz Lang, le pouvoir est entre les mains du Condor, dont le coup d'État a chassé les tribuns et dont le palais s'appelle la Casbah, signe que le pouvoir, sous l'apparence de l'ordre, ne cache que le chaos. Ici vit Martin Venator, ou Manuel comme l'appelle le Condor, sensible à la sonorité des noms. C'est un jeune historien qui, la nuit, travaille comme serveur dans le bar de la Casbah, au service direct du dictateur. Martin Venator concilie les deux activités à la fois du point de vue de son intérêt historique pour la politique du Condor et de ses intimes, et surtout du fait qu'il est l'Anarque, donc ni contre ni pour le pouvoir, mais intimement étranger à celui-ci, indifférent donc autant à le servir qu'à le combattre.
Il y a déjà ici une différence fondamentale entre l'Anarque et l'anarchiste, bien que l'humus qui les a générés soit le même. En fait, tout le monde est anarchique et, pour cette raison, la famille, la société et l'État interviennent immédiatement pour conditionner et émonder cette force primordiale ; cependant, l'élément anarchique reste à l'arrière-plan, peut-être inconscient, mais toujours prêt à jaillir comme de la lave. Tout ce qui est agent de force est anarchique - l'amour, le guerrier, le meurtre, le Christ - alors que leurs homologues bourgeois - le mariage, le soldat, le meurtre, Saint Paul - ne le sont pas.
"L'histoire du monde est mue par l'anarchie".
14:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : anarque, anarchisme, ernst jünger, eumeswil, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


