mardi, 21 avril 2009
"Cette gaieté paradoxale et prodigieuse"
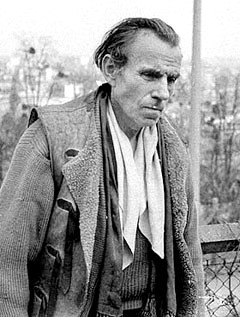
« Cette gaieté paradoxale et prodigieuse » [1957]
Nous avions exhumé l’article de Lucien Rebatet paru à la sortie de D’un château l’autre. Voici celui de Robert Poulet qui évoque, dans l’introduction, la polémique née au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Rivarol.
Dans les circonstances difficiles, il vaut mieux être tout à fait clair et tout à fait franc. J’ai lu, comme tout le monde, l’interview que Louis-Ferdinand Céline a donnée à L’Express le mois dernier. J’y ai retrouvé, ni plus ni moins, le ton, l’humeur, les dispositions qui ont toujours distingué l’auteur du Voyage au bout de la nuit. Avec les mêmes facéties truculentes, les mêmes défis burlesques, la même affectation de platitude et de grossièreté, qu’il mettait déjà dans ses discours au temps glorieux de ses débuts, et qui comme alors enveloppent bel et bien une extraordinaire hardiesse de pensée et d’expression... En ayant l’air de se moquer de tout et de lui-même, Bardamu vient d’asséner à ses adversaires qui avaient pensé cette fois le prendre au piège, des vérités comme aucune oreille française n’en a encore entendu depuis dix ans. Et les artificieux propos de Mme Françoise Giroud ¹ ne parvenaient pas une seconde à couvrir cette voix qui porte, jusque dans le registre le plus contenu, quand Céline joue, avec des intonations redoutables, la scène de l’esclave rebelle et puni : du Plaute tranposé dans ce siècle sans élites ; un morceau plus que remarquable, et où l’on ne découvre, mon cher Pierre-Antoine Cousteau, pas un atome de reniement ².
À celui qui ne fut jamais d’aucun clan, et qui se définit justement par cette autonomie totale, qui va jusqu’à la manie, jusqu’à la furie, on ne saurait demander de respecter la « loi du clan » – à laquelle je ne crois pas, quant à moi. Je n’ai de considération que pour la probité individuelle, pour l’amitié, pour la solidarité du malheur, qui est une question de sentiment. Il ne me paraît pas du tout qu’en l’occurrence le persécuté Céline, le méconnu Céline ait enfreint ces règles de pure hygiène morale. Celles-ci ne sauraient exiger qu’un écrivain de vigoureux tempérament cesse de se manifester sous l’aspect qui répond en lui à des nécessités quasi constitutionnelles.
L’œuvre et l’outil
Depuis vingt-cinq ans tout juste, l’auteur de Normance a toujours réussi à conjuguer le profond sérieux, qui se dissimule dans son œuvre et dans sa vie, et qui s’y approfondit encore en pathétique, avec la nature orageuse et volcanique de son art ; et aussi avec l’impatience irritée, le besoin de scandale et de contradiction, qu’excite chez lui – c’est sa vocation particulière – la soif de vérité, de pureté, de justice. Dès le commencement, on a reconnu dans cet anarchiste aux visions obscènes, aux propos blasphématoires, un défenseur déçu et meurtri de la tradition. Cet iconoclaste garde en lui le regret des « bonnes façons de vivre ». Sa manière de servir le beau et le vrai, c’est de s’insurger aveuglément contre toutes les impostures qui en tiennent lieu, dans une société faussée à la base ; de s’insurger sans réserve, sans mesure, comme il convient à l’indignation et à la déréliction. Et, comme les choses qu’il faut bafouer ont pris l’aspect des usages et des lois, l’insurrection célinienne s’ouvre par une explosion de délire subversif.
Les révolutionnaires professionnels n’en sont pas encore revenus, d’avoir vu naguère cet isolé, ce vagabond de la pensée, battre une fois pour toutes les records de négation, de destruction, de malédiction qu’ils pensaient avoir établis depuis cent ans, et qui, par comparaison avec la terrible et naïve « table rase » où s’installe Bardamu, paraissent les fruits d’une timidité ridicule. Personne n’avait jamais poussé la dérision de tout aussi loin que le petit médecin de banlieue, mal embouché, sorti d’on ne sait quels remous coloniaux, maritimes, internationaux, populaires, et qui surgit un matin de 1931 sur la scène de Paris.
Dès ses premiers mots, il montra ce que peut être, réellement, un contempteur du monde moderne. Du coup on vit les mœurs, les usages, la sensibilité, le langage même, chanceler sur leurs bases. D’autant que le novateur s’était fabriqué l’outil qu’il fallait ; un style comme on n’en avait jamais vu nulle part, fait d’argot décanté, qu’entrecoupent des soupirs, des haussements d’épaules ; le mouvement d’un discoureur de bistrot qui crache de mépris entre deux onomatopées ou qui a des renvois de vin bourru ; rythme essentiellement vulgaire, qui soutient une émotion parfaitement indépendante, parfaitement aberrante, mais d’une secrète noblesse.
Le génie deux fois escamoté
Le miracle se reproduisit, en plus éclatant encore, avec Mort à crédit. Seulement, déjà la tourbe des imitateurs s’était jetée sur le pur produit du célinisme. Dès avant la guerre, les sous-Céline pullulaient ; et maintenant il en est qui n’ont jamais lu leur modèle, qui n’ont jamais entendu prononcer son nom, ayant trouvé leur provende chez des épigones et des caudataires qui l’avaient pesamment remâchée ; et prospérant en outre dans une atmosphère intellectuelle que régit la conspiration du silence, au détriment de « l’auteur le plus original qui soit apparu en Europe depuis un siècle » (dixit Middleton Murry) ³.
Que reprochent à Céline les critiques qui pendant deux lustres l’ont supprimé de l’histoire littéraire, exclu de la vie littéraire, jeté moralement dans des oubliettes aussi profondes que celles dans lesquelles le grand écrivain languit au Danemark, pour avoir « vendu les plans de la Ligne Maginot » (ô alliance de la méchanceté et de la sottise, dont Hamlet devait rire amèrement à Elseneur, distante d’une portée de mitraillette) ? Ils lui reprochent (au nom d’un principe né de la guerre) d’avoir écrit des pamphlets contre les Juifs avant la guerre.
L’extravagance furibarde de Bagatelles pour un massacre et des Beaux draps avait sa source – c’est visible pour qui étudie de sang-froid ces pages pleines de divagations, d’imprudences, de méprises monumentales, pêle-mêle avec quelques beautés sulfureuses – dans l’angoisse que la vue trop exacte des hécatombes imminentes, voulues par les uns, acceptées par les autres, inspirait à un homme dont la pensée première, la définition initiale est l’horreur des maux évitables, avec la rage de crier cette horreur, fût-ce dans la confusion extrême qui accompagne les grandes crises de prophétisme.
Quoi qu’il en soit, l’événement Céline, pour des motifs qui ne tenaient pas à la littérature, et même qui ne se rattachaient pas aux idées de résistance et de collaboration, étrangères à ce j’men-fichiste fabuleux, à ce parangon d’anarchie, disparut d’une époque qui, sans lui, se révélait inexplicable. La jeunesse française ignore le romancier contemporain dont l’attitude, l’esprit, le vocabulaire, répondent le mieux au chaos mental et moral dans lequel elle se complaît, se raccrochant à des interprètes beaucoup moins qualifiés, beaucoup moins expressifs – et surtout beaucoup moins libres.
Quelques petites choses
Aux hommes de lettres « engagés », auxquels la nouvelle génération a un moment prêté l’oreille, faute de mieux, la révélation célinienne oppose, au contraire, le spectacle d’une âme soucieuse de se dégager à fond, de se dégager de tout, pour avoir senti soudain que toutes les contraintes sociales, avec les doctrines et les institutions dont elles découlent, étaient en train d’appesantir sur l’Occidental du XXème siècle une énorme chape de mensonge, faits de la corruption et de la falsification du patrimoine humain. Procédant du même état d’âme, le Voyage fit le même bruit d’écroulement que le dernier effort de Samson. Si les jouisseurs du désordre, les adorateurs de l’absurde, étaient conséquents avec eux-mêmes, ils se tourneraient de ce côté, pour voir enfin sortir de la terre, au milieu des décombres que Louis-Ferdinand Céline remue avec de sanglants sarcasmes, la pousse verte du naturel, en attendant la fleur de la charité, que n’ont pas étouffée toute cette colère et toute cette haine.
S’il y a dans ce temps-ci un écrivain qui l’exprime en plein, et qui même anticipe sur le temps à venir, avec des mots que sans doute on ne comprendra tout à fait qu’au-delà des effondrements qui y conduisent, c’est bien celui-ci, dont pourtant la plupart de nos successeurs n’ont aucune idée par la faute des témoins prévenus et des serviteurs infidèles de la littérature.
Ils tablèrent d’abord sur l’absence du personnage, puis sur son affaiblissement. Depuis son retour en France, l’auteur de L’Église a publié trois livres, dont les deux premiers, malgré des passages étonnants, que lui seul pouvait écrire, avaient quelque chose de blessé, un souffle rauque de grabataire ; un creux s’ouvrait au cœur de cette élocution toujours abondante et puissante. Puis, il y eut les Entretiens avec le professeur Y, où s’étirait et se gonflait une pugnacité convalescente. Mais voici D’un château l’autre. Et nul ne peut nier que le grand Céline soit revenu.
C’est si vrai que les chevaliers de la distraction calculée, les spécialistes de la bouche en cul-de-poule et de la mine-de-rien ont compris qu’il fallait changer de tactique. Du moment qu’on renonçait à faire comme si l’homme et l’œuvre étaient morts ou mieux, n’avaient jamais existé, il n’y avait pas de moyen terme : il fallait se précipiter à leur rencontre. Ainsi s’explique le tumulte exceptionnel qui s’est élevé dans la presse depuis trois semaines. Tout d’un coup, le réprouvé, le maudit, l’intouchable, est devenu l’un des thèmes majeurs de la publicité journalistique, l’un des bouffons favoris que ses organisateurs proposent au public. Et ainsi, tout en jouant les Frontins et les Scapins, au commandement et conformément à sa pente, Céline a-t-il pu se débarrasser de deux ou trois petites choses qu’il avait sur le cœur...
Une réalité seconde
Passons outre à ces numéros de cirque, mais d’un cirque sur lequel plane un drame. Et arrêtons-nous devant le livre qui a provoqué la rentrée du clown (voir les conséquences du fait dans un célèbre conte d’Edgar Poe 4 ).
On sait que les romans céliniens sont toujours tirés d’une réalité interprétée et transverbérée à laquelle s’applique le martèlement du verbe, dont les coups rapides et répétés finissent par forger une réalité seconde, chargée de poésie frénétique et sarcastique, avec une épouvante au bout. Cette fois, c’est sur ses souvenirs d’Allemagne – où il dut fuir en 1944, menacé de mort, sans nul motif – que l’auteur a travaillé. Il en résulte que, par exemple, on voit surgir à Sigmaringen une image du Maréchal Pétain, une image de Pierre Laval, et beaucoup d’autres images dont chacune a l’air d’être quelqu’un, de porter un nom. Purs cauchemars, où naturellement n’interviennent aucune des délicatesses ou des précautions que l’auteur a toujours instinctivement méprisées, à tort ou à raison, ne trouvant son maximum d’expressivité que dans l’irrespect intégral. Néanmoins, je défie bien les esprits les plus mal disposés de retirer d’un tel tableau une idée amoindrie des personnes qu’il met en scène.
Cela éclate surtout aux yeux de ceux qui prennent la peine de lire jusqu’au bout ces trois cent cinquante pages à la température d’ébullition. Il en sera récompensé par des plaisirs, par des surprises, dont les lecteurs des romans à la mode, si infirmes, si timorés sous leur masque de fausses audaces, ont perdu l’habitude. Il y a, notamment, une hallucination au bord de la Seine, qui rappelle dans le féerique et dans l’effrayant la fameuse « galère » du Voyage, et laisse loin derrière elle les plus échevelés pensums surréalistes. Il y a l’errance en chemin de fer. Il y a l’écriture, qui est encore plus divisée qu’avant ; ce n’est plus qu’un halètement musical, comme dans les premiers Stravinsky. Il y a cette gaieté paradoxale et prodigieuse, où entrent des éléments enfantins, des éléments jupitériens, à mi-chemin entre le petit garçon qui faisait des niches à ses copains en poussant dans Paris la voiture de sa mère dentellière, et le démiurge qui se moque de sa création au moment de la détruire.
En ce cas, le monde finirait par un cri de désespoir, qui ressemblerait furieusement à un cri de joie. C’est pourquoi l’on peut croire qu’au fin fond de la dissolution universelle à la Céline, il y a un noyau de santé. Puisse-t-il en tirer tout le suc, le cher homme !
En attendant, voici son bouquin. Le troisième de sa main qui ait chance de défier les siècles. Citez-moi seulement une dizaine de contemporains, dans les trois générations, qui puissent en dire autant !
Robert POULET
(Rivarol, 4 juillet 1957)
Notes
1. C’est François Giroud qui avait rédigé le chapeau rédactionnel de cette interview paru dans L’Express (14 juin 1957) sous le titre « Voyage au bout de la haine ».
2. Poulet répond ici à l’article de P.-A. Cousteau paru dans Lectures françaises (juillet-août 1957) sous le titre « Fantôme à vendre ».
3. John Middleton Murry (1889-1957), critique littéraire anglais, époux de Katherine Mansfield.
4. « La Barrique d’amontillado », avec son personnage tragique de Fortunato.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, belgique, lettres belges, littérature belge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.