samedi, 28 août 2010
Jean Mabire: de quelques écrivains guerriers
De quelques écrivains-guerriers
Ils sont ici un peu moins d’une vingtaine – deux groupes de combat avec leur équipe de voltige et leur pièce d’appui – qui seraient parfois surpris de se trouver ensemble. Les conflits qu’ils ont vécus se suivent et ne se ressemblent pas, tout au long de ce bref quart de siècle où la France a réussi à perdre trois guerres et à n’en gagner qu’une seule, dans le sillage d’alliés qui ont fait le plus gros de la besogne. Mais ces hommes, quels sont-ils? Des écrivains ou des guerriers? Les deux, tour à tour et parfois en même temps.
Remarquons d’abord qu’il y a peu de professionnels. Les guerres modernes ont été tragiquement vécues par ceux dont ce n’était pas le métier. Aussi ne se trouve-t-il qu’un seul saint-cyrien dans cette cohorte: Pierre Sergent. Et encore il intégra Coët en 1944, après avoir été volontaire dans un maquis.
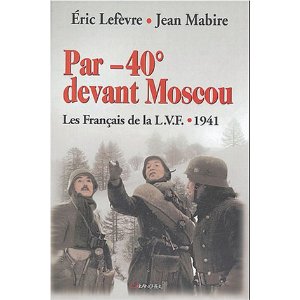 Et Marcel Bigeard? Mais c’est le type même de l’officier sorti du rang, qui commence sa carrière avec les godillots de 2e classe et la termine avec les étoiles de général. Sans la captivité et surtout sans la Résistance, il serait resté petit employé de banque, peut-être directeur d’une succursale dans une sous-préfecture des marches de l’Est. Bigeard n’en reste pas moins l’exemple même de ceux que les événements ont révélé à lui-même: ce n’est pas un militaire, c’est un soldat. Ce n’est pas un mince compliment. Il ne deviendra écrivain que sur le tard, à l’âge de la retraite (mot qu’il n’aime pas) et des Mémoires. Il y nourrit ses nostalgies guerrières de quelques jugements parlementaires menés, selon son habitude, tambour battant.
Et Marcel Bigeard? Mais c’est le type même de l’officier sorti du rang, qui commence sa carrière avec les godillots de 2e classe et la termine avec les étoiles de général. Sans la captivité et surtout sans la Résistance, il serait resté petit employé de banque, peut-être directeur d’une succursale dans une sous-préfecture des marches de l’Est. Bigeard n’en reste pas moins l’exemple même de ceux que les événements ont révélé à lui-même: ce n’est pas un militaire, c’est un soldat. Ce n’est pas un mince compliment. Il ne deviendra écrivain que sur le tard, à l’âge de la retraite (mot qu’il n’aime pas) et des Mémoires. Il y nourrit ses nostalgies guerrières de quelques jugements parlementaires menés, selon son habitude, tambour battant.
Son âge lui a permis de participer à toutes les guerres: 39-40, la résistance, 44-45, l’Indo, l’Algérie, sans compter quelques aventures qui ne sont plus qualifiées aujourd’hui «coloniales», mais seulement «extérieures». De tous les guerriers de ce recueil, il reste le plus incontournable et de tous les écrivains, le moins nécessaire. Mais quel personnage!
Ce n’est pas sur une réputation militaire que s’est établie la renommée de Guy des Cars. Cet aristocrate devenu un des champions du roman populaire à gros tirage a pourtant fait, à trente ans, une entrée fracassante dans la république des Lettres, en 1941, avec un superbe récit, L’Officier sans nom, dans lequel il racontait avec un accent de vérité indéniable ce que fut sa guerre de 39-40.
On a trop oublié que l’armée française devait laisser sur le terrain cent vingt mille tués. Le fameux devoir de mémoire plaçait alors le sacrifice de ces garçons en priorité absolue dans le souvenir de leurs compatriotes. S’ils ne sont pas aujourd’hui totalement oubliés, c’est entre autres à Guy des Cars qu’on le doit.
Après cette brève et désastreuse expérience militaire, il devait remiser à jamais son uniforme dans la naphtaline d’une vieille cantine et on ne le verra plus sur un champ de bataille. Mais il représente fort bien l’itinéraire des meilleurs de sa génération. Quant à sa trajectoire d’écrivain, elle est plus honorable que ne veulent l’avouer ces critiques envieux qui l’avaient surnommé «Guy des Gares».
 À la même génération appartient Marc Augier. Si sa campagne de 39-40 ne fut guère mémorable, il devait se rattraper par la suite. Militant socialiste et pacifiste du temps du Front populaire, il avait commencé une originale carrière de journaliste, de motard et de campeur, publiant un assez beau récit sur un Solstice en Laponie. Après avoir partagé les espoirs et les rêves de ses camarades des Auberges de la jeunesse, Les Copains de la belle étoile, on le retrouve animateur d’un mouvement d’adolescents au temps de ce qu’on nommait l’Europe nouvelle. Il n’était pas homme à inciter ses garçons à aller se battre en Russie sans s’y rendre lui-même, sous-officier de la LVF et correspondant de guerre. Il en ramènera un court récit, Les Partisans, et une réputation de maudit qui lui collera à jamais à la peau. Pourchassé et exilé en Amérique du Sud, le réprouvé Augier deviendra le romancier Saint-Loup. Sans une indiscrétion sur son passé, il aurait sans doute obtenu le prix Goncourt en 1952. Il fera mieux et réussira à gagner un public vite fanatique d’une œuvre qui doit beaucoup à ses expériences vécues dangereusement.
À la même génération appartient Marc Augier. Si sa campagne de 39-40 ne fut guère mémorable, il devait se rattraper par la suite. Militant socialiste et pacifiste du temps du Front populaire, il avait commencé une originale carrière de journaliste, de motard et de campeur, publiant un assez beau récit sur un Solstice en Laponie. Après avoir partagé les espoirs et les rêves de ses camarades des Auberges de la jeunesse, Les Copains de la belle étoile, on le retrouve animateur d’un mouvement d’adolescents au temps de ce qu’on nommait l’Europe nouvelle. Il n’était pas homme à inciter ses garçons à aller se battre en Russie sans s’y rendre lui-même, sous-officier de la LVF et correspondant de guerre. Il en ramènera un court récit, Les Partisans, et une réputation de maudit qui lui collera à jamais à la peau. Pourchassé et exilé en Amérique du Sud, le réprouvé Augier deviendra le romancier Saint-Loup. Sans une indiscrétion sur son passé, il aurait sans doute obtenu le prix Goncourt en 1952. Il fera mieux et réussira à gagner un public vite fanatique d’une œuvre qui doit beaucoup à ses expériences vécues dangereusement.
De la demi-douzaine de garçons qui ont choisi la Résistance et se retrouvent ici, on peut d’abord dire qu’ils étaient jeunes, très jeunes même quand ils ont choisi leur camp, au risque de leur peau. Ils n’avaient rien écrit, sauf quelques dissertations scolaires quand ils se sont lancés dans la bagarre.
Alain Griotteray fut du premier rendez-vous, celui qui lança quelques étudiants devant l’Arc-de-Triomphe par un glacial 11 novembre d’occupation. Cette manifestation trop oubliée fut le prélude d’un mouvement de défi qui porta les plus intrépides vers les maquis.
Pierre de Villemarest choisit pour sa part ce massif montagneux, véritable forteresse naturelle qui devait devenir le plus célèbre haut lieu des combattants de la nuit et du brouillard: le Vercors.
Pierre Sergent se retrouve en Sologne, soldat sans uniforme, en un temps où les volontaires ne se bousculaient pas, car les occupants tenaient solidement le pays. Il choisit ainsi d’entrer dans la carrière des armes par la porte la plus étroite et la plus rude.
Le maquis de Roger Holeindre, ce fut le pavé de Paris où il joua au Gavroche sur les barricades, s’emparant de haute lutte d’une mitrailleuse ennemie et gagnant à jamais le droit d’ouvrir sa gueule quand poussèrent comme champignons les fameux «résistants de septembre», une fois l’orage de feu apaisé.
André Figueras réussit à fuir le pays occupé et à rejoindre l’armée régulière, ce qui lui valut de revenir au pays pistolet-mitrailleur au poing et coiffé du béret noir des commandos.
Sergent, comme les quatre autres, a vécu assez pour se faire traiter de «fasciste» par ceux qui arborent à la boutonnière le triangle rouge des déportés politiques devenu l’insigne de «Ras l’front», plus d’un demi-siècle après la fin de la dernière guerre, tout danger écarté.
Parmi les cent soixante-dix-sept Français qui débarquèrent de vive force sur les côtes normandes à l’aube du 6 juin 1944, se trouvait un garçon de 19 ans. Ce jeune Breton de Cornouailles avait déjà réussi un exploit en rejoignant l’Angleterre à bord d’un minuscule rafiot à voile. Il se nomme Gwen-Aël Bolloré et sert alors comme quartier-maître infirmier.
 Une belle carrière l’attend: chef d’entreprise, océanographe, éditeur, poète, romancier, mémorialiste. L’ancien du commando Kieffer sera lié avec toutes les personnalités de la république des Lettres. Mais son plus grand titre de gloire est d’avoir défié le pouvoir, en s’en prenant au général-président, dont il n’approuvait guère la politique algérienne. Il avait montré du courage et du talent. Il devait prouver alors qu’il avait aussi du caractère, chose surprenante chez un personnage aussi convivial.
Une belle carrière l’attend: chef d’entreprise, océanographe, éditeur, poète, romancier, mémorialiste. L’ancien du commando Kieffer sera lié avec toutes les personnalités de la république des Lettres. Mais son plus grand titre de gloire est d’avoir défié le pouvoir, en s’en prenant au général-président, dont il n’approuvait guère la politique algérienne. Il avait montré du courage et du talent. Il devait prouver alors qu’il avait aussi du caractère, chose surprenante chez un personnage aussi convivial.
Ceux pour qui la résistance – la vraie – prenait fin avec la défaite du iiie Reich et le jugement de Nuremberg, n’en avaient pas fini avec le combat. En Extrême-Orient, une guerre s’allumait. Les Viets arboraient l’étoile des anciens alliés soviétiques. La croix gammée fracassée, cette étoile devenait pour eux le symbole de l’ennemi. Pas question de se mettre à écrire tranquillement. Des volontaires partaient à l’autre bout du monde. Les meilleurs servaient dans les parachutistes, vite légendaires. On allait y retrouver nos anciens résistants: Holeindre avec le béret rouge des paras coloniaux et Sergent avec le béret vert des légionnaires paras.
Bientôt les rejoint un jeune sous-lieutenant qui devait devenir, quelques années plus tard, le plus célèbre des écrivains guerriers, garçon qui fit ses universités à Diên Biên Phu. Il se nommait Erwan Bergot. Comme tous ses camarades d’aventure indochinoise, il allait être marqué par ce «mal jaune», grande nostalgie maladive du Sud lointain.
Servant comme chef de section dans les rangs du bataillon Bigeard, il se révélera le meilleur parmi les meilleurs. Une promotion de l’école des élèves-officiers de réserve de l’école d’Infanterie de Montpellier portera un jour son nom. Les jeunes aspirants qui ont choisi ce patron se réclamaient à la fois du combattant et de l’écrivain, car il fut l’incarnation exemplaire de ces deux vocations exigeantes.
L’année même où tombaient l’un après l’autre les pitons aux noms de femmes disséminés dans la sinistre cuvette choisie par le haut-commandement, un autre feu s’allumait en Algérie. Bigeard devait y construire sa légende tout au long de la «piste sans fin» où progressaient ses léopards, l’index crispé sur la queue de détente de leur MAT 49. Un jour, devenu général, député, ministre, il écrira des livres. Pour le moment, c’est sur le terrain qu’il se veut maître et seigneur.
Cette guerre, où combattent côte à côte gens de métier et gars du contingent, va être la grande aventure de toute une nouvelle génération. Seuls les aînés comme Holeindre ou Sergent ont connu la résistance et seul Bergot – comme son chef Bigeard – a vécu l’enfer des camps viets, où la mortalité était pire qu’à Dachau ou à Tambow. Leurs camarades, futurs écrivains, mais provisoires combattants, sont des garçons dont ce n’est pas le métier de se battre, mais qui vont se débrouiller aussi bien que leurs aînés des maquis et des rizières.
Rien ne distingue, sur les superbes photos prises par l’officier marinier René Bail, ancien de l’Aéronavale, les appelés et les professionnels. Ils portent la même tenue camouflée, ils ont le même visage ruisselant de sueur sous la casquette de combat.
Dans cette armée qui passe ses nuits et ses jours dans les djebels, rien ne sépare les gradés de leurs hommes. Ils partagent tout. Et la soif et la peur et le froid («L’Algérie est un pays froid où le soleil est chaud», disent les anciens). Ils vivent en plein vent, dans la caillasse et la boue, dans le sable et les ronciers. Finalement, ils ont le même âge ou presque et se ressemblent étrangement en cette fin des années cinquante de notre siècle.
Les soldats d’outre-Méditerranée sont alors en train de durement gagner sur le terrain, tandis que d’autres à Paris vont jeter la crosse après le fusil, comme on jette le manche après la cognée. Cette défaite programmée fera d’eux des rebelles et même des hors-la-loi, marqués à jamais par cette expérience tragique du courage et de la peur, où ils ont vu tomber pour rien les meilleurs de leurs camarades.
Ce fut une sacrée équipe que celle de ces soldats plus ou moins perdus, dont les chemins par la suite ne vont cesser de se croiser et de se recroiser. En voici une demi-douzaine, dont l’amertume et la lucidité ne vont pas faire oublier les dures joies de la camaraderie et de l’enthousiasme. Nous les découvrons côte à côte, une dernière fois, sur cette terre d’Algérie (et de Tunisie pour l’un d’eux) qui les a tant marqués: le quartier-maître de fusiliers marins commandos Georges Fleury, le brigadier de chasseurs d’Afrique Jean Bourdier, le sergent de chasseurs à pied Dominique Venner, le lieutenant de tirailleurs Philippe Héduy, le lieutenant d’alpins Jean Mabire.
À eux cinq, appelés ou rappelés, ils incarnent des vertus militaires que ne désavouèrent pas le «vieux» briscard parachutiste Roger Holeindre qui n’a guère soufflé depuis la Résistance et poursuit en Algérie les opérations de commando inaugurées en Indochine.
Leurs chansons, leurs crapahuts, leurs combats impressionnent fort un garçon plus jeune qu’eux, fils et petit-fils de soldats, marqué au fer rouge par la disparition en Indochine de son père, un légionnaire d’origine russe. Ainsi, par le privilège du sang versé par les siens, Serge de Beketch figure ici à côté de ses aînés.
Tout comme le romancier Serge Jacquemard, très jeune témoin des atrocités de plusieurs guerre celle d’Espagne où ses parents furent pris en otage, celle de l’Occupation et de ses rigueurs et celle du coup d’État en Indonésie qui porta Suharto au pouvoir pour plusieurs décennies. S’il ne fut pas véritablement guerrier lui-même, sa rencontre avec le Bat’ d’Af’ Maurice H. influencera une grande partie de son œuvre.
Et puis, pour beaucoup, ce sera le retour, le retour écœurant dont parlait Pierre Mac Orlan. Viendront le complot, l’aventure, la prison, l’exil, ce qu’ils nomment parfois «la politique» et qui n’est pour eux qu’une nouvelle manière de se battre. Ils ne seront pas des journalistes ou des écrivains «comme les autres». Leurs articles ou leurs bouquins gardent toujours l’empreinte de combats vécus avant d’être rêvés. Ils sont à jamais différents du monde des civils, méprisant cette «civilisation» qui a voulu transformer les centurions en boutiquiers. Ils ne marchent pas dans la société marchande. Ils sont à jamais libérés du libéralisme. Ils savent que la vie est une lutte et que toutes les armes comme toutes les ruses y sont bonnes.
Ils ne croient pas plus à la droite qu’à la gauche. Ils savent que la première des consignes, dans la paix comme dans la guerre, est de garder ses distances… Ils étaient des soldats d’occasion. Ils ne sont pas vraiment sûrs d’être des écrivains de métier. Ils savent seulement qu’il n’est plus possible de tricher. Leur encre aura toujours le goût du sang.
* * *
Préface au livre Ils ont fait la guerre de Philippe Randa (en vente sur www.dualpha.com).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean mabire, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, guerre, militaria, soldats |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.