Robert STEUCKERS:
Les oppositions américaines à la guerre de Roosevelt
Analyse : Ronald RADOSH, Prophets on the Right. Profiles of Conservative Critics of American Globalism, Free Life Editions, New York, 1975 (ISBN : 0-914156-22-5). L’histoire des oppositions américaines à la seconde guerre mondiale est très intéressante. Elle nous initie aux idées des isolationnistes et neutralistes des Etats-Unis, seuls alliés objectifs et fidèles que nous pouvons avoir Outre-Atlantique, mis à part, bien entendu, les patriotes d’Amérique hispanique.
Aborder ce sujet implique de formuler quelques remarques préliminaires.
- L’histoire contemporaine est évaluée sous l’angle d’une propagande. Laquelle ? Celle qui a été orchestrée par les bellicistes américains, regroupés autour du Président Roosevelt. La tâche de l’histoire est donc de retrouver la réalité au-delà du rideau de fumée propagandiste.
- L’histoire contemporaine est déterminée par la perspective rooseveltienne où
a) les Etats-Unis sont l’avant-garde, la terre d’élection de la liberté et de la démocratie ;
b) les Etats-Unis doivent agir de façon à ce que le monde s’aligne sur eux.
c) Via leur idéologie messianique, interventionniste et mondialiste, les Etats-Unis se posent comme le bras armé de Yahvé, sont appelés à unir le monde sous l’autorité de Dieu. Leur président est le vicaire de Yahvé sur la Terre (et non plus le Pape de Rome).
Mais, pour s’imposer, cette idéologie messianique, interventionniste et mondialiste a eu des ennemis intérieurs, des adversaires isolationnistes, neutralistes et différentialistes. En effet, dans les années 30, 40 et 50, deux camps s’affrontaient aux Etats-Unis. En langage actualisé, on pourrait dire que les partisans du « village universel » se heurtaient aux partisans de l’ « auto-centrage ».
Quels ont été les adversaires du mondialisme de Roosevelt, outre le plus célèbre d’entre eux, le pilote Lindbergh, vainqueur de l’Atlantique. Nous en étudierons cinq :
1) Oswald Garrison VILLARD, éditeur du journal Nation, ancré à gauche, libéral et pacifiste.
2) John T. FLYNN, économiste et éditorialiste de New Republic, également ancré à gauche.
3) Le Sénateur Robert A. TAFT de l’Ohio, chef du Parti Républicain, surnommé « Mr. Republican».
4) Charles A. BEARD, historien progressiste.
5) Lawrence DENNIS, intellectuel étiqueté « fasciste », ancien diplomate en Amérique latine, notamment au Nicaragua et au Pérou.
Tous ces hommes avaient une biographie, un passé très différent. Dans les années 38-41, ils étaient tous isolationnistes. Dans les années 43-50, ils sont considérés comme « conservateurs » (c’est-à-dire adversaires de Roosevelt et de l’alliance avec l’URSS) ; de 1948 à 1953, ils refusent la logique de la Guerre Froide (défendue par la gauche sociale-démocrate après guerre).
Pourquoi cette évolution, qu’on ne comprend plus guère aujourd’hui ?
- D’abord parce que la gauche est favorable au « globalisme » ; à ses yeux les isolationnistes sont passéistes et les interventionnistes sont internationalistes et « progressistes ».
- Dans le sillage de la Guerre du Vietnam (autre guerre interventionniste), la gauche a changé de point de vue.
En effet, l’interventionnisme est synonyme d’impérialisme (ce qui est moralement condamnable pour la gauche hostile à la Guerre du Vietnam). L’isolationnisme relève du non-impérialisme américain, de l’anti-colonialisme officiel des USA, ce qui, dans le contexte de la Guerre du Vietnam, est moralement acceptable. D’où la gauche militante doit renouer avec une pensée anti-impérialiste. La morale est du côté des isolationnistes, même si un Flynn, par exemple, est devenu macchartyste et si Dennis a fait l’apologie du fascisme. Examinons les idées et les arguments de chacun de ces cinq isolationnistes.
Charles A. BEARD
Charles A. Beard est un historien qui a écrit 33 livres et 14 essais importants. Sa thèse centrale est celle du « déterminisme économique » ; elle prouve qu’il est un homme de gauche dans la tradition britannique de Mill, Bentham et du marxisme modéré. La structure politique et juridique, pour Beard, dérive de la stratégie économique. La complexification de l’économie implique une complexification du jeu politique par multiplication des acteurs. La Constitution et l’appareil légal sont donc le reflet des desiderata des classes dirigeantes. La complexification postule ensuite l’introduction du suffrage universel, pour que la complexité réelle de la société puisse se refléter correctement dans les représentations.
Beard sera dégoûté par la guerre de 1914-18.
1. Les résultats de cette guerre sont contraires à l’idéalisme wilsonien, qui avait poussé les Etats-Unis à intervenir. Après 1918, il y a davantage de totalitarisme et d’autoritarisme dans le monde qu’auparavant. La première guerre mondiale se solde par un recul de la démocratie.
2. Ce sont les investissements à l’étranger (principalement en France et en Grande-Bretagne) qui ont poussé les Etats-Unis à intervenir (pour sauver leurs clients de la défaite).
3. D’où le véritable remède est celui de l’autarcie continentale (continentalism).
4. Aux investissements à l’étranger, il faut opposer, dit Beard, des investissements intérieurs. Il faut une planification nationale. Il faut construire une bonne infrastructure routière aux Etats-Unis, il faut augmenter les budgets pour les écoles et les universités. Pour Beard, le planisme s’oppose au militarisme. Le militarisme est un messianisme, essentiellement porté par la Navy League, appuyée jadis par l’Amiral Mahan, théoricien de la thalassocratie. Pour Beard, l’US Army ne doit être qu’un instrument défensif.
Beard est donc un économiste et un théoricien politique qui annonce le New Deal de Roosevelt. Il est donc favorable au Président américain dans un premier temps, parce que celui-ci lance un gigantesque plan de travaux d’intérêt public. Le New Deal, aux yeux de Beard est une restructuration complète de l’économie domestique américaine. Beard raisonne comme les continentalistes et les autarcistes européens et japonais (notamment Tojo, qui parle très tôt de « sphère de co-prospérité est-asiatique »). En Allemagne, cette restructuration autarcisante préconisée par le premier Roosevelt suscite des enthousiasmes et apporte de l’eau au moulin des partisans d’un nouveau dialogue germano-américain après 1933.
Le programme « Big Navy »
Mais Roosevelt ne va pas pouvoir appliquer son programme, parce qu’il rencontrera l’opposition des milieux bancaires (qui tirent plus de dividendes des investissements à l’étranger), du complexe militaro-industriel (né pendant la première guerre mondiale) et de la Ligue Navale. Pour Beard, le programme « Big Navy » trahit l’autarcie promise par le New Deal.
Le programme « Big Navy » provoquera une répétition de l’histoire. Roosevelt prépare la guerre et la militarisation des Etats-Unis, déplore Beard. En 1934, éclate le scandale Nye. Une enquête menée par le Sénateur Gerald Nye prouve que le Président Wilson, le Secrétaire d’Etat Lansing et le Secrétaire d’Etat au Trésor Gibbs McAdoo, le Colonel House et les milieux bancaires (notamment la J.P. Morgan & Co) ont délibérément poussé à la guerre pour éviter une crise, une dépression. Résultat : cette dépression n’a été postposée que de dix ans (1929). Donc la politique raisonnable serait de décréter un embargo général à chaque guerre pour que les Etats-Unis ne soient pas entraînés aux côtés d’un des belligérants.
En 1937, Roosevelt prononce son fameux « Discours de Quarantaine », où il annonce que Washington mettra les « agresseurs » en quarantaine. En appliquant préventivement cette mesure de rétorsion aux seuls agresseurs, Roosevelt opère un choix et quitte le terrain de la neutralité, constate Beard. En 1941, quand les Japonais attaquent Pearl Harbour, le matin du 7 décembre 1941, Beard révèle dans la presse que Roosevelt a délibérément obligé le Japon à commettre cet irréparable acte de guerre. De 1941 à 1945, Beard admettra la nature « expansionniste » de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon, mais ne cessera d’exhorter les Etats-Unis à ne pas suivre cet exemple, parce que les Etats-Unis sont « self-suffisant » et que l’agressivité de ces Etats n’est pas directement dirigée contre eux. Ensuite, deuxième batterie d’arguments, la guerre désintègre les institutions démocratiques américaines. On passe d’une démocratie à un césarisme à façade démocratique.
Beard accuse le gouvernement américain de Roosevelt de chercher à entrer en guerre à tout prix contre le Japon et l’Allemagne. Son accusation porte notamment sur quatre faits importants :
1. Il dénonce l’échange de destroyers de fabrication américaine contre des bases militaires et navales anglaises dans les Caraïbes et à Terre-Neuve (New Foundland).
2. Il dénonce la « Conférence de l’Atlantique », tenue entre le 9 et le 12 août 1941 entre Churchill et Roosevelt. Elles ont débouché sur un acte de guerre au détriment du Portugal neutre : l’occupation des Açores par les Américains et les Britanniques.
3. Il dénonce l’incident de septembre 1941, où des navires allemands ripostent aux tirs de l’USS Greer. Beard prétend que Roosevelt monte l’incident en épingle et il appuie son argumentation sur le rapport de l’Amiral Stark, prouvant l’intervention du navire aux côtés des Anglais.
4. En octobre 1941, un incident similaire oppose des bâtiments de la Kriegsmarine à l’USS Kearny. Roosevelt amplifie l’événement avec l’appui des médias. Beard rétorque en s’appuyant sur le rapport du Secrétaire de la Navy Knox, qui révèle que le navire américain a pris une part active aux combats opposants bâtiments anglais et allemands.
Une stratégie de provocation
Beard conclut que la stratégie de Roosevelt cherche à provoquer délibérément un incident, un casus belli. Cette attitude montre que le Président ne respecte pas les institutions américaines et ne suit pas la voie hiérarchique normale, qui passe par le Congrès. La démocratie américaine n’est plus qu’une façade : l’Etat US est devenu césariste et ne respecte plus le Congrès, organe légitime de la nation.
Il est intéressant de noter que la gauche américaine récupèrera Beard contre Johnson pendant la guerre du Vietnam. De Roosevelt à Johnson, la gauche américaine a en effet changé du tout au tout, modifié de fond en comble son argumentation ; elle était favorable à Roosevelt parce qu’il était l’impulseur du New Deal, avec toutes ses facettes sociales et dirigistes, et qu’il fut le leader de la grande guerre « anti-fasciste ». Elle cesse de soutenir l’option présidentialiste contre le démocrate Johnson, redevient favorable au Congrès, parce qu’elle s’oppose à la guerre du Vietnam et à l’emprise des lobbies militaro-industriels. En fait, la gauche américaine avouait dans les années 60 qu’elle avait été autoritaire, bouclier de l’autocratie rooseveltienne et anti-parlementaire (tout en reprochant aux fascistes de l’être !). Pire, la gauche avouait qu’elle avait été « fasciste » par « anti-fascisme » !
Dans une première phase donc, la gauche américaine avait été interventionniste. Dans une seconde, elle devient isolationniste. Cette contradiction s’est (très) partiellement exportée vers l’Europe. Cette mutation, typiquement américaine, fait la spécificité du paysage politique d’Outre-Atlantique.
Mettre le Japon au pied du mur…
Intéressantes à étudier sont également les positions de Beard sur la guerre américaine contre le Japon. Beard commence par constater que le Japon voulait une « sphère de co-prospérité est-asiatique », incluant la Chine et étendant l’influence japonaise profondément dans le territoire de l’ex-Céleste Empire. Pour cette raison, croyant contrarier l’expansion nippone, Roosevelt organise l’embargo contre le Japon, visant ainsi son asphyxie. En pratiquant une telle politique, le Président américain a mis le Japon au pied du mur : ou périr lentement ou tenter le tout pour le tout. Le Japon, à Pearl Harbour, a choisi le deuxième terme de l’alternative. L’enjeu de la guerre américano-japonaise est donc le marché chinois, auquel les Etats-Unis ont toujours voulu avoir un accès direct. Les Etats-Unis veulent une politique de la « porte ouverte » dans toute l’Asie, comme ils avaient voulu une politique identique en Allemagne sous Weimar. Dans la polémique qui l’oppose à Roosevelt, Beard se range du côté de Hoover, dont la critique à du poids. Beard et Hoover pensent que l’action du Japon en Chine n’enfreint nullement la souveraineté nationale américaine, ni ne nuit aux intérêts des Etats-Unis. Ceux-ci n’ont pas à s’inquiéter : jamais les Japonais ne parviendront à japoniser la Chine.
Après la deuxième guerre mondiale, Beard ne cessera de s’opposer aux manifestations de bellicisme de son pays. Il critique la politique de Truman. Il refuse la bipolarisation, telle qu’elle s’incruste dans les machines propagandistes. Il critique l’intervention américaine et britannique en Grèce et en Turquie. Il critique la recherche d’incidents en Méditerranée. Il rejette l’esprit de « croisade », y compris quand il vise le monde communiste.
En conclusion, Beard est resté pendant toute sa vie politique un partisan de l’autarcie continentale américaine et un adversaire résolu du messianisme idéologique. Beard n’était ni anti-fasciste ni anti-communiste : il était un autarciste américain. L’anti-fascisme et l’anti-communisme sont des idées internationalistes, donc désincarnées et irréalistes.
Oswald Garrison VILLARD
Né en 1872, Oswald Garrison Villard est un journaliste new-yorkais très célèbre, offrant sa prose précise et claire à deux journaux, Post et Nation, propriétés de son père. L’arrière-plan idéologique de Villard est le pacifisme. Il se fait membre de la Ligue anti-impérialiste dès 1897. En 1898, il s’oppose à la guerre contre l’Espagne (où celle-ci perd Cuba et les Philippines). Il estime que la guerre est incompatible avec l’idéal libéral de gauche. En 1914, il est l’un des principaux avocats de la neutralité. De 1915 à 1918, il exprime sa déception à l’égard de Wilson. En 1919, il s’insurge contre les clauses du Traité de Versailles : la paix est injuste donc fragile, car elle sanctionne le droit du plus fort, ne cesse-t-il de répéter dans ses colonnes. Il s’oppose à l’intervention américaine contre la Russie soviétique, au moment où Washington débarque des troupes à Arkhangelsk. De 1919 à 1920, il se félicite de l’éviction de Wilson, de la non-adhésion des Etats-Unis à la SdN. Il apporte son soutien au néo-isolationnisme.
De 1920 à 1930, Villard modifie sa philosophie économique. Il évolue vers le dirigisme. En 1924, il soutient les initiatives du populiste LaFollette, qui voulait que soit inscrite dans la constitution américaine l’obligation de procéder à un référendum avant toute guerre voire avant toute opération militaire à l’étranger. Villard souhaite également la création d’un « Third Party », sans l’étiquette socialiste, mais dont le but serait d’unir tous les progressistes.
En 1932, Franklin Delano Roosevelt arrive au pouvoir. Villard salue cette accession à la présidence, tout comme Beard. Et comme Beard, il rompra plus tard avec Roosevelt car il refusera sa politique extérieure. Pour Villard, la neutralité est un principe cardinal. Elle doit être une obligation (compulsory neutrality). Pendant la Guerre d’Espagne, la gauche (dont son journal Nation, où il devient une exception) soutient les Républicains espagnols (comme Vandervelde au POB). Lui, imperturbable, plaide pour une neutralité absolue (comme Spaak et De Man au POB). La gauche et Roosevelt veulent décréter un embargo contre les « agresseurs ». Villard, à l’instar de Beard, rejette cette position qui interdit toute neutralité absolue.
Plus de pouvoir au Congrès
Les positions de Villard permettent d’étudier les divergences au sein de la gauche américaine. En effet, dans les années 30, le New Deal s’avère un échec. Pourquoi ? Parce que Roosevelt doit subir l’opposition de la « Cour Suprême » (CS), qui est conservatrice. Villard, lui, veut donner plus de pouvoir au Congrès. Comment réagit Roosevelt ? Il augmente le nombre de juges dans la CS et y introduit ainsi ses créatures. La gauche applaudit, croyant ainsi pouvoir réaliser les promesses du New Deal. Villard refuse cet expédient car il conduit au césarisme. La gauche reproche à Villard de s’allier aux conservateurs de la CS, ce qui est faux puisque Villard avait suggéré d’augmenter les prérogatives du Congrès.
Dans cette polémique, la gauche se révèle « césariste » et hostile au Congrès. Villard reste fidèle à une gauche démocratique et parlementaire, pacifiste et autarciste. Villard ne « trahit » pas. Ce clivage conduit à une rupture entre Villard et la rédaction de Nation, désormais dirigée par Freda Kirchwey. En 1940, Villard quitte Nation après 46 ans et demi de bons et loyaux services, accusant Kirchwey de « prostituer » le journal. Cette « prostitution » consiste à rejeter le principe autarcique et à adhérer à l’universalisme (messianique). Villard va alors contre-attaquer :
1. Il va rappeler qu’il est un avocat du Congrès, donc qu’il est démocrate et non philo-fasciste.
2. Il va également rappeler qu’il s’est opposé aux conservateurs de la CS.
3. Il va affirmer que c’est l’amateurisme de Roosevelt qui a conduit le New Deal à l’échec.
4. Il démontre qu’en soutenant Roosevelt, la gauche devient « fasciste » parce qu’elle contribue à museler le Congrès.
Ni le Japon ni l’Allemagne n’en veulent aux Etats-Unis, écrit-il, donc nul besoin de leur faire la guerre. L’objectif raisonnable à poursuivre, répète-t-il, est de juxtaposer sur la planète trois blocs modernes autarciques et hermétiques : l’Asie sous la direction du Japon, l’Europe et l’Amérique. Il rejoint l’America-First-Committee qui affirme que si les Etats-Unis interviennent en Asie et en Europe, le chaos s’étendra sur la Terre et les problèmes non résolus s’accumuleront.
Villard n’épargnera pas la politique de Truman et la criblera de ses critiques. Dans ses éditoriaux, Truman est décrit comme un « politicien de petite ville incompétent », monté en épingle par Roosevelt et sa « clique ». Villard critiquera le bombardement atomique de Hiroshima et de Nagasaki. Il s’opposera au Tribunal de Nuremberg, aux Américains cherchant à favoriser la mainmise de la France sur la Sarre, à tous ceux qui veulent morceler l’Allemagne. Villard sera ensuite un adversaire de la Guerre Froide, s’insurgera contre la partition de la Corée et contre la création de l’OTAN.
Robert A. TAFT
Le père de Robert A. Taft fut pendant un moment de sa vie Président de la CS. Le milieu familial était celui des Républicains de vieille tradition. Robert A. Taft exerce ses premières activités politiques dans le sillage de Herbert Hoover et collabore à son « Food Programm ». En 1918, il est élu en Ohio. En 1938, il devient Sénateur de cet Etat. Dès cette année, il s’engage à fond dans le combat pour la « non-intervention ». Toute politique, selon lui, doit être défensive. Il fustige les positions « idéalistes » (c’est-à-dire irréalistes), des messianistes démocrates. « Il faut défendre du concret et non des abstractions », tel est son leitmotiv. La guerre, dit-il, conduirait à museler le Congrès, à faire reculer les gouvernements locaux, à renforcer le gouvernement central. Même si l’Allemagne gagne, argumente-t-il, elle n’attaquera pas les Etats-Unis et la victoire éventuelle du Reich n’arrêterait pas les flux commerciaux. D’où, affirme Taft, il faut à tout prix renforcer le « Neutrality Act », empêcher les navires américains d’entrer dans les zones de combat, éviter les incidents et décréter un embargo général, mais qui permet toutefois le système de vente « cash-and-carry » (« payer et emporter »), à appliquer à tous les belligérants sans restriction. Taft est réaliste : il faut vendre tous les produits sans exception. Nye, Sénateur du North Dakota, et Wheeler, Sénateur du Montana, veulent un embargo sur les munitions, les armes et le coton.
« Lend-Lease » et « cash-and-carry »
Taft ne sera pas candidat républicain aux élections présidentielles car l’Est vote contre lui ; il ne bénéficie que de l’appui de l’Ouest, hostile à la guerre en Europe. Il s’opposera à la pratique commerciale du « Lend-Lease », car cela implique d’envoyer des convois dans l’Atlantique et provoque immanquablement des incidents. En juillet 1941, la nécessité de protéger les convois aboutit à l’occupation de l’Islande. Taft formule une contre-proposition : au « Lend-Lease », il faut substituer le « cash-and-carry », ce qui n’empêche nullement de produire des avions pour la Grande-Bretagne. En juin 1941, la gauche adhère à une sorte de front international anti-fasciste, à l’instigation des communistes (visibles et camouflés). Taft maintient sa volonté de neutralité et constate que la majorité est hostile à la guerre. Seule une minorité de financiers est favorable au conflit. Taft martèle alors son idée-force : le peuple travailleur de l’Ouest est manipulé par l’oligarchie financière de l’Est.
Dans le cadre du parti Républicain, Taft lutte également contre la fraction interventionniste. Son adversaire principal est Schlesinger qui prétend que les isolationnistes provoquent un schisme à l’intérieur du parti, qui risque de disparaître ou d’être exclu du pouvoir pendant longtemps. Dans cette lutte, que s’est-il passé ? Les interventionnistes républicains, rangés derrière Wendell Willkie, chercheront l’alliance avec la droite démocratique de Roosevelt, pour empêcher les Républicains de revenir au pouvoir. De 1932 à 1948, les Républicains seront marginalisés. Une telle configuration avait déjà marqué l’histoire américaine : le schisme des Whigs en 1858 sur la question de l’esclavage (qui a débouché ensuite sur la Guerre de Sécession).
Pour Schlesinger, les capitalistes, les conservateurs et la CS sont hostiles à Roosevelt et au New Deal, qu’ils estiment être une forme de socialisme. Taft rétorque que les ploutocrates et les financiers se sont alliés aux révolutionnaires, hostiles à la CS, car celle-ci est un principe étatique éternel, servant la cause du peuple, celui de la majorité généralement silencieuse. Les ploutocrates sont favorables au bellicisme de Roosevelt, parce qu’ils espèrent conquérir des marchés en Europe, en Asie et en Amérique latine. Telle est la raison de leur bellicisme.
Tant Schlesinger que Taft rejettent la responsabilité sur les capitalistes ou les financiers (les « ploutocrates » comme on disait à l’époque). La différence, c’est que Schlesinger dénonce comme capitalisme le capital producteur enraciné (investissements), alors que Taft dénonce le capital financier et vagabond (non-investissement).
Contre l’idée de « Croisade »
Quand les Japonais bombardent Pearl Harbour le 7 décembre 1941 et y détruisent les bâtiments de guerre qui s’y trouvent, la presse, unanime, se moque de Taft et de ses principes neutralistes. La stratégie japonaise a été de frapper le port hawaïen, où ne stationnaient que de vieux navires pour empêcher la flotte de porter secours aux Philippines, que les Japonais s’apprêtaient à envahir, avant de foncer vers les pétroles et le caoutchouc indonésiens. Taft rétorque qu’il aurait fallu négocier et accuse Roosevelt de négligence tant aux Iles Hawaï qu’aux Philippines. Il ne cesse de critiquer l’idée de croisade. Pourquoi les Etats-Unis seraient-ils les seuls à pouvoir déclencher des croisades ? Pourquoi pas Staline ? Ou Hitler ? L’idée et la pratique de la « croisade » conduit à la guerre perpétuelle, donc au chaos. Taft dénonce ensuite comme aberration l’alliance entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS (chère à Walter Lippmann). A cette alliance, il faut substituer des plans régionaux, regrouper autour de puissances hégémoniques les petits Etats trop faibles pour survivre harmonieusement dans un monde en pleine mutation d’échelle.
Taft s’opposera à Bretton Woods (1944), aux investissements massifs à l’étranger et à la création du FMI. Il manifestera son scepticisme à l’endroit de l’ONU (Dumbarton Oaks, 1944). Il y est favorable à condition que cette instance devienne une cour d’arbitrage, mais refuse tout renforcement de l’idéologie utopiste. Après la guerre Taft s’opposera à la Doctrine Truman, à la création de l’OTAN, au Plan Marshall et à la Guerre de Corée. En 1946, Churchill prononce sa phrase célèbre (« Nous avons tué le mauvais cochon », celui-ci étant Hitler, le « bon cochon » sous-entendu et à tuer étant Staline) et déplore qu’un « rideau de fer » soit tombé de Stettin à l’Adriatique, plongeant l’Ostmitteleuropa dans des « régimes policiers ». Taft, conservateur « vieux-républicain », admet les arguments anti-communistes, mais cette hostilité légitime sur le plan des principes ne doit pas conduire à la guerre dans les faits.
Taft s’oppose à l’OTAN parce qu’elle est une structure interventionniste, contraire aux intérêts du peuple américain et aux principes d’arbitrage qui devraient être ceux de l’ONU. En outre, elle sera un gouffre d’argent. Vis-à-vis de l’URSS, il modifie quelque peu son jugement dès que Moscou se dote de la Bombe A. Il appuie toutefois Joe Kennedy (père de John, Robert/Bob et Ted) quand celui-ci réclame le retrait des troupes américaines hors de Corée, de Berlin et d’Europe. Taft est immédiatement accusé de « faire le jeu de Moscou », mais il reste anti-communiste. En réalité, il demeure fidèle à ses positions de départ : il est un isolationniste américain, il constate que le Nouveau Monde est séparé de l’Ancien et que cette séparation est une donnée naturelle, dont il faut tenir compte.
John T. FLYNN
John T. Flynn peut être décrit comme un « New Dealer » déçu. Beard et Villard avaient également exprimé leurs déceptions face à l’échec de la restructuration par Roosevelt de l’économie nord-américaine. Flynn dénonce très tôt la démarche du Président consistant à se donner des « ennemis mythique » pour dévier l’attention des échecs du New Deal. Il critique la mutation des communistes américains, qui deviennent bellicistes à partir de 1941. Les communistes, dit-il, trahissent leurs idéaux et utilisent les Etats-Unis pour faire avancer la politique soviétique.
Flynn était proche malgré lui des milieux fascisants (et folkloriques) américains (Christian Front, German-American Bund, l’American Destiny Party de Joseph McWilliams, un antisémite). Mais le succès de Lindbergh et de son America-First-Committee l’intéresse. Après la guerre, il critiquera les positions de la Fabian Society (qu’il qualifie de « socialisme fascisant ») et plaidera pour un gouvernement populaire, ce qui l’amène dans le sillage de McCarthy. Dans cette optique, il fait souvent l’équation « communisme = administration », arguant que l’organisation de l’administration aux Etats-Unis a été introduite par Roosevelt et parachevée par Truman. Mais, malgré cette proximité avec l’anti-communisme le plus radical, Flynn reste hostile à la guerre de Corée et à toute intervention en Indochine, contre les communistes locaux.
Lawrence DENNIS
Né en 1893 à Atlanta en Géorgie, Lawrence Dennis étudie à la Philips Exeter Academy et à Harvard. Il sert son pays en France en 1918, où il accède au grade de lieutenant. Après la guerre, il entame une carrière de diplomate qui l’emmène en Roumanie, au Honduras, au Nicaragua (où il observe la rébellion de Sandino) et au Pérou (au moment où émerge l’indigénisme péruvien). Entre 1930 et 1940, il joue un rôle intellectuel majeur. En 1932, paraît son livre Is Capitalism Doomed ? C’est un plaidoyer planiste, contre l’extension démesurée des crédits, contre l’exportation de capitaux, contre le non-investissement qui préfère louer l’argent que l’investir sur place et génère ainsi le chômage. Le programme de Dennis est de forger une fiscalité cohérente, de poursuivre une politique d'investissements créateurs d’emploi et de développer une autarcie américaine. En 1936, un autre ouvrage suscite le débat : The Coming American Fascism. Ce livre constate l’échec du New Deal, à cause d’une planification déficiente. Il constate également le succès des fascismes italien et allemand qui, dit Dennis, tirent les bonnes conclusions des théories de Keynes. Le fascisme s’oppose au communisme car il n’est pas égalitaire et le non-égalitarisme favorise les bons techniciens et les bons gestionnaires (les « directeurs », dira Burnham).
Il y a une différence entre le « fascisme » (planiste) tel que le définit Dennis et le « fascisme » rooseveltien que dénoncent Beard, Villard, Flynn, etc. Ce césarisme/fascisme rooseveltien se déploie au nom de l’anti-fascisme et agresse les fascismes européens.
En 1940, un troisième ouvrage de Dennis fait la une : The Dynamics of War and Revolution. Dans cet ouvrage, Dennis prévoit la guerre, qui sera une « guerre réactionnaire ». Dennis reprend la distinction des Corradini, Sombart, Haushofer et Niekisch, entre « nations prolétariennes » et « nations capitalistes » (haves/havenots). La guerre, écrit Dennis, est la réaction des nations capitalistes. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, nations capitalistes, s’opposeront à l’Allemagne, l’Italie et l’URSS, nations prolétariennes (le Pacte germano-soviétique est encore en vigueur et Dennis ignore encore qu’il sera dissous en juin 1941). Mais The Dynamics of War and Revolution constitue surtout une autopsie du monde capitaliste américain et occidental. La logique capitaliste, explique Dennis, est expansive, elle cherche à s’étendre et, si elle n’a pas ou plus la possibilité de s’étendre, elle s’étiole et meurt. D’où le capitalisme cherche constamment des marchés, mais cette recherche ne peut pas être éternelle, la Terre n’étant pas extensible à l’infini. Le capitalisme n’est possible que lorsqu’il y a expansion territoriale. De là, naît la logique de la « frontière ». Le territoire s’agrandit et la population augmente. Les courbes de profit peuvent s’accroître, vu la nécessité d’investir pour occuper ou coloniser ces territoires, de les équiper, de leur donner une infrastructure, et la nécessité de nourrir une population en phase d’explosion démographique. Historiquement parlant, cette expansion a eu lieu entre 1600 et 1900 : les peuples blancs d’Europe et d’Amérique avaient une frontière, un but à atteindre, des territoires à défricher et à organiser. En 1600, l’Europe investit le Nouveau Monde ; de 1800 à 1900, les Etats-Unis ont leur Ouest ; l’Europe s’étend en Afrique.
L’ère capitaliste est terminée
Conclusion de Dennis : l’ère capitaliste est terminée. Il n’y aura plus de guerres faciles possibles, plus d’injection de conjoncture par des expéditions coloniales dotées de faibles moyens, peu coûteuses en matières d’investissements, mais rapportant énormément de dividendes. Cette impossibilité de nouvelles expansions territoriales explique la stagnation et la dépression. Dès lors, quatre possibilités s’offrent aux gouvernants :
1. Accepter passivement la stagnation ;
2. Opter pour le mode communiste, c’est-à-dire pour la dictature des intellectuels bourgeois qui n’ont plus pu accéder au capitalisme ;
3. Créer un régime directorial, corporatiste et collectiviste, sans supprimer l’initiative privée et où la fonction de contrôle politique-étatique consiste à donner des directives efficaces ;
4. Faire la guerre à grande échelle, à titre de palliatif.
Dennis est favorable à la troisième solution et craint la quatrième (pour laquelle opte Roosevelt). Dennis s’oppose à la seconde guerre mondiale, tant dans le Pacifique que sur le théâtre européen. Plus tard, il s’opposera aux guerres de Corée et du Vietnam, injections de conjoncture semblables, visant à détruire des matériels pour pouvoir en reconstruire ou pour amasser des dividendes, sur lesquels on spéculera et que l’on n’investira pas. Pour avoir pris de telles positions, Dennis sera injurié bassement par la presse du système de 1945 à 1955, mais il continue imperturbablement à affiner ses thèses. Il commence par réfuter l’idée de « péché » dans la pratique politique internationale : pour Dennis, il n’y a pas de « péché fasciste » ou de « péché communiste ». L’obsession américaine de pratiquer des politiques de « portes ouvertes » (open doors policy) est un euphémisme pour désigner le plus implacable des impérialismes. La guerre froide implique des risques énormes pour le monde entier. La guerre du Vietnam, son enlisement et son échec, montrent l’inutilité de la quatrième solution. Par cette analyse, Dennis a un impact incontestable sur la pensée contestatrice de gauche et sur la gauche populiste, en dépit de son étiquette de « fasciste ».
En 1969, dans Operational Thinking for Survival, Dennis offre à ses lecteurs sa somme finale. Elle consiste en une critique radicale de l’American Way of Life.
Conclusion
Nous avons évoqué cinq figures d’opposants américains à Roosevelt. Leurs arguments sont similaires, en dépit de leurs diverses provenances idéologiques et politiques. Nous aurions pu comparer leurs positions à celles de dissidents américains plus connus en Europe comme Lindbergh ou Ezra Pound, ou moins connus comme Hamilton Fish. Nous aurions pu également analyser les travaux de Hoggan, historien contemporain non conformiste, soulignant les responsabilités britanniques et américaines dans le deuxième conflit mondial et exposant minutieux des positions de Robert LaFollette. Enfin, nous aurions pu analyser plus en profondeur l’aventure politique de cet homme politique populiste des années 20, leader des « progressistes ». Leur point commun à tous : la volonté de maintenir une ligne isolationniste, de ne pas intervenir hors du Nouveau Monde, de maximiser le développement du territoire des Etats-Unis. 80% de la population les a suivis. Les intellectuels étaient partagés.
L’aventure de ces hommes nous montre la puissance de la manipulation médiatique, capable de retourner rapidement l’opinion de 80% de la population américaine et de les entraîner dans une guerre qui ne les concernait nullement. Elle démontre aussi l’impact des principes autarciques, devant conduire à une juxtaposition dans la paix de grands espaces autonomisés et auto-suffisants. En Europe, ce type de débat est délibérément ignoré en dépit de son ampleur et de sa profondeur, l’aventure intellectuelle et politique de ces Américains non conformistes est désormais inconnue et reste inexplorée.
Une étude de cette problématique interdit toute approche manichéenne. On constate que dans la gauche américaine (comme dans une certaine droite, celle de Taft, p. ex.), l’hostilité à la guerre contre Hitler et le Japon implique, par une logique implacable et constante, l’hostilité ultérieure à la guerre contre Staline, l’URSS, la Corée du Nord ou le Vietnam d’Ho Chi Minh. Dans l’espace linguistique francophone, il semble que les non-conformismes (de droite comme de gauche) n’aient jamais tenu compte de l’opposition intérieure à Roosevelt, dont la logique est d’une clarté et d’une limpidité admirables. Navrante myopie politique…
Robert STEUCKERS.
(Conférence prononcée à Ixelles à la Tribune de l’EROE en 1986, sous le patronage de Jean E. van der Taelen ; texte non publié jusqu’ici).






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg





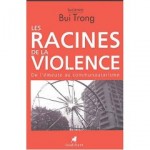










 Harde toespraak in München kan begin zijn van een ‘Poetindoctrine’
Harde toespraak in München kan begin zijn van een ‘Poetindoctrine’