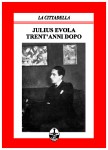É habitual, na nossa cultura, invocar o modelo grego como aquele da sabedoria, criando nos espíritos uma Grécia de postal ilustrado. As noções de serenidade, de equilíbrio e harmonia vêm naturalmente ao espírito daquele que se abandona à nostalgia do nosso grande passado. Porquê naturalmente? Sem dúvida porque essa Grécia é mais facilmente compreendida pelos nossos esquemas e quadros de pensamento modernos, pensamento ordenado, submetido à razão e à lógica. Contudo, essa Grécia, certamente bem real, é a que poderíamos denominar como “segundo movimento”, a que vai estabelecer limites e amar o que “está concluído”, ela tornou-se a nossa “referência grega”.
Um mundo sobre fundo de fogo, de ebriedade e de êxtase
Esses limites, ela colocou-os sobre um outro mundo, aquele que Nietzsche definirá em “O Nascimento da Tragédia” como o do reino de Dionísio, um mundo sobre fundo de fogo, de ebriedade e de êxtase. Esse mundo, gerador da vida da nossa cultura, está-nos muito mais inacessível, muito mais obscuro que aquele da época clássica, é o que vê nascer e viver os mitos de extraordinária potência cuja evocação não deixa de exercer sobre um bom número de nós uma espécie de fascínio, é por isso que parece útil estudar a capacidade do nosso pensamento actual em integrá-los, ou mesmo somente em entendê-los. Referir-se aos mitos significa mergulhar na memória histórica, na grande memória, aquela que tem a fonte, as raízes, a matriz do nosso presente e portanto do nosso futuro. Os mitos que dominam toda a nossa Antiguidade europeia e que, sob formas atenuadas ou mesmo desnaturadas, sobrevivem ainda no início da nossa era, estes mitos são-nos acessíveis ou são como esses sinos dos quais, sob a aparência material intacta, não saem senão alguns sons derisórios e falsos, sem correspondência nem com o seu belo aspecto exterior nem com a potência de vibração que continham em si?
I-O pensamento pelos mitos
A tentativa de conhecimento dos mitos pelo homem moderno não é, como todas as suas abordagens, mais que intelectual. O nosso pensamento, apesar das tentativas dos românticos do século passado, já só pode fazer apelo à razão para tentar compreender: tornámo-nos incapacitados. É outra coisa diferente que seria necessário para penetrar as profundezas de uma cultura onde a vitalidade e a força não se podem reduzir a uma análise cartesiana, a uma compreensão. Os mitos nos quais se exprimia este pensamento, esses, a nossa pobre razão, tão seca, não foi capaz de mais do que concebê-los como símbolos. Segundo os séculos, as ideologias, as modas, as escolas ou as disciplinas, os mitos tornaram-se a expressão de um simbolismo que não é na realidade mais que o reflexo de conceitos modernos: alguns viram neles a expressão de um inconsciente colectivo, outros deram aos mitos uma função social e gente muito séria viu mesmo nos mitos elementos das lutas de classes. É preciso, então, abordar o estudo da mitologia sem demasiadas ilusões e sabendo que somos, face a ela, como o visitante de um museu que está separado do objecto da sua admiração por um vidro que lhe interdita todo o contacto. Para ilustrar esta tentativa, tomemos o exemplo de um mito muito revelador, um mito profundamente enraizado na cultura grega ao longo da sua evolução e que, ademais, tem o interesse de ter passado parcialmente para a nossa cultura: o mito de Hércules.
O mito de Hércules
De origem puramente grega, e mais precisamente dórica, segundo fontes tão precisas quanto Walter Otto ou Wilamowitz, o seu culto espalha-se rapidamente em torno do mediterrâneo onde se enriquece de deuses locais que absorve. Tornar-se-á uma personalidade mitológica muito complexa, e a sua evolução no tempo é muito reveladora do duplo problema que nos preocupa: a percepção do mito e a evolução do pensamento.
Este semideus, nascido dos amores de Zeus e Alcmena, uma mortal, será ao longo de toda a sua vida terrestre perseguido pelo ódio de Hera, esposa enganada de Zeus. A ele faltar-lhe-á sempre essa parte divina, essa “parte de Hera” que o impedirá de ser totalmente um deus. A sua vida, marcada por provações, é célebre pelos seus Doze Trabalhos, mas está longe de ser exemplar. Este herói tem fraquezas, enlouquecido por Hera, ele comete crimes (mata a sua primeira esposa, princesa Mégara, como os seus três filhos, de onde a purificação desta infâmia pelos Trabalhos, sendo que nenhum seria à partida possível de cumprir), abandona-se durante um ano aos pés de Onfales, rainha da Lídia, vago mito da encarnação do umbigo (omphalos) do mundo. Este semideus, à vez possante, louco, protector dos fracos, curandeiro (é por vezes associado a Esculápio), criminoso, é muito representativo da mentalidade grega para a qual o bem e o mal estão intimamente ligados; a idade moderna só conhece heróis totalmente bons, mas nos gregos, se lhes amputamos o mal é a vida que lhes suprimimos, porque ela é um todo onde o que é bom e o que é mau está de tal modo imbricado que é indissociável e necessário um ao outro. Um grego antigo não se atormenta por prestar culto a um herói que, para lá das suas qualidades, é um bêbado, um debochado, um homicida. A divindade não é, então, percepcionada como na nossa civilização presente, onde não é mais que um elemento religioso, mas antes como um elo entre o mundo divino e o mundo natural no qual ela se comporta de modo que nos é muito próximo. Uma tradição onde também existe a divindade ctoniana, isto é, associada à estância dos mortos. Mas a terra, essa estância dos mortos, é, ao mesmo tempo, a terra fecunda, portadora de frutos e colheitas: ali, novamente, coexiste o bom e o mau, como a vida e a morte.
O racionalismo moderno não pode apreender a essência dos mitos
Os mitos deste período chegam-nos pela poesia épica, género que provém da arte, da história e da religião, mas também pelo conhecimento dos cultos. Se, como acabámos de ver, não penetramos os mitos e não temos deles mais que um conhecimento externo, o mesmo vale para os cultos que, talvez ainda mais que os mitos, passaram nos nossos dias pelo filtro do racionalismo e do funcionalismo. Portanto, vários estudiosos, a maior parte alemães, viram e denunciaram a nossa incapacidade. Depois de Hölderlin, Walter Otto será o mais brilhante crítico das interpretações modernas. Cita como exemplo um muito velho rito de purificação que consistia em passear um ou dois homens pela cidade e em matá-los depois fora desta, destruindo completamente os seus cadáveres. Depois deste exemplo, Walter Otto (in Dyonisos, Mythe et Culte) reproduz a interpretação moderna típica que, naturalmente, procura a finalidade prática do rito:” Depois de ter absorvido todos os miasmas da Cidade, era morto e queimado, exactamente como se limpa uma mesa suja com uma esponja que jogamos fora depois”. E Otto sublinha “ a desproporção entre o acto em si e a intenção que lhe atribuímos”. Este exemplo é característico do impasse no qual nos encontramos para apreender um pensamento que se manifesta através de mitos e ritos que somos incapazes de comentar sem ser com um vocabulário submetido à razão, ao espírito de causalidade, ao espírito prático, ao nosso “espírito cinzento e desencantado”.
Os gregos vão lutar contra a sua natureza e proteger-se do fundo trágico da existência através da cortina apolínea, a serenidade. Esta Grécia, diz-nos Nietzsche, a do equilíbrio entre o dionisíaco e o apolíneo, a da tragédia, encerra os seus mistérios como a do período dito arcaico. Ela dura pouco, 80 anos aproximadamente, e tem um brilho tal que não pode sobreviver por muito tempo. Entretanto, o pensamento vai evoluir e começar uma viragem que se revelará ser uma verdadeira ruptura, um pensamento que apreenderemos muito melhor porque abriu caminho ao pensamento moderno.
II-O pensamento pelas ideias
Se conhecemos o lugar privilegiado que Nietzsche atribui à música face às outras artes, porque emanando directamente da fonte, do instinto vital, não nos espantaremos com as violentas críticas que o filósofo alemão proferirá em relação a Sócrates, “o homem que não sabe cantar”. Sócrates vai privilegiar a consciência e a lucidez em relação ao instinto. Ele é o homem não místico; Nietzsche dirá: “o homem teórico”. Com efeito, Sócrates, o primeiro, vai permitir-se contemplar os mitos, concebê-los diferentemente do pensamento tradicional. O mito, de carnal e complexo, vai dirigir-se para a simplificação e a abstracção. Mais ainda, é o início de uma racionalização, de uma explicação. Em “Fedro”, de Platão, um diálogo entre Fedro e Sócrates é muito revelador do estado de espírito deste último. Evocando o mito no qual Oréstia é raptada por Bóreas, Fedro interroga:” Mas diz-me Sócrates, acreditas que esta aventura mitológica aconteceu realmente?”. E Sócrates responde:” Mas se eu duvidasse, como os sábios, não haveria lugar a espanto”. Sócrates explica que o sopro de Bóreas (o vento) provocou a queda de Oréstia, que morreu. Aí está, talvez, o primeiro argumento racional destinado a se substituir a um elemento mitológico. Vemo-lo aqui, este pensamento é muito moderno e muito acessível à nossa compreensão. Sócrates e Platão vão fazer evoluir os mitos, e do conhecimento instintivo deslizamos para o conhecimento racional. Não aceitamos mais o sentido místico do mundo que vai ser devorado pela lógica.
Os mitos não serão, contudo, abandonados: vão evoluir, à vez na maneira como são entendidos e na sua própria forma. É tempo aqui de retomar o mito de Hércules que deixámos na primeira parte desta exposição, em toda a força e potência ambíguas de um ser meio-divino, meio-humano, com a sua força sobre-humana, os seus deboches e as suas paixões desmesuradas. Depois de Sófocles, que em “As Traquínias”, faz dele um ser brutal e sem fineza, Hércules não parará de evoluir rumo a um tipo ideal. O período helenístico mostrá-lo-á como uma divindade civilizadora em que os seus Trabalhos são transformados em provas de utilidade pública, torna-se um benfeitor da humanidade ao serviço do bem. Os filósofos (cínicos e estóicos) vão exaltar o carácter altamente moral da aceitação voluntária dos sofrimentos que marcam a sua vida: ele aceita livremente o sacrifício, sacrifica-se pela humanidade. O seu nome é invocado nas situações difíceis (chamam-lhe “Alexikakos”, o afugentador de males) e torna-se o “herói” por excelência. Muito grego mas muito popular, passará para Roma onde sofrerá a mesma depuração que na Grécia. Este Hércules idealizado não terá dificuldade em sobreviver parcialmente na personagem de um outro semideus, purificador da terra e salvador da humanidade, o Cristo.
A racionalização é o prelúdio da moralização
Entretanto, o mito purificado desencarna-se cada vez mais e caminha rumo à idealização, à abstracção. Afastando-se do mundo, as divindades, deuses e heróis, tornam-se ideias, conceitos, absolutos. Assim, eles moralizam-se e a moralização surge-nos como o corolário inevitável do absoluto. Platão vai rejeitar o lado humano e recusar o que chamará ”mentiras de poetas”, e os deuses, pouco a pouco, recolher-se-ão sabiamente ao Olimpo, numa virtude exemplar que convida tanto à imitação como ao tédio. Invocando o mundo das ideias Platão abriu a porta a um mundo onde o Bem e o Mal se combatem: o mal é o mundo do instinto, do irracional, simbolizado em Platão pelo cavalo negro; o bem é o mundo da vontade, da temperança, simbolizado pelo cavalo branco; os dois cavalos são conduzidos pelo cocheiro: a razão. Este carro simboliza a alma humana que, vemo-lo, hierarquiza os seus dois componentes. O instinto, desde aí, não deixará de ser desprezado e a razão glorificada. O mito morrerá, esse magnífico vínculo que os homens haviam construído para ligar os seus deuses à condição humana, ao mundo natural; esse vínculo é doravante destruído, para sempre sacrificado por alguns homens orgulhosos de serem menos ingénuos, sobre o altar do que Heidegger chama, com graça, “o pensamento calculante”.
É preciso abandonar a esperança de renovar com os mitos fundadores, sob a sua forma original. Esta empreitada conduziria, ademais, a uma folclorização análoga à que vemos florescer nas aldeias onde, sob instigação de sindicatos de iniciativa, ranchos tradicionais alternam tristemente com majoretes. Contudo, sabemos que as civilizações morrem: a nossa, porque se apoia sobre a técnica, é mais frágil que outras. Um dia teremos necessidade de nos lembrarmos, deveremos fazer apelo a essa memória profunda afim de que, do caos, ressurja a vida que nasce do Eterno Retorno. Os velhos mitos serão transformados, darão nascimento a outros, graças à benevolência daquela a quem nunca cessámos de prestar culto: Mnemósine, deusa da memória e mãe das Musas. Então reapropriaremos a criação, a poesia, que os homens do nosso sangue nunca deveriam ter abandonado, deixando aos povos que nunca nada conseguiram criar os malefícios de uma razão especulativa que nos contaminou demasiado. Com a força das origens, forjaremos novos mitos para novas primaveras.
Catherine Salvisberg, VOULOIR n°56/58, 1989





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg






 Junges Forum Nr. 6: Evola von links! Metaphysisches Weltbild - Antibürgerlicher Geist
Junges Forum Nr. 6: Evola von links! Metaphysisches Weltbild - Antibürgerlicher Geist