 Tratto, per gentile concessione dell’Autore, dal sito www.gianfrancobertagni.it; precedentemente pubblicato in ArKete 3 (1/1999).
Tratto, per gentile concessione dell’Autore, dal sito www.gianfrancobertagni.it; precedentemente pubblicato in ArKete 3 (1/1999).
Una delle principali scoperte che Mircea Eliade fa nel suo periodo indiano è l’importanza del simbolo. L’articolo presenta la teoria eliadiana del simbolo, elemento mediano tra il sacro e l’uomo. Particolare rilevanza riveste il ’sistema simbolico’ all’interno del quale ogni simbolo agisce e senza il quale questo perde il suo più profondo significato; e ancora l’«evoluzionismo simbolico» che sembra a volte presentarsi nell’opera eliadiana.
Da sottolineare inoltre l’operatività nascosta del simbolo, agente nella totalità della struttura psichica dell’uomo, e quindi non solo nella parte cosciente. Solo grazie al simbolo e al simbolismo all’uomo è permessa un’esperienza religiosa totale, nella quale il sacro sia «ovunque e in nessun luogo». Dopo il conseguimento della laurea in filosofia, il giovane Mircea Eliade il 20 novembre del 1928 parte per l’India. Vi permarrà per tre anni, e grazie al patrocinio del maharaja Manindra Chandra Nandy di Kassimbazar, potrà godere di una borsa di studio che gli permetterà di penetrare i segreti della lingua sanscrita e della filosofia indiana, sotto l’ammaestramento del professor Surendranath Dasgupta.
Cinquant’anni dopo, Eliade, in un’intervista con Claude-Henri Rocquet, ricordò l’importanza della sua esperienza indiana, nella quale venne a contatto con tre aspetti della spiritualità che saranno tra gli assunti metodologici del futuro storico delle religioni romeno. Egli scoprì quel tentativo tipico della religiosità indiana che consiste nel trasfigurare la vita dell’uomo in un’esperienza sacramantale. Per Eliade, del resto, l’esperienza religiosa tende alla santificazione dell’intera realtà; soprattutto l’uomo appartenente alle società arcaiche riusciva - secondo lo studioso romeno - a realizzare in qualsiasi ambito della sua vita (personale e sociale) una coesistenza tra il suo essere e la sfera del sacro, che lo proiettava in una situazione in cui realtà metafisica e libertà sono un tutt’uno: gli “atti elementari diventano, per il «primitivo», un rito; la sua mediazione aiuta l’uomo ad avvicinare la realtà, a inserirsi nell’ontico, liberandosi dagli automatismi (privi di contenuto e di significato) del divenire, del «profano», del nulla”[1].
Questo tipo di uomo era tale nella misura in cui non era naturale, inserito invece nella pienezza della realtà, realtà che per Eliade significa sacro, ontico. Inoltre, nella tipica contrapposizione eliadiana tra sacro e storia, se quest’ultima “è sempre una caduta del sacro, […] [esso] non cessa di manifestarsi, e in ogni sua nuova manifestazione riafferma la sua originaria tendenza a rivelarsi totalmente e perfettamente”[2]. Quindi il sacro si manifesta, ma soprattutto, continua a manifestarsi nelle più diverse forme, in forza della sua inesauribilità; ogni teofania, ogni cratofania, ogni ierofania indica il sacro, ma nello stesso tempo lo limita, indica cioè che quello che essa mostra non è il sacro originario. Appunto per questo, secondo Eliade, ogni esperienza religiosa tende, per sua natura, alla mistica, cioè ad un’esperienza spirituale totale e totalizzante: “Un’esperienza religiosa totale […], se riesce, porta all’esperienza mistica assoluta, che scopre e identifica il sacro dovunque e in nessun luogo nell’Universo”[3].
Eliade scopre, nella sua permanenza in India, anche l’importanza dell’uomo neolitico nelle successive fasi culturali dell’umanità. Quegli archetipi antichissimi, originari delle spiritualità arcaiche dei popoli, tornano con nuovi nomi anche nelle tradizioni religiose ad esse posteriori. Una volta conosciuto il mondo degli archetipi, l’uomo non potrà mai liberarsene; egli potrà viverlo ritualmente attraverso la riattualizzazione dei miti e la trasfigurazione del tempo profano in tempo sacro, potrà esserne contemporaneo grazie alla ripetizione dei gesti degli esseri soprannaturali per dare valore alle sue attività quotidiane, come potrà ritrovarli inconsciamente nella nostra epoca secolarizzata grazie ai sogni, alle opere artistiche o in quelle situazioni oggi desacralizzate ma originariamente religiose; in ogni caso, le intuizioni del mondo arcaico sopravvivono in ogni epoca: “L’uomo potrebbe sfuggire da ogni cosa, meno che dalle sue intuizioni archetipiche, create nel momento in cui ha preso coscienza della sua posizione nel Cosmo. […] La spiritualità arcaica, così come l’abbiamo decifrata, assetata di ontico, continua fino ai giorni nostri”[4].
Ma Eliade in India fa anche una scoperta che non meno di queste sarà fondamentale all’interno della sua teoria morfologica delle religioni. Eliade scopre il significato del simbolo. Nella sua intervista a Rocquet racconta come in Romania, prima della sua esperienza indiana, non si sentisse affatto attratto dalla vita religiosa, come interpretasse le icone che riempivano le chiese di Bucarest quasi alla stregua di idoli: “Ebbene, in India mi è capitato di vivere in un villaggio di Bengala e ho visto delle donne e delle ragazze che accarezzavano e decoravano un lingam, un simbolo fallico”. E capì allora il senso del simbolo, in quel caso del lingam. Quest’ultimo voleva dire molte cose: l’origine della vita, della creatività, della fertilità cosmiche; si trattava dell’epifania di Siva. “Allora questa possibilità di provare un’emozione religiosa in virtù dell’immagine e del simbolo, mi ha rivelato tutto un mondo di valori spirituali”.
E allora anche davanti ad un’icona il credente non vedrà semplicemente l’immagine di una donna con un bambino, ma vivrà l’esperienza del mistero della madre di Dio, della santa Sophia. “Immaginate l’importanza di questa scoperta, dell’importanza del simbolismo religioso nelle culture tradizionali nella mia formazione”[5]. Il lingam non è un feticcio: esso non viene venerato in se stesso, e questa è una caratteristica della ierofania. L’oggetto ierofanico mostra qualcosa di altro, trascende la sua materialità e oggettività, in quanto investito di una potenza che lo trasfigura; in forza di ciò non si può parlare di idolatria: “Mai un albero fu adorato unicamente per se stesso, sempre per quel che si «rivelava» per suo mezzo”[6]; e neppure si può parlare di panteismo: “Un solo oggetto (o simbolo) indica la presenza della Natura. Non si tratta dunque di un sentimento panteistico, simpatia o adorazione della natura, ma di un sentimento provocato dalla presenza del simbolo (ramo, albero, ecc.) e stimolato dall’attuazione del rito (processioni, lotte, gare, ecc.)”[7].
“Sovente, degli esseri, degli oggetti, delle azioni sono «potenti», hanno del mana, perché traggono la loro «potenza» da un principio che la precede e in un certo senso la fonda: un simbolo (un Essere supremo, un avvenimento mitico, ecc.)”[8]. E ancora: “L’efficacia delle pietre non è mai insita in loro; partecipano a un principio o incarnano un simbolo, esprimono una «simpatia» cosmica o traducono un’origine celeste. Queste pietre sono segni di una realtà spirituale diversa, o strumenti di una forza alla quale servono soltanto di ricettacolo”[9]. In queste ultime due citazioni abbiamo a che fare con un concetto di simbolo che si discosta in parte, come vedremo, da quello che comunemente utilizza Eliade, ma entrambe indicano quella peculiarità della ierofania che fa di essa ciò che è grazie ad una realtà che trascende quella in cui si viene a trovare l’oggetto investito di sacralità. E questa è la caratteristica principale del simbolo: “I simboli possono rivelare una modalità del reale o una struttura del mondo che non sono evidenti sul piano dell’esperienza immediata. […] I simboli religiosi […] svelano il lato miracoloso, inesplicabile della Vita e ad un tempo la dimensione sacramentale dell’esistenza umana”[10].
Per la mentalità arcaica, il mondo è un organismo nel quale tutto è collegato. Ogni segno ne richiama altri, e così i diversi piani della realtà comunicano tra loro. Se un solo oggetto indica la natura intera, ciò è dovuto alle caratteristiche del simbolo: “Se il Tutto esiste nell’interno di ciascun frammento significativo, questo […] avviene […] perché ogni frammento significativo ripete il Tutto”[11]. È allora possibile passare dal piano isolato del simbolo a quello del simbolismo; ed è proprio ciascuno dei suoi elementi che lo riassume e lo evoca interamente; non si può parlare di simbolo che sia isolato: “Non esiste simbolo, emblema o efficienza che sia monovalente o singolarizzato. Tutto è collegato, ogni cosa è legata alle altre, formando un insieme di struttura cosmica”[12]. Se ogni simbolo richiama un simbolismo, allora quest’ultimo può essere studiato solo attraverso un esame di tutti i simboli che ne costituiscono la trama: “Ogni simbolismo «fa sistema» e si può realmente comprenderlo soltanto nella misura in cui lo si considera nella totalità delle sue applicazioni particolari”[13]. Il motivo per cui il simbolismo non è solo un insieme, ma è un ’sistema’ è dato dal fatto che esso, come un organismo vivo, “permette la circolazione, il passaggio, da un livello all’altro, da un modo all’altro, integrando tutti questi livelli e piani, ma senza confonderli. La tendenza a coincidere col Tutto dev’essere intesa come tendenza a integrare il «tutto» in un sistema”[14].
Il simbolo non solo richiama una modalità trascendente quella profana, ma fa sì che anche la realtà quotidiana venga trasfigurata: “La multivalenza simbolica di un emblema o di una parola appartenente alle lingue arcaiche ci obbliga continuamente a notare che, per la coscienza che le formò, il mondo si rivelava come un tutto organico”[15]. La peculiarità di questo tipo di realtà, nella quale viene compresa e vissuta la forza del simbolo, è che i piani interferiscono tra loro; ad esempio: “La fecondità della donna influisce sulla fecondità dei campi, ma l’abbondanza della vegetazione, a sua volta, aiuta la donna a concepire”[16].
L’esempio classico, su cui Eliade torna più volte, è la luna: “La grande importanza della luna nelle mitologie arcaiche, e soprattutto l’integrazione in un unico ’sistema’, da parte del simbolismo lunare, di realtà diverse tra loro come la donna, le acque, la vegetazione, il serpente, la fertilità, la morte, la ‘ri-nascita’, ecc.”[17]. Ma qui è da sottolineare quanto non sia un semplice fatto naturale a connettere diverse realtà tra loro, ma un simbolismo, che forma quella rete di collegamenti, grazie alla quale si può parlare giustamente di ’sistema’. È il simbolismo, e non la luna, che fonda la possibilità, ad esempio, di legare la donna alla terra: “Un complesso simbolismo, dalla struttura antropocosmica, associa la donna e la sessualità ai ritmi lunari, alla Terra (assimilata alla matrice) e a ciò che dobbiamo chiamare il ‘mistero’ della vegetazione”[18]. La struttura simbolica di qualsiasi complesso religioso non è cioè una sorta di religione naturalistica, ma trova origine in una intuizione archetipica, pre-razionale, che è alla base della metafisica a struttura platonica della religiosità arcaica; la caduta del simbolismo in una interpretazione esclusivamente ‘fattuale’ è invece sinonimo di degradazione.
A riguardo delle origini del simbolismo della perla, Eliade evidenzia che esse non sono “empiriche, ma teoriche e metafisiche”; tuttavia “questo simbolismo, in seguito, fu interpretato, «vissuto» diversamente, poi degradato fino alle superstizioni e al valore economico-estetico che rappresenta per noi la perla”[19]. Anche considerando i rituali della vegetazione, rituali così intimamente connessi ad un certo periodo dell’anno, Eliade riafferma la priorità dell’intuizione metafisica: “La concezione teorica, metafisica, precede l’esperienza concreta e l’avvento della primavera”[20]. Infatti, “il simbolo non può essere il riflesso dei ritmi cosmici in quanto fenomeni naturali, in quanto un simbolo rivela sempre qualcosa di più che l’aspetto della vita cosmica che sta a rappresentare”[21]: il simbolo, nel pensiero arcaico - fondato sui complessi mitico-rituali e simbolici -, approda ad una metafisica sistematica che ripercorre l’intera vita religiosa. I simboli, i miti, i riti, attraverso diverse modalità, esprimono, “un complesso sistema di affermazioni coerenti sulla realtà ultima delle cose, sistema che può essere considerato come una vera e propria metafisica”[22].
Peculiare di questo tipo di metafisica è il basarsi su simboli e non esclusivamente su concetti, come accade nella prassi filosofica comune; è infatti proprio della mentalità primitiva il pensare per simboli, caratteristica che non preclude la possibilità di una logica soggiacente: “Il pensiero arcaico non procede esclusivamente per concetti o elementi concettuali, ma si serve anche e anzitutto di simboli. […] I simboli vengono «maneggiati» secondo una logica simbolica”[23]. Si può quindi parlare di una “logica del simbolo”[24], inseribile a pieno titolo tra i problemi essenzialmente filosofici: la “logica del simbolo esce dal campo della storia delle religioni propriamente detta e si schiera fra i problemi della filosofia”[25]. Ma soprattutto la possibilità di vedere nella logica dei simboli una vera e propria ontologia è data dal fatto che, essendo questi di tipo essenzialmente religioso, non possono che riguardare ciò che è il reale per definizione, cioè il sacro e ciò che da esso è investito: “Per i primitivi, i simboli sono sempre religiosi, poiché mirano o a qualcosa di reale, o a una struttura del mondo. Ora, ai livelli arcaici della cultura il reale - cioè il potente, il significativo, il vivente - equivale al sacro. […] Per questo i simboli religiosi arcaici implicano una ontologia”[26].
Attraverso il simbolo, il mondo diviene trasparente all’uomo e assume ai suoi occhi un significato: quell’universo di significati nel quale è immerso l’uomo delle società in cui il mito è cosa vivente “non è più una massa opaca di oggetti arbitrariamente gettati assieme, ma un Cosmo vivente, articolato e significativo. In ultima analisi, il Mondo si rivela come linguaggio”[27]. Un linguaggio che può essere inteso dall’uomo perché è da lui condiviso. Del resto, un’altra caratteristica del simbolo è che esso apre la realtà nella quale agisce; questo vale sia per l’uomo (”L’uomo non si sente rinchiuso nel suo modo d’esistenza; anch’egli è «aperto», comunica con il Mondo, perché utilizza lo stesso linguaggio: il simbolo”[28]), che per il mondo stesso: “Per il pensiero simbolico, il mondo non è solo «vivo», è anche «aperto»: un oggetto non è mai semplicemente se stesso (come accade per la coscienza moderna), è anche segno o ricettacolo di qualcos’altro, di una realtà che trascende il livello d’essere dell’oggetto”[29]. Il mondo, grazie al simbolo, svela all’uomo la sua apertura verso ciò che lo supera; vi è infatti tutta una serie di simbolismi che, nella varietà dei loro caratteri, sono accomunati dalla stessa descrizione della struttura del mondo: “Le ascensioni rituali al cielo avvengono sempre in un «centro» […] ogni abitazione umana è una imago mundi […] tutti questi simboli collegati e complementari presentano, ciascuno nella propria prospettiva, uno stesso significato: l’uomo può trascendere il mondo”[30].
Gianfranco Bertagni
Tratto, per gentile concessione dell’Autore, dal sito www.gianf rancobertagni.it; precedentemente pubblicato in ArKete 3 (1/1999).
NOTE
[1] Mircea Eliade, Trattato di storia delle religioni, Boringhieri, 1988, p. 39.
[2] Id., Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Mediterranee, 1975, p. 15.
[3] Id., Spezzare il tetto della casa. La creatività e i suoi simboli, Jaca Book, 1988, p. 203.
[4] Id., I riti del costruire, Jaca Book, 1990, p. 111.
[5] Id., La prova del labirinto, Jaca Book, 1980, p. 54. Le pp. 53-58 sono dedicate a Le tre lezioni dell’India cui accenniamo.
[6] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 276.
[7] Ibidem, pp. 336-7.
[8] Id., Spezzare il tetto della casa, cit., p. 201.
[9] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 234.
[10] Id., Mefistofele e l’androgine, Mediterranee, 1971, pp. 189-90.
[11] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 277.
[12] Ibidem, pp. 160-1.
[13] Id., Miti, sogni e misteri, Rusconi, 1976, p. 137.
[14] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 470.
[15] Ibidem, p. 195.
[16] Ibidem, p. 369.
[17] Id., Storia delle credenze e delle idee religiose, vol. I: Dall’età della pietra ai misteri eleusini, Sansoni, 1979, p. 34.
[18] Ibidem, p. 53. È da sottolineare però anche una certa oscillazione in Eliade, per cui a volte sembra che sia proprio la luna a creare il suo simbolismo. Ad esempio nel passo seguente: “L’intuizione della Luna, in quanto norma dei ritmi e fonte di energie, di vita e di rigenerazione, ha intessuto realmente una rete fra tutti i piani cosmici, creando simmetrie, analogie e partecipazioni fra fenomeni infinitamente vari”: Mircea Eliade, Trattato di storia delle religioni, cit., p. 176.
[19] Ibidem, p. 456.
[20] Ibidem, p. 339.
[21] Id., Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico-religioso, TEA, 1993, p. 156.
[22] Id., Il mito dell’eterno ritorno, Rusconi, 1975, p. 15.
[23] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 40.
[24] Ibidem, p. 467.
[25] Ibidem, p. 471.
[26] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., p. 190.
[27] Id., Mito e realtà, Borla, 1976, p. 175.
[28] Ibidem, pp. 176-7.
[29] Id., Arti del metallo e alchimia, Bollati Boringhieri, 1976, p. 127.
[30] Id., Miti, sogni e misteri, cit., p. 133.
Il linguaggio attraverso il quale il mondo si rivela non è equiparabile al linguaggio usuale, quotidiano, perché la realtà di cui esso comunica l’essenza non è quella profana: “Non si tratta di un linguaggio utilitario e oggettivo. Il simbolo non ricalca la realtà oggettiva. Esso rivela qualche cosa di più profondo e di più fondamentale”[31]. Infatti abbiamo già detto che la realtà di cui ci parlano i simboli non è quella evidente all’esperienza comune; è invece - per certi versi - il suo opposto: per essempio, è paradossale: “Forse la funzione più importante del simbolismo religioso (importante, soprattutto per via del ruolo che doveva avere nelle successive speculazioni filosofiche) è la sua capacità di esprimere alcune situazioni paradossali e alcune strutture della realtà ultima, altrimenti impossibili ad esprimere”[32]; come è paradossale la ierofania stessa, la quale rivela e cela allo stesso tempo il sacro.
La paradossalità è vissuta nella vita dell’uomo attraverso quelle situazioni che lo pongono di fronte ai suoi limiti e ai loro superamenti, e queste sono espresse dal simbolo: “I simboli esprimono generalmente delle situazioni limite; un simbolo ci guida sempre verso il mistero della nascita, dell’amore, della fecondità, del rinnovamento, della morte e della resurrezione, dell’iniziazione, del passaggio da un modo d’essere all’altro, ecc.”[33]. Ogni simbolo esprime una situazione limite, e in forza di questo ci è consentito, secondo Eliade, confrontare simboli appartenenti a tradizioni diverse: “Quando, facendo astrazione dalla «storia» che li separa, noi raffrontiamo un simbolo oceaniano a un simbolo dell’Asia settentrionale, ci riteniamo autorizzati a farlo non in quanto entrambi sarebbero il prodotto di una stessa «mentalità infantile», bensì perché il simbolo, in se stesso, esprime la presa di conoscenza di una situazione-limite”[34]. L’uomo, i suoi ostacoli, le sue necessità sono identici ovunque e in ogni tempo: i simboli lo dimostrano.
Il simbolismo, comunicandoci la nostra natura paradossale e limitata, ci mette in contatto con la nostra situazione esistenziale: “Lo studio del simbolismo persegue [lo scopo di] decifrare […] la situazione esistenziale che ne ha reso possibile la costituzione”[35]; è questo aspetto che tocca più da vicino la natura umana, facendo sì che essa si senta pienamente coinvolta, chiamata in causa: essa non ha più a che fare con qualcosa che le è esterno, ma che invece la investe totalmente. Anche per questo aspetto, il simbolismo non è oggettivo: così il simbolismo religioso ha un valore esistenziale, infatti “un simbolo allude sempre a una realtà o ad una situazione tale da impegnare l’esistenza umana”. È innanzi tutto qui che i simboli si distinguono dai concetti. Il simbolo non solo comunica ma “dà anche un significato all’esistenza umana”. Attraverso il simbolismo, l’uomo esce dalla sua contingenza particolare, cosmicizzandosi: “«Vivere» un simbolo e decifrarne correttamente il messaggio implica l’apertura verso lo Spirito e alla fine l’accesso all’universale”[36]. Il simbolo ci informa dell’uomo in quanto tale: è questo che sembra significare Eliade quando parla di «situazione esistenziale», «valore esistenziale», ecc. Questo tipo di uomo è quello che non è ancora stato degradato dalla storia, dai condizionamenti dei tempi e delle culture: prima di essere storico, l’uomo è simbolico, ed è in quest’ultima modalità che vanno ricercate le strutture più significative e profonde che lo costituiscono: “Il pensiero simbolico […] è connaturato all’essere umano: precede il linguaggio e il ragionamento discorsivo. […] Le immagini, i simboli, i miti […] rispondono a una necessità ed adempiono una funzione importante: mettere a nudo le modalità più segrete dell’essere. Ne consegue che il loro studio ci permette di conoscere meglio l’uomo, l’«uomo tout court», quello che non è ancora sceso a patti con le condizioni della storia. Ogni essere storico porta con sé una grande parte dell’umanità prima della Storia”[37].
Il simbolo non è l’archetipo: non ha quindi una realtà autonoma rispetto alla quale l’uomo non deve far altro che conoscerla e adeguarcisi; giustamente Roberto Scagno, il maggior conoscitore di Eliade in Italia, ha scritto: “Il simbolo non è sostanza metafisica, ma strumento umano di riflessione e comunicazione”[38]. È infatti l’uomo l’unico creatore di simboli, oltre che unico fruitore; quindi, a differenza dell’archetipo, “il simbolo appare come una costruzione della psiche”[39]. L’uomo si caratterizza per quella particolare facoltà creatrice di simboli che gli è connaturata: “Dato che l’uomo dispone di una facoltà creatrice di simboli (symbol-forming power), tutto ciò che compie è simbolico”[40]. Si tratta quindi di una facoltà continuamente attiva, in forza della quale Eliade può parlare dell’uomo come homo symbolicus; infatti “i simboli non scompaiono mai dall’attualità psichica”[41]. Se ogni attività umana implica un simbolismo, allora anche “ogni fatto religioso avrà necessariamente un carattere simbolico”[42]. Vi è poi un circolo vizioso - anzi, eliadianamente virtuoso - per il quale anche il fatto religioso stesso, simbolico in quanto proprio dell’uomo, porta quest’ultimo ad interpretarsi come simbolo, esperienza esistenziale che gli consente di sentirsi parte di quella rete di simboli per eccellenza che è l’universo: “L’esperienza magico-religiosa permette la trasformazione dell’uomo stesso in simbolo. […] L’uomo non sente più di essere un frammento impermeabile, è invece un Cosmo vivo, aperto a tutti gli altri Cosmi vivi che lo circondano”[43].
In quanto dato immediato della coscienza, il simbolismo “determina sia l’attività del […] subcosciente [dell’uomo], sia le più nobili espressioni della sua vita spirituale”[44]. Eliade considera gli archetipi influenti, oltre che sulla vita spirituale, anche su quella subcosciente. Essendo l’attività dei simboli anche inconscia, ed essendo l’uomo il produttore di simboli, anche in un periodo non religioso come quello moderno si può continuare a parlare di un uomo che, seppur profano, “rimanendo uomo, produce ugualmente simboli; si tratta però di simboli degradati, che, non essendo consapevolmente riconosciuti, non possono svolgere pienamente la loro funzione. Solo il simbolo religioso è vissuto coscientemente, nella pienezza del suo significato”[45]. Se il vero significato del simbolo lo si può cogliere solo attraverso la sua comprensione religiosa, anche qui si riscontra una equivalenza con l’analisi eliadiana degli archetipi: questi ultimi hanno la loro sede propria nel transconscio, e anche i simboli, per la loro logica che è altra rispetto a quella propria della ragione (ricordiamo che il simbolismo per Eliade è l’opposto del razionalismo), rimandano a quel centro psichico che permette all’uomo religioso di vivere una vita pienamente regolata ai paradigmi divini. Compresa la logica del simbolo solo retoricamente si può porre la seguente domanda: “determinate zone dell’inconscio individuale o collettivo sono dominate, a loro volta, dal logos, oppure ci troviamo davanti a manifestazioni di un transconscio?”[46].
Simbolo e ierofania assolvono entrambi allo stesso compito: infatti modificano la consistenza ontologica della realtà che investono. Se la ierofania è “ciò che mostra il sacro”, allora la sua dialettica paradossale consiste proprio nell’indicare, ad esempio, un oggetto come la sede del sacro: il finito diventa infinito, pur mantenendo le sue proprietà. L’oggetto quindi si trasforma in qualcosa di altro, pur rimanendo tale. Un analogo discorso si può fare anche nei riguardi del simbolo: “La sua funzione resta invariabile: trasformare un oggetto o un atto in qualche cosa di diverso da quel che sono nella prospettiva dell’esperienza profana”[47]. In questo senso, il simbolo non è altro che la naturale continuazione della rivelazione ierofanica: “Il simbolo prolunga la dialettica della ierofania: tutto quel che non è direttamente consacrato da una ierofania, diventa sacro grazie alla sua partecipazione a un simbolo”[48]. Se la ierofania si ferma nel rivelare il sacro in un sasso, in una persona, in un gesto, ecc., il simbolo ha in sé la capacità di riepilogare il Cosmo intero, attraverso un’infinità di collegamenti con altri simboli: questo fa sì che, come abbiamo già visto, ogni simbolo si richiami al simbolismo di cui fa parte. Attraverso le ierofanie, l’esperienza religiosa si frammenta in una infinita discontinuità; invece “il simbolismo tradisce il bisogno dell’uomo di prolungare all’infinito la ierofanizzazione del Mondo”. Grazie ad esso, traspare all’uomo “una tendenza a identificare questa ierofania col complesso dell’Universo”[49].
Se la storia delle religioni è essenzialmente storia delle ierofanie, l’esperienza religiosa, se vuole accedere a quella visione mistica della realtà caratteristica di chi vede ovunque il sacro, deve inserirsi in un simbolismo che permetta di non arrestarsi alle ierofanie, che realizzano e giustificano la differenza ontologica tra sacro e profano, ma che consenta di superarle grazie a una trasfigurazione dello stesso profano. “Per la mentalità arcaica, natura e simbolo coesistono”[50]. Nell’esperienza mistica, la natura è tutta divina, tutto è archetipo, tutto ierofania, non esiste più sopra e sotto: “Per i «primitivi» in genere non esiste una differenza netta fra «naturale» e «sovrannaturale», fra oggetto empirico e simbolo. Un oggetto diviene «se stesso» (cioè incorpora un valore) nella misura in cui riproduce un archetipo, ecc.”[51]. Il profano può aspirare ad una sorta di realtà solo in quanto traccia del sacro; questo gli è possibile unicamente grazie al simbolo, che rende evidente la complementarità tra sacro e profano, attraverso la quale il simbolismo si estende sulla totalità del reale. Perciò è da evitare il “credere che il simbolismo si riferisca unicamente alle realtà «spirituali». Per il pensiero arcaico una separazione del genere tra lo «spirituale» e il «materiale» non ha senso: i due piani sono complementari”[52].
Ma questa distinzione tra la capacità onnicomprensiva del simbolo e la frammentazione del sacro attraverso le ierofanie non deve però condurci a contrapporre, per così dire, una “interpretazione ierofanica” a una “interpretazione simbolistica”: il sacro, infatti, per sua essenza, cerca la sua massima rivelazione nella realtà. E questo tentativo non può che esplicitarsi nelle stesse ierofanie, che sono la sua originaria manifestazione: così “la massima parte delle ierofanie sono atte a diventare simboli”[53]. Le ierofanie divengono a volte simboli, ma anche i simboli diventano ierofanie: ciò è forse ancor più inevitabile. Del resto ierofania è tutto ciò che rivela il sacro; allora anche il simbolo dovrà avere carattere ierofanico. Infatti, grazie ad esso, ci sono rivelate diverse sfere della realtà sacra, che altrimenti - cioè rimanendo sul piano delle ierofanie pure - ci rimarrebbero oscure. Per questo, “il simbolo […], all’occorrenza, è esso stesso una ierofania, cioè […] rivela una realtà sacra o cosmologica che nessun’altra «manifestazione» è capace di rivelare”[54]. Ogni ierofania è per altro parte di un simbolismo coerente all’interno del quale riceve il suo più vero significato, grazie al fatto che proprio di quest’ultimo è la capacità di comunicare il sacro nel modo più estensivo possibile, rendendo del tutto espliciti l’insieme dei significati che in ogni ierofania sono a volte solo accennati e frammentati: i “diversi simbolismi possono con ragione considerarsi «sistemi» autonomi, nella misura in cui manifestano più chiaramente, più totalmente e con coerenza superiore quel che le ierofanie manifestano in modo particolare, locale, successivo”[55]. Perciò ogni ierofania va interpretata, quando è possibile, all’interno del sistema simbolico di cui fa parte, per coglierne il significato profondo.
Certo, come il simbolo, anche il simbolismo non è una realtà oggettivamente constatabile (il “simbolismo acquatico non è manifestato in nessun luogo in modo concreto, non ha «sostegno», è formato da un insieme di simboli interdipendenti e integrabili in un sistema; nondimeno è reale”[56]), ma è quella costruzione teorica che è compito dello storico delle religioni rilevare, affinché in ogni fatto religioso sia esplicito il fascio di significati e la serie di legami con altre sfere del sacro in esso contenute: questa costruzione è possibile perché “un simbolo rivela sempre […] l’unità fondamentale di parecchie zone del reale. […]; d’altra parte gli oggetti, diventando simboli, cioè segni di una realtà trascendente, annullano i loro limiti concreti, cessano di essere frammenti isolati, per integrarsi in un sistema”[57].
Il simbolo, oltre a richiamare altri simboli, riceve in sé i sempre nuovi significati di cui la storia lo investe nelle diverse tradizioni religiose: “Il simbolo è sempre aperto. […] L’interpretazione non è mai conclusa”[58]. Consideriamo, ad esempio, il simbolo dell’albero. Quest’ultimo rappresenta il Cosmo, nella sua inesauribile rigenerazione, simbolo a sua volta dell’eternità: allora, “l’albero-Cosmo può per questo diventare, su di un altro livello, albero della «Vita-senza-morte»”. Ma la vita eterna, nella metafisica arcaica, vuole significare la realtà assoluta, e dunque “l’albero diventa il simbolo di questa realtà («il centro del mondo»)”[59].
Sarà allora obbligatoria a chiunque voglia conoscere il significato di un qualsiasi simbolo religioso, compararne i diversi contenuti nelle varie tradizioni e anche in una stessa storia religiosa: “Un simbolo resta vuoto di senso, se non si analizza un numero molto grande di varianti. Ora, tra queste non esiste, talvolta, alcuna contiguità storica e ciò rende ancora più difficile il lavoro d’interpretazione”[60]. Il simbolismo che si ricaverà da questo approccio comparativo sarà necessariamente trans-culturale, trans-storico, nella certezza che, secondo l’impostazione eliadiana, la coerenza non potrà mai essere contraddetta, in forza di quei principi paradigmatici che sempre e comunque si rivelano identici a se stessi nel loro significato più profondo: “È in una prospettiva totale che racchiude la totalità delle culture che dobbiamo giudicare la fecondità di un simbolismo il quale esprime le strutture della vita cosmica e contemporaneamente rende intelligibile il modo di essere dell’uomo nel mondo”[61]. La comparazione però non si spinge fino all’appiattimento di qualsiasi significato ad un unicum: se da una parte, l’analisi delle diverse interpretazioni dello stesso simbolo ci indicano il suo valore archetipico, dall’altra essa sola ci consente di valutare correttamente e mettere in risalto quelle differenze ineliminabili dovute alla storia, all’ideologia religiosa di cui esso fa parte, ecc.: “La struttura di un simbolismo si lascia decifrare completamente solo quando si è analizzato un notevole numero di esempi. […] Solo dopo aver esaminato tutte le varianti, la diversità del significato di ognuna vien bene in rilievo”[62]. Così Eliade riassume la sua posizione rispetto alla comparazione tra i simboli: “Si cerca di ricostruire il significato simbolico di fatti religiosi in apparenza eterogenei ma strutturalmente collegati […]. Un tale procedimento non implica la riduzione di tutti i significati a un comune denominatore. Non si potrà insistere mai abbastanza sul fatto che la ricerca sulle strutture simboliche è un lavoro, non di riduzione ma di integrazione. Si paragonano e si confrontano due espressioni di uno stesso simbolo non per ridurle a una forma unica preesistente, ma per scoprire il processo grazie al quale una struttura può arricchirsi di nuovi significati”[63].
In che senso ‘può arricchirsi di nuovi significati’? Il significato permane al di là della mutevolezza dei significanti. Ma, oltre che permanere, viene maggiormente inteso, sempre più profondamente vissuto: il motivo è la dialettica caratteristica del sacro, che fa sì che esso non smetta mai di manifestarsi, cercando sempre nuove ierofanie, nel tentativo di totalizzarsi nell’intera realtà. A tale riguardo, sembra esservi a volte in Eliade una sorta di “evoluzionismo ierofanico”; “Le innumerevoli nuove manifestazioni del sacro ripetono […] altre innumerevoli manifestazioni di esso già contenute […] nel […] passato, nella […] «storia»: ma è parimenti vero che l’esistenza di questa storia non giunge fino a paralizzare la spontaneità delle ierofanie: una rivelazione più completa del sacro resta sempre possibile, in qualsiasi momento”[64].
Come nelle ierofanie, anche nei simboli, se da una parte il fascio di significati in essi contenuti sembra rifarsi al piano degli archetipi, dall’altra parte il vero senso del simbolo, la sua pienezza teoretica si rende evidente - a volte - solo nella sua maturità: “Il senso ultimo di certi simboli si manifesta soltanto nella loro «maturità», cioè quando si considera la loro funzione nelle operazioni più complesse dello spirito”[65]. Si può dunque parlare anche di «evoluzionismo simbolico», che comunque è un tutt’uno con la dialettica delle ierofanie, in quanto riconducibili entrambi in quella carica intrinseca del sacro per cui esso cerca di rivelarsi nel modo più aperto possibile. Questo tipo di evoluzionismo il più delle volte si presenta non solo come evoluzionismo metafisico, ma anche come evoluzionismo storico: ad esempio, l’ontofania del sasso cultuale “può modificare la sua «forma» nel corso della storia; lo stesso sasso”, se prima mostrava semplicemente che il sacro è cosa diversa dall’ambiente circostante, che, simile alla roccia, il sacro «è» di carattere assoluto, “potrà essere venerato, più tardi, non per quanto rivela in modo immediato (non più come ierofania elementare), ma perché è integrato in uno spazio sacro (tempio, altare, ecc.) o perché è considerato l’epifania di un dio, ecc.”[66].
Si tratta però di un evoluzionismo molto particolare: a volte cioè sembra che un’immagine, un simbolo, siano naturalmente portati a includere certi significati, e che se essi diverranno espliciti solo da un certo momento storico, ciò comunque vorrà dire che non potevano che essere contenuti in quel particolare simbolo, e non in altri: per esempio, la rivelazione portata dalla fede (l'’invenzione’ del giudaismo), “non distruggeva i significati «primari» delle Immagini[67], ma si limitava semplicemente ad aggiungere ad esse un nuovo valore”; resta però sempre vero che “ogni nuova messa in valore è sempre stata condizionata dalla struttura stessa dell’Immagine, a tal punto che di un’Immagine si può dire che essa attende che il suo significato si compia”[68]. Più spesso invece Eliade, facendosi aiutare dai risultati della psicologia del profondo, indica la totalità dei significati residente da sempre nel simbolo: alcuni sarebbero vissuti in modo cosciente, altri in modo incosciente, ma tutti assolverebbero alla loro funzione nella vita spirituale dell’uomo. Nella conclusione di un articolo sul simbolismo religioso Eliade si chiede se i ’significati superiori’ dei simboli, espliciti nella piena maturità di questi ultimi, non fossero già impliciti, quindi almeno in vago modo percepiti anche dagli uomini appartenenti alle culture più arcaiche. Il problema è assai arduo, perché - continua Eliade - il simbolo agisce all’interno di tutta la struttura psichica: quindi il messaggio di un simbolo non si può circoscriverlo ai significati di cui si è coscienti. Quindi abbiamo a che fare con due conseguenze: “1) Se a un certo punto della storia un simbolo religioso ha potuto esprimere con chiarezza un significato trascendente, si è autorizzati a supporre che in un’epoca anteriore questo significato ha potuto essere oscuramente presentito”; inoltre, come avevamo avuto già modo di rilevare, “2) per decifrare un simbolo religioso, non basta prendere in considerazione tutti i suoi contesti, bisogna anche, e soprattutto, riflettere sui significati che esso ha avuto in quella che si potrebbe chiamare la sua «maturità»”[69].
In Eliade dunque il cosiddetto ‘terrore della storia’, su cui lo studioso romeno spesso si è soffermato, coesiste con una sotterranea consapevolezza della positività del procedere storico, nel senso di portatore di nuovi valori, nella sempre nuova e sempre più matura interpretazione dei simboli. La sua idea secondo la quale sarebbe la religiosità cosmica immanente al mondo a informare l’uomo della sua situazione esistenziale, fa sì che egli tenti di limitare di molto tutti quei valori religiosi che invece vengono comunicati attraverso la storia: i simboli derivanti, in certo modo, dalla storia sono dichiarati come “molto meno frequenti dei simboli a struttura cosmica o di quelli che si riferiscono alla condizione umana”[70]. Eliade si dichiara disinteressato a ciò che può costituire la storia di un simbolo; il suo Trattato ne è l’esempio classico. Spesso dichiara che se si dovrà fare una storia delle religioni, prima sarà necessario comprendere da dentro le strutture e i significati delle diverse esperienze religiose: “Il problema della «storia» dei motivi interessa la nostra ricerca soltanto in via sussidiaria. […] Quel che ci interessa per ora è di sapere quale fu la funzione religiosa”[71]. Per altro verso, anche quei simboli che provengono da una storia recente, sistematizzatori di quelle nuove acquisizioni che l’uomo ha avuto - per esempio, nell’ambito della tecnica - sono diventati simboli religiosi grazie alla loro funzione di creatori di cultura. Se una parte di realtà è fondata dal simbolo in un certo periodo storico, allora esso, rivestito del suo carattere sacro (in quanto solo il sacro è reale e il reale è tale in quanto rimanda al sacro), esce dal tempo, portandosi nella sua sede originaria, cioè nell’illud tempus: “Certi simboli legati a fatti recenti di cultura, pur essendo situati nel tempo storico sono divenuti simboli religiosi per aver contribuito a «fondare il mondo», nel senso da permettere a nuovi mondi rivelati dall’agricoltura, dall’addomesticamento degli animali, dalla regalità, di «parlare», di rivelarsi agli uomini, svelando nello stesso punto nuove situazioni umane. In altre parole, i simboli legati a fasi recenti di cultura si sono costituiti allo stesso modo dei simboli più arcaici, cioè come il risultato di tensioni esistenziali e di assunzioni totali del mondo. Quale pur sia la storia di un simbolo religioso, la sua funzione è sempre la stessa”[72].
In questa ermeneutica del simbolo, ogni documento costituisce un prezioso elemento: l’eterogeneità dei significati compresi in un simbolo ci è evidente anche dalla diversificazione delle fonti di cui disponiamo: le diverse provenienze e i diversi contenuti dei documenti sono da considerare “indispensabili, non soltanto per ricostruire la storia di una ierofania, ma anzitutto perché concorrono a costruire le modalità del sacro rivelate attraverso questa ierofania”[73]. Tale eterogeneità dei documenti è indispensabile non solo per una completa comprensione del simbolo , ma anche per una più generale morfologia del sacro: in essa, simbolo, mito e rito devono essere gli imprescindibili strumenti di lavoro dello storico delle religioni. Infatti ognuno di questi generi di documenti mostra regioni del sacro di cui gli altri non partecipano o partecipano solo in maniera implicita e nascosta: solo essi, presi insieme, possono “rivelarci tutte le modalità del sacro, perché un simbolo o un mito lasciano trasparire nettamente le modalità che un rito non può manifestare, che nel rito sono solo implicite”, così come anche “un simbolo non potrà mai rivelare tutto quel che rivela il rito”[74].
Il mondo (e il sacro in esso presente tramite la dialettica delle ierofanie) comunica la sua struttura profonda all’uomo attraverso questa triade di filtri: “Attraverso i simboli il mondo […] si «rivela»”[75] e “tramite il mito e il rito «il mondo ‘parla’ all’uomo»”[76].
Gianfranco Bertagni
NOTE
[31] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., p. 189.
[32] Ibidem, p. 192.
[33] Id., Spezzare il tetto della casa, cit., p. 225.
[34] Id., Immagini e simboli, cit., p. 156.
[35] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., pp. 187-8.
[36] Ibidem, pp. 194-5.
[37] Id., Immagini e simboli, cit., p. 16.
[38] Roberto Scagno, «Mircea Eliade: un Ulisse romeno tra Oriente e Occidente», in: L. Arcella, P. Pisi, R. Scagno (a cura di), Confronto con Mircea Eliade. Archetipi mitici e identità storica, Jaca Book, 1998, p. 23.
[39] Mircea Eliade, Immagini e simboli, cit., p. 157.
[40] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., p. 178.
[41] Id., Immagini e simboli, cit., p. 19.
[42] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., p. 186.
[43] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., pp. 473-4. È invece propria dell’uomo moderno (in quanto irreligioso), l’”esistenza frantumata e straniata”, Ibidem.
[44] Ibidem, pp. 43-4.
[45] Natale Spineto, «La ‘nostalgia del paradiso’. Religione e simbolo in Mircea Eliade», in: “Filosofia e Teologia”, n. 2, 1992, p. 302.
[46] Mircea Eliade, Immagini e simboli, cit., p. 37.
[47] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 462.
[48] Ibidem.
[49] Ibidem, pp. 464-5.
[50] Ibidem, p. 275.
[51] Id., Lo sciamanismo, cit., p. 287 (nota 15).
[52] Id., Immagini e simboli, cit., p. 157.
[53] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 463.
[54] Ibidem.
[55] Ibidem, p. 466.
[56] Ibidem.
[57] Ibidem, p. 469.
[58] Id., La prova del labirinto, cit., p. 121.
[59] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 275.
[60] Id., Arti del metallo e alchimia, cit., p. 63.
[61] Id., La nostalgia delle origini. Storia e significato nella religione, Morcelliana, 1972, p. 188.
[62] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., p. 185.
[63] Ibidem, p. 188.
[64] Id., Lo sciamanismo, cit., p. 15.
[65] Id., Miti, sogni e misteri, cit., p. 140.
[66] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 31. Il corsivo è nostro.
[67] L’immagine è simbolo. Spesso Eliade parla indifferentemente di ’simbolo’ e di ‘immagine’. Del resto è proprio dell’immagine rimandare ad altro. Cfr. Natale Spineto, «La ‘nostalgia del paradiso’. Religione e simbolo in Mircea Eliade», cit., p. 302-3.
[68] Mircea Eliade, Immagini e simboli, cit., p. 142.
[69] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., pp. 198-9.
[70] Ibidem, p. 196.
[71] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 273.
[72] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., p. 197.
[73] Id., Trattato di storia delle religioni, cit., p. 11.
[74] Ibidem, p. 13.
[75] Id., Mefistofele e l’androgine, cit., p. 189.
[76] Natale Spineto, «La ‘nostalgia delle origini’. Religione e simbolo in Mircea Eliade», cit., p. 313.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Mircea Eliade, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, 1972.
Mircea Eliade, Lo Sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Mediterranee, 1975.
Mircea Eliade, Spezzare il tetto della casa. La creatività e i suoi simboli, Jaca Book, 1988.
Mircea Eliade, I riti del costruire, Jaca Book, 1990.
Mircea Eliade, La prova del labirinto, Jaca Book, 1980.
Mircea Eliade, Mefistofele e l’androgine, Mediterranee, 1971.
Mircea Eliade, Miti, sogni e misteri, Rusconi, 1976.
Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose. I. Dall’età della pietra ai misteri eleusini, Sansoni, 1979.
Mircea Eliade, Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico-religioso, TEA, 1993.
Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, Rusconi, 1975.
Mircea Eliade, Mito e realtà, Borla, 1966.
Mircea Eliade, Arti del metallo e alchimia, Bollati Boringhieri, 1987.
Mircea Eliade, La nostalgia delle origini. Storia e significato nella religione, Morcelliana, 1972.
L. Arcella, P. Pisi, R. Scagno (a cura di), Confronto con Mircea Eliade. Archetipi mitici e identità storica, Jaca Book, 1998.
Natale Spineto, La ‘nostalgia del Paradiso’. Religione e simbolo in Mircea Eliade, in Filosofia e Teologia, n. 2., 1992, pp. 296-319






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


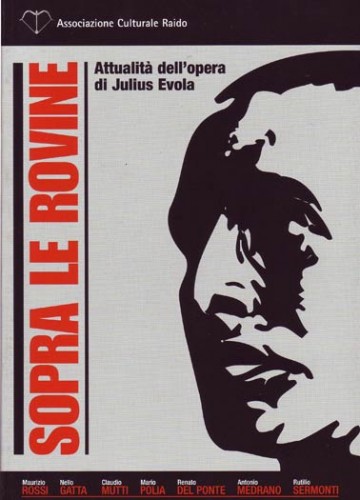



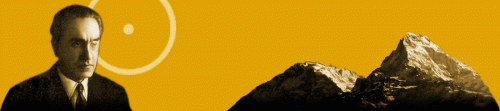

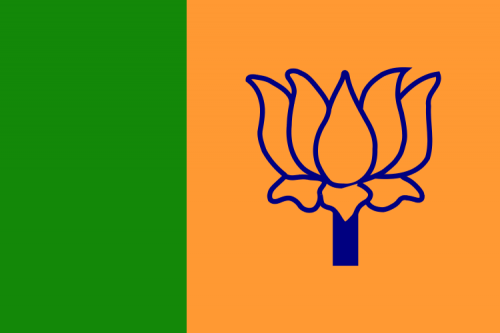
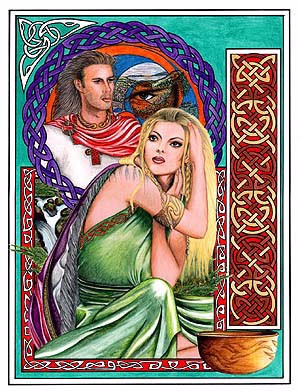










 Tratto, per gentile concessione dell’Autore, dal sito
Tratto, per gentile concessione dell’Autore, dal sito  Di Alfonso De Filippi
Di Alfonso De Filippi