vendredi, 16 mai 2025
Le cinéma noir et la prison de fer
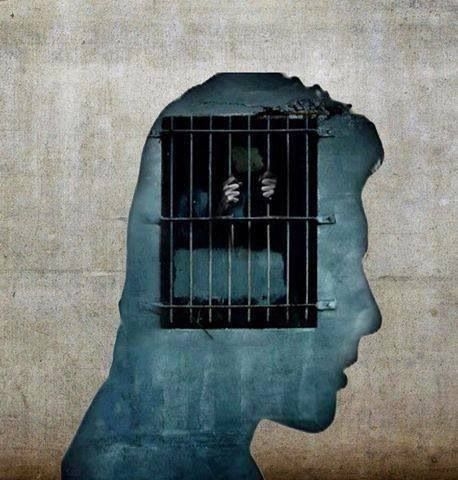
Le cinéma noir et la prison de fer
Nicolas Bonnal
Encensé d’une manière ridicule depuis des décennies par la cinéphilie (une cinéphilie d’ilotes sans culture théologique ni philosophique), le cinéma noir ne peut toutefois offrir comme la plus fille du monde que ce qu’il est : un documentaire sur la pourriture du monde (allez, du monde capitaliste), sur la déchéance du héros, le nihilisme tragi-comique, la laideur industrielle (relire les pages de Tocqueville à Manchester), la rapacité féminine qui mène l’homme par le bout de son nez, les invincibles méchants et cette loi de la rue maladive et tordue qui évoque les pages inoubliables d’Edgar Poe :
– des efforts insensés furent faits pour établir une Démocratie universelle. Ce mal surgit nécessairement du mal premier : la Science. L’homme ne pouvait pas en même temps devenir savant et se soumettre. Cependant d’innombrables cités s’élevèrent, énormes et fumeuses. Les vertes feuilles se recroquevillèrent devant la chaude haleine des fourneaux. Le beau visage de la Nature fut déformé comme par les ravages de quelque dégoûtante maladie. Et il me semble, ma douce Una, que le sentiment, même assoupi, du forcé et du cherché trop loin aurait dû nous arrêter à ce point. Mais il paraît qu’en pervertissant notre goût, ou plutôt en négligeant de le cultiver dans les écoles, nous avions follement parachevé notre propre destruction.
On ne saurait être plus clair : la folle activité industrielle et commerciale américaine, bientôt dominée par des banquiers invisibles et des mafieux trop invisibles (le jeu, la drogue, le sexe, le tabac, l’alcool, les paris, etc.) ne peut déboucher que sur le désastre deviné et courageusement révélé par Walt Whitman dans ses vistas démocratiques publiées après la Guerre de Sécession. Cette dernière sonne le glas de la civilisation américaine déjà compromise par le commerce et l’immigration européenne. Poe, mais aussi Booth Tarkington (Splendeur des Amberson…) ou Walt Whitman (voir notre texte) l’ont déjà compris.
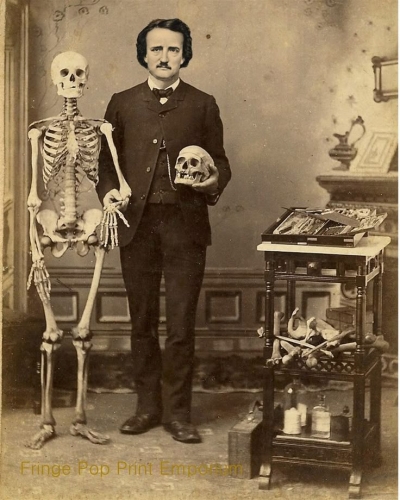
La dégoutante maladie de Poe se met en place et l’on observe avec tous les forbans de la nuit (film d’autant plus supérieur qu’il est tourné à Londres !) une civilisation maudite et malade. Nous sommes maudits, dit la blonde de King Kong (la vraie, celle de 1976, traînée dans la boue par la critique). Dick parle de prison de fer, à laquelle l’humanité n’a pu échapper malgré (à cause de, plutôt) le judéo-christianisme. L’homme judéo-chrétien et capitaliste étriqué né du protestantisme scientiste et bientôt athée est déchu non de sa nationalité mais de son ontologie. Et Tocqueville comprend longtemps avant le sinistre Grand sommeil (métaphore non de la mort mais de la vie occidentale, de l’American Way of Death) que « les petits et vains plaisirs dont ils emplissent leur âme » mènent au désespoir. Métaphore du crédit et de la dette du consommateur, la femme dite fatale se retourne contre l’homme-banquier-financier-équipementier qu’elle ruine et mène à la mort (pauvre Burt Lancaster, grand dadais mécanique dans Criss Cross et les Killers) ; dans la divine comédie de Dante, premier film noir, spendere veut dire tuer ; dépenser c’est tuer, tout comme consommation veut dire mort. D’ailleurs chez Shakespeare Mercutio se dit spent quand il est transpercé. Dépenser, s’est ne plus être. La monstruosité américaine va déteindre sur nous, n’apparaissant plus monstrueuse qu’à une mince élite, le reste se mutant en troupeau zélé de consommateurs.
L’école de Hudson et ses paysages géniaux trottent alors dans nos têtes, alors que le sujet du western consiste à faire bouger des vaches, du capital donc, d’un coin de paradis piétiné par les sabots à un autre.
Le monde est beau à voir et laid à être, a dit l’oncle Arthur.
Dans son grand opus, le formidable Francis Parker Yockey (les Américains ont les plus grands penseurs nationalistes au vingtième siècle, et ce n’est certes pas un hasard) parle admirablement des métiers parasites qui pullulent en cette Fin des Temps agonique et interminable : le mariage a été remplacé par le divorce et le détective déglingué homoncule sorti d’un cauchemar de Dostoïevski (qui envoie ses idiots et ses démons en Amérique pour se faire initier puis démolir leur Russie, voir notre livre) couche avec sa cliente, celle qui veut se débarrasser d’un riche mari pour trouver mieux à court terme. Lui-même parsème son cursus honorum de cadavres et détruit toujours plus ce qu’il prétend protéger : ce qu’on appelle une Happy End.
Le grand sommeil (le monde de l’idiot intentionnel dont parle Orson Welles au début de sa Femme de Shanghai) n’est pas terminé et mériterait sa conclusion. On arrive au monde de la science-fiction et au héros taré et désabusé de Dick, sur fond de décor noir, pluvieux, et de gabardines façon Blade runner (on cherche à fuir, mais où ? Le monde sera vie américanisé comme le Mexique, voyez The Big Steal, toujours avec Mitchum).

« Et encore une clairvoyance dickienne concernant notre présent où les socialistes et communistes regagnent le pouvoir partout dans le monde sous des formes différentes : Dick revient à sa théorie développée dans les autres romans où le camp capitaliste est égal au camp communiste et les deux amènent le même danger (ainsi le président FFF de ce roman est un communiste caché). Et encore l’image fusionnée de l’Empire et de la prison, du temps romain et du temps californien où le narrateur « sentait l’Empire, sentait une énorme prison de fer où travaillaient des esclaves », et seuls les petites figures en vêtements gris (les premiers chrétiens) résistent aux espions de l’Empire qui n’est pas disparu mais s’est caché à notre vue. »
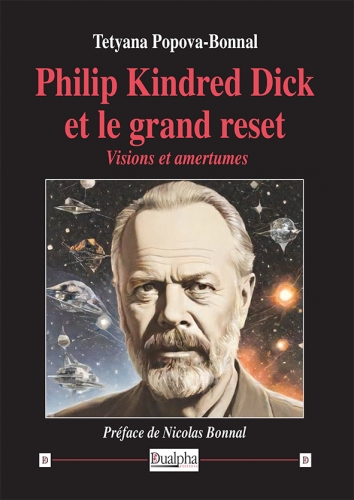
Tetyana ajoute dans son livre sur Dick :
« Infatigable Philip Dick trouve une ironie même dans cette situation de son personnage : « Maintenant il a senti sur sa propre peau qu’être un fou – à part d’être enfermé- te coûte aussi beaucoup d’argent. On t’émettra une facture pour ta folie, et si tu ne peux pas ou ne veux pas la payer – on te poursuivra en justice, et si tu n’accomplis pas la décision du juge on t’enfermera dans la prison pour offense contre le juge ». De cette manière le personnage est enfermé pas seulement dans l’Empire mais aussi dans sa prison de fer personnelle. »
On a du mal à croire au salut par le christianisme depuis longtemps fondu et confus, confondu dans cette masse gélatineuse de pouvoir et d’argent. La Sibylle de Dick annonçait un autre message, un âge d’or qu’on a raté en temps et en lieu.
Le cinéma noir et son roman annonçaient toutes sortes de grandes transformations (ou déformations, comme a dit Stockman justement, car après Eisenhower…)
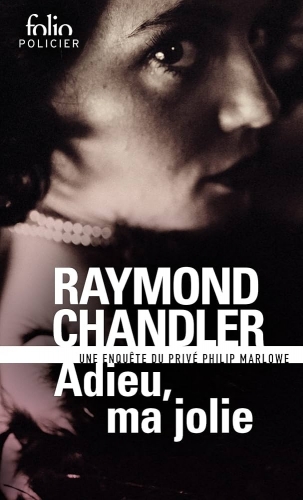
Tiens, la première phrase d’Adieu ma jolie (roman que personne n’a dû lire) :
IT WAS ONE OF THE MIXED BLOCKS over on Central Avenue, the blocks that are not yet all Negro.
On comprend pourquoi personne n’a lu le livre ; à la même époque Céline fait les mêmes observations, avec tout un tas d’Américains surpris de se voir remplacer à la vitesse de l’éclair. L’âge d’or colonial célébré par Madison Grand ou Lothrop Stoddard (cités dans Gatsby, récit à clés) est terminé.
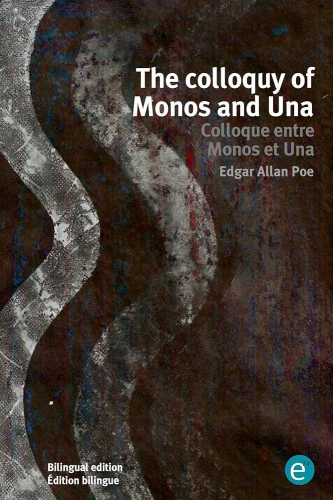
Revenons-en à Edgar Poe. C'est dans son Colloque entre Monos et Una que notre aristocrate virginien élevé en Angleterre se déchaîne :
« Hélas ! nous étions descendus dans les pires jours de tous nos mauvais jours. Le grand mouvement, – tel était l’argot du temps, – marchait ; perturbation morbide, morale et physique. »
Il relie très justement et scientifiquement le déclin du monde à la science:
« Prématurément amenée par des orgies de science, la décrépitude du monde approchait. C’est ce que ne voyait pas la masse de l’humanité, ou ce que, vivant goulûment, quoique sans bonheur, elle affectait de ne pas voir.
Mais, pour moi, les annales de la Terre m’avaient appris à attendre la ruine la plus complète comme prix de la plus haute civilisation. »
Sources:
https://www.amazon.fr/puissance-apocalyptique-Essais-foli...
https://www.amazon.fr/Philip-Kindred-Dick-grand-reset/dp/...
https://www.dedefensa.org/article/walt-whitman-et-la-maud...
https://www.dedefensa.org/article/poe-et-baudelaire-face-...
17:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nicolas bonnal, cinéma, edgar a. poe, cinéma noir |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


