samedi, 30 octobre 2021
L'Etat vrai selon Platon

L'Etat vrai selon Platon
Par Giorgio Freda
Ex: https://www.osentinela.org/
"Nous croyons qu'il faut rendre l'État heureux non pas en convertissant en heureux au sein de l'État quelques individus, considérés sous une forme séparée et singulière, mais l'État dans son ensemble." (Politeia, 420c)
Les modernes attribuent à la justice un fondement exclusivement moral.
Sur la base d'un tel caractère, ils ont converti la justice en une valeur du monde moral, en un commandement de la conscience, situé in interiore homine.
Une fois rompue la relation analogique entre le monde divin et le monde humain, le monde divin a perdu le caractère concret de réalité naturelle que les anciens lui attribuaient et, par conséquent, l'humain a été privé de sa dimension divine. Il en est résulté une fracture entre les deux ordres, et la chute progressive de leur caractère divin - converti en éléments moraux - dans le monde de la conscience, d'une part, et l'absolutisation de l'humain, réduit à des termes profanes et "séculiers", d'autre part.
Ce n'est pas entièrement à cause de la virulence du christianisme que cette unité originelle a été brisée ; le christianisme a plutôt été la conséquence d'un processus de dissolution - ou, mieux encore, d'effondrement qui s'est produit dans les deux entités - une dissolution qui lui préexistait néanmoins. L'apparition du christianisme a signifié, dans un certain sens, la "prise de conscience" de la crise, la représentation, insérée en termes d'habeas théologique, d'un état d'esprit qui assumait lentement de telles caractéristiques, au moins depuis quelques siècles avant son arrivée.
Ce n'est pas le lieu - et nous ne sommes pas suffisamment qualifiés - pour déterminer les phases du passage d'une affirmation objective, "nue" et active de la valeur-justice, à son internalisation émotive, moralisatrice et passive dans la conscience humaine : nous croyons suffisant pour notre propos de partir de l'hypothèse que la sensibilité classique n'admettait aucun hiatus entre le monde des valeurs et le monde politique, entre la sphère de la conscience morale et le plan des principes politiques, ce hiatus étant une conséquence qui est devenue inhérente aux conceptions des modernes, et qu'il serait illicite de le rapporter aux anciens, si le caractère abstrait, que les termes d'une telle séparation trahissaient pour eux, n'était mis en évidence.
Par conséquent, il est arbitraire par rapport à la conception classique de distinguer la justice entre justice "individuelle" et justice "sociale": pour Platon, il y a une justice-idée, une justice-valeur, qui s'applique aussi bien à l'âme individuelle qu'au corpus étatique.
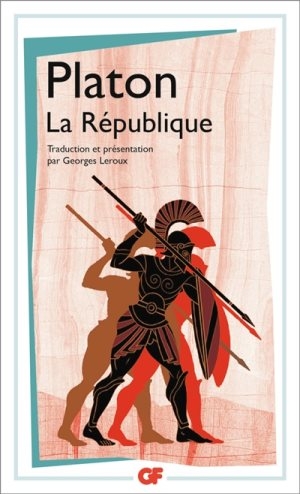 La justice est une valeur qui est réalisée par les citoyens dans leur ensemble selon un parallélisme absolu avec la réalisation de la même chose de la part de l'âme individuelle: la politique est donc "le soin de l'âme" et ce qui prend soin de la santé de l'âme, prend également soin de "la polis elle-même".
La justice est une valeur qui est réalisée par les citoyens dans leur ensemble selon un parallélisme absolu avec la réalisation de la même chose de la part de l'âme individuelle: la politique est donc "le soin de l'âme" et ce qui prend soin de la santé de l'âme, prend également soin de "la polis elle-même".
Ainsi, dans le Gorgias, Socrate appelle "politique" l'art qui prend pour objet l'âme: c'est la conception classique pour laquelle le lieu naturel de l'homme est l'État et non l'individu, et les structures politiques n'ont pas non plus d'existence autonome en soi, mais toutes deux sont animées par une tension qui les organise et les intègre nécessairement.
Pourtant, au IVe siècle, on assiste à l'émergence d'un état d'esprit individualiste qui, sous l'influence de nouvelles exigences et des recherches sophistiques, tend à opposer à la sphère des intérêts et des besoins individuels l'activité de la polis, que ces intérêts tentent d'inclure dans le cadre coercitif de la loi ; même si l'antithèse nature-droit est apparue presque comme un leitmotiv dans la recherche sophistique, l'âme grecque devait rester - dans son essence et malgré ces "incertitudes" - ancrée à cette identité naturelle de l'individu et de l'État, qui fonctionnait pour elle à la manière d'un canon normatif.
Pour Socrate aussi en effet, la science de l'humain signifie l'investigation et la connaissance de l'homme intégral, dans son aspect individuel et dans son aspect politique : c'est seulement la perspective selon laquelle l'homme - objet unitaire et identique dans ses aspects - est assumé qui change.
A travers cet aspect de l'influence socratique, nous pouvons comprendre comment Platon, dans la mesure où il tend à rechercher le meilleur modus vivendi, la connaissance de ces principes qui induiront chez l'homme la possession de la sagesse, entreprend de la même manière de déterminer la meilleure forme d'Etat, l'Etat parfait, dont le but suprême est le "bonheur".
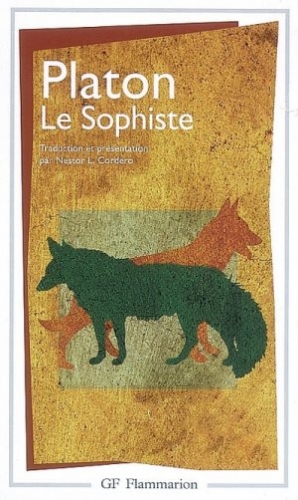 Il s'agit maintenant de développer la prémisse initiale de l'inséparabilité entre la "morale" et la politique ou, si l'on préfère, entre l'éthique individuelle et l'éthique "sociale", c'est-à-dire de souligner comment les deux termes, dans la double existence que nous leur prêtons, n'ont pas de réalité authentique selon l'œuvre de Platon, puisque la justice individuelle ne prend pas un sens proprement "moral" et que le régime platonicien, en outre, ne comporte pas les éléments profanes et temporels que le citoyen moderne attribue nécessairement à l'État. Il s'agit donc de rendre raison de la correspondance analogique entre l'individu et l'État dans la détermination platonicienne de la justice.
Il s'agit maintenant de développer la prémisse initiale de l'inséparabilité entre la "morale" et la politique ou, si l'on préfère, entre l'éthique individuelle et l'éthique "sociale", c'est-à-dire de souligner comment les deux termes, dans la double existence que nous leur prêtons, n'ont pas de réalité authentique selon l'œuvre de Platon, puisque la justice individuelle ne prend pas un sens proprement "moral" et que le régime platonicien, en outre, ne comporte pas les éléments profanes et temporels que le citoyen moderne attribue nécessairement à l'État. Il s'agit donc de rendre raison de la correspondance analogique entre l'individu et l'État dans la détermination platonicienne de la justice.
Selon Platon, de même que la justice chez l'homme est la relation qui intègre harmonieusement les trois degrés de la vie individuelle et s'établit comme la vertu qui renforce et unit la sagesse, le courage et la tempérance, de même, dans l'État, elle est déterminée comme l'élément qui lie et coordonne les trois castes, vues sous le profil des fonctions qu'elles exercent. Il considère que l'élément fondamental de l'être humain est constitué par l'âme et, d'autre part, ce qui revêt une plus grande importance dans l'activité humaine est la politique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fonctionnement organique de la cité. L'âme humaine et la société étatique ont la même structure: dans les deux cas, la même cause produit le même effet. C'est pourquoi l'injustice n'est pas seulement une forme particulière de désordre, mais le désordre lui-même dans ce qu'il apporte de plus dangereux et de plus caractéristique, affectant aussi bien l'État que l'âme humaine lorsqu'une caste ou une des facultés de l'âme, au lieu de rester à la place que la nature lui a assignée, développe une fonction qui ne lui est pas propre. De même que l'âme injuste est celle où il n'y a pas de subordination des autres facultés à la nous, dont le rôle est de conduire l'homme vers la réalisation du Bien ; de même la cité injuste est celle où l'autorité n'est pas exercée par les philosophoi, c'est-à-dire par ceux qui possèdent exclusivement la connaissance du Bien.
Mais l'affirmation selon laquelle les mêmes caractéristiques différentielles sont placées dans l'individu au même endroit que dans l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul problème d'injustice et que le même problème est formulé à la fois pour l'individu et pour l'État ; que de simples "applications" parallèles de la justice - en soi unitaire - s'expriment sur les deux plans: cette affirmation n'est pas démontrée par Platon. Il ne formule pas le problème de vérifier si les supports de cette injustice, représentés respectivement par l'individu et l'État, sont susceptibles d'être opposés l'un à l'autre. La question à régler est constituée par lui par la délimitation des éléments substantiels de la justice, non des termes formels auxquels elle est inhérente.
Que la justice, en effet, étant érigée en canon normatif pour l'homme, doive se présenter dans la même mesure aussi pour l'État et vice versa, est une donnée que Platon accepte "naturellement", comme un présupposé: un présupposé qui n'est pas converti en termes de démonstration, non pas parce qu'il est indémontrable comme principe de raisonnement, mais précisément à cause de l'objectivité spontanée avec laquelle sa reconnaissance s'impose. Nous avons déjà vu au passage - de manière encore incomplète - comment l'idée de faire adhérer l'individu au " régime politique ", de construire une relation entre l'être individuel et l'État, a été reconnue de manière tout à fait naturelle par les Grecs anciens.
En effet, les Grecs ont spontanément accepté la conception selon laquelle l'éthique individuelle est liée à l'organisme politique, ainsi que le principe selon lequel les deux entités se déterminent mutuellement dans une relation de coordination réciproque.
Il convient donc de répéter que dans la polis antique il n'y a pas de solution dualiste entre l'individu et la cité, ni l'individu ni la cité n'ont une existence conclue dans des fonctions et des limites spécifiques et en tant que telles exclusives: il y a le citoyen qui est l'homme inséré dans la cité et il y a la cité qui est la cité du citoyen.

Pour revenir à Platon, sur la base de cette prémisse, il est nécessaire de souligner que l'analogie ne constitue pas l'élément d'une investigation "originale" concernant le philosophe, mais qu'elle se réfère plutôt à une tendance dominante dans le monde grec. Platon n'avait pas besoin de rechercher l'identité "formelle" homme-état, puisque pour lui le problème ne se posait pas, les termes n'ayant pas le même caractère dual que celui que leur accordent les modernes.
En effet, lorsque Socrate, dans la Polythéa, propose de transférer l'enquête sur la justice du niveau spirituel au niveau étatique, personne ne formule d'objection, puisque le transfert est considéré comme légitime: puisqu'il ne s'agit pas d'un changement de substance, mais d'un changement de plan, de perspective, d'angle de vision.
De Platon, à son tour, émerge l'intensification d'un tel présupposé unitaire, ce qui rend l'analogie encore plus évidente lorsque le présupposé devient distinct dans ses composantes. L'identité qualitative de l'homme avec la société politique induit en effet un lien étroit entre organisme individuel et organisme étatique : les deux entités ayant "la même structure, les mêmes besoins, le même principe d'organisation", puisque pour Platon la cité est un être vivant. Platon est explicite à ce sujet, en développant la comparaison selon laquelle l'État et l'individu présentent les mêmes caractéristiques : avec la différence que celles de la cité sont écrites dans des dimensions plus grandes et que la lecture en ressort plus facilement. L'État n'est donc rien d'autre que "l'image magnifiée" de la personne, et tout comme l'essence de la personne est ordonnée par la Vertu qui donne l'harmonie aux autres vertus, l'État est également fondé sur le même principe. L'État est, en somme, la personne elle-même, il constitue son âme au sens large, de sorte qu'il existe une certaine relation d'altérité entre le citoyen et l'État : en plaçant l'État comme image de l'âme individuelle à un niveau différent et par les vertus de l'âme possédant des valeurs éthiques et politiques en même temps.
Surtout, à partir du livre IV du Polythea, cette continuité de nature entre l'individu et l'État émerge, de sorte que - comme on l'a souligné plus haut - le passage du niveau de l'éthique à celui de la politique, plus qu'un passage véritable et propre, est une mise sous les différents angles de vision.
On voit ainsi que Platon ne se préoccupe pas de formuler un plan de " constitution " politique, mais de déterminer les " vertus " mises en avant comme fondement de l'État, et il est symptomatique que lorsqu'il veut donner une image générale de la Polyphée, il la définit comme: "l'État dans lequel les désirs d'une masse vicieuse sont dominés par les désirs et la sagesse d'une minorité vertueuse ".
L'objectif suprême de l'individu et de l'État est le bonheur au sens classique d'intégration, de plénitude et de participation au divin.
Dans ce but, l'État n'est pas placé comme une réalité extérieure à l'âme, mais comme une présence intime dans l'homme: s'il reste comme une simple structure extérieure, comme un simple facteur d'organisation sociale, il n'est pas l'État selon la justice. Elle le sera si elle est ordonnée dans son noyau métaphysique, dans l'idée de valeur que le véritable État a en commun avec le juste citoyen. C'est pourquoi - comme on l'a souligné - entre la réalité de cette dernière et la réalité de l'individu il n'y a pas de différence ontologique, mais en tout cas une distinction de possibilité et d'intensité, à partir du moment où la polis représente le centre de tension pour que le citoyen devienne eudaimon (heureux).
Mais quelle valeur ou fonction l'État représente-t-il devant le citoyen ? Il est évident - selon ce que nous avons essayé de mettre en évidence auparavant - que le problème - tel qu'il est présenté - ne concerne que ceux qui, interprétant en termes duels les termes d'État et de citoyen, renvoient la même altérité à la conception platonicienne. Deux thèses suscitent à cet égard un intérêt prédominant : la première se réfère à ceux qui présentent l'État platonicien comme un État totalitaire ; la seconde est propre à ceux qui attribuent à la Politeia une "fonction éthique" au service de l'âme individuelle.

En ce qui concerne la thèse qui divise dans la Politeia platonicienne les éléments typiques des régimes totalitaires, nous considérons que l'idée de convertir l'État en une entité "divinisée" devant laquelle la personne doit se sacrifier et à laquelle elle doit renvoyer la raison de ses propres actions, est complètement étrangère à la position platonicienne. Si l'on considère toutes les fonctions, ou plutôt les applications, du totalitarisme, la comparaison de celui-ci avec un système qui - comme le Polythea - est basé sur l'identité entre l'économie intérieure de l'âme individuelle et la vie de l'État, est manifestement absurde. Si dans l'État platonicien émergent des éléments capables de conformer en apparence la thèse d'un État "centralisateur", ce n'est pas d'un État totalitaire dans ses dimensions typiques qu'il s'agit ici. Dans le système totalitaire, l'unité est imposée de l'extérieur, non pas sur la base d'un principe émanant d'en haut, d'une autorité naturelle et reconnue, mais d'une partie d'un pouvoir politique matérialiste. Ceci est affirmé comme l'une des dernières implications - dans la sphère politique - de la décadence qui avait déjà commencé avec la séparation de l'élément humain, séculier, de l'élément sacré. La sclérose typique de l'État totalitaire, l'instinct de tronquer toute harmonie et toute liberté différenciée qu'il veut atteindre, l'absolutisation conférée à la sphère inférieure des besoins humains et d'autres éléments qu'il est inutile de souligner ici, sont en antithèse radicale avec les formes organiques de l'État platonicien, avec la multiplicité et la vivacité des fonctions présentes en lui, avec l'Idée transcendante sur laquelle il repose. Plus exactement, les articulations différenciées et organiques de l'État platonicien sont telles qu'il ne faut pas parler de totalitarisme, mais d'un "ordre total", qui se présente par rapport au citoyen avec les mêmes caractères du cosmos au niveau individuel. Les préoccupations du gouvernant "idéal" ne s'identifient donc pas aux instances vulgaires qui donnent la prééminence - dans le cadre des formes étatiques que les temps modernes développent - aux facteurs matérialistes, économiques et technicistes : pour Platon, la politique reste toujours adhérente à un canon normatif et à une fonction formative qui, en tant que telle, assume l'âme du citoyen et ses inclinations comme son propre sujet.
Mais à ce stade, il est nécessaire de prendre position contre la thèse opposée, qui voulait attribuer à l'État platonicien la fonction d'auxiliaire de la morale individuelle et à l'activité politique celle de subordonné à celle-ci.

Nous considérons que la thèse du fondement moral de l'État platonicien est valable pour restreindre le Polythea dans les limites d'une activité purement temporelle, humaine, génératrice de " vertus " au sens moderne du terme : sans le situer, donc, dans le domaine qui lui est propre.
Or, selon nous, la polis représente dans le système platonicien l'élément de médiation qui favorise la réintégration du citoyen dans la réalité divine : à travers l'État, le citoyen parvient à dépasser la simple éthique individuelle pour s'ouvrir à une réalité qui le transcende. L'État platonicien ne doit donc être considéré ni comme une fin (un État totalitaire, une entité séculaire sublimée et divinisée) ni comme un élément fonctionnel limité à la conscience de l'homme. Si l'on veut, on peut également dire que l'État est "en fonction" du rapport harmonique entre les puissances de l'âme, bien qu'il faille noter que pour Platon, fonder la justice in interiore homine ne signifie nullement limiter une telle réalisation à l'intérieur de la conscience humaine, puisque, comme le dit Platon, en exprimant Dieu tout bien, par conséquent aussi l'accomplissement juste de tout effort pour devenir juste signifie tendre à devenir semblable à Dieu.
La justice dans l'âme constitue le présupposé de l'ascension vers le divin : c'est l'État qui, lorsque la justice est atteinte, induit chez l'individu une tension anagogique vers le supra-humain. Par conséquent, ce qui est la morale individuelle, au contact de l'ordre représenté par l'État, s'ouvre, s'intensifie, s'objective, se convertit en une éthique absolue, déconnectée de ces traits de simple "vertu" que les modernes sont amenés à lui attribuer.
Ainsi - selon nous - lorsque nous parlons de la priorité de l'homme sur l'État selon Platon, nous nous enfermons dans une abstraction aussi absurde que celle qui résulte de l'attribution d'une dimension totalitaire à la Polythéa. Platon ne parle pas des hommes tels que nous sommes amenés à les concevoir : les hommes de Platon sont des êtres différenciés, qui possèdent chacun une certaine catégorie, une liberté différente, un style différent.
Ces hommes sont supposés être l'objet du travail de l'État, et leur perfection est la fin à laquelle l'ordre étatique est subordonné. A ce propos, nous avons parlé de la fonction analogique de l'ordre politique, ou plutôt de ce qui constitue sa légitimation : cultiver, susciter, soutenir les dispositions de ceux qui y sont organiquement insérés, et agir en fonction de ce qui dépasse la simple individualité.
Cela est possible dans la mesure où la Polythéa, incarnation de la justice, se présente comme un ordre qui participe hiérarchiquement à la " stabilité " au sens spirituel, comme le reflet " effectif " du monde de l'être, c'est-à-dire de l'idée du Bien, sur le devenir.
Seuls les modernes peuvent concevoir l'existence d'un ordre politique qui revendique sa propre légitimité et le destin même de la vie associé au purement temporel : tout comme il appartient à la décadence des modernes de penser que seul l'ordre "moral" pose le problème de la fin ultime de l'homme. Dans la Politeia platonicienne - comme ailleurs dans tous les régimes politiques "normaux" - l'État est soutenu par une puissance non humaine, par une idée et par une signification étrangère : par conséquent, en tant qu'expression d'une réalité supérieure, l'État doit aussi être un "chemin" vers elle.
En conclusion, chez Platon, l'instance politique est légitimée par des valeurs supra-individuelles et c'est la tâche de l'État d'assigner à ces valeurs leur place dans un ordre complet, afin de réaliser dans un sens supérieur la justice. L'État détermine donc la direction à suivre pour que les citoyens vivent dans la pratique des valeurs sur terre et méritent l'eudamonia (bonheur) que les Dieux accordent à ceux qui vivent selon la justice.
Le régime platonicien émerge d'une idée déterminée du destin de l'homme et des devoirs qui lui sont imposés : dans cet état, les gouvernants ont les yeux dirigés vers l'idée du Bien à laquelle ils tentent d'adhérer par leur action politique. Il ne s'agit ni du bien de l'âme individuelle en tant que " pratique de la vertu ", ni du bien de l'État : mais du Bien absolu, du principe divin qui n'apparaît que sous une forme impersonnelle ; du suprême, en tant que tel supérieur à l'existence - car rien n'existe sans lui - et à l'essence, car il ne peut être conclu dans aucune définition.

C'est en ces termes que se réduit le sens de la Politeia platonicienne : découlant de l'existence d'un " bonheur " fondateur, elle " ordonne " les moments par lesquels l'homme parvient au bout du chemin, précisément à l'eudaimonio, qui consiste en sa participation au divin. L'État ne peut exister sans une tension de la volonté de l'homme (surtout de l'homme-philosophos) d'adhérer au Bien authentique, mais il est vrai à son tour, réciproquement, que seule cette Politeia peut permettre au sage de s'élever à l'idée du Bien.
Ce n'est que dans la polis parfaite que le sage opère en réalisant cette perfection intégrale, ce "bonheur" auquel il aspire : l'action politique s'impose donc au sage comme ce qui doit être fait. C'est pourquoi il doit redescendre dans la grotte pour instruire et gouverner les prisonniers. Le mythe de la caverne n'a pas d'autre sens : l'homme politique a la vocation d'opérer en termes politiques et opérer en termes politiques signifie conduire à la vraie réalité - qui est la réalité divine - des gouvernés. C'est précisément par rapport à cette signification antérieure que le caractère dominant de l'État a été considéré comme celui de la médiation, de la relation : c'est-à-dire de la "voie" qui relie l'existence humaine à la réalité supra-humaine.
Et c'est à cette direction ascendante qu'il faut se référer pour considérer la Polythéa platonicienne, œuvre née à une époque qui présentait déjà des éléments de rupture, comme une tentative organique de restaurer non pas tant l'aspect politique extérieur que le sens et la position de l'homme dans son rapport avec la réalité divine.
11:50 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, giorgio freda, état, république, politeia, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 novembre 2011
Giorgio Freda : The Unclassifiable Revolutionary
Giorgio Freda : The Unclassifiable Revolutionary
Edouard Rix
Ex: http://tpprovence.wordpress.com/
“I hate this book. I hate it with all my heart. It gave me the glory, that poor thing called fame, but it is also the source of all my miseries. For this book, I have known many months in prison, (…) police persecution as petty as cruel. For this book, I experienced the betrayal of friends, enemies, bad faith, selfishness and the wickedness of men. From this book has originated the stupid legend that made me out to be cynical and cruel, a sort of Machiavelli disguised as Cardinal de Retz that they like to see in me.” Though written by Curzio Malaparte in the introduction to his famous essay ‘Technique of the coup’, Giorgio Freda, the author of ‘The Disintegration of the System’, could have made these lines his own. Because, in writing this small booklet of about sixty very dense pages that undermined the basis the of the bourgeois system, the young publisher has suffered years of judicial and media persecution.
THE EDIZIONI DI AR
On October 26, 1963, Senator Umberto Terracini, an influential member of the Jewish community and the Italian Communist Party, reported publicly to the Ministers of Interior and Justice the dissemination in Padua of “a vile pamphlet bearing the title Gruppo di Ar (Ar Group), which, taking up the most vile racist theories of Italian Nazism, openly portrays the authors as publishers advocating anti-democratic ideology”, and asks “whether and which measures have been proposed and taken to cauterize the wound and stop the infection before it gets wider dissemination and enters the sphere of action.”
Originally publicly stigmatized, the group found a young Platonist and Evolan lawyer named Giorgio Freda. The term chosen by the group for its name, Ar, was highly symbolic, as it is in many Indo-European languages, being the semantic root connoting the idea of nobility and aristocracy.
In 1964, Freda had to face trial for a pamphlet denouncing Zionist policy in Palestine. This was just the first of many. The same year, Edizioni di Ar, which he had just founded, published their first book, ‘An Essay on the Inequality of the Races’ by Arthur de Gobineau. Following were the minor writings of Julius Evola and the works of Corneliu Codreanu. Each title had a circulation of 2000 copies.
There were two constants in Freda’s militant commitment: the fight against international Zionism, including Israel, which he believed was only the tip of the struggle and against the bourgeois liberal system, expressed by American imperialism in Europe since 1945. About anti-Zionism, Freda was the first editor in Italy who supported Palestinian fighters, even as the Right, embodied by the MSI (Movimento Sociale Italiano), extolled Israel as a “bulwark of the West against the Arabs enslaved by Moscow”. It was he who organized in Padua in March 1969- in conjunction with the Maoist group, Potere Operairo (Workers’ Power)- the first major meeting in Italy to support the Palestinian resistance in the presence of representatives of Yasser Arafat’s Fatah. The Zionist lobby never forgave him. Moreover, not content with simple verbal support, like so many distinguished intellectuals, he would secretly provide timers to a supposed representative of Fatah.
THE DISINTEGRATION OF THE SYSTEM
But Giorgio Freda is above all a man of the text. And what a text! ‘The Disintegration of the System’ was written in 1969 as student protests were in full force. Italy then underwent, not a sudden explosion and fallout as fast as in France, but a “creeping May”. Convinced of the urgent need for the radical subversion of the bourgeois world, Freda believed that everything must be tried and, when so many young people were seeking to give a truly revolutionary content to the student revolt, that it would be recovered from the proponents of orthodox Marxist or social democratic reformism. It was for these young people that ‘The Disintegration of the System’ was intended, and far from being Freda’s personal program it synthesized the common demands of the entire national-revolutionary milieu, from Giovane Europe (Young Europe) to Lotta di Popolo (People’s Struggle).
The tone of the text is decidedly offensive. A disciple of Evola, Freda is the first to not just comment learnedly on his writings, but to move from theory to practice, so much so that one can see in ‘The Disintegration of the System’ the political practice of the theory outlined in ‘Riding the Tiger’, the last of Evola‘s writings. With this book, the Baron gave the intellectual framework affirming Freda’s belief that there can be no compromise with the bourgeois system. “There is a solution, writes Evola, which must be firmly ruled out: that is to build on what survives of the bourgeois world, and to defend it as a basis to fight against the currents of dissolution and the most violent subversion, after possibly trying to facilitate or strengthen the remains with some higher values that are more traditional.” And the Baron added: “It might be good to help bring down the already faltering and what belongs to the world of yesterday, instead of seeking to support and to artificially prolong life. This possible tactic, such as to prevent the final crisis, is the work of the opposing forces which would then undertake the initiative. The risk of this is obvious: we do not know who has the last word.”
In ‘The Disintegration’, Freda was not tender with the idols and values of bourgeois society. Order for the sake of order, sacrosanct private property, capitalism, moral conformism, and visceral blind, pro-Zionism and philo-Americanism, but also God, priests, judges, bankers- nothing and no one escaped his criticism. To the dominant market model, he offered a real alternative, reaffirming the traditional doctrine of the state, fully opposed to pseudo-bourgeois values, and developed a coherent state project, the most spectacular aspect including the organization of a Communist economy-a Spartan and elitist communism which owes more to Plato than to Karl Marx.
A man of action, Freda was sickened by pseudo-intellectual Evolo-Guénonians locked away in their ivory towers. He had harsh words for some Evolans: “sterile apologists of the discourse on the state”, “worshippers of abstractions,” “champions of conceptual gestures” that, in his eyes, were riders of paper tigers . “For us, he writes, be true to our vision of the world – and therefore of the state – means to comply with it, leaving nothing undone to achieve it historically.” In this perspective, he clearly shows the intention to reach out to sectors involved in the objective negation of the bourgeois world, including the ultra-extra-parliamentary left to which he proposes a strategy that was loyal to a united struggle against the System. It was then that he contacted various Maoist groups, such as Potere Operaio and the Communist Party of Italy-Marxist Leninist.
“For a political soldier, purity justifies any hardness, indifference all guile, while the impersonal imprinted in the fight dissolves all moral concerns.” These strong words ends the manifesto.
VICTIM OF DEMOCRACY
On December 12, 1969, a bomb exploded in the National Bank of Agriculture, Piazza Fontana in Milan, killing 16 people and injuring 87. The Italian section of the Situationist International of the ultra-left issued a manifesto entitled ‘The Reichstag Burns’, denouncing the regime as the real organizer of the massacre. The Situationists will continue to repeat that the Piazza Fontana bomb was “neither anarchist nor fascist.”
Giorgio Freda, meanwhile, continued his intellectual struggle against the System. In 1970, in a preface to a text by Evola, he welcomed the possibility of urban warfare in Italy. In April 1971, Edizioni di Ar publish officially for the first time in the peninsula since 1945, ‘The Protocols of the Elders of Zion’. That same month, Freda was arrested and accused of “having distributed books, printed and written information containing propaganda or incitement to violent subversion.” The repressive machine gets under way. For the first time since the end of the fascist regime, a magistrate intended to apply Article 270 (law against subversive association) of the Code Rocco (named after Mussolini’s attorney general). Soon after, the Edizioni di Ar published ‘The Enemy of Man’, a collection of Palestinian fighting poetry, provoking the fury of the Zionists.
In July 1971, the judge modified the charges and accused Freda of making “propaganda for the violent subversion of the political, economic and social development of the state” through ‘The Disintegration of the System’, “where he alludes to the need of subversion, by violent means, of the bourgeois democratic state and its replacement by a state defined and characterized as a people’s state”.
Undaunted by repression, Edizioni di Ar published in November 1971 the Italian translation of the ‘International Jew’ by Henry Ford.
On December 5, 1971, Freda was arrested again. He is no longer prosecuted for crimes of opinion, but bluntly accused of having organized the massacre of Piazza Fontana. Since they failed to catch the “anarcho-fascists” they decided to pinch the “Nazi-Maoists”. The charges against Freda was based on two pieces of evidence: that he bought timers like those found in the bank as well as the travel bags in which the bombs were placed. But Freda had indeed bought timers but had given them to a captain of the Algerian secret services who requested them for the Palestinians. The weekly Candido, investigating the RFA from the manufacturer, collected evidence that timers sold in Italy were not 57, as claimed by the judge – Freda had bought 50 – but hundreds, and that the models purchased by the publisher differed from those used in the attack. In addition, the merchant from Bologna who had sold four travel bags similar to those used in the attack did not recognize Freda as the buyer, but two police officers … Of course, the judge wouldn’t take into account exculpatory evidence. Freda began his lonely tour of Italian prisons in 1972- Padua, Milan and Trieste. Then Rome, Bari, Brindisi, Catanzaro.
Called a “Maoist” traitor or “agent of Communist China” by the Right, especially by the neo-fascist MSI or a “racist fanatic” and “delusional anti-Semite” by the legalistic left and Zionist circles, and fearfully rejected by some ultra-left men with whom he had actively collaborated, Giorgio Freda was then tricked by the press into taking the supposedly infamous label of “Nazi-Maoist.” Thanks to the hype, this only turned out to be positive as the stock of 1500 copies of ‘The Disintegration of the System’ were quickly exhausted. A few years later, Freda admitted that the text was taken more into consideration by extremists on the left than those on the right.
TRIAL
The long River Piazza Fontana trial was opened on January 1975, before the Assize Court in Catanzaro. Accused were the anarchist Pietro Valpreda and eleven accomplices, neo-fascist Giorgio Freda and twelve co-defendants. Reaching the end of his preventive detention, Freda was released and placed under house arrest in August 1976. But his convictions remained intact. Thus in 1977, when he was facing a life sentence, he did not hesitate: in an interview he gave to his friend Claudio Mutti he talked about armed struggle as the best form of opposition to the System in Italy!
Convinced that the dice were loaded and that his conviction wasn’t in doubt, Freda went on the run in October 1978. He was captured in the summer of 1979 in Costa Rica, from which he was not extradited, but forcibly returned by the Italian political police.
The judicial farce continued. In December 1984, the fourth trial for the massacre of Piazza Fontana was opened in Bari. After sixteen years of investigation, Freda was ultimately acquitted of the bombing but incarcerated for crimes of opinion, “subversive association” according to the Italian legal language, which earned him a sentence of fifteen years in prison.
On his release, the media was still talking about Freda because of his launching of the Fronte Nazionale (National Front), for which he was again arrested and charged in July 1993. Surely, good blood cannot lie!
Edouard Rix, Le Lansquenet, printemps 2003, n°17.
00:05 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio freda, italie, stratégie de la tension, années 70, années 80, nationalisme révolutionnaire, nazimaoïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 novembre 2010
Giorgio Freda: Nazi-maoïste ou révolutionnaire inclassable?
Archives - 2003
Giorgio Freda : Nazi-maoïste ou révolutionnaire inclassable?
Edouard Rix
 «Je hais ce livre. Je le hais de tout mon coeur. Il m’a donné la gloire, cette pauvre chose qu’on appelle la gloire, mais il est en même temps à l’origine de toutes mes misères. Pour ce livre, j’ai connu de longs mois de prison, (...) de persécutions policières aussi mesquines que cruelles. Pour ce livre, j’ai connu la trahison des amis, la mauvaise foi des ennemis, l’égoïsme et la méchanceté des hommes. C’est de ce livre qu’a pris naissance la stupide légende qui fait de moi un être cynique et cruel, cette espèce de Machiavel déguisé en cardinal de Retz que l’on aime voir en moi». Ces quelques lignes, écrites par Curzio Malaparte en introduction à son célèbre essai Technique du coup d’Etat, l’auteur de La désintégration du système, Giorgio Freda, aurait pu les faire siennes. Car, pour avoir rédigé cette modeste brochure qui, en une soixantaine de pages très denses, sape à la base le système bourgeois, ce jeune éditeur a subi des années de persécutions judiciaires et mediatiques.
«Je hais ce livre. Je le hais de tout mon coeur. Il m’a donné la gloire, cette pauvre chose qu’on appelle la gloire, mais il est en même temps à l’origine de toutes mes misères. Pour ce livre, j’ai connu de longs mois de prison, (...) de persécutions policières aussi mesquines que cruelles. Pour ce livre, j’ai connu la trahison des amis, la mauvaise foi des ennemis, l’égoïsme et la méchanceté des hommes. C’est de ce livre qu’a pris naissance la stupide légende qui fait de moi un être cynique et cruel, cette espèce de Machiavel déguisé en cardinal de Retz que l’on aime voir en moi». Ces quelques lignes, écrites par Curzio Malaparte en introduction à son célèbre essai Technique du coup d’Etat, l’auteur de La désintégration du système, Giorgio Freda, aurait pu les faire siennes. Car, pour avoir rédigé cette modeste brochure qui, en une soixantaine de pages très denses, sape à la base le système bourgeois, ce jeune éditeur a subi des années de persécutions judiciaires et mediatiques.
LES EDIZIONI DI AR
Le 26 octobre 1963, le sénateur Umberto Terracini, membre influent de la communauté juive et du Parti communiste italien, dénonce publiquement auprès des ministres de l’Intérieur et de la Justice la diffusion, à Padoue, «d’un immonde opuscule portant le titre Gruppo di Ar qui, reprenant les plus ignobles thèses racistes du nazisme italien, qualifie ouvertement les auteurs éditeurs comme les partisans d’une idéologie antidémocratique», et demande «si des mesures et lesquelles ont été proposées et prises afin de cautériser la plaie fétide et purulente avant qu’elle n’étende la sphère de son action».
A l’origine du groupe ainsi publiquement stigmatisé, l’on trouve un jeune juriste platonicien et évolien, Giorgio Freda. Le terme d’Ar, choisi comme dénomination, se veut éminemment symbolique, puisqu’il s’agit, dans de nombreuses langues indo-européennes, de la racine sémantique connotant l’idée de noblesse, d’aristocratie.
Dès 1964, Freda doit affronter un procès pour avoir dénoncé dans une brochure la politique sioniste en Palestine. Ce n’est que le premier d’une longue série. La même année, les Edizioni di Ar, qu’il vient de fonder, publient leur premier livre, l’Essai sur l’inégalité des races d’Arthur de Gobineau. Suivront des écrits mineurs de Julius Evola, et les oeuvres de Corneliu Codreanu. Chaque titre est tiré à 2000 exemplaires.
Deux constantes dans l’engagement militant de Freda : la lutte contre le sionisme international, dont Israël, estime-t-il, n’est que la partie émergée, et le combat contre le Système libéral bourgeois, expression de l’impérialisme américain en Europe depuis 1945. Concernant l’antisionisme, Freda est l’éditeur qui, le premier en Italie, a soutenu les combattants palestiniens, alors même que la Droite, incarnée par le MSI, exaltait Israël, «rempart de l’Occident contre les Arabes asservis à Moscou». C’est lui qui organisera, en mars 1969, à Padoue, en liaison avec le groupe maoïste Potere Operairo, la première grande réunion en Italie de soutien à la résistance palestinienne, en présence de représentants du Fatah de Yasser Arafat. Le lobby sioniste ne lui pardonnera jamais. En outre, ne se contentant pas d’un simple soutien verbal, comme tant d’intellectuels distingués, il se procurera des minuteries en vus de les remettre à un représentant supposé du Fatah.
LA DÉSINTÉGRATION DU SYSTEME Mais Giorgio Freda est avant tout l’homme d’un texte. Et quel texte ! Il s’agit de La désintégration du système, qui voit le jour en 1969, en pleine contestation étudiante. L’Italie subit alors, non une explosion soudaine et aussi vite retombée comme en France, mais un «mai rampant». Convaincu de l’impérieuse nécessité d’une subversion radicale du monde bourgeois, Freda estime que tout doit être tenté, au moment où beaucoup de jeunes cherchent à donner un contenu véritablement révolutionnaire à la révolte étudiante, pour éviter que celle-ci ne soit récupérée par les tenants de l’orthodoxie marxiste ou du réformisme social-démocrate. C’est à ces jeunes que s’adresse La désintégration du système, qui loin d’être le programme personnel du seul Freda, synthétise des exigences communes à tout un milieu national-révolutionnaire, de Giovane Europa à Lotta di Popolo.
Mais Giorgio Freda est avant tout l’homme d’un texte. Et quel texte ! Il s’agit de La désintégration du système, qui voit le jour en 1969, en pleine contestation étudiante. L’Italie subit alors, non une explosion soudaine et aussi vite retombée comme en France, mais un «mai rampant». Convaincu de l’impérieuse nécessité d’une subversion radicale du monde bourgeois, Freda estime que tout doit être tenté, au moment où beaucoup de jeunes cherchent à donner un contenu véritablement révolutionnaire à la révolte étudiante, pour éviter que celle-ci ne soit récupérée par les tenants de l’orthodoxie marxiste ou du réformisme social-démocrate. C’est à ces jeunes que s’adresse La désintégration du système, qui loin d’être le programme personnel du seul Freda, synthétise des exigences communes à tout un milieu national-révolutionnaire, de Giovane Europa à Lotta di Popolo.
Le ton du texte est résolument offensif. Disciple d’Evola, Freda est le premier à ne pas se contenter de commenter doctement ses écrits, mais à passer de la théorie à la pratique, à tel point que l’on peut voir dans La désintégration du système la pratique politique de la théorie exposée dans Chevaucher le tigre, le dernier essai d’Evola. Avec cet ouvrage, le baron a donné le cadre intellectuel dans lequel s’inscrit l’action de Freda en affirmant qu’il ne saurait y avoir de compromis avec le système bourgeois. «Il y a une solution, écrit Evola, qu’il faut résolument écarter: celle qui consisterait à s’appuyer sur ce qui survit du monde bourgeois, à le défendre et à s’en servir de base pour lutter contre les courants de dissolution et de subversion les plus violents après avoir, éventuellement, essayé d’animer ou de raffermir ces restes à l’aide de quelques valeurs plus hautes, plus traditionnelles». Et le baron d’ajouter : «Il pourrait être bon de contribuer à faire tomber ce qui déjà vacille et appartient au monde d’hier, au lieu de chercher à l’étayer et à en prolonger artificiellement l’existence. C’est une tactique possible, de nature à empêcher que la crise finale ne soit l’oeuvre des forces contraires dont on aurait alors à subir l’initiative. Le risque de cette attitude est évident : on ne sait pas qui aura le dernier mot».
Dans La Désintégration, Freda n’est pas tendre avec les valeurs et les idoles de la société bourgeoise. Ordre pour l’ordre, sacro-sainte propriété privée, capitalisme, conformisme moral, anticommunisme viscéral et aveugle, pro-sionisme et philo-américanisme, mais aussi Dieu, prêtres, magistrats, banquiers, rien ni personne n’échappe à sa critique. A ce modèle marchand dominant, il propose une véritable alternative, réaffirmant la doctrine traditionnelle de l’Etat, opposée intégralement aux pseudo-valeurs bourgeoises, et élaborant un projet étatique cohérent, dont l’aspect le plus spectaculaire est l’organisation communiste de l’économie -un communisme spartiate et élitiste, qui doit plus à Platon qu’à Karl Marx -.
Homme d’action, Freda vomit les pseudo-intellectuels évolo-guénoniens enfermés dans leur tour d’ivoire. Il a des mots très durs pour certains évolomanes, «stériles apologètes du discours sur l’Etat», «adorateurs d’abstractions», «champions des témoignages conceptuels», qui ne sont, à ses yeux, que des chevaucheurs de tigres de papier. «Pour nous, écrit-il, être fidèle à notre vision du monde - et donc de l’Etat - signifie se conformer à elle, ne rien laisser de non entrepris pour la réaliser historiquement». Dans cette perspective, il manifeste clairement l’intention d’aller à la rencontre des secteurs objectivement engagés dans la négation du monde bourgeois, y compris l’ultra-gauche extra-parlementaire à laquelle il propose une stratégie loyale de lutte unitaire contre le Système. Il est alors en contact avec divers groupes maoïstes, comme Potere Operaio et le Parti communiste d’Italie-marxiste léniniste.
«Chez un soldat politique, la pureté justifie toute dureté, le désintérêt toute ruse, tandis que le caractère impersonnel imprimé à la lutte dissout toute préoccupation moraliste». C’est sur ces fortes paroles que se clôt le manifeste.
VICTIME DE LA DEMOCRATIE
Le 12 décembre 1969, une bombe explose dans la Banque nationale de l’agriculture, Piazza Fontana, à Milan, tuant 16 personnes et en blessant 87. La section italienne de l’Internationale situationniste d’ultra-gauche diffuse un manifeste intitulé Le Reichstag brûle, qui dénonce le régime comme le véritable organisateur du massacre. Les situationnistes ne cesseront de répéter que la bombe de Piazza Fontana n’était «ni anarchiste, ni fasciste».
Giorgio Freda, quant à lui, poursuit sa lutte intellectuelle contre le Système. En 1970, dans une préface à un texte d’Evola, il envisage favorablement la possibilité d’une guérilla urbaine en Italie. En avril 1971, les Edizioni di Ar publient officiellement, pour la première fois dans la péninsule depuis 1945, Les Protocoles des Sages de Sion. Le même mois, Freda est arrêté et accusé d’ «avoir diffusé des livres, des imprimés et des écrits contenant de la propagande ou instigation à la subversion violente». La machine répressive se met en branle. Pour la première fois depuis la fin du régime fasciste, un magistrat entend appliquer l’article 270 du Code Rocco. Peu après, les Edizioni di Ar publient L’ennemi de l’homme, un recueil de la poésie palestinienne de combat, provoquant la fureur des sionistes.
En juillet 1971, le juge d’instruction modifie les chefs d’accusation et reproche à Freda d’avoir fait «de la propagande pour la subversion violente de l’ordre politique, économique et social de l’Etat» par l’intermédiaire de La désintégration du système , «où il est fait allusion à la nécessité de la subversion, par des moyens violents, de l’Etat démocratique et bourgeois et de son remplacement par un organisme étatique défini et caractérisé comme Etat populaire».
Nullement impressionné par la répression, les Edizioni di Ar publient, en novembre 1971, la traduction italienne du Juif international d’Henry Ford.
Le 5 décembre 1971, Freda est de nouveau arrêté. Il n’est plus seulement poursuivi pour délit d’opinion, mais on l’accuse carrément d’avoir organisé le massacre de Piazza Fontana. Puisqu’on ne réussit pas à coincer les «anarcho-fascistes», on coincera les «nazi-maoïstes». Les accusations contre Freda reposent sur deux types d’indices: il aurait acheté des minuteries dont les débris furent retrouvés dans la banque, ainsi que les sacs de voyages dans lesquels furent déposées les bombes. Or, Freda avait bel et bien acheté des minuteries, remises à un capitaine des services secrets algériens qui les lui avait demandées pour les Palestiniens. L’hebdomadaire Candido, qui menera une enquête en RFA auprès du fabricant, recueillera les preuves que les minuteries vendues en Italie n’étaient pas 57 , comme le soutenait le juge - Freda en avait acheté 50 -, mais plusieurs centaines, et que les modèles achetés par l’éditeur différaient de ceux utilisés pour l’attentat. De plus, la commerçante de Bologne qui avait vendu quatre sacs de voyage semblables à ceux utilisés pour l’attentat ne reconnaîtra pas comme acheteur Freda, mais deux officiers de police... Bien entendu, le juge d’instruction ne tiendra aucun compte de ces preuves à décharge. Freda commence son tour des prisons italiennes Rien que pour 1972, Padoue, Milan et Trieste. Puis Rome, Bari, Brindisi, Catanzaro.
Traité de «maoïste» ou d’«agent de la Chine communiste» par la Droite, en particulier les néo-fascistes du MSI, de «raciste fanatique» ou d’«antisémite délirant» par la gauche légaliste et les milieux sionistes, rejeté peureusement par certains hommes d’ultra-gauche avec lesquels il avait collaboré activement, Giorgio Freda est alors affublé par la presse de l’étiquette, qui se veut infamante, de «nazi-maoïste». Seul point positif, grâce au battage mediatique, les 1500 exemplaires de La désintégration du système sont rapidement épuisés. Quelques années plus tard, Freda admettra que ce texte a été plus pris en considération par les ultras de gauche que par ceux de droite.
LE PROCES
En janvier 1975 s’ouvre, devant la Cour d’Assises de Catanzaro, le procès-fleuve de Piazza Fontana. Sont jugés l’anarchiste Pietro Valpreda et onze complices, le néo-fasciste Giorgio Freda et douze coinculpés. Arrivé au terme de la détention préventive, Freda est remis en liberté et assigné à résidence en août 1976. Ses convictions sont demeurées intacts. C’est ainsi qu’en 1977, alors qu’il risque une condamnation à perpétuité, il n’hésite pas, dans un entretien qu’il accorde à son camarade Claudio Mutti, à parler de la lutte armée comme de la meilleure forme d’opposition au Système en Italie !
Convaincu que les dés sont pipés et que sa condamnation ne fait aucun doute, Freda s’enfuit en octobre 1978. Il est capturé, pendant l’été 1979, au Costa-Rica, dont il n’est pas extradé, mais ramené de force par la police politique italienne.
La farce judiciaire se poursuit. En décembre 1984, s’ouvre à Bari le quatrième procès pour le massacre de Piazza Fontana. Après seize ans d’enquête, Freda est finalement acquitté de ce crime, son incarcération n’étant maintenue que pour délit d’opinion, «association subversive» selon le jargon juridique italien, qui lui vaut une condamnation à quinze ans de prison.
A sa libération, Freda fera encore parler de lui dans les media en lançant le Fronte nazionale, ce qui lui vaudra d’être une nouvelle fois arrêté et poursuivi, en juillet 1993. Décidément, bon sang ne saurait mentir !
Edouard Rix, Le Lansquenet, printemps 2003, n°17.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, histoire, nationalisme révolutionnaire, nazi-maoïsme, giorgio freda, stratégie de la tension, années de plomb |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



