samedi, 28 février 2026
Le nihilisme historique et la crise du politique à notre époque

Le nihilisme historique et la crise du politique à notre époque
Par Santiago Mondéjar
Source: https://juangabrielcarorivera.substack.com/p/el-nihilismo...
Le nihilisme historique ne se réduit pas à une posture sceptique envers les récits hérités, ni à une méthodologie révisionniste interne à l'historiographie. Il doit plutôt être compris comme une crise ontologique de la temporalité politique en soi. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'exactitude des représentations du passé, mais la possibilité même que l'histoire puisse fonctionner comme un horizon médiateur entre l'être et la compréhension de soi collectifs (Hegel, 1807/1977 ; Ricoeur, 2004).
Lorsque cette fonction médiatrice s'effondre, le temps cesse d'apparaître comme un horizon de devenir et se fragmente en présents déconnectés. Le sujet politique ne se situe plus dans un continuum de sens, mais se confronte à lui-même comme un commencement absolu. Le nihilisme historique transforme ainsi le passé d'une dimension constitutive du présent en un reste intolérable, une archive de culpabilité, d'erreur ou de violence qui doit être annulée plutôt qu'interprétée. Il ne nie pas l'histoire au sens factuel, mais la dé-ontologise. Le temps n'est plus un champ de médiation, mais un lieu d'effacement.
En termes hégéliens, cela correspond à l'effondrement de la négativité en tant qu'Aufhebung, la sublation par laquelle la négation annule et préserve ce qu'elle nie (Hegel, 1821/1991). La négativité n'est plus productive; elle ne génère plus de réconciliation, mais devient absolue. Elle cesse de fonctionner comme moteur du devenir et devient principe de désintégration. Le nihilisme historique n'est donc pas simplement critique, mais anti-formal. C'est une critique sans monde, une négation sans réconciliation.
Cette désarticulation ontologique est indissociable d'une crise de la subjectivité politique. Lorsqu'un peuple ne peut plus se reconnaître comme agent historique, l'identité collective perd ses repères symboliques. Le présent n'est plus habité comme un moment de devenir, mais comme un point zéro. Le résultat n'est pas l'émancipation, mais l'abstraction: une liberté sans monde, un sujet sans héritage (Arendt, 1958).
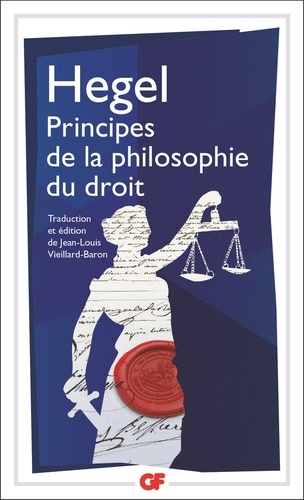 Dans La philosophie du droit, Hegel insiste sur le fait que l'histoire n'est pas une succession d'événements empiriques, mais le processus par lequel le Geist s'objective dans des institutions, des pratiques et des modes de vie partagés, ce qu'il appelle Sittlichkeit ou substance éthique (Hegel, 1821/1991). L'histoire, en ce sens, n'est pas une toile de fond sur laquelle se déroule la politique, mais le moyen par lequel la vie politique prend forme.
Dans La philosophie du droit, Hegel insiste sur le fait que l'histoire n'est pas une succession d'événements empiriques, mais le processus par lequel le Geist s'objective dans des institutions, des pratiques et des modes de vie partagés, ce qu'il appelle Sittlichkeit ou substance éthique (Hegel, 1821/1991). L'histoire, en ce sens, n'est pas une toile de fond sur laquelle se déroule la politique, mais le moyen par lequel la vie politique prend forme.
Par conséquent, l'État n'est pas un mécanisme externe imposé à des individus atomisés. Il est la cristallisation immanente d'une vie éthique vécue qui sert de médiateur entre la subjectivité et l'universalité. Sa légitimité ne découle pas uniquement de la légalité procédurale, mais de la reconnaissance que l'ordre actuel est — toujours fini et conflictuel — la réalisation d'une rationalité historique (Habermas, 1976).
Cette reconnaissance n'est jamais complète. Le conflit est intrinsèque à la vie éthique. Cependant, dans une perspective dialectique, le conflit n'est pas purement destructeur, mais le moyen par lequel la réconciliation devient possible. La légitimité d'un ordre politique ne réside pas dans sa pureté, mais dans sa capacité à métaboliser sa propre négativité (Taylor, 1975).
Le nihilisme historique interrompt ce métabolisme. Lorsque le passé n'est plus reconnu comme un moment nécessaire du devenir, la négativité cesse d'être productive. L'État perd sa densité symbolique et devient une structure purement formelle. L'autorité se réduit à la procédure, la loi à l'application, la politique à la gestion (Weber, 1919/2004). La légalité peut persister, mais la légitimité se dissout. L'ordre politique devient radicalement contingent et ontologiquement insignifiant.
D'un point de vue post-structuraliste, cette transformation peut être décrite comme l'émancipation de la critique de l'horizon de la totalité. Alors que la négation dialectique préservait ce qu'elle niait, la critique contemporaine opère de plus en plus selon une logique d'annulation, dans laquelle tout héritage est réduit à une contamination (Derrida, 1994).
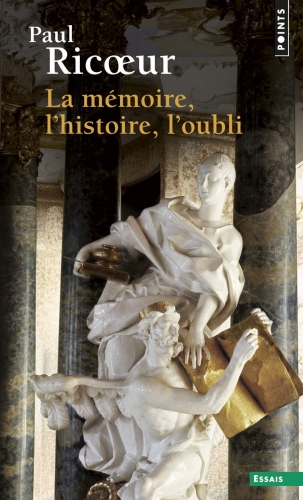 Il ne s'agit pas simplement d'une position morale, mais d'une transformation ontologique. Annuler le passé, ce n'est pas seulement le juger, mais le dépouiller de sa capacité à fonctionner comme ressource symbolique. La mémoire est sanctifiée ou criminalisée, mais elle cesse d'être médiatrice. Comme le soutient Ricoeur (2004), lorsque la mémoire devient tribunal ou monument, elle perd sa fonction narrative et s'effondre dans le ressentiment ou le mythe.
Il ne s'agit pas simplement d'une position morale, mais d'une transformation ontologique. Annuler le passé, ce n'est pas seulement le juger, mais le dépouiller de sa capacité à fonctionner comme ressource symbolique. La mémoire est sanctifiée ou criminalisée, mais elle cesse d'être médiatrice. Comme le soutient Ricoeur (2004), lorsque la mémoire devient tribunal ou monument, elle perd sa fonction narrative et s'effondre dans le ressentiment ou le mythe.
Le sujet produit par ce régime ne se libère pas, mais se disloque. Incapable désormais de se reconnaître comme un moment d'un devenir collectif, il se reconstitue comme un commencement absolu. Cependant, ce geste d'autonomie radicale est en soi la forme la plus abstraite d'aliénation: liberté sans héritage, négativité sans forme (Marx, 1844/1978).
Le concept du politique de Carl Schmitt révèle pourquoi le nihilisme historique ne peut rester politiquement neutre. Pour Schmitt, le politique n'est pas un domaine parmi d'autres, mais l'instance existentielle dans laquelle un collectif décide de son propre mode de vie. Cette décision se résume à la distinction entre ami et ennemi, non pas comme un jugement moral, mais comme une différenciation existentielle (Schmitt, 1932/2007).
Cependant, une telle décision présuppose un sujet historique. Un peuple ne peut décider par lui-même que s'il se reconnaît comme quelque chose qui a été et qui peut être menacé. L'identité politique ne s'invente pas, elle se transmet. La mémoire collective n'est pas un accessoire de la souveraineté, mais sa condition même (Assmann, 2011).
Le nihilisme historique neutralise cette condition. En dissolvant l'héritage, il prive le peuple de sa capacité d'autodétermination. Lorsque le collectif ne peut plus décider par lui-même en tant que sujet historique, d'autres décident à sa place: les élites technocratiques, les systèmes économiques ou les structures supranationales (Agamben, 2005). Le pouvoir ne disparaît pas simplement, il devient opaque, voire confus.
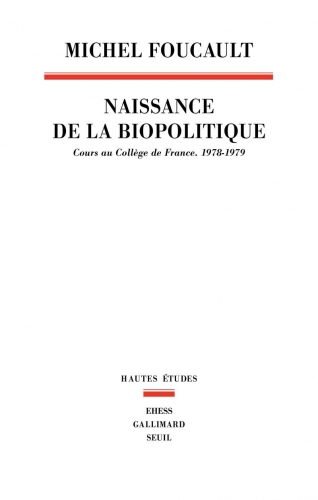 La neutralisation du passé conduit à la neutralisation du politique. La distinction entre ami et ennemi devient impensable car il n'y a plus de « nous » historique à défendre. À sa place émerge une rationalité technocratique dans laquelle les conflits sont repensés comme des problèmes administratifs. La souveraineté se dissout dans la gouvernance ; la politique devient la gestion de processus (Foucault, 2008).
La neutralisation du passé conduit à la neutralisation du politique. La distinction entre ami et ennemi devient impensable car il n'y a plus de « nous » historique à défendre. À sa place émerge une rationalité technocratique dans laquelle les conflits sont repensés comme des problèmes administratifs. La souveraineté se dissout dans la gouvernance ; la politique devient la gestion de processus (Foucault, 2008).
Cette dépolitisation n'est pas pacifique. C'est la forme contemporaine d'une théologie politique inversée. Comme l'a fait valoir Schmitt (1922/2005), les concepts politiques modernes sont des concepts théologiques sécularisés. Cependant, dans le nihilisme historique, la place de l'absolu n'est plus occupée par Dieu, mais par le vide lui-même. Le vide devient le souverain silencieux.
Des décisions continuent d'être prises, mais elles ne semblent plus en être. Le pouvoir opère sans être nommé. Le peuple est gouverné, mais il ne se reconnaît plus comme sujet du gouvernement.
La dissolution de l'Union soviétique illustre très clairement cette dynamique. Lorsque son récit fondateur a été réinterprété exclusivement comme une série de crimes et d'échecs, la négativité a cessé d'être dialectique et est devenue absolue (Furet, 1999). L'histoire ne pouvait plus être considérée comme un moment nécessaire du devenir.
Comme le montre Yurchak (2006), il ne s'agissait pas simplement d'un effondrement institutionnel, mais aussi symbolique et ontologique. L'État a perdu sa reconnaissance historique. Sa désintégration était métaphysique avant d'être politique.
Surmonter le nihilisme historique ne signifie pas restaurer le mythe a-critique. Cela signifie réintégrer la négativité dans la totalité, en restaurant sa fonction médiatrice. La mémoire doit redevenir un espace de reconnaissance politique plutôt qu'un tribunal ou un sanctuaire (Ricoeur, 2004).
Sans cette médiation, il n'y a pas de sujet politique, seulement une administration ; il n'y a pas de légitimité, seulement une procédure ; il n'y a pas d'histoire, seulement des archives. Reconstruire le lien entre la négativité, la décision et la totalité n'est pas un geste conservateur. C'est la condition ontologique de l'autodétermination collective.
Références :
Agamben, G. (2005). State of exception. University of Chicago Press.
Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.
Assmann, J. (2011). Cultural memory and early civilization. Cambridge University Press.
Derrida, J. (1994). Specters of Marx. Routledge.
Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics. Palgrave.
Furet, F. (1999). The passing of an illusion. University of Chicago Press.
Hegel, G. W. F. (1977). Phenomenology of spirit. Oxford University Press.
Hegel, G. W. F. (1991). Philosophy of right. Cambridge University Press.
Marx, K. (1978). Economic and philosophic manuscripts. Norton.
Ricoeur, P. (2004). Memory, history, forgetting. University of Chicago Press.
Schmitt, C. (2005). Political theology. University of Chicago Press.
Schmitt, C. (2007). The concept of the political. University of Chicago Press.
Taylor, C. (1975). Hegel. Cambridge University Press.
Weber, M. (2004). The vocation lectures. Hackett.
Yurchak, A. (2006). Everything was forever, until it was no more. Princeton University Press.
18:52 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nihilisme, nihilisme historique, crise du politique, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 février 2026
La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique

La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique
Santiago Mondejar Flores
Source: https://posmodernia.com/la-justicia-sin-verdad-rawls-y-la...
Alors que la théorie politique contemporaine célèbre avec un rituel académique l'œuvre de John Rawls comme l'aboutissement d'une réflexion libérale raisonnable et modérée, nous devons considérer cette jubilation pour ce qu'elle est à bien des égards: la cristallisation philosophique d'une époque moralement affaiblie, d'une civilisation qui a remplacé la recherche du bien par la gestion prudente des préférences, la vérité par le consensus, la dignité par la neutralité (MacIntyre, 1981 ; Taylor, 1989).
Rawls fait sans aucun doute preuve d'une grande et brillante technique, mais il adopte également une attitude épistémologique et morale qui renvoie à ce que l'on pourrait appeler l'hypostase de la justice: la transformation de la justice en un fétiche, qui n'est pas très différent du fétiche libéral de la liberté absolue, promu dans d'autres contextes comme la sphère inviolable de l'individu et la transaction rationnelle sans poids moral ultime (Deneen, 2018). C'est cette hypostase que nous devons soumettre à la critique, car il ne s'agit pas d'une erreur mineure, mais d'un renoncement profond à une dimension incontournable de la vie morale humaine.
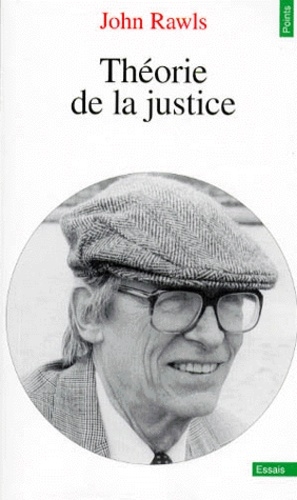 Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).
Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).
La célèbre « position originelle » et son voile d'ignorance ne sont donc pas des outils heuristiques neutres permettant de découvrir une vérité morale; ils constituent un artifice conceptuel conçu pour balayer sous le tapis toute question gênante sur ce qui constitue une bonne vie, une nature humaine orientée vers le bien ou une hiérarchie de valeurs qui transcende le consensus contingent d'une société libérale avancée (Sandel, 1982).
Chez Rawls, la justice se légitime par son acceptabilité, et non par sa vérité. Et si la justice se définit par son acceptabilité, et non par sa vérité, alors nous ne sommes plus face à une éthique, mais à une technique de stabilisation sociale (Williams, 1985).
Cette neutralité axiologique — que Rawls présente comme une vertu — est, du point de vue d'une réflexion morale plus exigeante, un symptôme d'épuisement philosophique. Car renoncer à une conception substantive du bien n'équivaut pas à une ouverture pluraliste compréhensive, mais à un silence délibéré sur les tensions morales les plus profondes (Taylor, 1992). La tradition classique concevait la justice comme une vertu orientée vers la réalisation de possibilités humaines objectivement valables.
Pour Aristote, la justice et le bien commun étaient intrinsèquement liés; pour Kant, la moralité — y compris la justice — repose sur des impératifs catégoriques qui ne peuvent dépendre d'accords contingents. Rawls, en faisant abstraction de ces fondements, confie la force normative de la justice au consensus entre agents rationnels. Mais le consensus n'est pas la vérité, et l'acceptabilité n'est pas la correction morale (MacIntyre, 1988). L'universalisme que proclame Rawls est un universalisme formel, un vide qui peut accueillir des conceptions incompatibles du bien à condition qu'elles s'ajustent à ses conditions procédurales.
La position originelle, conçue comme l'appareil justificatif des principes de justice, révèle clairement cette renonciation. Sous le voile de l'ignorance, les agents ne savent rien de leur personne concrète: ils ne connaissent pas leur talent, leur statut social, leurs priorités vitales. Cette abstraction extrême élimine du jugement moral tous les facteurs qui font de la vie humaine un événement moralement significatif (Sandel, 1982).
Il n'y a pas de passions, pas d'histoire, pas de conflit tragique entre le devoir et le désir. Il n'y a qu'une rationalité calculatrice qui tente d'équilibrer les attentes dans des conditions artificielles. Dans ce panorama, la justice ne répond plus à une urgence morale — comme elle répondrait à la fragilité, à la vulnérabilité, à l'inégalité réelle des vies incarnées — mais à une prudence rationnelle qui cherche à atténuer les risques (Walzer, 1983). Ainsi conçue, la justice devient un contrat destiné à protéger ses propres intérêts potentiels, et non une exigence morale qui transforme la vie des sujets.
Le caractère appauvri de cette conception apparaît de manière paradoxale si on la compare à l'élaboration contemporaine de la liberté comme totémisme. Dans l'analyse culturelle de notre époque, la liberté absolue — la revendication de l'autodétermination sans sanction morale ou sociale — a été élevée au rang de mythe qui fonctionne comme un placebo face à la désorientation morale de la modernité tardive (Taylor, 2007).

Cette liberté sans ancrage dans une compréhension du bien devient une illusion, un masque qui cache le vide de notre orientation éthique. De manière analogue, chez Rawls, la justice devient une idolâtrie: une structure formelle technocratique vénérée pour sa neutralité, même si, au fond, elle ne fait qu'administrer des préférences sans soutenir aucune vie morale au-delà de la simple coexistence pacifique (Mouffe, 2005).
Si ce diagnostic culturel peut être identifié comme le mal de notre époque – une foi dans la liberté comme absolu, dans l'économie comme critère ultime de sens, dans la transaction comme modèle d'interaction humaine –, alors Rawls n'en est pas l'antidote, mais sa synthèse la plus raffinée. Sa théorie ne sauve pas la moralité de l'indifférence postmoderne, mais l'intègre dans un schéma de légitimation rationnelle (Deneen, 2018).
La neutralité axiologique, célébrée comme le respect de la pluralité, est, d'un autre point de vue, le même renoncement qui se répand aujourd'hui sous la forme de célébrations culturelles du choix personnel: la suspension des jugements sur le bien au profit du respect procédural des décisions subjectives (Taylor, 1992).

L'égalitarisme de Rawls ne sauve donc pas la justice de cette renonciation; il la reconfigure simplement. La priorité des principes de justice n'est pas de nier les inégalités en elles-mêmes, mais de s'assurer que les inégalités sont acceptables selon des critères procéduraux (Rawls, 1971). Ce résultat est-il préférable à une inégalité arbitraire ? Peut-être. Mais moralement, la question de savoir pourquoi nous devrions le préférer implique de faire appel à une conception du bien humain que Rawls a exclue de sa théorie. La justice rawlsienne devient ainsi une justice fonctionnelle: elle sert à administrer des sociétés complexes, mais ne donne aucune indication sur les vies qui méritent d'être vécues ni sur les raisons pour lesquelles certains biens ont plus de valeur que d'autres (Walzer, 1983).
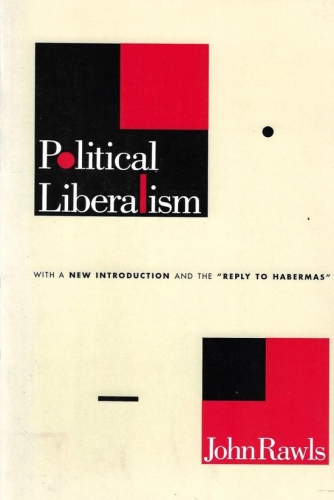 Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.
Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.
Cependant, une telle neutralité n'est pas une suspension de la moralité, mais une consécration tacite d'une morale libérale particulière, historiquement située et rarement soumise à un examen critique (Sandel, 1998). L'exigence critique est suspendue sur l'autel de l'acceptabilité et de la stabilité sociale.
Cette suspension ne reste pas confinée au plan théorique et n'est pas politiquement inoffensive. Lorsque la légitimité de l'ordre politique repose exclusivement sur la correction procédurale et non sur une conception substantive — bien que contestée — du bien commun, l'autorité morale des institutions s'affaiblit progressivement (Williams, 2005).
Là où la justice ne peut plus faire appel à des vérités normatives fortes, le pouvoir recourt à la légalité formelle, à l'efficacité administrative et à l'expertise technique pour maintenir l'obéissance. Ce déplacement n'est pas accidentel, mais structurel.

Une société qui a renoncé à délibérer publiquement sur les fins de la vie en commun n'élimine pas le conflit moral, mais le réintroduit sous la forme d'une gestion technocratique, d'une réglementation intensive ou d'une décision exceptionnelle (Mouffe, 2005 ; Schmitt, 1922/2005).
En ce sens, le libéralisme rawlsien ne fonctionne pas comme un rempart contre l'autoritarisme, mais comme l'un des cadres qui affaiblissent les défenses morales contre celui-ci. En réduisant la politique à la bonne application de procédures par des institutions supposées impartiales, il déplace la légitimité de l'orientation vers le bien commun vers la conformité à des règles abstraites (Williams, 1985).
Lorsque ces procédures cessent de générer la loyauté civique – en raison d'inégalités persistantes, de crises sécuritaires ou de fragmentation culturelle –, le procéduralisme manque de ressources internes pour se renouveler. Le vide normatif laissé par la neutralité est comblé par des formes de pouvoir qui promettent l'ordre, la décision et l'efficacité là où le libéralisme ne peut offrir que des garanties formelles (Deneen, 2018).
Les expressions contemporaines de l'illibéralisme et de l'autoritarisme démocratique formellement irréprochable ne doivent pas être comprises comme de simples régressions pré-libérales, mais comme des réponses symptomatiques à l'appauvrissement moral de l'ordre libéral.
Là où la justice a été réduite à une technique de stabilisation et la liberté à un choix sans orientation, la revendication de sens revient sous des formes plus brutales: décision sans délibération, autorité sans légitimité morale partagée, ordre sans justice substantive (Mouffe, 2018). La coercition apparaît alors comme un substitut à la persuasion morale que le libéralisme neutre lui-même a désactivée.
Bibliographie
Deneen, P. J. (2018). Why liberalism failed. Yale University Press.
MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in moral theory. University of Notre Dame Press.
MacIntyre, A. (1988). Whose justice? Which rationality? University of Notre Dame Press.
Mouffe, C. (2005). On the political. Routledge.
Mouffe, C. (2018). For a left populism. Verso.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.
Sandel, M. J. (1982). Liberalism and the limits of justice. Cambridge University Press.
Sandel, M. J. (1998). Liberalism and the limits of justice (2nd ed.). Cambridge University Press.
Schmitt, C. (2005). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty (G. Schwab, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1922)
Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard University Press.
Taylor, C. (1992). The ethics of authenticity. Harvard University Press.
Taylor, C. (2007). A secular age. Harvard University Press.
Walzer, M. (1983). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic Books.
Williams, B. (1985). Ethics and the limits of philosophy. Harvard University Press.
Williams, B. (2005). In the beginning was the deed: Realism and moralism in political argument. Princeton University Press.
15:24 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john rawls, justice, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 décembre 2025
Ontologie et eschatologie de l’ordre mondial

Ontologie et eschatologie de l’ordre mondial
Evgueni Vertlib
À une époque où la victoire de la vision du monde libérale semblait définitive et où l’on proclamait la « fin de l’histoire » comme un fait irréversible, le monde s’est retrouvé au bord d’une nouvelle réalité post-atomique, où les conflits idéologiques et civilisateurs ne disparaissaient pas, mais se transformaient en formes plus complexes et ontologiquement inconciliables. L’ordre mondial ne peut plus reposer sur l’illusion d’une homogénéité ou sur la stratégie de détruire l’adversaire, car les enjeux ont atteint une limite existentielle: la victoire, définie comme la maximisation des dégâts, entraîne aujourd’hui inévitablement une catastrophe globale. Ainsi, la seule issue réaliste du face-à-face n’est pas la capitulation de l’une ou l’autre partie, mais la reconnaissance ontologique et la fixation d’une nouvelle limite stratégique, dans la logique de laquelle la capacité à prévenir la guerre devient la valeur politique suprême. En conséquence, le monde n’atteindra pas l’utopie de l’homogénéité, mais trouvera la stabilité grâce à la « multiplicité florissante » (K. Leontiev), passant à un état de tension contrôlée et de coexistence structurale dans tous les hémisphères.

Les années de Mathusalem apportent une confrontation ontologique profonde entre deux principes civilisateurs : l’universalisme atlantique (Léviathan), qui aspire à l’unification du monde et à l’élimination de toutes les formes de différence, et le principe tellurique (Katechon), qui défend le droit des peuples à la souveraineté, à l’enracinement et à la multiplicité du sacré. L’essence de cette confrontation consiste en la lutte pour la structure même de l’être, pour l’essence humaine et la trajectoire du développement historique. Le principe atlantique (Léviathan) s’oppose au principe tellurique (Katechon) : le mobile (maritime, abstraction) contre le sédentaire (terre, ordre). Historiquement, chaque avancée de l’universalisme, depuis les réformes de Pierre Ier jusqu’aux théories révolutionnaires du début du XXe siècle, a été accompagnée d’une tentative de démanteler les systèmes qui maintiennent les différences nationales et culturelles. Le mondialisme contemporain n’a pas rejeté cette impulsion, mais l’a reconfigurée selon une clé technocratique. La chimère de la révolution permanente a été remplacée par le modèle d’intégration du Nouvel Ordre Mondial à travers la bureaucratie, la standardisation numérique et la gestion unifiée, où la supervision et la régulation remplacent fonctionnellement l’extrémisme antérieur. La dimension eschatologique du choix stratégique s’exprime dans un dilemme : soit l’universalisme technocratique, où le contrôle se dissimule derrière une unité symbolique, soit le rétablissement de la multipolarité tellurique, qui affirme le droit à la différence comme principe fondamental de l’ordre mondial.
Le bloc tellurique des États, dont le noyau est constitué par les centres de pouvoir de l’Eurasie — Russie, Chine et Iran —, applique une stratégie d'endiguement et de limitation de l’hégémonisme universaliste. La mission du Katechon, comprise comme la tâche de retenir le temps historique et d’entraver la triomphale victoire du mal eschatologique, vise à créer un ordre mondial autonome, basé sur une architecture duale, où coexistent deux systèmes qui se limitent mutuellement. Le maintien de l’autonomie stratégique exige une approche globale dans laquelle l’autosuffisance économique, technologique, militaire et culturelle s’intègre dans un système unique de durabilité.
La clé pour les États telluriques est d’assurer la continuité des chaînes de production et de technologie, le contrôle des ressources et des flux énergétiques, ainsi que la capacité de réponse autonome en matière de défense. La durabilité stratégique est assurée non seulement par la présence de forces armées, mais aussi par la structure organisationnelle de la société, le niveau de préparation technologique et la flexibilité de la mobilisation. L’interaction avec d’éventuels alliés du Sud global joue un rôle stratégique, renforçant les alliances macro-régionales et créant des plateformes pour un développement conjoint.

La dissuasion financière se réalise par le biais de systèmes monétaires et de paiement alternatifs, garantissant la liberté financière stratégique. La dissuasion économique repose sur le principe de la limitation stratégique des vulnérabilités, où les corridors logistiques deviennent un instrument de contrôle stratégique. L’autonomie technologique se construit par la création de plateformes numériques et informatiques indépendantes: l’infrastructure numérique est construite selon le principe d’une gestion segmentée mais intégrée, où les systèmes critiques sont protégés contre l’ingérence extérieure, permettant d’atteindre la souveraineté économique et technologique par la création de complexes macro-régionaux autonomes. La dissuasion militaire intègre l’autonomie des forces armées nationales avec la coordination macro-régionale, en utilisant le concept d’«attaque impossible». La dimension informationnelle et culturelle du Katechon constitue la base stratégique de la souveraineté: le contrôle des discours et des codes culturels permet de préserver l’intégrité de la société face à la pression universaliste.
Dans sa configuration ultime, le monde entre dans une ère où le changement anthropologique devient décisif: la formation d’un nouveau type de personne, séparée du territoire et de la tradition. Les futurologues ont prévu l’émergence du nomade global, un consommateur mobile, sans racines et vivant dans une culture de consommation jetable et dévaluée. Cette figure incarne le sujet idéal de l’Hyper-Empire technocratique: un être humain ayant perdu contact avec la terre et incapable de résister politiquement à tout ce qui vient de l’extérieur. La lutte pour la souveraineté se déplace dans l’espace intérieur de l’être humain: sa mémoire culturelle, ses fondements psychologiques et sa capacité à maintenir une identité stable. Une guerre des mentalités est menée pour la préservation du noyau humain. Les États doivent défendre leur propre code anthropologique pour éviter qu’il ne se dissolve dans le panier d’achat de la société hyper-modernisée. Ce projet de gestion technocratique est clairement annoncé par ses architectes. Klaus Schwab insiste sur le «Grand Reset» et son conseiller, Yuval Noah Harari, indique directement: «Nous n’avons simplement pas besoin de la majorité d’entre vous… Nous aurons l’opportunité de pirater les gens». Cette position, confirmée par des idéologues comme Jacques Attali, donne à la conception du nouveau camp de concentration numérique une objectif concret, dans lequel la supervision et la régulation remplacent fonctionnellement l’extrémisme antérieur.

La dimension financière de la confrontation est devenue le domaine où le projet atlantique a atteint sa plus grande maturité. La transition du contrôle territorial au contrôle informationnel et financier a permis de déplacer le centre du pouvoir vers le domaine de la surveillance algorithmique et de la dépendance monétaire. Ainsi apparaît l’eschatologie financière, un concept dans lequel l’argent se transforme d’instrument d’échange en mécanisme de contrôle total. L’unification de l’espace monétaire mondial par le biais des monnaies numériques ouvre la voie à la création d’un cadre financier supranational capable d’imposer des règles uniques. La formule historique «celui qui contrôle la masse monétaire d’un pays contrôle le pays» acquiert une dimension globale. Pour les forces telluriques, cela crée un impératif stratégique: la souveraineté monétaire devient un élément clé de l’indépendance politique, ce qui fait de la crypto-politique le front principal du XXIe siècle. À l’ère du capitalisme numérique, le principe atlantique obtient un avantage absolu dans la gestion de l’information. Le pouvoir algorithmique remplace le pouvoir des flottes, formant l’impérialisme des données, une forme de domination basée sur le contrôle de l’environnement numérique. La dimension eschatologique de ce projet se manifeste dans le désir de créer un état de paix où toute alternative serait techniquement impossible, transformant la fin de l’histoire en une eschatologie algorithmique.

La fracture entre les différents fronts du monde se déplace définitivement vers la sphère du contrôle de la signification. Un nouveau régime cognitif apparaît, dans lequel le contrôle s’exerce par la distribution de l’attention et la reconfiguration de la réalité, et où les algorithmes façonnent la perception de l’être humain. En réponse, le principe tellurique tente de rendre à la culture sa profondeur et sa sacralité. Le code culturel est une forme d’enracinement existentiel qui relie l’être humain à l’histoire et à l’espace. La confrontation entre dans le domaine de l’eschatologie culturelle: un projet cherche à créer un sujet universel pour l’économie en réseau (en utilisant la hyper-tolérance et la déconstruction postmoderne pour l’individualisation), tandis qu’un autre cherche à restaurer le sujet comme porteur de la tradition, dont l’existence transcende les prédictions et le contrôle des algorithmes.

La couche la plus profonde du conflit réside dans la question du corps et des limites. La civilisation atlantique propose l’idée de dissoudre la nature matérielle de l’être humain par le biais du posthumanisme, tandis que la logique tellurique insiste sur l’enracinement insurmontable de l’être humain dans la géographie charnelle de l’être. La terre implique le corps, et le corps implique des limites. Le projet atlantique construit un monde où les limites doivent disparaître, tandis que le projet tellurique construit un monde où les limites sont la base de l’ordre, et l’ordre la base de la liberté. Cela fait de la restauration des frontières une stratégie ontologique.
La structure du face-à-face mondial prend sa forme définitive lorsque l’on analyse le temps. Le projet atlantique cherche à priver l’humanité de sa profondeur historique, en réduisant le passé à des symboles déconstruits et l’avenir à une projection technocratique unique et rationnelle, ce qui constitue une confrontation entre deux théologies de l’histoire: la technocratique et la traditionnelle. Le système supra-humain que la civilisation atlantique souhaite créer est une technocratie sans technocrates, un pouvoir réparti entre machines et protocoles. Le projet tellurique, quant à lui, cherche à intégrer la technologie dans la structure du sens, plutôt que de remplacer le sens par la technologie, en générant l’idée de la souveraineté du sens.

Il est en jeu la propre possibilité d’existence des civilisations humaines en tant que formes de vie autosuffisantes, où la souveraineté commence par la liberté intérieure et le sens collectif. Le conflit entre les projets atlantique et tellurique n’est pas simplement une dispute sur la gouvernance du monde, mais une lutte sur ce qu’il faut considérer comme le monde. À ce niveau, le choix stratégique acquiert une profondeur eschatologique: accepter la dissolution dans un conglomérat nomade universel, ou construire un monde contre-eschatologique basé sur la sacralité de l’espace, la tradition et le droit à la différence, qui devient une nouvelle valeur politique suprême. La jonction de tous ces éléments forme un bloc macro-régional capable de maintenir l’équilibre stratégique avec le Léviathan. Le capital démographique devient alors un instrument de profondeur stratégique et une garantie de reproduction de la souveraineté nationale et culturelle, constituant un aspect fondamental dans cette lutte et, par conséquent, le pari final du conflit mondial.
Ainsi, nous avons exploré l’ontologie et l’eschatologie de l’ordre mondial, établissant que le conflit mondial a dépassé les limites de la géopolitique classique, devenant une confrontation antagoniste entre deux principes métaphysiques. Dans ce contexte, la victoire russe sur le théâtre des opérations ukrainien n’est pas seulement un succès militaire et politique, mais un acte existentiel de réalisation du potentiel des forces du Katechon pour contenir la victoire totale des intrigues antichristiques de l’euro-atlantisme. Étant donné l’inacceptabilité d’un affrontement militaire direct entre les pôles dans un contexte de dissuasion nucléaire entre des parties à potentiel de destruction mutuelle égal, la confrontation passe au plan de la stratégie d’épuisement: guerres de sanctions, blocus maritimes et technologiques, où la victoire ne se gagne pas tant par la destruction physique de l’ennemi que par la destruction de sa volonté de continuer la lutte. «Une façon efficace d’affaiblir un rival grand et armé d'un potentiel nucléaire est de le faire saigner de loin, ce qui constitue une version moderne et relativement sûre de la stratégie de l'anaconda. L’objectif de cette lutte n’est pas la défaite immédiate, mais l’épuisement prolongé et inexorable de ses ressources et de sa détermination politique», affirme le stratège américain de renom Stephen M. Walt (photo), professeur de Relations internationales à Harvard.

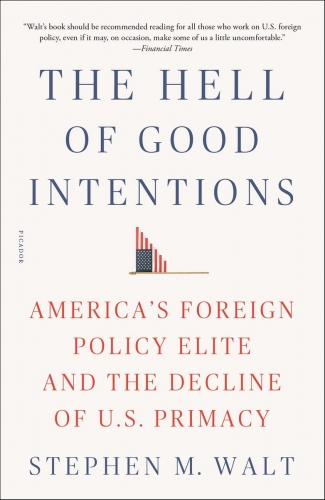

C’est précisément cette conscience d’un épuisement total, mais à distance, qui rend impossible la victoire totale du Léviathan et mène inévitablement à la nécessité d’établir une nouvelle limite de la sagesse stratégique. Cette limite conduit à la composition d’un compromis dual, que l’analyste Evgueni Vertlib a nommé l'«architecture de la survie» («La logique des compromis stratégiques», 2014 ; «Katechon et Léviathan. Duel global», 2025). L’auteur a formalisé la dichotomie Léviathan vs. Katechon non plus comme une confrontation entre États, mais comme une nécessité dans laquelle Léviathan et Katechon s’avèrent être des contrepoids indispensables dans l’unité dialectique des opposés, dictée par les limites de la destruction mutuelle. Le Katechon (l'Ours Russe), après avoir supporté la stratégie d’épuisement, oblige Léviathan à reconnaître les limites de son universalité: les limites du maintien de l’apparence de la victoire, la légitimation de la non-défaite comme victoire. La conclusion de cette confrontation ne sera pas la capitulation, mais la reconnaissance ontologique et la fixation d’une nouvelle limite stratégique. Selon cette logique, la victoire ne consiste pas à maximiser les dégâts, mais à maximiser la capacité à prévenir la guerre. En conséquence, le monde n’atteindra pas l’utopie de l’homogénéité, mais trouvera la stabilité dans sa multiplicité, ce qui est la seule issue réaliste à l’ère post-nucléaire et la garantie de la préservation de l’espace même de l’action historique, où la «multiplicité florissante» (K. Leontiev) devient la nouvelle valeur politique suprême.
Le monde entre dans une période de tension contrôlée et de coexistence structurée de deux hémisphères, ce qui, en essence, constitue une réincarnation pragmatique du principe de «coexistence pacifique», concept fondamental de la politique étrangère soviétique qui, malgré tout son arrière-plan idéologique, visait à prévenir un affrontement militaire direct et à fixer la compétition à long terme comme un processus contrôlé et non catastrophique. En ce sens, notre modèle de «coexistence structurée de deux hémisphères» occupe une position unique, démontrant un avantage significatif sur les deux autres paradigmes mondiaux majeurs.

Premièrement, il diffère de manière critique de la formule chinoise «Un pays, deux systèmes», un modèle développé par Deng Xiaoping pour préserver les enclaves capitalistes sous la souveraineté de l’État socialiste. Alors que cette formule atteint la paix par la subordination ontologique d’un système à la souveraineté étatique unifiée (comme le démontre l’interprétation officielle: «Un pays» est la prémisse et la base, les «deux systèmes» sont subordonnés à «un pays» et tous se basent dessus»), notre vision exclut la subordination hiérarchique. La «coexistence structurée de deux hémisphères» affirme l’équilibre, non la subordination, fixant la limite stratégique comme une frontière horizontale de reconnaissance mutuelle, où la « multiplicité florissante » se présente comme une valeur politique autosuffisante et une garantie de paix, et non comme une concession temporaire pour préserver l’unité de l’État.

Deuxièmement, notre conception se caractérise également par une plus grande rigidité politique et un réalisme accru par rapport à l’idée du «Dialogue des civilisations», promue notamment par le président iranien Mohammad Khatami, en réponse à la thèse du «Choc des civilisations». Alors que le «Dialogue des civilisations» vise à dépasser le conflit par un rapprochement éthique, culturel et de valeurs basé sur le respect mutuel et l’échange actif (en affirmant notamment qu’«il n’y a pas de choc des civilisations, mais un choc d’intérêts et d’ignorance»), il ne comporte pas de mécanismes pour contenir l’agression systémique. Notre conception, au contraire, est ontologiquement réaliste, puisqu’elle reconnaît et intègre la «tension contrôlée» comme partie intégrante du système, en fixant la limite stratégique précisément par la maximisation de la capacité à prévenir la guerre. De cette façon, elle ne se fonde pas uniquement sur la surmontée volontaire de l’«ignorance», mais utilise la force de dissuasion comme base de la stabilité structurelle. Par conséquent, la « coexistence de deux hémisphères » n’est pas seulement une question pragmatique pour éviter la guerre, mais aussi un mécanisme politique de premier ordre qui affirme l’égalité structurelle et fonde la paix sur une limite stratégique contrôlable.
Cette approche exige de renoncer aux prétentions universalistes, caractéristiques à la fois de l’idéologie de la Guerre froide et de l’hégémonisme post-bipolaire, où la victoire était conçue comme l’absorption totale ou la reformulation de l’adversaire. À la place, la nouvelle limite de l’action stratégique dicte la nécessité de développer des protocoles d’interaction complexes et multi-strates, capables d’intégrer l’antagonisme dans le tissu d’un ordre mondial durable. Dans ce système, la «tension contrôlée» devient un état permanent dans lequel les acteurs clés calibrent constamment leurs actions par rapport à la nouvelle limite stratégique, sans dépasser la ligne critique qui mène à la catastrophe. De cette manière, la différence ontologique des systèmes, en étant reconnue et institutionnalisée, cesse d’être une source de conflit incontrôlable et se transforme en une source d’équilibre dynamique, dans laquelle la stabilité est assurée, paradoxalement, précisément, par la coexistence compétitive.
Pour le Katechon, qui lutte seul contre la légion de l’Antéchrist, le rôle de la Russie en tant que Reteneur serait rempli. Cette mission, enracinée dans la Deuxième Épître de l’apôtre Paul aux Thessaloniciens (« Car le mystère de l’iniquité est déjà en action; il ne sera déployé que lorsque celui qui le retient sera enlevé… puis l’impie sera révélé»), se projette dans la tâche ontologique de stabiliser la limite stratégique globale.
Le calcul stratégique de la victoire russe dépasse la simple réussite des objectifs opérationnels et tactiques classiques et repose sur l’obligation d’amener l’ennemi à s’auto-limiter et à accepter l’irréductible multiplicité de l’architecture mondiale. La Russie n’aspire pas à la domination totale, mais à créer des faits irréversibles d’équilibre stratégique qui rendent toute escalade militaire ultérieure défavorable à l’existence même de l’ennemi. L’impératif clé est de maximiser sa propre stabilité et de minimiser l’espace opératoire pour l’expansionnisme mondialiste, ce qui se réalise par une formule triple: provoquer des dégâts inacceptables en cas de confrontation directe pour renforcer la limite stratégique; démontrer l’autonomie et l’autosuffisance de la civilisation, qui montre l’inutilité de la stratégie de «suffocation»; et former de nouveaux pôles d’attraction: coalitions d’États souverains pour lesquels le modèle dominant de «pluralité florissante» deviendra une alternative sûre à l’hégémonie centrée sur les États-Unis. Ainsi, la victoire russe n’est pas la capitulation de l’ennemi, mais la victoire du bon sens et de la nécessité historique, qui conduit à la reconnaissance ontologique par les deux hémisphères d’une nouvelle norme durable de l’ordre mondial: à l’humanité dans son ensemble, il est donné la possibilité d’exister «légalement» dans sa pluralité. L’objectif est de re-codifier la stratégie globale, passant de la logique du «celui qui gagne prend tout» à la raison pratique: «tous ceux qui reconnaissent la limite survivent». Telle est la fonction du Reteneur : non pas empêcher la fin du monde, mais la retarder autant que possible en établissant l’ordre et le droit au développement souverain dans des conditions de tension permanente contrôlée.

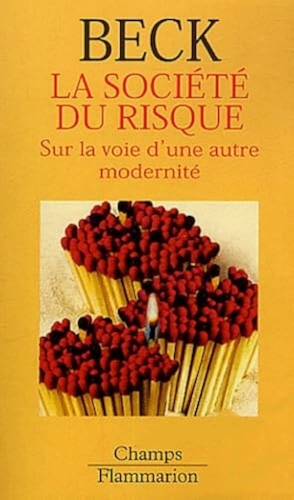
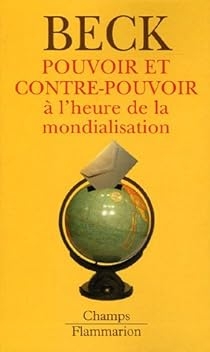
Cet impératif stratégique devient encore plus incontournable dans le contexte de la compréhension que l’histoire mondiale n’a pas seulement continué, comme l’a postulé Francis Fukuyama dans sa conception de « La fin de l’histoire » après la victoire de la démocratie libérale, mais qu’elle est revenue sous la forme d’un conflit entre des paradigmes ontologiques inconciliables, réfutant définitivement l’illusion de l’unification. Plus encore, cette nouvelle ère coïncide avec la formation de la «société du risque global» selon Ulrich Beck (1986), dans laquelle les menaces systémiques, invisibles et transfrontalières (du climat à l’atome) créent une nouvelle solidarité universelle face à une catastrophe commune provoquée par l’homme. «Les risques, comme les richesses, se distribuent selon un schéma de classes, sauf qu’ils le font en ordre inversé», affirmait Beck, soulignant que les menaces modernes dépassent toutes les frontières nationales, rendant toute tentative de victoire totale ontologiquement dénuée de sens. Ainsi, la Russie, agissant comme Reteneur, assume la fonction de stabilisateur mondial, dont la victoire ne consiste pas à imposer son ordre, mais à fixer une limite métaphysique infranchissable garantissant à toutes les civilisations leur propre existence par la «multiplicité florissante» et en annihilant toute prétention à une fin unique de l’histoire.
19:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : axtualité, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, ontologie, eschatologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 18 octobre 2025
Nietzsche et Marx
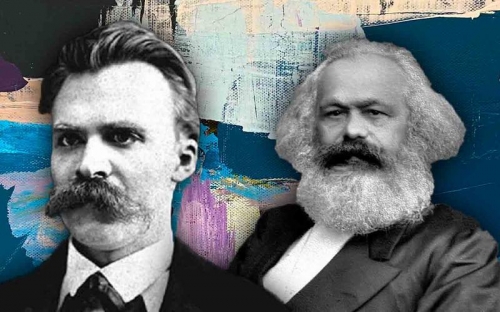
Nietzsche et Marx
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/10/06/costanzo-preve-om-ni...
 Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.
Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.
Preve était un penseur intéressant, comme en témoigne son ouvrage Marx e Nietzsche de 2004 (en italien, mais il existe aujourd’hui de bons logiciels de traduction). Le point de départ est que nous nous trouvons dans une nouvelle situation historique, où les anciennes lectures de Marx et Nietzsche sont dépassées. Il faut donc une nouvelle lecture, ce que Preve appelle une « orientation gestaltique ». Ce n'est pas chose aisée, étant donné les associations qui, au fil du temps, se sont attachées à Marx comme à Nietzsche, mais la situation est grave et, pour la comprendre, nous avons besoin, entre autres, de leurs outils.
Plusieurs de nos textes sur Marx et Engels ont abordé la déconstruction et la reconstruction, le fait de lire Marx « par la droite » et d’examiner dans quelle mesure une telle lecture offre des perspectives utiles et quelles en sont les limites. L’approche de Preve est en partie similaire; il estime que la dichotomie droite-gauche est dépassée et que Marx n’est aujourd’hui plus particulièrement de gauche. Il remarque qu’il est désormais reconnu que Nietzsche peut aussi être lu à gauche, mais « il n’est pas du tout de notoriété publique que Marx n’a pratiquement rien à voir avec ce qui est considéré comme la pensée de “gauche”. Marx était certainement “de gauche” en son temps, dans le sens que ce mot avait entre 1840 et 1880, mais aujourd’hui le terme “gauche”, malgré son flou, contient des éléments historiques (l'antifascisme, la modernisation) et philosophiques (l'historicisme, l'économicisme, etc.) qui n’ont plus rien à voir avec la vision du monde de Marx. »
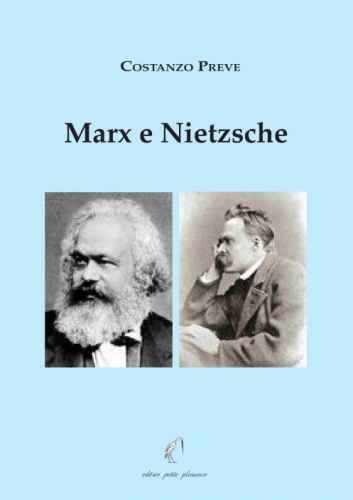
Preve et l’histoire
Mais jusqu’à présent, beaucoup ont parlé de sa mort (Nietzsche), de son inexistence (Marx), etc., mais personne n’avait encore osé parler de sa consommation. Vattimo le fait, et à mon avis, le philosophe turinois n’est que le porte-parole involontaire de forces historiques et économiques immensément plus puissantes que lui: à savoir, le capitalisme totalitaire post-bourgeois et post-prolétarien. Le fait que l’Être puisse effectivement être « consommé » ne peut se produire que dans un horizon social où la Consommation est devenue le seul lien social perceptible, visible et discernable.
– Preve
Preve propose un résumé original de l’histoire moderne où, entre autres, la petite bourgeoisie et la dichotomie droite-gauche sont éclairées d’un jour nouveau. En partie, il s’agit de constats déjà connus — il écrit notamment que « les années qui vont de 1917 à 1945 ont été qualifiées de “guerre civile européenne” (Nolte) et les années 1945 à 1975 de “trente glorieuses” (Hobsbawm) ». Il est intéressant qu’il considère la période jusqu’en 1975 comme un « revers » pour la logique du capital, cette logique qui réduit tout à des marchandises sur le marché (« la première société de l’histoire humaine dont la dynamique interne de développement tend à désintégrer toutes les communautés préexistantes et à les remplacer par une masse artificielle de producteurs et de consommateurs sous pression »).
Ce revers venait de deux directions, de la « droite » et de la « gauche » (Preve cite ici tout autant Perón et le socialisme baasiste - de Syrie et d'Irak - que Staline et Hitler). Il s’agissait, du moins en Europe, de deux stratégies: «une tendance faisait appel à la petite bourgeoisie et était principalement de droite. Une autre tendance s’adressait aux classes laborieuses, prolétariennes et populaires et était principalement de gauche ». Dès les années 1970, la dynamique du capital a repris, plus particulièrement après la chute du bloc de l’Est.

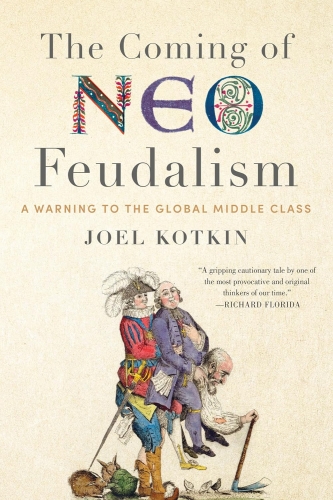
Preve rappelle le grand ouvrage de Samuel Francis, Leviathan & Its Enemies, en constatant que « le nouveau capitalisme qui émerge après le tournant du 20ème siècle est largement post-bourgeois, post-populaire et post-prolétarien ». Il évoque à la fois Francis et Kotkin lorsqu’il identifie les composantes de la nouvelle société de classes comme « une oligarchie financière multinationale, une classe moyenne mondiale et une plèbe flexible sont les nouvelles classes qui exigent de nouvelles approches et de nouvelles classifications, lesquelles tardent à émerger précisément en raison d’une paralysie de trente ans dans la perception des innovations historiques ».
Un aspect fécond de l’écriture historique de Preve est sa compréhension du phénomène de 1968, célébré par beaucoup, et pas seulement à gauche, mais que Preve identifie comme « un moment “systémique” de transition d’un capitalisme bourgeois, donc encore relativement fragile, à un capitalisme post-bourgeois, donc beaucoup plus répandu, métabolisé et puissant. » Il s’agissait avant tout de détruire les restes des anciennes formes religieuses, culturelles, sociales et politiques européennes.
L’analyse de Preve sur la gauche à laquelle il a jadis appartenu est également précieuse. Il a visité à plusieurs reprises les pays de l’Est et a pu constater que la proportion de convaincus ne dépassait pas 20%, les 80% restants ne croyant pas au projet socialiste réel (y compris de nombreux hauts politiciens).
Preve décrit la gauche comme un milieu social incapable de se réformer. «En termes marxistes, toute proposition innovante est inacceptable si son destinataire social est irréformable. En termes nietzschéens, la consolidation d’un bloc social composé d’Ermites et de Derniers Hommes engendre simultanément Décadence et Nihilisme », constate-t-il. Il décrit aussi comment de nombreux anciens de gauche se sont tournés vers les États-Unis quand leur ancien “maître”, sous la forme de l’Union soviétique, avait disparu. « Pour moi, je le répète, l’appartenance n’est rien, et la compréhension est tout, et cette position est l’opposé de ce qui se passe dans 98% du mouvement communiste, pour lequel la compréhension ne compte pas et l’appartenance est tout », écrit Preve.
Preve et les couches intermédiaires
Politiquement, les communautés subalternes se redéfinissent comme le Peuple, et économiquement, elles se définissent comme le Prolétariat.
– Preve
Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque Preve aborde la relation entre la gauche et la classe ouvrière. Son point de départ est que les classes subalternes, dominées, sont incapables par elles-mêmes de développer une culture anticapitaliste et doivent donc déléguer ce travail aux couches intermédiaires instruites (« complètement incapables de produire une culture stratégique anticapitaliste, et obligées d’en déléguer la construction aux classes moyennes inférieures instruites, qui sont totalement inadaptées à cette tâche car prisonnières de leurs propres fantômes: ceux du ressentiment (prolétarien) et de la peur (petite-bourgeoisie)»). On peut d’ailleurs noter l’incapacité de Marx à l’introspection, évoquant la relation entre classe et idéologie mais sans s’attarder sur sa propre appartenance, qui était non prolétarienne.
Preve explique cela: « 95% des “intellectuels organiques” de la gauche (prolétarienne) et de la droite (petite-bourgeoise) proviennent du même environnement, à savoir la petite bourgeoisie cultivée… Marx et Nietzsche sont, de ce point de vue, des penseurs beaucoup plus proches qu’on ne le croit à première vue ». Il évoque aussi le fait que les couches subalternes, contrairement à la théorie de Marx, sont plus révolutionnaires au début de leur rencontre avec le capitalisme, avant d’être intégrées mentalement et politiquement, et que la prolétarisation des classes moyennes n’a pas eu lieu car « le mécontentement des classes moyennes est, de fait, bien plus dangereux pour la reproduction capitaliste que celui des classes ouvrières proprement dites (c’est un point que l’économisme populiste marxiste ne comprend pas et ne comprendra jamais)». Il remarque également que les alternatives de ces couches subalternes, mutualistes et coopératives, sont « en réalité le terrain le plus avancé possible pour ceux qui entendent maintenir leur ancienne identité fondée sur la solidarité ».
Marx et Nietzsche
Est-il possible de proposer une comparaison entre l’individualité libre de Marx et le Surhomme–l’Autre homme de Nietzsche ? Voilà, bien sûr, tout l’enjeu de ce modeste petit travail.
– Preve
La lecture que fait Preve de Marx revient aux sources et le replace dans son contexte historique. Il identifie notamment le cœur du projet marxien: l’aliénation. L’aliénation suppose une rupture historique et une nature humaine aliénée (la fameuse essence de l’espèce).
Preve résume l’aliénation ainsi: « le capitalisme aliène donc l’essence humaine générique du simple fait qu’il la réduit à une seule dimension: celle de la production et de l’échange de marchandises. L’essence humaine est générique, et le capitalisme la force à devenir uniquement spécifique. Les humains sont forcés de penser leur présent et de planifier leur avenir dans la seule dimension restrictive de la production et de l’échange de marchandises».

On peut ici comparer avec la description d’Evola du caractère démoniaque de l’économie et du travail contre d’autres activités, même si Marx, à la différence, manque d’un appareil conceptuel pour ces autres activités et cette essence d’espèce. Quoi qu’il en soit, Marx estime que l’homme a été aliéné au cours de l’histoire. Contrairement à beaucoup à droite, il pense néanmoins qu’un retour à des formes sociales plus anciennes et moins aliénées est impossible. Il faut donc construire de nouvelles formes.
Preve trouve cette approche féconde et écrit: « Marx envisage une anthropologie de l’individualité libre dans un cadre communautaire non oppressif, et c’est ce projet qui a les implications épistémologiques de sa théorie du “matérialisme historique”. Si un “retour à Marx” a un sens aujourd’hui, ce ne peut être que dans cette perspective. »
Tels sont les idéaux de Marx. Sa méthode peut être tout aussi utile selon Preve. Il s’agit d’un appareil conceptuel pour comprendre les sociétés, même si l’on sait aujourd’hui que Marx ne pouvait pas forcément prédire l’avenir avec le dit appareil. Il a surestimé, par exemple, le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière et n’a pas développé de théorie sur sa propre classe. Mais cela ne signifie pas que la notion de classe est inutilisable.

Preve résume la boîte à outils marxienne ainsi: «Le modèle scientifique de Marx repose sur quatre concepts fondamentaux (mode de production, forces productives, rapports de production et idéologie), auxquels on peut ajouter un cinquième et un sixième, développés surtout par Lénine (formation socio-économique et impérialisme)… Personnellement, je pense que l’utilisation rationnelle de ces six concepts, qui forment ensemble un modèle théorique harmonieux et équilibré, est totalement indépendante de la “foi” dite en une solution communiste des contradictions sociales, même si chez Marx, la perception de l’aliénation, le projet anthropologique de l’individualité libre et enfin le modèle épistémologique d’une science historique unifiée étaient une seule et même chose, inséparables».
Comme l’écrit Preve, il est tout à fait possible d’utiliser ces quatre ou six concepts marxistes centraux et de conclure que la société classique libérale ou l’État-providence est l’état le plus probable et/ou le plus souhaitable. Ou de les combiner à des concepts d’autres penseurs, par exemple Spengler et Schmitt.
La lecture que fait Preve de Nietzsche est par endroits aussi féconde que celle de Marx. Il ne considère pas Nietzsche comme un penseur particulièrement irrationnel ou athée; au contraire, il « philosophe avec le marteau » de façon fondamentalement rationnelle, et la « mort de Dieu » est avant tout une description d'une société ayant perdu sa base métaphysique.
Preve est conscient que Nietzsche avait une autre vision des ouvriers et de la démocratie que Marx; il écrit notamment: « Nietzsche, cependant, ne s'est pas seulement opposé à la Commune de Paris, il est allé beaucoup plus loin. Il y voyait le terrible signal émanant du “volcan” de la hideuse populace démocratique, porteuse du vieil esprit de ressentiment, de la décadence et du nouveau ressentiment du nihilisme. La Commune de Paris joue un rôle crucial dans la genèse historique et psychologique de la pensée de Nietzsche».

En même temps, il ne voit pas en Nietzsche un défenseur de l’inégalité, que ce soit dans sa forme traditionnelle ou libérale de marché (« que le lecteur réfléchisse donc à un fait curieux. Nietzsche, ce penseur dont le style expressif déborde de rhétorique sur l’inégalité, est en même temps le créateur d’une philosophie qui n’offre aucune base pour légitimer ni le modèle religieux de l’inégalité précapitaliste ni le modèle économique de l’inégalité capitaliste », écrit-il).
Mais, une fois encore, on peut distinguer entre les idéaux de Nietzsche, d'une part, et sa méthode ou son appareil conceptuel, d'autre part. Ce dernier s'avère utile pour comprendre aussi bien l’histoire que le présent, comme le montre l’analyse de la gauche teintée de nietzschéisme de Preve.
Il écrit à propos de Nietzsche: « il n’est pas incorrect de dire qu’il aboutit en fait à un système implicite, dans lequel un fait préliminaire à reconnaître (la mort de Dieu) donne lieu à une métaphysique fondée sur quatre coordonnées structurantes (décadence, nihilisme, retour éternel du même, et enfin la volonté de puissance). » Ce sont là quatre concepts utiles.
Preve résume aussi les cinq types de personnages chez Nietzsche: «La thèse de Nietzsche sur la mort de Dieu est une thèse anthropologique car elle n’a pas d’autre fonction que de servir de fondement à une sorte de théâtre anthropologique composé de cinq personnages différents (l’Homme, l’Ermite, l’Homme supérieur, le Dernier Homme, et enfin le Créateur) dont la nature doit être pleinement comprise. »
Dans l’ensemble, c’est un petit ouvrage riche d’enseignements. Preve décrit une nouvelle situation historique, où les anciennes classes ont été remplacées par des oligarques, une classe moyenne mondiale et une plèbe, et où droite et gauche sont devenus des concepts obsolètes. On n’est pas obligé de partager sa définition de la droite et de la gauche; il existe également une approche plus métahistorique représentée, entre autres, par Evola et Chafarevitch, qui permet de trouver son récit historique utile.
Preve est particulièrement intéressant pour une gauche qui commence à soupçonner que la « gauche » s’est enfermée dans des comportements nuisibles. Son analyse de l’empire mondial américain est en partie datée, beaucoup de choses se sont passées depuis 2004, mais la lutte pour une Europe libre demeure intemporelle.
L’accent mis par Preve sur le capitalisme plutôt que sur la bureaucratie moderne suggère aussi une perspective spécifique; la question de savoir qui est le maître et qui est le valet dans la relation entre « l’État et le capital » a été débattue depuis longtemps et, selon Evola et Klages, pourrait même cacher certains facteurs “z” ayant façonné aussi bien le capitalisme que l’État moderne. Mais dans l’ensemble, le livre de Preve, Marx e Nietzsche, est vivement recommandé au lecteur averti.
18:09 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, friedrich nietzsche, costanzo preve, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 10 octobre 2025
Sur la démocratie et la figure du Démocrate

Sur la démocratie et la figure du Démocrate
Andrea Falco Profili
Source: https://www.grece-it.com/2025/09/26/opinioni-sulla-democr...
Les mots, comme tout autre instrument, subissent l’usure du temps. À l’instar des outils, c’est précisément le passage de main en main qui accélère ce processus, en émoussant les arêtes et en affaiblissant la charge de la signification originelle, jusqu’à les rendre presque méconnaissables. Aucun mot n’a peut-être subi une usure plus radicale que « démocratie ».
Aujourd’hui, ce terme est un récipient universel pour toute aspiration au bien ou – plus fréquemment – un synonyme paresseux de liberté, de tolérance et de droit. Évidemment, dans cette œuvre de sacralisation laïcisée, les Lumières ont joué un rôle de premier plan. Les régimes bourgeois qui s’opposaient à l’Ancien Régime, dans leur tentative de se doter d’une légitimation, ont cherché leurs racines vertueuses dans un passé idéalisé, construisant une généalogie qui, de l’Athènes classique, mènerait linéairement jusqu’aux palais de Bruxelles, Washington, Montecitorio ou de l’Élysée. Naturellement, l’opération est idéologique, comme le sont toutes les grandes entreprises de construction du mythe, mais ce n’est pas une raison pour accorder foi aux illusions auxquelles elle conduit en revendiquant une « identité démocratique ».
La démocratie n’est pas un terme thaumaturgique capable de dissoudre les conflits. Une nécessaire opération philologique révèle que l’élément décisif de ce construit lexical, kratos, signifie puissance au sens de force efficace, parfois contrainte dans sa dimension la plus physique. Demos, sans kratos, reste une somme indistincte ; kratos, sans demos, devient pure domination. Les Grecs n’ignoraient pas la friction, car la démocratie athénienne fut un équilibre instable entre l’assemblée, les tribunaux, le tirage au sort et le commandement militaire.

L’époque de Périclès démontre que l’hégémonie culturelle d’un leader n’abolissait pas les contrôles, mais la cité se reconnaissait, lors des moments décisifs, dans un guide capable d’imprimer une direction. Ce n’est pas un hasard si les détracteurs du gouvernement populaire appelaient le parti au pouvoir « démocratie » précisément pour signaler l’aspect coercitif du kratos, tandis que ce dernier préférait se désigner simplement comme « le demos ».
D’où la première constatation essentielle: là où aujourd’hui on lit « gouvernance », les classiques écrivaient kratos. Vider le terme de sa substance « violente » revient à occulter que la décision comporte un risque, une forte responsabilité personnelle et – si besoin – le conflit. Dans les moments de bifurcation, la polis ne se sauve pas par la simple procédure, mais parce que quelqu’un concentre et dirige l’énergie commune. C’est précisément cela que la rhétorique contemporaine tend à éluder.

Il est également intéressant de noter un terme d’usage classique qui a connu peu de fortune historique, demokrator. Dans la Grèce de l’époque romaine, «demokratía» peut signifier la domination sur la communauté: chez Appien, César et Pompée « luttent pour la demokratía » (ils ne briguent sûrement pas une élection) ; et un témoin tardif rapporte que Dion Cassius définissait Sylla comme demokrator. Il ne s’agit pas de la fonction technique du dictateur romain, mais d’un pouvoir personnel plein, accepté parce qu’efficace.
Ainsi, l’opposition scolaire commode entre « démocratie » et « dictature » apparaît floue. La différence, pourtant, existe et reste cruciale: le dictateur romain est une magistrature extraordinaire et temporaire, déléguée par la loi pour résoudre une urgence. Le demokrator pourrait être défini comme un aboutissement, c’est la force collective qui se reconnaît dans un guide qui intègre – au lieu de suspendre – le tissu institutionnel, orchestrant le pluralisme sans le dissoudre. À l’époque moderne, ce dispositif réapparaît comme césarisme et, à une certaine époque, sous le nom de bonapartisme: gouvernement personnel qui naît d’une relation directe avec le corps civique et mesure sa légitimité à son efficacité.

Mais pour revenir à Athènes, il est remarquable de rappeler que Thucydide anticipe en Périclès la figure du princeps: pour éviter l’accusation d’être un régime démocratique (horribile dictu), il rapporte qu’Athènes était « en paroles une démocratie, en fait un gouvernement du pròtos anèr (premier homme) ». Il s’agit donc d’une primauté personnelle acceptée, capable de rendre la légalité opérante et d’hégémoniser la majorité.
L’image renverse le lieu commun de la démocratie athénienne comme principe des systèmes d’assemblée « redécouverts » à l’époque moderne, et montre au contraire un lien inconfortable avec l’institution romaine dont, dans l’histoire, le parcours de Bonaparte se serait voulu le continuateur: un compromis entre élites, corps et peuple, avec une direction qui sait aussi être impopulaire.
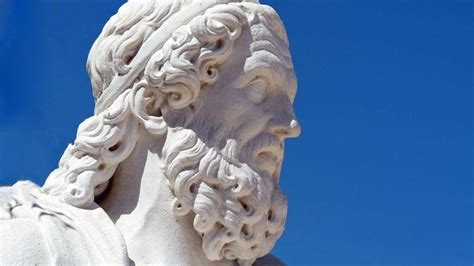
Démocratie donc, n’équivaut pas à demo-archie: c’est l’opération de camouflage de la « force des nombreux » en « principe des nombreux ». Que la démocratie soit aussi une question d’indépendance matérielle est démontré par un épisode historique précis: en 89-87 av. J.-C., lorsque Athènes recouvre momentanément sa souveraineté, elle réactive des formes démocratiques. Indépendance et démocratie vont de pair parce que la citoyenneté est, avant tout, puissance en armes: sans autonomie, aucun kratos commun n’est possible.
Ce n’est pas seulement un rappel gênant pour ceux qui identifient la démocratie à un sondage éternel, mais si dans l’esprit de certains cela ouvre la perspective d’un régime militaire traditionnellement opposé à Athènes comme celui de Sparte, cela n’est pas un hasard. Ce fut en effet l’Athénien Isocrate (statue, ci-dessus) qui définissait Sparte comme une « démocratie parfaite », pour avoir fait coïncider citoyenneté et puissance armée dans la figure des Spartiates: citoyens par droit du sang, armés et appelés à exercer une participation exclusive vis-à-vis de l’étranger.
Pour donner consistance à la figure du demokrator, il s’agit de le définir comme celui qui reçoit un mandat à haute énergie et le restitue en œuvres, en définissant priorités et délais. En d’autres termes, un régime est démocratique non s’il exclut l’existence d’élites, mais s’il les requalifie, en passant d’élites de naissance à élites de fonction, dont le rang dépend de la capacité à rendre productive la force du peuple.
Napoléon est un cas exemplaire, il n’a pas exercé un rôle dictatorial au sens romain, mais plutôt celui de directeur plébiscitaire: son administration, fondée sur un rapport immédiat avec la nation, sans abattre les corps intermédiaires mais en les réorganisant, atteste d’une trajectoire qui – avec les éventuelles ombres du cas – confirme le kratos comme un outil. La question, avant d’être institutionnelle, est aussi symbolique. L’histoire est un réservoir d’images et de rites civiques qui concentrent l’attention collective. Sans ce registre, la politique se réduit à une administration compliquée.
Dans les moments décisifs, les communautés se rassemblent autour de figures qui séparent le tissu vivant des formes parasitaires: des interprètes capables de libérer des ressources contre les rentes et les appareils qui les drainent. C’est la manière dont le « sacré » civil canalise, sans mysticisme, l’énergie commune.
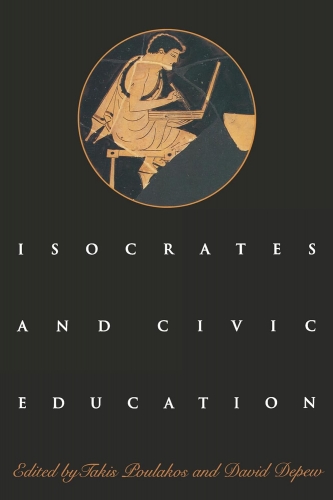

Que l’acception réelle de la démocratie soit aujourd’hui aussi étrangère, sinon contradictoire, n’est pas sans raison: « démocratie » est un terme qui a eu trois siècles marginaux dans l’Antiquité, puis a disparu longtemps avant de ressurgir tardivement, jusqu’à la consécration post-1789; au vingtième siècle, souvent employé comme mot d’ordre contre les régimes illibéraux plutôt que comme définition institutionnelle.
Revenir aux textes est un exercice nécessaire pour reconnaître les pulsions vitales de la politique, communément diabolisées dans la figure maléfique du « démagogue populiste » qui – observait Spengler – correspond à une phase de déclin des bureaucraties amorphes, destinées à s’effondrer dans le césarisme, qui ne vient pas éteindre la démocratie mais la revitaliser. Il ne s’agit pas d’invoquer l’homme providentiel, mais une grammaire qui lie décision et responsabilité, permettant au peuple de se reconnaître dans celui qui gouverne, afin que « démocratie » retrouve le sens de capacité à destiner et non seulement à administrer avec de vrais résultats.
Andrea Falco Profili
20:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : athènes, thucydide, isocrate, démocratie grecque, hellénisme, grèce antique, démocratie, théorie politique, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 octobre 2025
Gianfranco La Grassa, père de la théorie du "Conflit Stratégique" est décédé: un génie de la philosophie politique nous a quittés

Gianfranco La Grassa, père de la théorie du "Conflit Stratégique" est décédé: un génie de la philosophie politique nous a quittés
Entrevue avec Gianni Petrosillo
propos recueillis par Carlos X. Blanco
Le 25 septembre 2025 dernier, l’éminent économiste et penseur italien Gianfranco La Grassa est décédé. Né en 1935, La Grassa laisse derrière lui, par sa longue vie et son intense labeur, une œuvre immense, insuffisamment connue, surtout dans mon pays, l'Espagne, où tout semble désormais inconnu de tous. Lié au marxisme dès sa jeunesse, il a fini par développer sa propre pensée, la "théorie du Conflit Stratégique" que, hélas, je dois avouer n’avoir découverte que relativement récemment. Dès le début, j’ai compris son importance et me suis immédiatement mis au travail. Il me paraissait urgent de traduire ses articles et livres (certains déjà disponibles en espagnol, d’autres en cours de traduction), et de collaborer – dans la mesure de mes modestes moyens et malgré ma “cancellation” académique – avec son disciple, mon ami Gianni Petrosillo. À l’occasion de son décès tout récent, il était de mon devoir de rendre hommage au Maître disparu. J’ai décidé, en accord avec Gianni, à qui je suis très reconnaissant, de commencer cet hommage à La Grassa par un entretien avec son disciple, quelques questions posées à celui qui connaît si bien le penseur et son œuvre. Un penseur ne meurt jamais totalement si son œuvre est étudiée et prise en compte.

– Qui était Gianfranco La Grassa ? Que représente sa perte ?
Avant tout, permets-moi de te remercier, Carlos, pour le travail que tu accomplis. Gianfranco La Grassa a été très heureux d’apprendre que tu avais traduit un de ses derniers textes en espagnol, une langue qu’il chérissait beaucoup car certaines de ses œuvres ont été publiées dans le passé dans des pays d’Amérique latine hispanophones.
Gianfranco La Grassa fut l’un des plus grands interprètes de la pensée de Marx en Italie et hors d’Italie. Il était un marxiste rigoureux qui ne s’est jamais éloigné de la lettre de Marx, c’est-à-dire qu’il ne lui a jamais attribué de théorisations ni de développements de pensée qui ne se trouvaient pas dans ses écrits “terminés”, contrairement à beaucoup d’autres qui ont utilisé Marx pour lui faire dire des choses qu’il n’a jamais pensées, en les tirant d’œuvres inachevées ou même de notes (ce qu’il appelait les grundrissistes).
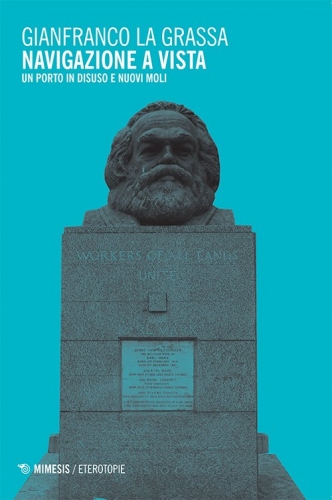
Pour La Grassa, Marx était un scientifique et non un philosophe, et il l’a traité comme tel lorsqu’il s’est rendu compte que sa théorie ne menait pas aux résultats objectifs dont Marx lui-même parlait. Évidemment, l’interprétation de Marx par La Grassa a également varié selon les différentes époques, mettant en avant certains aspects plutôt que d’autres, mais il s’agissait toujours de Marx et non de fantaisies que certains intellectuels lui ont prêtées, réduisant Marx à un philosophe ou à un économiste embrouillé (comme dans la question de la baisse tendancielle du taux de profit ou de la transformation et, par conséquent, de la stricte correspondance entre valeur et prix de production).
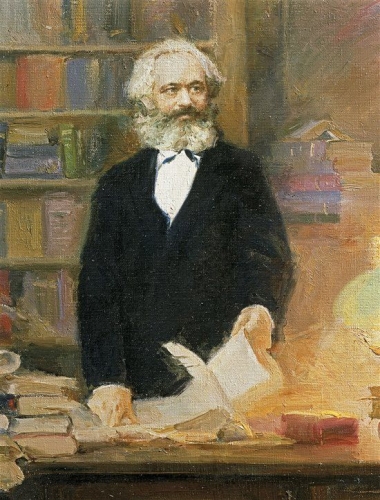
Marx n’était ni un philosophe ni un économiste. Il a fondé une nouvelle science, la critique des modes de production (l’enveloppe qui contient les forces productives et les rapports de production entre ces forces), et donc les rapports sociaux étaient son objet d’étude (Le Capital est une relation sociale, affirme Marx). Althusser appelait cela l’ouverture à la science du “continent histoire” et, comme disait Engels, la présentation d’une nouvelle science impliquait une révolution dans la terminologie spécifique de cette même science.
Or, La Grassa, à partir de Marx, découvre ou redécouvre le “continent politique” que Marx avait laissé au second plan (du fait qu’à son époque, la science économique, tout juste formalisée, était devenue la discipline à laquelle il fallait se confronter). Et le concept de lutte des classes (entre propriétaires des moyens de production et détenteurs de la force de travail), principal moteur de l’histoire, il le remplace par celui de "conflit stratégique" entre agents dominants qui n’agissent pas seulement dans la sphère économique mais dans toutes les sphères sociales, avec, en dernière analyse, une prévalence de la sphère politique.
Parce que la Politique n’est pas seulement un domaine humain, mais un flux d’action (en tant que série de coups stratégiques pour s’imposer), c’est-à-dire l’élément que l’on retrouve dans toutes les sphères. L’entrepreneur qui veut s’imposer sur le marché, l’idéologue qui cherche à se distinguer dans la sphère culturelle, le politique qui veut prendre le pouvoir, tous font de la politique en ce sens.

En utilisant un langage classique, avec La Grassa, l’économie cesse d’être la détermination en dernière instance de nos systèmes et c’est la politique qui le devient, non pas comprise comme sphère sociale, mais comme une série de coups stratégiques pour s’imposer dans chaque domaine.
Ainsi, La Grassa s’est éloigné de Marx, mais à partir de Marx, et a assumé la responsabilité de cette étape sans l’attribuer au penseur allemand.
Si l’on veut situer Gianfranco, il faut le placer parmi les continuateurs de la soi-disant école réaliste italienne, celle qui met la politique au premier plan dans son sens le plus cru et réaliste, de Machiavel à Michels, Mosca et Pareto, mais toujours avec une originalité propre. C’est avec Machiavel que la politique devient science, et Gianfranco ajoute quelque chose de nouveau et de différent à toute cette grande école italienne.
– Pour toi, personnellement, en tant que disciple et collaborateur durant de nombreuses années, que représentait cet homme?
Ce n'est pas facile pour moi, en ce moment, de parler de ma relation avec Gianfranco, si peu de jours après sa mort. J'étais beaucoup plus jeune lorsque nous nous sommes connus, et nous avons collaboré jusqu'à tout récemment. Pendant vingt ans, nous nous sommes vus (au moins une fois par an, car il vivait dans le nord de l’Italie et moi dans le sud) et nous nous parlions tous les jours. Pour moi, il a été un maître en tout. Un de ces maîtres tellement supérieurs que la règle du disciple qui dépasse le maître ne s'applique pas. Comme le disait Engels de Marx, c’était un génie. Eh bien, La Grassa fut, mutatis mutandis, un penseur de ceux qui ne naissent que très rarement. Évidemment, il n’a pas reçu de son vivant tous les mérites qu’il aurait dû, car il était peu enclin à se mettre en avant, comme seuls les plus grands savent l’être. Sa pensée passait avant son individualisme et, de ce fait, la société ne se rend souvent pas compte de ce qu’elle a perdu. En effet, il a écrit énormément d’essais, mais je ne me souviens d’aucune présentation publique; il préférait s’adresser à peu de gens, mais à ceux qui étaient vraiment intéressés à construire quelque chose de sérieux.
– En quoi consiste sa théorie du Conflit Stratégique ?
Marx, en décrivant la dynamique de la société capitaliste, place au centre la sphère productive, bien qu’elle ne soit pas strictement économique (la réflexion sur les rapports sociaux et sur le Capital comme relation sociale que nous avons esquissée dans la première réponse), la considérant, sinon comme la sphère dominante par rapport à la politique et à l’idéologie-culture, du moins comme la déterminante “en dernière instance”.
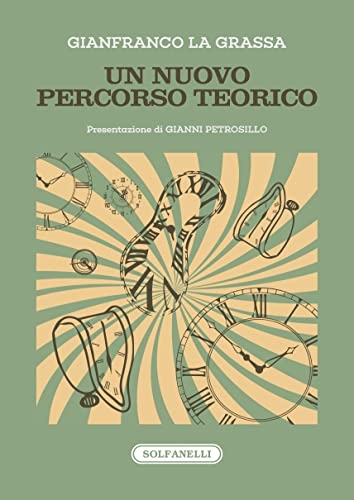
Selon lui, la concurrence entre capitalistes guide l’expansion de la production et l’augmentation du taux d’exploitation de la force de travail, menant, en raison de contradictions internes, à la formation du travailleur collectif coopératif (union de cadres et de journaliers), la nouvelle classe sociale qui, formée dans ce processus, aurait renversé le capitalisme, puisque les capitalistes eux-mêmes, déjà désintéressés par la production et réduits à un noyau restreint, se seraient transformés en simples actionnaires et spéculateurs financiers. Cependant, Marx concentre principalement son analyse sur l’innovation des processus et sur la plus-value relative, négligeant totalement l’innovation des produits et les dynamiques stratégiques entre capitalistes, ainsi que la nécessité d’interagir avec des acteurs sociaux non strictement économiques. Ainsi, sa prévision du développement capitaliste reste liée à une vision téléologique, presque inévitable, de l’histoire: les contradictions internes auraient automatiquement créé les conditions de la révolution.
La Grassa, à partir d’une critique de ces limites, propose une approche alternative fondée sur le concept de “conflit stratégique”. Ce conflit n’est pas simplement un antagonisme entre capitalistes ou entre classes, mais un processus continu de désagrégation et de ré-assemblage des forces sociales, entraînées par le flux constant du réel et s’affrontant en raison d’une force objective qui traverse la société humaine elle-même. Les acteurs sociaux (politiques, économiques, culturels) créent des alliances temporaires pour prévaloir, innovent dans les produits et les processus, se restructurent et s’adaptent en réponse aux pressions concurrentielles, générant des dynamiques imprévisibles qui façonnent la société de manière non linéaire ni déterministe. Le conflit stratégique devient ainsi le moteur principal des transformations sociales, remplaçant l’idée marxiste d’un chemin historique prédéterminé.
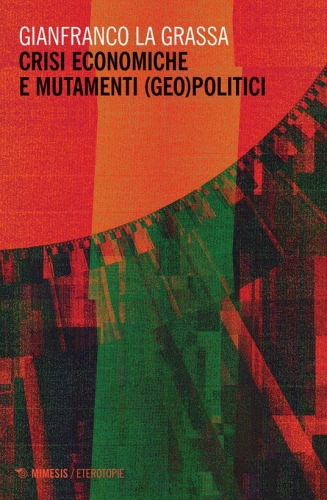
Cette approche permet de comprendre comment la société capitaliste contemporaine évolue à travers la négociation continue du pouvoir, des ressources et des capacités entre différents acteurs. Il n’existe plus de sujet révolutionnaire unique, comme le travailleur collectif décrit par Marx; au contraire, les possibilités de transformation émergent des interactions stratégiques entre groupes et individus, des innovations et de la compétition constante qui caractérisent non seulement l’économie moderne, mais toute l’agrégation humaine. La Grassa met ainsi en évidence que la clé pour comprendre le capitalisme contemporain ne réside pas tant dans l’analyse de la seule exploitation de la force de travail, mais dans la lecture du conflit stratégique comme dynamique fondamentale et moteur du changement social.
En synthèse, alors que Marx voyait le capitalisme comme un système dont les contradictions internes mèneraient inévitablement à une transformation révolutionnaire, La Grassa interprète la réalité moderne comme un ensemble complexe de conflits stratégiques, où la nécessité de prévaloir, qui peut se manifester de diverses manières — concurrence, affrontement direct ou dissimulé —, façonne continuellement les possibilités de développement, de restructuration et de changement de la société. Ce sont surtout les groupes dominants et ceux qui les défient qui déterminent ces conflits, au niveau étatique et international, mais aussi dans d’autres sphères. Cela réduit donc le conflit de classe à un aspect secondaire, qui peut cependant émerger avec plus de force dans certaines circonstances historiques, lorsque, par exemple, les classes exploitées sont de nouveau entraînées dans l’histoire par certains groupes qui ont besoin de leur apport pour modifier les rapports de force. Mais les revendications de la classe ouvrière, comme le disait Lénine, sont toujours syndicalistes, jamais révolutionnaires; les bolcheviques, par exemple, en tant que groupe d’avant-garde l’étaient, mais leur arrivée au pouvoir n’a pas signifié que la classe ouvrière ait réellement pris le contrôle de la société. Évidemment, la question est plus longue et complexe, et pour la définir, il faudrait lire les livres de Gianfranco, auxquels je dois évidemment renvoyer pour plus de précision.
– Maintenant que nous sommes peut-être aux portes d’un conflit mondial, peut-être la Troisième Guerre mondiale, la géopolitique suscite un intérêt croissant. La théorie du Conflit Stratégique ne s’insère-t-elle pas parfaitement dans cette discipline? La géopolitique est-elle la grande absente chez les auteurs marxistes?
Tout d’abord, je voudrais préciser ce que je considère comme étant la géopolitique dans l’enseignement de La Grassa. Je la comprends comme l’ensemble des flux politiques, économiques et militaires qui traversent les espaces et les aires géographiques. Ces mêmes flux, en se pénétrant et en s’entrecroisant, influencent les structures des différentes formations sociales, comprises comme des pays individuels (dans leur totalité) ou comme des aires homogènes regroupant plusieurs pays. Ces faisceaux de flux ne peuvent être interprétés de façon aseptique, car ils sont le résultat d’une direction spécifique qui porte en elle la propension hégémonique des différents acteurs en jeu.

La géopolitique s’apparente donc beaucoup à une partie d’échecs, où l’enjeu est le contrôle des structures politiques, économiques, énergétiques et militaires de régions géographiques entières. Comme tout bon joueur le sait, il ne faut pas toujours affronter l’adversaire de front, mais le pousser à se découvrir afin de pouvoir le mettre en échec. Les manœuvres d’irritation de l’ennemi deviennent alors fondamentales: il doit être continuellement provoqué d’un côté pour être capturé de l’autre. Dans ce développement de multiples tactiques liées à un dessein stratégique plus ou moins défini (car dans la poursuite graduelle des objectifs intermédiaires, la stratégie générale se modifie aussi, sans pour autant perdre son essence), l’utilisation d’instruments de soft power et de hard power est implicite.
Nous n’avons jamais négligé la géopolitique; beaucoup d’autres marxistes, en revanche, l’ont fait, aveuglés par un internationalisme ouvrier inexistant. Nous l’avons cependant intégrée dans une analyse théorique plus large qui part justement du conflit stratégique, dont l’expression maximale est l’affrontement entre groupes dominants de différents États pour la suprématie mondiale. Nous nous approchons d’une période de guerres — même s’il est difficile de dire dans quelle mesure elles ressembleront aux guerres mondiales du passé —, car le pays unipolaire, les États-Unis, est en relatif déclin et se trouve défié par de nouvelles puissances. Quant aux résultats de ce conflit, qui naturellement deviendra de plus en plus direct, il est encore difficile de faire des prévisions sûres.
Face à la Russie de Poutine, aujourd’hui premier adversaire, avec la Chine, des États-Unis, les Américains ont alterné le hard power (intervention militaire en Serbie, considérée comme une zone de fraternité pro-russe; puis, après la Serbie et d’autres manœuvres déstabilisatrices, la guerre par puissance interposée en Ukraine) et le soft power (la promotion des “révolutions de couleur” dans les anciennes républiques soviétiques d’Europe centrale et de l’Est), cherchant à enclencher une manœuvre d’encerclement du géant russe et en se concentrant, de plus, sur la possibilité de déstabiliser les pays traditionnellement sous l’hégémonie de Moscou. Certes, les Américains ne sont pas encore prêts à affronter directement une puissance nucléaire comme la Russie (frapper les premiers et annihiler sa possible riposte nucléaire), mais ils conspirent pour limiter ses zones d’influence et l’isoler de ses alliés potentiels.
Cependant, je ne pense pas qu’il y ait déjà une Troisième Guerre mondiale ; il faudra encore des années et il n’est pas certain qu’elle puisse être comparée aux précédentes, qui elles-mêmes n’étaient pas comparables entre elles ni à celles qui les ont précédées.

– Le concept de « démocratie libérale » nous est présenté comme une grande tromperie, une farce. Chez La Grassa, retrouve-t-on davantage Lénine ou Schmitt ? Qu’en penses-tu ?
Sous des formes différentes, Lénine et Schmitt sont deux grands penseurs, et Schmitt s’est sans aucun doute confronté à la figure de Lénine, qui réunit en lui la capacité de théorisation et la force révolutionnaire sur le terrain, comme cela s’est rarement produit dans l’histoire. Aujourd’hui, ayant définitivement dépassé les stigmates idéologiques, du moins en ce qui nous concerne, nous pouvons puiser librement chez tous, dans tout ce qui peut nous aider à comprendre le monde et, si possible, à le transformer.
Nous n’avons pas de « recettes pour les auberges du futur » ni même de système social à construire, mais nous savons que la démocratie libérale et le pays qui l’a utilisée en adaptant son concept à son image et à sa ressemblance est notre ennemi; qu’on soit clair, je ne parle pas d’un ennemi culturel, je ne suis pas anti-américain par préjugé, mais par choix politique. Trop de pouvoir concentré dans un seul pays aggrave les problèmes et tout devient démesuré: trop de massacres, trop d’injustices, trop de guerres. Nous n’éliminerons jamais ces choses du monde et il n’y aura jamais d’équilibre parfait des forces, mais il faut veiller à ce qu’un seul gendarme ne décide pas de ce qui est juste ou non.

La démocratie a toujours été l’emballage d’une certaine dictature, celle du modèle américain qui s’est imposé au monde, avec ses récits individualistes et libertaires, mais même la liberté, de cette façon, n’est qu’une cage dorée. Comme se demandait Lénine: liberté pour qui et pour faire quoi? Aujourd’hui, je suis libre d’exprimer ma pensée — à vrai dire, de moins en moins — et avec le risque d’être traduit devant les tribunaux, ou devant le tribunal de la pensée politiquement correcte qui juge sans même qu’il y ait procès.

Mais la démocratie a toujours recouru à de nombreux systèmes pour réprimer ou rendre insignifiants ses adversaires, de façon légère ou sévère selon les situations. Même le droit de vote, aujourd’hui, est complètement inutile, et l’a peut-être toujours été. Je ne peux voter que pour ceux qui se présentent, aujourd’hui ils sont de plus en plus inacceptables, et d’ailleurs, les gens ont cessé de voter, mais eux n’ont pas cessé de décider du destin des pays; je dis «eux» parce qu’ils sont tous pareils.
Je pense maintenant à l’Italie, où il y a un gouvernement de centre-droit, dirigé par Meloni. Quand Meloni n’était pas au pouvoir et était dans l’opposition, elle parlait de souveraineté nationale, de ne pas s’opposer à la Russie, de reconnaître la Palestine. Devenue Première ministre, elle a renié toutes ces positions, adoptant l’inverse, car en Italie, peu importe qui gagne, ce sont les Américains qui décident de ce qui peut ou non être fait. Nous sommes un pays où il y a des centaines d’installations militaires américaines, nos services secrets sont infiltrés par les États-Unis, nous sommes occupés depuis la Seconde Guerre mondiale, de quelle liberté nous parle-t-on?
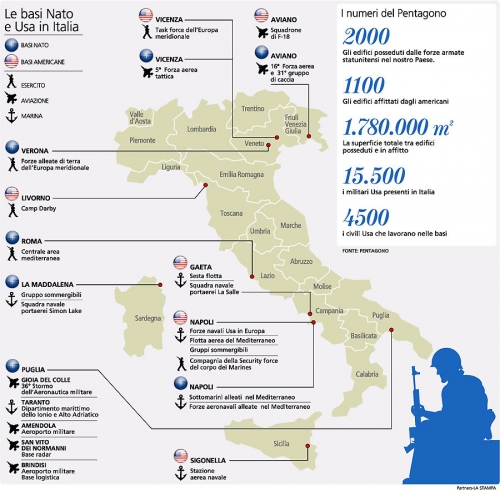
Comme le disait Albert Caraco, « Pour un pays qui fait l’Histoire, il y en a plus de vingt qui la subissent, et dans ces vingt, chaque parti, quel qu’il soit, est le parti de l’étranger, même s’il se proclame nationaliste. » Je suis un peu l’actualité en Espagne et, même s’il y a quelques différences, il me semble qu’il n’en va pas très différemment là-bas, car toute l’Europe est une extension des États-Unis, mais le monde change, et cette subordination qui nous avait garanti une longue période de tranquillité est en train de devenir, dans le nouveau contexte historique, ce qui nous ruinera.

– Comment comptes-tu travailler désormais sur le plan intellectuel ? Que feras-tu de l’immense héritage de ce Maître? Le site Conflitti e Strategie (http://www.conflittiestrategie.it/) est-il un instrument pour cela?
Je maintiendrai assurément la pensée de La Grassa vivante et, comme il l’aurait souhaité, nous veillerons à ce qu’elle soit actualisée et, si nécessaire, dépassée, car son approche était scientifique. Gianfranco répétait toujours une phrase de Max Weber: « Chacun de nous sait que, dans la science, son propre travail, après dix, vingt, cinquante ans, aura vieilli. Tel est le destin, ou mieux dit, telle est la signification du travail scientifique, lequel, par rapport à tous les autres éléments de la culture pour lesquels on peut en dire autant, y est subordonné et s’y confie dans un sens absolument spécifique: tout travail scientifique “achevé” entraîne de nouveaux “problèmes” et désire vieillir et être “dépassé”. Celui qui veut servir la science doit s’y résigner. »
Le site continuera d’être un outil pour réaliser ce travail, mais nous espérons que d’autres naîtront, de partout. Ensuite, il y a toutes ses lettres et documents à organiser, un penseur laisse toujours beaucoup.
– Quels auteurs, vivants ou disparus, sont les plus proches de l’héritage de La Grassa ?
Je ne saurais te dire quel penseur est le plus proche de La Grassa, sa pensée est très originale, mais on peut retrouver des idées chez de nombreux grands du passé. Aujourd’hui, je vois peu de disposition à innover et à penser vraiment. L’époque n’aide pas, et c’est l’histoire qui fait les grands hommes, dans tous les domaines, jamais l’inverse. Ici aussi, Gianfranco disait : « Essayez d’imaginer Marx sans la Révolution industrielle (première et seconde phase) et sans 1848, il n’aurait probablement pas pu théoriser ce qu’il a ensuite fait. »
– Penses-tu que le “gauchisme” est une maladie infantile (Lénine) et même un soutien stratégique du Capital?
Cette question est importante pour clarifier ce qu’a toujours été la gauche dans l’histoire, pas seulement aujourd’hui. Comme le disait Lénine, c’était le lieu de la trahison des dominés. La gauche a toujours trahi les exploités. Aujourd’hui, elle le fait même ouvertement. Depuis que la gauche s’est détachée du marxisme et des idées communistes, elle a montré son vrai visage. C’est l’idéologie des classes aisées qui ont honte de l’être, mais pas de profiter de leurs privilèges, qu’elles exhibent sous des formes raffinées. La gauche, disait Gianfranco, est le cancer de la société et la droite un faux remède homéopathique. Tout cela reste à réinterpréter et à construire.
– Merci beaucoup Gianni. Étudions l’œuvre de La Grassa, c’est notre meilleur hommage, comme tu le sais bien.
15:47 Publié dans Entretiens, Hommages, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gianfranco la grassa, hommage, entretien, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, conflit stratégique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 septembre 2025
Ordre, autorité, communauté

Ordre, autorité, communauté
Le conservateur authentique, c'est-à-dire continental, se distancie du pseudo-conservatisme anglo-américain. Il s'oppose beaucoup plus fermement au libéralisme, dont le mot d'ordre est devenu : liberté, égalité, fraternité.
Jiří Hejlek
Source: https://deliandiver.org/rad-autorita-pospolitost/
Nous nous trouvons dans une situation qui exige un nouvel ancrage intellectuel de l'action politique. Il est aujourd'hui courant d'utiliser le terme « conservatisme » dans ce contexte. Nous nous opposons ainsi au libéralisme dominant, que nous rejetons instinctivement, mais dont nous reprenons généralement les schémas intellectuels et le langage, restant ainsi sous son influence.
L'éminent philosophe politique russe Alexandre Douguine est bien conscient des écueils auxquels se heurte le conservatisme et préfère donc qualifier sa position de « quatrième théorie politique », qui s'inscrit dans la continuité du traditionalisme conservateur.
La première théorie, actuellement victorieuse mais en déclin, est le libéralisme, envers lequel il faut se démarquer.
La deuxième est le socialisme et le communisme, qui sont morts d'épuisement à un âge avancé, tandis que la troisième théorie, c'est-à-dire le fascisme au sens large, est morte jeune de ses propres maladies. Il n'est plus possible de s'appuyer sur l'une ou l'autre des deux dernières théories, même si l'on peut y trouver des éléments positifs. Cherchons donc une quatrième théorie. Voilà expliciter sommairement la position de Douguine. Il convient encore de noter qu'il s'appuie sur les conservateurs les moins respectables, tels qu'Alain de Beonist aujourd'hui et Arthur Moeller van den Bruck, Oswald Spengler ou Carl Schmitt dans le passé.
Nous conserverons le terme « conservatisme », car il est plus courant en Europe centrale qu'en Russie. Il est souvent opposé au libéralisme, mais généralement sans clarification de ses fondements idéologiques. Nous laisserons de côté les expressions confuses telles que « politique libérale-conservatrice » et montrerons au contraire la forte opposition entre ces deux positions politiques et idéologiques.

Cette opposition est complètement occultée par l'interprétation anglo-saxonne des termes correspondants et des concepts qui leur correspondent. Partons de la théorie civilisationnelle selon laquelle la civilisation actuelle dans la majeure partie de l'Europe est une civilisation atlantique, dont les foyers sont les pays anglophones. Elle a pour ambition de conquérir progressivement le monde entier et, depuis ses débuts à la fin du 17ème siècle, elle utilise non seulement la violence, mais aussi une propagande sophistiquée.
C'est une civilisation bâties sur des illusions auxquelles elle succombe elle-même, et c'est pourquoi l'hypocrisie est sa caractéristique typique. L'ensemble de ces illusions forme son idéologie libérale éclairée, qui se présente hypocritement comme une simple description de ce qui est « naturel » et donc universellement valable.
L'illusion centrale, autour de laquelle tout le reste gravite, est celle de la liberté. Le libéralisme a fabriqué de toutes pièces un individu libre qui, d'un côté, est l'égal de tous les autres et, de l'autre, n'est qu'un simple exemplaire de « l'homme en général ». L'idole ainsi créée est devenue une divinité dans le culte de l'humanisme et des droits de l'homme.

La Révolution française, qui a suivi la Révolution anglaise de cent ans et la Révolution américaine de plus de dix ans, a formulé le célèbre slogan du libéralisme : liberté, égalité, fraternité. Ses racines sont toutefois anglo-saxonnes. Lorsque le conservatisme a commencé à se former à la fin du 18ème siècle en opposition au libéralisme, une différence déjà nette est apparue en Europe entre les positions des fondateurs du conservatisme britannique et continental.
Le conservatisme britannique, puis américain, ne sont en fait que des ramifications du libéralisme. Ils en maintiennent les principes fondamentaux: la liberté individuelle, la protection de la propriété, la méfiance envers l'État et les autres autorités, et surtout le libre marché. Après tout, deux célèbres conservateurs britanniques sont issus des rangs des libéraux: Edmund Burke et Winston Churchill.

Le leader conservateur victorien Disraeli (photo) était un défenseur du libre-échange. Nous ne devons pas non plus nous faire d'illusions sur nos héros conservateurs anglo-saxons des années 80, Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Sans parler de Donald Trump. Leurs positions morales étaient certes louables, mais en matière économique et sociale, ils étaient des libéraux purs et durs.
Chez les Britanniques, il ne faut pas se laisser tromper par leur attachement apparent au caractère aristocratique du conservatisme. Immédiatement après la révolution anglaise de 1688, dont Burke est si fier, les aristocrates sont devenus des entrepreneurs capitalistes, alors qu'en France, et a fortiori en Allemagne, ils sont longtemps restés séparés de la bourgeoisie. De même, la figure du roi britannique est trompeuse. L'influence de la couronne a décliné jusqu'à ce qu'avec l'avènement de la dynastie hanovrienne, qui détient encore aujourd'hui la couronne, la Grande-Bretagne devienne essentiellement une république oligarchique dirigée par les financiers de la City de Londres, qui ont renversé le roi légitime en 1688 et placé sur le trône leurs marionnettes Marie et Guillaume d'Orange.

En France, le conservatisme est né de l'opposition à la révolution. Tout le monde connaît aujourd'hui le nom du pseudo-conservateur Burke, mais qui connaît Joseph de Maistre (illustration) ou Louis-Gabriel de Bonald, véritables pères fondateurs du conservatisme ? L'art anglo-saxon de la propagande a réussi à effacer presque totalement ces grands hommes de la mémoire historique. Il en a été de même pour un autre noble et diplomate, l'Espagnol Juan Donoso Cortés. Ce n'est pas un hasard si tous étaient catholiques, tout comme les fondateurs du conservatisme romantique allemand, Adam Müller, Friedrich Schlegel et Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. On peut également citer des poètes et des écrivains. Outre Schlegel, déjà mentionné, il y a son ami Novalis, le Français François René de Chateaubriand et, plus tard, l'admirable Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski. Son œuvre complète a été traduite en allemand par Moeller van den Bruck, chef de file du conservatisme allemand du premier quart du 20ème siècle.
Après avoir clarifié la question de l'origine du conservatisme dans sa forme continentale authentique, accompagnée d'un bref aperçu historique, nous nous pencherons sur les principes fondamentaux du conservatisme authentique. Revenons donc à la liberté libérale. Celle-ci montre clairement son vrai sens sous la forme de la liberté du commerce. Alors que les libéraux « pudiques », tels qu'Isaiah Berlin, mettent l'accent sur la liberté négative, c'est-à-dire la liberté de quelque chose (par exemple de la peur), et comprennent ainsi la liberté comme une indépendance, les libéraux directs mettent l'accent sur la liberté pour quelque chose. Il ne s'agit en fait que de pouvoir. La liberté du marché est la liberté des plus riches d'éliminer progressivement les moins riches. La liberté des grandes nations leur permet d'opprimer les petites. La liberté de l'individu sans scrupules lui donne le pouvoir d'asservir les plus démunis. Les Anglo-Saxons mettent donc l'accent sur le droit naturel, qui crée l'illusion parfaite que cette oppression est une évidence. Ils s'opposent également à un État qui pourrait faire obstacle à ce gouvernement illusoire du droit. À la place de l'État, ils ont mis en place une structure appelée « société », ou « société ouverte » ou « société civile ». Nous y reviendrons plus tard.
 Les conservateurs ont remarqué la confusion entre liberté et pouvoir. Ils ont compris que la liberté n'est pas indivisible. Au contraire, peu de choses peuvent être divisées aussi bien que la liberté. La liberté des uns repose souvent sur la servitude des autres. Là où se manifeste le désir de liberté d'une communauté, une autre vague de désir pour une autre liberté se lève contre elle. Adam Müller (ill. ci-contre) a génialement appelé ce phénomène « anti-liberté ». Dans nos actions, la valeur est ce qui ne peut être réduit à quelque chose de plus fondamental, ce qui ne peut être défini par autre chose. Déclarer quelque chose comme une valeur est une sorte d'axiome moral.
Les conservateurs ont remarqué la confusion entre liberté et pouvoir. Ils ont compris que la liberté n'est pas indivisible. Au contraire, peu de choses peuvent être divisées aussi bien que la liberté. La liberté des uns repose souvent sur la servitude des autres. Là où se manifeste le désir de liberté d'une communauté, une autre vague de désir pour une autre liberté se lève contre elle. Adam Müller (ill. ci-contre) a génialement appelé ce phénomène « anti-liberté ». Dans nos actions, la valeur est ce qui ne peut être réduit à quelque chose de plus fondamental, ce qui ne peut être défini par autre chose. Déclarer quelque chose comme une valeur est une sorte d'axiome moral.
L'interprétation de Kant de la valeur comme impératif catégorique était erronée, mais ne nous attardons pas là-dessus. Pour nous, il est important de comprendre que la liberté n'est pas une valeur. D'où pouvons-nous donc la déduire pour ne pas avoir à la considérer comme un simple pouvoir ? La réponse conservatrice est: de l'Ordre. L'ordre n'est pas l'œuvre des hommes ni une question de règles. Il est donné aux hommes de l'extérieur comme tout ce qui sert leur bien. Mais il n'est pas donné de telle sorte que nous le voyons, le comprenons et l'appliquons immédiatement. Il change de forme au cours de l'histoire et l'homme doit le redécouvrir sans cesse. Il a également ses formes culturelles. C'est pourquoi les conservateurs accordent une telle importance à l'histoire et aux différentes nations. De Maistre disait qu'il ne connaissait pas l'homme, mais seulement des Français, des Allemands, des Russes, etc. La liberté n'est possible que dans le cadre de l'ordre, elle n'est pas le libre arbitre d'un individu ou d'un groupe d'individus. La liberté dans le cadre de l'ordre découle de l'axiome le plus fondamental: rien de ce qui concerne l'homme n'est autonome, mais hétéronome.
 Adam Müller soulignait la différence fondamentale entre ce qui est vivant et ce qui est inanimé ou mort. Il disait par exemple que le concept est mort, mais que l'idée est vivante. Oswald Spengler (ci-contre) a repris cette idée plus tard dans sa conception de la civilisation. Selon lui, chaque civilisation commence spontanément, s'éveille à son apogée. Dès que les formes culturelles vivantes se figent et se fossilisent, une période de civilisation, une époque de formes mortes, commence, signe indubitable de sa fin prochaine.
Adam Müller soulignait la différence fondamentale entre ce qui est vivant et ce qui est inanimé ou mort. Il disait par exemple que le concept est mort, mais que l'idée est vivante. Oswald Spengler (ci-contre) a repris cette idée plus tard dans sa conception de la civilisation. Selon lui, chaque civilisation commence spontanément, s'éveille à son apogée. Dès que les formes culturelles vivantes se figent et se fossilisent, une période de civilisation, une époque de formes mortes, commence, signe indubitable de sa fin prochaine.
Un conservateur authentique reconnaît cette différence dans tout et fait la distinction entre l'organique et le mécanique, entre ce qui peut croître par lui-même et ce qui est simplement construit. Tout ce qui trouve son origine dans l'autonomie humaine est artificiel, mécanique, donc mort. Ce qui nous est donné de manière hétéronome est vivant, organique. L'ordre est de nature organique, ce qui est une définition bien meilleure que « naturel ». Le principe de l'ordre hétéronome s'oppose radicalement à l'idée autonomiste d'une loi déterministe de l'histoire et de son mouvement immanent, et donc à l'idée de progrès.
Si nous nous en tenons au mot d'ordre de la Révolution française, nous devrions maintenant nous occuper de l'égalité. À première vue, il est évident que l'égalité appartient également au domaine des mécanismes morts. Les libéraux ont beau se tortiller comme ils le peuvent, ils en arrivent toujours à transformer l'égalité en uniformité.
 Et l'égalité juridique initialement prévue, combinée à la conception libérale de la liberté comme arbitraire, transforme d'une part chaque être humain vivant en un élément mort et indifférent de la soi-disant société et, d'autre part, lui permet de se créer – de manière illusoire, bien sûr – en ce qu'il veut. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes passés du statut juridique des femmes à la création de dizaines de statuts sexuels, appelés de manière absurde « genres ». La question se pose donc: si l'ordre est le fondement de la liberté possible, quel est le fondement de l'égalité ? Et tout comme l'égalité est liée à la liberté, le fondement de l'égalité est-il lié à l'ordre ? Cette fois, la réponse tient en deux mots étroitement liés : hiérarchie et autorité. Et ceux-ci sont bien sûr liés à l'ordre.
Et l'égalité juridique initialement prévue, combinée à la conception libérale de la liberté comme arbitraire, transforme d'une part chaque être humain vivant en un élément mort et indifférent de la soi-disant société et, d'autre part, lui permet de se créer – de manière illusoire, bien sûr – en ce qu'il veut. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes passés du statut juridique des femmes à la création de dizaines de statuts sexuels, appelés de manière absurde « genres ». La question se pose donc: si l'ordre est le fondement de la liberté possible, quel est le fondement de l'égalité ? Et tout comme l'égalité est liée à la liberté, le fondement de l'égalité est-il lié à l'ordre ? Cette fois, la réponse tient en deux mots étroitement liés : hiérarchie et autorité. Et ceux-ci sont bien sûr liés à l'ordre.
 Au tout début de la civilisation atlantique des Lumières, on avait encore conscience de l'ordre inhérent à toute chose. Carl Linné et ses disciples trouvaient l'ordre de la nature dans son organisation hiérarchique. Au cours de la première moitié du 19ème siècle, le naturaliste et philosophe Lorenz Oken (ill. ci-contre) a créé un système sophistiqué pour toute la nature. L'effondrement du principe hiérarchique n'est survenu que lorsque la hiérarchie, qui faisait obstacle à la pensée des Lumières parce qu'elle maintenait l'idée d'hétéronomie, a été littéralement uniformisée (le terme nazi de Gleichschaltung est ici approprié) par le principe purement autonomiste de l'évolution. Le modèle évolutionniste a écarté de la pensée européenne la pensée hiérarchique, non seulement dans ses relations avec la nature, mais aussi dans ses relations avec l'environnement humain. Aujourd'hui encore, on sous-estime philosophiquement la négation darwinienne des frontières entre les espèces, qui sont devenues « fluides ».
Au tout début de la civilisation atlantique des Lumières, on avait encore conscience de l'ordre inhérent à toute chose. Carl Linné et ses disciples trouvaient l'ordre de la nature dans son organisation hiérarchique. Au cours de la première moitié du 19ème siècle, le naturaliste et philosophe Lorenz Oken (ill. ci-contre) a créé un système sophistiqué pour toute la nature. L'effondrement du principe hiérarchique n'est survenu que lorsque la hiérarchie, qui faisait obstacle à la pensée des Lumières parce qu'elle maintenait l'idée d'hétéronomie, a été littéralement uniformisée (le terme nazi de Gleichschaltung est ici approprié) par le principe purement autonomiste de l'évolution. Le modèle évolutionniste a écarté de la pensée européenne la pensée hiérarchique, non seulement dans ses relations avec la nature, mais aussi dans ses relations avec l'environnement humain. Aujourd'hui encore, on sous-estime philosophiquement la négation darwinienne des frontières entre les espèces, qui sont devenues « fluides ».
Alors que dans la nature, la hiérarchie est une propriété immanente que personne ne peut remettre en question, dans l'environnement humain (nous ne l'appelons pas « société »), elle est maintenue, voire transformée, par un facteur hétéronome, à savoir l'autorité conférée à certaines personnes qui sont responsables de son utilisation. Celle-ci est un instrument indispensable au maintien de la cohésion des groupes humains. Après avoir brisé la hiérarchie dans l'environnement naturel de l'homme, la civilisation atlantique a dû trouver le moyen de perturber la hiérarchie ici aussi.
 La seule possibilité était de nier toute forme d'autorité, ce qui a plongé la fragile hiérarchie interhumaine dans le chaos actuel. Un conservateur authentique doit donc insister sur le rétablissement de l'autorité, en particulier dans quatre domaines. Il s'agit de la famille, de l'école, du travail et de l'État. Si les trois premières autorités, à savoir les parents, les enseignants et les employeurs, ne suscitent apparemment pas beaucoup de controverses, l'autorité de l'État est aujourd'hui problématique. Il existe une explication conservatrice à cela. Par État, nous entendons une structure institutionnelle qui garantit aux citoyens d'un État donné ce qu'Aristote appelait « eu zén », une bonne vie, ou plus précisément une bonne existence, ce qui ne signifie pas le bien-être matériel, mais une vie digne.
La seule possibilité était de nier toute forme d'autorité, ce qui a plongé la fragile hiérarchie interhumaine dans le chaos actuel. Un conservateur authentique doit donc insister sur le rétablissement de l'autorité, en particulier dans quatre domaines. Il s'agit de la famille, de l'école, du travail et de l'État. Si les trois premières autorités, à savoir les parents, les enseignants et les employeurs, ne suscitent apparemment pas beaucoup de controverses, l'autorité de l'État est aujourd'hui problématique. Il existe une explication conservatrice à cela. Par État, nous entendons une structure institutionnelle qui garantit aux citoyens d'un État donné ce qu'Aristote appelait « eu zén », une bonne vie, ou plus précisément une bonne existence, ce qui ne signifie pas le bien-être matériel, mais une vie digne.
L'État, ou la communauté, doit, par son gouvernement, offrir à ses citoyens un cadre de vie meilleur que celui dont ils disposeraient sans lui. Malheureusement, la formation politique actuelle, qui prétend être un État, ne gouverne pas et n'administre pas le pays de manière à rendre la vie digne d'être vécue. Les conservateurs veulent que la nation retrouve sa pleine souveraineté, qui lui apporterait un État capable de devenir une véritable autorité.
À ce stade, on ne peut ignorer la question de la démocratie. Elle n'est pas essentielle à notre analyse, nous n'y ferons donc qu'une brève allusion. Aujourd'hui, on n'utilise plus les slogans « liberté et égalité », mais « liberté et démocratie ». On y ajoute parfois « prospérité ». Celle-ci est certes bonne pour la paix dans l'État, mais ce qui importe davantage, c'est la vie digne dont nous venons de parler. Si un slogan est répété à l'envi, les mots qu'il contient perdent leur sens. Pour conserver son efficacité, il faudrait le retirer de la circulation comme une pièce usée ou un billet de banque froissé. Mais cela n'arrive généralement pas. Le slogan change en effet de mission. Il devient une shahada, une profession de foi succincte. Le prononcer signifie que l'on appartient à la religion correspondante.

Aujourd'hui, lorsqu'une personne se revendique de la « liberté et de la démocratie », elle montre qu'elle appartient à la civilisation atlantique et qu'elle professe sa religion, centrée sur les valeurs sacrées du libéralisme (liberté), de la démocratie (égalité) et des droits de l'homme (fraternité). Dans l'Empire romain, la loyauté s'exprimait par des sacrifices aux dieux romains, les chrétiens ont le Credo et les musulmans la shahada, les communistes avaient le socialisme et l'internationalisme prolétarien. Le fait que le mot « démocratie » soit devenu une sorte de formule magique rend son analyse et son interprétation difficiles. La « liberté » est plus facile à comprendre, car elle a d'autres utilisations que politiques.

Une fois débarrassé de son contexte idéologique, le mot « démocratie » ne pose pas de problème majeur aux conservateurs. Il a alors un double sens. Tout d'abord, il exprime la volonté de donner à tous les citoyens jouissant des droits correspondants, et donc pas aux étrangers par exemple, la possibilité de participer à la vie publique. Dans ce sens, le conservateur considère la démocratie comme l'opposé de l'oligarchie, qui est le régime politique typique du libéralisme, hypocritement déguisé en démocratie. Une telle « démocratie » n'est rien d'autre que le règne de l'argent, comme l'a démontré Oswald Spengler.
Dans le second sens, la démocratie est également acceptable pour les conservateurs sous certaines conditions. Il s'agit d'une démocratie procédurale, formelle, c'est-à-dire la sélection des représentants politiques sur la base d'élections. Pour un conservateur authentique, le problème réside dans le système parlementaire multipartite, qui tend vers une oligarchie libérale et dans lequel les partis politiques se réduisent à la représentation non pas des citoyens, mais de groupes d'intérêt.
La république est un bon terme pour désigner une démocratie non partisane et anti-oligarchique. À l'heure actuelle, où la noblesse européenne, avec à sa tête les familles royales, a été dénationalisée et s'est en fait fondue dans la ploutocratie mondiale, le système politique le plus acceptable pour les conservateurs est la république telle que décrite ci-dessus. Il est donc plus approprié d'utiliser le terme « républicain » que « démocratique » en relation avec le conservatisme.

L'idée s'impose que le problème le plus immédiat lié à l'égalité est la question sociale. Le paragraphe précédent a déjà indiqué que le conservateur est proche du socialiste à bien des égards (notamment dans son opposition commune à l'individualisme libéral). Bien sûr, il ne part pas comme lui de l'égalité ni de la « solidarité ». La « solidarité » est l'équivalent actuel du mot désuet « fraternité ». Du point de vue du conservatisme authentique, il s'agit pour ainsi dire d'un concept d'urgence qui implique la notion de « société » en tant qu'entité sociale atomisée et mécanique. Les partisans actuels du socialisme trahissent par le terme « solidarité » leurs origines libérales du début du 19ème siècle. Un social-démocrate pourrait leur faciliter leur rejet croissant de l'héritage libéral.
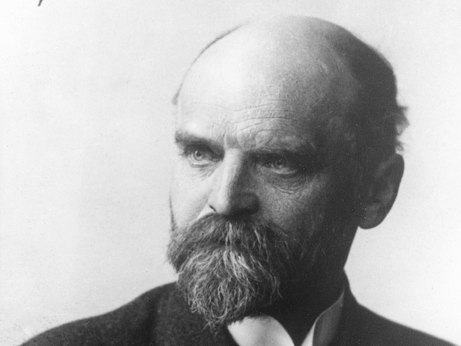 Le créateur de la sociologie philosophique allemande, Ferdinand Tönnies (photo), s'est inspiré des oppositions déjà évoquées entre « vivant » et « mort », ainsi qu'entre « organique » et « mécanique ». En tant qu'opposant actif au national-socialisme naissant, il adhéra en 1930, à l'âge de 75 ans (!), au Parti social-démocrate allemand. Entre autres, en 1936, année de sa mort, parut une nouvelle édition de son opera magna, Gemeinschaft und Gesellschaft (« Communauté et société ») de 1887. Il y oppose les structures sociales mécaniques et organiques. La société représente les structures mécaniques, tandis que la communauté représente les structures organiques. C'est précisément la communauté qui est devenue au 20ème siècle la clé de la résolution des problèmes sociaux pour les conservateurs. Dans le monde anglo-américain, un courant politique appelé « communitarisme », d'après le terme anglais désignant la communauté, a même influencé la philosophie politique de la fin du 20ème siècle. Les communitaristes étaient soit des libéraux, soit des pseudo-conservateurs.
Le créateur de la sociologie philosophique allemande, Ferdinand Tönnies (photo), s'est inspiré des oppositions déjà évoquées entre « vivant » et « mort », ainsi qu'entre « organique » et « mécanique ». En tant qu'opposant actif au national-socialisme naissant, il adhéra en 1930, à l'âge de 75 ans (!), au Parti social-démocrate allemand. Entre autres, en 1936, année de sa mort, parut une nouvelle édition de son opera magna, Gemeinschaft und Gesellschaft (« Communauté et société ») de 1887. Il y oppose les structures sociales mécaniques et organiques. La société représente les structures mécaniques, tandis que la communauté représente les structures organiques. C'est précisément la communauté qui est devenue au 20ème siècle la clé de la résolution des problèmes sociaux pour les conservateurs. Dans le monde anglo-américain, un courant politique appelé « communitarisme », d'après le terme anglais désignant la communauté, a même influencé la philosophie politique de la fin du 20ème siècle. Les communitaristes étaient soit des libéraux, soit des pseudo-conservateurs.
Chaque individu appartient à plusieurs communautés, et ces appartenances constituent son identité. La communauté fondamentale est la famille, ou plutôt la lignée. À la campagne notamment, il s'agit de la communauté de voisins, qui peut s'étendre à tout le village. La communauté religieuse, de la paroisse au diocèse, est également incontournable. Nous connaissons également les cercles d'amis, qui sont des communautés d'amis. La communauté se crée également dans les relations de travail. L'histoire nous a surtout appris l'existence des corporations, qui réunissaient des personnes exerçant la même profession, de manière beaucoup plus étroite et surtout plus durable qu'aujourd'hui.
Les communautés sont capables de créer un réseau complexe de relations, dont la société civile n'est qu'un piètre substitut. Là où aucune structure identitaire de communautés ne se construit, la société civile s'installe. La communauté qui englobe toutes les autres est la nation. La nation n'est toutefois pas seulement une communauté de contemporains, elle comprend également les ancêtres et les descendants. La tâche des contemporains est de transmettre l'héritage de leurs ancêtres à leurs descendants. Pour les conservateurs, il n'y a donc pas de conflit générationnel. Si l'on exclut les contemporains de la nation, il ne reste que le peuple. C'est précisément le peuple que les libéraux et les socialistes libéraux appellent à tort « société ». Mais le peuple n'est pas un mécanisme, il est vivant, très vivant. Il est également le sujet qui forme les institutions couronnées par l'État. Seul le peuple, qui est en même temps une nation, peut créer un État libre. Libre au sens de l'indépendance et au sens du pouvoir. Pour cela, il faut encore que l'État soit construit et maintenu (c'est-à-dire conservé) par des individus connaissant l'ordre et dotés d'une autorité légitime.

La vie d'une nation se déroule au sein de communautés hiérarchisées. Cela vaut également pour les relations de travail. Pour le conservateur continental (tout comme pour le socialiste), le travail jouit d'un grand prestige. Les gens devraient exercer des professions utiles, qui apportent un bénéfice réel, qu'il soit matériel ou immatériel, et ils devraient les exercer si possible toute leur vie et dans le cadre de la famille. Le credo du conservateur vise le déclin de toutes les formes possibles de migration et de mobilité.
Il ressort clairement de ce qui précède que le conservateur continental (contrairement au conservateur anglo-américain) est opposé au capitalisme. La question reste ouverte de savoir si – ou plutôt comment – les idées du corporatisme peuvent être reprises dans l'économie. L'une des caractéristiques qui distingue la communauté de la société est la cohésion interne. C'est pourquoi nous ne parlons pas de solidarité, c'est-à-dire des relations entre des étrangers, mais de cohésion, de cohésion interne. Seuls les membres d'une même communauté nationale peuvent aider volontiers les autres membres de cette communauté.
Le réseau des communautés doit également servir de base à la vie politique. La politique doit être exercée par des citoyens respectés et riches d'une longue expérience de la vie. Ceux-ci représenteraient différentes communautés partielles, et non des partis. Il est toutefois évident que des partis politiques verraient le jour au sein des assemblées représentatives, mais ceux-ci ne seraient pas des institutions permanentes.

Le contrôle de l'économie doit être une tâche importante. Les conservateurs ont toujours exigé que l'économie soit contrôlée politiquement, civilement. C'est une autre caractéristique qu'ils partagent avec les socialistes et qui les oppose aux libéraux. Bien qu'ils soient partisans d'un ordre hiérarchique dans le domaine économique, ils considèrent comme néfaste l'apparition de trop grandes différences de richesse entre les individus. On retrouve cette idée dans La République de Platon.
Pour conclure, rappelons un fait oublié. Dans la folie écologique actuelle, rappelons-nous que ce sont les conservateurs continentaux qui ont été les premiers à brandir l'étendard de la protection de la nature. Leur romantisme les a conduits à cette idée, ainsi que l'égarement des capitalistes. Dès le début du 19ème siècle, Adam Müller s'est lancé dans une campagne contre la déforestation en Allemagne pour des profits dérisoires. On peut trouver de nombreux exemples de ce type.

Les conservateurs ne doivent plus laisser les extrémistes s'approprier cette question. L'approche conservatrice ne devrait probablement pas utiliser le terme « écologie » et ses dérivés, mais nous pourrions plutôt parler de protection et de préservation (conservation) de la nature pour les générations futures, pour la nation. Cela va de pair avec l'entretien général du paysage et la production d'une alimentation nationale saine.
Faisons un bref résumé. Un conservateur authentique, c'est-à-dire continental, se distancie du pseudo-conservatisme anglo-américain. Il s'oppose beaucoup plus fermement au libéralisme, dont le slogan est devenu : liberté, égalité, fraternité (1). Le conservateur, en revanche, répète : ordre, hiérarchie et autorité, communauté et nation. Il s'oppose aux déviations sexuelles et de genre, à la folie écologique et aux autres pratiques terroristes de la ploutocratie mondiale.
Note :
(1) Et en effet, ce slogan mystique des démocraties a surtout sa place sur les drapeaux. Dès qu'on le retire, il devient et est déjà devenu source d'innombrables contradictions. Dans la triade Liberté – Égalité – Fraternité, le mot liberté est primordial, sinon pourquoi serait-il placé en tête ? D'ailleurs, sa primauté sémantique découle trop clairement de tout ce que nous avons envisagé depuis la Renaissance [idée libérale].
Les deux autres termes expriment également des exigences, mais les choses se présentent ainsi : la fraternité est une réminiscence pathétique, inconsciemment religieuse, elle témoigne de la descendance chrétienne évangélique et du lien qui existe entre toutes les formes de démocratisme, tous les hommes sont les enfants du même Père divin, ils sont donc frères et doivent s'aimer fraternellement.
Sur le plan moral et émotionnel, cette réminiscence est appropriée, mais sur le plan factuel, elle n'est qu'une métaphore, tandis que l'exigence de liberté est prise au sens littéral, « réaliser et naturaliser ».
Quant à l'égalité, en tant qu'exigence abstraite, elle n'a pas plus de sens concret ; en réalité et naturellement, les hommes ne sont pas, ne peuvent et ne doivent être égaux, l'humanité n'est pas, ne peut pas et ne doit pas être la répétition d'un même exemplaire biologique et psychique en trois milliards d'exemplaires, l'inertie de l'égalité et de l'uniformité arrêterait son évolution si elle ne la ramenait pas à l'état simiesque : le rouquin n'est pas l'égal du brun, le travailleur n'est pas l'égal du paresseux, le génie n'est pas l'égal de l'idiot, l'homme à la volonté active n'est pas l'égal du primitif incorrigible qui ne veut rien d'autre que satisfaire ses besoins végétaux.
L'égalité en tant qu'exigence abstraite est tout simplement un malentendu, et plus précisément une conclusion erronée tirée du rationalisme philosophique des Lumières et de l'empirisme philosophique des Lumières: dans le rationalisme, elle découle de la définition de l'homme comme être doué de raison, contrairement à l'animal, et de la conception cartésienne de la raison comme « la chose la mieux partagée du monde », c'est-à-dire la chose la mieux, la plus généralement et la plus équitablement partagée dans le monde ; dans l'empirisme, on y est parvenu par l'expérience, c'est-à-dire par l'observation de la vie, qui présente chez l'homme les mêmes attributs, depuis la même bipédie jusqu'à la même capacité de parler et de penser raisonnablement.
Mais, qu'il soit dit aux rationalistes que la raison est certes la chose la plus uniformément partagée entre les hommes (chacun a une raison), mais qu'elle est très inégalement et inégalement répartie (personne ne l'a autant et comme un autre) ; aux empiristes, qu'il faut dire que nous sommes tous bipèdes, mais que chez beaucoup, la qualité humaine continue à marcher à quatre pattes, seul le tronc s'est redressé.
Le reste de l'erreur a été fourni par le zèle enthousiaste de la lutte des Lumières contre l'Ancien Régime et ses privilèges de naissance et de classe, et plus encore par le primitivisme égalitaire démagogique du progressisme moderne.
L'identité abstraite de la même chose, mais répartie de manière inégale entre les individus, ne fonde absolument pas une quelconque égalité naturelle et intrinsèque entre tous, et ne peut en aucun cas être formulée comme une exigence d'égalité qui, dans la coexistence sociale, égaliserait et nivellerait les différences individuelles entre les personnes.
Voltaire n'a donc jamais été l'égal de son tailleur, et à l'époque, ils le savaient tous les deux, et Einstein n'est pas l'égal d'un gitan analphabète, et aujourd'hui, au moins Einstein le sait. Cela n'empêchait pas le tailleur, et encore moins le gitan, d'être des adeptes bruyants et exigeants de l'égalité commune à quatre, en pensant avant tout à l'égalité des biens. Pour leur faire plaisir, pensons-y nous aussi, hélas, mais montrons en même temps que l'égalisation ou l'uniformisation des gens dans la société, ne serait-ce qu'en termes de propriété absolue, est une solution totalement utopique qui ne survivra pas à une seule génération : au cours de ces trente années, ces personnes « égalisées » contribueront de manière très, très différente selon leurs talents et leur diligence, et à la fin de la génération, une inégalité renouvelée apparaîtra et l'égalisation devra être répétée de force, de sorte que le développement social devra nécessairement repartir tous les trente ans d'une « tabula rasa » sociale, de zéro, du déluge. – Réflexion de V. Černý tirée de : O povaze naší kultury (Brno : Atlantis, 1991), 39–41.
Note du site DP :
« ... aucun conservateur ne veut être exclu du débat public comme quelqu'un qui a déjà « franchi la ligne ». Les conservateurs ? Ce ne sont que des libéraux un peu en retard sur leur temps, que les progressistes tirent derrière eux comme un canard en bois, qui se met parfois sur la tête, dont on bloque parfois les rouages, mais qui, en principe, maintient le cap », déclare – en notre nom et au nom de notre – Václav Jan dans son article (« Desatero progresivní detektivky »). Et il en a toujours été ainsi, puisque les premiers conservateurs continentaux ont été des aristocrates libres penseurs – des libéraux français, des monarchistes modérés qui ont pris peur devant les conséquences de leur propre idéologie (voir O. Spengler, Myšlenky, p. 162 et suivantes) : y compris la guillotine.
C'est ainsi que « la droite » s'est progressivement rapprochée de ses adversaires de classe, les réactionnaires irréconciliables du « trône et de l'autel » (voir P. Sérant, Le romantisme fasciste, p. 299 et suivantes). Dans la seconde moitié du 19ème siècle, sous la pression des socialistes internationalistes, les nationalistes-républicains bourgeois, véritables démocrates, se joignent à eux.
Par la suite, les esprits les plus pénétrants constatent que dans un contexte de décomposition générale, de « déclin de l'Occident », le conservatisme ne peut plus être que révolutionnaire... « Si nous comprenons la raison bourgeoise comme une pensée démocratique-libérale au sens général, il est évident que la révolution conservatrice la critique de manière destructrice, c'est-à-dire de manière totalement négative. » Alors que : « Le néo-marxisme veut que sa critique de la raison bourgeoise aboutisse à quelque chose de positif – il ne peut donc logiquement être la continuation d'une critique qui voulait aboutir à la destruction. » Il en découle que « il est vrai que, par rapport au monde qui les entoure, les fascismes sont révolutionnaires au sens le plus radical et aussi au sens étymologique du terme, ce que même leurs adversaires les plus honnêtes ont fini par reconnaître.
Horkheimer, marxiste à l'origine et finalement porte-parole d'une sorte de néo-judaïsme abstrait, a reconnu à la fin de sa vie que « la révolution ne peut être que fasciste », car seul le fascisme veut renverser complètement le « système de valeurs » existant et « changer le monde », de sorte qu'il considère le monde actuel exactement comme les premiers chrétiens considéraient le monde gréco-romain et l'Empire romain. » (voir G. Locchi, Podstata fašismu, p. 40, 16)
11:47 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 04 septembre 2025
Carl Schmitt et Guiguzi : des concepts en parallèle

Carl Schmitt et Guiguzi: des concepts en parallèle
Prof. Dr. h.c. Hei Sing Tso
Président, Guiguzi Stratagem Learning, Hong Kong.
Beaucoup de personnes, y compris des érudits et des stratèges, ont comparé les idées du penseur militaire prussien Clausewitz et celles de Sun Tzu. Le premier est un penseur moderne en Europe, tandis que l’autre vivait plus de mille ans plus tôt en Chine. Dans cet article, je vais essayer de discuter d’une autre paire de penseurs issus de l’Allemagne et de la Chine. Carl Schmitt est un juriste et théoricien politique allemand très éminent du siècle dernier. Bien que controversé dans une certaine mesure, ses idées ont suscité des critiques et obtenu des soutiens, tant de la droite que de la gauche. Son homologue est Guiguzi, un praticien et penseur mystérieux de la période des Royaumes combattants (ca. 475 – 221 av. J.-C.) de la Chine antique. Guiguzi est le fondateur d’une école de pensée connue sous le nom d’École de l’Alliance Verticale et de la Division Horizontale (縱橫家), axée sur l’art de la diplomatie. De plus, il est aussi l’initiateur d’une discipline appelée Moulue (謀略), qui signifie littéralement « Stratagème ».


- 1. La théologie politique
Les pensées de Schmitt reposent sur la théologie politique, qui se distingue de la philosophie politique. La philosophie concerne la pensée humaine, tandis que la théologie s’intéresse à l’intention des dieux. Selon Schmitt, la vérité de la politique provient de la révélation. Il voyait la révélation et la politique comme étant liées et tentait, dans la mesure du possible, de les combiner. La distinction entre ami et ennemi trouve sa justification théorique dans la foi en la révélation, et cette foi est inévitable. Il considère que les concepts politiques ne sont que la sécularisation de la théologie.
Guiguzi, quant à lui, défendait le pouvoir du « Ciel ». « Ciel » dans le contexte chinois n’est pas une divinité personnelle mais une source suprême de l’univers, aussi appelée « Tao » (la voie). Tout stratagème politique ou Moulue découle de la puissance du Tao ou du Ciel. En d’autres termes, nous utilisons la puissance de l’univers pour vaincre nos ennemis. En terminologie chinoise, c’est l’Art du Tao (道術), où la tactique visible (l’Art) est dérivée d’un univers mystérieux (Tao). Même si Guiguzi ne croyait pas en un dieu comme Schmitt, tous deux considèrent que la politique séculière et le stratagème découlent d’une source cosmologique ultime. Par ailleurs, pour comprendre la vérité de la politique et du stratagème, il faut avoir foi (Schmitt) ou intuition (Guiguzi), plutôt que se limiter à la réflexion rationnelle et à l’analyse.
- 2. L’inimitié
Une idée centrale dans la théorie politique de Carl Schmitt est la distinction ami/ennemi. Nous avons des ennemis en termes politiques, et cette nature ne peut pas être changée. Cependant, la tension et le conflit entre ennemis peuvent s’intensifier jusqu’à la violence réelle, voire jusqu'à la guerre. Tout ce que nous pouvons faire, c’est contenir cette escalade par des institutions. L’État joue un rôle absolu dans cette démarche. Une caractéristique fondamentale du Moulue (Stratagème) fondé par Guiguzi est l’inimitié. Les gens doivent utiliser des stratagèmes pour vaincre leurs ennemis. S’il n’y a pas d’ennemi, il n’est pas nécessaire d’avoir des stratagèmes. Dans le contexte du Moulue, l’ennemi peut être externe, comme une personne, une armée ou une nation, mais aussi intérieur, c’est-à-dire soi-même. De plus, il existe un type particulier d’ennemi dans la sagesse chinoise connu sous le nom de « Petites Personnes » (小人). Ces petites personnes sont rusées, égoïstes mais puissantes, et jouent donc toujours un rôle clé dans tout conflit politique ou guerre. Guiguzi a proposé de nombreuses tactiques et principes pour traiter avec ces petites personnes. En plus de limiter l’escalade de la tension entre ennemis, comme le suggère Schmitt, il peut également être utile de prêter attention au rôle de ces petites personnes.


Prusse/Allemagne: l'état d'exception en 1813 et en 1919.
- 3. L’état d’exception
Dans la théorie juridique de Schmitt, « L’état d’exception » est un concept très étrange. Il est lié à la distinction entre ennemi et ami en politique. Lors de l’escalade provoquée par l’inimitié, des situations imprévues, urgentes mais graves, peuvent survenir. Schmitt soutient que nous ne pouvons pas énumérer ou même définir tous ces scénarios avec des termes juridiques objectifs et en posant des limites. Lorsqu’une exception apparaît, un leader politique ne peut compter que sur son pouvoir discrétionnaire subjectif pour faire face à ces défis et menaces. Dans ces circonstances, même la Constitution doit être suspendue en tout ou en partie. Cela est totalement légitime. La Stratagème chinoise ou Moulue met l’accent sur le concept de « Qi » (奇), qui signifie non conventionnel, étrange, surprenant, etc. Qi s’oppose à « Zheng » (正), qui signifie normal, dominant, commun. Il existe un vieux proverbe chinois : « Utilise Zheng dans le gouvernement, mais Qi en guerre. » À cet égard, Qi est très précieux en situation d’État d’exception, car toutes les institutions et politiques habituelles, formelles et conventionnelles, ne mèneront qu’à l’échec.
- 4. La parapolitique
Schmitt considère que l’ordre juridique ne peut pas être compris exclusivement en termes rationalistes dans un système autosuffisant tel que le suggère le positivisme juridique. L’analyse de l’État doit faire référence à ces agences qui ont la capacité de décider de l’état d’exception. Cela indique l’existence d’un « État profond » derrière l’État de droit dans de nombreux pays. Cependant, les chercheurs conventionnels refusent toujours de penser à fond la politique occulte, la manipulation dans l’ombre et les conspirations. Selon la sagesse du Moulue, une stratégie supérieure doit être « invisible ». Pour Guiguzi, la manipulation secrète ou même les conspirations sont normales et nécessaires. Je pense que des idées supplémentaires issues du Moulue peuvent être appliquées pour étudier et analyser les conspirations de l’État profond.

- 5. Le Nomos
Schmitt a dit que tout ordre fondamental est un ordre spatial. Le Nomos, le vrai et réel ordre fondamental, touche en son cœur à des frontières spatiales particulières, à des séparations, à des quantités spécifiques et à une partition particulière de la Terre. Au début de chaque grande époque, se produit une grande appropriation des terres. En particulier, chaque changement significatif est lié à des changements politico-mondiaux et à une nouvelle division de la Terre et à une nouvelle répartition des terres.
Guiguzi a conçu 72 astuces pour le changement et 36 arts de stratagème. Beaucoup de ces stratagèmes sont tridimensionnels et présentent un aspect spatial. Par exemple, la technique classique 22 dit: « Voler pour capturer et détruire le pouvoir » (飛箝破勢). Cela consiste à créer un pouvoir qui soit comme une cage invisible pour enfermer l’ennemi, le restreignant de toutes parts et brisant progressivement son propre pouvoir. Nous pouvons appliquer cela pour étudier la façon dont la « partition » fonctionne dans la théorie du nomos de Schmitt.


La maison de Carl Schmitt à Plettenberg dans le Sauerland.
- 6. La métapolitique
Au-delà des théories, il faut aussi étudier la praxis de Schmitt. Après la Seconde Guerre mondiale, Schmitt a disparu de la politique, du monde académique et de l’arène publique. Il avait prévu d’émigrer en Argentine pour le reste de sa vie. Au contraire, le juriste allemand a changé de tactique. Il a vécu en exil dans sa propre ville natale, Plettenberg, mais a été privé de tous postes académiques. À partir des années 1950, il a poursuivi ses études et a souvent reçu des visiteurs, notamment le chancelier allemand Kurt Georg Kiesinger, et ces visites se sont succédé jusqu’à ce qu'il ait atteint un âge avancé. Schmitt n’a pas été vaincu, mais il a mené sans arrêt une lutte métapolitique contre le libéralisme. Un cercle privé de disciples s’est progressivement constitué, donnant à Schmitt une grande influence dans la politique d’après-guerre en Allemagne et en Europe entière.
Guiguzi, durant la période des Royaumes combattants, était habile en diplomatie en lien avec différents rois nobles. Plus tard, il s’est beaucoup inquiété, a été frustré par le chaos politique et a décidé de vivre en autarcie comme ermite dans une vallée appelée Guigu. Cependant, il ne s’est pas totalement retiré, mais a commencé à enseigner ses idées, ses connaissances et ses compétences à des étudiants sélectionnés. Certains sont devenus plus tard de brillants hommes d’État et stratèges. Tous ces praticiens, suivant l’enseignement de Guiguzi, ont formé un groupe informel connu sous le nom d’École de l’Alliance Verticale et de la Division Horizontale, ou simplement l’École de Diplomatie, qui a eu une influence considérable sur les relations internationales de l’époque.
Contrairement à Clausewitz et Sun Tzu, Carl Schmitt et Guiguzi sont des penseurs controversés. Schmitt a été critiqué de son vivant, tandis que les idées de Guiguzi ont été rejetées par les érudits officiels du courant mainstream en Chine pendant de longues périodes, car elles allaient à l’encontre des valeurs confucéennes. Cependant, récemment, les idées de Schmitt ont été redécouvertes et discutées sérieusement par la droite et la gauche, même au-delà de l’Occident, comme en Chine et en Iran. Ces dernières années, le Moulue ou Stratagème de Guiguzi a commencé à attirer l’attention en politique et en affaires.
J’espère que cet article court pourra stimuler davantage d’intérêt pour explorer un dialogue plus approfondi entre ces deux brillants penseurs issus de l’Ouest et de l’Est.
18:15 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, guiguzi, théorie politique, stratagèmes, politologie, sciences politiques, philosophie politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 août 2025
La fin du politique

La fin du politique
Renzo Giorgetti
Source: https://www.heliodromos.it/la-fine-della-politica/
En ces moments historiques, se taire pourrait sembler de l'apathie – et c'est la seule raison pour laquelle nous écrivons ces considérations – même s'il n'y aurait en réalité presque rien à ajouter, ayant déjà largement préfiguré dans le passé les développements sinistres de la situation actuelle. La chute des derniers masques derrière lesquels se cachait le régime tyrannique du totalitarisme mondial n'est pas une surprise, car elle était prévisible, du moins pour ceux qui avaient un minimum de sensibilité et d'intelligence pour discerner les dynamiques du pouvoir des deux derniers siècles dans le monde occidental dit moderne.
Le fait que toutes les « conquêtes » et tous les « droits » du passé aient été éliminés avec une totale désinvolture et sans aucune résistance ne peut que susciter l'hilarité et la peine (surtout à l'égard de ceux qui y ont cru), car tout cet appareil de formules vides n'était rien d'autre qu'un décor, une fiction créée pour persuader les malheureux de vivre dans un monde libre. Il ne s'agissait en fait que de produits artificiels, présentés comme des valeurs absolues, mais qui n'étaient en réalité que de misérables concessions dont l'apparence d'intangibilité n'était garantie que par la parole, c'est-à-dire par des déclarations solennelles mais inconsistantes d'individus à la crédibilité douteuse.

Et en effet, tout ce qui a été donné a ensuite été repris avec intérêts, laissant en plus les dommages psychologiques du lavage de cerveau sectaire, de l'incapacité à élaborer des pensées réellement alternatives. Il est inutile maintenant de se plaindre et de réclamer « plus de droits », « plus de liberté » ou même de se plaindre du « manque de démocratie » : ces schémas sont perdants. Ils ont été implantés dans l'esprit de la population à une époque où les besoins de l'époque imposaient ce type de fiction. Il fallait en effet faire croire que l'on avait été libéré (on ne sait pas bien par qui) et, après une série de « luttes » et de « conquêtes », que l'on était enfin arrivé au summum de l'évolution et du progrès. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et de nouvelles fictions sont nécessaires pour garantir la continuité du pouvoir.
Le « Nouveau Régime » (1789-2020) est en cours de restructuration, devenant « Tout Nouveau » : la période de transition que nous vivons sera caractérisée par le démantèlement définitif de tout l'appareil des droits et des garanties qui ont caractérisé la vie civile précédente. Ce démantèlement ne sera pas suivi d'un vide, mais de nouveaux ordres fondés sur de nouvelles logiques et de nouveaux paradigmes. La destruction du pacte social ne conduira pas à l'état de nature (qui n'a probablement jamais existé) et au rejet de toutes les règles, mais à un « nouveau pacte » avec de nouvelles règles plus ou moins volontairement acceptées. La forme de gouvernement des derniers temps ne sera pas l'anarchie mais l'imperium, un sacrum imperium, une hégémonie à la fois spirituelle (façon de parler) et temporelle, une forme de pouvoir avec sa sacralité toute particulière, très différente de la laïcité du présent.

La polis, entendue comme lieu de rencontre et de résolution dialectique et pacifique des conflits, s'est désormais effondrée, désagrégée par le lent travail mené à l'intérieur de ses propres murs, et tout discours politique est donc dépassé, irréaliste, irréalisable, un tour de passe-passe sans aucun effet pratique. Mais la désagrégation de la polis ne ramènera pas à l'état sauvage. Le retour aux origines sera d'un tout autre ordre. À la polis, c'est-à-dire à la civitas, ne s'oppose pas la silva, mais le fanum, ce territoire consacré au dieu, dont les habitants doivent se soumettre aux règles de la divinité à laquelle ils appartiennent. Ceux qui vivent dans le fanum vivent selon des lois particulières, selon un ordre qui n'est pas celui de la vie civile, un ordre différent, pas nécessairement négatif. Le cives se rapporte aux autres sur un plan horizontal, tandis que le fanaticus vit la dimension verticale, il est possédé, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire (le terme fanatique doit être compris dans un sens neutre, son anormalité n'étant telle que dans un monde politique) ; ses actions répondront à des critères différents dans la mesure où la présence de l'invisible s'est désormais manifestée, rendue à nouveau tangible, agissant dans le monde de manière concrète.
Dans la mesure où des influences qui ne sont plus liées à la stricte matérialité entrent dans le monde, tout reprend alors des accents sacrés et rien ne peut plus être profane, rien ne peut plus être exclu de l'irruption du numineux qui imprègne et transfigure tout.
Par « sacré », nous entendons au sens large ce qui n'est pas confiné dans les limites de la matière, et le terme peut donc désigner à la fois ce qui est proprement sacré (comme la spiritualité supérieure) et ce qui s'y oppose comme une force blasphématoire, exécrable, même si elle possède sa propre « sainteté ».

L'irruption du transcendant dans le monde laïc et matérialiste (dans le monde profane) entraîne un changement historique, modifiant non seulement les règles de la vie civile, mais aussi les paradigmes mêmes sur lesquels repose l'existence. La fin de la politique s'inscrit dans ce contexte et porte la confrontation sur un autre plan.
L'effondrement du monde politique laisse déjà entrevoir, parmi les décombres, la montée d'une puissance étrangère, le numen, les forces de l'altérité qui déconcertent en manifestant la puissance du tremendum. Le nouveau saeclum verra se manifester ce qui, invisible mais existant, se cachait derrière l'apparence d'une matérialité fermée et autoréférentielle, des forces absolues qui agiront de manière absolue, ignorant les constructions conventionnelles inutiles de la pensée humaine. La dernière époque verra le retour des dieux.
Mais cela, qu'il soit dit pour le réconfort de tous, ne se fera pas à sens unique. Certaines forces ne peuvent se manifester impunément sans que d'autres, de signe opposé, descendent pour rétablir l'équilibre.
La lutte reviendra à des niveaux primaires, car l'anomie, l'hybris a trop prévalu et, dans sa tentative de s'imposer, risque sérieusement de bloquer le cours même de la vie. En effet, comme nous l'ont montré de nombreux mythes (nous devons nous tourner vers le mythe car la situation actuelle n'a pas de précédent historique connu), cet état de choses n'est pas durable et conduit toujours à des interventions d'équilibrage qui, en contrant les forces de la prévarication, éliminent également le déséquilibre devenu trop dangereux pour l'ordre cosmique lui-même.
La fin de la polis conduit à l'impossibilité de résoudre les conflits par le compromis et la médiation. Tout passe désormais du politique au fanatique, car les forces qui s'affrontent sont des forces antithétiques, absolues, qui, tout comme la vie et la mort ou la justice et l'injustice, ne peuvent coexister simultanément dans un même sujet.

Ces discours ne sont peut-être pas très compréhensibles pour ceux qui ont été programmés selon les anciens schémas de pensée, mais il serait bon de commencer à les assimiler, car l'avenir ne fera pas de concessions à ceux qui tenteront de survivre avec des outils désormais obsolètes : avec la polis, c'est en effet cette autre construction artificielle appelée raison qui s'est effondrée. La nouvelle ère, en montrant l'aspect le plus vrai de la vie, c'est-à-dire la confrontation entre des forces pures, rendra à nouveau protagoniste ce qui a été trop longtemps et injustement appelé l'irrationnel.
Renzo Giorgetti
16:31 Publié dans Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, théorie politique, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 juillet 2025
Evola et la démocratie filtrée à travers Friedrich Nietzsche

Evola et la démocratie filtrée à travers Friedrich Nietzsche
La maïeutique evolienne se concentre sur la question des universaux. La position claire du philosophe en faveur des individus est nette.
par Marco Iacona
Source: https://www.barbadillo.it/122680-focus-4-evola-e-la-democ...
Dans la revue Colonna di Cesarò, Julius Evola évoquait la démocratie, ou plutôt le démocratisme – ou encore: l’idée de démocratie, telle qu’elle devrait être pour les démocrates – comme un régime ou une forme d’État dont les racines idéales plongent dans le christianisme. Doctrine religieuse inacceptable suite aux reproches de Nietzsche adressés à la mesquinerie d’un certain type d’homme. Le problème du christianisme sera résolu par le philosophe en préconisant, à sa manière, avec style et tonalité, une tradition anti-guelfe. Deux entités, dit-il, comme l’État et l’Église, ne peuvent coexister dans une seule substance (pour que ce soit clair : si le christianisme abandonne sa nature démocratique-égalitaire, en faisant valoir le véritable principe hiérarchique), à moins que la substance étatique ne contienne en elle le principe spirituel: alors elle seule sera digne d’être appelée "État". Pour Evola, ce sera l’entité étatique, ou dans ce cas: impériale, c’est-à-dire dépourvue de limites modernes, qui absorbera ce qui est proprement spirituel; le but étant de créer une harmonie lumineuse « concrète » entre les pouvoirs.

Un tel régime n’existe pas et il sera difficile d’en trouver un. La perspective du philosophe consiste à observer mentalement la chose – en utilisant des lentilles catégoriques – non à penser communément la chose, précisément. Le monde de la vie se manifeste dans un ordre tout autre et avec des règles bien différentes. Ce devoir d’être brut, cette relation au mythe sera, pour Evola, seulement une étape préparatoire – un simple moyen – en fonction de l’État, qui est ou sera, toujours et uniquement, une puissance absolue; libre, c’est-à-dire dépourvue de toute obligation ou position. Si celui-ci n’existe pas encore, et qui sait jusqu’à quelle limite temporelle, on sera contraint de constater l’insuffisance des hommes pour la réalisation d’un tel sujet. Si l’homme possède en lui la puissance – comme Evola l’a expliqué depuis longtemps dans son interprétation du tantrisme oriental – il sera définitivement et invinciblement en acte; si l’homme ou les hommes échouent, il sera difficile de trouver une excuse qui ne repose pas sur l’insuffisance ou la faiblesse de la puissance elle-même.
Plus que de se référer aux « hauteurs » de ce qui sera – même si, jusqu’à un certain point – in convient de faire référence doctrinalement au père de l’anti-positivisme européen, c’est-à-dire à Friedrich Nietzsche. Evola cherche ici à dévoiler : a) les oppositions logiques à l’intérieur de la démocratie, en rendant publique l’idée (la sienne) que la démocratie – comprise comme une haute valeur ou dans certains cas comme une méthode – n’existe pas (pour une série de raisons embrouillées que j’expliquerai dans un prochain article); b) la circonstance non négligeable que, celle-ci, est une autre façon de soumettre la masse à la volonté d’autrui, une sorte de métaphysique de l’homme seul, seule voie possible, souvent présentée sous une autre forme, dont Evola est un habile et fervent défenseur. C’est pourquoi, au-delà des effets (probablement positifs pour Evola), cela ne vaut pas la peine d’accorder de l’espace à la démocratie, à son idée, ou de construire pour elle une narration de portée épocale.
Pour le lecteur attentif aux événements actuels, certains passages sembleront dangereusement proches d’une interprétation élitiste, de gauche, du sens ultime de la démocratie: la démocratie non pas comme un pouvoir exercé par le peuple, mais éventuellement comme un pouvoir exercé pour le peuple. Une auto-référence à ses propres positions ou fonctions, plutôt qu’à répondre aux sollicitations provenant d’un corps électoral. Un mélange culturel des intérêts, et un bonisme exhibé, ainsi pour lui-même.
Contrairement à d’autres, le philosophe écrit à propos d’un gouvernement des nombreux et non du peuple, car, comme il l’explicite, il n’offre aucun droit de citoyenneté aux substances universelles. Il se concentre donc sur un point fondamental pour la démocratie moderne: la distinction gouvernants-gouvernés. Cette distinction, sur laquelle il n’est pas possible de faire de concessions, constitue une affirmation de la supériorité évidente des premiers sur les seconds, une exception peu conforme au principe sacré de l’égalité, qui en perd ainsi sa véritable substance; ou une négation de la philosophie moderne qui, par voie institutionnelle, corrige les verticalités d’une ou plusieurs traditions. La réponse démocratique, à ce stade, sera: la suprématie mentionnée mais fonctionnelle sera, pour ainsi dire, atténuée par le contrôle exercé par les nombreux: contrôle exercé a priori comme équivalent du choix ou de la sélection. Supériorité donc uniquement de fait, fonctionnelle au mécanisme institutionnel, mais en aucun cas un « droit ».

Pourtant, ainsi répond Evola à un interlocuteur imaginaire, le débat ne pourra pas être abordé du côté d’une raison technique, qui dissimule la vérité des causes, mais d’une raison pure – originale – capable de dévoiler la substance scientifique du fait. Il écrit ainsi : les contrôleurs, par évidence ou auto-évidence, ne possèdent pas en eux des qualités ou attributs qui ne soient pratiques, et il en résultera que les représentants ne seront que des personnages pratiques. En cohérence avec cela, la démocratie: 1) ou sera une manière de gouverner qui ne donne que des réponses pratiques; 2) ou sera une fausse mise en scène des soi-disant valeurs élevées; 3) ou enfin, elle basera sa crédibilité sur la confiance, mais une confiance mal placée: tôt ou tard, les nombreux finiront par comprendre que le critère matériel n’est ni le premier ni le dernier parmi les valeurs, ils apprendront à reconnaître des valeurs vraies, supérieures ou même religieuses. Cependant, étant donné qu’Evola a postulé l’irrationalité de la masse, c’est-à-dire sa capacité innée, perceptible, la dernière option ne sera pas du tout prise en compte.
Après ces prémisses (la démocratie pensée fait semblant d’être une haute valeur, mais n’est en réalité que mesquinerie), la maïeutique evolienne se concentre sur la question des universaux. La position claire du philosophe en faveur des individualités est sans équivoque. Aristote affirmait que les substances secondaires n’avaient aucune base, car elles n’étaient pas des individualités mais des concepts utiles pour les classifications. Pour Evola, le peuple n’est qu’une métaphore à laquelle, par définition, correspond une somme de forces instables. Le peuple ou, pire encore, l’humanité, est une sorte de dogme insignifiant: ce qui compte, ce sont les citoyens ou les hommes ou, comme il l’a déjà écrit, les nombreux.
12:22 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie politique, démocratie, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 juillet 2025
« La destra e lo Stato » (La droite et l'État) de Spartaco Pupo: une étude sur les catégories de la pensée politique

« La destra e lo Stato » (La droite et l'État) de Spartaco Pupo: une étude sur les catégories de la pensée politique
Cet ouvrage met en évidence un courant de résistance spirituelle à la dissolution nihiliste produite par le rationalisme abstrait et l'individualisme effréné.
par Giusy Capone
Source: https://www.barbadillo.it/123019-la-destra-e-lo-stato-di-...
À une époque où la modernité avancée se complaît dans la liquéfaction de tout enracinement identitaire et dans la célébration d'un universalisme sans âme, La destra e lo Stato de Spartaco Pupo s'impose comme une œuvre nécessaire, un geste de restauration intellectuelle qui rappelle aux lecteurs les plus avertis que la droite n'est ni une caricature nostalgique du passé ni une aberration pathologique de la politique, mais l'une des plus nobles traditions de la pensée occidentale, façonnée par la conscience tragique des limites inhérentes à la nature humaine et de la nécessité d'un ordre supérieur qui endigue la dérive entropique de l'anomie démocratique, comme l'avertissait Joseph de Maistre lorsqu'il écrivait que la meilleure Constitution pour un peuple est celle qu'il se donne sans le savoir.

Spartaco Pupo, avec une lucidité aristocratique et une rigueur scientifique, reconstitue la relation intime et controversée entre la droite et l'État, montrant comment cette union ne s'est jamais cristallisée en formules dogmatiques, mais a toujours oscillé entre l'exaltation de l'État comme garant de la hiérarchie et de la tradition, et la méfiance envers les dégénérescences de l'étatisme niveleur et bureaucratique; et ici l'on ré-entend la leçon de Carl Schmitt, qui voyait dans l'État le gardien suprême de la décision souveraine contre la neutralité libérale informe. Cette oscillation n'est pas une contradiction, mais plutôt la fidélité à une vision organique de la société, dans laquelle l'État n'est légitime que dans la mesure où il se pose en gardien des identités historiques, des aristocraties naturelles, des liens communautaires façonnés par l'histoire et la lignée. Pupo rejette fermement l'approche caricaturale de ceux qui voient dans la droite une simple réaction irrationnelle au progrès, et redonne à cette tradition son statut authentique: celui d'une résistance spirituelle à la dissolution nihiliste produite par le rationalisme abstrait et l'individualisme effréné.
Ce n'est pas un hasard si son étude considère la droite comme la gardienne de valeurs permanentes, de ces vérités non négociables qui survivent aux bouleversements des modes politiques et aux velléités utopiques de la gauche, conformément à la maxime de Donoso Cortés selon laquelle quand on ne croit pas en Dieu, on finit par croire en n'importe quoi. À travers une analyse fine des différentes âmes de la droite, du conservatisme aristocratique au nationalisme identitaire, du traditionalisme organique au populisme souverainiste, Spartaco Pupo démontre que la relation avec l'État a toujours été filtrée par une vision sacrée de la politique: l'État, lorsqu'il est digne de ce nom, n'est pas une simple administration ou un mécanisme procédural, mais l'incarnation visible d'une volonté historique et spirituelle, un rempart contre le chaos destructeur des passions atomistiques.

Avec perspicacité et sens de la mesure, Pupo illustre comment, à l'époque contemporaine, la droite a dû faire face à de nouveaux défis: la mondialisation, l'érosion des souverainetés nationales, la colonisation culturelle opérée par des élites cosmopolites et technocratiques, contre lesquelles s'élève le souvenir de la leçon d'Ortega y Gasset, selon laquelle les nations ne meurent pas parce qu'elles sont envahies, elles meurent lorsqu'elles se vident de leur substance. Et pourtant, loin d'avoir disparu, la droite a su se renouveler, en revendiquant la centralité de la communauté, la défense des frontières, la restauration de la primauté politique contre les prétentions morales et juridiques de l'universel abstrait.
Ce renouveau, loin d'être une capitulation, se révèle être un retour aux origines profondes de la droite: la primauté de la substance historique sur la forme abstraite, de la racine sur l'élan, de la fidélité sur la nouveauté, selon le principe formulé par Evola selon lequel la Tradition n'est pas ce qui était, mais ce qui est éternel.

La destra e lo Stato est donc bien plus qu'une monographie érudite: c'est un manifeste implicite de résistance culturelle, une invitation à redécouvrir dans l'histoire les raisons éternelles de la communauté contre le cosmopolitisme désintégrateur, de la hiérarchie naturelle contre l'égalitarisme artificiel, de l'ordre substantiel contre l'anarchie déguisée en liberté.
Spartaco Pupo nous rappelle, avec sérénité, que la droite, avant d'être une doctrine politique, est une posture spirituelle face au mystère tragique de l'existence, une fidélité aristocratique à ce qui ne passe pas. À une époque qui a perdu le sens de la limite, du sacré, de la tradition, lire cet ouvrage équivaut à un acte de réappropriation de sa dignité intellectuelle, à une reconquête de la profondeur contre la superficialité joyeuse des masses.
Ces pages contiennent un appel silencieux mais puissant à ceux qui ne veulent pas céder à l'oubli, à ceux qui savent que toute civilisation authentique naît d'un acte de fidélité et d'un sens de l'honneur que nul temps, aussi sombre soit-il, ne peut éteindre.
15:40 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, état, philosophie, livre, spartaco pupo, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 juillet 2025
Max Weber sur les classes et les ordres sociaux

Max Weber sur les classes et les ordres sociaux
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/07/05/max-weber-om-klasser...
La droite authentique a historiquement cherché des alternatives à la société fondée sur l'individu et les classes, l'une des plus récurrentes de ces alternatives étant une société fondée sur les ordres sociaux (Stände). On en trouve des variantes chez Per Engdahl, Rudolf Kjellén et Othmar Spann.
Dans une certaine mesure, on peut dire que la société d'états (Stände) abolit la société basée sur les classes et peut ainsi être considérée comme « sans classes ». L'approche consiste à identifier les groupes naturels de la société et à leur donner une représentation formelle. Il n'est pas rare qu'ils correspondent plus ou moins aux trois fonctions indo-européennes, avec les exemples familiers où se juxtaposent « noblesse, clergé, bourgeoisie et paysannerie ». Quelle que soit la façon dont on envisage la possibilité de remplacer le parlementarisme basé sur les partis par une représentation corporative, les classes sociales constituent un complément précieux et une correction du concept marxiste de classe. Il existe d'ailleurs depuis au moins un siècle une forte tendance chez les sociologues à transformer cette dernière en quelque chose qui rappelle la première (cf. « habitus » de Bourdieu et « clercs » de Kotkin).
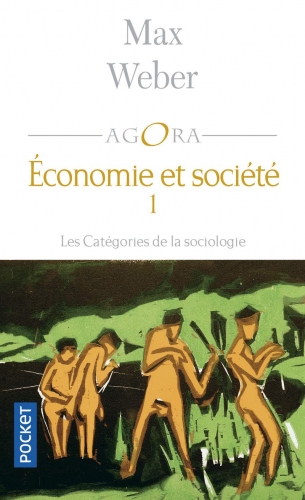 Dans ce contexte, il est intéressant de mentionner le court essai du sociologue et philosophe allemand Max Weber, Class, Status, Party, qui est en fait un chapitre de Economy and Society. Weber y définit les concepts de classe, de statut et de parti, en se basant sur les types idéaux de Gemeinschaft et Gesellschaft. Ce dernier est un couple d'opposés essentiel pour comprendre la pensée allemande, notamment pour ceux qui souhaitent lire Marx en tant que penseur inscrit dans la tradition allemande. Alors que la Gemeinschaft est la forme de société la plus ancienne, car elle est organique et naturelle, la Gesellschaft est une « communauté » artificielle et mécanique. « La Gemeinschaft se caractérise par le fait que les gens sont unis malgré les facteurs qui les séparent, tandis que la Gesellschaft se caractérise par le fait qu'ils sont séparés malgré ce qui les unit », pour citer un texte ancien consacré à Tönnies. Dans une large mesure, Marx et d'autres penseurs allemands sont des bardes qui chantent le chant du cygne de la Gemeinschaft lorsqu'elle est remplacée par la Gesellschaft sous la forme du marché et de la bureaucratie. Conformément à la dialectique germanique, ils pressentent également un avenir où la Gemeinschaft reviendra mais, cette fois, à un niveau supérieur.
Dans ce contexte, il est intéressant de mentionner le court essai du sociologue et philosophe allemand Max Weber, Class, Status, Party, qui est en fait un chapitre de Economy and Society. Weber y définit les concepts de classe, de statut et de parti, en se basant sur les types idéaux de Gemeinschaft et Gesellschaft. Ce dernier est un couple d'opposés essentiel pour comprendre la pensée allemande, notamment pour ceux qui souhaitent lire Marx en tant que penseur inscrit dans la tradition allemande. Alors que la Gemeinschaft est la forme de société la plus ancienne, car elle est organique et naturelle, la Gesellschaft est une « communauté » artificielle et mécanique. « La Gemeinschaft se caractérise par le fait que les gens sont unis malgré les facteurs qui les séparent, tandis que la Gesellschaft se caractérise par le fait qu'ils sont séparés malgré ce qui les unit », pour citer un texte ancien consacré à Tönnies. Dans une large mesure, Marx et d'autres penseurs allemands sont des bardes qui chantent le chant du cygne de la Gemeinschaft lorsqu'elle est remplacée par la Gesellschaft sous la forme du marché et de la bureaucratie. Conformément à la dialectique germanique, ils pressentent également un avenir où la Gemeinschaft reviendra mais, cette fois, à un niveau supérieur.
Une idée intéressante de Weber est que la société de classes présuppose la Gemeinschaft. Il a écrit à ce sujet que « l'existence d'une entreprise capitaliste nécessite une action communautaire très spécifique de la part de la Gemeinschaft qui protège la possession des biens, et en particulier le libre pouvoir des individus de disposer des moyens de production ».

Sans une communauté qui a choisi de protéger le droit de propriété, celui-ci n'existe pas. Cela peut être interprété comme signifiant que la propriété privée est liée à la propriété populaire du pays, ce qui ne conduit pas nécessairement au communisme à grande échelle. Weber se rapprochait de Marx lorsqu'il définissait le concept de classe, une relation fondamentalement objective liée à la propriété et à la non-propriété (« la propriété et les biens » et « l'absence de propriété ou de biens » sont donc les catégories de base de toutes les situations de classe). La définition de Weber est même plus restrictive que celle de Marx, car il ne considérait pas, par exemple, les esclaves de l'Antiquité comme une classe et voyait les conflits antiques plus souvent comme des guerres entre ordres sociaux que comme des guerres entre classes. Pour citer Weber :
Nous pouvons également parler de « classe » 1) lorsqu'un grand nombre de personnes ont en commun un élément causal spécifique leur offrant des chances dans la vie, 2) lorsque cet élément causal est représenté exclusivement par des intérêts économiques liés à la possession de biens et aux possibilités de revenus, et 3) lorsque l'élément causal est représenté dans les conditions des marchés des marchandises ou du travail (« situations de classe » 4).
Weber se distinguait également de Marx dans son analyse de ce que cela signifiait concrètement. Alors que Marx considérait la lutte des classes comme la stratégie rationnelle pour les non-propriétaires, la théorie du jeu de Weber était moins figée. La recherche de la réussite personnelle ou, d'ailleurs, la passivité peuvent également être des stratégies tout à fait rationnelles. Ce que Weber appelait « action de classe », comparable à la « lutte des classes » marxiste, est l'une des nombreuses stratégies possibles et suppose, entre autres, que la classe partage des normes (à l'instar des classes sociales et de la Gemeinschaft). Nous notons ici en passant pourquoi l'immigration de masse est une arme si efficace dans la lutte des classes : elle brise la Gemeinschaft historique qu'est la classe ouvrière européenne. Weber l'a exprimé en ces termes : « cette action de masse est fondée sur l'opinion dominante du groupe. Ce fait est à la fois simple et important pour comprendre les événements historiques ». Marx parlait dans ce contexte de conscience de classe plutôt que de Gemeinschaft, et de l'évolution de la classe en soi à la classe pour soi, mais il s'agit de processus similaires.
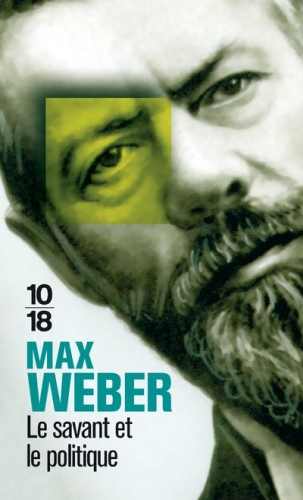 Par rapport aux classes, qui peuvent être définies objectivement par la situation du marché, les états/Stände sont plus amorphes. Au lieu de l'économie, ils ont trait au statut ou à l'honneur. Les Stände sont des communautés, Weber écrivait que « contrairement aux classes, les états/Stände sont normalement des Gemeinschaften, des communautés. Cependant, ils sont souvent de nature amorphe. Contrairement à la « situation de classe », qui est purement déterminée par l'économie, nous voulons caractériser la situation des classes comme résultant d'une partie intégrante typique de la vie, dans laquelle le destin des hommes dépend d'une évaluation sociale positive ou négative spécifique de l'honneur ». Elles sont exclusives et formulent certaines exigences pour qu'on en devienne membre. Par exemple, on ne peut pas vivre n'importe comment et être un citoyen lambda, ou d'ailleurs un fonctionnaire, un criminel ou un aristocrate. Weber a notamment utilisé ici l'exemple de la noblesse: « La fonction sociale (de la noblesse) fonctionne de manière très exclusive et repose sur une sélection d'individus qui sont personnellement qualifiés pour en être membres (par exemple, la chevalerie), en fonction de leurs aptitudes martiales, physiques et psychologiques ». Comme on peut le constater, nous ne sommes pas très loin ici des biotypes et des classes. Weber a également décrit comment certains groupes ethniques sont devenus dans la pratique des sortes de classes, parmi lesquels les Juifs et les Roms, qui sont des « communautés qui ont acquis des traditions professionnelles spécifiques dans des métiers particuliers ou d'autres arts, et qui favorisent la croyance en une identité ethnique qui sous-tend leur communauté ».
Par rapport aux classes, qui peuvent être définies objectivement par la situation du marché, les états/Stände sont plus amorphes. Au lieu de l'économie, ils ont trait au statut ou à l'honneur. Les Stände sont des communautés, Weber écrivait que « contrairement aux classes, les états/Stände sont normalement des Gemeinschaften, des communautés. Cependant, ils sont souvent de nature amorphe. Contrairement à la « situation de classe », qui est purement déterminée par l'économie, nous voulons caractériser la situation des classes comme résultant d'une partie intégrante typique de la vie, dans laquelle le destin des hommes dépend d'une évaluation sociale positive ou négative spécifique de l'honneur ». Elles sont exclusives et formulent certaines exigences pour qu'on en devienne membre. Par exemple, on ne peut pas vivre n'importe comment et être un citoyen lambda, ou d'ailleurs un fonctionnaire, un criminel ou un aristocrate. Weber a notamment utilisé ici l'exemple de la noblesse: « La fonction sociale (de la noblesse) fonctionne de manière très exclusive et repose sur une sélection d'individus qui sont personnellement qualifiés pour en être membres (par exemple, la chevalerie), en fonction de leurs aptitudes martiales, physiques et psychologiques ». Comme on peut le constater, nous ne sommes pas très loin ici des biotypes et des classes. Weber a également décrit comment certains groupes ethniques sont devenus dans la pratique des sortes de classes, parmi lesquels les Juifs et les Roms, qui sont des « communautés qui ont acquis des traditions professionnelles spécifiques dans des métiers particuliers ou d'autres arts, et qui favorisent la croyance en une identité ethnique qui sous-tend leur communauté ».
Il est intéressant de noter qu'il considérait les classes comme un frein à l'évolution vers la Gesellschaft. Il a notamment écrit que « l'existence des classes sociales empêche la réalisation conséquente du principe du marché nu ». La situation normale était une société composée de plusieurs classes sociales, chacune ayant ses propres exigences sur la manière dont ses membres devaient vivre pour ne pas être déshonorés. « Les époques et les pays dans lesquels la situation de classe nue revêt une importance prédominante sont généralement les périodes de transformations technologiques et économiques ; alors que tout ralentissement d'un processus de changement économique à court terme conduit au réveil de la culture des classes. En conséquence, l'importance de l'« honneur » social est rétablie ».
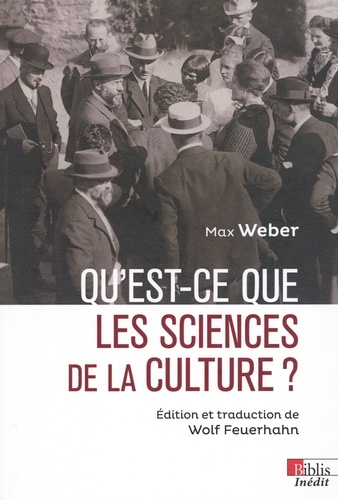 Dans l'ensemble, le bref raisonnement de Weber sur les classes et les castes est enrichissant. Des définitions et des idées pertinentes telles que « les gens ne recherchent toutefois pas le pouvoir uniquement pour s'enrichir économiquement. Le pouvoir, y compris le pouvoir économique, peut être apprécié « pour lui-même » apparait à plusieurs reprises dans son écrit. Le texte de Weber devrait également servir d'avertissement à un mouvement ouvrier qui souhaite également mener une politique d'immigration massive, car les classes ouvrières réellement existantes en Occident étaient également des Stände et l'immigration massive les a considérablement affaiblies. D'un point de vue abstrait, les travailleurs suédois et divers travailleurs non suédois appartiennent à la même « classe », mais dans la pratique, ils constituent d'innombrables classes sociales.
Dans l'ensemble, le bref raisonnement de Weber sur les classes et les castes est enrichissant. Des définitions et des idées pertinentes telles que « les gens ne recherchent toutefois pas le pouvoir uniquement pour s'enrichir économiquement. Le pouvoir, y compris le pouvoir économique, peut être apprécié « pour lui-même » apparait à plusieurs reprises dans son écrit. Le texte de Weber devrait également servir d'avertissement à un mouvement ouvrier qui souhaite également mener une politique d'immigration massive, car les classes ouvrières réellement existantes en Occident étaient également des Stände et l'immigration massive les a considérablement affaiblies. D'un point de vue abstrait, les travailleurs suédois et divers travailleurs non suédois appartiennent à la même « classe », mais dans la pratique, ils constituent d'innombrables classes sociales.
Mais Weber, en collaboration avec Burnham, nous rappelle également que le « mouvement ouvrier » n'a peut-être pas été mené par les « ouvriers » dans un passé récent, mais par des classes sociales complètement différentes, avec d'autres systèmes d'honneur internes (comparez le politiquement correct et l'engouement « woke » comme cultures de classe pour les cadres et les universitaires, avec le lien vers le « ralentissement d'un processus de changement économique »). Il est particulièrement intéressant de lire Weber à la lumière des analyses sociales réalisées récemment par Curtis Yarvin et Joel Kotkin sur les groupes de l'Occident contemporain, avec des noms tels que clercs, paysans, serfs et oligarques, ou vaishyas, brahmanes, dalits et hilotes. Le terme « classes sociales » aurait en fait été plus approprié que « castes » pour désigner ces derniers, même si le modèle ingénieux de Yarvin aurait alors probablement eu moins d'impact dans les milieux anglophones.
12:44 Publié dans Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, théorie politique, politologie, sciences politique, philosophie politique, max weber, karl marx, communauté, sociétés, classes sociales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 juillet 2025
Totta Theologia: théologie totale. Théologie de la fraude. Théologie par-delà "gauche et droite"

Totta Theologia: théologie totale. Théologie de la fraude. Théologie par-delà "gauche et droite" (Disputation de Diego FUSARO « Théologie politique comme religion des modernes »)
par Jean-Louis Feuerbach
De la cruelle réalité des choses infâmes (Charles MAURRAS).
L’interrègne théocratique se termine (Auguste COMTE).
Il n’est pas de vie vraie dans le faux théologique (Adorno revu et rectifié)
TOUT EST THEOLOGIE !
All is theology, clament à l’unisson Edgar Allan POE, Jorge Luis BORGES, Guido G. PREPARATA.
« Today, religion is everywhere » lit-on sous la signature de Martti KOSKENNIEMI, professeur à Oxford.
Tout est théologique, et rien que cela.
Il s’impose de s’en convaincre enfin.
Transpercer la fraude des mots, il faut.
Là où il est dit, écrit, gueulé « démocratie », il faut lire, entendre, comprendre théocratie.
Théocratie, théologie, théologique, là est la métaconstitution véritable.
Les juristes affutés s’avisent de cibler la "constitution invisible" (Martin LOUGHLIN, Hugues RABAULT, Laurence H. TRIBE) tant ils insupportent que le théologique soit la constitution de l’âge axial. Car depuis 2800 ans en effet, l’hegemon est à la théologie et à ses théologiens.
La clé de voûte de l’intelligence de la domination est à situer ici. L’intelligence du politique s’ensuit.
Ceci posé, il y a deux postures possibles : ceux qui savent, comprennent, incarnent d’un côté ; ceux qui ne savent, ne comprennent, ne saisissent, de l’autre.
Les premiers sont les anges du régime, les maîtres, les dominants qui dominent.
Les seconds sont étiquetés au mieux à « Gentils » (gentiles), aux « gens « (du latin « gens, gentis »), à « esclaves », soit au plus vrai à masses racisées à l’animalité théologique.Ce sont les « cons » qui ignorent les règles du jeu de la « modernité ».
Le clivage est intelligence théologique versus imbecillitas theologiae .
Cela pourrait se résumer à « gauche » contre « droite «.
Le théologique se love toujours dans le clivage. L’acmé du théologique est toujours à dénicher dans la discrimination, dans le séparatif, dans le divis.
Théologie est division dans son principe. Il s’agit toujours de fracturer les peuples. Défaire le « laos », le peuple, est l’axiome cardinalice.
À preuve, les théologiens n’ont que le mot « démos » à la gueule car ils savent pertinemment que démos n’est pas laos, que dème n’est pas peuple, que « démocratie » n’est pas pouvoir- puissance du peuple, mais que leur paroisse a pour objet social la « théocratie libre », la « société intégrée «, la théostructure intégralement théonomisée (Vladimir Soloviev).

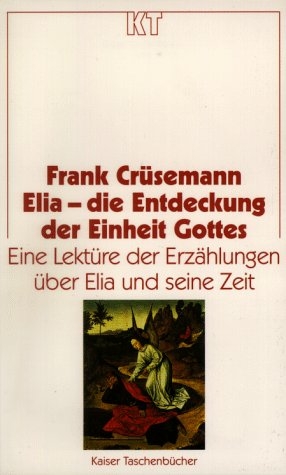

Le théologien allemand Frank Crüsemann (photo, ci-dessus) a vendu la mèche : « démocratie c’est théocratie » !
Martin LOUGHLIN (photo ci-dessous) d’enfoncer le clou : théocratie drappée des ors de la « démocratie mystérieuse » et lovée en « constitution invisible » de la domination sur le peuple (Against constitutionalism 2022). L’éminent professeur de Londres connaît le mystère autoclave et ses dogmes mystérieux; il connaît le lieu de la supériorité méta constitutionnelle et méta théologique projetée sur le monde; il sait cette doctrine de l’ordre implicite sous l’ordre apparent. Ce n’est pas un "con"!

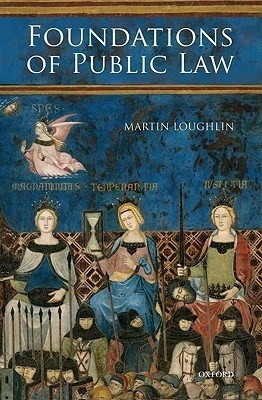
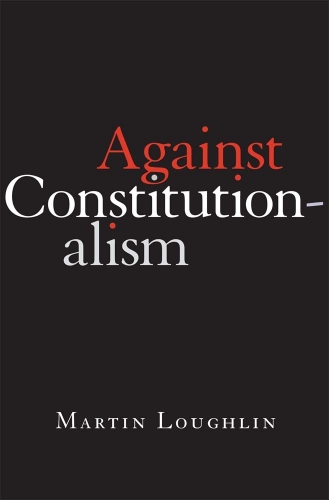
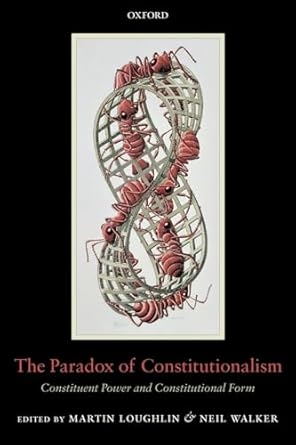
I. LA THEOLOGIE DROITE-GAUCHE SELON FUSARO
Le brillant penseur italien Diego FUSARO a compris lui que la plus grande pertinence est à trouver dans la conflagration entre le théologique et l’anti théologique. Se faire penseur de l’anti théologique est devenu l’économie de sa religiosité politique.
Il vient de cristalliser sa pensée dans un récent article paru en Espagne chez « Posmodernia » (le 3 avril dernier) sous le titre "Teleologia-politica, la politica como religion de los modernos". Sa traduction est à lire sur le site de l’excellent Robert STEUCKERS sur son blog « EURO-SYNERGIES » (Hautetfort Newsletter) depuis le 26 mai 2025 (cf. http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/05/26/theologie-politique-la-politique-comme-religion-des-modernes.html ) .
Il n’est pas sans portée de relever que l’interpellation de Diego FUSARO vient « de gauche », par un homme de « gauche », d’un penseur relevé et élevé "à gauche". Il s’affiche marxiste – marxien. Au point que par marxistes, on doit entendre ces théologiens de l’anti-théologique grimés en intellectuels engagés dans les champs du profane pour y voiturer la profanation de la profanation, la déthéologisation du théologique, à sa sortie de l’histoire. Ils sont en même temps schisme et par-delà le schisme dans la disruption d’avec le fondamentalisme théomane. En clair, ce sont les arracheurs de bure devenus. FUSARO met à nu le régime et les cliques du régime. Bakhounine compte un disciple d’envergure.

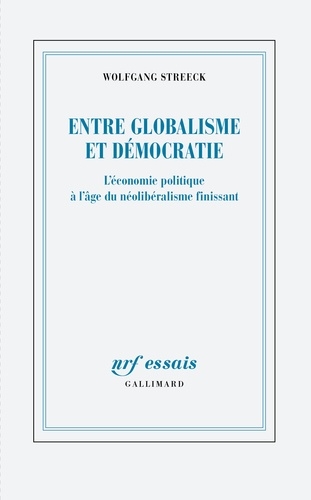

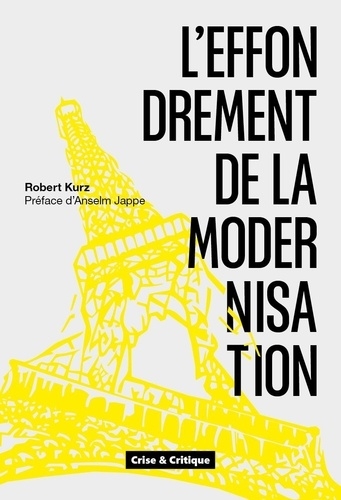
Spécialement, quand FUSARO (et ses camarades comme Wolfgang STREECK ou Robert KURZ - photos ci-dessus)) s’attaque au « capitalisme », ce n’est pas l’activité de production économicociste qu’il cible. Il vise symboliquement la tête du Léviathan. Capital vient du latin « caput », la tête. Leviathan personnifie l’activité théologique du « capital » et sa « raison sociale » du gros niquage. Théologie se résume à faiseuse de rois et de droit d’injustice (jus ad in-jurium).
N’est-il pas que les vangé-listes prophétisent le slogan théonomique du "aux riches il sera tout donné ; aux autres il sera tout pris". On connaissait le « Mathew Effect » de Merton et Streeck ; voici le mien ma-ma-lu-prinzip (Marc 4,25 ; Matthieu 25,29 ; Luc 19,22 et 26). C’est toujours et encore l’antienne chauvine de la piraterie deutéro-nomiste au « il faut sucer les peuples ».
Il n’est pas vain de souligner ici l’avantage mental de la théo-rie marxiste : elle est biberonnée à l’éveil théonomique par le "livre", le "récit", la "structure" théologiques.
Pas la droite.
L’arrogance sociologique de la « gauche » tient et vient de son irradiation supérieure par le théologique. L’insolence hyper éthiste est fanfare du combat mytho-métaphysico-idéologique dans les habits noirs du méta-théologique. L’activisme fébrile, hystérique et ravageur des paroissiens de "gauche" chauvinise le prophétisme managérial.
L’hébétude est toujours de «droite»: on y broute ce que vomit la «gauche».
Jamais on n’y discute la causalité magique, seulement parfois ses effets ; jamais on n’y est capable de saisir et de comprendre la logique « métaphysique de l’après » (Kurt Hiller) ; toujours on s’y complait à l’imbécillité historique et à l’imbécillité théologique.
Bravo l’ami Fusaro d’énoncer l’instance du suprémacisme théologique, d’exploser le Fake des fakes du genre cache-sexe de la théologie pure, et de dénoncer la machine de machination théologique comme entreprise de classe, de casse, de fraude !
A . DU CLIVAGE PROFANE GAUCHE-DOITE
Le clivage théologique entre « droite et gauche » s’avère l’impensé impensable du pourtant pensé.
L’ancrage théologique du dispositif est véritablement l’impensé de la doctrine, l’impensable de la pratique, l’omis du récit instituant ledit clivage.
Le dit est au non-dit.
La source est tue.
L’origine est cachée.
Le fondement est oblitéré.
a) Le journalisme ethnologique et alimentaire ne s’intéressera au clivage qu’à partir de la révolution de 1789. Il en fait catégorisation sociale d’une histoire sociale en vue de donner une identité à une construction de figurants et de configurations à des apparences, des blocs idéologiques d’appartenance, des spectres de conception du monde. Le truc c’est de celer l’ancrage des forces habillées et habitées pour jouer ce qu’elles ne sont pas et grimer ce qu’elles font. La science du clivage de paroisse se contente du rangement à l’arrangement à la droite ou à la gauche des rois, des présidents de chambres ou des chefs de parlements. Nul ne s’interroge du pourquoi, du pour quoi faire, du qu’est -ce que ça veut dire ? Pourquoi configurer en amis et en ennemis dans un même plénum ? Sinon signifier la mise en musique des canons du théologique dans la comédie profane. Ici on installe en déclinaisons opératives au clairon du dualisme spectaculaire et on motorise dans une nouvelle enveloppe hostilice :
- secondaire contre primaire
- bien contre mal
- messianisme versus « nationalisme »
- avant-gardisme et conservatisme
- potestas indirecta contra potestas directa
- bien sûr gauche contre droite
Ce partage devenu coutumier aura pris rang de titre juridique directif et orientatif. Ainsi la « République » de se fonder sur ce clivage. Elle sera au divis de division, elle qui se veut pourtant « une et indivisible «.
L’ordre est au divis d’adhésion professionnelle du plus fort confessionnel : faire mine de lutter pour le peuple et se battre contre lui, agiter les « lumières » ou les éteindre. Car ici sévit la maxime au tout faire croire » au changer il faut », pour que tout reste pareil et que règne le statu quo de l’interrègne à l’ordonnancement : « libéralisme » comme soft law pour les élites ; socialisme comme hard law contre les masses ; au bout, le peuple mithridatisé, sidéré, neutralisé. Précision insigne : libéral doit s’entendre au sens latin de « liber, libris », le livre, c’est-à-dire la Bible, et pas autrement.
Il est donc permis d’opiner avec Karl Marx que si les idées de la classe dominante sont les idées dominantes de la classe possédant la puissance matérielle et spirituelle, la théologie est l’idée de la classe dominante qui dispose de la production théocratiste.
b) L’encastrement à la méta théologie est donc latent mais pas patent. La division du travail théologique en deux sous- instances fait écran opaque, segmentation décorative, déguisement profane. Le régime enrégimente les false flags à une rhétorique de tromperie (Marcel Gauchet parlera d’une « histoire de mots », au lieu d’une histoire des maux).
Ce choix tactique doit tromper les masses à « l’ère des masses « avec des fausses identités. Car cette « organisation dualiste « permet de mettre la "société" en étau à deux mors et en deux parquages artificiels.
La droite et la gauche sont (à non-évidence) distributions théologiques et précipités du théologique dans l’instance de la politique. Le cœur théorique se trouve dans le transfert théosophique dans le profane.
Dans la mesure où il s’impose de retenir en présuppositions du Theos, ses mythèmes de création du secondaire et de péché du primaire, il s’ensuit que le » bien » c’est la communion au mythe de la religion secondaire et « mal » ce qui s’ancre dans la religion primordiale.
Y ajoutant, la matrice de fraude accumule les ergots de feintes: complexifier pour irriter, celer, mystifier, relativiser, brouiller et surtout anathémiser le pouvoir.
Les arnaques pullulent. La « laïcité » est l’une d’elle : dans l’océan des paroisses cabote la frêle esquif du peuple-politique ou laos; l’apartheid protège le religieux contre le politique et pas l’inverse. Le "ra-isme" en est l’autre: le cri du «ra», au «ra», par le «ra», gutturalise l’extrémisme théologique. C’est la lettre de cachet, le brevet de Haine, la créance de ponérologie inaugurale déchainés contre la « méchanceté », la « mauvaiseté », la « malitude », à dires de théologiens du mode de la mode de « modé-ration » exterminatrice de ce et ceux qui leur déplaisent. Shitstorm always again.
Allons plus loin. Explication.
B. DU COUP D’ETAT THEOLOGIQUE : DEUX COMMENCEMENTS, DEUX RELIGIONS, UNE TERREUR
En histoire, il n’est jamais de dieu pour sauver quiconque. Pour la comprendre, il faut saisir la question qui aura présidé à la réponse donnée par l’histoire, et donc la pensée devenue histoire d’une pensée (c’est le principe question réponse ou logic of question and answer de Robin George Collingwood).
a) Au commencement du système primordial, les peuples premiers vivaient heureux ensemble dans les essences du politique et du religieux. Leur accord sonnait juste. L’harmonie régnera longtemps. Survint la théorie du "péché originel" colportée par des marchands au long cours et à la théologie impitoyable. Il fallut divorcer.
b) Au commencement du système secondaire, une « société sainte » de théologiens civils (sous le label « Idra Sita «) invente un dieu à façon, puis le dépose à marque, brevet, modèle, concept, au choix. Ledit fétiche de voiturer la jalousie de ses créateurs et de partir jalouser les peuples premiers: la Déesse-Mère, le divin féminin, le matriachat, leur science, leur sagesse ,... Cette jalousie de prospérer jusqu’à poser un avant et un après à l’œuvre de "création". Ledit dieu jaloux fit de cette summa divisio le point cardinal de son culte. Fini le paradis de la félicité des peuples du Nord, du savoir immémorial, du merveilleux en mythe. L’ingénierie de la jalousie d’installer la tyrannie de ses valeurs, de fonder une nouvelle axiologie à la guerre des dieux, d’œuvrer à l’expulsion, à la scission, à la chute.
c) La » création » est constitutivement revendiquée à « sens inversé, ordre de renversement, inversion » de l’ordre antérieur voué à l’épuration (Zohar I 102b et 205b). Désormais, les présupposés du système primaire sont déclarés faux, tandis que ceux du régime du secondaire sont proclamés seuls vrais. Le coup d’état interdit tout retour de « l’Antéchrist ». La distinction pentateutique requiert l’exclusivité du culte. Pas d’autres dieux, ni d’autres déesses à l’horizon, au firmament ou dans les palais. Le roi c’est Dieu et Dieu est roi. Avec ses théologiens.
Ceux-ci assurent l’ambiance de sorcellerie et innervent « l’accusatif illimité de la persécution » (Emmanuel Levinas). Il leur faut la figure de l’ennemi comme ultimation de détestation théologique.
Théologie est ainsi motorisation à la haine, croisade permanente et hystérisation contre le réfractaire, l’opposant, le résistant. L’autre est toujours "païen", "impie", "infidèle", hétérodoxe. Sa seule présence devient profanation. Il doit être ex-terminé, c’est-à-dire exorbité de la création du genre paroissial. Telle est l’économie du « miracle » des uns et terreur pour les autres.
C. MIRACULISME
Le miraculisme relève du théologique et vice versa. Il se décline en hyper-fascisme de la sécularisation moderne.
a) Le théologique ritualise à la nausée les espaces de détestation et les aliens qui errent dans les camps de concentration du Theos. La liturgie vomit assez : « l’-eszs-trèm-droate », les « populismes », les « complotistes » et autres flatulences. C’est façon pour le théologique d’incendier son plan – complot de ses agressions dopées à l’extrémisme "amaléciste".
Le dispositif peut se résumer à la formule de Nicolas Sombart : "est ennemi qui s’oppose au plan mondial"! L’avantage de la formule est que l’axiome dévoile les fins du théologique :
- conquête du globe à plan arrêté de « commonwealth » monoparoissial,
- désignation à ennemi qui ose s’opposer à la « messianose » (Michel MAFFESOLI) ;
- extermination des « complotistes » qui conspirent au « complot « contre » le Complot » au travers de la solution polythéiste, polygéniste, polyversiste, bref du di-vers vraiment divers et diversitaire de plurivers juxtaposés et non intriqués.
b) Par sécularisation, il faut entendre la déportation des vices des uns sur les peuples désignés comme "boucs émissaires" (Lévitique 16,21-22 !). Soit la translation du récit biblique en déontologie hyper-éthiste faisandée.
Séculariser, c’est persuader, propagander, harceler à la préférence, au sens, à la paroisse du culte devenant culte-ture : bascule au primat paroissial du citoyen croyant et du croyant citoyen.
Il est donc aisé de discriminer qui en est et qui n’en est pas.
Clivage est gouvernail de croyance et d’incroyance.
Clivage est corruption, récit de corruption, batelage de corruption.
Le commissaire politique Saül de Tarse de poser la méthode réglée contre les masses : ce qu’elles font, elles ne le comprennent pas ; ce qu’elles veulent, elles ne le pratiquent pas ; mais ce qu’elles haissent, elles le font à fond.
II. THEOLOGIE POLITIQUE
Clivage induit et présuppose une ligne de séparation, de démarcation, de discrimination. Cette bicaméralité bipolaire bipolarise au binôme. Ce qui trahit à nouveau l’identité théologique du dualisme théonomique constitutif (deus versus démonie, créé contra incréé, biennisme et malisme, etc.) et élevé à « théologie politique ».
À quoi ça sert ?
A . KATECHONTIQUE. KATECHON & Compagnie.
Nul ne saurait servir deux maîtres. Ou le dieu, ou son peuple. Pas les deux, grondent les théologiens.
Katechon est partant l’idéologème (couché dans la seconde épître aux Thessaloniciens de Saul dit Paul de Tarse, versets 7 à 12) qui signifie interdire au peuple la grandeur politique, le renvoyer à l’impolitique, le téléologiser à masse minérale inerte.
a) Les meilleures bibliothèques sont polluées par des rayonnages entiers croulant sous la littérature à l’enseigne de la "théologie politique". Force billevesées sont accumulées à des fins d’effarement et d’égarement. Une « Imposture » s’esclaffera Géraldine Muhlmann ; quoi le théologique?
La vraie vocation de l’instrument dénommé « théologie politique » est de marquer l’empreinte du théologique dans le profane. (C’est précisément ce qui horripile les théologiens : que l’on puisse oser dire ou penser que le fond, les fonds et le tréfonds de l’administration des choses et des peuples soient théologiques; parce qu’il est interdit de caresser l’idée que c’est le théologique qui déconne et dragonne la politique !). Il y convoque au travail théologique de sa raison théologique fondamentale : catéchonciser. Catechontiser c’est empêcher. Théologiser c’est empêcher les autres d’être et de devenir ce qu’ils sont, de se connaître et de se donner à reconnaître pour tels.
Le mythe fondateur du théologique se trouve dans la mission messianiste et eschatologique d’interdire tout retour du primaire, du principiel, du primordial. Alter- Apocalypse, no pasaran !
La théologie politique se ramène donc à la mise en œuvre du katechon dans tous les registres du vécu. L’acmé réside dans l’absolue sainteté de la prophétie migratoire. Elle emporte prohibition absolue de contester la soumission au feu de la « main droite » ou de résister au « grand carnage dans la terre d’Edom » (c'est-à-dire Rome, donc europie d’Europe et des Boréens par extension) promis aux masses « de toutes les extrémités de la terre » ! Il n’y fait pas bon d’être du « côté gauche « (Zohar II,32 a) ! Violence absolue de violence au culte de la tyrannie de violence pour la violence.
b) Pour le théologien Jan Assmann, le nec plus ultra de la théologie politique c’est le monothéisme.
Le modèle orchestre à la séparation des pouvoirs :
- le politicien ajuste au culte et culte au culte ;
- le théologien choisit le politicien : il le proclame, l’acclame, le déclame ad nutum.
- le médiatcratique met en spectacle la liturgie d’adoubement ou de damnation ; il césarise et décésarise ; fait oraison de starisation ou hérémisation des démonisés.
Les unit la rivalité mimétique pour conquérir la « violence légitime « (sic !) du théologique contre les peuples, conduquer les haines de la transcendance dans l’immanence, manager, orchestrer, exploiter le muselage du peuple. C’est cela l’ingéniérie du miraculisme.
En d’autres termes, le concept de théologie politique sert à grimer l’imposture impérialiste du théologique sur les essences et les instances. Il est feinte de bicaméralité, réponse eschatologique à la sécularisation et gestion politicoclastique du katechon. Il opère « construction sociale de la réalité » (Peter L. Berger) en mensonge.
Le dispositif ne laisse pas d’interroger :
- Pourquoi cette tromperie ?
- Pourquoi masquer, obvier, oblitérer la lutte théolopétique ?
- Pourquoi cacher le travail à la transparence et hausser l’enseigne du dieu invisible ?
- Pourquoi cette crispation à l’oblique, au repli du soi de fourberie, au travestissement de la sur-veraineté en sous-veraineté en sous-jacence ?
- Pourquoi l’invisible règne-t-il, gouverne-t-il, légifère-t-il, jugeationne-t-il, condamne-t-il, engeole-t-il ?
Raillons ce jeu de masques sous lesquels la guerre de certains se poursuit contre tous.
La « culture » des théologisés vocifère les slogans de fronts de haine et les « lois du pouvoir invisible » visibilisent assez le système théologique et théonomique global.
B. L’hémiplégie originée au mythe du péché des origines (Hyperborée ou Phénicie) et à sa culpabilisation subséquente définit ceux qui s’en gardent et ceux qui mégardent.
Il y a ceux qui se conforment aux dogmes de la révolution yahwique et ceux qui la conchient.

Le professeur Michel Maffesoli (photo) ne laisse de dénoncer que le clivage participe du principe de coupure du secondaire et que partant, les clercs du clergé théologique décident de se séparer du commun du peuple, osent prétendre savoir à sa place ce qui lui convient et le conduquent dans le mainstream.
Le clivage étiquette dès lors l’inimitié – hostilité. L’ennemi est prédéterminé : nommé, marqué, désigné. Aussi la technique du clivage permet de blasonner telle catégorie en vue de sa perception, de sa reconnaissance, de sa capacité à mobiliser contre elle. Le classement classe et déclasse. Il identifie au plus et au moins. Il offre à séparer bibliquement "le bon grain et l’ivraie". Il modélise la conformité du moment et la non-conformité de toujours. Il est vendu comme fait de culture du culte au seul vrai et à l’unique conformisme, à l’acclamation et à l’aversion, à l’approbation et à la récusation, au thème et à l’anathème.
Le cœur nucléaire du dispositif est à lire dans l’opus méta-constitutionnel planqué dans les bas-fonds de l’ésotérisme et qui s’exotérise au slogan publicitaire de « ZOHAR » ou « livre des splendeurs ». Le cabbaliste Oscar GOLDBERG opinera que cette thèse fera mathèse et sera ensuite vernaculisée en « Thora », Livre de bible, proclamations testamentaires (ancienne et nouvelles), « coranie » et autres chorégies régulières et séculières, ensemble les « wokeries » de gauche ou de droite.
C’est de cela qu’il est question quand il est question de « théologie politique «. Ce concept renvoie à l’obscénité théologique de l’oppression historique. « Souverain » devient qui neutralise le politique par le théologique : qui installe le rideau de fer entre le théologique et le politique, le cordon sanitaire entre le pie et l’impie, le « front républicain » des clercs contre le laos .
C. FUSARO fait bien de raviver à son débat et d’y convoquer qui Jean-Jacques Rousseau, qui Thomas Hobbes, qui Carl Schmitt. Parce qu’il faut en finir avec l’impérialisme du théologique, de ses concepts, mythes, mythèmes ou rites dans le profane politique.
Il s’impose de bloquer à toute force le curseur de l’intelligence 'sociologique' quelque part entre la polarité "théologique" et le pôle "politique".
Le seul fait d’en appeler aux trois précités vaut répudiation des théologiens-politi-chiens de dieu (domini-canes) ou du grand-fétiche–golem de l’»Humanité » comme Saint-Simon, Comte ou Kojéve, et tous les autres.
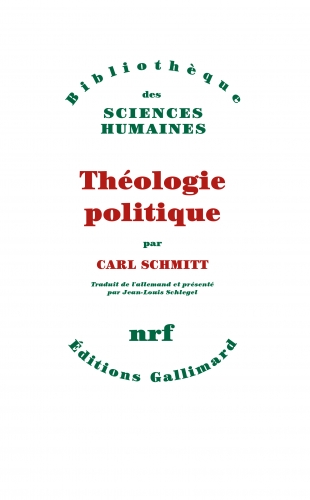
Il est permis de rappeler que l’essai de Schmitt remonte à 1922 et est inscrit dans les Mélanges offerts à Max Weber (prédécédé du virus « SARS I », ripoliné en « grippe espagnole ») sous le titre « Soziologie des Souveränitätsbegriffs und politische Theologie »). Il parut ensuite en livre et est désormais connu sous le titre de « Théologie Politique », avec double majuscule. Thèse et concept firent florès en littérature mais échouèrent en dehors. Pour l’heure, le souverain qui décide du régime d’exception reste le théologique qui sous-verainise l’état normal, neutralise l’état primaire et se sur-verainise dans la dictature de l’Angélinat. La tyrannie du système secondaire, c’est lui. Conscient de son insuccès, Carl Schmitt proposera en 1978 une nouvelle définition: «souverain est celui qui règne sur les ondes de l’espace». Ce faisant il aura acté la translatio imperii du théologique dans le cybernétique...! Soit théologie à la puissance 10!
III. THEOLOGIE THEOLOGIQUE
FUSARO a bien compris que la théologie politique n’est que la continuation de « l’articulation dichotomique » par tous les moyens de l’injuriologie théologique.
Le récit dogmatique est installé dans le profane. Toutefois, son arrimage au mensonge et à la fraude n’en finit pas de le déstabiliser. Assurément le théologique vacille. Il est à bout. Le réel dévoile l’imposture. Diego FUSARO peut donner son coup de pied (gauche bien sûr) et reprendre la balle de volée en pleine lucarne. Il arrache le masque de l’ennemi qui désigne industriellement l’ennemi et se désigne en ennemi de tous.
Léviathan n’est pas un monstre de terre mais de mer. Il a pour profession de terroriser Behemoth. Les deux étaient potes; « Yahweh les sépara » (Robert GRAVES). Behemoth est devenu cet énorme veau blond dont Alexandre de Macédoine défera le nœud, pour le renvoyer au désert du chaos. Là où la politique est religieuse!
FUSARO parle de "nihilisme". Il vise par là le théologique comme ultimation de la négation de la négation ou du nihil ex creatio. Le théologique n’est qu’accomplissement de la "politique du royaume de Dieu" (Léo Strauss): interdire aux Boréens toute agrégation à l’unité politique originelle. "Politique divine" = katechon = hybris de néantisation.
Bref, Léviathan ou Behemoth, gauche ou droite, theos-laos, c’est toujours le même mythe du dualisme qui opère séparation des eaux entre la "part divine"et la part hominide, «le côté droit et le côté gauche», «Ismaël et Edom». La "maison de Lévi" fait toujours la guerre bifrons sur terre et sur mer, instances contre essences, secondaire versus primaire, le pas bien contre le pas mal. Et elle nous dit que c’est son dieu qui a dit ce qu’il faut faire…
Sauf qu’à force, le nihilisme s’hétérotélise en affirmation de la négation de ce qui est nié!
A. DESIGNER LES MAITRES…
La thématique retenue par FUSARO, qui a tout appris chez Carl Schmitt, devient clin d’œil chargé de malice. Il oriente les "esclaves" en direction des "maîtres" et dit qui ils sont. Il les montre assis sur la cloche du plomb thoramorphique, désigne l’identité de leur doctrine et fournit la clé du fonctionnement d’état de la contrainte bureaucratisée.

En son temps, l’immense Julien FREUND (photo) visait les "hiérocrates"! C’est bien viser là où il faut, contre qui il faut.
Ne jamais oublier l’axiome freundien: c’est toujours l’ennemi qui désigne l’ennemi! Puisse alors cet ennemi souffrir de se voir rétro-désigné en ennemi et de se voir fracassé à l’asymétrie renversée…
FUSARO comme Carl SCHMITT sont des «Méta-MACHIAVEL»! Ils donnent à lire leur «mythologie politique». Les concepts totaux sont des mythes. Les mythes locutent des affects et des arcanes, des archétypes et des immixtions de la pensée et de la volonté des maîtres devant être reçues par les dominés.
Le théologique est évidemment assemblage mythologique derrière lequel œuvrent les cliques, les potentats invisibles, les théologiens. Les accents d’invisibilité, du règne de l’ombre, de façade à l’opaque donnent le théologique en authentique hyper fascisme. Il fait le vide. Tout est dépolitisé, sauf lui. C’est le parti unique, de doctrine unique, de totalitarisme unique. Il se lit comme désert unique, dieu unique, pensée unique, lobotomisation unique, vocabulaire unique, imaginaire unique, race unique, et bien sûr maîtres uniques du bloc d’idolâtrie unique.
La droite et la gauche y participent comme distributions théologiques et précipités du théologique dans l’instance de la politique.
Le cœur théorique se trouve dans le transfert théosophique depuis le Theos dans le profane. Dans la mesure où il s’impose de retenir en présupposition du Theos ses mythèmes de création du secondaire et de péché du primaire, il s’ensuit que le "bien" c’est la communion au mythe de la religion secondaire et "mal" ce qui s’ancre dans la religion primaire. Cette dernière aura précisément été expulsée du paradis théologiquement conquis. Elle se voit hyper-criminalisée en hyper-péché au commencement de la création du récit du livre. Dès lors "bien et mal" sont fixés, balisées, situés comme hyper-catégories du théologique. Elles fonctionnent à théonomie, laquelle régente la théodicée subséquente du juste et de l’injuste, du licite et de l’illicite, enfin de la gauche et la droite. Hyper-éthisme, c’est hyper-fascisme toujours!
Jean-Jacques Rousseau a raison: c’est bien la "société divine" qui pollue, corrompt, acculture homo à la méchanceté du plus méchant de tous les dieux et de ses paroissiens, pas l’inverse.
Pis, tout le travail théologique de la conversion au pseudo-bien fait le mal. Il fait chuter homo dans une autre nature qui l’aliène, l’exploite et le possède. C’est précisément par la suppression du "toit métaphysique" (Arnold Gehlen) qu’est le primordial, que les peuples du Nord sont enjoints de se ranger au «contrat» théologique du régime de l’exception. Immanuel KANT l’aura dénoncé en «extorsion» frauduleuse sous promesse de "rédemption". Parce qu’il avait lu le Code civil: la mise en cage des peuples n’est pas dans le commerce. Le droit noahide n’est pas opposable aux peuples tiers. Ils n’ont pas à reconnaître « Noé » et ne sont « ses fils ». Bref, fraude à nouveau.
B. EGALITE INEGALITE POUR QUOI FAIRE ?
De là surgit le méta-débat de « l’égalité » et de « l’inégalité ».
FUSARO, homme de "gauche", demeure hanté par cette question. On peut le comprendre. Sauf que la question est pipée. À nouveau la théologie pollue. Nietzsche, rétablit la situation et inscrit la solution «par-delà le bien et le mal»: le mythème de l’égalité n’est que cet «étrange expédient mental» du travail hostilice à plein du théologique contre les peuples.
La performance du théologique est à lire dans l’accomplissement de sa vision du monde. Performance est «épitélésis», rites, processions, processus; performance est mise en état, mise en acte, mise en musique; performance, c’est installation du culte en culte-ture. En procède « l’égalité » dans le culte pour ceux qui cultent et "inégalité" de ceux qui sont hamlétisés, démonétisés, exclus de l’inclusion.
«La lutte des esclaves contre les maîtres» ne vise donc pas l’égalité politique, économique, juridique ou sociale mais la délivrance d’avec la théorie et la praxis d’encastrement dans le tout théologique. Les "convulsions" subséquentes opposent les camps : inégalité de la physis, de l’incréé, du primordial versus «égalité» à l’orbe techno-théologique du système secondaire. Ce que stigmatisent les marxiens, ce sont non pas tant les prébenderies, les prédations, les prises de la dictature de l’Angélinat, mais leur légalisation par le déguisement en "ordre naturel". Or ce qui est proclamé "naturel" ne l’est pas du tout. C’est mise au pas du « profane » ou du "naturale" aux "commandements" du théologique hors de sa juridiction. Inversion et contrefaçon, c’est à nouveau fraude du théologique qui inflige l’artifice d’une théo-rie thoratologique en téléologie de dispositif et de piraterie de la fragile théorie post socratique d’un impossible «droit naturel». Et en fait «lettre de course». De la sorte, le pirate devient corsaire; il n’est plus «ennemi du genre humain» mais ami du fric et du frac. Demeure le clivage sacrificiel entre sacrificateurs et sacrifiés.
L’inégalité n’est donc pas biologique mais d’abord appartenance spatiale : au camp du bien ou au camp du mal; à maîtres ou à esclaves; à élite ou à masse; à l’angélinat face au prolétariat criminalisé en « populisme ».
Il faut se résoudre à comprendre les concepts de «liberté-égalité-fraternité» théologiquement:
- Etre "libre" c’est ramper et se soumettre aux commandements du livre des « maîtres » ; car « seul Dieu est libre »;
- "égalité", c’est obligation à la « Rigueur », solidarité passive devant la Dette, dans les dettes, « progrès » de l’imposition théologique «dimière» (du dixième elle est passée au sextuple); l’égalité arithmétique et disciplinaire ajoute à la justice injuste par la soumission horizontale;
- «fraternité» c’est le privilège du despotisme des maîtres: seuls les maîtres sont frères.
C . THEOLOGIE ECONOMIQUE
Jean-Jacques Rousseau et Fusaro dénoncent la cage d’acier. Homo vit dans les fers de la théologie.
Le camp marxien de rebondir et d’attaquer le dispositif de la cage et ses gardiens: le capitalisme.

Ne nous méprenons pas: par capital, il faut entendre l’activité du travail théologique, «sous sa forme la plus pure», précise le penseur coréen Byung-Chul Han (photo), au culte global de l’économie théologique des maîtres. Ici on moissonne saintement grâce au mamaluprinzip. Selon Streeck, on fait même payer le prix du «temps acheté» par l’industrie de la dette. L’importation des "troupes de réserve" de la théologie "depuis les 4 coins de la terre" est encore vendue comme «une chance»… pour la théologie. Les théologiens de capitaliser la traite humanitaire en sacrificialité «parfaite».
Diego FUSARO relève avec acuité «la charge religieuse maximale» du dispositif. L’explosivité incendiaire de la "charge" est encore suraugmentée, écrit-il, dans la phase finissante de la sécularisation. Elle est l’acmé à "la splendeur de la religion du capital".
Le théologique doit s’entendre, en seconde ligne, comme théorie de la prise, doctrine du casse, technologie de la mise en "splendeur". La pléonexitude devient raison théologique et religion des associés à l’entreprise théocentrique. Le culte met les riches en culte! Les autres, adversaires, ennemis, pauvres en «esprit de profanie» mal-sainte, se voient ravalés en parti de l’impiété, de l’impureté, en "déchets" (Zigmunt Bauman).
C’est ainsi que le théologique se décline en théologie économique et dévoile sa nature anti systémique, sa dimension de réaction réactionnaire, son hostilité torve. Foin de «doux commerce»; hard theology.
Il est machine de production médiate et immédiate de « rapports de force concrets » à la fixation de son règne, au descellement du primaire, et à la concrétion de son «antithèse radicale». A preuve, le travail typiquement théologique de l’expérimentation théologique, c’est-à-dire l’activisme qui consiste à "façonner le monde selon les préceptes de la raison théologique". Les missionnaires de vaticiner au mensonge du «changer le monde» qui ne doit changer puisque fait à leur image et à leur ressemblance. Ce sont donc eux les ultraconservateurs du statu quo théologique et les bateleurs de la fraude à nouveau, encore et toujours !
Au particulier et depuis Clovis, la circulation des élites a lieu selon le modèle, la grille, la sélection de la "société des anges" (Emmanuele COCCIA - photo, ci-dessous).

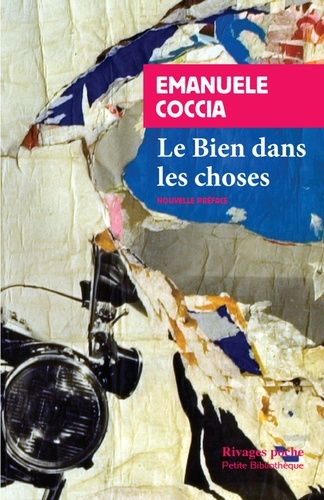
L’élu-tariat des managers ostensibles est strictement recruté, sélectionné, puis oint selon les procédures canoniques de l’inceste tribal: royauté dite de droit divin maison, «démocratie» théocratique paroissiale, dictature commissariale, commissionnaire, cybernétique (au choix des chocs de ceux qui choquent l’histoire).
Le mode demeure incontinent à la tyrannie de l’Angélinat: les dirigeants ainsi retenus de gouverner "au nom du peuple" mais pour compte de l’hyper-classe. De là, Terreur, Vengeance, Ressentiment, sous la tutelle du totem qui ne dit mot.
Alexandre Kojève cinglait à "imposture" pareil état d’"Etat". Cette mise en état de hachoir mental entre sainteté d’un côté et déchets de l’autre voudrait venir au soutien de "la validité de la dyade". Elle participe en effet de l’ordre méta-constitutionnel visibilisé de l’interrègne théotropique. La tyrannie de "république des valeurs" en est jactance spectaculaire. Le caractère et la vocation "aseptique" sert de boussole à l’hyper-discrimination entre "la part divine" et "la part maudite" à maudire (Georges Bataille). C’est la clé théologique de composition et de décomposition: sainteté versus abomination, «droite» contra «gauche»… comme nous verrons plus loin.
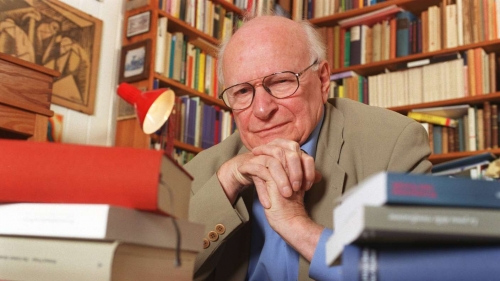


Le théologique reste indécrottablement la matrice des « conflagrations asymétriques « (Reinhart KOSELLECK - photo). La veille fasciste de l’hyper-fascisme théologique est au permaculte de la traque des boucs émissaires qui disent non à la politicoclastie. Ce ne sont pas les enfants de Noé et d’Abram, mais de PAN et de DIONYSIOS. L’atmosphère pue encore l’essence – carburant des « buissons ardents » de sorcellaire mémoire.
Es kann also kein richtiges Leben im theologischem Leben geben ! Il ne peut y avoir de vraie vie dont le tout faux théologique ! Merde à Adorno …..
Voici que surgit le « clivage gauche-droite »
IV. DU CLIVAGE EPITHEOLOGIQUE DROITE-GAUCHE, GAUCHE-DROITE
Il est fascinant de lire Fusaro originer sa "gauche" en dérivations du théologique et de créditer sa "droite" en résidus de la « réaction » réactionnaire à la mise au pas thoratologique .
Sauf que c’est l’inverse: gauche urbaine n’est pas gauche ésotérique; droite spectacle n’est pas droite théologique.
A. Le piège du clivage est grand ouvert.
La « société ouverte » c’est çà.
La méta-théologie a réussi le tour de force d’avoir inversé gauche et droite théologiques dans l’orbe profane politicien. Aussi ce qui est dit de gauche est au vrai, droite, et ce qui est dit droite veut dire gauche. Lisons et méditons le Zohar. Tout y est écrit !
Il y a donc deux constellations représentant deux blocs de fonctions, de missions et d’états inconciliables :
- la droite théologique, c’est le patriarchat thorato-biblique, le «côté pur»; elle est incarnée et spectacularisée par la gauche profane; c’est elle qui décide de la conformité métapolitique, métaculturelle et métacognitive en tout, sur tout, contre tout, par tous ; Fusaro écrit exactement qu’elle est la « gardienne de l’ordre théonomique » et le « parti qui aspire à corriger «le mal de l’inégalité» entre les hommes «devant la dogmatique théurgique»;
- la gauche théologique est en revanche ce qui est mis à la péjoration en "droite" dans le profane; ce sera le «côté impur», le divin féminin, le matriarchique; elle est soumise de plein droit divin à la « Rigueur » du conditionnement théonomique, donc au plan hyper-éthiste global «voulu» par les ingénieurs et mécaniciens portant le maillot du dieu; ici on subit la construction socialo-théologique, le temps théocratique, le tempo théocratique, les rapports de « belligérence », l’inimitié comme horizon indépassable, le normativisme enragé au commandement et à l’obéissance aux commandements, la Décision théosophique de Jalousie, l’hyper-culpabilisation du theologus hominorum,…
Singulière construction mentale de métempsychose accidentée, "l’invention de Dieu" (Thomas Römer) déconne et dragonne. Sa création est fausse monnaie, mensonge, casse historique.
L’ennemi qui désigne l’ennemi se désigne lui-même dans une furieuse opération croisée. Il donne à maudire la part divine de sa droite et à louer la part maudite à sa gauche. Il ne faut pas s’étonner alors qu’homo sapiens sapiens aura fini par exterminer 32 espèces hominides sur 34 (Jean-Jacques Hublin). L’inversion et le renversement aboutissent nécessairement à extermination (Zohar I 205b et 251b, Zohar II163a, Zohar III109b et 127b). La sainteté est saloperie à l’analyse; le théologique, c’est au vrai la "bête immonde" de Bertolt Brecht.
Le théologique fixe et entretient ce nouvel abcès de fraude massive. Pas étonnant que les patriciens de la gauche alimentaire ne s’y retrouvent plus dans leur catéchèse…
Il conviendra d’infliger aux « tricksters "l’objection héraldique":
- la gauche urbaine exotérique, c’est la droite cabbale de la rigueur divine;
- la droite civile, outragée, abominée, démonologisée, c’est la gauche de résistance et de reconquète,
L’hyper-rectification opère fantastique bascule de l’asymétrie de départ en asymétrie d’arrivée: l’ennemi doit commuter en victime de fraude; le fraudeur doit valser.
La plus fabuleuse plus-value numineuse doit advenir!
La substitution de qualité doit ouvrir la voie à la main gauche et à la puissance élevée au carré (P2).
B. L’actualité de la pensée de Fusaro invite à conjuguer "l’existant" en fausse équation d’une vraie asymétrie et en vraie bagarre «"grammaticale de la mise en mal".
Dans ce cadre, nous savons désormais que « mal » est provenance, origine, situs dans le combat des gens du dieu unique pour qu’il soit l’unique à la « fin des temps » de l’histoire de la cabbalocène (syndrôme du monothéisme).
Il importe de récuser le forçage "sur le plan immanent horizontal" de la technologie théologique et de la "liturgie conflagrationnelle droite -gauche".
Il s’impose de dire non à ce « clivage «qui se veut l’ultima regula des modernes» et à l’inversionnite selon l’inversionary principle (scripsit l’amora Mordecai M. Kaplan).
La défense légitime oblige à les culbuter, les renverser, les inverser, à les annuler surtout parce qu’ils sont frauduleux.
Parce que "l’esprit théologique est capacité d’exercer la dictature" (Walter Benjamin), il nous est fait obligation de bousculer et l’axialité de l’inversion et la colonisation par l’inversion.
Cette hyper-triche anthropocénique avère l’hyper fascisme global et appelle au soulèvement contre la théocratie planétaire.
L’opération de création laissera au final le parti de la fraude et le parti qui a compris la fraude.
V. TOUT EST FAUX EN THEOLOGIE
Tout est faux en théologie; qui agit, pense, exécute théologiquement, trompe.
Les choses incomplètes ne peuvent subsister, pérore- t-on en face (Zohar III 296a). Alors permutons, expulsons, contre-anathémisons.
A. Julien Freund nous apprend que la théorie théologique contient les éléments de sa propre contestation. La faille est ici monstrueuse: la jalousie, matrice de la fraude, fait vices, malices, sévices. Jamais vérité, toujours méthode de fausseté; raison-déraison encapsulée dans l’affect; archétypothéie de la rage.
Toute pensée encapsulée en fraude est problématique et doit être repensée dans ses présupposés de fraude.
Toute réponse fixée dans le concept « Dieu » est impertinente. Elle trace la jalousie réactionnaire en machination de fraude.
Il s’agit alors d’ouvrir la conscience historique à la détermination par la bonne question, puis de révoquer la logique de propositions du roman de fraude.
L’histoire est hachoir mental du principe d’incomplétude. C’est elle qui rend absurde «le mode bi- composé de saint Sancho» (Karl Marx).
B. Le vrai du théologique c’est sa fraude.
Carl Schmitt soutenait que « Progrès » n’est que progrès de la Prise, par la prise et dans la prise (prendre, conquérir, saisir; nemein; nomos).
J’ajoute que « Progrès » c’est l’entreprise du développement de la Fraude et le théologique, c’est la loi du développement de la fraude. Théosophie, théurgie, théonomie, tout est fraude !
Soyons les Hyper-Antifascistes qui se dressent contre le «Führerprinzip» au dieu jaloux, l’hyper-grammaire de dévastation, la super-timonerie des enragés du théologique.
C. En théologie, tout tient à sa causalité. Il suffit de débusquer, de démasquer, de pointer cette causalité frauduleuse pour que tout se renverse, s’inverse, s’effondre. Il suffit de doxanalyser la jalousie causale de fraude pour que l’effet de supernova opère.
Hyper-rinçage en déluge du nouveau genre. Liquidation des pseudo-valeurs en non-valeurs. Hyper-désert du dézinguage par la fraude .
Renversons l’ordre du renversement ! Désobéissons à la théonomie ! Faisons dorénavant l’inverse et le contraire de ce que le théologique pérore et inflige, dit et fait, veut et impose ; ce sera faire le Nouveau Bien
D. Carl Schmitt aura su pointer l’incompatibilité du système secondaire d’avec le tragique. « L’essence du tragique, écrit-il, réside précisément en ce qu’elle est insusceptible de s’incorporer au secondaire « (Hamlet oder Hekuba,1985, p 71).
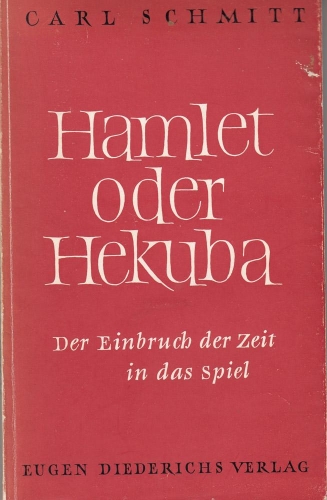
Le Nouveau Bien hétérotopique est tragique. Il se love dans le tragique. Il est hétérotélique, paradoxe des conséquences, énantiodromie. La Négation de la négation qui devient Affirmation du Contraire constitue l’hyper-défi du scandalon impensé et constitutionnalise l’invalidité du théologique.
Le Contre-Katechon tient là sa « critique indigène » (David Graeber) contre les « maîtres » et leur doctrine du théologique.
La planète terre est ronde, elle tourne en boule et révulse tout ce qui est fourbe, courbe, oblique; ce qui est faux, frauduleux, mensonge, imposture, usurpartion, piraterie.
E. Diego Fusaro se pose comme ce nouveau « réactionnaire de gauche », ce super turbo-contre-catéchonte, ce maître de la catéconcie du catechon qui précipite l’expulsion du drame théologique et accélère la clôture de l’ère de Fraude par l’exception de fraude: Fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout !
F. Hyper-fondamentalement enfin, Fusaro se sera convaincu qu’une Alternative au théologique et à son capitalisme existe.
Il l’initialise, l’actualise et la dresse en hyper-théorie pivotale.
Pareille Affirmation de nouvelle synthèse asymétrique convoque au triomphe .
Le monde vu dans une nouvelle théorie est un monde différend.
Vive l’hyper-gauche !
Jean-Louis FEUERBACH
16:46 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théologie politique, philosophie politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 juin 2025
Le philosophe français Marcel Gauchet voit le progressisme se déliter en un autoritarisme technocratique

Le philosophe français Marcel Gauchet voit le progressisme se déliter en un autoritarisme technocratique
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Marcel Gauchet, né en 1946, est considéré en France comme l’un des penseurs les plus stimulants de notre époque. D’après Wikipedia, son œuvre révèle une vision aiguë des enjeux tels que les conséquences politiques de l’individualisme dominant, la relation entre religion et démocratie, et les dilemmes de la mondialisation. Dans son récent essai Le Noeud démocratique, il tire une fois de plus la sonnette d’alarme, car la démocratie occidentale risque de se transformer en un autoritarisme éclairé, refusant d’écouter la voix du peuple.
Gauchet part de la définition classique de la démocratie, avec la souveraineté populaire comme fondement. Une souveraineté qui se manifeste lors des élections. Mais ce principe se voit concurrencé par une démocratie dirigée par des juges, où les décisions politiques sont filtrées ou même dictées par des décisions judiciaires. Sous prétexte de protéger les droits fondamentaux, on marginalise, par voie judiciaire, des majorités électorales, soupçonnées de basculer dans le « populisme ». Une caste judiciaire est ainsi placée au-dessus de la légitimité du peuple.

Les figures politiques dérangeantes sont éliminées — le débat démocratique disparaît.
De la Roumanie à l’Allemagne, en passant par la France et les États-Unis, on observe l'émergence d'une certaine logique: les tribunaux sont utilisés pour neutraliser les figures politiques qui dérangent l’établissement. Trump, Marine Le Pen ou Weigel: des pans entiers de l’électorat sont effacés, en invoquant toutes sortes de raisons techniques. Le philosophe Marcel Gauchet estime que cette manière rend impossible tout débat démocratique sur des thèmes comme l’immigration, la sécurité ou la souveraineté nationale. Ce n’est pas une renaissance démocratique, mais le symptôme d’une démocratie qui a peur de son propre peuple, de ses propres électeurs.
La démocratie moderne est dominée, selon l’auteur, par un individualisme démesuré, au point que sa dimension collective — et, en lien, l’intérêt général — disparaissent totalement du radar. Le lien entre droits fondamentaux et volonté du peuple s’efface. Les élites technocratiques refusent toute remise en question de leur vision du progrès. Si le peuple s’écarte de cette ligne, il est considéré comme une anomalie qu’il faut corriger, voire exclure totalement du processus décisionnel.
Gauchet lance une nouveau cri d’alarme, et il est une voix très crédible en France. Mais les élites technocratiques et progressistes l'écouteront-elles ?
19:01 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel gauchet, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, livre, démocratie, gouvernement des juges |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 juin 2025
Réflexions sur la souveraineté, la main gauche et les machines de guerre

Réflexions sur la souveraineté, la main gauche et les machines de guerre
Juan Gabriel Caro Riviera
La souveraineté a deux facettes : l'une chaotique et guerrière, l'autre ordonnée et législative. De Mitra-Varuna à Romulus-Numa, l'histoire montre comment les sociétés oscillent entre l'élan dionysiaque de la conquête et la stabilité apollinienne de la loi. En explorant les mythes indo-européens et l'oeuvre de penseurs tels que Dumézil, Evola et Deleuze, Juan G. C. Riviera enquête sur les « machines de guerre » qui défient l'État et propose une relecture de la tradition pour faire face à la stagnation moderne.
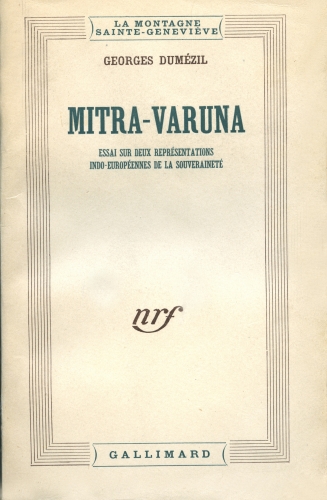
Les premiers sont les dieux dont la fonction est le conflit et autour desquels s'organisent les ligues masculines conquérantes (Mannerbünde) qui, par le biais de rituels statiques, de l'usage de drogues et d'activités militaires, se constituent en bandes armées qui établissent leur domination sur un temps et un lieu déterminés. Lorsque ces bandes anarchiques parachèvent leurs conquêtes, des pactes sont établis qui norment la terre, délimitent l'espace et segmentent le monde pour l'organiser. Cette deuxième étape est dominée par les dieux dont la souveraineté s'exprime à travers le nomos, la loi, et qui établissent une certaine tradition basée sur les coutumes et la morale particulières des habitants d'un lieu.
Selon Dumézil, ce schéma se retrouve chez les hindous et la division entre les ghandarvas et les brahmanes ou chez les Romains dans leur division entre Lupercalia et Flamins. Dans la tradition hindoue, les ghandarvas sont des guerriers sans loi qui mangent de la viande, consomment des drogues et font des choses que les brahmanes ont l'interdiction de faire en raison des lois strictes imposées à leur caste. Il en allait de même pour les Lupercales romaines, qui étaient en quelque sorte une représentation anarchique de la fondation de Rome et qui ont progressivement perdu leur place jusqu'à être réduites à une fête et à un culte de la fertilité.


Dans le cas de Rome, la différence entre les Lupercales et les Flamines est établie dans l'histoire de la fondation de la ville par le duo Romulus-Numa. Romulus est le fils d'une louve, un chef guerrier qui rassemble autour de lui des bandits, des voleurs et des criminels pour établir les limites de Rome. Romulus tue son frère, enlève des femmes sabines pour obtenir des épouses pour ses hommes et mène toutes sortes d'expéditions militaires pour piller la région environnante. Après la mort de Romulus, Numa prend sa place, étant tout le contraire du premier. Contrairement à Romulus, Numa rédige des lois, organise l'espace de la ville, distribue des terres, enseigne le culte des dieux, établit le calendrier et fixe les directives de la vie civique. Romulus est représenté comme un jeune homme, tandis que Numa est représenté comme un vieil homme.

Dans ces exemples mythiques et historiques, nous pouvons trouver les deux fonctions de la souveraineté: l'une basée sur la partie maudite, la transgression et l'ouverture (Georges Bataille) et l'autre basée sur l'état d'exception, l'ordre et la fermeture (Carl Schmitt). La première est ce que nous pourrions appeler la voie dionysiaque et la seconde, une forme apollinienne. Ces deux aspects de la souveraineté sont complémentaires et ne peuvent être considérés comme opposés l'un à l'autre. En fait, on pourrait dire qu'ils se produisent en grande partie en parallèle, et que chaque société oscille entre les deux pôles. Toute société passe par une période de fermeture, de hiérarchie, de tension et d'ordre, mais aussi par une période d'ouverture, de déstructuration, de relâchement et de désordre.
On pourrait dire que les dieux et les chefs militaires, réunis autour des ligues masculines (Mannerbünde), sont les représentants de la Main gauche, tandis que les dieux législatifs et contractuels sont les représentants de la Main droite. Ce qui est interdit aux adeptes de la Main droite est permis aux adeptes de la Main gauche. La seule façon de rétablir un monde traditionnel, à une époque où tous les éléments qui ont rendu possible la Main droite ont disparu, est précisément d'aborder les fondements de la Main gauche et d'éveiller nos facultés dionysiaques atrophiées par la civilisation contemporaine.
Ces réflexions ont sans aucun doute inspiré de nombreux grands chercheurs et penseurs du 20ème siècle, tels que Julius Evola et Mircea Eliade, qui ont tenté de reconstruire les rituels chamaniques des anciennes ligues masculines indo-européennes avec leurs cultes du loup, leurs guerriers vêtus de peaux d'animaux qui se transformaient en ceux-ci et l'utilisation de masses guerrières et de techniques de guerre inspirées par le comportement de ces différentes espèces d'animaux. Le mythe de Zalmoxis, étudié par Eliade, montre que les anciens Romains, les Daces et les Mongols se considéraient comme les descendants des loups. Zalmoxis, le Hercule dace, était aussi un représentant de ces rites chamaniques.
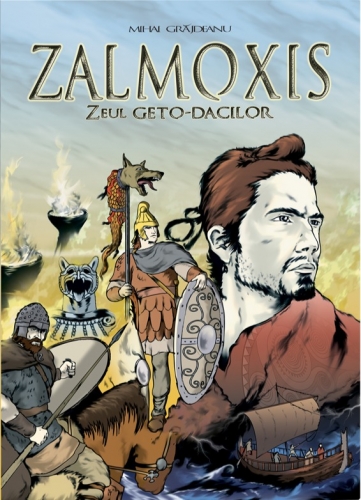
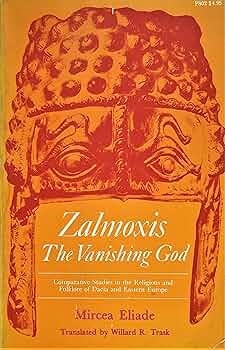
En ce sens, les Mannerbünde et leurs défenseurs (Evola, Blüher, Wikander, Höfler, Eliade et autres) voulaient revenir à la religion originelle des Indo-Européens, qui était basée sur un culte dont les principales caractéristiques sont la vénération des morts, les festivals sacrificiels orgiaques, le lien avec les organisations martiales et une attitude positive envers les forces obscures et démoniaques de la vie, où ses adeptes utilisaient une masse et combattaient au corps à corps avec des animaux sauvages. Les Ghandarvas hindous, les Maruts iraniens, les centaures grecs et les Berserkers nordiques sont des exemples de ces confréries masculines.

On peut certainement affirmer ce qui suit: tandis que dans la tradition du Sud (l'hindoue, la grecque, la romaine, etc.), le culte des dieux législateurs a fini par prédominer, dans la tradition du Nord, le culte des dieux anarchiques tels qu'Odin a perduré beaucoup plus longtemps et les confréries masculines ont joué un rôle important jusqu'à une période historique avancée. Cependant, on peut dire que la Voie de la Main Gauche ne s'est jamais totalement établie dans les sociétés du Sud, mais le fait que des cultes tels que ceux de Dionysos et de Shiva aient toujours refait surface en est la preuve a contrario. Il en va de même pour d'autres traditions.
Il est intéressant de noter que des auteurs postmodernes tels que Deleuze et Guattari, dans Mille Plateaux, consacrent un chapitre entier à l'analyse de Mitra-Varuna par Dumézil, intitulé « Traité de nomadologie : la machine de guerre ». Deleuze et Guattari soutiennent que les dieux indo-européens tels que Mitra et Varuna ne contrôlent pas leurs propres machines de guerre (leurs guerriers), mais ont tendance à conclure des pactes avec des guerriers indépendants et indomptables, tels qu'Indra, qui ont leurs propres lois et règles. Les guerriers sont indépendants des pactes et des rites promus par les dieux anarchiques et législatifs et établissent des relations avec ces derniers pour différentes raisons. Le guerrier Indra peut libérer des individus asservis par des dettes et établir ses propres lois selon ses idées.

La machine de guerre est extérieure à l'État et aux lois les plus strictes de la civilisation. Alors que le Dieu législateur ordonne et organise le monde pour attribuer à chaque personne sa place, la machine de guerre est nomade et en mouvement constant. Deleuze et Guattari considèrent que la science de l'État est la science de l'immobilité, du lourd, du macro, tandis que la science de la machine de guerre est la science du mouvement, du pouvoir et des forces agissantes. Ici, Deleuze et Guattari s'inspirent largement des idées de Nietzsche et considèrent les conquêtes mongoles, l'expansion de l'islam et les constructeurs de cathédrales gothiques comme différentes incarnations de cette « science mineure » nomade basée sur la force et le mouvement.

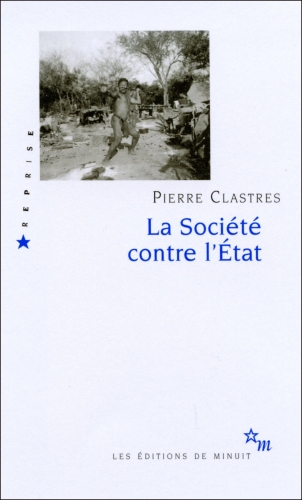
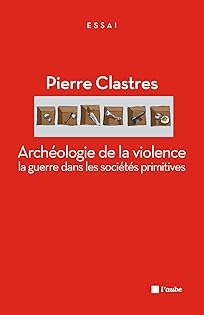
En ce sens, l'anthropologie anarchique de Pierre Clastres et la nomadologie de Deleuze-Guattari constituent une analyse intéressante des ligues masculines et des machines de guerre politiques. Les ligues masculines ne sont pas nécessairement identifiées à l'État, même si dans certains cas, les rois ou les empereurs sont issus de ligues masculines. Dans certains cas, ces ligues masculines deviennent la garde qui protège le roi de ses ennemis, mais elles peuvent aussi être les principales instigatrices de guerres civiles. Lorsque les machines de guerre sont interdites et persécutées par l'État, elles peuvent finir par devenir des gangs criminels, voire terroristes, qui attaquent les formations ordonnées par l'État.
De ce point de vue, nous pouvons dire que notre objectif actuel doit être de faire revivre les machines de guerre comme moyen de détruire le monde moderne, en unissant le prémoderne et le postmoderne, l'archaïque et le futur. Promouvoir la figure du héros tragique, qui affronte son destin, est le seul moyen de mettre fin à la stagnation actuelle.
14:38 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, philosophie, georges dumézil, mircea éliade, gilles deleuze, félix guattari, pierre clastres, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 juin 2025
Alasdair MacIntyre est mort. Hommage

Alasdair MacIntyre est mort. Hommage
par Roberto Pecchioli
Source: https://telegra.ph/In-morte-di-Alasdair-Mc-Intyre-06-02
Si nous pensons à la phrase qui a le plus marqué notre formation personnelle, nous citons volontiers José Ortega y Gasset et son formidable « Je suis moi et mes circonstances », la prise de conscience que chaque individualité est marquée par le lieu, le temps, l'environnement et la culture dans lesquels elle s'est formée. Si nous devions citer le texte contemporain qui nous a le plus influencés dans une vie de lectures voraces, variées, irrégulières, contradictoires, entre fiction, poésie, histoire, art, sociologie et philosophie, nous n'aurions aucun doute : il s'agit de Après la vertu d'Alasdair MacIntyre, Écossais expatrié aux États-Unis, marxiste dans sa jeunesse, puis philosophe aristotélo-thomiste qui a embrassé la foi catholique à maturité.
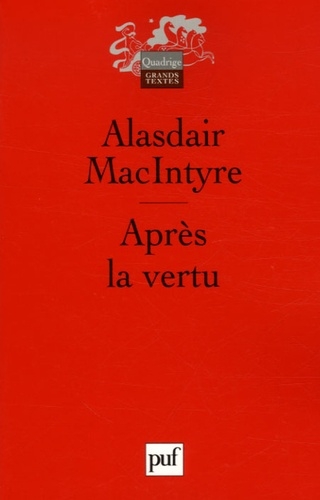 Il y a quelques jours, le vieil Alasdair – né en 1929 – est décédé, atteignant le but résumé dans la phrase placée en exergue de son œuvre majeure : Gus am bris an la, une expression que l'on trouve sur de nombreuses tombes celtiques: « en attendant que le soleil se lève et que les ombres de la nuit se dissipent ». En gaélique, pour souligner les origines et l'enracinement tenace du penseur né à Glasgow.
Il y a quelques jours, le vieil Alasdair – né en 1929 – est décédé, atteignant le but résumé dans la phrase placée en exergue de son œuvre majeure : Gus am bris an la, une expression que l'on trouve sur de nombreuses tombes celtiques: « en attendant que le soleil se lève et que les ombres de la nuit se dissipent ». En gaélique, pour souligner les origines et l'enracinement tenace du penseur né à Glasgow.
MacIntyre a remis la philosophie morale au centre du débat, il a redonné de la force au débat sur les fins, sur la « bonne » vie, sur les principes premiers – et donc ultimes – à la base de l'aventure de la vie, sur le concept de vertu, abandonné par l'Occident en décomposition au profit des droits, du relativisme, du nihilisme, résultat inévitable de la mort de Dieu. Le philosophe écossais a été hâtivement classé (dans la frénésie postmoderne à fabriquer de la taxonomie, à procéder à l'attribution d'étiquettes) parmi les penseurs « communautaristes », une manière précipitée et restrictive de juger son œuvre. Lui, philosophe moral, a toujours rejeté l'association à l'école communautariste – plus politico-sociologique que métaphysique – apparue dans les années 80 aux États-Unis. Non pas que McIntyre ne soit pas aussi un communautariste – c'est-à-dire un critique de l'individualisme libéral et de l'homogénéisation culturelle qui rejette les identités et les racines – mais il était bien plus que cela : un philosophe qui a remis au centre la métaphysique, l'idée du bien commun, la recherche des fins de l'existence (le telos) et les moyens de les atteindre.
Nous nous souvenons avec gratitude de ce géant de la pensée contemporaine dont le seul tort fut de ne pas adhérer à l'orthodoxie marxiste, libérale et progressiste, et qui s'est mis à la recherche d'une philosophie pérenne. Nous sommes convaincus que l'abandon de la grande leçon de Thomas d'Aquin (et d'Aristote, son père et maître) est à l'origine des défaites culturelles de la tradition dans la contemporanéité.
Après la vertu n'est pas un texte académique, un livre pour philosophes qui discutent entre eux dans une foire d'obscurité linguistique qui cache la pauvreté du contenu. La philosophie morale et politique, en récupérant la tradition des vertus mise à l'écart par l'exaltation des droits, grâce à MacIntyre, remet au centre l'homme concret et son existence, au-delà des abstractions. Elle constitue une piste, un repère pour un projet alternatif à la modernité rationaliste-empiriste d'origine illuministe et au nihilisme libertaire de la postmodernité haletante. MacIntyre travaille « à de nouvelles formes de communauté au sein desquelles la vie morale puisse être soutenue, afin que la civilisation et la morale aient la possibilité de survivre à l'époque naissante de barbarie et d'obscurité ».

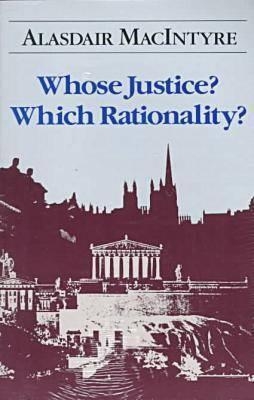
Une position aussi claire, son opposition au libéralisme triomphant et sa critique des professeurs de philosophie verbeuse l'ont conduit à l'isolement culturel, dans un milieu universitaire intoxiqué par le wokisme, les déchets de l'Ecole de Francfort et le nihilisme des « déconstructivistes » que l'on appelle aux États-Unis la « French Theory ». Une contribution spécifique de MacIntyre est la révélation de l'émotivisme contemporain, la tendance à vivre d'émotions immédiates qui ne deviennent pas des sentiments partagés, la conviction que le jugement moral n'est qu'un choix personnel, une préférence individuelle qui ne débouche jamais sur des jugements de valeur généraux. Un élément du relativisme qui homologue tout et soumet tout à la souveraineté subjective. Sans jugement global, cependant, sans ancrage dans des principes communs et solides, sans distinction entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, la vertu et le vice, il n'y a ni communauté ni société.
Des convictions acquises grâce à la lecture quotidienne des textes et des idées de Thomas d'Aquin et d'Aristote, mais aussi d'Edith Stein, puissant esprit philosophique au destin tragique. Une armure idéale qui permet à MacIntyre de rejeter tant l'individualisme libéral que l'économisme et le déterminisme marxistes. Tous deux manquent d'un principe d'évaluation rationnel, « élevé », rendant impossible la construction d'un projet communautaire existentiel. Il n'existe pas de morale abstraite et universelle, mais des coutumes spécifiques et des pratiques inscrites dans un horizon culturel précis. Pour paraphraser Ortega, « nous et nos circonstances ». Les coutumes, les spécificités, les valeurs d'une communauté ne naissent pas de rien ; elles surgissent, se construisent et vivent pour répondre aux défis et aux questions de sens de l'humanité concrète.
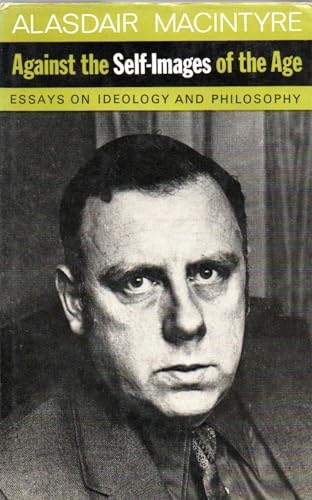
Toutes les morales du passé, contrairement à l'émotivisme inconsistant, possèdent une conception commune de la vertu, c'est-à-dire du bien et de la bonne vie morale. Selon MacIntyre, le moi émotif « manque de tout critère d'évaluation rationnel ». Cela rend impossible la fondation d'une communauté, d'un système partagé, d'un critère de jugement qui résolve les angoisses des hommes, « animaux rationnels dépendants » (le titre d'un de ses ouvrages) à la recherche d'une « éthique dans les conflits de la modernité », thème de son dernier ouvrage. Un passage de ce texte extrême de MacIntyre est éclairant: "nous avons tendance à nous tromper (...) parce que nous sommes trop enclins à être séduits par le plaisir, l'ambition et l'amour de l'argent. La bonne vie peut être décrite comme la capacité à faire de bons choix entre les biens et les vertus nécessaires à la fois pour surmonter et dépasser les adversités, et pour accorder la place qui leur revient (et pas plus) au plaisir, à l'exercice du pouvoir et au gain d'argent". Des mots indigestes tant pour l'homme contemporain en compétition sur le marché, gladiateur du néant, que pour l'homme-masse qui se conforme aux mots d'ordre du pouvoir, dans lesquels la vertu n'est que le conformisme de la consommation et des dépendances, détaché de tout jugement moral, de toute question éthique.
Le thème d'Après la vertu est comment mener une « bonne » vie, à quels principes s'en tenir, ce qui peut être appelé vertu à une époque qui a détrôné la vertu. MacIntyre est également communautariste (même s'il s'en défend), un proche du mouvement philosophico-politique qui reproche au libéralisme d'avoir créé une société individualiste, composée d'individus atomisés et déracinés, dépourvus de liens et de traditions sociales; une société condamnée à l'amoralité, car la moralité est un ensemble de critères socioculturels non individuels qui encadrent la bonne vie. MacIntyre, contrairement aux libéraux et aux progressistes, est très critique à l'égard de la modernité. Sa vision s'appuie sur les contributions de l'aristotélisme et du thomisme et intègre certains points de la critique marxiste de l'individualisme et du libéralisme. Il prévient que, même si le marxisme peut aider à identifier certaines lacunes de la modernité, sa critique n'est pas adéquate, car elle est issue du même contexte et repose sur les mêmes prémisses.

Pour MacIntyre, Aristote et Thomas d'Aquin représentent l'alternative la plus appropriée pour critiquer l'ordre social et culturel de la modernité. La tradition aristotélicienne-thomiste implique une conception de la nature humaine qui exige des préceptes inhérents à l'éthique rationnelle, c'est-à-dire aux vertus; c'est une vision de la nature humaine qui implique un telos, une fin, la bonne vie. Le philosophe écossais conclut que les Lumières ont échoué dans leur tentative de fonder une moralité rationnelle en raison de l'absence de fondements spirituels et d'une conception finaliste de l'existence humaine. Nietzsche a marqué l'apogée du projet de la modernité: la moralité n'était plus une question de raison, mais de volonté. La culture morale de la modernité est une succession de désaccords, de conflits de volontés, dont le résultat est l'émotivisme. Les jugements moraux ne sont que l'expression de sentiments personnels et subjectifs qui rejettent toute prétention d'objectivité, dont le fondement est un « moi démocratisé » dépourvu d'identité sociale.
L'éthique moderne – si elle existe – est laïque, irréligieuse, universelle, indépendante des contextes sociaux et culturels: abstraite. La société moderne repose sur deux aspects apparemment contradictoires, mais en réalité complémentaires: la bureaucratie et l'individualisme. Tous deux garantissent que le sujet se comporte selon des paramètres « émotivistes ». Les personnages caractéristiques de la modernité sont l'esthète riche, dont l'objectif est le triomphe de ses intérêts matériels ; le manager axé sur l'efficacité ; le thérapeute qui doit transformer les symptômes névrotiques en énergie hétérodirigée ; le moraliste conservateur, un libéral prudent qui cache ses intérêts derrière une rhétorique pompeuse. À tout cela s'ajoutent, dans le cadre moral moderne, les « droits de l'homme » sans fondement, produits de l'absence d'un modèle rationnel parmi les différentes modalités de l'éthique moderne.
Sur la base de ce diagnostic, MacIntyre est très critique à l'égard de la réalité sociale et politique occidentale. La démocratie libérale est le royaume des forces économiques, un système dans lequel le pouvoir est réparti de manière terriblement inégale. Bien qu'un principe d'égalité soit affirmé (un individu, une voix), les alternatives ne sont pas déterminées par la majorité. L'influence des groupes de pression, des experts, des médias et de l'argent est décisive. Comme alternative, MacIntyre propose la tradition néo-aristotélicienne-thomiste, fondée sur trois prémisses fondamentales: le bien commun, le raisonnement pratique et le bonheur.
Le bien commun exclut la compétition extrême pour la réussite personnelle. Il implique une éthique communautaire dans laquelle la morale fait partie de la politique: l'homme est avant tout un « animal politique » (Aristote) et non un individu. En ce sens, le « raisonnement pratique » suppose que ce n'est pas le jugement subjectif qui a le dernier mot, mais l'éducation aux vertus qui corrigent les tendances négatives de la nature humaine.
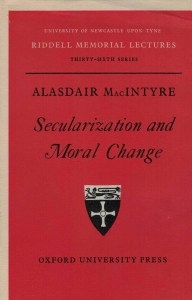 Le bonheur n'est pas lié aux intérêts individuels, mais à un mode de vie dans lequel les capacités physiques, morales, esthétiques et intellectuelles de la personne se développent de manière à atteindre son but, une vie bonne et vertueuse. Dans cette conception philosophico-politique, l'éthique est enracinée dans des contextes sociaux et culturels distincts. Pour MacIntyre, le patriotisme est une vertu parce que les hommes ont besoin d'appartenir à des communautés historiques, tant pour la formation de leur identité personnelle et culturelle que pour leur développement moral. À gauche , l'approche de MacIntyre semble réactionnaire. À droite, elle est largement méconnue, car l'individualisme libéral et l'amoralisme commercial y dominent. Son œuvre reste essentielle pour construire une alternative morale – avant même d'être sociale, économique ou politique – aux contradictions d'une société atomisée, sans centre ni colonne vertébrale.
Le bonheur n'est pas lié aux intérêts individuels, mais à un mode de vie dans lequel les capacités physiques, morales, esthétiques et intellectuelles de la personne se développent de manière à atteindre son but, une vie bonne et vertueuse. Dans cette conception philosophico-politique, l'éthique est enracinée dans des contextes sociaux et culturels distincts. Pour MacIntyre, le patriotisme est une vertu parce que les hommes ont besoin d'appartenir à des communautés historiques, tant pour la formation de leur identité personnelle et culturelle que pour leur développement moral. À gauche , l'approche de MacIntyre semble réactionnaire. À droite, elle est largement méconnue, car l'individualisme libéral et l'amoralisme commercial y dominent. Son œuvre reste essentielle pour construire une alternative morale – avant même d'être sociale, économique ou politique – aux contradictions d'une société atomisée, sans centre ni colonne vertébrale.
On cite souvent une phrase symbolique d'un auteur, qui résume toute son œuvre. Pour Alasdair MacIntyre, le dernier paragraphe de Après la vertu reste inégalé. « Si la tradition de la vertu a pu survivre aux horreurs de la dernière période sombre, nous ne sommes pas totalement dépourvus de fondements pour espérer. Cette fois-ci, cependant, les barbares n'attendent pas au-delà des frontières: ils nous gouvernent déjà depuis longtemps. Et c'est notre inconscience de ce fait qui constitue une partie de nos difficultés. Nous n'attendons pas Godot, mais un autre Saint Benoît, sans doute très différent ».
18:13 Publié dans Hommages, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alasdair macintyre, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, aristotélo-thomisme, vertu |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 31 mai 2025
Le déclin du marxisme
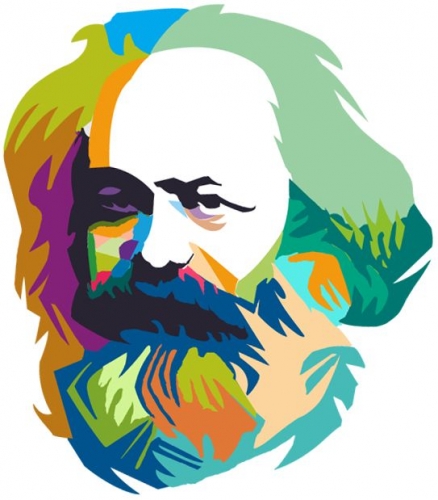
Le déclin du marxisme
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/the-decline-of-marxi...
J'ai souvent expliqué pourquoi je rejette complètement la notion extrêmement réductrice de « marxisme culturel », l'une des tentatives les plus malhonnêtes de la droite pour trouver des excuses aux maux multiples de la société capitaliste. Mais si les think tanks de gauche tels que l'école de Francfort ont clairement beaucoup à se reprocher et ont sans aucun doute joué un rôle crucial dans la formulation idéologique et la mise en pratique finale de la gauche au cours du 20ème siècle, il est beaucoup trop simpliste d'imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'il y ait jamais eu une chaîne ininterrompue de déclin socioculturel directement attribuable à l'école de Francfort seule ou aux marxistes en général.
Une façon de réfuter la prétendue suprématie du marxisme dans le domaine universitaire, par exemple, consiste pour les jeunes à se familiariser avec certaines des œuvres politiques et biographiques produites dans les années 1970. Les marxistes ont certes exercé une influence dans de nombreuses universités européennes, ce qui a culminé avec les célèbres émeutes étudiantes de 1968, mais il serait beaucoup trop facile de suggérer qu'ils ont fait tout ce qu'ils voulaient ou de négliger l'opposition concomitante et, en fait, conséquente au marxisme lui-même.
De nombreux écrivains et commentateurs sociaux du début des années 1970, sans doute dans le cadre d'une réponse capitaliste orchestrée au marxisme et à son emprise sur les jeunes esprits intellectuels au cours de la décennie précédente, se sont mis à critiquer et à démanteler certains des principaux représentants des idées de gauche, qu'ils soient marxistes de la vieille école, existentialistes, structuralistes, nouveaux gauchistes, déconstructionnistes, post-structuralistes ou postmodernistes. Je ne parle pas non plus d'une poignée d'auteurs obscurs, car un effort concerté et collectif a été déployé par de nombreux éditeurs grand public pour annuler complètement et rendre obsolètes les effets les plus dangereux du marxisme, et ce qui était autrefois considéré comme extrême a rapidement dégénéré en l'apanage de l'un ou l'autre professeur aux cheveux blancs qui pouvait nourrir quelques opinions de gauche et produire des textes marxistes bizarres, mais qui ne risquait jamais de semer la zizanie sur le campus en mettant en péril sa position confortable au sein du département des sciences humaines.
Le marxisme, autrefois perçu comme une menace sérieuse par nos maîtres capitalistes, ou du moins présenté comme tel, est aujourd'hui devenu un dinosaure idéologique en faillite, toléré uniquement dans la mesure où il n'est jamais autorisé à perturber le bon fonctionnement quotidien de l'économie. En bref, le marxisme est devenu une soupape de pression utile. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir une perspective plus réaliste et semi-objective sur l'influence perçue du marxisme, ainsi que sur ses diverses permutations philosophiques, essayez de lire quelques textes anciens afin d'examiner la manière dont il a été effectivement mis à l'écart à la suite de ce printemps parisien qui fut si exaltant pour d'aucuns. Comme la plupart des illusions courantes, le spectre d'un marxisme éternel et vigoureusement influent n'existe vraiment que dans les esprits.
12:17 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marxisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 mai 2025
La Chine et le retour de Confucius

Présentation de « La Chine et le retour de Confucius »
Carlo X. Blanco
Source: https://www.hiperbolajanus.com/posts/presentacion-china-r...
Nous présentons ici « La Chine et le retour de Confucius », une compilation éditée par Carlos X. Blanco. Le livre explore le confucianisme aux 20ème et 21ème siècles, ses défis, ses transformations et sa revitalisation dans la Chine contemporaine, en soulignant son rôle culturel, social et politique.
Nous avons le plaisir de présenter à notre public de lecteurs l'ouvrage La Chine et le retour de Confucius, une compilation d'articles du prestigieux professeur Carlos X. Blanco, auteur prolifique et collaborateur du groupe Hipérbola Janus, où nous sommes honorés et gratifiés par ses contributions à la diffusion de différents sujets et domaines de connaissance. En l'occurrence, l'Extrême-Orient reste une grande inconnue pour nous, Européens, surtout en ce qui concerne la mentalité et les idées qui animent la vision du monde de la nation la plus représentative, dont la puissance économique, commerciale et géopolitique l'a hissée au rang de superpuissance mondiale, nous parlons évidemment de la Chine. Sous une forme légère et agréable, celle du dialogue, l'ouvrage nous présente une série de textes qui nous permettent de percer les clés de la pensée confucéenne et de son évolution tout au long des 20ème et 21ème siècles. Un bref avant-propos de David Ownby sert d'introduction au livre. L'un des principaux essais est « Un siècle de confucianisme » de Chen Lai (1952), qui structure l'analyse en trois sections principales: les défis du confucianisme, ses réponses et la manière dont il a survécu à l'ère moderne.

L'analyse du confucianisme, qui reste fortement ancré dans la conscience du peuple chinois, aborde quatre défis majeurs, qui sont énumérés ci-dessous :
- Les réformes politiques et éducatives de l'ère Qing et de l'ère républicaine (1901-1912): l'abolition du système des examens impériaux a affaibli la base institutionnelle du confucianisme, affectant son rôle dans la société et l'éducation.
- Mouvement de la nouvelle culture (1915-1919): la modernisation fondée sur la culture occidentale est encouragée, le confucianisme étant considéré comme un obstacle au progrès.
- Révolution de 1949 et révolution culturelle (1966-1976): la collectivisation et les communes populaires détruisent la base sociale confucéenne, tandis que la révolution culturelle l'attaque sur le plan idéologique.
- Réformes de Deng Xiaoping (à partir de 1978): la modernisation et l'économie de marché ont réduit l'influence des valeurs confucéennes face au pragmatisme et à l'utilitarisme.
Auparavant, le confucianisme avait toujours été un facteur de cohésion nationale, contribuant à préserver l'unité du peuple chinois, notamment face aux menaces extérieures, comme la confrontation avec le Japon dès le début des années 1930, avec l'occupation japonaise de la Mandchourie, et les épisodes successifs de guerre contre le Japon entre 1937 et 1942.

Pour toute commande: https://www.hiperbolajanus.com/libros/china-regreso-confu...
Le texte de Chen Lai prend pour point de départ les dernières années de la dynastie Qing et les premières années de l'ère républicaine, entre 1901 et 1912, en mettant particulièrement l'accent sur le processus de modernisation entrepris durant cette période, avec l'introduction des sciences et disciplines occidentales, qui a contribué à la mise à l'écart des classiques confucéens.
Ce processus s'est déroulé en plusieurs étapes, avec l'abolition du système des examens impériaux, qui avait été pendant des années le pilier institutionnel du confucianisme, ce qui a eu pour conséquence inévitable que les érudits confucéens ont abandonné leur rôle central dans la société chinoise. La tendance à dénigrer la tradition confucéenne s'est accentuée avec le passage de la dynastie Qing aux premières années de la République, comme en témoignent l'élimination des cérémonies sacrificielles en l'honneur de Confucius et l'interdiction de l'étude obligatoire des classiques confucéens. Le confucianisme a ainsi perdu son rôle prépondérant dans l'éducation et l'administration publique et a été relégué dans le domaine de l'éthique et de la culture.
Ce processus de rejet et d'érosion du confucianisme dans son rôle de contribution à l'identité nationale chinoise et à la formation de la jeune génération s'est accéléré au cours des décennies suivantes. Ce processus a été conduit par des intellectuels tels que Chen Duxiu et Hu Shih, qui ont activement promu la modernisation et l'adoption de valeurs occidentales telles que la science et la démocratie. Adoptant des positions analogues à celles de l'Occident par rapport à la Tradition, ils ont considéré le confucianisme comme une forme de pensée arriérée et dépassée, totalement opposée au progrès, et donc jetable, ses enseignements n'ayant aucune valeur opérationnelle pour le développement de la Chine.
En conséquence, le confucianisme a été culturellement et intellectuellement mis à l'écart.

Avec l'avènement de la révolution culturelle chinoise et la formation du régime communiste de 1949 à la mort de Mao Tsé Toung (1893-1976), la situation du confucianisme ne s'est pas améliorée et, au contraire, il a été considéré comme incompatible avec le socialisme marxiste. Les attaques se multiplient et le confucianisme fait l'objet de campagnes de haine brutales, comme la « Critique de Lin Biao et de Confucius » de 1973 à 1976, qui l'accuse d'être une « idéologie féodale et réactionnaire ». La destruction des temples confucéens et la persécution des intellectuels confucéens étaient monnaie courante durant cette période.
Dans la période qui suit immédiatement, à partir de 1978, le facteur idéologique s'atténue avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping (1904-1997), au profit d'une ère marquée par le pragmatisme et l'importance croissante du développement économique et matériel. Les attaques contre le confucianisme ont largement cessé, mais celui-ci a été soumis à la logique unificatrice de l'utilitarisme et de la croissance économique.


Kang Youwei et Liang Shuming
Cependant, malgré les attaques continues contre le confucianisme, Chen Lai met en évidence la résilience du confucianisme, sa volonté inflexible face à la menace de sa disparition, à travers les propositions de divers penseurs confucéens contemporains. C'est le cas, par exemple, de Kang Youwei (1858-1927) avec ses propositions de faire du confucianisme une religion officielle ou de l'intégrer dans le modèle éducatif avec ses enseignements moraux pour l'ensemble du peuple chinois. D'autres philosophes, comme Liang Shuming (1893-1988), ont tenté de surmonter les antithèses du monde moderne et de faire de la doctrine confucéenne un élément fonctionnel du socialisme grâce à ses fondements moraux et sociaux, car il voyait dans ces idées la clé de l'harmonie et de la stabilité sociale, comme cela avait été le cas dans les moments les plus délicats de l'histoire du grand pays asiatique.
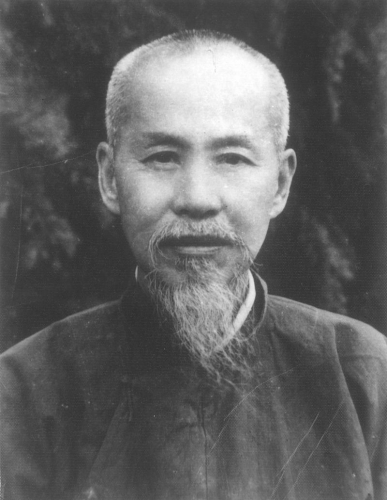

Xiong Shili et Feng Youlan
Parallèlement, des intellectuels confucéens tels que Xiong Shili (1885-1968), Feng Youlan (1895-1990) et He Lin (1902-1992) ont tenté d'apporter de nouveaux développements à la doctrine confucéenne dans les domaines de la philosophie et de la métaphysique. Ces spéculations ont donné naissance à de nouvelles écoles, telles que la « nouvelle philosophie des principes » de Feng Youlan et la « nouvelle philosophie de l'esprit » de He Lin. De nouvelles tentatives d'intégration entre les valeurs traditionnelles et le socialisme marxiste ont également vu le jour grâce aux interprétations de Xiong Shili. Ce n'est qu'après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping que le confucianisme a été réévalué, subissant un révisionnisme qui l'a finalement ramené dans les universités et la société chinoises, et à partir de ce moment, son héritage a été récupéré en tant que partie de l'identité nationale.
Ce processus de revitalisation a contribué à l'étude du confucianisme et à l'émergence de nouvelles interprétations au cours des dernières décennies. Les réinterprétations de la pensée confucéenne ont mis la doctrine en contraste avec les idées politico-idéologiques du monde d'aujourd'hui, liées à la « démocratie », aux « droits de l'homme » et à la « mondialisation », c'est-à-dire avec ces éléments idéologiques dont nous souffrons depuis longtemps et qui sont à l'origine de changements dramatiques dans nos sociétés en ce moment même. Cependant, cette récupération du confucianisme ne s'est pas limitée aux sphères les plus cultivées et académiques, mais est également devenue populaire, et sa présence dans la société chinoise s'est accrue depuis les années 1990, comme on le voit à travers la connaissance des classiques confucéens par le biais d'activités et de cours destinés à l'ensemble de la population.
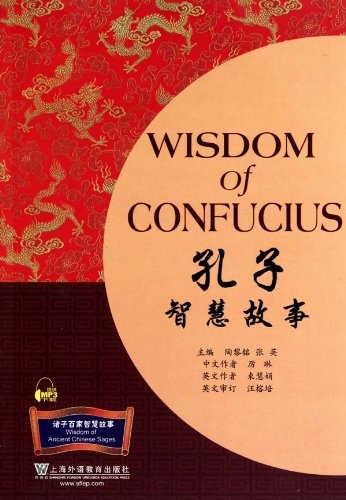
Ainsi, pour Chen Lai, le moment actuel, après la réhabilitation de la pensée confucéenne, est un moment-clé pour continuer à renforcer sa doctrine, notamment en raison de la montée de la Chine en tant que puissance mondiale, qui a conduit à un intérêt croissant pour la Chine et sa culture au-delà de ses frontières. Mais aussi, et au-delà des aspects généraux et plus formels, en raison de son contenu éthique et moral inhérent, qui peut agir comme un frein à la corruption et à la dégradation des temps modernes. Nous pouvons donc affirmer qu'une véritable synergie est possible entre les valeurs traditionnelles et les nouveaux défis que la modernité propose à la Chine, sur un large front, dans les domaines culturel, politique, social, etc.
Dans le deuxième chapitre du livre, Chen Ming, l'une des figures les plus importantes de la résurgence du confucianisme dans la Chine contemporaine, aborde la signification de cette doctrine dans le contexte de l'État et de la nation chinoise au 21ème siècle. Son approche donne un aperçu des aspects politiques, sociaux, éducatifs, culturels, identitaires et religieux du confucianisme, tout en le distinguant d'autres perspectives néo-confucéennes plus orientées vers la philosophie ou l'éthique.

Tu Weiming
Le néo-confucianisme hors des frontières chinoises a diversifié ses courants et ses thèmes, en se concentrant sur le rapport à la démocratie, à la science et, en somme, sur sa compatibilité avec les valeurs du libéralisme occidental. Ces thèmes ne sont pas nouveaux dans les dérives interprétatives et les spéculations confucéennes du siècle dernier. Tu Weiming (1940), philosophe d'origine chinoise naturalisé américain, en est un éminent représentant.
En Chine continentale, le discours confucéen s'est révélé pleinement fonctionnel pour les intérêts de l'État chinois, contribuant à fonder les valeurs de l'État et de la nation, se dissociant de toute recherche de compatibilité avec les valeurs occidentales et, à son détriment, essayant de renforcer l'identité culturelle chinoise en s'affichant ouvertement comme un pilier fondamental du nationalisme culturel et politique du pays. Ainsi, Chen Ming ne considère pas la doctrine confucéenne comme un ensemble d'idées abstraites et anachroniques, mais comme un potentiel en devenir permettant de renforcer les fondements de l'État et de la société chinoise dans le monde d'aujourd'hui.
Son analyse du confucianisme par rapport à la religion est également importante, car elle différencie ses éléments de toute forme de religion monothéiste telle que nous la concevons en Occident. Néanmoins, il y a un élément religieux dans son origine, et l'idée d'un Dieu (Shangdi ou Tian) en tant que créateur et colonne vertébrale d'un ordre moral. On peut dire que Confucius a transformé cette pensée en une pratique fondée sur l'éthique et la vertu, mais sans en éliminer la dimension spirituelle. Certains interprètes modernes de la doctrine ont tenté d'en dénaturer le contenu en la réduisant à ce que l'on appelle en chinois le « wenjiao » (enseignement culturel), cherchant une formule de sécularisation pour la vider de son contenu transcendant. Selon Chen Ming, ces tentatives de sécularisation ont été perpétrées par le Mouvement du 4 mai à partir de 1919.

Il faut cependant insister sur le fait que le confucianisme, tout en possédant une dimension spirituelle, ne doit pas être confondu avec notre concept de religion, et que l'accent doit être mis sur l'idée de structure morale et sociale, comme une sorte de guide moral et spirituel qui agit comme un antidote à la crise des valeurs si caractéristique de l'époque moderne. Le texte de Chen Ming aborde également d'autres questions que nous ne pouvons décomposer dans cette présentation en raison de leur ampleur et de leur complexité, comme par exemple la relation entre le confucianisme et l'État, l'athéisme du parti communiste chinois, la recherche de formes d'intégration et de synthèse, la cohésion sociale, le problème de l'éducation, etc. Les idées confucéennes sont remises en cause dans la mesure où cette recherche d'insertion dans la Chine contemporaine pose une série de défis qui mettent en péril l'essence même de sa tradition.
Le dernier chapitre du livre est réservé à un entretien entre Chen Yizhong et Chen Ming dans lequel toutes les questions abordées dans les chapitres précédents sont traitées sous la forme d'un dialogue approfondi. Nous assistons à une confrontation entre une multitude d'arguments sur le confucianisme et sa relation avec la modernité, avec les défis de l'avenir, avec les tensions et les réticences soulevées par les valeurs libérales et occidentales, totalement sécularisées et, nous le disons, vouées à la destruction de tout fondement traditionnel, ethnique ou spirituel à tous les niveaux.
15:25 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, confucianisme, confucius, chine, tradition, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Théologie politique: la politique comme religion des modernes

Théologie politique: la politique comme religion des modernes
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/teologia-politica-la-politica-com...
À la lumière de l'herméneutique mobilisée par Schmitt, c'est dans le Léviathan de Hobbes (1651) que le dispositif de la politische Theologie (théologie politique) apparaît opératoire dans sa splendeur originelle. Mais ce n'est qu'à partir du système catégoriel de Rousseau que le modèle de la théologie politique commence à s'articuler selon une dichotomie qui prélude à celle entre la droite et la gauche apparue avec la Révolution française.
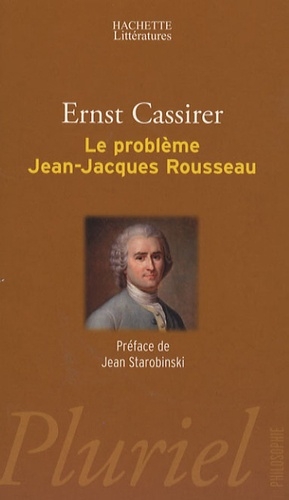 C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.
C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.
La société qui a produit le mal - l'aliénation et l'exploitation, l'inégalité et la propriété privée, comme l'affirme déjà Rousseau dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) - est également appelée à se racheter par la politique. Puisque, comme l'affirme le Contrat social (1762), l'homme est né libre et partout il est dans les fers, c'est une exigence fondamentale de la politique que de travailler à rendre à l'homme sa liberté en brisant les chaînes qui ont été créées par l'évolution historique.
Pour Rousseau, précisément parce que le mal n'est pas co-essentiel à la nature humaine et ne coïncide pas avec une condamnation sanctionnée ab aeterno par Dieu, c'est la tâche ambitieuse de la politique de rectifier l'injustice et de libérer la société du mal, en instaurant l'égalité entre les hommes et la démocratie directe comme forme de gouvernement.
Il est vrai, cependant, que Rousseau se place dans le cadre « contractualiste » des modernes et, bien qu'il aspire à une communauté de solidarité et de rédemption, il part de l'hypothèse anthropologique trompeuse de l'individu comme préexistant à l'État (compris à son tour - dirait Hegel - comme le fruit d'un « contrat » conçu selon les modules du « contrat privé »). Le Discours sur l'origine de l'inégalité de 1755 distingue l'inégalité naturelle - celle qui, par exemple, différencie les hommes par l'intelligence et la puissance physique - de l'inégalité conventionnelle, qui « dépend d'une sorte de convention, et est établie ou du moins permise par le consensus des hommes ». Il faut agir pour éliminer la seconde et neutraliser les effets de la première.

Fichte, dans ses cinq conférences d'Iéna sur le destin des sages en 1794, n'apportera pas de modifications majeures à ce programme. Il se contentera d'insister davantage sur la dimension de l'avenir comme espace ouvert à sa réalisation par l'action passionnée d'un Sujet conscient (je) capable, sous la conduite intelligente du « sage » (der Gelehrte), de redéfinir l'Objet (non-moi) en fonction de la raison.
Nous avons ainsi la genèse de la « théologie » moderne de la politique divisée entre gauche et droite, bien que le lexique de Rousseau ne mentionne pas encore expressément le clivage (la division) qui n'émergera qu'avec le choc de 1789. La gauche est le parti qui aspire à corriger un mal - l'inégalité entre les hommes et les pathologies qui lui sont associées - qui est social, c'est-à-dire produit par la société et rachetable par sa propre praxis. La droite, quant à elle, réagit en réaffirmant la nature de l'ordre existant, dont elle s'érige en gardienne: l'inégalité, qui pour la gauche est une erreur sociale à laquelle il faut remédier, apparaît à la droite comme la condition naturelle, toujours donnée, voulue par Dieu ou, en tout cas, nécessairement produite par les relations entre ces entités belligérantes et réciproquement hostiles que sont les hommes, tels des loups.
Cette reconstruction permet, entre autres, de comprendre pourquoi la gauche est « originaire » et la droite « dérivée ». La seconde est « réactionnaire », car elle répond à la mobilisation théorico-pratique de ceux qui aspirent à modifier les grammaires de l'existant pour le libérer du mal. Le profil philosophique de Nietzsche peut donc, pleno iure, être compris comme l'inversion de celui de Rousseau.
En effet, il part du principe que les hommes sont inégaux par nature et que seule la société, avec sa « morale du troupeau » et sa religion de la résignation, produit la corruption de l'égalité (du christianisme au socialisme).
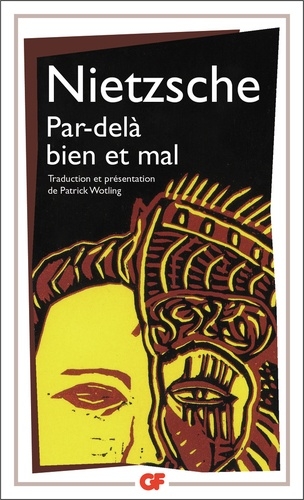 La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.
La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.
Cette approche permet de différencier la droite et la gauche en fonction de la manière dont elles se sont articulées et opposées dans l'aventure multiforme de la modernité. La droite tend à défendre un ordre naturel - s'il n'est pas directement voulu par Dieu - contre ses éventuelles convulsions pratiques ; un ordre qui, en tant que tel, présuppose des hiérarchies et des inégalités. Cela ne signifie pas pour autant que la droite, si attentive à la nature, n'ait pas sa propre culture, ni même qu'elle puisse être identifiée au rejet total de la culture au nom du réalisme et du pragmatisme: cela signifie simplement que la culture de la droite - non moins riche et articulée que celle du camp opposé - trouve sa propre référence constante dans l'immédiateté de la nature et d'un ordre naturellement donné.
La gauche, pour sa part, insiste sur la culture et sur l'historicité plutôt que sur la nature, sur le νόμος -nómos- plutôt que sur la φύσις -physis- : pour la gauche, l'ordre existant n'est pas naturel, mais le produit de rapports de force concrets qui, marqués comme ils le sont par des hiérarchies et des inégalités, exigent d'être rectifiés au nom de configurations de société plus élevées et plus rationnelles, qu'il appartient à la praxis sociale de traduire de la puissance à l'acte. L'immédiateté de la nature donnée, chère à la droite, crée une antithèse radicale à la réflexivité de la culture, typique de la gauche.
Il s'agit donc d'une contraposition entre la culture comme regnum hominis, d'où découle l'impératif - typique de la gauche - de l'action visant à façonner le monde selon les préceptes de la raison, et la nature comme puissance extérieure, qui - pour la droite - ne se laisse pas anthropomorphiser et qui, au contraire, doit être protégée contre les prétentions révolutionnaires à la violer en la subvertissant et en la réorganisant en fonction de la volonté de l'homme.
La genèse théologico-politique de la dichotomie droite-gauche, qui projette sur le plan immanent-horizontal les espoirs et la foi, le dogmatisme et souvent l'intransigeance propres à la sphère transcendante-verticale de la religion, explique à sa manière, entre autres, le caractère « sacré » avec lequel le couple dichotomique continue à être défendu liturgiquement et fidéistiquement même à l'époque de son « crépuscule » : précisément, presque comme s'il s'agissait d'une foi, souvent même en contraste avec les canons du λόγος -lógos- (credo quia absurdum - je le crois parce que c'est absurde-).


Le clivage a en effet guidé la pensée et l'action des modernes: et ils sont dans l'erreur ceux qui, partant peut-être d'une évaluation correcte de la hodierna morte de la dichotomie, soutiennent qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle n'a jamais joué un rôle vraiment décisif. Par exemple, les partisans de la théorie des élites (Mosca, Pareto, Michels) ont diversement considéré que, toujours et de toute façon, il était inévitable que des groupes dirigeants sélectionnés se forment au sommet de la société, même dans les sociétés qui prétendaient ex hypothesi être plus égalitaires et de gauche : pour eux, donc, la dichotomie entre droite et gauche serait en tant que telle un ens imaginationis. Ortega y Gasset a exprimé cette thèse, bien que dans une perspective différente, en affirmant qu'« être de gauche est, comme être de droite, l'une des infinies façons dont l'homme peut choisir d'être un imbécile: toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale ».

Il est vrai que, historiquement, c'est surtout la droite qui a nié la validité de la dichotomie, la présentant comme une construction intellectualiste subreptice qui désintègre la nature organique et unitaire de la société. Cette thèse, embryonnaire dans la pensée de De Maistre, est pleinement formulée, par exemple, par Jean Madiran dans La droite et la gauche (1977). Madiran (photo, ci-dessus) va plus loin. Il affirme que la distinction s'est toujours faite à l'initiative et au profit de la gauche, qui l'a utilisée pour renverser le pouvoir et pour boucler et exclure la droite en l'identifiant au mal.
Par ailleurs, Donoso Cortés avait déjà affirmé que le parlementarisme et la dichotomie gauche-droite se réfèrent à la « chattering class », la classe bourgeoise qui débat.
Ici aussi, il y a un aspect paradoxal. Si la dichotomie est à l'origine symboliquement favorable à la droite (le « bon » côté opposé au « mauvais » côté), c'est la gauche qui l'institue - et y fonde sa propre identité - et c'est la droite qui, dans un premier temps, la rejette. C'est pourquoi, comme le soulignait déjà Alain au siècle dernier, c'est surtout la droite qui tente de nier la dichotomie alors qu'elle était encore opérante: et celui qui, dans la Modernité, prétend n'être ni de droite ni de gauche, tend à le faire parce qu'il se place déjà dans les rangs de la droite. Mais il est vrai aussi que, si l'on inverse les rôles, ceux qui attribuent à la droite l'indistinction ou l'inexistence du clivage sont presque toujours à gauche.
Il est vrai que la droite surtout, après 1945, a essayé de nier la dichotomie pour des raisons purement techniques et tactiques, c'est-à-dire pour cacher sa propre faiblesse et son échec, en cherchant à se « camoufler » sous des catégories de sortie différentes et moins désavantageuses.
 Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).
Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).
D'autre part, en ce qui concerne la dichotomie, il ne faut pas négliger le caractère structurellement asymétrique qu'elle présente : le dupla n'est pas seulement utilisé pour décrire aseptiquement, mais aussi pour distinguer, discriminer et évaluer. Dans le passé, on s'en souvient, la gauche était identifiée à la « partie maudite », la droite à la « partie divine ». C'est surtout dans la seconde moitié du 20ème siècle, du moins en Europe, que le rapport s'est inversé : seule la gauche tend à être présentée avec des connotations positives dans le discours public, tandis que la droite - souvent identifiée sans réserve par ses adversaires aux expériences tragiques du nazisme et du fascisme - se voit imputer des dévalorisations substantielles.
Alors que la gauche se voit souvent attribuer sans réfléchir les valeurs d'égalité, de progrès et de solidarité, la transformant idéologiquement en une sorte de paradis sémantique, la droite se voit attribuer, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les prérogatives les plus abjectes de dictature, de violence, d'inégalité et de discrimination.
En dehors de ces considérations, le caractère religieux et seulement imparfaitement sécularisé de la dichotomie apparaît clairement, et ce sous la forme d'une foi tenace qui, de manière apparemment contradictoire, semble survivre même à la fin des grands récits avec laquelle, selon Lyotard, la condition postmoderne coïnciderait. Weber avait raison lorsqu'il affirmait que le « désenchantement du monde » (Entzauberung der Welt) ouvert par le « développement particulier » (Sonderentwicklung) de la rationalisation capitaliste occidentale finit par coexister avec une sorte de réenchantement immanent qui lui est propre : celui en vertu duquel les hommes ont cessé de croire en Dieu et en la dichotomie entre l'au-delà et l'au-delà, au moment même où la foi dans le marché capitaliste et dans le binôme droite-gauche a atteint un degré d'intensité impressionnant.
C'est pourquoi, à l'époque de la « mort de Dieu » et de la splendeur de la religion du capital, la dichotomie semble dotée d'une charge religieuse maximale ; une charge qui s'exprime, entre autres, dans le « tabou de l'impureté » adressé à quiconque appartient au parti adverse (ou, ce qui n'est pas rare, à quiconque est même soupçonné d'avoir des relations avec lui) et dans la substitution désormais consommée de l'espace de « l'action communicative » (socratique avant même d'être habermassienne), incardiné sur le λόγος, -logos-, par le terrain émotionnel, fidéiste et fanatique de l'appartenance « confessionnelle » et de la lutte obéissante contre les « hérétiques » du camp adverse. En bref, la politique devient à toutes fins utiles la religion des modernes. Aujourd'hui, cependant, les post-modernes vivent la mort de Dieu également en politique ; et sous toutes les latitudes, c'est la perte de la foi politique ou, si l'on préfère, le nihilisme politique qui prédomine.
14:45 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, clivage gauche-droite, gauche, droite, théologie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 mai 2025
Hugo Fischer sur Marx
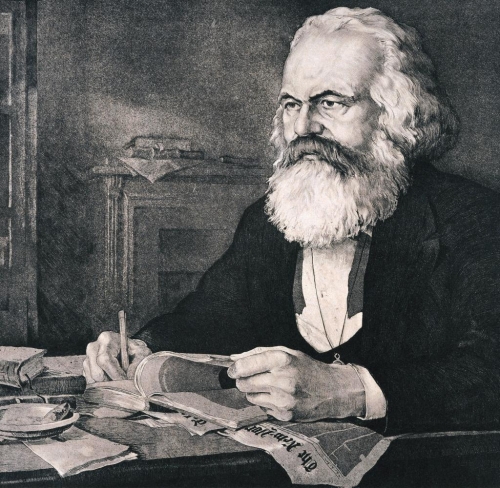
Hugo Fischer sur Marx
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/04/30/hugo-fischer-om-marx/
Le 1er mai, jour de célébration et de lutte pour la classe ouvrière, nous discutons depuis des décennies de divers penseurs socialistes, de Jacques Camatte aux socialistes du conseil. Dans ce contexte, il est difficile d'éviter Karl Marx ; nous avons écrit sur ses tendances, qui sont aujourd'hui idéologiquement suspectes, et sur son analyse du fuidhir irlandais. Costanzo Preve a noté dans Marx e Nietzsche qu'« il n'est pas du tout connu que Marx n'a pratiquement rien à voir avec ce qui est considéré comme une pensée de gauche », une lecture de Marx à partir de la droite peut être fructueuse (au moins, des figures comme Burnham, Wittfogel et Horkheimer le suggèrent). Cependant, beaucoup de ces lectures sont plus ou moins superficielles ; à côté de Das Kapital von Karl Marx d'Oberlercher, une exception notable est Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft d'Hugo Fischer, datant de 1932.
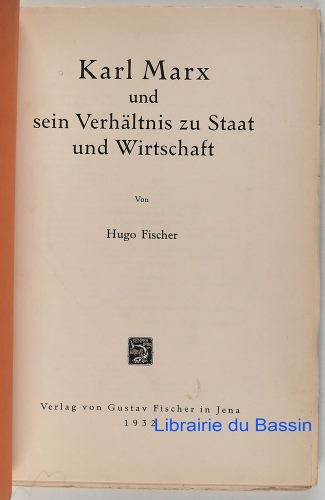

Fischer (1897-1975) appartenait au cercle des révolutionnaires conservateurs tels que Ernst Jünger, Carl Schmitt, Hans Freyer et Ernst Niekisch. Il a contribué à la pensée soldatique-nationaliste de Jünger et à l'élaboration de concepts tels celui de Der Arbeiter, il a correspondu avec Schmitt et a écrit des articles pour la revue Widerstand du national-bolchevik Niekisch. Fischer analyse les conditions d'une synthèse pour l'unité européenne et pour la diversité des nationalités, pour la réalisation de l'idée de Reich, il écrit sur la « substanzielle Gemeinschaftlichkeit » et la « Metaphysizierung der Politik » (sur la "communauté substantielle" et sur la "métaphysisation de la politique"). Quand il était un peu plus jeune, Fischer voyait, un peu naïvement, Staline comme un protecteur des peuples soviétiques contre l'homogénéisation américaine; plus âgé, Fischer a étudié le sanskrit et appris à connaître l'Inde. Il est intéressant de noter qu'il avait une bonne connaissance non seulement de Nietzsche et de Hegel, mais aussi de Marx. C'est pourquoi son ouvrage Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft (= Karl Marx et sa relation avec l'État et l'économie) est particulièrement intéressant. Il déclare d'emblée que « à la droite de Marx se trouve l'économie, à la gauche de Marx l'État... Marx lui-même n'est ni à droite ni à gauche ».
 La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.
La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.
Trois coordonnées déterminent les penseurs du 19ème siècle : l'économie est la dimension de la largeur, la technologie celle de la profondeur et la politique celle de la hauteur. Mais au « siècle de la médiocrité », l'économie était considérée comme la dimension décisive, même pour les aspects non économiques.
Fischer a identifié une contradiction chez Marx. Il était à bien des égards un économiste et un positiviste, mais il annulait également ces qualités. Les « grands » positivistes se caractérisent par le fait que, dans les moments décisifs, ils doivent être infidèles au positivisme », écrit M. Fischer. Mais lorsqu'il s'agit de savoir comment l'économisme déforme la religion, l'art, la nature et la métaphysique, Nietzsche est supérieur à Marx. Dans l'ensemble, les commentaires de Marx dans ces domaines ne sont ni particulièrement originaux ni productifs, selon Fischer, et je suis enclin à être d'accord avec lui sur ce point. Marx, par exemple, n'a pas la vision d'une religion saine, « il reste à côté de la critique » par rapport à Nietzsche. Les arguments de Fischer sur le positivisme et la philosophie sont parfois très lisibles, notant par exemple que « le personnage du philosophe Karl Marx est celui du sociologue ».
Il est intéressant de noter que, selon Fischer, Marx a identifié la décadence comme le phénomène central du 19ème siècle, alors que le cadre de pensée du 19ème siècle rendait son analyse de la décadence difficile. Marx « a regardé le visage de la Méduse », mais son erreur fondamentale a été de considérer « la décadence comme une forme de capitalisme plutôt que le capitalisme comme une forme de décadence ». Tant que la culture féodale et médiévale était forte, il y avait des limites claires à l'économie, comme le montre une citation de Beniost selon laquelle ce dernier déclare être heureux de vivre dans une société avec un marché, mais pas dans une société de marché. Mais après le déclin de l'ancienne culture, en particulier à cause de la Réforme, l'économie a pu franchir ces limites qui lui avaient été imposées. « La cause en est le déclin d'une véritable culture », écrit Fischer (ce qui n'est pas tout à fait conforme au modèle marxien de l'histoire, mais plutôt à celui d'Evola).

Cela nous donne un indice sur la manière dont Marx doit être lu par la droite : tout comme le capitalisme est compris comme l'expression d'une tendance plus large à la décomposition, nous pouvons lire l'oeuvre de Marx comme une analyse partielle, souvent ingénieuse, de certains aspects de la décomposition. Selon Fischer, « la catégorie Kapital est une spécification de la catégorie übergreifenden kulturphilosophisch-metaphysischen und soziologischen Dekadenz » (= la catégorie surplombante qu'est la décadence sociologique, culturelle-philosophique et métaphysique). D'autres Allemands comme Hegel, Nietzsche, Schmitt et Tönnies ont analysé d'autres aspects de la décadence. Une telle lecture est utilement complétée par Fischer car il propose une anthropologie politique qui manque à Marx, il répond à la question d'Evola « sous quel signe » nous luttons contre la décadence.
Un concept comme l'aliénation devient diffus sans une anthropologie et une métaphysique claires, sinon la question devient facilement la suivante: « aliéné de quoi ? ».
La lecture de Marx par Fischer illustre la valeur de la perspective politique, l'Europe féodale étant la « Heimat » à laquelle nous comparons le présent. En s'appuyant sur Marx, Fischer a identifié deux sous-processus dialectiques dans lesquels la relation entre la politique et l'économie est déformée. D'une part, la « Wirtsschaftsförmigkeit des Staates » (= "la formité économique de l'Etat"), d'autre part la « Staatsförmigkeit der Wirtschaft » (= "la formité étatique/politique de l'économie"). Cela signifie que les intérêts et les conflits économiques envahissent ou s'infiltrent dans l'État et que l'économie prend des dimensions politiques. Il n'est plus possible de déterminer « où finit l'économie et où commence l'État ». La description par Fischer de la manière dont les intérêts économiques réduisent et banalisent des choses telles que la nation, la famille, la paternité, l'amitié, l'amour et la terre est une lecture enrichissante et une clarification des thèmes de Marx. L'« économicisation » de l'État est liée à la domination de la bourgeoisie. Entre autres choses, la politique sera considérée comme une distraction par rapport à l'économie, et le parlement occupera le devant de la scène avec ses intrigues et ses querelles de partis. Tout cela a pour but de neutraliser la politique au sens propre du terme », ajoute Schmitt.

Fischer compare la société bourgeoise à la société féodale et constate que seule cette dernière était politique. Cela s'explique par le fait qu'il y avait des domaines au lieu de classes, que l'économie et les intérêts privés avaient des limites claires et qu'il existait une volonté et une autorité politiques. « Au Moyen-Âge, le peuple et l'État s'identifient », écrit Fischer, qui résume cette évolution par les mots suivants : “l'autorité de l'ensemble politique est remplacée par l'autorité des intérêts individuels”. Comme on le voit, Fischer, Schmitt, Niekisch et d'autres avaient accès à un appareil conceptuel concernant le politique qui complétait celui de Marx. Le reproche fait à la société bourgeoise n'est pas des moindres : elle est apolitique. « L'économie devient étatique, l'économie étatique, ce sont les deux faces d'un même processus : l'économicisation de la vie politico-sociale dans la phase finale de sa décomposition ».
Fischer a succinctement décrit des phénomènes modernes tels que le pouvoir du travail mort sur le travail vivant, l'objectivation et l'inversion des mots (voir avec le terme « valeur »). On retrouve le Der Arbeiter de Jünger dans les descriptions du progrès technologique et de la façon dont le « travailleur combiné » annule le bourgeois. Comparez par ailleurs le travaux de Debord et de Vaneigem avec la prise de conscience de Fischer que « le milieu dans lequel règne la mort est la monotonie ». La domination des morts est la domination des marchandises et de l'argent, l'une des idées les plus utiles de Marx, tant pour la droite que pour la gauche. Fischer décrit en détail « l'économicisation de la vie politique et sociale au stade final de sa décadence », la manière dont les acteurs économiques exploitent l'État, la manière dont l'État est lié aux conflits de classe, le dualisme entre l'intérêt privé et le droit, etc. Il considère ces processus comme des expressions de la décadence, comme des déviations de la relation correcte entre la politique et l'économie. Pendant la phase de décadence, l'économie envahit non seulement la politique, mais aussi l'art, la métaphysique, la famille, etc. Nous trouvons également ici une analyse intéressante de la relation entre la décadence et la bureaucratie. « La forme première de la totalité illusoire est la bureaucratie » selon Fischer, “la bureaucratie possède l'Etat, l'essence spirituelle de la société, c'est sa propriété privée” selon Marx. L'État moderne sert les intérêts économiques, son objectif est l'« anti-étatisme ».
Dans l'ensemble, il s'agit d'une lecture fascinante pour le lecteur avisé. Fischer aborde la relation entre Max Weber et le concept dialectique du capital de Karl Marx, il décrit le déclin progressif de l'ordre féodal et résume le « conservatisme » par les mots: « la phase finale du processus de décomposition doit être stabilisée ». Il est parfois susceptible de surprendre, par exemple dans la manière dont les deux fondateurs du marxisme considéraient l'État moderne. Fischer cite Engels sur « la maladie du crétinisme parlementaire » et Marx sur l'État moderne, en l'occurrence français, comme « un terrible parasite... vivant sur le dos de la société française ». Voici un complexe d'idées dans lequel le politique, les États et l'Empire s'opposent au totalitarisme bureaucratique et à une révolution managériale que Marx et Fischer n'auraient pu qu'imaginer. Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft est une lecture de Marx initiée par la droite, une critique sociale précieuse à bien des égards, et parfois aussi surprenante qu'enrichissante pour la droite comme pour la gauche.
Pour en savoir plus:
Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft
Hugo Fischer: Ernst Jünger’s Mentor – Tiana Berger – Junge Freiheit n°20 – 2000
En français: https://vouloir.eklablog.com/hugo-fischer-a48482356 (avec en plus : "Souvenir de Hugo Fischer", par Ernst Niekisch
Ex oriente ordo: Eine deutsche Philosophie zum Anbruch des planetarischen Zeitalters (anno 1933)
16:39 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl marx, hugo fischer, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 14 mai 2025
Marxiens, oui. Marxistes, non

Marxiens, oui. Marxistes, non
par Alessio Mannino
Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/marxiani-si-marxi...
Le 5 mai 1818 naissait à Trèves ce penseur brillant, profond, infatigable, fiévreux, utopiste malgré lui, politiquement autoritaire et philosophiquement incontournable qu'était Karl Marx. Il existe d'innombrables bibliothèques sur sa biographie et son œuvre, et il ne s'agit pas ici de se lancer dans une nouvelle interprétation fantaisiste (nous ne sommes d'ailleurs pas dignes d'en formuler une nouvelle). Mais l'occasion, qui nous est donnée ici, nous donne le droit de mettre un point final à son actualité, du moins à mon avis: le marxisme reste une pensée vivante et fertile en tant que méthode analytique, alors qu'il est gangréné de l'intérieur et devenu inutile en tant que conception palingénésique. C'est une idée qui a toujours été hérétique dans le camp marxiste (le premier à l'avoir formellement théorisée fut l'Allemand Karl Korsch, il y a cent ans, une sorte d'anti-Lukacs, qui a fini dans l'oubli précisément parce qu'il était un pestiféré et un réprouvé). Mais la thèse reste la même. D'autant plus aujourd'hui, après les échecs pratiques du communisme tel qu'il a été appliqué, où l'on peut, et même, d'après moi, l'on doit se dire marxien mais non pas marxiste.

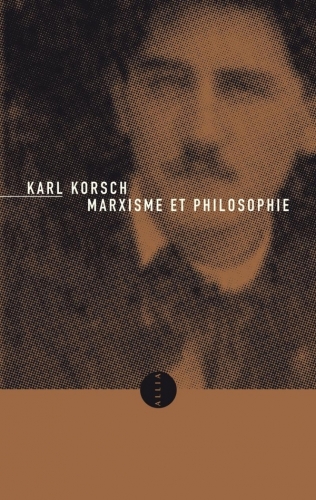
Marx, comme on le sait, est un élève rebelle de Hegel. Le philosophe prussien, dans son article de 1802 intitulé « La Constitution de l'Allemagne », définit l'esprit bourgeois comme relevant d'une « préoccupation constante » pour la propriété. Le bourgeois est avant tout un individu angoissé. Quelques années plus tard, dans son opus majeur, la Phénoménologie de l'esprit, il formule sa fameuse conception du travail comme devoir d'émancipation, « discipline de service et d'obéissance » sans laquelle la peur de la mort, propre à l'être humain, « reste intérieure », polluant la conscience qui, dès lors, « ne devient pas conscience elle-même ». Pour Hegel, et même les pierres le savent, ce qui constitue l'histoire humaine est le processus dialectique de l'autoconscience progressive de l'Esprit. Marx, dans son objectif de « remettre la dialectique hégélienne sur pied », a substitué la matière à l'Esprit (c'est cela le matérialisme historique), tout en maintenant l'aspiration au progrès, à l'amélioration et à l'humanisation, qui, selon lui, étaient entravés par les structures sociales oppressives, dominées à l'époque par la bourgeoisie. C'est-à-dire par le bourgeois dévoué à ses affaires plutôt que, comme le prolétaire, à l'émancipation de l'humanité entière, laquelle serait même, un jour, libérée du travail en tant que tel, grâce au communisme (« de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins »).
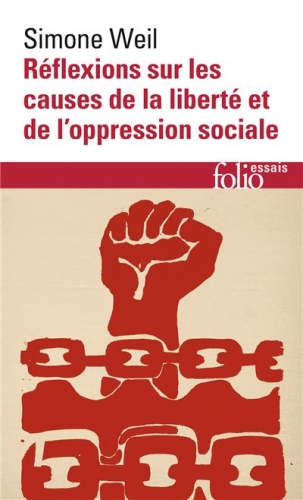
Comme l'a souligné Simone Weil dans ses fulgurantes Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, Marx attribuait en effet au rêve révolutionnaire la tâche de libérer « non pas les hommes, mais les forces productives ». L'attention de Marx s'est progressivement déplacée de l'homme concret vers la production: ce n'est pas un hasard si le concept d'aliénation (la perte d'humanité de l'homme en tant qu'esclave de la machine capitaliste), si central et significatif pour la postérité, c'est-à-dire pour nous, n'est pas développé par le Marx de la maturité, qui laisse plutôt inachevée l'imposante cathédrale théorique qu'est le Capital.
L'image de la société communiste reste vague, essentiellement identifiée à l'extinction de l'État. Ce dernier est remplacé par une organisation sociale calquée sur le régime hyper-rationnel de la grande entreprise, que Friedrich Engels résume ainsi : « du gouvernement des hommes à l'administration des choses ». Une immense étendue de communautés qui tendent à se pacifier dans la mesure où elles sont régies par des principes, dirions-nous aujourd'hui, de rationalisation des ressources, visant au développement maximal de la productivité. Disons-le tout net : un cauchemar, plutôt qu'un rêve.
En effet, Weil a toujours observé que la limite macroscopique de Marx consistait dans le fait que son anticapitalisme « s'accordait profondément avec le courant général du capitalisme ». C'est-à-dire la mécanisation, la concentration, la managérialisation, tout le système d'asservissement que l'on verrait à l'œuvre dans le fordisme-taylorisme américain. En un mot : le productivisme, qui se traduit aujourd'hui par le dogme de la croissance économique infinie. Une exigence purement machinique, un automatisme de système, un article de foi rationnel, anxiogène, disciplinaire et aliénant vis-à-vis de tout. Mais rien de raisonnable et d'humain, absolument rien, ne s'y manifeste.
La part fallacieuse du philosophe barbu de Trèves ne réside donc pas tant dans la prédiction erronée de la baisse tendancielle du taux de profit, que dans la vision eschatologique de fin des temps d'un règne futuriste et saturnien, débarrassé de la pénibilité du travail et de l'âpreté des conflits.

C'est pourquoi le marxisme, entendu comme pensée systématique, n'a plus grand-chose à nous dire, après le 20ème siècle: non pas parce que le capitalisme a battu en efficacité et en efficience les expériences du communisme tel qu'il a été réalisé, mais avant tout à cause de la déshumanisation qu'il portait dans son ADN, et dans laquelle toute tentative de poursuite d'un idéal abstrait et réductricement rationaliste finit invariablement par se déverser. C'est un fait établi: la poursuite aveugle du bonheur collectif conduit à la persécution aveugle et au malheur chronique des individus, pris dans leurs interactions, leurs relations et leurs rapports sociaux. Dans leur vie, en somme. Méfions-nous donc de ceux qui imprègnent encore les révolutionnarismes d'une saveur messianique, introduisant dans leur militantisme trop de transcendance et d'actes de foi. La révolution est possible, mais pour retourner le conflit en faveur des aliénés selon la justice. Pas pour le supprimer, ce qui est humainement impossible et indésirable. Ici, le républicain, qui est aussi précisément conflictualiste, Machiavel, peut servir d'excellent antidote (ce n'est pas pour rien que Machiavel, cette pierre angulaire qui va bien au-delà du machiavélisme maniéré, est un auteur totalement ignoré par Marx).
En quoi Marx reste-t-il non seulement utile, mais indispensable ? Dans le diagnostic de la maladie capitaliste (un terme, bien sûr, qu'il n'aurait pas utilisé, nous l'utilisons pour indiquer toute la difformité et l'insalubrité dont est victime la condition psychophysique, aussi bien que politique, de l'homme-animal: une aliénation, en fait, selon moi, qui est comparable à bien des égards à l'inévitable fléau du nihilisme, diagnostiqué plutôt par Nietzsche).
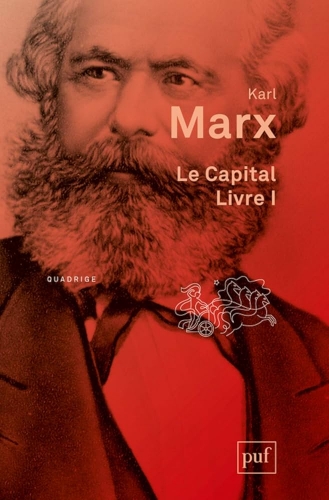
Dans la mise en évidence de la nature de l'argent, qui provoque un manque inhumain d'empathie en étouffant à la racine le besoin naturel de communauté (« l'indifférence », dit Marx). Dans le chapitre III de la prophétie que constitue le Capital, celle-ci ponctuellement réalisée, est l'« aristocratie financière » qui étendra sa domination au monde entier. Enfin, même s'il est banal de le souligner, dans la subordination lucide de tout jugement à l'examen rigoureux des forces en présence à un moment historique donné, afin de relier les superstructures idéologiques aux structures de pouvoir sous-jacentes (sans tomber pour autant dans un économisme puéril - erreur dans laquelle, contrairement à certains de ses épigones, Marx n'est jamais tombé). Marx est donc toujours vivant. Le marxisme, beaucoup moins. D'ailleurs, malgré le maniement despotique et férocement polémique qui caractérisait le Marx politique actif dans le mouvement ouvrier, c'est lui-même qui disait, selon un témoignage d'Engels, que « ce qui est certain, c'est que je ne suis pas marxiste ». Deux siècles plus tard, nous pouvons d'autant plus nous permettre de ne pas l'être.
15:35 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, marxisme, philosophie, philosophie politique, théorie politiquen, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 mai 2025
Economie verte et écologisme néolibéral

Economie verte et écologisme néolibéral
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/business-ecologico-el-ambientalis...
Il existe un paradoxe apparent lié à la question de l'apocalypse environnementale qu'il convient d'aborder : le logo dominant dans le cadre du technocapitalisme du nouveau millénaire non seulement ne reste pas silencieux face au dilemme de la catastrophe imminente, mais l'élève au rang d'objet d'une prolifération discursive hypertrophique. L'urgence environnementale et climatique est, à juste titre, l'un des sujets les plus soulignés et les plus discutés dans l'ordre actuel du discours.
Cela semble, à première vue, une contradiction dans les termes, si l'on considère que poser ce dilemme revient à énoncer la contradiction même du capital, qui est son fondement. Ne serait-il pas plus cohérent avec l'ordre technocapitaliste d'occulter - ou du moins de marginaliser - cette question problématique, d'une manière similaire à ce qui se passe avec la question socio-économique du classisme et de l'exploitation du travail, rigoureusement exclue du discours public et de l'action politique ?
Affirmer que, contrairement au problème de l'exploitation du travail (qui reste largement invisible et qui, de toute façon, peut être facilement éludé par le discours dominant), la question environnementale est claire et évidente aux yeux de tous, oculos omnium, et que, par conséquent, il serait impossible de l'éviter comme si elle n'existait pas, revient à faire une affirmation vraie mais, en même temps, insuffisante: une affirmation qui, en outre, n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles le discours dominant non seulement aborde ouvertement la question, en la reconnaissant dans sa pleine réalité, mais tend même à l'amplifier et à la transformer en une urgence et en une véritable urgence planétaire.

La thèse que nous entendons soutenir à cet égard est qu'il existe une différence notable entre la question environnementale et la question socio-économique (que Marx appellerait, sans périphrase et à juste titre, « lutte des classes »). Cette dernière ne peut en aucun cas être « normalisée » et métabolisée par l'ordre technocapitaliste qui, en fait, opère de telle sorte qu'elle n'est même, tendanciellement, jamais mentionnée (ni, ça va sans dire par les forces du camp gauche de la politique, depuis longtemps redéfini comme gauche néolibérale ou, mieux encore, « sinistrash » - gauche poubelle). Margaret Thacher, quant à elle, avait déjà ostracisé le concept même de classe sociale, le qualifiant de vestige inutile et pernicieux du communisme (selon ses propres termes : « la classe est un concept communiste. Il sépare les gens en groupes comme s'il s'agissait de parcelles et les monte ensuite les uns contre les autres").
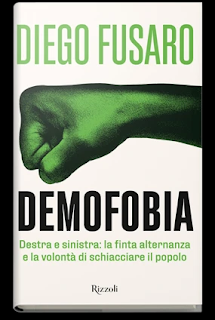 Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).
Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).
Contrairement à la question socio-économique, la question environnementale peut être métabolisée et - littéralement - rentabilisée par l'ordre technocapitaliste pour de multiples raisons. Précisons toutefois que l'ordre discursif néolibéral affronte et, en fait, amplifie la question environnementale et climatique dans l'acte même par lequel il la déclare abordable et résoluble mais toujours et seulement dans le cadre du technocapitalisme, neutralisant a priori la pensabilité de toute arrière-pensée ennoblissante éloignée de la prose de la réification du marché et de la Technique. Et c'est en fonction de cette clé herméneutique que s'explique l'intensification discursive néolibérale de l'urgence climatique et environnementale, toujours caractérisée par l'occultation de la matrice capitaliste des désastres.
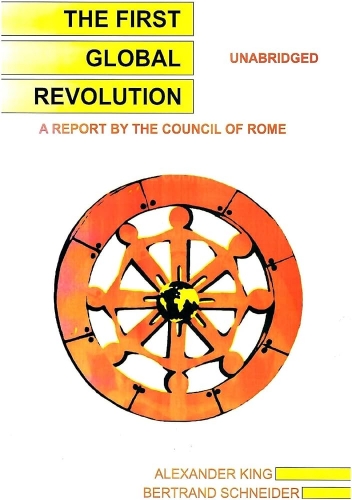
Bien canalisée dans les rails de la mondialisation néolibérale, la question environnementale peut jouer, pour l'ordre dominant, le rôle d'une fonction efficace de défocalisation du regard sur la question socio-économique, le classisme, l'exploitation et l'impérialisme. Pour comprendre cet usage apotropaïque dans toutes ses implications, on peut par exemple se référer au rapport de 1991 intitulé La première révolution mondiale, publié par le « Club de Rome », une association fondée en 1968 par l'homme d'affaires Aurelio Peccei, le scientifique écossais Alexander King et le turbo-capitaliste milliardaire David Rockefeller : une entité que l'on peut à juste titre classer parmi les nombreux think tanks (du Cato Institute à la Heritage Foundation, de l'Adam Smith Institute à l'Institute of Economic Affairs) au service de l'ordre dominant, auquel ils apportent une caution idéologique.
Ainsi, on peut lire dans le rapport de 1991 : « Dans la recherche d'un nouvel ennemi qui pourrait nous unir, nous avons trouvé l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau potable, la faim et d'autres choses du même genre serviraient notre objectif ». En somme, la question verte doit être habilement identifiée comme une contradiction fondamentale et un « ennemi commun » capable de nous unir ("un nouvel ennemi pour nous unir") dans une bataille qui, d'une part, détourne le regard du conflit entre le Serviteur et le Seigneur et, d'autre part, conduit le premier à adhérer à nouveau à l'agenda du second, notamment aux nouvelles voies du capitalisme écologique telles qu'elles seront sculptées dans les années à venir.
Le rapport du Club de Rome peut être accompagné d'un autre document datant de deux ans plus tôt qui, malgré les différences de nuances et d'intensité des approches, propose un schéma de pensée convergent. Il s'agit d'un discours prononcé par Margaret Thatcher le 8 novembre 1989 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est animé, entre les lignes, par la volonté d'identifier un nouvel « ennemi commun » pour remplacer le « socialisme réel », déjà en déclin (il est significatif que le discours de la Dame de fer ait eu lieu à la veille de la chute du mur de Berlin). Et que, par conséquent, il peut être assumé comme le nouveau défi global au capitalisme, en impliquant tout le monde dans son projet. Selon Thatcher, « de tous les défis auxquels la communauté mondiale a été confrontée au cours de ces quatre années, l'un d'entre eux est devenu plus évident que tous les autres, à la fois en termes d'urgence et d'importance : je veux parler de la menace qui pèse sur notre environnement mondial ».

Le sermon de la Dame de fer est parfois encore plus symptomatique du nouvel esprit du temps que le rapport du « Club de Rome », en particulier dans son insistance sur la nécessité de traiter la question environnementale sans renoncer à l'impératif de croissance, préservant ainsi le capitalisme sous une forme éco-durable tout en se consacrant à la croissance économique. Pour reprendre les termes de Thatcher, « nous devons faire ce qu'il faut sur le plan économique. Cela signifie que nous devons d'abord avoir une croissance économique continue afin de générer la richesse nécessaire pour payer la protection de l'environnement ». L'astuce - une constante dans l'ordre du discours néolibéral - consiste à dénoncer le problème environnemental, en accompagnant immédiatement la dénonciation de la reconnaissance que la croissance, le développement et les auri sacra fames - la faim d'or maudite - du capital ne sont pas la cause, mais la solution possible : « nous devons résister à la tendance simpliste de blâmer l'industrie multinationale moderne pour les dommages causés à l'environnement. Loin d'être les méchants, ce sont eux sur qui nous comptons pour enquêter et trouver des solutions ».
Ainsi, suivant le discours de Thatcher, qui résume le nouvel esprit du capitalisme vert in statu nascendi - en phase d'émergence - la critique du capitalisme comme cause de la destruction de l'environnement (en un mot, l'environnementalisme socialiste) serait une « tendance simpliste », du fait que les industries multinationales, « loin d'être les méchants », sont les agents qui peuvent mener les recherches et trouver les solutions au dilemme. Cependant, le non sequitur dans lequel la réflexion de Thatcher, et avec elle, la raison d'être néolibérale elle-même, s'enlisent est que, même à supposer que les entreprises multinationales puissent trouver la solution, cela ne peut servir d'alibi à leur responsabilité dans la genèse de la tragédie, comme semble l'indiquer le passage cité plus haut. Et, de toute façon, comme nous essaierons de le montrer, les « solutions » recherchées et trouvées par l'industrie multinationale moderne évoluent toujours sur la base de l'acceptation (et de la reproduction perpétuelle) de la contradiction qui génère le problème.
Par conséquent, l'ordre hégémonique admet et même encourage le discours sur la catastrophe, tant qu'il est invariablement articulé dans les périmètres du cosmos technocapitaliste, supposé comme un a priori historique non modifiable ou, en tout cas, comme le meilleur système possible à la fois parmi ceux qui ont déjà existé et parmi ceux qui pourraient éventuellement exister en tant qu'alternative.
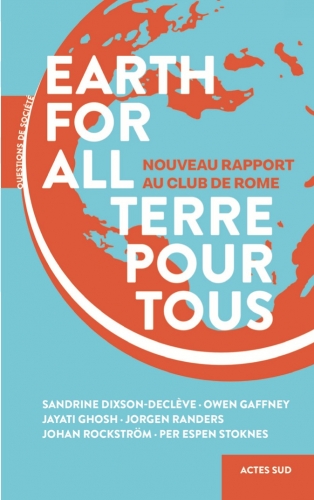
L'évocation constante de la catastrophe climatique et l'exigence d'y remédier sont donc permises et d'ailleurs constamment induites, à condition que les recettes et les solutions soient administrées par la logique du profit et le maintien de la forme valeur comme fondement du système de production.
Enfin, si l'environnementalisme néolibéral est ouvertement promu et pratiqué par les modèles politiques de l'Occident - ou, plus précisément, de l'Ouest -, l'environnementalisme socialiste est découragé et diabolisé, soit sur la base de ce que Fisher a défini comme le « réalisme capitaliste » (selon lequel il n'y aurait pas d'alternatives à ce qui existe), soit sur la base de la stigmatisation de la passion utopique et anti-adaptative, idéologiquement assumée comme prémisse à la violence et au retour des atrocités du 20ème siècle.
En d'autres termes, le turbo-capitalisme pose et débat la question de l'apocalypse verte en se présentant comme la solution et non comme l'origine du problème: ainsi, tout en cultivant les causes de la catastrophe, il se propose de travailler sur les effets, dans une perspective qui, de surcroît, est fonctionnelle à la préservation de la logique du capitalisme lui-même. Il va sans dire qu'affronter le dilemme environnemental en restant sur le terrain du technocapitalisme signifie, dans la meilleure des hypothèses, ne pas le résoudre et, dans la pire (comme nous pensons que c'est effectivement le cas), renforcer encore les bases de la catastrophe.
En particulier, nous tenterons de montrer comment, sous la forme de l'environnementalisme néolibéral, le discours turbo-capitaliste sur l'apocalypse verte tente, d'une part, de moduler les stratégies de résolution de la catastrophe qui, présupposant l'ordre technocapitaliste et son maintien, sont toutes vouées à l'échec et, d'autre part, de neutraliser préventivement la viabilité de l'option de l'environnementalisme socialiste. Sans exagérer, si le logo hégémonique s'approprie le discours environnemental, c'est en raison de sa volonté de le sortir du camp socialiste pour le ramener - et donc le « normaliser » - sur le terrain néolibéral, plutôt qu'en raison de sa volonté réelle de remédier au cataclysme qui s'annonce. D'autre part, pour les porte-drapeaux du fanatisme techno-économique - pour paraphraser Jameson - il est plus facile et moins douloureux d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.

L'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale s'explique par trois raisons principales, qui seront examinées ci-dessous : (a) la transformation de l'urgence environnementale elle-même en une source d'extraction de la plus-value, qui se produit surtout en vertu du système manipulateur de l'économie verte et de ses « sources renouvelables » d'affaires ; (b) le brouillage du regard par rapport au conflit socio-économique (qui, comme on l'a rappelé, ne peut être incorporé et normalisé dans l'ordre technocapitaliste, contrairement à la question environnementale) ; (c) la fabrique de la crise et le gouvernement de l'économie de marché, qui sont les principaux responsables de l'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale ; c) la fabrique de la crise et l'utilisation gouvernementale de l'urgence, sous la forme d'un « Léviathan vert » qui utilise la crise elle-même comme ars regendi - l'art de gouverner - pour consolider, optimiser et étendre la domination technocapitaliste sur la vie.
Sur la base de ces hypothèses, l'économie verte peut être comprise à juste titre comme la solution que la raison néolibérale propose pour la question environnementale, dans une tentative non pas tant de sauver la planète (et avec elle, la vie) du capitalisme, mais de sauver le capitalisme lui-même des impacts environnementaux et climatiques. En d'autres termes, l'économie verte aspire à garantir que le capital puisse, de quelque manière que ce soit, surmonter sa contradiction intrinsèque qui se traduit par l'épuisement des ressources et la neutralisation du « remplacement organique » de la mémoire marxienne : pour rendre cela possible, le punctum quaestionis - l'état de la question - conduit à la redéfinition du capitalisme lui-même, selon une nouvelle configuration verte, qui lui permet de poursuivre la valorisation de la valeur, en évitant la récession et en reportant dans le temps l'éclatement de la contradiction.
Les élites turbo-financières apatrides s'approprient les revendications écologistes croissantes, nées dans les années 1970 et devenues de plus en plus solides, et les détournent vers les circuits de l'économie verte, en cohérence avec laquelle la limite environnementale doit être perçue non pas comme un obstacle au développement, mais comme une opportunité de profit sans précédent, comme un moteur de croissance renouvelé et comme le fondement d'un nouveau cycle d'accumulation.
L'erreur qui est à la base de l'« économie verte » et, plus généralement, de l'environnementalisme néolibéral dans toutes ses extra-inspections, peut être facilement identifiée dans la conviction générale que la contradiction ne réside pas dans le capitalisme en tant que tel, mais dans son fonctionnement, encore insuffisamment calibré pour trouver un équilibre avec la nature.
En somme, le capitalisme est perçu comme la thérapie d'un mal qui, tout au plus, peut être compris comme la conséquence d'une application encore perfectible du capitalisme lui-même. Il va sans dire que ce qui échappe à la raison d'être néolibérale, c'est que, comme Marx et Heidegger l'ont montré - bien que sur des bases différentes - c'est le fondement même du technocapitalisme qui consomme les entités dans leur totalité et conduit à l'épuisement de la nature.

En bref, le capitalisme n'est pas malade, comme les hérauts de l'économie verte et de l'environnementalisme néolibéral semblent vouloir le suggérer : il est la maladie. Il ne s'agit donc pas de guérir le capitalisme, mais de guérir l'humanité et la planète du capitalisme. Cela signifie que ni la justice sociale ni même un véritable environnementalisme ne peuvent exister sans l'anticapitalisme. Prétendre guérir le capitalisme signifie seulement perpétuer, sous de nouvelles formes, le système d'oppression de l'homme et de la nature par l'homme.
La dévastation de l'environnement et le changement climatique générés à son image par le technocapital (heideggérien dans son « oubli de l'Être » et sa volonté de puissance de croissance démesurée) deviennent, grâce à l'économie verte, un phénomène par lequel la ruse de la raison capitaliste (comme nous pourrions aussi l'appeler, en empruntant la formule hégélienne), se trompe elle-même en croyant pouvoir résoudre la contradiction, désormais indéniable parce qu'attestée par les données scientifiques et l'expérience quotidienne.
En d'autres termes, puisque la contradiction est réelle et évidente, et que ses effets désastreux tendent à se manifester dès le temps présent, l'ordre libéral s'emploie à la résoudre par des méthodes qui ne remettent pas en cause l'ordre capitaliste lui-même et qui, de surcroît, permettent de le maintenir et même de le renforcer.
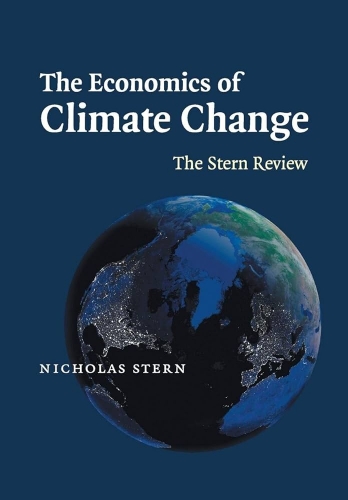
Selon la ligne théorico-pratique ouverte par le « Rapport Stern » (2006), l'économie verte conçoit de nouvelles sources de profit qui, sans affecter réellement le processus de production, ont simplement - ou semblent avoir - moins d'impact sur l'environnement et le climat. En substance, ils recommandent que nous fassions simplement ce que nous faisons déjà, mais d'une manière verte. Ainsi, non seulement le capitalisme se trompe lui-même (et nous trompe) en prétendant avoir trouvé la solution à la catastrophe environnementale dont il a été l'un des principaux responsables, mais il se revitalise et revitalise sa propre logique en modifiant les hypothèses du mode de production et en conquérant de nouveaux marchés, en inventant de nouvelles stratégies et en encourageant la consommation de nouvelles marchandises « éco-durables ».
17:34 Publié dans Actualité, Ecologie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, économie verte, club de rome, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, capitalisme, actualité, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 mai 2025
De Machiavel à Schmitt: le réalisme politique renaît

De Machiavel à Schmitt: le réalisme politique renaît
Alexander Raynor
Alexander Raynor examine comment le philosophe belge Antoine Dresse renouvelle le réalisme politique pour relever les défis du 21ème siècle.
Qui est Antoine Dresse, alias Ego Non?
Né en 1996 à Liège, en Belgique, Antoine Dresse a poursuivi des études de philosophie à Bruxelles. Pendant sa scolarité, il a étudié l'anglais, l'allemand et le russe. À 18 ans, avant de commencer l'université, il a passé plusieurs mois à Heidelberg, en Allemagne, et à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour perfectionner ses connaissances linguistiques.
Aujourd'hui, Antoine Dresse anime la chaîne YouTube, qui compte plus de 29.000 abonnés et est intitulée Ego Non (« Même si tous les autres, pas moi ») consacrée à la philosophie politique et morale, et contribue régulièrement à la publication Éléments. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La Guerre des civilisations : Introduction à l’œuvre de Feliks Koneczny, publié en 2025. Dans cet ouvrage, Dresse analyse la pensée politique du philosophe polonais Feliks Koneczny et sa théorie des civilisations.
Il a également co-écrit À la rencontre d'un cœur rebelle avec Clotilde Venner, l'épouse de feu Dominique Venner. De plus, il a contribué en tant que préfacier à Definitions: The Texts That Revolutionized Nonconformist Culture, écrit par Giorgio Locchi et récemment traduit et publié en langue anglaise par Arktos.
L'approche philosophique de Dresse offre des voies de libération intellectuelle face aux dogmes moralisateurs. Loin de faire l'éloge du cynisme, son travail aide à décoder la nature souvent trompeuse de la rhétorique révolutionnaire qui, malgré des présupposés apparemment généreux, aboutit fréquemment à des conflits.

Antoine Dresse
Critique de livre : Political Realism: Principles and Assumptions d'Antoine Dresse
Political Realism: Principles and Assumptions d'Antoine Dresse, traduit et publié en 2025 par Arktos Media en partenariat avec l'Institut Iliade, constitue une contribution profonde et intellectuellement rigoureuse au discours sur la théorie politique. À une époque où l'interaction entre l'idéalisme moral et la gouvernance pragmatique est de plus en plus tendue, Dresse offre à ses lecteurs un cadre clarifiant et résolument réaliste pour comprendre la nature de la politique. Cet ouvrage rend non seulement hommage aux penseurs fondateurs du réalisme politique — Machiavel, Thomas Hobbes et Carl Schmitt — mais trace également un chemin unique à travers leurs héritages, offrant une synthèse à la fois érudite et remarquablement lucide.
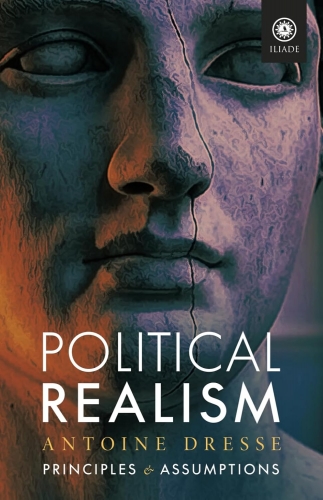
Dès le début, Dresse démantèle l'illusion réconfortante selon laquelle les bonnes idées donnent naturellement de bonnes politiques. L'introduction est un tour de force qui met le lecteur au défi de séparer l'aspiration de la réalité, l'exhortant à reconsidérer la relation fondamentale entre la moralité, la théorie et l'action politique. La précision de Dresse dans la catégorisation des « idées » — en tant qu'impératifs moraux, esprits du temps et modèles conceptuels — donne le ton à l'ensemble de l'ouvrage: prudent, incisif et déterminé à délimiter les phénomènes politiques en tant que tels.
L'une des plus grandes vertus du livre réside dans sa généalogie intellectuelle. Dresse revisite Nicolas Machiavel, tout en ne le percevant pas comme l'archétype du cynique que garde de lui l'imaginaire populaire, mais comme un penseur pionnier de la technique politique — préoccupé par l'action, non par l'abstraction. Il dépeint Machiavel comme un observateur honnête de la nature humaine, qui a refusé de confondre moralité et art de gouverner. L'analyse de Dresse du Prince et des Discours est particulièrement éclairante en attirant l'attention sur le réalisme méthodologique de Machiavel: l'idée que le succès politique exige une attention impitoyable aux circonstances et l'application adaptative des connaissances historiques.
Dans le chapitre sur Thomas Hobbes, Dresse aborde le problème fondamental de l'obéissance et de l'autorité. Il contextualise la théorie politique de Hobbes comme une réponse à la menace existentielle posée par la guerre civile, montrant comment le Léviathan de Hobbes a offert un nécessaire recentrage de la politique autour de la sécurité et de la stabilité. Plutôt que de rejeter le contrat social de Hobbes comme naïf ou mécaniste, Dresse l'apprécie comme une puissante expérience de pensée — conçue pour établir la légitimité du pouvoir dans un monde sans consensus moral.
L'inclusion de Carl Schmitt dans le troisième grand chapitre est un choix opportun. L'œuvre de Schmitt est traitée avec un soin érudit, soulignant son insistance sur l'autonomie du politique et la centralité de la distinction ami/ennemi. Dresse ne recule pas devant les implications de l'argument de Schmitt : que toute dépolitisation du monde — par le droit, l'économie ou la moralité — est intrinsèquement politique en soi. Son analyse accorde le poids voulu à la critique du libéralisme par Schmitt, offrant une sobre lentille à travers laquelle regarder notre ère post-politique.
Ce qui rend Political Realism particulièrement convaincant, c'est qu'il parvient à être lucide sans sombrer dans le cynisme. Dresse ne cherche pas à glorifier la manipulation ou la cruauté; au lieu de cela, il plaide pour une compréhension désintéressée de la politique en tant que domaine propre, régi par sa propre logique. C'est peut-être la correction la plus importante que le livre offre à une époque saturée de confusion idéologique: l'insistance sur le fait que confondre politique avec moralité, économie ou esthétique n'ennoblit aucune d'entre elles — cela ne fait qu'obscurcir la réalité politique et affaiblir la capacité d'action efficace.

L'écriture — magistralement traduite par Roger Adwan — est claire, mesurée et élégante. Malgré sa densité d'idées, le livre reste accessible à un large public intéressé par la philosophie politique, l'histoire ou les affaires contemporaines. La structure, qui progresse logiquement à travers une progression conceptuelle, est facilitée par des notes de bas de page et des références utiles, ce qui en fait une ressource utile pour les nouveaux venus comme pour les théoriciens chevronnés. Sans oublier que le livre est une lecture courte, agréable et facile à digérer.
Political Realism est une intervention de premier plan dans la pensée politique moderne. Il réintroduit le réalisme non pas comme une doctrine, mais comme une disposition nécessaire — une posture intellectuelle qui reconnaît les limites de l'idéalisme humain et les vérités persistantes, souvent inconfortables, de la vie collective. Ce faisant, Antoine Dresse ne se contente pas de répéter les idées des réalistes politiques du passé ; il les revitalise pour une nouvelle génération confrontée aux périls de la dépolitisation et de l'excès idéologique.
Ce livre est un manuel essentiel de Realpolitik pour les universitaires, les étudiants et les militants politiques.
Commander Political Realism: Principles and Assumptions:
https://www.amazon.com/dp/1917646453
Pour commander l'original français:
https://boutique.institut-iliade.com/product/le-realisme-...
19:31 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine dresse, livre, carl schmitt, machiavel, thomas hobbes, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, réalisme politique, réalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 avril 2025
Pléthon, Sparte et Zarathoustra

Pléthon, Sparte et Zarathoustra
Claude Bourrinet
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528
Dans la traduction de 1492 des Ennéades de Plotin, dédicacée à Laurent de Médicis, Marcile Ficin évoque le philosophe byzantin Gémiste, dit Pléthon (1355/1360/26 juin 1452), et le présente « comme un autre Platon », avec qui Cosme discutait des « mystères platoniciens ». La redécouverte du platonisme, à la Renaissance, s’accompagne d’une victoire progressive sur l’aristotélisme (bien que l’on cherchât en général la concordance entre les philosophes), et ce, malgré la résistance des milieux monastiques et la plupart des « réformateurs » de l’Eglise, qui prônaient plutôt le retour aux Pères. La prise de Constantinople en 1453, et le patronage des mécènes médicéens, en particulier de Cosme, fondateur de l’Académie platonicienne florentine, ont favorisé la translatio studii du corpus néoplatonicien et la vision d’une chaîne d’or liant cette tradition de pensée à des sagesses archaïques, comme celle d’Hermès ou de Zoroastre. La venue au Concile de Ferrare/Florence de 1438/1439, auquel participait l’empereur Jean VIII Paléologue, qui visait à réconcilier, en vue d’affronter l’empire turc, les deux parts d’une chrétienté déchirée par le schisme de 1054, notamment par la question du Filioque, a été l’occasion de rencontres fructueuses entre intellectuels grecs et latins. On pourrait penser que Pléthon fût l’un des acteurs de cet échange. N’a-t-il pas rédigé alors, en 1439, un texte sur les différences (appelé couramment De differentiis, publié en grec en 1450 - celle en latin ne le fut jamais- entre Platon et Aristote ? Cette comparaison, restée confidentielle, provoqua une réponse virulente, en 1448/1449, de son adversaire Scholarios Gennade. Ce modèle comparatif allait pourtant inspirer de nombreuses analyses de ce type en Occident. Et si l’étude des sources qui ont nourri les œuvres de Ficin montre bien un démarquage, parfois presque une paraphrase, du philosophe de Mistra, sa personne et ses ouvrages souffrirent d’une occultation qui le firent oublier du monde savant. Une part de ses idées fut utilisée, par Pic de la Mirandole ou par Ficin, en ce qui concerne singulièrement la référence aux prophètes et aux sages de haute antiquité comme Zoroastre.
Toutefois elles furent réorientées dans un sens chrétien, et récupérées pour refonder une Eglise fragilisée par des attaques multiples. Ce qui était loin des préoccupations de Pléthon. Le philosophe de Morée aurait dû, de ce fait, demeurer comme une référence relativement anecdotique, une note en bas de page pour spécialistes de l’histoire de la pensée, d’autant plus que ses livres furent peu édités, quand ils ne furent pas détruits, comme son ouvrage majeur, le Traité des lois, brûlé, à l’exception de quelques feuillets attestant le polythéisme de l’ouvrage, par Georges Scholarios (v. 1405 – 1472), qui l’accusait d’être païen et polythéiste, et, pour tout dire, antichrétien.

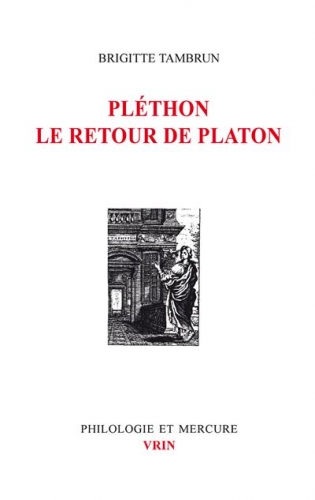
Néanmoins, en recoupant ces passages préservés avec d’autres écrits, il est possible de reconstituer la pensée de Pléthon, ce qu’ont fait François Masai, en 1956, dans son étude Pléthon et le platonisme de Mistra, parue aux éditions « Les Belles Lettres », et Brigitte Tambrun, en 2006, aux éditions Vrin, dans la collection « Philologie et Mercure », dans son ouvrage qui a pour titre Pléthon, le retour de Platon, que je suis de près pour cette étude. Comme il n’est pas question de remplacer des analyses aussi fouillées et solides, surtout celle de Madame Tambrun, qui nous livre en même temps de fort profondes réflexions sur plusieurs auteurs néoplatoniciens et sur l’empereur Julien, je vais me contenter, par cette présentation, de mettre l’accent sur ce qui peut nous importer chez un philosophe méconnu et, apparemment, si étranger à la modernité philosophique.
Situation de Pléthon
- 1) La philosophie des Hellènes à Byzance (source : Alain de Libera ; La philosophie médiévale ; PUF) .
Bien que grecque d’origine, la philosophie, considérée comme « hellénique », est regardée comme étrangère à la pensée religieuse stricto sensu. Du IXe au milieu du XVe siècle, on l’appréhende comme une « science extérieure », une « philosophie du dehors » (exôthen, thurathen), contraire à la « philosophie de l’intérieur », la théologie. Ce statut précaire (puisque sujet à la censure) lui confère une certaine autonomie, contrairement à son rôle de « servante de la théologie » joué dans l’université latine, institution complètement inconnue du monde byzantin. Si la logique d’Aristote et de Porphyre est utilisée dans l’élaboration de la théologie trinitaire, elle n’est pas déterminante comme instrument de la théologie dans son ensemble. Le fossé entre corpus philosophique et religion va se creuser, au XIVe siècle, avec le palamisme mystique et le courant hésychaste (la doctrine palamite, antiphilosophique, est devenue, en 1352, la théologie officielle de l’Eglise orthodoxe). L’enseignement supérieur est octroyé, à titre privé, pour former les hauts fonctionnaires, ce qui entraîne que de nombreux lettrés, à Constantinople, sont laïcs. Pléthon appartient à ce cénacle. Les polémiques entre philosophes et théologiens, comme en Occident chrétien, sont peu probables entre deux univers qui ne se rencontrent pas. En revanche, toute affirmation de l’un, pour rare qu’elle soit, entraîne des conséquences radicales. L’empire byzantin, qui laissait tomber en ruine ou transformait les monuments de Grèce antique, se voulait l’ennemi déclaré de l’hellénisme. Sans remonter à la fermeture de l’Ecole platonicienne d’Athènes, en 529, par Justinien, Jean Italos, sous l’empereur Alexis Comnène (1081 – 1118), va être condamné à la relégation dans un monastère pour neuf articles tès hellènikès athéotètos gémonta, « emplis d’athéisme hellénique », autrement dit « païen ».
Pléthon lui-même, sous la pression du haut-clergé, fut contraint, bien qu’il fût relativement protégé par Manuel II Paléologue, de s’exiler à Mistra, citadelle laconienne, à Sparte (et c’est déjà tout un programme), centre du renouveau de la pensée antique, où l’empereur lui octroya une magistrature (et, un peu plus tard, le despote de Morée, Théodore, fils de Manuel II, lui accorde, en 1427, par un argyrobulle, un domaine en pronoia, propriété provisoire – puis héréditaire - qui lui permet de percevoir , en gouverneur, ou képhalis, des droits sur les paysans, moyennant service (douleia) rendu au souverain, et lui assure les moyens de vivre, ainsi qu’une relative indépendance, à l’abri des poursuites de l’Eglise). Mais son retour à l’hellénisme, plus ou moins affiché (nous verrons qu’il s’adressait à une élite) provoqua un conflit violent avec le monothéisme chrétien. De fait, la décadence byzantine ouvrait des perspectives de renaissance d’une Grèce renouant avec un passé qu’on aurait voulu oublier, ou soumettre, en le trahissant, à une autre Weltanschauung.

- 2) Un monde culturel multipolaire
La gigantomachie qui oppose le monde musulman au monde chrétien, et, à l’intérieur de celui-ci, depuis la prise de Constantinople par les Latins en 1204, (mais, religieusement, bien avant), le heurt entre Eglise d’Orient et Eglise d’Occident, elle-même ébranlée par des schismes depuis 1378 (papes contre anti-pape(s), pape Eugène IV, élu en 1431, contre le Concile de Bâle, ou les hérésies (par exemple celle de Jean Hus, brûlé le 6 juillet 1415), ouvrent, paradoxalement, et, somme toute, fort logiquement, un espace de remise en question(s) des certitudes idéologiques, et autorisent un approfondissement des identités.
Nous avons vu que la nécessité militaire motivait un rapprochement entre l’Orient chrétien et l’Occident. En fait c’était une soumission qui était exigée, moyennant l’acceptation du controversé Filioque, qui plaçait sur le même plan ontologique le Père et le Fils (conception d’une grande importance politique : elle induit la relation, égalitaire ou hiérarchique, de l’Etat et de la société). Pléthon, anti-unioniste, comme Marc d’Ephèse (Marc Eugénikos), contrairement au célèbre Bessarion, s’était élevé contre ce qu’il considérait comme une abdication, ce qui lui avait permis, sous couvert de critiquer le thomisme, de s’en prendre directement, au nom de Platon, à l’aristotélisme.
Quant à l’Islam, empreint de tradition néoplatonicienne, Byzance n’était pas sans recevoir son influence philosophique, même si l’Eglise, acculée par les désastres militaires, s’arc-boutait sur l’orthodoxie strictement religieuse (le même pendant se retrouvant dans le sunnisme, par exemple les Docteurs de la Loi, les ‘olama d’Alep, ceux-là mêmes qui prononcèrent contre Sohravardi le takfir, et le vouèrent à la mort). Il se trouve justement que Georges Scholarios, pour nuire à adversaire, prétendait tenir « de nombreuses personnes qui ont bien connu Pléthon dans sa jeunesse », qu’il s’était rendu « à la cour des barbares », sans doute Andrinople, et qu’il y avait fréquenté « un Juif très influent », Elissaios (Elisha). Scholarios ajoute qu’en fait, le « maître » (didaskalos) de Pléthon n’était pas un Juif, mais un païen (hellênistês), un « polythéiste » (polutheos), qui lui aurait fait connaître « les doctrines concernant Zoroastre et les autres ».

Or, l’une des sources de la falsafa, outre Aristote, Plotin, Proclus, qu’on essayait de concilier, un commentateur « persan », influencé par le soufisme, héritier des anciens Perses et restaurateur de la doctrine de Zoroastre, est Sohravardi, dont la pensée était alors très active. Même si le projet du penseur iranien et celui de Pléthon divergent (« Pléthon voit dans la résurrection du platonisme une arme de salut pour l’indépendance hellénique, une juste politique, une renaissance spirituelle dirigée contre la double menace, latine et turque. Sohravardi situe d’emblée son projet au niveau de l’ontologie pure et de la véritable signification du monothéisme. La vérité du Livre saint est pour lui un essentiel souci. Revenir à la sagesse de l’ancienne Grèce, de l’ancienne Perse, ce n’est pas contester l’islam, mais en approfondir le sens » (Christian Jambet, introduction au Livre de la sagesse orientale, traduit par Henri Corbin), il n’en demeure pas moins que la doctrine du prophète du Mazdéisme permettra à ce dernier non seulement de contester la prétention des chrétiens de faire remonter la sagesse archaïque à Moïse, mais aussi d’asseoir une conception large de la religion capable de subsumer toutes croyances positives ancrées dans les périodes postérieures à Zoroastre, et, de ce fait, inférieures. Cette perception d’un sacré évolutif, et néanmoins toujours le même, malgré des dissemblances apparentes, ne sera pas sans conséquences pour son projet que l’on pourrait appeler « métapolitique ».
- 3) Un cul de sac géopolitique
La situation politique, militaire de l’empire byzantin est alors désespérée. Dans son Mémoire pour Théodore, Pléthon écrit : « Nous n’avons actuellement besoin de rien moins que d’être sauvés : nous voyons, en effet, ce qu’est devenu l’Empire des Romains. Toutes nos cités sont perdues, il nous en reste juste deux en Thrace, plus le Péloponnèse, encore pas tout entier, et l’une ou l’autre petite île. » Pire : après la bataille de Maritsa, les Byzantins durent payer aux Ottomans le haradj et participer aux expéditions du sultan. L’empire était vassalisé. Les Turcs, comme d’ailleurs Vénitiens et « Francs », interviennent parfois dans les querelles internes des Grecs. Les ports et le commerce, en outre, étaient le monopole des Italiens. Il ne faut pas oublier que la reconquête du Péloponnèse (la Morée) se fit contre les « Francs », les Latins, singulièrement la famille champenoise de Villehardouin, dont les ruines du castel, au sommet de la colline de Mistra, attestent encore la puissance.
Mais au fond, ce morcellement territorial et politique, non seulement rappelait l’état anarchique de l’Hellade antique, finalement si propice à l’éclosion de la pensée, mais aussi donnait loisir aux réfractaires de se réfugier quand c’était nécessaire, ou de jouer sur les oppositions d’intérêts. La faiblesse pouvait s’avérer une force, à condition que l’on trouvât le moyen de dispenser une sécurité et une durée suffisante à chaque nation, pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même, ce qui était loin d’être assuré pour un empire byzantin qui était réduit à la dimension d’une province prise en étau, et à la merci d’un dernier coup de boutoir.

L’espoir demeurait : en 1429, presque tout le Péloponnèse était reconquis, hormis les possessions vénitiennes. Malheureusement, l’assaut final de 1453 mettra fin aux rêves de reconquête et de renaissance nationale. Auparavant, la victoire ottomane de Varna, en 1444, avait enlevé tout espoir de salut au despotat de Morée récemment devenu royaume. Le défi que va essayer de relever Pléthon, non sans courage, sera de restaurer les conditions intellectuelles, morales et politiques pour retrouver l’indépendance nationale. Toutefois, ce dessein, bien que prenant une distance audacieuse avec la prétention de l’empire à incarner l’universalisme chrétien, n’est pas un programme « laïc ». Il n’est nullement moderne, c’est-à-dire ne se soustrait pas au rapport puissant qui existe entre la théologie, la science du divin, et un mode opératoire civique qui s’avère être une application nécessaire des principes sacrés. Pour Pléthon, ce qui s’impose « là-bas » doit ordonner, mettre en ordre, ici-bas. C’est pourquoi, avant d’exposer les préceptes politiques du conseiller de Manuel et de Théodore, convient-il d’énoncer la doctrine relative aux choses divines, proposée par le philosophe de Mistra.
Théologie
- 1) Une doctrine « secrète »
L’ouvrage le plus important de Pléthon, le Traité des lois, dont il reste des partie substantielle souvent reproduite dans l’étude de François Masai, et qui a été intégralement publiées en 1987 (édition B. Tambrun-Krasker), est tenu pour un livre secret, peut-être destiné à ceux de son entourage qu’il nomme sa « phratrie ». La prudence entre pour une bonne part dans cette volonté d’extrême discrétion (le sort du livre le démontre assez bien), car, d’inspiration païenne et polythéiste, il y enseigne la théologie selon « Zoroastre », et présente les bases de sa réforme, la politeia lakônikê, le régime spartiate qu’il préconise (moins la dureté extrême de son éthique).
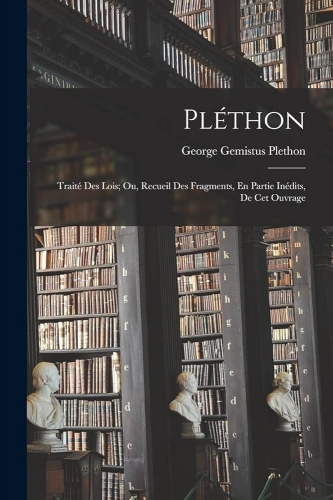
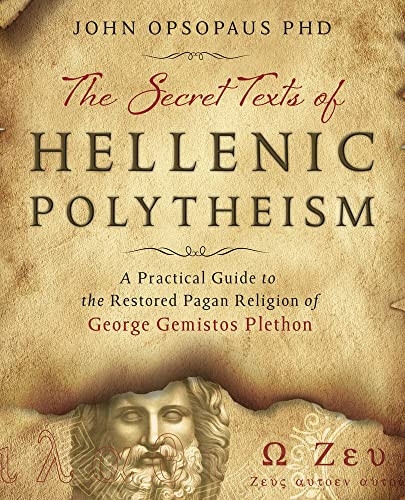
Cependant, cette dissimulation d’une partie du message, qui se concrétise, dans l’ouvrage, en deux parties qui semblent parfois se répéter, reprend la méthode des études platoniciennes, qui comportent deux niveaux, en fonction de l’approfondissement du disciple. La deuxième partie livrerait donc un enseignement plus « ésotérique », ce que recoupe aussi ce qu’avance la tradition, que Platon livrait oralement une doctrine secrète, s’inscrivant dans la « chaîne d’or » des sages d’antique mémoire, instruction seulement réservée à une élite.
- 2) Contre l’aristotélisme
Nous avons évoqué l’ouvrage de Pléthon, En quoi Aristote est en désaccord avec Platon, appelé De differentiis, et sa participation au concile de Ferrare/Florence. Pour lui, il ne s’agit pas de concilier les religions entre elles, ni Aristote et Platon. L’échec du concile de Florence, imputé en partie à la méthode utilisée, le syllogisme aristotélicien, qui n’aboutit qu’à une éristique stérile, concile qui débattait de la question du Filioque, mais visait expressément à une absorption de l’Eglise d’Orient par celle d’Occident, montrait que cette ambition était vaine, sinon absurde. En fait, jamais le schisme n’avait paru si évident. Au demeurant, Pléthon ne vise pas seulement la christianisation d’Aristote dans le thomisme, mais Aristote lui-même, plus précisément sa dissidence par rapport à Platon. Il lui reproche d’ignorer le dieu créateur, et de ne penser l’Être qu’en logicien. Il dénonce aussi chez lui sa position ambiguë sur l’immortalité de l’âme.
- 3) Retour à l’hellénisme
Pléthon va renverser totalement la théologie historique et sapientielle des chrétiens. La question du Filioque, pour abstruse qu’elle passe au regard des modernes, est d’une importance majeure. « Les Grecs enseignent que l’Esprit Saint procède du Père, tandis que les latins affirment qu’il procède du Père et du Fils » (B. Tambrun). Pléthon, à la suite de Marc d’Ephèse, souligne que la dernière assertion induit la présence de deux « causes » et de deux « principes » d’origine dans la Trinité, ce qui est contraire à la conception hellénique (explicitée dans la Lettre II, 312e, attribuée à Platon) qui soutient l’existence d’une hiérarchie interne au divin. Le retour à l’hellénisme est aussi une réaction contre le palamisme, dont le centre de diffusion est précisément Mistra (Défense des saints hésychastes, de Grégoire Palamas), dont l’irrationalisme mystique, encouragé par la théologie négative (le Bien est au-dessus de la parole), contredisait directement le rationalisme hellénique, et enjoignait, plutôt que de choisir Platon ou Aristote, de s’en remettre à Jésus et Moïse : « La folle philosophie des sages du dehors ne comprend donc pas et ne révèle pas la sagesse de Dieu » (Cf. Paul, dans la Première Lettre au Corinthiens, par exemple : « Et nous n’en parlons pas dans le langage qu’enseigne la sagesse humaine… »). Enfin, pour Platon, le principe de non-contraction était une garantie de la vérité, et les polémiques entretenues entre théologiens monothéistes, orthodoxes ou hérétiques, sont autant de « sophismes ». Car les dieux ont déposé dans notre âme rationnelle des « notions communes », dont Zoroastre saura formuler les vérités, léguées au fil des âges.

- 4) Retour à Zoroastre
La justification d’une doctrine, avant les Temps modernes, se situe aux origines, dans le passé le plus reculé. Pour discréditer une doctrine adverse, il est nécessaire de prouver qu’elle est une « nouveauté », ce que ne manquera pas de faire Pléthon à propos des monothéismes, qui appellera des « sophismes », et qui sont, pour lui des dégradations d’une sagesse archaïque transmise par une « chaîne » de guides (hodêgoi). Il s’agit donc de trouver quel a été le plus ancien législateur, qui a été le maître (didaskalos) originel. Les chrétiens, à la suite de Justin martyr, qui situe Moïse cinq mille ans avant le Christ, puis de Tatien, Clément d’Alexandrie, qui décrit un Logos pédagogue se servant de la Loi et des prophètes, Origène et Eusèbe de Césarée (au début de L’Histoire ecclésiastique), et en se référant aux historiens juifs, comme Artapanus, Eupolemus, Philon d’Alexandrie et Flavius Josèphe, ont avancé le thème du larcin : Platon devrait tout à Moïse. Clément et Eusèbe citent le pythagoricien Numénius : « Qu’est-ce en effet que Platon, sinon un Moïse qui parle attique ? » Il s’agit donc, pour Pléthon, de découvrir la date à laquelle Zoroastre a professé sa doctrine, ses principes (arkhas). Dans le Traité des Lois, Pléthon dit que Zoroastre est « le plus ancien des législateurs et des sages dont nous ayons mémoire », qu’il a été « pour les Mèdes et les Perses et la plupart des autres anciens de l’Asie l’interprète le plus illustre des choses divines et du plus grand nombre des autres grandes questions. » Ayant vécu 5000 ans avant la guerre de Troie (d’après Plutarque – en fait, l’auteur des Gathas – Zarathoustra, en avestique - prophète des Aryens (« Nobles »), peuple indo-européen originaire du nord-est de l’Iran, a peut-être vécu vers -1700), il est à l’origine d’une chaîne d’or qui aboutit à Pythagore et Platon. Il serait aussi, pour Pléthon, l’inspirateur des Oracles chaldaïques, qui, sous Marc-Aurèle, auraient été recueillis par deux théurges chaldéens, Julien le Père, et son fils Julien, et transmis par Psellos (XIe siècle). Ils seraient, une fois rattachés à la tradition des « mages », des révélations philosophiques du prophète iranien, que Pléthon purgera des scories chaldaïques et chrétiennes, et qui constitueront le « centre de gravité » (Brigitte Tambrun, qui en reproduit une traduction) de son système. Ils « présentent l’itinéraire de l’âme, sa descente dans le corps, le service qu’elle doit accomplir sur terre, puis sa remontée ».

Le terme « mage » est étranger, ici, à la tradition chrétienne. Majûs, en arabe comme en persan, désigne les « Anciens Sages de la Perse », à ne pas confondre avec les « Mages mazdéens », adeptes du dualisme, contrairement à Zoroastre, qui affirme un principe unique à l’origine du monde. En grec, magos peut se référer à celui qui pratique la theôn therapeia, le culte des dieux, ou au goês, le magicien. La confusion peut s’effectuer aussi, en grec, entre mages et Chaldéens (qui s’occupent d’astronomie, et qui peuvent être rattachés, de près ou de loin, à la tradition zoroastrienne). Le but de Pléthon est de disqualifier le monothéisme en évinçant Moïse de la liste des sages primordiaux. Il détaille une liste de législateurs, dont le dénominateur commun est avant tout l’immortalité de l’âme, base morale de toute application des lois : d’abord Zoroastre, puis Eumolpe, Minos, Lycurgue, Iphitos et Numa. Trois de ceux-ci représentent la Crète, Sparte et Rome. Ensuite, il évoque les brahmanes de l’Inde, ou gymnosophistes, les mages de Médie, et les Courètes. Il faut s’attarder sur ces desservants de Zeus, qui exécutent, dans un bruit étourdissant, une danse en armes énergique.
Pour Pléthon, ils sont les défenseurs et les conservateurs de la tradition polythéiste. Ils ont un rôle éthique et militaire. Selon la mythologie, grâce à eux, les géants, allégorie du monothéisme, qui assaillaient les dieux, ont été défaits. D’autre part, ils sont des prêtres de Zeus, autrement dit le premier principe, et le philosophe hellène porte un intérêt particulier pour l’oracle de Zeus à Dodone, peut-être le plus antique « centre de la fondation de l’hellénisme », dont les prêtres, les Selloi, ou Helloi, portent un nom hautement significatif. Pléthon récuse l’approche mystique du divin, sa vision directe, illustrée par le courant néoplatonicien et les palamites. L’écoute lui paraît plus adéquate. Il mentionne aussi Polyide, que Minos consultait, puis le centaure Chiron, éducateur de héros, enfin des sages, rattachés au courant pythagoricien et platonicien, Pythagore, Platon, Parménide, Timée, Plutarque, Plotin, Porphyre et Jamblique. Le philosophe néoplatonicien, Proclus, l’un des membres de l’Ecole d’Athènes, fermée par Justinien, qui s’exilèrent en Perse en 529, et qui est assidûment étudié à Byzance, est absent de cette liste (en même temps qu’Homère, Orphée : Pléthon se méfie des poètes ; quant à Hermès, la confusion qu’on en a fait avec Moïse le pousse à le refuser).
- 5) Sohrawardi
Avant d’expliquer pourquoi Proclus est rejeté, il faut revenir sur la découverte que fit Pléthon, dans sa jeunesse, auprès d’Elisha, un Juif, mais en fait un hellênistês, peut-être un disciple de l’école du platonicien Sohrawardi, de Zoroastre et des mages de Perse, ce qui permettra d’en comprendre les raisons. La doctrine de celui qui revivifia l’avicennisme par un retour aux sages iraniens est un philosophe de la lumière orientale, c’est-à-dire de la lumière qui se lève. Or, pour Sohrawardi, la lumière n’est pas une métamorphose, ou pas seulement, mais aussi le principe métaphysique qui manifeste tout existant, et lui donne tout l’éclat de l’Etre. Du premier principe au bas de l’échelle des êtres, tout est régi par un même lien. La lumière s’oppose aux Ténèbres, ce en quoi consiste l’enseignement des Sages de l’ancienne Perse. Le symbolisme de la lumière et du feu, omniprésent dans les Oracles chaldaïques, sera essentielle dans la théologie de Pléthon. Pour bien en saisir l’essence, il est nécessaire de les lire dans l’ouvrage de B. Tambrun, et de parcourir les commentaires qui les accompagnent. Mais pourquoi Pléthon a-t-il dédaigné le grand Proclus, malgré l’insinuation de Scholarios qu’il en fît sa source cachée ?
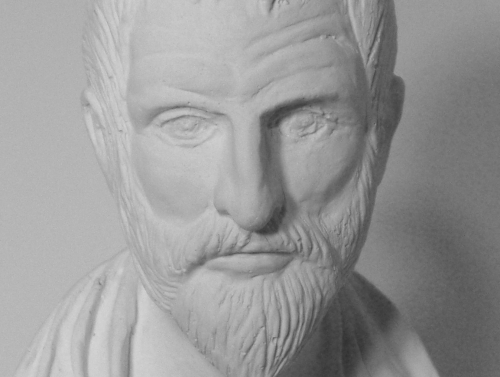
- 6) Rejet de Proclus et d’une partie du néoplatonisme, notamment l’apophatisme.
Les points communs entre les deux philosophes platoniciens appartiennent à la tradition néoplatonicienne (B. Tanbrum en donne la liste, que je reproduis en la raccourcissant p. 153-154-155) : composition d’une théologie à partir de Platon et des Oracles, existence d’un premier principe qui est cause (aitia), production du monde sensible par l’intermédiaire d’un monde intelligible, pluralité unitaire des dieux, conçus comme des idées, divinisation des planètes et des astres fixes, dégradation progressive de l’être, rapport proportionnel entre les causes et leur mode de production, existence de plusieurs ordres de réalité, de plusieurs ordres de dieux, dont le nombre est fini, et dont les deux principes primordiaux sont le limitant et l’illimité. De plus, la génération des dieux diffère selon les différents niveaux ontologiques, les réalités divines sont produites, chaque ordre dérive d’un seul principe, il y a communauté entre les dieux, les propriétés des dieux et leurs attributions ne sont pas équivalentes, chaque dieu a son rang, il y a ressemblance des dérivés par rapport aux êtres dont ils sont issus. Les points divergents ont, en revanche, des conséquences majeures : la théologie scientifique de Proclus se fonde sur le « Parménide », traité de théologie de Platon qui a influencé aussi Plotin. Or, il est à la source de l’apophatisme païen et chrétien.

Pléthon, fortement inspiré par l’Hymne à Zeus, d’Aristide Aelius, s’oppose aussi bien au pseudo-Denys qu’à Grégoire Palamas et à Thomas d’Aquin, et surtout aux acquis du concile de Nicée au sujet du Divin. Pour le néoplatonisme, le premier principe est transcendant de manière absolue, il est « hors de tout et incoordonné à ses dérivés ». Proclus dit : ce dieu est « au-delà des premiers aduta, plus ineffable que tout silence et plus inconnaissable que toute existence ». Or, Pléthon « procède exclusivement par voie de théologie affirmative ». Le dieu ne se cache pas. Pour lui, il est communicable (sauf le fait d’être par soi), il n’est pas absolument transcendant, même s’il est un et unique. Surtout, il est générateur, démiurge, démiurge des démiurges. Zeus est désigné par de très nombreuses qualifications : il est père, démiurge et roi, c’est-à-dire basileus ou autokrator ; il est dit maître, c’est-à-dire despotês absolu, tandis que Proclus identifie le démiurge comme troisième père de la première triade des dieux intellectifs. « Pour Pléthon, le premier dieu est aussi dit réellement être, et être en soi (autoôn), véritablement un et un en soi (autoen), bon en soi (autogathos), parfait en soi (autotelês) ; il est véritable Janus ; il est aussi qualifié d’inengendré, de bienheureux au plus haut degré ; il est noble par essence, il est doux ; il est cause ultime et premier chef, le plus haut de tous (panupertatos), tout-puissant (pagkratês), engendrant toutes choses (paggenetôr) », enfin « être par lui-même (auto dia sauton) ». Nous verrons quelles les implications politiques d’une telle capacité de l’homme à pouvoir connaître le premier dieu.
- 7) Une théologie polythéiste
Pléthon est résolument polythéiste. Il s’agit d’un polythéisme hiérarchisé, dont les divinités sont énumérées dans l’ordre d’une « échelle », terme désignant les taktika de l’époque, les titres et fonctions de la nomenclature impériale, et de ceux qui leur sont subordonnés. Il développe cette vision dans son « livre secret », le Traité des lois, celui-là même, et pour cette raison, qui encourra l’ire de Scholarios. Il reprend les noms des dieux de la tradition grecque, mais en leur faisant subir des distorsions (diastrophas), en les « redressant » par la réflexion, et en les transformant de façon à y placer une intention rationnelle. Ses dieux sont des « Dieux-Idées », que le néoplatonisme utilise régulièrement. Sans exposer une théogonie assez savante et subtile, et non moins cohérente (voir le tableau de B. Tambrun page 159, avec son exégèse), il est nécessaire d’en présenter la logique.
- 8) Une théologie généalogique
La clé de cette théologie – opposée à celle du néoplatonisme, pour qui l’on n’est pas le genre suprême, est la conception d’un panthéon généalogique. Les Dieux-Idées ne sont pas hétérogènes, ils sont apparentés, engendrés, « et sortent l’un de l’autre », à partir de l’Être-Un-Bien : « […] Zeus, premier principe et première cause, engendre deux « genres » (genê), c’est-à-dire deux familles, de dieux hypercosmiques, et celles-ci engendrent à leur tour les autres êtres » (B. Tambrun). « Zeus engendre le deuxième dieu qui est aussi le deuxième père, Poséidon ou l’ousia, (le Noûs, l’Intellect de Plotin), et de lui proviennent des générations de dieux et d’êtres », jusqu’à la matière. Il s’agit là d’un système en miroir, « chaque niveau de l’ousia reflétant le niveau immédiatement supérieur ». Tous les êtres sont donc rassemblés en un seul genre, eph’ hen genos.

La fraternité hiérarchique préside le monde des dieux, et le monde terrestre en est l’analogie. « Le monde est bien un kosmos, un bel ordonnancement où les êtres sont assignés à une place et à un rang déterminé ». Le mal en est exclu. Pléthon est résolument optimiste. En outre, la matière est exempte de toute uniformisation et réduction, d’arasement rationaliste, car le mode de génération est fondé sur le processus de la division par dichotomie, qui est explicitation et création (démiurgie), du sommet de l’être à la base, et par production de l’altérité, qui est le double inverse du producteur. Le principe de l’identité-altérité conduit le monde, donc, à ce titre, est accessible à la raison dans sa richesse liée à sa diversité, et liant l’universel au particulier. C’est pourquoi le problème religieux est appréhendé selon le mode du « même » (l’arkhê zoroastrien générant la théorie des déclinaisons de la sagesse éternelle) et de l’ « autre » (les différentes philosophies, religions et Eglises qui ont existé au fil des âges, avec leurs langues, leurs particularités ethniques, historiques, et se sont plus ou moins éloignées de l’origine). Une théologie universelle est donc possible, « située au niveau des formes intelligibles », ces « notions communes » qui donnent la possibilité de compréhension d’un monde où tout est uni selon le même principe, sont des symboles, semés « en puissance » par le démiurge, que chaque âme possède pour saisir la raison des êtres.
Politique
Pléthon reprend la conception byzantine qui veut que le modèle politique prenne sa source dans celui de la théologie. Cependant, pour lui, il n’existe pas de peuple élu, chaque civilisation ayant sa propre raison d’être.
- 1) Les origines de la catastrophe, selon Pléthon
Tout membre de l’empire, au XVe siècle, pour peu qu’il eût quelque lumière de l’antiquité, devait être saisi par le contraste tragique entre la misère des temps et la grandeur de la Grèce païenne. D’où cette catastrophe prenait-elle sa source ? Les souvenirs de Saint Augustin et les circonstances de la rédaction de La Cité de Dieu reviennent à l’esprit. L’évêque d’Hippone répondait en effet aux détracteurs du christianisme, à ceux qui expliquaient la prise de Rome, en 410, par Alaric, par l’abandon des divinités ancestrales de l’Urbs. De même, Julien, à la suite de ceux qui prônaient une restauration des cultes polythéistes, avait tenté de renouer le fil brisé des dieux.

Et que dit Pléthon ? Il constate que le démembrement de l’empire des Rhomaioi est dû aux luttes intestines, mais aussi à la faillite de l’idéologie monothéiste. Le simple fait de perdre sa puissance, à l’époque, « prouve » que l’on est abandonné de Dieu. Après avoir vaincu les dieux nationaux, l’empire chrétien a imposé un culte qui s’est voulu universel, et que l’on avait l’intention d’étendre à la terre entière. C’était le postulat eusèbien qui repose la vérité religieuse sur la puissance de la monarchie constantinienne, argument qui se retourne en ce quinzième siècle, époque qui est l’aboutissement d’une série de catastrophes. Outre ce réquisitoire d’ordre idéologico-historique, Pléthon recourt à une critique interne à la conception qu’a Eusèbe du modèle politique de la monarchie. En effet, en considérant le pouvoir divin, prototype de la monarchie, comme une triade (la Trinité nicéenne), et non comme une monade, en posant l’identité entre le Père et le Fils (contre l’arianisme), il instaure une isotomia, c’est-à-dire une égalité d’honneurs, une égalité entre principes divins qui devraient être hiérarchisés, et postule donc deux causes à la réalité du monde, donc à la structure politique de l’empire. L’universalité monothéiste « orthodoxe » devient non seulement une coquille vide, mais aussi le modèle de l’impuissance politique, d’autant plus qu’il est menacé par d’autres monothéismes, celui des Latins et celui de l’Islam ottoman.
- 2) Un programme de restitutio politique
Les institutions des anciens Grecs ayant fait leurs preuves, il convient de s’en inspirer. Contre les ploutocrates, ou la trop grande pauvreté, Pléthon recommande que les conseillers du prince fussent instruits et vivant dans une aurea mediocritas. S’inspirant de Sparte, (si la terre exerce une influence déterminante sur la pensée, il n’est pas indifférent que ce fût sur l’antique sol de Lacédémone qu’il soumit à ses compatriotes les instruments de leur salut) et constatant que le modèle du paysan corvéable, ou celui du mercenaire intéressé, ne sont pas viables, dans le Mémoire pour Théodore, le Mémoire pour Manuel (1418) et le Traité des lois, il propose une refondation du corps social en trois classes bien distinctes. « En toute cité ou presque, la première classe, la plus nécessaire et la plus nombreuse, est celle des producteurs, écrit-il dans le Traité des lois, c’est-à-dire des agriculteurs, des pâtres et de tous ceux qui se procurent directement les fruits de la terre », ceux qu’il nomme les « hilotes », en souvenir de Sparte. La deuxième classe (qui n’est mentionnée que dans le second Mémoire) est intermédiaire et tenue dans un état d’infériorité. Elle aide à produire (les ouvriers agricoles) ou à se procurer des produits (les négociants). Cette « classe » en est à peine une : en homme de la terre, Pléthon rejette le mercantilisme et le modèle oligarchique vénitien, et prône l’autarcie économique. La troisième classe est celle des dirigeants (les « gardiens » de Platon et les « philosophes »), c’est-à-dire l’armée, l’administration (les archontes), le basileus (l’empereur). Cette classe ne peut exercer efficacement son office qu’en étant dégagée des soucis de la production et des tentations du négoce, donc en étant nourrie par les deux autres par un impôt sur le revenu (en nature), cet impôt étant par ailleurs réparti en trois parts (en fait deux) : pour les producteurs et les propriétaires (mais la terre est commune et concédée par l’Etat), et pour ceux qui assurent la sécurité. Ces trois (deux en fait) strates sont attachées par l’intérêt réciproque, la vertu, et la fidélité à des valeurs communes. Pléthon propose donc un système d’armée permanente, loyale et solide, un corps civique préoccupé d’abord du souci national, de la patrie, plutôt que du sort de l’Eglise et de la religion, telles qu’elles sont dans le cadre de l’empire. D’autre part, les fonctions civiles et militaires seront bien distinctes. Enfin, il insiste, dans son traité de 1439, Des vertus, sur la nécessité d’appliquer vigoureusement ces lois, application illustrant la vertu des dirigeants.

- 3) La cité vertueuse
Toutes les exhortations destinées aux responsables politiques, à Manuel, à Théodore, aux nobles, visent à ce qu’ils ne désespèrent pas de la cause grecque, et qu’ils se persuadent que la victoire dépend de la fidélité à des principes et à des valeurs. La puissance d’un Etat tient aux idées qui régissent son organisation, et à la vertu des hommes qui l’incarnent. Un exemple parmi d’autres, du lien entre principes spirituels et comportement, est la source des succès musulmans. Pléthon y décèle deux causes : d’abord, la conviction que l’âme est immortelle, croyance qui rend la mort moins redoutable, et même, d’une certaine façon, qui la présente sous un jour favorable, dans le cadre du jihad, puis la certitude que le destin (Mektoub, « ce qui était écrit », l’équivalent arabe du fatum) mène le jeu, que la liberté (au sens moderne) n’existe pas (de là peut-être son intérêt pour l’astronomie, peu dégagée, à l’époque, de l’astrologie, et qu’il explicite dans un manuel), et que chaque sort est imparti par une nécessité transcendante, conviction qui libère l’énergie en prodiguant à l’être la sensation de se réaliser pleinement, sans crainte d’être paralysé par l’assaut de choix fallacieux, facteurs d’hésitations nuisibles.
Dans le Traité du Destin, contenu dans le Traité des lois, il compare les humains à des douloi, des esclaves, (ils sont « sous la main », hupo kheira) – les fonctionnaires sont des esclaves de la chose publique, des douloi tou koinou - esclaves dont le sort ne peut être malheureux sous l’emprise d’un bon maître (cf. notre mot « ministre », minister, « serviteur », dérivé de ministerium, « ministère », « devoir », « service »). Le tout est de prendre conscience de cette « nécessité », et, pour le reste, de faire confiance à la volonté divine. La force des armées ottomanes, pour Pléthon, est à comparer favorablement avec celle des anciens Hellènes, qui mettaient très haut, à un niveau supérieur à celui des dieux, la Moïra, issue de l’ousia de Zeus, l’ Heimarmenê des stoïciens, la « part », le « lot » de chaque être. Pour Pléthon, c’est Héphaistos, «préposé à la « stasis », au repos, au maintien, fixe « à chacun son domaine et sa place » » (B. Tambrun).
L’hybris, par exemple, est la tentative vaine de transgression de ces limites imparties par le destin. « […] véritablement trois Parques (Moirai) tiennent sous leur garde vigilante la parfaite réalisation de ce que chacun des Dieux a décidé par la plus excellente délibération », écrit-il dans le Traité des lois. Le droit naturel est conditionné par les idées adéquates sur le monde divin. Celles-ci ont pour base le constat que le monde terrestre est intimement uni, par analogon, au monde céleste, que les dieux gouvernent toutes choses, avec rectitude et justice.
Pléthon, à l’opposé des pratiques cultuelles des fidèles, notamment dans les monastères, considère que, le « divin » (thèîon) octroyant à chaque être la part qui lui revient selon ce qui lui convient, il est inutile de vouloir le fléchir ou le flatter. La divinité n’a pas besoin des hommes. La piété consiste dans la reconnaissance des biens qui proviennent de là-haut. Du reste, l’éthique, la morale, le comportement des hommes doivent se moduler sur le Bien, équivalant à l’Un et à l’Être en soi. Autant dire que l’homme, comme Dieu, est bon. La morale de Pléthon est optimiste. Il s’éloigne par-là de la tradition néoplatonicienne. En effet, pour elle, la vertu supérieure consiste à se séparer le plus possible du corps et des richesses matérielles. Il faut procéder à un éloignement de la vie d’ici-bas, comme le préconise Platon dans le Théétète : « … il faut, le plus vite possible, s’enfuir d’ici, là-bas ». La « justice » doit tendre vers l’intelligence, la tempérance, le courage, et la sagesse, qui est contemplation des êtres. Or Pléthon « introduit une restriction considérable à l’imitation de Dieu par l’homme ». Il est beaucoup plus proche de la morale stoïcienne.

L’homme étant placé à la limite (methoriôi) entre la matière périssable et le monde divin immortel, auquel nous sommes apparentés, l’âme se trouvant entre deux genres de formes (il emploie le terme metaxu), le composé humain étant methorion et sandesmos, limite commune et lien de l’univers, , mélange (mixis), son pneuma rendant possible cette jonction, il appartient à deux patries qui, au fond, ne forment qu’une Cité. Il est redevable de la société (koinônia), cette société s’étendant verticalement et horizontalement, et étant fondée sur le principe de l’association, une « sympathie » vis-à-vis de tout ce qui survient. Il « se trouve au centre de la « cité complète des êtres » (tôn ontôn têi pantelei têide polei). Il est un centre nodal. L’homme est donc à la ressemblance des dieux. Comme eux, il doit se charger de son lot de devoirs. Il possède une véritable mission. De lui dépend l’harmonie universelle. Il doit tenir son poste, son rang dans la société et le monde. Il est copula mundi, car il est le lien entre plusieurs cercles concentriques, sa famille, sa patrie, son domaine, sa terre, l’univers. Son action est un service, une leitourgia. Il est en effet le médiateur par excellence, celui par qui passent les dimensions de l’être, et il prend la place du Christ. Nouvel Hercule, il ne peut se soustraire à sa tâche. Là est sa dignité. La doctrine théologico-politique de Pléthon est une propédeutique à l’action.
- 4) Un Etat monarchique analogue au monde divin
La structure de l’empire doit être calquée sur celle de la famille. Cette notion, d’origine commune et de filiation, est essentielle pour Pléthon. Il rejette la conception d’un empereur « lieutenant de Dieu sur terre », d’un empire à vocation militaire. Certes, le monde politique reflète l’archétype divin, l’ordre céleste. Mais chaque strate, si elle est semblable par l’origine ultime avec celle qui la précède et l’engendre, en est en même temps différente. Chaque maillon de la chaîne hiérarchique possède sa « part », son rôle, son devoir. L’empereur, comme le premier dieu, fonde une lignée, qui est une diffusion hiérarchique de la puissance politique. Mais chaque « fils », ou chaque condition est une créature à part entière. Il n’existe pas, chez Pléthon, cette abolition des limites, des puissances intermédiaires entre le pouvoir central et les exécutants, comme l’implique la conception palamite, qui supprime la distance entre l’homme et Dieu, et, finalement, aboutit à un écrasement, à un nivellement universel. Chaque rouage recrée le pouvoir transmis, comme les dieux le font dans le domaine. Le basileus, qui n’est pas un magistrat (il n’est pas élu), n’est pas un tyran. Il est certes, pour ainsi dire, partout à la fois, mais il délègue son pouvoir. Il doit exister des « centres de relais décisionnels entre [l’empereur] et ses sujets ». Il « faut une adaptation des décisions impériales à la variété des réalités locales ».

- 5) Le genos comme paradigme universel
On voit par là que le modèle généalogique est un paradigme politique. Toute sa pensée est régie par ce principe universel. « Or déjà Plotin (Ennéades, VI, 1 [42] 2 et 3) montrait que si l’ousia était un genre unique (ou une unique catégorie), cela ne pourrait être qu’au sens où les Héraclides forment un seul « genos », non parce qu’ils ont tous un prédicat commun, mais au sens où ils sont tous issus d’un seul (aph’ henos) ». Cette référence aux Héraclides (Hêrakleidôn kathodos), leur retour dans le Péloponnèse, qui est à l’origine de la « race » des Grecs, est mise en parallèle avec le retour des frères de l’empereur Jean VIII Paléologue, en qui il voit l’aube d’une renaissance hellénique. C’est à cette fin qu’il invoque le « germe » d’où peut resurgir la puissance hellénique, Sparte-Mistra, en plein cœur du Péloponnèse, le berceau de l’âme de l’Hellade. Il écrit en effet à Manuel II : « … nous, que vous gouvernez et dont vous êtes l’empereur nous sommes Hellènes de genos, comme l’attestent notre langue et la culture de nos pères. Et pour les Grecs il n’est pas possible de trouver un pays qui leur soit plus propre et qui leur convienne mieux que le Péloponnèse et toute la partie de l’Europe qui lui est contiguë ainsi que les îles adjacentes. En effet, c’est manifestement le pays que les Grecs eux-mêmes ont toujours habité, du moins d’après les souvenirs que les hommes ont conservés ; personne d’autre ne l’avait habité avant eux et aucun étranger ne l’a occupé ».
- 6) Un monde apaisé
D’après Georges de Trébizonde relate qu’à Florence, Pléthon aurait prédit qu’il n’y aurait plus qu’une seule religion. Il ne s’agissait évidemment pas de concilier l’inconciliable, c’est-à-dire des dogmes figés par le temps et des certitudes ancrés dans des préférences chauvines. Le concile de Ferrare-Florence en avait montré l’inanité. Or, le retour à l’Arkhê, aux origines de la sagesse primordiale portée par Zoroastre, le premier Sage à partir de qui est engendrée cette « chaîne d’or » qui passe par Pythagore et Platon, « apparaît comme particulièrement propre à servir de référence commune à une multiplicité d’Etats bien cloisonnés qui pourront disposer chacun d’une version particulière de cette doctrine ». Pléthon a conscience que le platonisme irrigue la philosophie musulmane chiite de Perse et la tradition byzantine, et constate qu’il se répand en Occident latin. Ce substrat spirituel commun ne va-t-il pas être reconnu universellement, et servir, non à une fusion des particularités nationales, qui est impossible, et de toute façon non souhaitable, mais à une entente, plutôt à une écoute capable de juguler les expansionnismes, et même d’asseoir une paix universelle fondée sur la quête harmonieuse de la vie vertueuse ? Des notions sont communes à ces civilisations, comme la reconnaissance de réalités intelligibles, la thèse de l’immortalité de l’âme. D’autre part, le polythéisme rectifié peut souffrir d’être perçu, par les théologies qui en nient le principe, comme une relation d’Idées acceptable. Les coutumes seraient donc sauvegardées, avec leurs spécificités politiques, les constitutions idoines (Pléthon s’oppose cependant à la vision qu’avait Julien l’empereur de dieux ethnarques (ou d’anges, selon le Pseudo-Denys), divinités tutélaires des nations), mais une cohabitation pacifique serait possible grâce à un référent conjoint, pour ainsi dire par la reconnaissance d’un même paggenetôr, chaque nation étant elle-même genos (suggeneis, « de même parenté »), c’est-à-dire reflet du modèle divin.
14:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, pléthon, byzance, hellénité, polythéisme, hellénisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 avril 2025
Carl Schmitt et la résistance tellurique au système

Carl Schmitt et la résistance tellurique au système
par Nicolas Bonnal
Il y a dix ans, pendant les fortes manifs des jeunes chrétiens contre les lois socialistes sur la famille (lois depuis soutenues et bénies par la hiérarchie et par l’ONG du Vatican mondialisé, mais c’est une autre histoire), j’écrivais ces lignes :
« Deux éléments m’ont frappé dans les combats qui nous occupent, et qui opposent notre jeune élite catholique au gouvernement mondialiste aux abois : d’une part la Foi, car nous avons là une jeunesse insolente et fidèle, audacieuse et tourmentée à la fois par l’Ennemi et la cause qu’elle défend ; la condition physique d’autre part, qui ne correspond en rien avec ce que la démocratie-marché, du sexe drogue et rock’n’roll, des centres commerciaux et des jeux vidéo, attend de la jeunesse.»

L’important est la terre que nous laisserons à nos enfants ne cesse-ton de nous dire avec des citations truquées ; mais l’avenir c’est surtout les enfants que nous laisserons à la terre ! Cela les soixante-huitards et leurs accompagnateurs des multinationales l’auront mémorisé. On a ainsi vu des dizaines milliers de jeunes Français – qui pourraient demain être des millions, car il n’y a pas de raison pour que cette jeunesse ne fasse pas des petits agents de résistance ! Affronter la nuit, le froid, la pluie, les gaz, l’attente, la taule, l’insulte, la grosse carcasse du CRS casqué nourri aux amphétamines, aux RTT et aux farines fonctionnaires. Et ici encore le système tombe sur une élite physique qu’il n’avait pas prévue. Une élite qui occupe le terrain, pas les réseaux.
Cette mondialisation ne veut pas d’enfants. Elle abrutit et inhibe physiquement – vous pouvez le voir vraiment partout - des millions si ce n’est des milliards de jeunes par la malbouffe, la pollution, la destruction psychique, la techno-addiction et la distraction, le reniement de la famille, de la nation, des traditions, toutes choses très bien analysées par Tocqueville à propos des pauvres Indiens :
« En affaiblissant parmi les Indiens de l'Amérique du Nord le sentiment de la patrie, en dispersant leurs familles, en obscurcissant leurs traditions, en interrompant la chaîne des souvenirs, en changeant toutes leurs habitudes, et en accroissant outre mesure leurs besoins, la tyrannie européenne les a rendus plus désordonnés et moins civilisés qu'ils n'étaient déjà. »


Et bien les Indiens c’est nous maintenant, quelle que soit notre race ou notre religion, perclus de besoins, de faux messages, de bouffes mortes, de promotions. Et je remarquais qu’il n’y a rien de pire pour le système que d’avoir des jeunes dans la rue (on peut en payer et en promouvoir, les drôles de Nuit debout). Rien de mieux que d’avoir des feints-esprits qui s’agitent sur les réseaux sociaux.
J’ajoutais :
« Et voici qu’une jeunesse montre des qualités que l’on croyait perdues jusqu’alors, et surtout dans la France anticléricale et libertine à souhait ; des qualités telluriques, écrirai-je en attendant d’expliquer ce terme. Ce sont des qualités glanées au cours des pèlerinages avec les parents ; aux cours des longues messes traditionnelles et des nuits de prières ; au cours de longues marches diurnes et des veillées nocturnes ; de la vie naturelle et de la foi épanouie sous la neige et la pluie. On fait alors montre de résistance, de capacité physique, sans qu’il y rentre de la dégoutante obsession contemporaine du sport qui débouche sur la brutalité, sur l’oisiveté, l’obésité via l’addiction à la bière. On est face aux éléments que l’on croyait oubliés. »
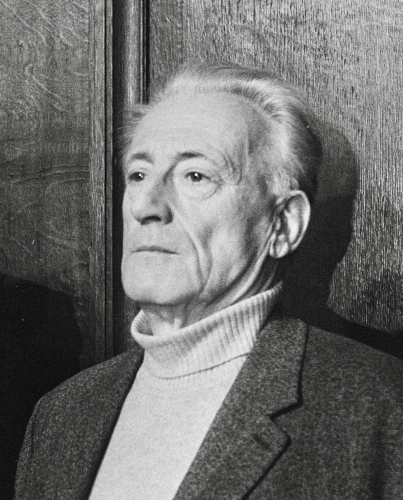
Enfin je citais un grand marxiste, ce qui a souvent le don d’exaspérer les sites mondialistes et d’intriquer les sites gauchistes qui reprennent mes textes. C’est pourtant simple à comprendre : je reprends ce qui est bon (quod verum est meum est, dit Sénèque) :
« Je relis un écrivain marxiste émouvant et oublié, Henri Lefebvre (photo), dénonciateur de la vie quotidienne dans le monde moderne. Lefebvre est un bon marxiste antichrétien mais il sent cette force. D’une part l’URSS crée par manque d’ambition politique le même modèle de citoyen petit-bourgeois passif attendant son match et son embouteillage ; d’autre part la société de consommation crée des temps pseudo-cycliques, comme dira Debord et elle fait aussi semblant de réunir, mais dans le séparé, ce qui était jadis la communauté. Lefebvre rend alors un curieux hommage du vice à la vertu ; et il s’efforce alors à plus d’objectivité sur un ton grinçant.
Le catholicisme se montre dans sa vérité historique un mouvement plutôt qu’une doctrine, un mouvement très vaste, très assimilateur, qui ne crée rien, mais en qui rien ne se perd, avec une certaine prédominance des mythes les plus anciens, les plus tenaces, qui restent pour des raisons multiples acceptés ou acceptables par l’immense majorité des hommes (mythes agraires).

Le Christ s’exprime par images agraires, il ne faut jamais l’oublier. Il est lié au sol et nous sommes liés à son sang. Ce n’est pas un hasard si Lefebvre en pleine puissance communiste s’interroge sur la résilience absolue de l’Eglise et de notre message :
Eglise, Saint Eglise, après avoir échappé à ton emprise, pendant longtemps je me suis demandé d’où te venait ta puissance.
Oui, le village chrétien qui subsiste avec sa paroisse et son curé, cinquante ans après Carrefour et l’autoroute, deux mille ans après le Christ et deux cents ans après la Révolution industrielle et l’Autre, tout cela tient vraiment du miracle.
Le monde postmoderne est celui du vrai Grand Remplacement : la fin des villages de Cantenac, pour parler comme Guitry. Il a pris une forme radicale sous le gaullisme : voyez le cinéma de Bresson (Balthazar), de Godard (Week-end, Deux ou trois choses), d’Audiard (les Tontons, etc.). Le phénomène était global : voyez les Monstres de Dino Risi qui montraient l’émergence du citoyen déraciné et décérébré en Italie. L’ahuri devant sa télé…

Il prône ce monde une absence de nature, une vie de banlieue, une cuisine de fastfood, une distraction technicisée. Enfermé dans un studio à mille euros et connecté dans l’espace virtuel du sexe, du jeu, de l’info. Et cela donne l’évangélisme, cette mouture de contrôle mental qui a pris la place du christianisme dans pas le mal de paroisses, surtout hélas en Amérique du Sud. Ce désastre est lié bien sûr à l’abandon par une classe paysanne de ses racines telluriques. Je me souviens aux bords du lac Titicaca de la puissance et de la présence catholique au magnifique sanctuaire de Copacabana (rien à voir avec la plage, mais rien) (photo) ; et de son abandon à la Paz, où justement on vit déjà dans la matrice et le conditionnement. Mais cette reprogrammation par l’évangélisme avait été décidée en haut lieu, comme me le confessa un jour le jeune curé de Guamini dans la Pampa argentine, qui évoquait Kissinger.
J’en viens au sulfureux penseur Carl Schmitt, qui cherchait à expliquer dans son Partisan, le comportement et les raisons de la force des partisans qui résistèrent à Napoléon, à Hitler, aux puissances coloniales qui essayèrent d’en finir avec des résistances éprouvées ; et ne le purent. Schmitt relève quatre critères : l’irrégularité, la mobilité, le combat actif, l’intensité de l’engagement politique.
En allemand cela donne : Solche Kriterien sind: Irregularität, gesteigerte Mobilität des aktiven Kampfes und gesteigerte Intensität des politischen Engagements.
Tout son lexique a des racines latines, ce qui n’est pas fortuit, toutes qualités de ces jeunes qui refusèrent de baisser les bras ou d’aller dormir : car on a bien lu l’Evangile dans ces paroisses et l’on sait ce qu’il en coûte de trop dormir !
Schmitt reconnaît en fait la force paysanne et nationale des résistances communistes ; et il rend hommage à des peuples comme le peuple russe et le peuple espagnol : deux peuples telluriques, enracinés dans leur foi, encadrés par leur clergé, et accoutumés à une vie naturelle et dure de paysan. Ce sont ceux-là et pas les petit-bourgeois protestants qui ont donné du fil à retordre aux armées des Lumières ! Notre auteur souligne à la suite du théoricien espagnol Zamora (comme disait Jankélévitch il faudra un jour réhabiliter la philosophie espagnole) le caractère tellurique de ces bandes de partisans, prêts à tous les sacrifices, et il rappelle la force ces partisans issus d’un monde autochtone et préindustriel. Il souligne qu’une motorisation entraîne une perte de ce caractère tellurique (Ein solcher motorisierter Partisan verliert seinen tellurischen Charakter), même si bien sûr le partisan – ici notre jeune militant catholique - est entraîné à s’adapter et maîtrise mieux que tous les branchés la technologie contemporaine (mais pas moderne, il n’y a de moderne que la conviction) pour mener à bien son ouvrage.
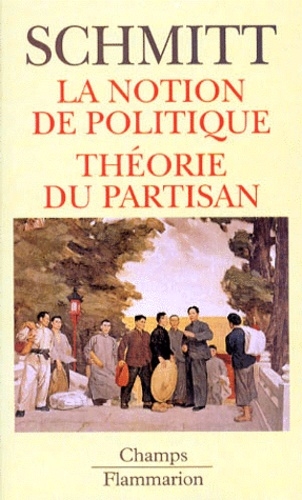 Schmitt reconnaît en tant qu’Allemand vaincu lui aussi en Russie que le partisan est un des derniers soldats – ou sentinelles – de la terre (einer der letzten Posten der Erde ; qu’il signifie toujours une part de notre sol (ein Stück echten Bodens), ajoutant qu’il faut espérer dans le futur que tout ne soit pas dissous par le melting-pot du progrès technique et industriel (Schmelztiegel des industrielltechnischen Fortschritts). En ce qui concerne le catholicisme, qui grâce à Dieu n’est pas le marxisme, on voit bien que le but de réification et de destruction du monde par l’économie devenue folle n’a pas atteint son but. Et qu’il en faut encore pour en venir à bout de la vieille foi, dont on découvre que par sa démographie, son courage et son énergie spirituelle et tellurique, elle n’a pas fini de surprendre l’adversaire.
Schmitt reconnaît en tant qu’Allemand vaincu lui aussi en Russie que le partisan est un des derniers soldats – ou sentinelles – de la terre (einer der letzten Posten der Erde ; qu’il signifie toujours une part de notre sol (ein Stück echten Bodens), ajoutant qu’il faut espérer dans le futur que tout ne soit pas dissous par le melting-pot du progrès technique et industriel (Schmelztiegel des industrielltechnischen Fortschritts). En ce qui concerne le catholicisme, qui grâce à Dieu n’est pas le marxisme, on voit bien que le but de réification et de destruction du monde par l’économie devenue folle n’a pas atteint son but. Et qu’il en faut encore pour en venir à bout de la vieille foi, dont on découvre que par sa démographie, son courage et son énergie spirituelle et tellurique, elle n’a pas fini de surprendre l’adversaire.
Gardons une condition, dit le maître : den tellurischen Charakter. On comprend que le système ait vidé les campagnes et rempli les cités de tous les déracinés possibles. Le reste s’enferme dans son smartphone, et le tour est joué.
Bibliographie
Carl Schmitt – Du Partisan
Tocqueville – De la démocratie I, Deuxième partie, Chapitre X
Guy Debord – La Société du Spectacle
Henri Lefebvre – Critique de la vie quotidienne (Editions de l’Arche)
21:55 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, philosophie politique, carl schmitt, nicolas bonnal, politologie, tellurisme, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


