Archives de Synergies Européennes - 1987
Le déclin de la pensée conservatrice et la renaissance de la nation
par Günter MASCHKE
 Toute mouvance politico-idéologique est la résultante d'une situation politique donnée. Elle articule les aspirations d'une classe sociale identifiable et développe ses concepts en opposition à l'univers mental d'un ennemi concret. La base sociale d'une mouvance politico-idéologique en est à la fois le récipient et le moule : si la forme meurt, ou si le contenant se brise, l'esprit peut-être survivra mais il ne fera que virevolter sur les décombres d'un passé dont il se réclamera d'abord sur un ton tragique, puis sur le mode nostalgique, enfin de façon grotesque.
Toute mouvance politico-idéologique est la résultante d'une situation politique donnée. Elle articule les aspirations d'une classe sociale identifiable et développe ses concepts en opposition à l'univers mental d'un ennemi concret. La base sociale d'une mouvance politico-idéologique en est à la fois le récipient et le moule : si la forme meurt, ou si le contenant se brise, l'esprit peut-être survivra mais il ne fera que virevolter sur les décombres d'un passé dont il se réclamera d'abord sur un ton tragique, puis sur le mode nostalgique, enfin de façon grotesque.
L'esprit alors sombre dans l'arbitraire, il devient la proie d'aspirations naguère encore étrangères, qui se servent de lui comme d'un paravent idéologique lorsqu'elles vont pêcher des âmes aux lisières de leur terrain de chasse. L'esprit devient une arme au service de forces nouvelles, tantôt celles-ci, tantôt celles-là, avec d'autant plus de facilité que sa forme même se défait, que ses contours deviennent flous, incertains. Il se transforme alors en auxiliaire utile de décisions qui lui sont étrangères, et lorsque ces dernières, s'étant servi de lui, parviennent à leurs fins, il lui arrive de croire que leur victoire est la sienne.
Le conservatisme allemand : un cadavre mercenaire
C'est précisément le destin de la pensée conservatrice en Allemagne que d'avoir fait un bout de chemin avec des orientations étrangères, voire adverses. Plus encore que les idéologies concurrentes, dont la base sociale s'est effritée plus lentement et plus tardivement (1), elle a succombé à l'érosion intellectuelle et au plongeon dans le n'importe-quoi. En Allemagne, le conservatisme est mort en 1870-1871 (2), avec le déclin de l'aristocratie foncière, au plus tard lors de la fondation de l'empire bismarckien, mais les conservateurs, eux, ont survécu. Ils sont devenus les objets, souvent actifs certes, des processus politiques et de l'évolution de la société. Plus l'acte de décès du conservatisme était ancien, plus l'idéologie conservatrice devenait fortuite, improvisée et lacunaire, et plus s'imposait à l'esprit la question de savoir ce qui pouvait bien encore être «conservateur».
Déjà, sous la République de Weimar, les réponses abondaient. Dans celle de Bonn, tout débat sur le conservatisme s'ouvre encore par des tentatives de définition qui s'organisent chaque année, selon un rituel immuable, autour de sondages pour des revues, de symposiums, d'anthologies, etc... ; la plupart du temps avec les mêmes orateurs qui ne font que répéter avec componction ce qu'ils disaient déjà trois, cinq ou dix ans auparavant.
Trois grandes étapes politiques jalonnent le déclin de la pensée conservatrice : la fondation du Reich allemand, la phase finale de la République de Weimar et la création de la République fédérale. À chaque fois, le conservatisme fut partie prenante et agissante : sous Bismarck comme force, avant et sous Hitler comme facteur, avec Adenauer comme climat intellectuel. En s'alliant au courant politique incarné tout à tour par ces dirigeants, le conservatisme essaya toujours de sauver la mise à court terme. Comment d'ailleurs eût-il pu faire autrement : ses principes s'étaient évaporés et n'étaient plus applicables au réel. À chaque fois, bien qu'avec toujours moins de conviction, il crut pouvoir décider du cours des événements, du moins en partie, et fut régulièrement victime délit force à laquelle il croyait s'unir alors qu'il se livrait à elle pieds et poings liés. Après chaque liaison, d'abord heureuse, puis malchanceuse, il retomba affaibli et désemparé, essayant en vain de faire un minimum de clarté sur ses propres structures et sur sa substance. C'est invariablement à lui que furent imputés les errements, réels ou supposés, d'un partenaire bien plus puissant qui l'avait entraîné dans sa course.
Le Reich bismarcko-wilhelminien, coupable – dit-on – de la Première Guerre mondiale, aurait été, selon la lecture contemporaine, un système « conservateur ». Le Reich hitlérien, dont le caractère criminel et la fin sanglante étaient, dit-on encore, prévisibles dès le début, n'aurait été que l'exacerbation d'un conservatisme militant puisque, pour l'idéologie dominante, le « fascisme » est contenu en puissance dans l'idéologie conservatrice. Même le parti et le gouvernement du pauvre Helmut Kohl se voient aujourd'hui appelés par leurs adversaires politiques, de façon volontairement diffamatoire mais qui fait mouche, les « conservateurs ». Comme souffre-douleur, le conservatisme a pour lui l'éternité. Mais cela ne prouve en rien son existence.
Le conservatisme à la remorque du libéralisme, de Weimar et du nazisme
L'alliance avec Bismarck, ci-devant conservateur ultra, amena le gros des conservateurs à accepter le césarisme, lequel paie toujours tribut à la démocratie et à la souveraineté populaire (3), à hausser les épaules quand une couronne légitime (celle du Hanovre) fut mise à la trappe, à s'accommoder du socialisme d'État avec tous ses effets centralisateurs et bureaucratiques et à célébrer les fastes du nationalisme et de l'étatisme. En acceptant comme « moindre mal » la Révolution d'en haut contre la Révolution d'en bas (qui menaçait déjà), le conservatisme a perdu dès cette époque sa liberté d'action et sa capacité à mettre en œuvre une stratégie propre. C'est un pragmatisme instruit par sa propre misère qui l’a poussé à la « trahison ». Avec la seconde phase de l'Empire, c'est-à-dire le wilhelminisme, dont la façade militaro-junkérienne arrive encore aujourd'hui à berner de nombreux observateurs, le conservatisme se mit à la remorque du libéralisme. C'est justement parce qu'il arborait un profil politique bas que le libéralisme put réaliser en Allemagne son programme avec toute la frénésie qui le caractérise : expansion économique, impérialisme, construction d'une flotte de guerre. La politique d'encerclement de l'Allemagne fut la réponse de l'étranger à son ascension trop tardive, laquelle, à l'instar de celle, plus précoce, de l'Angleterre et de la France, ne fut guère qu'un déchaînement d'énergies libérales. Quant à l'« étatisme » de façade de l'Allemagne, il était là pour donner bonne conscience aux réactions émotionnelles de l'étranger.
Après 1918, le conservatisme perdit assez rapidement ses illusions monarchistes et s'essaya à la critique du wilhelminisme, y compris à sa substance libérale. Confronté à la faiblesse de la démocratie et du libéralisme, il comprit que cette faiblesse était complice de l'oppression et de l'exploitation de la nation allemande par les puissances victorieuses. Ces dernières, grâce au diktat de Versailles et à la SDN de Genève, pratiquaient elles aussi le libéralisme et la démocratie, mais, à l'égard de l'Allemagne, dans un sens « machtpolitisch ». Du coup, il devenait impossible de lutter contre Genève et contre Versailles avec des méthodes libérales. Or, l'antilibéralisme de la Révolution conservatrice, désormais forcée de saper le statu quo, n'était pas logique avec lui-même : cet antilibéralisme-là a toujours été dirigé contre la structure politique interne de la République, jamais contre le libéralisme économique en tant que tel. Non seulement celui-ci devait être maintenu, mais il fallait encore le renforcer : le grand capitaine d'industrie fut célébré au nom du darwinisme social. Hugo Stinnes devenait le Messie. Mieux : ce libéralisme autoritaire s'alliait, de façon plus ou moins diffuse, avec les idéologies corporatistes du « Ständestaat » (4). Il s'agissait, selon la formule de Moeller van den Bruck, de « créer des choses qui vaillent la peine d'être conservées » : Dinge schaffen, deren Erhaltung sich lohnt.Cette formule, qui renferme, paraît-il, la substantifique moelle de la Révolution conservatrice, pouvait être approuvée par n'importe quelle formation politique ! C'était une formule creuse, dépourvue de force mobilisatrice.
Les masses, puisqu'elles existaient, ne pouvaient être mises en mouvement par une idée qui n'était qu'un mélange d'éléments obscurs empruntés à un passé romantisé et à une actualité grisâtre. Et le bavardage sur « la prise en compte du concret » dont les conservateurs avaient, paraît-il, l'apanage sur les autres, n'y changeait rien. Pour une révolution, de deux choses l'une : soit elle a des idées politiques simples (en particulier quant à l'ordre qu'elle veut instaurer) qui s'imposent d'elles-mêmes (les contradictions et la complexité du réel, cela se règle après la victoire). Soit elle arbore une idée floue, élastique, interprétable à volonté et s'adressant à une masse suffisamment nombreuse. L'idéal est la combinaison des deux : illusion de la clarté et illusion de la défense des intérêts de chacun, lesquels se rejoignent harmonieusement dans la communauté du peuple. Or, sur ces deux points, la Révolution conservatrice fut déficitaire. Elle se condamna donc à « suivre » passivement une révolution plus puissante qu'elle, mieux : une révolution réelle dont elle pensait naïvement qu'elle se laisserait contrôler et manipuler.
Après le nazisme, un conservatisme culpabilisé
Inutile d'expliquer ici que le national-socialisme fut une force anti-conservatrice, une force fondamentalement révolutionnaire, du « jacobinisme brun », si l'on veut, du « Rousseau appliqué », selon l'expression de Hans Freyer. Les conservateurs ont attendu jusqu'au lendemain du 20 juillet 1944 pour s'en apercevoir. Beaucoup même attendirent l'après-guerre ! Ils en conçurent un tel sentiment de culpabilité qu'ils mobilisèrent tout leur sens des antiquités historiques pour sortir du placard le conservatisme de papa, celui du XIXème siècle. Se méprenant totalement sur le caractère nécessaire, inéluctable, de ce qui leur arrivait, ils passèrent leur temps à commémorer le conservatisme bavarois, prussien, autrichien, hanovrien, catholique, etc..., y trouvant d'ailleurs matière à polémiques internes : à qui incombait la faute, quand et comment tous leurs malheurs avaient commencé... Bref, un combat d'ombres chinoises en petit comité. Les yeux fixés sur le national-socialisme avec d'autant plus d'horreur qu'on leur reprochait leur collaboration (réelle), ils reconnurent en lui l'Ennemi, celui que déjà leurs ancêtres combattaient : l'État-Moloch, la Grande Machine, la Bête des Profondeurs, « un certain degré de misère avec promotions et uniformes su roulement des tambours » (Burckhardt), avec « le final en point d'orgue : le despotisme sur ses ruines » (Niebuhr).
Tout cela était certes fort plausible, mais les conservateurs n'en revenaient, tout compte fait, qu'aux idylles de leurs grands-pères : eux aussi n'avaient embrassé ces marottes que lorsqu'ils furent défaits. Idylles sur lesquelles venait d'ailleurs se greffer la « théorie du déclin » : de l'absolutisme à Hitler, ce n'était qu'une marche ininterrompue vers le malheur, dont l'aboutissement nécessaire est le communisme, déjà installé sur les bords de l'Elbe. On ne tarda pas, cependant, à s'apercevoir que la situation était à ce point désespérée qu'on ne pouvait faire retour ni au conservatisme du XIXème siècle (la séparation fut d'ailleurs pénible) ni à la Révolution conservatrice, d'autant plus qu'entre-temps, celle-ci était devenue la nouvelle bête noire des conservateurs.
Le « réalisme » et Adenauer
On décida donc d'être « réaliste », ce qui, en l'occurrence, signifia choisir le moindre mal, c'est-à- dire Adenauer. Le communisme, que l'on combattait encore dans les années 50 avec tout le pathos d'une théologie politique vieille de plus d'un siècle, était désormais l'ennemi. Mieux : il était l'ennemi incarné, idéal au contraire de l'autre ennemi, défunt celui-là : le national-socialisme. S'appuyant sur Adenauer, les conservateurs purent ainsi caresser subrepticement leurs tendances anti-nationales et anti-étatiques. Hitler n'avait-il pas été un représentant de l'idée nationale et étatique ? Les conservateurs ne virent pas qu'Hitler était tout autre chose qu'un nationaliste : c'était un impérialiste de la race pour qui le peuple allemand était de la matière première et qui ne se soucia guère de son sort en 1945. En même temps, il avait été le fossoyeur le plus sûr de l'idée d'État. Car de deux choses l'une : ou il existe une relation entre la protection et l'obéissance, ou il n'y a pas d'État. Prisonniers de leurs réactions émotionnelles, jamais totalement surmontées et désormais réactivées, les conservateurs se rallièrent à la thèse des rééducateurs : Hitler, c'était « l'État » et la « nation ». Du coup, tous les appels à une intervention ordonnatrice de l'État, à une politique efficace, à une administration sachant s'imposer, le cas échéant, de façon autoritaire, furent dénoncés comme dangereux, fascistoïdes, totalitaires, etc... Dans ce concert, ce sont les conservateurs qui braillaient le plus fort, oubliant par là même de balayer devant leur porte.
Du libéralisme à la «permissive society »
Il reste que dans les années 1945-1949, il était difficile de prévoir les conséquences d'un libéralisme hostile à l'idée de nation, fait d'impuissance et de soumission empressée, qui n'était pas sans rappeler celui de la République de Weimar. Ces conséquences étaient bien entendu programmées avec Adenauer, cet ancien ennemi juré du Reich. Les impératifs de la reconstruction, l'immense réservoir de discipline de l'Allemagne et le « principe de l'expérience » (Prinzip Erfahrung),cher à Schelsky, camouflèrent, quelque temps encore, la décomposition de la nation et de l'État. En outre, jusqu'aux années 60, les patriarches avaient les rênes du pouvoir bien en mains : Adenauer, Heuss, Schumacher, Kaisen, Ernst Reuter, etc... Nul ne s'avisa alors que ces politiciens étaient ceux de la phase déclinante de Weimar, des hommes prédestinés à inaugurer la grande restauration libérale, elle qui ne reconnaît aucune frontière dictée par l'État et par l'esprit national. C'est elle qui a préparé l'intégration de la majeure partie de l'Allemagne à l'Occident et le remplacement de « Vaterland »(patrie) par « Abendland »(Occident), lequel dégénéra rapidement en « permissive society ».
On ouvrit toutes grandes les portes à un libéralisme économique échevelé, indifférent aux barrières nationales ou étatiques. Le tout avec la bénédiction plus ou moins avouée des conservateurs qui récolteront dans les années 60, avec ahurissement, ce qu'ils avaient contribué à semer. Bien entendu, ils étaient – et sont restés – parfaitement inconscients de leur part de responsabilité. Ils s'empressèrent de s'allier avec ceux qn'Armin Mohler appelle les « Kerenskis de la Révolution culturelle », de Topitsch à Lübbe. Leur seule devise était : « on ne va pas plus loin ! ». Ils voulaient bâtir sur les sables mouvants de l'ordre existant les bunkers à partir desquels s'élancerait la contre-offensive. Ils s'imaginaient naïvement trouver un point d'appui quelconque dans cette réalité. Autrement dit, c'est dans l'économie de marché forcenée d'une masse à qui l'on avait extirpé la conscience nationale et inculqué le primat du « social », que devaient refleurir discipline, droiture, volonté de défense, éthique familiale, insensibilité aux sirènes de la décadence, refoulement de l'égoïsme de masse, résistance aux facilités des ersatz d'existence. Or, quiconque plaide pour l'économie libérale de marché et le système des besoins à satisfaire sans songer à réguler ces forces, par définition expansives, au moyen d'une « idée incontestable », c'est-à-dire un principe supérieur, se condamne à des combats d'arrière-garde sans issue.
L'idéologie conservatrice du « moindre mal » a engendré le déclin actuel
En fin de compte, il s'imagine être « conservateur » et « national » alors qu'il ne fait que renforcer la soumission aux États-Unis – et se retrouve du même coup intellectuellement en deçà du mouvement pacifiste. Car celui-ci, au moins, sait fort bien que la République fédérale est un pays occupé, qu'elle souffre d'un déficit de souveraineté aux effets potentiellement mortels, et que les États-Unis sont nos ennemis. Même si le mouvement pacifiste en arrive à des conclusions absurdes, il reste idéologiquement, pour ce qui concerne le diagnostic du mal, fort en avance sur les conservateurs.
Tout ce qui offusque les conservateurs n'est pas exclusivement certes, mais dans une large mesure tout de même, le résultat de la dénationalisation, de l'illusion européenne, de la foi dans le primat de l'économie et du bien-être, de l'abandon naïf à une Loi fondamentale qui n'est qu'un « cadeau » des vainqueurs et un esclavage accepté avec zèle par les vaincus. Ce n'est pas ici le lieu de critiquer la partitocratie et le parlementarisme. Il reste qu'il n'y a pas de massification et de « déclin culturel » sans destruction de l'identité nationale. Il n'y a pas de disparition de l'éthique sociale sans dénigrement ni démantèlement de l'État, lequel, finalement, ne peut fonctionner que dans une nation qui se veut elle-même. Il n'y a pas de sous-culture de masse américaine sans destruction de la tradition, à laquelle coopèrent avec zèle l'État en place et ses fonctionnaires puisque c'est la condition même de leur carrière et la garantie de leur pouvoir. Dans ce système de faiblesse confortable – je dirais presque : jouissive – aucune ligne de défense n'existe plus. En effet, le «moindre mal» a toujours suffisamment mauvaise conscience pour capituler bientôt sous la pression du plus grand mal, alors même que celui-ci a été identifié.
Avec la CDU, plus rien à défendre ! Avec une optique national-révolutionnaire, un avenir à construire !
L'itinéraire de la CDU, qui incarne toujours, aux yeux de nombreux conservateurs, le « moindre mal », illustre parfaitement cette loi d'airain de la planche savonneuse : « on ne connaît que trop, écrit Ernst Jünger, le visage de la démocratie sur le tard, celle où la trahison et l'impuissance ont lissé leurs stigmates, où tous les ferments de décomposition, tous les éléments morts, allogènes et ennemis ont magnifiquement prospéré ; assurer à tout prix la pérennité du système, voilà leur objectif secret » (5). Situation où il n'y a plus rien à défendre, à tenir, à conserver...
Si les conservateurs veulent encore sauver quelque chose de ce qui leur est cher, il ne leur reste qu'à renouveler le programme de la Révolution conservatrice en le précisant, en le concrétisant et en le radicalisant. Tout est dans le comparatif : pour transposer dans le concret le pays qu'ils recherchent dans leur âme meurtrie, ils devront, s'ils veulent le contempler, se muer en nationaux-révolutionnaires. Bien sûr, Bonn n'est pas Weimar, mais rien n'empêche de considérer ce nouveau Versailles et ce nouveau Genève (« l'Occident », « l'Europe », la « rééducation ») pour ce qu'ils sont : Bonn, c'est un Weimar à la puissance dix, un super-Versailles ! Or, la reconquête de la nation, seule possibilité de sauver ce qui reste du conservatisme, se heurte, outre aux blocages que nous connaissons, au simple fait qu'avant 1933, cette reconquête était relativement facile parce que les couches supérieures de la société d'alors étaient exploitées par leurs « sœurs de classe» des pays victorieux tandis qu'aujourd'hui, devenues partie prenante du système, elles sont elles aussi à la mangeoire. C'est la raison pour laquelle le combat doit s'amorcer « à la base » et non « par le haut ». L'anticapitalisme doit être authentique et non, comme avant 1933, mi-embarrassé mi-démagogique.
Il n'y a plus de nationalisme anticommuniste qui soit possible !
L'entreprise, cependant, apparaît insurmontable parce qu'en Allemagne, la nation est venue « d'en haut » et « de droite », espaces où, depuis l'équipée hitlérienne, d'ailleurs souvent mal interprétée, aucune mobilisation n'est plus possible. Autre chose : il est de plus en plus question de « tentatives » de fonder un parti national. Mais ces projets commettent l'erreur de donner la priorité au combat anticommuniste, ce qui, tout compte fait, n'est qu'un retour à Adenauer et au premier Strauss. Or, ce genre de nationalisme ne mène strictement à rien : la clé de la réunification allemande se trouve au Kremlin, pas dans les orangeries californiennes ! La volonté et la force d'aller l'y chercher sont l'affaire des Allemands et pour cela, ces derniers doivent être prêts à passer des arrangements avec le super-grand de l'Est. Bien sûr, cette volonté, qui doit toujours rester attentive aux périls, n'est pas une panacée, mais sans elle, rien ne peut se faire.
L'actualité nous force à ajouter que toute exigence de réunification qui n'inclurait pas un tel arrangement et n'approuverait pas explicitement la neutralité d'une Allemagne restaurée dans son intégralité territoriale, sera bien évidemment rejetée par les Russes. On l’a vu au printemps et à l'été 1987. Mais si l'on exige qu'il soit mis fin à la « division de l'Europe » (comme si l'Europe était une unité au même titre que l'ancienne Allemagne), moyennant la réunification allemande sous un chapiteau « européen », cette exigence, vue de Moscou, ne pourra être interprétée que comme une déclaration de guerre implicite, même si ce genre de fantasmes tient plutôt du discours d'arrière-salle de café. Ce genre de « propositions » sur la réunification allemande est anti-nationale, étant donné sa vision du passé de l'Allemagne.
La gauche a servi les intérêts américains !
La gauche, en fait, n'a toujours pas compris qu'elle s'est laissée utiliser comme appendice de la rééducation et donc comme servante des intérêts américains. Son pseudo-anti-américanisme consiste en réalité à reprocher aux vainqueurs de ne pas vivre leurs propres impératifs catégoriques. Knut Nevermann et Hans-Jürgen Krahl sont tout aussi victimes de la « pédagogie sociale » que Volker Rühe ou Gerold Tandler. L'hypertrophie moralisatrice d'un côté, le nouveau culte du « juste milieu » de l'autre, se complètent finalement, leur affrontement n'étant en fin de compte que le débat entre deux méthodes différentes de se mettre à plat ventre.
Pourtant, la tâche est aussi démesurée que la défaite est totale, comme est totale l'inconscience quant à la situation de l'Allemagne sous ce super-Versailles. Le premier pas doit être une rupture mentale, voire psychique et affective avec l'entreprise « République fédérale » ; le second un effort de réflexion sérieuse. Les craintes, les palinodies et les scrupules des conservateurs, ce prosaïsme terre-à-terre soit-disant « réaliste » sont parfaitement stériles. Comme toujours, les grandes choses ne viennent que du foisonnement de la vie qui, elle, n'a jamais réellement fécondé la pensée conservatrice et qui, aujourd'hui, se consume dans la mesquinerie de la gestion au quotidien. « Je crois et je soutiens, écrivait Clausewitz, qu'un peuple n'a rien de plus haut à respecter que la dignité et la liberté de son existence..., que la souillure d'une lâche soumission est indélébile... et je tiens la fausse intelligence avec laquelle les petits esprits veulent échapper au danger pour la chose la plus funeste que puissent inspirer la crainte et la peur » (6).
L'acte de naissance d'une nation est souvent la guerre civile. Il y a fort à parier que l'acte de sa reconquête ne soit pas autre chose puisque le pire ennemi de la nation est une partie de celle-ci. Ce n'est pas là du romantisme de western, c'est une déduction plausible après reconnaissance du terrain de la crise. Inter faeces et urinam nascimur !Pendant plus d'un siècle, les conservateurs ont montré des dons pour la métamorphose. Ils ont toujours été les dindons de la farce, qu'ils fussent aveugles, mal-voyants ou bien lucides. Pourquoi ne réussiraient-ils pas à se sacrifier en s'abolissant enfin comme conservateurs afin de ressusciter comme nationaux-révolutionnaires ? Après tout, ce sont eux, sans doute, qui perçoivent le mieux la dépravation de la société contemporaine, qui ont à son égard les réactions émotionnelles les plus fortes. Pour la première fois, une chance réelle s'offre à eux : être à l'avant-garde !
Günter MASCHKE.
(Traduction française de Jean-Louis Pesteil. Texte paru dans l'anthologie intitulée Der Pfahl I, publiée par les éditions Matthes & Sein de Munich en 1987. Adresse : Matthes & Seitz, Mauerkirchestrasse 10, Postfach 86 05 28, D-8000 Mûnchen 86. Cette anthologie, dora un second volume est paru en 1988, est une véritable mine d anti-conformisme. Sa lecture et sa méditation sont obligatoires pour qui veut échapper aux pesanteurs morales, étriquées, rationalistes, philistines).
Notes :
(1) II n'y a pas de socialisme sans un prolétariat qui a une conscience de classe ; il n'y a pas de croyance au progrès sans petite-bourgeoisie en progrès ; il n'y a pas de libéralisme sans une bourgeoisie active ; il n'y a pas de conservatisme sans une aristocratie détentrice des terres. Certes, l'histoire est bien plus complexe que ne l'affirment ces lieux communs du marxisme vulgaire. Mais ceux qui les écartent en viennent finalement à produire des idées bizarres : ils imaginent que ces idéologies de base peuvent être élargies à plaisir sans qu'elles ne perdent ni cohérence ni consistance. Pour comprendre comment s'est opérée la dissolution de la pensée conservatrice, dissolution qui est le résultat de la dissolution de sa classe porteuse, lire : Panajotis Kondylis, Konservativismus : Geschichtlicher Kampf und Untergang, Stuttgart, 1986.
(2) Les conservateurs de la vieille garde, en Prusse, étaient pleinement conscients de cet état de fait mais ils n'en voulaient pas moins demeurer crispés sur leurs positions perdues. Lire : Hans Joachim Schoeps, Das andere Preussen : Konservative Gestalten und Probleme im Zeitalter Freidrich Wilhelms IV, Honnef/Rhein, 1957.
(3) C'est aussi la principale réticence des frères von Gerlach à l'égard de Bismarck. De l'autre côté de la barrière, dans le monde de la gauche, la révérence du césarisme adressée à la démocratie est notée avec un sobre sentiment de triomphe. Voir: P.J. Proudhon, La Révolution sociale démontrée par le Coup d'État du 2 décembre, Bruxelles, 1852.
(4) À ce propos, il convient de se référer à une étude très sérieuse et pleine de sarcasmes, due à la plume du national-socialiste Justus Beyer : Die Ständeideologien der Systemzeit und ihre Überwindung, Darmstadt, 1942.
(5) Ernst Jünger, Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt, Hamburg,1932, S. 236.
(6) Carl v. Clausewitz, Bekenntnisdenkschrift (Februar 1812) ; je cite d'après une édition contemporaine, intitulée Schriften, Aufsätze, Briefe, Bd. 1,Hrsg. Hahlweg, Göttingen, 1966, pp. 688 et suivantes.
 S’inspirant de la revue éponyme, le film de Gerald Potterton, produit par Ivan Reitman, est le symptôme de son époque. Il est l’adolescent qui, au « Qu’ai-je fait pour avoir un fils pareil ! » réponds en hurlant et en branchant sa guitare électrique. C’est ce que raconte Métal Hurlant, film nihiliste et bruyant qui suit les aventures du Loc-Nar, une bille verte symbolisant le mal absolu.
S’inspirant de la revue éponyme, le film de Gerald Potterton, produit par Ivan Reitman, est le symptôme de son époque. Il est l’adolescent qui, au « Qu’ai-je fait pour avoir un fils pareil ! » réponds en hurlant et en branchant sa guitare électrique. C’est ce que raconte Métal Hurlant, film nihiliste et bruyant qui suit les aventures du Loc-Nar, une bille verte symbolisant le mal absolu. Mais les adolescents en ébullition des années 80 trouvèrent dans Métal Hurlant ce que tous les jeunes garçons cherchent : de la bagarre, et des femmes nues. Entre récits d’aventures vaguement pulp et film d’animation, les (anti) héros de Métal Hurlant sauvent, séduisent et couchent avec de splendides jeunes femmes (et parfois dans le désordre). L’exception notable est le personnage de Taarna (personnage aux caractéristiques arthuriennes étonnantes) puisqu’il s’agit d’une femme et qu’elle se bat à moitié nue; et sans coucher avec personne, ni prononcer un mot, d’ailleurs.
Mais les adolescents en ébullition des années 80 trouvèrent dans Métal Hurlant ce que tous les jeunes garçons cherchent : de la bagarre, et des femmes nues. Entre récits d’aventures vaguement pulp et film d’animation, les (anti) héros de Métal Hurlant sauvent, séduisent et couchent avec de splendides jeunes femmes (et parfois dans le désordre). L’exception notable est le personnage de Taarna (personnage aux caractéristiques arthuriennes étonnantes) puisqu’il s’agit d’une femme et qu’elle se bat à moitié nue; et sans coucher avec personne, ni prononcer un mot, d’ailleurs.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
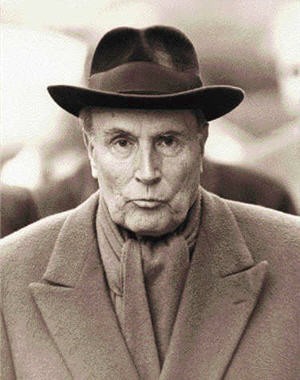
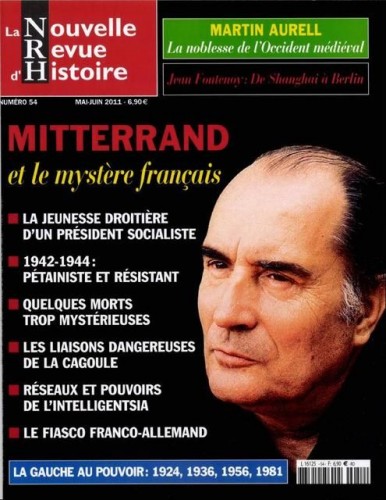
 Toute mouvance politico-idéologique est la résultante d'une situation politique donnée. Elle articule les aspirations d'une classe sociale identifiable et développe ses concepts en opposition à l'univers mental d'un ennemi concret. La base sociale d'une mouvance politico-idéologique en est à la fois le récipient et le moule : si la forme meurt, ou si le contenant se brise, l'esprit peut-être survivra mais il ne fera que virevolter sur les décombres d'un passé dont il se réclamera d'abord sur un ton tragique, puis sur le mode nostalgique, enfin de façon grotesque.
Toute mouvance politico-idéologique est la résultante d'une situation politique donnée. Elle articule les aspirations d'une classe sociale identifiable et développe ses concepts en opposition à l'univers mental d'un ennemi concret. La base sociale d'une mouvance politico-idéologique en est à la fois le récipient et le moule : si la forme meurt, ou si le contenant se brise, l'esprit peut-être survivra mais il ne fera que virevolter sur les décombres d'un passé dont il se réclamera d'abord sur un ton tragique, puis sur le mode nostalgique, enfin de façon grotesque.

