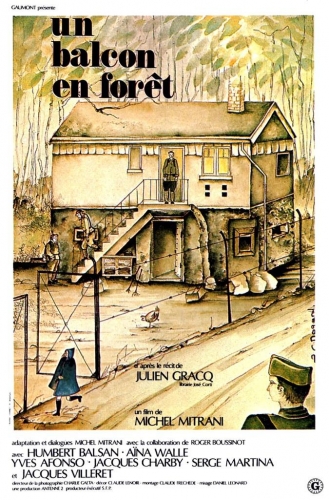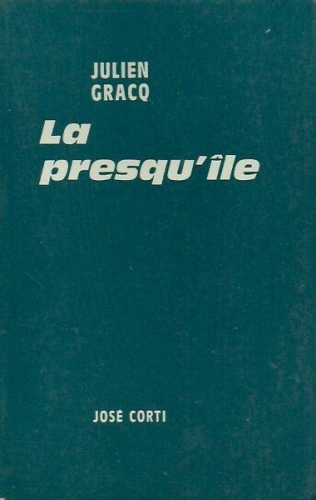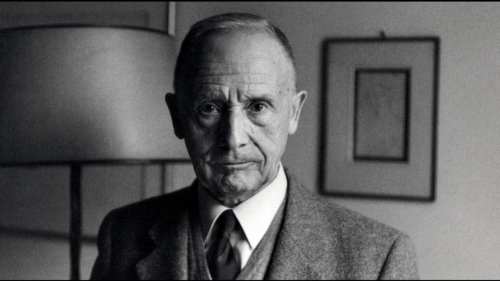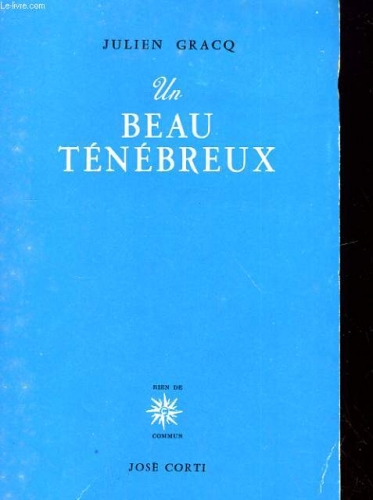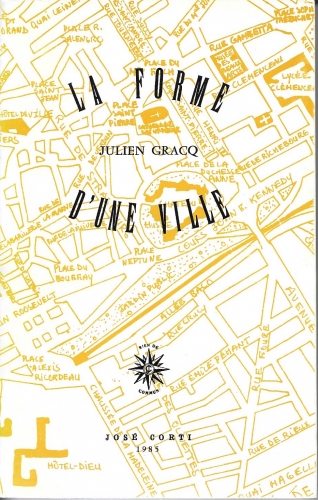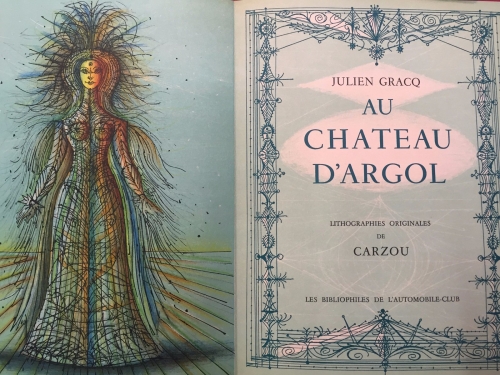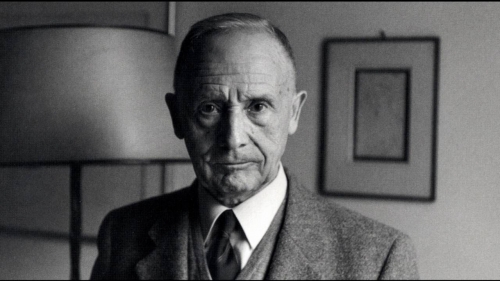La barbarie vivifiante de Julien Gracq
par Fares Gillon
Ex: https://www.philitt.fr
[Cet article est initialement paru dans la revue PHILITT #5 consacrée à la barbarie]
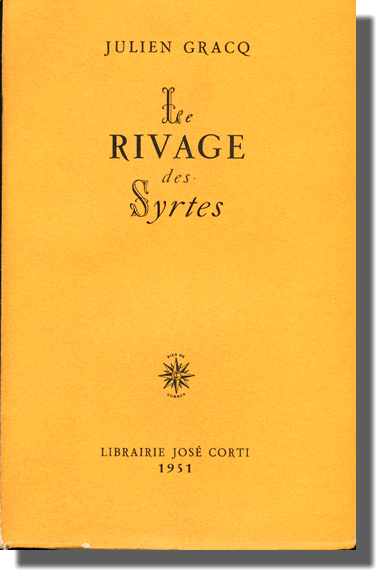 Dans Le Rivage des Syrtes, Julien Gracq prend le contre-pied d’une conception exclusivement négative de la barbarie en la présentant comme un renouveau nécessaire à la revivification d’un vieil État somnolent.
Dans Le Rivage des Syrtes, Julien Gracq prend le contre-pied d’une conception exclusivement négative de la barbarie en la présentant comme un renouveau nécessaire à la revivification d’un vieil État somnolent.
Le Rivage des Syrtes met en scène une vieille cité fictive, Orsenna, qui jouit tranquillement de sa paix, dans la sérénité des cimetières. Autrefois, une guerre l’avait opposée à un monde de l’autre côté de la mer, le Farghestan, civilisation en forme de « mosaïque barbare où le raffinement extrême de l’Orient côtoie la sauvagerie des nomades ». Après quelques escarmouches, « les hostilités languirent et s’éteignirent d’elles-mêmes tout à fait ». Selon un accord tacite, toutes les relations furent coupées, la mer devint une frontière infranchissable, et chacun vécut de son côté comme si l’autre n’existait plus. Durant trois siècles, Orsenna s’est enfoncée dans sommeil sans heurts. Le jeune héros, Aldo, s’ennuie d’une vie de plaisirs mondains et se fait envoyer comme fonctionnaire à l’Amirauté, port censément militaire sur le rivage de la région des Syrtes, qui fait face à l’ennemi tricentenaire, invisible et inconnu. L’inactivité militaire a progressivement fait de l’Amirauté une « bizarre entreprise rentable, qui s’enorgueillissait devant les bureaux de la capitale de ses bénéfices plus que de ses faits d’armes », plus occupée de fermage que de conquêtes ou de défense. « On pouvait enregistrer le progrès de son engourdissement inquiétant, dans le reflux de la vie aventureuse et dans le sourd appel montant de la terre rassurante et limitée. »
La rumeur barbare
Aldo s’étonne de trouver l’Amirauté dans un « état de stagnation », d’« irrémédiable décadence » : « L’aspect habituel du port était celui du profond sommeil », dit-il déçu. Pourtant, il demeure sceptique face à la montée de rumeurs et de « bruits » persistants qui laissent deviner que quelque chose se prépare du côté du Farghestan. Il refuse de les créditer du moindre fond de vérité – alors même qu’il aspire confusément à la nouveauté qui s’annonce, alors même qu’il a précisément quitté Orsenna dans l’espoir de rompre la monotonie de l’existence d’un fils de bonne famille. Lorsque l’administration d’Orsenna l’engage à prendre ces « bruits » plus au sérieux, il est surpris que son scepticisme qu’il croyait de commande ne soit pas partagé en haut lieu ; il franchira pourtant le pas qui précipitera le bouleversement.
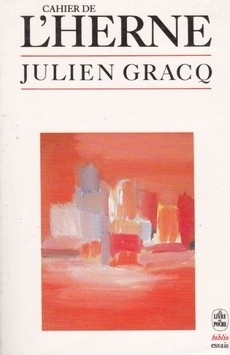 Orsenna est l’image même de l’État stable, depuis si longtemps habitué qu’il en a perdu toute vigueur. « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger », ainsi que le fait dire Gracq à Marino, le commandant de l’Amirauté, très attaché au maintien de cet équilibre, satisfait de l’existence sans surprise qu’il entraîne et inquiet du moindre changement. Mais à la tête d’Orsenna, un nouveau maître a l’ambition de secouer les choses : « Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans le jeu. » Devant un Aldo effaré, Danielo, l’homme fort de la Seigneurie d’Orsenna, expose sa volonté de sauver Orsenna contre elle-même, contre son « assoupissement sans âge », quitte à l’engager sur un chemin de mort et de destruction. « Quand un État a connu de trop de siècles, dit Danielo, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille : alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s’écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent.
Orsenna est l’image même de l’État stable, depuis si longtemps habitué qu’il en a perdu toute vigueur. « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger », ainsi que le fait dire Gracq à Marino, le commandant de l’Amirauté, très attaché au maintien de cet équilibre, satisfait de l’existence sans surprise qu’il entraîne et inquiet du moindre changement. Mais à la tête d’Orsenna, un nouveau maître a l’ambition de secouer les choses : « Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans le jeu. » Devant un Aldo effaré, Danielo, l’homme fort de la Seigneurie d’Orsenna, expose sa volonté de sauver Orsenna contre elle-même, contre son « assoupissement sans âge », quitte à l’engager sur un chemin de mort et de destruction. « Quand un État a connu de trop de siècles, dit Danielo, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille : alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s’écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent.
La sécurité contre la vie
La sécurité dans laquelle végète Orsenna, son assurance que rien ne changera, que les choses resteront toujours ce qu’elles sont, sont les signes de son déclin et de sa momification. Dans une société comme la nôtre où la sécurité est un argument électoral, il peut sembler surprenant que cette dernière soit comprise ici comme le signe de la mort ; c’est que nous confondons la conservation d’une vie individuelle, la bourgeoise « sécurité des biens et des personnes », avec la vie au sens fort. Mais « le monde n’est justifié qu’aux dépens éternels de sa sûreté » : quand on se mure contre les « hasards » et le « jeu », contre l’aiguillon de la vie, on conserve certes son corps et sa tranquillité d’esprit, mais c’est au même titre que les onguents conservent les cadavres. Or les cadavres n’ont aucun droit sur la vie, par définition. « Il y a plus urgent que la conservation d’une vie, si tant est qu’Orsenna vive encore. Il y a son salut. » Comme dans la parabole évangélique des talents, celui qui ne remet pas en jeu ce qu’il a reçu, celui qui ne risque rien, ne mérite rien. On ne peut faire fructifier quelque chose que l’on ne risque pas de perdre.
Au cœur du roman, le récit du lent éveil d’Orsenna face aux événements prend une dimension spirituelle lorsque Aldo assiste au sublime sermon d’une messe de Noël. C’est que Noël est la fête du « Roi qui apportait non la paix, mais l’épée », d’une lumière germant au cœur des ténèbres hivernales, de la naissance par excellence qui est le modèle de tout avènement : « Je vous apporte la nouvelle d’une ténébreuse naissance », clame le prêtre. Si le texte ne le dit pas explicitement, l’évocation de la Nativité vise bien les « invasions barbares » qui, du Farghestan, déferleront bientôt sur Orsenna, en ceci qu’elles ouvrent un nouveau cycle, une ère d’incertitude féconde : « En cette nuit d’attente et de tremblement, dit le prêtre, en cette nuit du monde la plus béante et la plus incertaine, je vous dénonce le Sommeil et je vous dénonce la Sécurité. »
La commémoration de la naissance du Christ est l’occasion de fustiger « la race de la porte close », « ceux qui tiennent que la terre a désormais son plein et sa suffisance », « les sentinelles de l’éternel Repos » prêtes à tout pour préserver le statu quo et sauvegarder ce qu’elles n’ont pas même acquis de leurs mains, mais dont elles n’ont fait qu’hériter. Or, comme l’écrit Ernst Jünger, ami de Gracq, dans Les Falaises de marbre, « l’héritage est la richesse des morts ». Et les morts s’opposent aux vivants, a fortiori aux naissances et à leur cortège de désagréments : « Il est des hommes pour qui c’est chose toujours mal venue que la naissance ; chose ruineuse et dérangeante, sang et cris, douleur et appauvrissement, un terrible remue-ménage – l’heure qu’on n’a point fixée, les projets qu’elle traverse, la fin du repos, les nuits blanches, toute une tornade de hasards autour d’une boîte minuscule. »
Et si la naissance doit apporter aussi la mort, si les têtes doivent fleurir au bout des piques, si l’ordre et la marche du monde doivent en être troublés, ainsi soit-il ! Car vient un moment où « tout vaut mieux que d’être ligoté vivant à un cadavre, tout soudain est préférable à se coller à cette chose condamnée qui sent la mort ». Outre que la naissance est « le Sens ». Quel sens ? Celui même de la vie.
[Vous pouvez vous procurer PHILITT #5 en cliquant sur ce lien.]






 En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »
En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. » Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.
Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.

 Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».
Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg









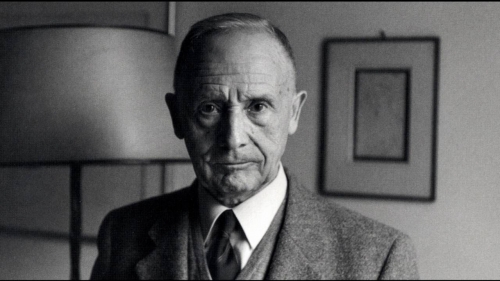



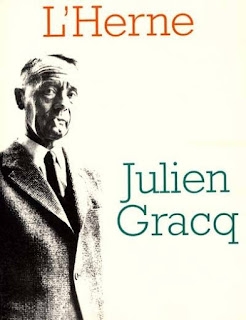 Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).
Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).