par Pierre Le Vigan,
auteur , essayiste
Ex: http://metamag.fr
♦ Pierre Le Vigan, est architecte, urbaniste, diplômé en psychopathologie et en histoire ; il est l’auteur de plusieurs livres et a participé à plusieurs ouvrages collectifs dont le Liber amicorum Alain de Benoist (2003 et 2014). Il a notamment publié «L’Effacement du politique / La philosophie politique et la genèse de l’impuissance de l’Europe».
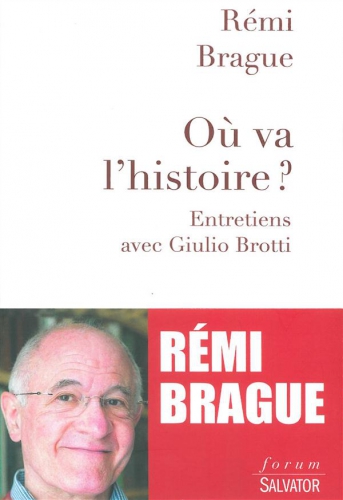 Il n’y a qu’une chose qui ne soit pas très pertinente dans le livre d’entretien du professeur Rémi Brague avec Giulio Brotti, c’est le titre. Il ne s’agit pas de savoir « où va l’histoire ». Car l’histoire n’est pas un véhicule, c’est le réseau même des routes possibles. C’est la carte. Il s’agit de savoir, non où va l’histoire, mais où va l’homme.
Il n’y a qu’une chose qui ne soit pas très pertinente dans le livre d’entretien du professeur Rémi Brague avec Giulio Brotti, c’est le titre. Il ne s’agit pas de savoir « où va l’histoire ». Car l’histoire n’est pas un véhicule, c’est le réseau même des routes possibles. C’est la carte. Il s’agit de savoir, non où va l’histoire, mais où va l’homme.
Il s’agit de savoir où nous allons, juchés sur le véhicule que nous avons-nous même construit, et sur lequel nous avons décidé de nous arrimer, et qui est la modernité. Une modernité « tardive », comme disait Friedrich Schiller, mais qui tarde en tout cas à se terminer. Elle se retourne sur elle-même pour mieux reprendre de l’élan, et ne cesse de détruire ses propres fondements : la croyance en l’homme, au progrès, en l’universalisme. La modernité, tardive ou hyper, est une machine en apparence folle. Mais est-elle si folle ? Elle a sa logique. Elle est en fait autophage.
Dans les lignes qui suivent, nous serons moins dans la digestion, c’est-à- dire la paraphrase, que dans l’inclusion, c’est à dire le commentaire, que Rémi Brague qualifie comme « le modèle européen de l’appropriation culturelle ».
L’entretien avec Rémi Brague porte sur l’esprit de notre temps. Il déroule la question : pouvons-nous continuer l’homme si nous ne croyons plus en l’homme ? En d’autres termes, si nous ne savons plus quelle est la place que nous avons à tenir sur terre, si nous ne croyons plus à notre part de responsabilité, si notre présence au monde ne relève plus que du ludique, à quoi bon poursuivre l’homme ? On objectera que, justement, les hommes sont de plus en plus nombreux. Mais l’humanité est par là même de plus en plus fragile, et de plus en plus menacée de perdre son humanité.
Il y a de plus en plus d’hommes ? Mais ne seront-ils pas de moins en moins humains ? On peut appeler cela « oubli de l’être ». Il ne s’agit pas d’un énième « c’était mieux avant » ou de quelque chose comme « l’oubli de son parapluie », comme dit plaisamment R. Brague. Il s’agit de l’oubli de ce que l’être peut manifester. De ce qu’il peut dévoiler. D’abord lui-même. La question est : qu’est-ce que nous avons oublié ? Et nous pouvons déjà avancer quelques éléments de réponse. Que l’historicité de l’homme n’est pas seulement le « tout passe ». Qu’il y a des permanences, celles que les religions et les philosophies explorent, chacune à leur façon.
Pour comprendre la place de l’homme dans le monde, il faut tenter de comprendre le sens de l’histoire humaine. « Le sens de l’histoire » est le titre d’un livre de Nicolas Berdiaev. Cela ne veut pas dire que l’histoire n’a qu’une direction mais cela signifie qu’elle n’est pas absurde, insensée. Il nous arrive ce qui nous ressemble. Comprendre le sens de l’histoire nécessite de comprendre l’histoire de la pensée. Rémi Brague souligne que nous avons longtemps sous-estimé intellectuellement le Moyen Age. Nous sommes passés des Antiques aux Renaissants, directement. Or, comprendre la pensée nécessite de comprendre le moment central du Moyen Age. Au moins dix siècles. Car, comme le remarquait Etienne Gilson, la Renaissance est toute entière dans la continuité du Moyen Age. C’est « le Moyen Age sans Dieu », disait encore Gilson. Ce qui, à la manière de Hegel, doit, du reste, être compris non comme un manque mais comme l’intégration d’une négativité.
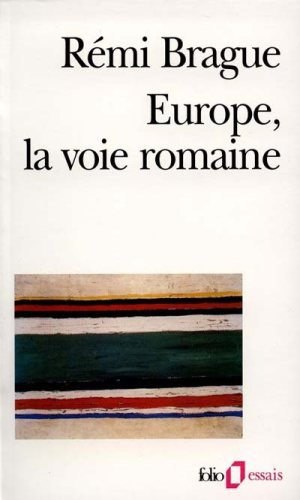 Justement, sans Dieu, comment fonder la morale ? « Que dois-je faire ? » s’interroge Rémi Brague à la suite de Kant. L’idée du « bien faisable », idée d’Aristote, suffit pour cela. Mais comment hisser les hommes au niveau nécessaire pour que l’humanité ait un sens ? En d’autres termes, la morale n’est pas qu’une question de pratique. Il est besoin de ce que Kant appelait une raison pure pratique. Sa forme moderne pourrait sans doute être définie comme une esthétique de la morale, telle qu’on la trouva chez Nietzsche, ou encore, très récemment, avec Dominique Venner.
Justement, sans Dieu, comment fonder la morale ? « Que dois-je faire ? » s’interroge Rémi Brague à la suite de Kant. L’idée du « bien faisable », idée d’Aristote, suffit pour cela. Mais comment hisser les hommes au niveau nécessaire pour que l’humanité ait un sens ? En d’autres termes, la morale n’est pas qu’une question de pratique. Il est besoin de ce que Kant appelait une raison pure pratique. Sa forme moderne pourrait sans doute être définie comme une esthétique de la morale, telle qu’on la trouva chez Nietzsche, ou encore, très récemment, avec Dominique Venner.
Pour cela, c’est l’idée platonicienne du Bien (difficile ici d’éviter la majuscule) qui est nécessaire. Cette idée du Bien rejoint celle du Vrai, du Beau et celle de l’Un : c’est la convertibilité des transcendances, expliquée par Philippe Le Chancelier et d’autres théologiens du Moyen Age. C’est leur équivalence, qui n’est pas leur identité mais est leur correspondance (l’analogie avec les correspondances de métro serait ici à la fois triviale et parfaitement adaptée). Le Bien, le Beau, le Vrai sont différentes formes d’une même hypostase, telle est l’idée néo-platonicienne que l’on trouve chez Flavius Saloustios, un des « intellectuels d’État » de Julien l’Apostat, le rénovateur du paganisme. N’ayant précisément pas eu lieu durablement, la restauration du paganisme laisse dissociés le beau, le vrai, le bien (ou encore le bon). D’où un malaise dans l’homme.
On rencontre parfois l’idée que la genèse de la modernité vient, avec Copernic, de la fin de la position centrale de l’homme. Ce n’est pourtant pas la même chose que la fin du géocentrisme et la fin de l’anthropocentrisme. Mais Brague soutient qu’il n’y a pas eu de fin de l’anthropocentrisme car il n’y avait pas d’anthropocentrisme. L’homme antique ne se voyait pas dans une position centrale, mais au sein d’un système du vivant. Voilà la thèse de Brague.
Est-ce si sûr ? « Mais que l’homme soit un animal politique à un plus haut degré qu’une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l’état grégaire, cela est évident. La nature en effet, selon nous, ne fait rien en vain, et l’homme de tous les animaux possède la parole. Or tandis que la voix sert à indiquer la joie et la peine, et appartient pour ce motif aux autres animaux également (car leur nature va jusqu’à éprouver les sensations de plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns aux autres), le discours sert à exprimer l’utile et le nuisible et, par suite aussi le juste et l’injuste. Car c’est le caractère propre de l’homme par rapport aux autres animaux, d’être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l’injuste, et des autres notions morales, et c’est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité » (Politiques I, 2).
A partir d’Aristote, n’y a-t- il pas anthropocentrisme même si l’homme n’est pas en surplomb, même s’il ne lui est pas demandé d’agir « comme maître et possesseur de la nature », comme régisseur du vivant, mais bien plutôt de le ménager, d’en prendre soin ? (le christianisme de François d’Assise ne sera d’ailleurs pas loin de cette vision). L’anthropocentrisme n’est pas la dévoration du monde par l’homme, tant que la modernité ne se déchaîne pas. Tant qu’elle reste « modérément moderne ».
Le contraire de l’anthropocentrisme, c’est l’homme dans le flux du vivant. Nous sommes d’ailleurs revenus à cela avec Michel Foucault et la fin de la sacralisation de l’homme et de sa centralité. Le paradoxe est que nous sommes dans une société du contrat au moment où notre sociologie et le structuralisme tardif nous expliquent que le sujet n’en est pas vraiment un et que, somme toute, l’homme n’existe pas mais est « agi » par des forces et structures qui le dépassent. Dès lors, nous quittons la modernité classique pour autre chose. Ce que met à mal la culture post-moderne (ne faudrait-il pas plutôt parler d’idéologie, terme nullement dépréciateur dureste ?) c’est, nous dit Rémi Brague, trois choses : l’historicité, la subjectivité de l’homme, la vérité.
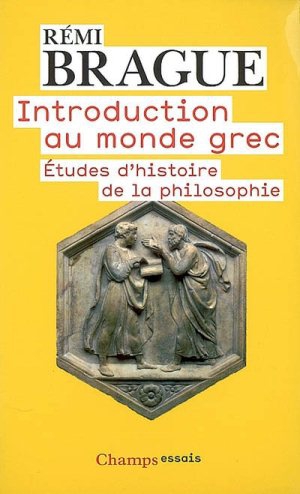 Nous avons aboli le monde vrai et la distinction entre vrai et faux, nous avons aboli le sujet et nous avons aboli le propre de l’homme qui est d’être un être historique. En d’autres termes, « l’homme est mort » – et pas seulement « Dieu est mort » (ce que Nietzsche constatait avec déploration, craignant que nous ne soyons pas à la hauteur du défi)). Dieu est mort et l’homme est mort. Et l’un est peut-être la conséquence de l’autre, suggèreRémi Brague. La sociobiologie a pris la place de l’histoire, la sociologie a pris la place du sujet (« les sciences humaines naturalisent l’histoire » explique Brague), la sophistique postmoderne a pris la place de la vérité, ou tout du moins de sa recherche. Les Anciens (on est Anciens jusqu’à la Révolution française, hantée elle-même par l’Antiquité) voulaient améliorer l’homme. Nous voulons maintenant le changer. Nous oscillons entre le rêve transhumaniste, qui n’est autre qu’un posthumanisme, et une postmodernité liquide qui relève d’un pur vitalisme dont l’une des formes fut, disons-le sans tomber dans le point Godwin ou reductio ad hitlerum, le national-socialisme. ( comme le montre très bien la confrontation des textes de Werner Best, doctrinaire nazi du droit, et de Carl Schmitt, in Carl Schmitt, Guerre discriminatoire et logique des grands espaces, éditions Krisis, 2011, préface de Danilo Zolo, notes et commentaires de Günter Maschke, traduction de François Poncet. On y voit que Best critique Schmitt au nom d’un vitalisme que Schmitt refuse d’adopter. Dont acte. Face à ce double risque de liquéfaction ou de fuite en avant transhumaniste, Rémi Brague rappelle le besoin de fondements qui nomme métaphysiques mais qui ne viennent pas forcément « après » la physique, dans la mesure où ils donnent sens àl’horizon même du monde physique. Rémi Brague appelle cela des « ancres dans le ciel » (titre d’un de ses précédents ouvrages).
Nous avons aboli le monde vrai et la distinction entre vrai et faux, nous avons aboli le sujet et nous avons aboli le propre de l’homme qui est d’être un être historique. En d’autres termes, « l’homme est mort » – et pas seulement « Dieu est mort » (ce que Nietzsche constatait avec déploration, craignant que nous ne soyons pas à la hauteur du défi)). Dieu est mort et l’homme est mort. Et l’un est peut-être la conséquence de l’autre, suggèreRémi Brague. La sociobiologie a pris la place de l’histoire, la sociologie a pris la place du sujet (« les sciences humaines naturalisent l’histoire » explique Brague), la sophistique postmoderne a pris la place de la vérité, ou tout du moins de sa recherche. Les Anciens (on est Anciens jusqu’à la Révolution française, hantée elle-même par l’Antiquité) voulaient améliorer l’homme. Nous voulons maintenant le changer. Nous oscillons entre le rêve transhumaniste, qui n’est autre qu’un posthumanisme, et une postmodernité liquide qui relève d’un pur vitalisme dont l’une des formes fut, disons-le sans tomber dans le point Godwin ou reductio ad hitlerum, le national-socialisme. ( comme le montre très bien la confrontation des textes de Werner Best, doctrinaire nazi du droit, et de Carl Schmitt, in Carl Schmitt, Guerre discriminatoire et logique des grands espaces, éditions Krisis, 2011, préface de Danilo Zolo, notes et commentaires de Günter Maschke, traduction de François Poncet. On y voit que Best critique Schmitt au nom d’un vitalisme que Schmitt refuse d’adopter. Dont acte. Face à ce double risque de liquéfaction ou de fuite en avant transhumaniste, Rémi Brague rappelle le besoin de fondements qui nomme métaphysiques mais qui ne viennent pas forcément « après » la physique, dans la mesure où ils donnent sens àl’horizon même du monde physique. Rémi Brague appelle cela des « ancres dans le ciel » (titre d’un de ses précédents ouvrages).
L’image est belle. Elle contient par la même une vérité. Elle va au-delà de la révélation chrétienne, qui peut sans doute en être une des formes. Mais certainement pas la seule. Heidegger parlait de « marcher à l’étoile ». Une autre façon d’avoir une ancre dans le ciel.
Rémi Brague, Où va l’histoire ? Entretiens avec Giulio Brotti, éditions Salvator, 184 pages, 20 €



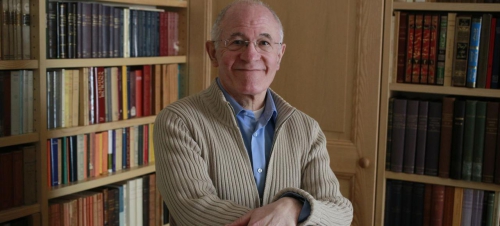

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg