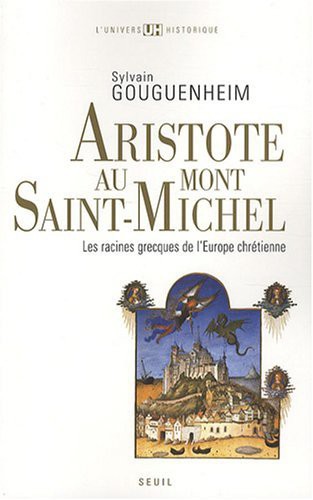Le médiéviste qui créa la polémique il y a quelques années livre en cette rentrée une biographie érudite de l’empereur Frédéric II de (Hohen)Staufen qui régna sur une grande partie de l’Europe de la première moitié du XIIIe siècle mais qui connut de douloureuses dernières années. Alors qu’il collectionnait les fiefs, les honneurs et les couronnes, il finit isolé à la suite de son affrontement avec une papauté. Celle-ci ne pouvait accepter une prééminence temporelle sur la Chrétienté. La défaite de Frédéric II détermine l’abaissement du rêve de restauration de l’Empire romain qui dominait jusque-là. Le portrait dressé, d’une très bonne tenue, néglige cependant quelques pistes.
Frédéric, acteur clé du Moyen Age européen
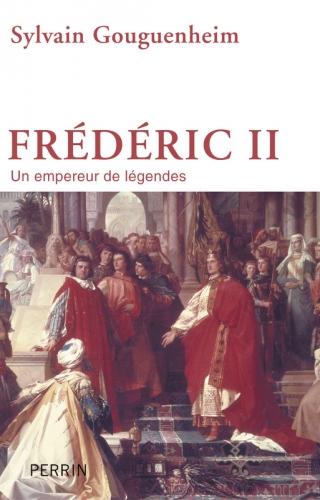
Quels sont les grands mouvements du règne qui s’étend donc jusqu’à sa mort en 1250 ? Le jeune roi s’impose d’abord face à la guerre féodale permanente (les faides) qui domine pendant la régence de sa mère (années 1200). Les années 1210 sont consacrées à la prise en main du Saint-Empire romain germanique : en s’appuyant sur les clans princiers, les réseaux ecclésiastiques et les oppositions royales, il fait destituer Otton IV, il est élu roi de Germanie avant de devenir empereur. Pour cela il sait bénéficier de la défaite que la France inflige à Otton IV à Bouvines et d’un apaisement de ses relations avec la papauté. Sans elle, il ne peut être sacré. Il ne cesse donc de donner des gages à Rome : il laisse le pape nommer des évêques, il lâche des libertés ou feint de les lâcher à l’égard des villes d’Italie du Nord, il promet surtout de partir en croisade pour reprendre Jérusalem récemment intégrée au royaume de Saladin. Les années 1220 sont celles d’une prise en main toute relative de l’Empire. Si l’héritier Staufen restaure les châteaux et l’autorité dynastique sur ses fiefs, s’il sait s’allier de nouveaux domaines en donnant des libertés à tel prince ecclésiastique, tel prince laïc ou telle ville, il ne peut jamais centraliser un Empire s’étendant du royaume d’Arles jusqu’à la Baltique et le duché d’Autriche. Que retenir de cette décennie passée dans l’Empire et de son retour à la fin des années 1230, période à laquelle il réduit la révolte de son premier fils Henri VII qu’il avait fait nommer successeur ? Au fond, Gouguenheim le rappelle, Frédéric II gouverne en dispensant des bienfaits avec contreparties, il ne peut jamais imposer une centralisation dans un ensemble fédéral traversé par des intérêts bien trop nombreux et divergents. Même l’élection d’un autre de ses fils Conrad IV comme « roi des Romains et futur empereur » en 1237 par les princes électeurs ne peut faire croire à une réelle instauration d’hérédité. Il innove donc peu dans sa gestion de l’Empire et doit se contenter de réprimer les révoltes (villes, fils rebelle…), disposant de trop peu de ressources pour dominer complètement. Il faut dire que toute sa vie, une part de ces mêmes ressources, essentiellement tirées de son royaume de Sicile, servent tantôt à ménager, tantôt à affronter une papauté irrémédiablement opposée à lui. Cette dernière ira jusqu’à l’excommunier une première fois puis surtout le déposer en 1245, déterminant de sombres dernières années pour son règne, même si elle ne l’a jamais vaincu militairement.
Entre temps, et l’auteur insiste sur ce point, Frédéric II passe de nombreuses années en son royaume du Sud de l’Europe où il peut bénéficier d’une centralisation ancienne. En cela il est héritier des Normands et des Byzantins. Sa « méthode de gouvernement » s’en inspire nettement : dignité royale – impériale reprenant la pompe byzantine (il est basileus dans les tenues comme dans le monnayage), nomination et contrôle régulier des gouverneurs de districts rigoureusement découpés, extension d’un système de mise en valeur rationnel de la campagne et de ses richesses (la massarie)… Surtout, il participe de la remise en ordre et de la rationalisation d’un système juridique jusqu’alors encore féodal. Cette remise en ordre incarnée par le Liber Augustalis du début des années 1230 est un effort de mise en cohérence des droits existants (avec des traces normandes) avec la renaissance du droit romain, notamment développé par le Studium de Naples, véritable « université royale » destinée à former les fonctionnaires du pouvoir. Cependant, ces efforts ne pourront être pleinement aboutis, la fin des années 1230 et surtout les années 1240 voyant les affrontements se multiplier entre l’Empereur proclamant clairement une recherche de souveraineté universelle et la papauté, aidée pour l’occasion par tout ce qui pouvait l’abattre. Rappelons qu’entre temps, à la fin des années 1220, après avoir ajourné longtemps celle-ci, Frédéric II partit en croisade car il était devenu roi de Jérusalem par mariage, ville et lambeau de royaume qu’il obtient non par l’affrontement mais par la négociation avec les arabes, summum de l’opprobre pour un croisé !
Au final Gouguenheim insiste très clairement sur le fait que l’empereur a bénéficié des forces de son royaume du Sud mais ne pouvait que les épuiser pour tenter de gouverner le Nord et contenir le Centre (Italie du Nord, papauté). Son empire si vaste, depuis Gand jusqu’à la Baltique et Jérusalem qu’il n’a au final jamais commandée, ne pouvait se maintenir après sa mort. Effectivement, la désagrégation intervient rapidement : les papes et leurs alliés éliminent ses héritiers, les Anjous venus de France prennent le royaume de Naples et la Sicile et l’Empire échoit, après un « grand interrègne » causé par ce vide dynastique, à des nouveaux venus, les Habsbourg.
Le choix d’une biographie « impressionniste »
La biographie n’est pas pleinement classique en ce qu’elle n’est pas entièrement chronologique. Divisée en quatre parties, la première est une sorte de résumé politique de l’œuvre de Frédéric II. Ensuite, on s’attache à ce qui serait une « pensée politique » que l’auteur a du mal à résumer clairement. Plus évident est le regard porté sur les constructions durables que l’empereur a suscitées. La dernière partie revient, à tous les moments de son existence, sur les représentations du personnage et sur son écho dans les siècles suivants.
L’avantage de cette construction est assez évident. On peut, comme dans le cadre d’articles précis, voire une question bien détaillée. L’auteur insiste beaucoup, en se positionnant notamment par rapport aux écrits de Kantorowicz, sur la politique de l’image développée : elle passe par des représentations idéalisées sur les documents impériaux et royaux, elle s’affiche sur les bulles mais aussi jusque dans le paysage urbain et rural avec de nombreuses forteresses qui viennent ponctuer les routes du royaume de Sicile. L’exemple le plus éclatant en est le Castel del Monte, château octogonal incongru entièrement voulu par le roi et dans lequel il ne séjourna pas réellement. Ce château est un peu à Frédéric II ce que Chambord fut à François Ier, un rêve de sa personne et de sa monarchie. Autre exemple, la Porte de Capoue, détruite par le vandalisme révolutionnaire des Français en 1799. Cet édifice reprenait les modèles de l’Empire constantinien et affirmaient d’une part la place de l’Empereur comme souverain à prétention universelle, d’autre part la place incontournable de la justice dans le royaume et enfin la Chrétienté de l’ensemble. Une forme de trinité… Si on appuie ceci sur le système de l’Aquinate, on peut penser que cette porte était un véritable manifeste politique, d’ailleurs un pendant à opposer à celui des libertés municipales mis en images un peu plus tard par la Commune de Sienne (Patrick Boucheron y consacra récemment l’ouvrage Conjurer la peur).

Mais cette démarche par touches pour permettre de saisir le personnage pose parfois problème. Plusieurs événements sont abordés à plusieurs reprises sans qu’on en saisisse vraiment la portée parce qu’ils ne sont qu’un contexte pour la démonstration du passage. Ainsi la bataille de Cortenuova et la place de Milan, le rapport aux voisins (la France de Louis IX et la Hongrie surtout)… ne sont jamais pleinement convoqués alors qu’ils sont des aspects importants pour comprendre l’évolution du règne. En même temps et sur d’autres points, cette démarche force à des répétitions, particulièrement sur l’affrontement avec la papauté (il est difficile pour celui qui connaît mal la période de remettre en perspective celui-ci et de comprendre son évolution). La querelle des investitures (des ecclésiastiques) peut donc être mal comprise de même que le plus important au fond, la bataille pour la prééminence sur la Chrétienté entre Frédéric (Hohen)Staufen et le pape Grégoire notamment. Plusieurs aspects ont donc rendus difficiles d’approche par cette démarche non chronologique.
Un dernier regret peut être formulé et découle sans doute de cette construction. La remise en perspective n’est pas toujours évidente. L’auteur discute des aspects importants de la figure de Frédéric II : c’est un roi qui cherche une première modernisation par rationalisation du droit, il fixe des règles sur les représentations du pouvoir, il dispose d’un premier corps de fonctionnaires dévoués et non ecclésiastiques, il affronte la papauté mais en même temps ne cesse de s’attribuer une dimension religieuse. Sur tous ces plans on pourrait le comparer aux autres souverains du temps, particulièrement à la France capétienne de Saint-Louis ou de Philippe Auguste et Philippe Le Bel : les mêmes traits sont attribuables à leur règne. Un simple exemple : Pierre de la Vigne, logothète de Frédéric II est bien comparable aux légistes de France (dont Guillaume de Nogaret)… Pourquoi ne pas avoir cherché à montrer, parmi ces traits communs aux souverains d’Occident, ce qui distinguait (ou pas) Frédéric II ?
La fin des polémiques
 Paradoxalement, enfin, la biographie de ce personnage plus que controversé du Moyen Age est assez détachée des polémiques qui ont ponctué les publications de Sylvain Gouguenheim. En effet l’universitaire avait suscité des clivages particulièrement violents à l’occasion de son Aristote au mont Saint-Michel il y a quelques années. Sur les rapports de Frédéric II au monde arabe, l’auteur semble avancer à pas de loup. Il faut dire qu’il avait fait débat comme l’objet de son livre… Frédéric fut en effet voué aux gémonies par ses contemporains pour avoir obtenu par la négociation et non par le combat la souveraineté sur quelques parcelles des Etats latins perdus quelques années auparavant. Il a en effet obtenu par le traité de Jaffa quelques places, mais rien de bien viable pour maintenir durablement la présence croisée au Levant. Effectivement, les Etats latins ne durèrent pas. Sur les rapports savants, intellectuels qui étaient au cœur de ses précédentes réflexions sur la Renaissance des idées en Occident, l’auteur conclue en s’appuyant sur la faiblesse des sources sur le fait qu’il a pu y avoir influence, mais que celle-ci est difficilement quantifiable. On se reportera au récent ouvrage qui pourra renseigner précisément sur quelques aspects de la Sicile comme plaque tournante des échanges culturels entre Nord et Sud de la Méditerranée (Héritages arabo-islamiques dans l’Europe méditerranéenne), l’auteur se concentrant uniquement sur la ville de Lucera, cas inédit d’une population musulmane concentrée en une ville pouvant demeurer musulmane au cœur même de l’Italie chrétienne.
Paradoxalement, enfin, la biographie de ce personnage plus que controversé du Moyen Age est assez détachée des polémiques qui ont ponctué les publications de Sylvain Gouguenheim. En effet l’universitaire avait suscité des clivages particulièrement violents à l’occasion de son Aristote au mont Saint-Michel il y a quelques années. Sur les rapports de Frédéric II au monde arabe, l’auteur semble avancer à pas de loup. Il faut dire qu’il avait fait débat comme l’objet de son livre… Frédéric fut en effet voué aux gémonies par ses contemporains pour avoir obtenu par la négociation et non par le combat la souveraineté sur quelques parcelles des Etats latins perdus quelques années auparavant. Il a en effet obtenu par le traité de Jaffa quelques places, mais rien de bien viable pour maintenir durablement la présence croisée au Levant. Effectivement, les Etats latins ne durèrent pas. Sur les rapports savants, intellectuels qui étaient au cœur de ses précédentes réflexions sur la Renaissance des idées en Occident, l’auteur conclue en s’appuyant sur la faiblesse des sources sur le fait qu’il a pu y avoir influence, mais que celle-ci est difficilement quantifiable. On se reportera au récent ouvrage qui pourra renseigner précisément sur quelques aspects de la Sicile comme plaque tournante des échanges culturels entre Nord et Sud de la Méditerranée (Héritages arabo-islamiques dans l’Europe méditerranéenne), l’auteur se concentrant uniquement sur la ville de Lucera, cas inédit d’une population musulmane concentrée en une ville pouvant demeurer musulmane au cœur même de l’Italie chrétienne.
Enfin, pour comprendre cette biographie de Frédéric II, il nous semble utile de noter le rapport ambigu de l’auteur à Ernst Kantorowicz qui écrivit une des plus impressionnantes biographies de l’empereur en 1927 (un deuxième tome fut publié, mentionnant les sources, en 1932). A de très nombreuses reprises l’auteur s’y réfère, se positionne dans sa lignée (le plus souvent), mais il ne consacre plusieurs pages à Kantorowicz et à son rapport au personnage et à la biographie expliquée dans son contexte qu’en fin d’ouvrage. Gouguenheim aurait pu faire apparaître ces pages en début d’ouvrage tant l’ombre du grand penseur s’impose au fil des pages… On peut cependant concevoir le choix définitif de l’étudier avec les échos historiographiques de Frédéric II. Ce dernier fut en effet convoqué pendant des siècles comme épouvantail (pour les néo-guelfes, nationalistes italiens ou allemands…) ou modèle (autres nationalistes allemands partisans d’un fédéralisme dans un GrossDeutschland, opposants au pouvoir pontifical…). Il n’en reste pas moins que domine longtemps une image négative, celle du renégat qui tenta de se faire plus puissant que le pape.
L’ouvrage, s’il souffre parfois de redites et d’absence de contextualisation, reste une biographie qui fera date d’un spécialiste des sources du Moyen Age, qui les utilise abondamment et à bon escient. Frédéric II y apparaît comme celui qui chercha avec pragmatisme mais détermination à mettre en place une relative centralisation sur un espace trop vaste pour ses ressources. Il se heurte à une papauté encore centrale dans le jeu européen mais préfigure déjà l’Europe des Etats et des frontières.
Sylvain Gouguenheim, Frédéric II, un empereur de légendes , Perrin , Août 2015, 428 p. 24 euros





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg